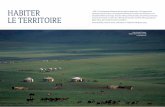Le village rubané - Rangées de maisons et espaces vierges ouvrent de nouvelles perspectives sur le...
Transcript of Le village rubané - Rangées de maisons et espaces vierges ouvrent de nouvelles perspectives sur le...
35
o l i v e r r ü c k
Le viLLage rubané:
rangées de maisons et espaces vierges
ouvrent de nouveLLes perspectives
sur Le déveLoppement et L’organisation
de L’habitat
Les plans de sites constituent la base de nos inter-prétations sur le développement et la structure des villages. Si l’on applique au Rubané l’idée de “la diversité dans l’uniformité”, telle que Modderman l’a définie en 1988, on peut alors se demander si le plan et l’agencement des sites d’habitat partagent un schéma de base commun, avec des caractéristiques différenciées selon les régions et si le plan d’organisation des sites se modifie au fil du temps. Aucune approche, purement inductive ou purement déductive, ne permettra de répondre à ces questions. Seule une analyse comparative et différenciée de nombreux plans de sites d’habitat permettrait d’identifier les éléments communs et distincts dans la genèse des implantations.
Dans ce but, la comparaison des plans montre que la structure d’une occupation offre plus de traçabilité pour des sites d’une ou deux douzaines de bâtiments, ou avec quelques recoupements de plans de maisons, contrairement aux grands sites à longue durée d’oc-cupation, comme Köln-Lindenthal (Rhénanie; Buttler & Haberey, 1936), Langweiler 8 (Rhénanie; Boelicke et al., 1988) ou Bylany (République Tchèque; Pavlu, 2000). Dans ce genre d’habitats denses, l’organisation spatiale est le résultat de plusieurs décennies, voire de siècles, d’occupation continue ou du retour sur le site après une interruption. Des plans confus, avec de nombreuses traces de chevauchement de maisons, résultent de cette occupation intensive. Lorsque “la régularité ori-ginelle d’un site [est] embrouillée au-delà de toute identification par les constructions ultérieures […]” (Lienau, 2000: 66), celui-ci ne convient que partiellement à une modélisation d’implantation. Néanmoins, en supprimant – virtuellement – les plans des maisons postérieures, recouvrant en partie les plus anciennes, il est parfois possible d’extraire l’agencement initial de l’habitat. Dans d’autres cas, il s’agit d’une phase déterminée ou de la fin de l’occupation.
une analyse préliminaire de nombreux plans de sites a déjà montré que certaines caractéristiques structurelles
sont répétitives, tant au niveau du plan des habitations individuelles que de l’agencement spatial des maisons entre elles. Ces résultats sont présentés ici.
observation 1en général, les plans de sites rubanés permettent toujours d’isoler des plans de maisons adjacentes, plus ou moins parallèles entre elles (e.a. Cuiry-lès-Chaudardes, Coudart, 1998; Frimmersdorf 141, Weiner et al., 2010; Remicourt – “Fond de Momalle” III, Fock et al., 1998; ulm-eggingen, Kind, 1989 ou vaihingen an der enz, Krause, 1998; fig. 23-24).
Fig. 23 – Remicourt – “Fond de Momalle”
(Hesbaye, Belgique). Les plans des maisons
sont disposés en parallèle, décalés, formant une
rangée incurvée. D’après Fock et al.,
1998: 124, fig. 2.
plan général de la fouille
catalogue 03_INT_20110929.indd 35 29/09/11 12:48
36 _ Des faits
observation 2Plusieurs sites présentent des bâtiments, généralement adjacents, dont les pignons sud, sud-est ou est sont alignés ou presque (< 3 m), suggérant l’existence d’une ligne de base commune. en supposant que les habitats voisins forment une unité spatiale, il paraît difficile de dénigrer cette référence commune. De nombreux exemples existent: Frimmersdorf 141 (Rhénanie), vaihingen an der enz (Bade-Wurtemberg), Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne), Poses – “Sur la Mare” (eure; Bostyn & Lanchon, 2007), le tell quasi contemporain d’okolište (Bosnie centrale; Müller-Scheeßel et al., 2009) ou Füzesabony-Gubakút (Hongrie nord-orientale; Domboróczki, 2001; fig. 24, 25 et 26a).
observation 3Mis à part cet alignement rectilinéaire des pignons, fréquemment observé, d’autres modèles d’arrangement récurrents, régionaux et interrégionaux, ont été observés: entre autres, des plans d’habitat où les pignons sont disposés selon une courbe (fig. 26b et 26c). Pour ce type de disposition, l’agencement des maisons, en escalier (fig. 26b) ou en éventail (fig. 26c), crée une sorte de place bordée par les différentes constructions (comme par exemple à Schwanfeld (Bavière; Lüning, 2011), Bylany, Merzenich (Rhénanie du Nord-Wesphalie; Cziesla, sous presse), Remicourt – “Fond de Momalle” III, Poses – “Sur la Mare”, Karo Batak-village (Sumatra; Fraser, 1968)1.
Fig. 24 – Frimmersdorf 141 – “Jüchen-Garzweiler” (Rhénanie, Allemagne). L’organisation spatiale des maisons en rangées parallèles est bien visible. La forme et la taille de l’enceinte représentent probablement les limites du village à un moment donné.D’après Weiner et al., 2010: 60, fig. 2.
Fig. 25 – Poses – “Sur la Mare” (eure, France). Site du Groupe de villeneuve-Saint-Germain. Deux dispositions différentes de rangées sont visibles: la rangée occidentale avec des maisons parallèles et décalées en escalier et la rangée orientale partiellement radiaire, avec des pignons alignés. D’après Bostyn & Lanchon, 2007: 211, fig. 1.
Fig. 26 – Schéma des dispositions existantes de maisons. a. Parallèle, droit; b. Parallèle, décalé; c. Radiaire.
a.
b.
c.
catalogue 03_INT_20110929.indd 36 29/09/11 12:48
37
on notera que la place ainsi créée est virtuellement vierge de structures, ou en affiche une très faible densité, non observée dans les autres parties du site (cf. Schwanfeld, Merzenich et Bylany).
Pour les plans de maisons disposés selon une courbe, deux variantes existent: bâtiments parallèles (fig. 26b, cf. Remicourt, Schwanfeld ou Bylany) ou disposition radiaire (fig. 26c; cf. Poses – “Sur la Mare”, Merzenich, Füzesabony-Gubakút ou Hienheim; fig. 25 et 27). Dans le cas de la disposition radiaire, les maisons sont probablement orientées vers un point de référence commun. Ce pourrait être une aire d’activité commune, un objet non conservé (par exemple un totem, un autel…) ou encore un bâtiment particulier (cf. Fraser, 1968: fig. 37), comme le propose Cziesla (sous presse) pour le site de Merzenich. Les organisations spatiales de sites d’habitat décrites ici impliquent que les maisons concernées étaient contemporaines pendant une assez longue durée.
observation 4en général, les plans des petits sites montrent peu de recouvrements de bâtiments, contrairement aux sites importants à longue durée d’occupation, ou réoccupés après un hiatus ou un déplacement. Dans ce contexte, une “occupation du Néolithique moyen” suit au même endroit, comme par exemple à Schwanfeld, Harting-Nord, Weisweiler 111 (Rhénanie du Nord-Westphalie) et sur d’autres sites (Rück, 2007). Les bâtiments attribués au Néolithique moyen côtoient parfois les maisons rubanées, souvent sans recouper les anciennes structures. Cela indiquerait soit que les zones occupées au Rubané étaient encore utilisées, soit que les anciennes maisons étaient encore visibles (sous quelque forme que ce soit).
Les plans de sites du Rubané récent et du Groupe de Blicquy/villeneuve-Saint-Germain en France et en Belgique présentent moins de recouvrements de maisons que dans d’autres régions. Le taux de recoupement est faible dans les grands sites d’habitat rubanés des Pays-Bas (Rück, 2007: 145), par exemple 16 % à elsloo (Modderman, 1985: Beilage 2), 8,6 % à Geleen-Janskamperveld (Kooijmans et al., 2003: 376, fig. 2). Les raisons peuvent être multiples: l’installation initiale d’une large communauté nécessitant la construction simultanée de plusieurs maisons voisines ou celle de plusieurs rangées de maisons. La durée d’existence de tels villages pourrait être de moins de 100 ans, ne nécessitant pas de construire sur d’anciens emplacements de maisons.
observation 5La présence d’une zone vierge de structures, le long du côté sud ou sud-est des maisons, est une caractéristique de tous les sites d’habitat. Cet espace était probablement occupé par un élément architectural directement accolé à la maison, telle une terrasse exposée au soleil (Rück, 2009). Cette solution est confortée entre autres par la découverte de trous de poteaux formant un prolongement des alignements longitudinaux internes
site2 orientation des bâtiments Alignement
parallèle radiaire rectiligneen
escalier courbe
Füzesabony-GubakútBylany sekce A
Hienheim
Harting-Nord 3
SchwanfeldUlm-Eggingen4 Vaihingen an der Enz
Merzenich
Frimmersdorf 141Remicourt – “Fond de Momalle” 5
Cuiry-lès-Chaudardes
Vignely –“La Porte aux Bergers”
Poses –“Sur la Mare”
1 en général, les agencements observés ne s’appliquent pas nécessairement à tous les bâtiments d’un site, ni à toute sa durée d’occupation; on les observe plutôt pour une partie des maisons qui étaient probablement contemporaines pendant un temps donné.
2 Dans l’ordre du tableau: Domboróczki, 2001; Pavlu, 2000; Moderman, 1977; Herren, 2003; Lüning, 2011; Kind, 1989; Krause, 1998; Cziesla, sous presse; Weiner et al., 2010; Fock et al., 1998; Coudart, 1998; Bedault, 2009; Bostyn & Lanchon, 2007.
3 à Harting-Nord, comme dans plusieurs autres sites du Néolithique moyen, on observe la formation de paires de maisons.
4 Les pignons de maisons sont orientés en oblique par rapport à une ligne de base droite.
5 Forme de transition entre une forme régulière en escalier et une forme incurvée de rangées.
Fig. 27 – Les sites repris dans ce tableau illustrent des variantes régionales d’orientation des plans et de disposition des rangées. Les plans examinés montrent des rangées plus
incurvées dans la partie orientale du monde rubané que dans la partie occidentale. De la même manière, les rangées de la sphère occidentale paraissent plus fréquemment en escalier.
Au centre du territoire rubané, les rangées sont plus souvent rectilignes. Il reste néanmoins que ces observations sont partielles. Des différences apparaissent
clairement dans certains cas (par exemple à Poses –“Sur la Mare”).
catalogue 03_INT_20110929.indd 37 29/09/11 12:48
38 _ Des faits
(cf. Cuiry-lès-Chaudardes). Les fosses qui évitent ces endroits constituent un argument supplémentaire à la thèse d’un espace couvert: elles sont toujours éloignées, à distance régu lière, du pignon sud, sud-est ou est de la maison (cf. elsloo). Des différences régionales existent aussi dans ce cas.
Le modèle en rangéeL’analyse de nombreux plans d’habitat montre claire-ment que différentes variantes d’un espace structuré apparaissent de façon récurrente (fig. 23-26 et 28). un élément commun, visible dans la majorité des sites, est l’agencement des maisons en rangées. Le choix du terme “rangée” est délibéré, car il se réfère à la terminologie utilisée en géographie des habitats (Lienau, 2000) et peut être différencié du concept moderne de lotissement à maisons mitoyennes (le village-rue) et d’une notion limitée sur la taille et la structure familliales. Par ailleurs, le terme “rang” n’est pas approprié: sur certains plans de site, comme à elsloo ou à Langweiler 8, des maisons sont “alignées” les unes derrière les autres – une observation qui mériterait d’être approfondie.
Les rangées de maisons peuvent adopter diverses formes: droite, en escalier ou courbe. Différentes formes de rangées peuvent exister au sein d’un même site (cf. Hienheim, Merzenich, Poses – “Sur la Mare”, Cuiry-lès-Chaudardes; fig. 25). Des recherches complémentaires seront nécessaires pour définir si cette variété est liée à la chronologie ou si les causes sont topographiques et/ou socioculturelles. La distance entre rangées varie de moins d’une longueur à deux longueurs de maison (fig. 23-25 et 28)6. Le nombre de rangées dépend proba blement de la taille et de la durée du site d’habitat, voire de sa situation topographique7. Les espaces créés entre les différents types de rangées peuvent servir de voies de circulation ou de places de villages.
Fig. 28 – vignely – “La Porte aux Bergers” (Seine-et-Marne, France). Site du Groupe de villeneuve-Saint-Germain. Les maisons sont partiellement appariées, ont des pignons toujours alignés et forment des rangées parallèles en escalier. D’après Bedault, 2009:113, fig. 2.
6 Cette observation dépend de la longueur moyenne d’une maison d’un site à l’autre. L’intervalle entre les rangées de maisons peut varier, selon les sites, de 25 à 50 m. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour déterminer si les rangées du site de Poses – “Sur la Mare”, très éloignées les unes des autres et de morphologie différente, sont réellement contemporaines.
7 et probablement aussi de la topographie locale. Ainsi, dans le cas de rangées plus longues, l’orientation des maisons du bout de la rangée peut changer en fonction de facteurs géomorphologiques.
catalogue 03_INT_20110929.indd 38 29/09/11 12:48
39
Toutes les rangées d’un site n’étaient pas nécessairement occupées en même temps. De même, toutes les maisons d’une rangée n’ont pas nécessairement existé simultanément. Toutefois, c’est une possibilité, surtout en l’absence de recoupement de plans de maisons. De plus, la régularité, souvent attestée, de l’espacement entre les maisons d’une même rangée corrobore la construction planifiée et simultanée des premières maisons, comme à Schwanfeld, vaihingen an der enz, Poses – “Sur la Mare”, Remicourt – “Fond de Momalle” III ou Füzesabony-Gubakút. L’apparence d’une rangée de maisons changeait probablement avec le temps: de nouvelles maisons venaient s’ajouter, de plus vieilles se délabraient ou étaient recouvertes par un nouveau bâtiment. en conclusion, on peut reconstituer un plan d’occupation à rangées de maisons pour la plupart des sites, même quand le plan d’installation initial est masqué par une intense activité d’occupation et par le recoupement des structures.
Jusqu’à présent, les sites d’habitat rubanés n’ont pas été analysés de manière systématique sous l’angle de l’organisation spatiale en rangée. Ceci s’explique par l’histoire de la recherche: le modèle à place principale (Hofplatzmodell) occupait une position dominante et une alternative ne semblait pas nécessaire, du moins pas en Rhénanie (Rück, à paraître [2011]). Toutefois, ces dernières années ont révélé un nombre croissant de plans de sites avec un agencement en rangées.
Domboróczki (2001), par exemple, a décrit la disposition de maisons en rangées dans la culture d’Alföld. Partant du constat que les grandes fosses du site de Füzesabony-Gubakút, dans le nord-est de la Hongrie, étaient disposées en rangées, séparées de 8 m à 10 m, il est arrivé à la conclusion suivante pour la configuration des habitats: “Le résultat le plus important des fouilles de Füzesabony-Gubakút est la reconnaissance de l’organisation spatiale pour l’Alföld. L’habitat était organisé en quatre rangées parallèles, avec deux rangées de part et d’autre d’un ancien lit de rivière. Les rangées étaient constituées de maisons et de fosses détritiques” (Domboróczki, 2001: 202).
à Schwanfeld, l’organisation des bâtiments montre également “un agencement planifié en deux, voire trois, rangées, c’est-à-dire que tous les bâtiments retrouvés sont alignés et orientés selon un ou deux chemins […]. Ce fait, ainsi que l’absence de recoupements avec les structures
rubanées les plus anciennes, montre que les maisons existantes ont été prises en compte pour l’édification des nouvelles. Par contre, il s’agit de sites enclos à durée de vie courte. Pour des périodes préhistoriques plus récentes, on n’hésiterait pas à envisager une planification spatiale du village et à affirmer la contemporanéité de tous les bâtiments” (Stauble, 2005: 202 et sv.). une quatrième rangée a été détectée par prospection géomagnétique (cf. Lüning, 2005: 51, fig. 3). La contemporanéité des habitations dans une ou plusieurs rangées est l’argument le moins bien étayé, car l’analyse des correspondances, effectuée sur la décoration de la céramique, n’arrive pas à séquencer les constructions. Sur la base des données pour la céramique du Rubané le plus ancien, “ni l’utilisation des dégraissants ni la décoration [...] ne permettent d’établir une succession chronologique des maisons à Schwanfeld” (Cladders, 2001: 80).
un troisième exemple est le site de Frimmersdorf 141, pour lequel seul un petit plan a été publié jusqu’à présent (fig. 24; Weiner et al., 2010). Ce plan de village, avec au moins neuf rangées de maisons, montre très clairement comment, avec un allongement de la durée de l’occupation, un agencement régulier, organisé, peut donner un plan de site qui, si l’occupation s’était encore prolongée, aurait ressemblé à Langweiler 8, Köln-Lindenthal ou Kückhoven (Lehmann, 2004).
quoi qu’il en soit, la régularité avec laquelle on retrouve des agencements de sites particuliers montre clairement qu’il faut se baser sur l’hypothèse de villages planifiés avec des agencements spécifiques8 et une structure interne définie de chemins et de places. Sur cette base, on peut prouver l’apparition d’une structure villageoise (Lienau, 2000: 61 et sv.) en europe centrale dès la fin du 6e millénaire. Même à ce stade de la recherche, des différences régionales sont déjà perceptibles. on peut ainsi mentionner l’agencement des maisons en escalier au sein d’une rangée dans les régions les plus occidentales du Rubané, comme à Poses – “Sur la Mare”, vignely – “La Porte aux Bergers”, Cuiry-lès-Chaudardes ou Remicourt – “Fond de Momalle” III (fig. 27). une autre particularité, en rapport avec la morphologie des plans de maisons dans
8 “La configuration d’un site peut se définir comme l’aspect d’un site d’habitat en fonction de son plan et de la densité des constructions. Le plan d’un habitat est le résultat de l’agencement spatial des maisons et/ou des cours, combinées en unité, et de leurs rapports avec les rues ou chemins et les places” (Lienau, 2000: 64).
catalogue 03_INT_20110929.indd 39 29/09/11 12:48
40 _ Des faits
une rangée, est que, dans les sites hollandais d’elsloo et Geleen-JKv, chaque rangée présente une construction de type 1a (elsloo) ou au moins une maison qui se démarque des autres par sa taille (longueur et/ou largeur; Geleen-JKv). Cuiry-lès-Chaudardes, ainsi que Langweiler 2 et Langweiler 8, montrent les mêmes tendances.
perspectivesIl est très probable que les maisons rubanées étaient habitées par un grand nombre de personnes. Nous suivons ici l’opinion de Meier-Arendt qui suppose “un groupe familial étendu” (Meier-Arendt, 1979: 62). Le nombre d’habitants par maison, multiplié par le nombre de maisons par rangée(s), donne, par site, une population plus importante qu’on ne le supposait auparavant. Les grands cimetières récemment découverts, avec plusieurs centaines de sépultures (Weiner et al., 2010; Cziesla, 2011), corroborent l’idée de villages plus grands. La forme et la dimension des enceintes autour des sites plaident égale ment pour l’existence de grands sites d’habitat, comme à Frimmersdorf 141, Köln-Lindenthal, vaihingen an der enz ou Geleen-JKv. Pourquoi entre-prendre des travaux exigeant autant de main d’œuvre s’ils ne servaient pas à protéger un espace densément construit? Plusieurs éléments suggèrent en fait que les enceintes sont le reflet de l’im portance du site d’habitat au moment de leur construction.
Afin d’étudier la structure des sites d’habitat du Néolithique ancien et moyen et d’identifier des différences régionales et chronologiques, relever la totalité du plan d’un site d’habitat devient une nécessité.
Savons-nous déjà vraiment comment se développait un site d’habitat, quelles circonstances socio-économiques y contribuaient, et comment était organisée la société rubanée? Dans tous les cas, la recherche sur le Rubané en est encore à ses balbutiements. Après tout, nous discutons encore sur le but et l’utilisation des fosses à argile et leur durée d’utilisation. Selon nous, les voies les plus productives pour la recherche sont des projets internationaux d’ethnoarchéologie et d’archéo-logie expérimentale, y compris des reconstitutions grandeur nature de parties de site d’habitat rubané selon différents modèles.
en y regardant de plus près, l’idée récurrente que la culture rubanée est l’une des cultures archéologiques d’europe centrale les mieux investiguées est en réalité inexacte.
remerciementsJ’adresse tous mes remerciements à François Bertemes, Ralph einicke, Daniela Hofmann, Sandro Meinhardt et Ronny ueckermann pour leur disponibilité dans la discussion, pour la relecture et la traduction du texte, et leur aide pour les illustrations.
bibliogrAPhiE
BeDAuLT L., 2009. First reflections on the exploitation of animals in villeneuve-Saint-germain society at the end of the early Neolithic in the Paris Basin (France). In: Hofmann D. & Bickle P. (éd.), Creating Communities. New advances in Central European Neolithic Research. oxford: 111-131.
BoeLICKe u., voN BRANDT D., LÜNING J., STeHLI P. & zIMMeRMANN A. (éd.), 1988. Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 8, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren. Beiträge zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte III. Rheinische Ausgrabungen, 28. Köln-Bonn, Rheinland verlag, 3 t., 1436 p. et annexes.
BoSTyN F. & LANCHoN y., 2007, Sériation chronologique et analyse spatiale dans la culture de villeneuve-Saint-Germain: les exemples du village de Poses (eure, France) et de la basse vallée de la Marne. In: Le BRuN-RICALeNS F., vALoTTeAu F. & HAuzeuR A. (dir.), Relations interrégionales au Néolithique entre Bassin parisien et Bassin rhénan. Actes du 26e colloque interrégional sur le Néolithique, Luxembourg, 8-9 novembre 2003. Archaeologia Mosellana, 7. Luxembourg: 209-227.
BuTTLeR W. & HABeRey W., 1936. Die bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal. Römisch-germanische Forschungen, 11. Berlin-Leipzig, verlag von Walter de Gruyter & Co, 241 p.
CLADDeRS M., 2001. Die Tonware der Ältesten Bandkeramik.Unter- suchungen zur zeitlichen und räumlichen Gliederung. universitäts-forschungen zur Prähistorischen Archäologie, 72. Bonn, 198 p.
CouDART A., 1998. Architecture et société néolithique. L’unité et la variance de la maison danubienne. Documents d’archéologie française, 67. Paris, 239 p.
CzIeSLA e., sous presse. Die bandkeramische Siedlung Merzenich-valdersweg. Bonner Jahrbücher 2009.
DoMBoRÓCzKI L., 2001. The excavation at Füzesabony-Gubakút. Preliminary Report. In: KeRTÉSz R. & MAKKAy J. (éd.), From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22-27, 1996. Budapest: 193-214.
FARRuGGIA J.-P., KuPeR R., LÜNING J., STeHLI P. (éd.), 1973. Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 2, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren. Rheinische Ausgrabungen, 13. Köln-Bonn, Rheinland verlag, 207 p., 55 pl.
FoCK H., GoFFIouL C., CoRNÉLuSSe F., 1998. Fouille d’un habitat rubané à Remicourt, au lieu-dit Fond de Momalle, secteur III. Notae Praehistoricae, 18: 123-129.
FRASeR D., 1968. Village Planning in the Primitive World. New york.
HeRReN 2003: Die alt- und mittelneolithische Siedlung von Harting-Nord, Kr. Regensburg/oberpfalz. Befunde und Keramik aus dem Übergangshorizont zwischen Linearbandkeramik und Südostbayerischem Mittelneolithikum (SoB). Arch. Berichte 17 (Bonn 2003).
KIND C.-J., 1989. Ulm-Eggingen. Die Ausgrabungen 1982 bis 1985 in der bandkeramischen Siedlung und der mittelalterlichen Wüstung. Forschungen und Berichte zur vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 34. Stuttgart: 500 p., 122 pl., 3 cartes h.t.
catalogue 03_INT_20110929.indd 40 29/09/11 12:48
41
KooIJMANS L. P. L., vAN De veLDe P. & KAMeRMANS H., 2003. The early Bandkeramik Settlement of Geleen-Jans-kamperveld: Its Intrasite Structure and Dynamics. In: eCKeRT J., eISeNHAueR u. & zIMMeRMANN A. (éd.), Archäologische Perspektiven; Analysen und Interpretationen im Wandel, Festschrift für Jens Lüning zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie. Studia honoraria, 20. Rahden/Westfalen: 373-397.
KRAuSe R., avec la collab. de Arbogast R.-M., Hönscheidt S., Lienemann J., Strien H.-C. & Welge K., 1998. Die Bandkeramik Siedlungsgrabungen bei vaihingen an der enz, Kreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg). Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 79/1999: 5-105.
KuPeR R., LÖHR H., LÜNING J., STeHLI P. & zIMMeRMANN A., 1977. Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 9, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren. Beiträge zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte II. Rheinische Ausgrabungen, 18. Köln-Bonn, Rheinland verlag, 3 vol.
LeHMANN J., 2004. Die Keramik und Befunde des bandkeramischen Sied lungsplatzes erkelenz-Kückhoven, Kreis Heinsberg (Grabungskampagnen 1989-1994). In: KoSCHIK H. (éd.), Der bandkeramische Siedlungsplatz erkelenz-Kückhoven. Rheinische Ausgrabungen, 54. Mainz: 1-364.
LIeNAu C., 2000. Die Siedlungen des ländlichen Raumes. 4e édition, Braunschweig, 246 p.
LÜNING J., 2005. Bandkeramische Hofplätze und die absolute Chronologie der Bandkeramik. In: Lüning J., Frirdich C., zimmermann A. (éd.), Die Bandkeramik im 21. Jahrhundert. Symposium Brauweiler 2002. Rahden/Westfalen: 49-74.
LÜNING J., 2011. Gründergrab und opfergrab: zwei Bestattungen in der ältestbandkeramischen Siedlung Schwanfeld, Lkr. Schweinfurt, unterfranken. In: LÜNING J., (éd.), Schwanfeldstudien zur Ältesten Bandkeramik. universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, 196. Bonn: 7-100.
MeIeR-AReNDT W., 1979. Die Steinzeit in Köln. 2e édition, Köln, 88 p.
MoDDeRMAN P. J. R., 1985. Die Bandkeramik im Graetheidegebiet, Niederländisch-Limburg. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 66/1985: 25-121.
MoDDeRMAN P. J. R., 1988. The Linear Pottery Culture. Diverstity in uniformity. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzeok, 38: 63-139.
MÜLLeR-SCHeeßeL N., SCHMITz J., HoFMANN R., KuJuNDŽIC-veJzAGIC z., MÜLLeR J. & RASSMANN K., 2009. Die Toten der spätneolithischen Tellsiedlung von okolište / Bosnien-Herzegowina: Massaker, Seuche oder Bestattungsbrauch? In: zeeB-LANz A. (éd.), Krisen – Kulturwandel – Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Beiträge der internationalen Tagung in Herxheim bei Landau (Pfalz) vom 14.–17. 06. 2007. Internationale Archäologie. Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 10. Rahden/Westfalen: 327-340.
PAvLu I., 2000. Život na sídlišti kultury s lineárni keramikou v Bylanech u Kutné Hory [Life on a Neolithic site. Bylany – situational analysis of artefacts]. Prag, 340 p.
RÜCK o., 2007. Neue Aspekte und Modelle in der Siedlungsforschung zur Bandkeramik. Die Siedlung Weisweiler 111 auf der Aldenhovener Platte, Kr. Düren. Internationale Archäologie, 105. Rahden/Westf, 318 p.
RÜCK o., 2009. New Aspects and Models on Bandkeramik Settlement Research. In: BICKLe P. & HoFMANN D. (éd.), Creating Communities. New Advances in Central European Neolithic Research. Cardiff: 158-184.
STÄuBLe H., 2005. Häuser und absolute Datierungen der Ältesten Bandkeramik. universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, 117. Bonn, verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 292 p.
WeINeR J., BIeMANN e., CzIeSLA e., GAITzSCH W., GeILeNBRÜGGe u., HeINeN M., IBeLING T. & MÜNCH u., 2010. Frühe Ackerbauern im Rheinland - Was gibt es neues seit 2005? In: oTTeN T., HeLLeNKeMPeR H., KuNoW J. & RIND M. (éd.), Fundgeschichten. Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Köln/München: 59-64.
c H r i S t i a n J e u n e S S e
Les enceintes rubanées: fossés continus,
fossés discontinus et pseudo-fossés
L’existence de fossés d’enceinte dans le Rubané est connue depuis la découverte, au début du siècle dernier, d’une double enceinte sur le site de Plaidt, dans la région de la confluence Rhin-Moselle (Lehner, 1912). Les enceintes sont d’emblée perçues comme un objet paradoxal et suscitent une gêne, lisible dans le peu d’intérêt qu’elles suscitent. Il faudra en effet attendre 2004 pour voir apparaître le premier travail de synthèse prenant en compte l’ensemble de la documentation existante (Schmidt, 2004). Le malaise vient du télescopage entre une archéologie qui ne conçoit, pour les enceintes, guère d’autre rôle que défensif et le caractère pacifique que l’on octroie, dans la lignée des thèses évolutionnistes du xIxe siècle, aux sociétés villageoises néolithiques. Les questions relatives aux pratiques funéraires, à l’organisation du village et à l’architecture domestique, qui entrent plus facilement dans ce cadre, occuperont donc – et occupent toujours – le premier rang. Parmi les jalons de cette recherche dont il serait trop long de détailler toutes les étapes, il faut citer les réflexions de synthèse inspirées à u. Boelicke par la fouille quasi-intégrale des deux enceintes de Langweiler 8 et Langweiler 9, en Rhénanie (Boelicke, 1988). Pour la première fois, une étude fondée sur une fouille extensive et une prise en compte attentive des observations de terrain affiche une préférence marquée pour la fonction cérémonielle.
L’impulsion suivante sera donnée par la découverte, en 1990, du monument de Rosheim (Basse-Alsace), qui conduit à la mise en évidence d’un nouveau type d’enceinte appelé, dans un premier temps, “de type Rosheim” (Jeunesse, 1996; Jeunesse & Lefranc, 1999), avant d’être rebaptisé “enceinte à pseudo-fossé” (Jeunesse, 2011). Le fossé de Rosheim n’est en effet pas un fossé à proprement parler, mais un alignement de fosses de forme et de dimensions variées dont le creusement s’étale sur au moins quatre ou cinq générations (fig. 29). Certaines d’entre elles recoupent des fosses antérieures déjà en grande partie comblées, ce qui montre bien que nous ne sommes pas en présence de ce que l’on appelle traditionnellement un “fossé discontinu”, c’est-à-dire un ensemble de fosses creusées d’un seul tenant. Si l’on essaie d’imaginer
catalogue 03_INT_20110929.indd 41 29/09/11 12:48