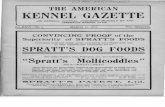Le terrier
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le terrier
Dans le cadre du séminaire « Le quotidien merveilleux », de Bernadette Bricout
Maxime Thomas
Dans le Dictionnaire du quotidien merveilleux, à la lettre T. Entrée :
Terrier
Travailler sur le quotidien merveilleux, c’est d’abord tenter de voir et de comprendre ce qui
transforme le banal et le normal en magique, ce qui dote le normal d’une dimension merveilleuse.
Les contes populaires, les livres pour enfants, les bandes dessinées, les films, les romans, font
travailler l’imagination, et gonflent le quotidien d’une signification qui le dépasse. Les
caractéristiques des objets de tous les jours se voient détournées, caricaturées, grossies. Ainsi la
croissance du haricot de Jack se voit accélérée, fortifiée et verticalisée par l’imaginaire ; les grandes
bottes de l’ogre du Petit Poucet paraissent tellement grandes à l’enfant minuscule qu’elles se voient
dotées du pouvoir de parcourir sept lieues comme par magie; la tache de sang dans Barbe Bleue est
rendue incroyablement indélébile du fait de la peur et de la culpabilité (comme un enfant est
terrorisé à l’idée que ces parents découvrent la « bêtise » qu’il a commise) !
L’imagination a donc ce pouvoir (ou cette condamnation ?) de toujours s’emparer de ce qui
meuble le quotidien. Ainsi le terrier que le promeneur découvre au bord du chemin peut également
devenir un élément de ce quotidien merveilleux. Nous le verrons, ce simple trou dans la terre, dont
on ne voit que l’orifice, va se gonfler d’une profondeur imaginative dans le cerveau de l’enfant, du
promeneur, du lecteur, du conteur. De cette profondeur imaginative découle une signification, que
nous allons tenter de décrypter.
Le terrier convoque à notre imagination des phénomènes déjà analysés par Bachelard. Quels
sont ces phénomènes ?
Paradoxalement, alors que le terrier n’a, rationnellement, rien d’attirant (il est froid, humide,
sale…), notre imagination tend à s’y loger : on veut y habiter, y emménager ! Mais d’où vient cet
étrange désir ? Nous tenterons de répondre à cette question en nous inspirant d’une étude de
Gaston Bachelard, et en convoquant les références d’origines diverses et variées qui nous ont
conduit à étudier ce thème. (Si le conte populaire n’est pas majoritaire au sein de ces références,
nous espérons toutefois que les exemples utilisés auront une portée aussi forte et une signification
tout aussi profonde, et qu’à cet égard ils apparaîtront comme des arguments légitimes dans une
démonstration sur les pouvoirs de l’imagination).
Pour paraphraser Bachelard, disons qu’ « Il nous faut seulement suivre des rêves, et même
des rêves exprimés, et même encore plus précisément des rêves qui veulent l’expression littéraire,
bref notre pauvre sujet n’est que [le terrier] en littérature. 1»
1 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, sur la grotte
La littérature enfantine2, le dessin-animé3, la bande-dessinée, ont de façon récurrente représenté des terriers qui étaient aménagés comme des maisons « humaines », aux intérieurs coquets et douillets. On peut mentionner par exemple le livre pour enfant Patatras! De Philippe Corentin, livre illustré dont l’intrigue consiste à la visite d’un loup dans l’immense terrier d’une famille de lapins : il parcourt un terrier labyrinthique à la recherche d’une proie. Si les images pourraient s’apparenter bêtement aux images de la maison, il demeure que le lecteur a en tête qu’il s’agit d’un terrier (quand le loup parcourt cette habitation à la recherche d’une proie, il le fait en allant de bas en haut, donc ; le sommet d’un terrier, paradoxalement, est tout en bas). L’habitat animal est donc métamorphosé par l’auteur en un habitat humain, mais doté en plus de cette particularité qu’il est souterrain. Voici qui doit nous interroger : pourquoi l’auteur offre-t-il à l’animal le bien-être et le confort domestique de nos maisons? La nouvelle de Kafka intitulée Le Terrier montre parfaitement cette ambivalence de l’imaginaire du terrier, à la fois agréable et oppressant. Le personnage est une taupe qui vit dans un terrier. Pour elle, et pour le lecteur-rêveur, le terrier est un endroit où il doit faire bon-vivre ; mais, dit-elle : « Je vis en paix au plus profond de mon terrier, et cependant, quelque part, n’importe où, l’ennemi perce un trou qui l’amènera sur moi 4». « Et ainsi je peux jouir pleinement et sans souci des moments que je passe ici, ou plutôt je le pourrais, mais c'est impossible. » La claustrophobie conduit à la paranoïa. Mais quoi qu’il en soit, ce que Kafka montre par ailleurs, c’est que, en dépit des aspects angoissants et « claustrophobiques » du terrier, il demeure que l’imagination, a priori, voit le terrier comme un idéal. Il symbolise la tranquillité : « La chose la plus merveilleuse dans mon terrier, c'est le silence. 5» « En accentuant les différences, on peut dire que les images de la grotte relèvent de
l’imagination du repos, tandis que les images du labyrinthe relèvent de l’imagination du mouvement
difficile, du mouvement angoissant. » Et en effet, le labyrinthe est oppressant et effrayant : on s’y
perd, il se referme sur nous comme un piège, on n’en sort jamais plus. Dans le film Kirikou et la
sorcière, on voit le personnage éponyme épuisé dans un dédale de galeries souterraines, perdu et
désespéré, incapable de retrouver son chemin. En revanche, « la grotte est un refuge dont on rêve
sans fin. Elle donne un sens immédiat au rêve d’un repos protégé, d’un repos tranquille. Passé un
certain seul de mystère et d’effroi, le rêveur entré dans la caverne sent qu’il pourrait vivre là. Qu’on y
séjourne quelque minute et déjà l’imagination emménage. Elle voit la place du foyer entre deux gros
rochers, le recoin pour le lit de fougère (…) En fait, l’acte d’habiter se développe presque
infailliblement aussitôt qu’on a l’impression d’être abrité. 6» « On sent bien que le moindre abri
naturel est ainsi la cause occasionnelle d’une immédiate rêverie pour les images du repos. » On
pourrait étendre ces propos de Bachelard sur la grotte au terrier. Le terrier se rapproche bien
davantage de la grotte que du labyrinthe. (Et il nous faudra nous méfier de la confusion entre
différents termes (terrier, tunnel, grotte, caverne, labyrinthe, puits, trou, gouffre, etc…) qui, s’ils
partagent souvent des caractéristiques (notamment la grotte et le terrier) renvoient parfois à des
phénomènes et des réalités différentes).
2 On peut mentionner par exemple La Brouille, de Claude Boujon, Loulou de Grégoire Solotareff, L’hiver de la famille Souris, de Kazuo Iwamura ; ainsi que certaines histoires du Père Castor : Blancheline, d’Albertine Deletaille, La famille Rataton, de Romain Simon. 3 Kirikou, de Michel Ocelot, Fantastic Mister Fox, de Wes Anderson, adapté du roman de Roald Dahl 4 Kafka, Le Terrier, Pléiade, Œuvres complètes II, p. 739 5 Kafka, Le terrier 6 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, pp. 208-209
Tolkien, en créant ses hobbits et leur mode de vie, fait vivre cette fascination du terrier dans
l’imagination du lecteur. Le trou de hobbit est l’habitat parfait. « Ils étaient les plus enclins à s'établir
dans un endroit précis, et ce furent eux qui conservèrent le plus longtemps la coutume ancestrale de
vivre dans des galeries et des trous. »
« Les hobbits avaient tous vécus à l’origine dans des trous creusés dans le sol ou tout au moins le
croyaient-ils, et c'est dans de telles demeures qu'ils se sentaient le plus à l’aise (…) »
C’est une drôle d’idée que d’aller vivre sous terre ! Néanmoins, force est d’admettre que le
mode de vie des hobbits laisse rêveur. Pourquoi ? Pourquoi Tolkien fait-il du trou dans la terre un
habitat douillet, comme en témoigne le passage suivant, qui sert d’incipit à son roman Le hobbit ? :
«Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de vers et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger: c'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel : un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis ; il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux - le hobbit aimait les visites. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en droite ligne, dans le flanc de la colline - la Colline, comme tout le monde l'appelait à des lieues alentour - et l'on y voyait maintes Petites portes rondes, d'abord d'un côté, puis sur un autre. Le hobbit n'avait pas d'étages à grimper: chambres, salles de bains, caves, réservés (celles-ci nombreuses), penderies (il avait des pièces entières consacrées aux vêtements), cuisines, salles à manger, tout était de plain-pied, et, en fait, dans le même couloir. 7»
Il nous semble que le lecteur doive aussitôt souscrire à ce rêve de confort et de terrier. Nous
allons tenter de comprendre pourquoi8.
Le premier chapitre du roman de Lewis Carroll s’intitule « Descente dans le terrier du lapin ». Mais ici, le personnage tombe dans un trou : il s’agit davantage d’un puits ou d’un gouffre, que d’un véritable terrier de lapin, finalement. Ce chapitre partage avec le conte intitulé Dame Holle des Frères Grimm le fait qu’au fond du trou tout un monde est caché. Le Pays des Merveilles d’Alice et le monde au-dessus des nuages de Dame Holle9 sont des mondes à coté du monde.
« [Elle] eut la chance d’arriver juste à temps pour [voir le lapin] s’enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir.
7 Tolkien, Bilbo le hobbit 8 Il semblerait que le peintre et architecte Friendensreich Hundertwasser ai également souscrit à ce mode de vie souterrain des hobbits, lui pour qui « la construction architecturale a pour première fonction de protéger les hommes de l'extérieur. Dans ce sens, l'habitation apparaît comme un terrier, une tanière. [Il] le prononce lui-même ainsi : « J'aimerais être une taupe… vivre sous terre… je serais à l'abri dans ma tanière ». » (http://fr.ekopedia.org/Friedensreich_Hundertwasser , consulté le 05.04.15) 9 Hölle, en allemand, signifie enfer (Cf. Hell en anglais). En outre, Hol, en néerlandais, correspondrait à peu près à terrier.
Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier comme dans un tunnel ; puis le sol s’abaissa brusquement, si brusquement qu’Alice, avant d’avoir pu songer à s’arrêter, s’aperçut qu’elle tombait dans un puits très profond. Soit que le puits fût très profond, soit que la fillette tombât très lentement, elle s’aperçut qu’elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d’elle et de se demander ce qui allait se passer. D’abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu’elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits, et remarqua qu’elles étaient garnies de placards et d’étagères ; par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère ; il portait une étiquette sur laquelle on lisait : CONFITURE D’ORANGES, mais, à la grande déception d’Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu’un et elle s’arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait, tout en tombant. »
Dans Alice au Pays des Merveilles, Dame Holle, ou encore dans Le Briquet des Frères Grimm,
terrier de lapin, puits et tronc d’arbre creux dans lequel on pénètre par la cime, doivent être vus
comme des passages. La verticalité est cruciale : elle permet d’accéder à un autre monde, où tout va
se jouer. (Ainsi on peut lire, dans Le briquet d’Andersen : «Vois-tu ce grand arbre ? continua la
sorcière en désignant un arbre tout voisin ; il est entièrement creux ; monte au sommet, tu verras un
grand trou ; laisse-toi glisser par ce trou jusqu’au fond de l’arbre.(…) Une fois au fond de l’arbre, tu te
trouveras dans un grand corridor bien éclairé, car il y brûle plus de cent lampes. Tu verras trois
portes ; tu pourras les ouvrir, les clefs sont aux serrures. 10» )
Rêver de terrier, c’est donc avoir des fantasmes de conquérants : « L’abri nous suggère la
prise de possession d’un monde. 11» En effet, cet abri étant naturel et préexistant à la rêverie, il
apparait comme disponible : le terrier est là, et on n’a qu’à s’y installer. Il est comme la maison des
trois ours dans Boucle d’Or : l’habitat est meublé, la soupe est sur la table, les lits sont faits. Quel
plaisir que de n’avoir qu’à pénétrer cette maison et y agir comme chez soi ! On n’a même pas à
creuser ce terrier, des animaux absents l’ont déjà fait. Comme dans la fable de La Fontaine « Le chat,
la belette, et le petit lapin », où la belette profite d’une absence momentanée du lapin pour investir
son terrier : on peut voir que le terrier est qualifié de différentes façons : s’il n’est que « souterrains
séjours », « un logis où lui-même [le lapin] n’entrait qu’en rampant ! », lorsque la belette en prend
possession clandestinement, le terrier est désigné comme le « palais d’un jeune lapin ». La Fontaine
joue sur le paradoxe déjà énoncé, et montre que c’est la disponibilité du terrier qui le rend enviable
(Le rêve de terrier tient donc avant tout à un désir de conquête, et non à un véritable plaisir
domestique : si le terrier est un objet de rêve, c’est parce que le désir du terrier ne peut être assouvi.
Le lecteur et l’enfant, rêvent de terrier parce que celui-ci leur est inaccessible : c’est le désir qui
émerveille).
Le terrier est une maison que la nature met à la disposition du rêveur. Cette gratuité fait
partie du potentiel de rêverie du terrier. Toutefois, « Cette possession n’est point une possession de
propriétaire, c’est celle d’un maître de la nature. L’enfant recevait là un jouet cosmique, une demeure
naturelle, un prototype des antres du repos. La grotte ne quittera jamais son rang d’image
fondamentale. » En effet, par l’imaginaire du terrier, le lecteur peut se représenter une vie primitive.
10 Andersen, Le Briquet 11 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, p. 211
Sans même suggérer que nous puissions avoir des réminiscences de notre passé préhistorique où les
hommes occupaient grottes et cavernes, on peut dire que la grotte et le terrier sont des maisons au
plus près de la nature. Ainsi, le conte Poucette, d’Andersen, va faire du terrier un habitat-
providence : de même que la nature est généreuse et offre à l’héroïne tout ce dont elle a besoin pour
boire et manger (« La petite Poucette passa ainsi l’été toute seule dans la grande forêt. Elle tressa un
lit de paille qu’elle suspendit au-dessous d’une feuille de bardane pour se garantir de la pluie. Elle se
nourrissait du suc des fleurs et buvait la rosée qui tombait le matin sur les feuilles. »), le terrier
apparaîtra comme une maison « toute-faite » grâce à la magie de la nature providentielle.
De plus, outre ce désir de conquête, le terrier propose à l’imagination un phénomène de miniaturisation. En même temps qu’ils s’imaginent emménager dans un terrier, le lecteur et le rêveur doivent rétrécir, se miniaturiser (pour reprendre un terme bachelardien), adopter la taille d’une souris (et ainsi, devenir souris). Le conte Poucette d’Andersen, de même que Le Petit Poucet ou Nils Holgersson, ou encore plus récemment Kirikou, joue sur ce fantasme de petitesse : «Elle reçut pour berceau une coque de noix bien vernie », écrit Andersen. Mais dans Poucette, l’être miniature n’a pas la malice de Poucet ou de Nils Holgersson : la petite taille n’est pas un moyen pour jouer des tours aux gens de taille normale, mais plutôt de pénétrer dans un autre monde : celui des animaux, crapaud, souris, taupe, hirondelle. Le monde des hommes est rapidement oublié et remplacé par celui des bêtes, le terrier et le nid faisant dès lors office de maison. Dans Poucette d’Andersen, le terrier de la souris survient comme un refuge pour le personnage : c’est l’hiver, et Poucette y trouve un abri chaleureux :
« Toute grelottante, elle arriva à la demeure d’une souris des champs. On y entrait par un petit trou, sous les pailles ; la souris était bien logée, possédait une pièce pleine de grains, une belle cuisine et une salle à manger. La petite Poucette se présenta à la porte comme mendiante et demanda un grain d’orge, car elle n’avait rien mangé depuis deux jours. « Pauvre petite ! répondit la vieille souris des champs, qui, au fond, avait bon cœur, viens manger avec moi dans ma chambre ; il y fait chaud. » Puis elle se prit d’affection pour Poucette, et ajouta : « Je te permets de passer l’hiver ici ; mais à condition que tu tiennes ma chambre bien propre, et que tu me racontes quelques jolies histoires ; je les adore. »»
Par contraste, le froid de l’hiver à l’extérieur rend l’intérieur accueillant (de même qu’il est dit, dans le Petit Poucet, que la maison de l’ogre est préférable aux loups de la forêt. Nous pensons que cette préférence est simplement due au fait que l’extérieur est toujours, dans l’imagination, plus hostile que l’intérieur). Comme l’écrivait Bachelard d’un texte « domestique » de Baudelaire, « Nous nous sentons placés au centre de protection de la maison du vallon, « emmaillotés », nous aussi, dans les tissus de l’hiver. Et nous avons bien chaud, parce qu’il fait froid dehors. 12» Bachelard souligne le lien de causalité entre le froid extérieur (et donc l’hostilité du monde) et la chaleur du foyer. Comme nous savons Poucette protégée à l’intérieur du terrier, « l’hiver évoqué est un renforcement du bonheur d’hiver. 13»i Et, pour parachever le sentiment domestique du terrier de Poucette, le terrier devient l’endroit où l’on raconte quelques jolies histoires, incorporant ainsi l’imaginaire douillet de la veillée d’hiver au feu de bois, en famille. (Le terrier, c’est aussi une potentielle demeure familiale, dont la rusticité favoriserait le vivre-ensembleii. Rêver de la maison de l’animal, c’est en même temps rêver d’être un animal, et rêver
12 Gaston BACHELARD, La poétique de l’espace, Paris, PUF Quadrige, 2012, p .52 13 Gaston BACHELARD, La poétique de l’espace, Paris, PUF Quadrige, 2012, p .52
d’une vie familiale idéale et simplifiée, que les livres pour enfants idéalisent. ( En outre, dans Harry Potter, la maison rustique et campagnarde de la famille Weasley s’appelle le Terrier (The burrow): le toponyme confère ainsi les phénomènes imaginatifs de la tranquillité à cette modeste demeure, qui devient ainsi le lieu par excellence de la vie familiale et conviviale, par rapport notamment à la maison de la famille Dursley (les moldus, qui ne pratiquent pas la magie), pavillon résidentiel aseptisé où le héros ne peut trouver sa place. ))
C’est aussi la dimension secrète du terrier, pensons-nous, qui le rend si attirant à
l’imagination : il est une « chambre secrète14 »iii, cachée sous terre, et sans fenêtre ! Ce dernier point
est capital : c’est parce que le terrier n’a pas de fenêtre qu’il est inviolable : il n’est pas ouvert sur
l’extérieur. Intérieur et extérieur sont parfaitement distincts. « Pour être bien seul, il faut que nous
n’ayons pas trop de lumière. 15» Le secret est fascinant : le terrier est potentiellement un lieu où le
rêveur se saurait parfaitement caché : c’est un lieu connu de lui seul. « (…) se trouve cachée, sous une
couche de mousse qu’on peut relever, la véritable entrée de mon habitation ; elle est aussi bien
défendue qu’une chose puisse l’être en ce monde 16».
Et être caché, c’est certes d’une part être tranquille et ne pas être vu, mais c’est aussi
pouvoir jouer des tours et espionner sans être vu. Dans Kirikou, le terrier permet au personnage
éponyme de pénétrer dans la maison de la sorcière par en-dessous, et de lui voler ses bijoux en
creusant et en perçant le coffre17, sans que la sorcière ne s’aperçoive de rien. De même, la malice du
personnage éponyme de Fantastique Maître Renard, roman de Roald Dahl, tient au fait de
commettre un larcin par en-dessous (Maître Renard vit dans un trou dans/sous un arbre. Il se nourrit
en volant de la nourriture dans les fermes de trois paysans des alentours. Quand sa maison est
détruite par ces paysans qui tentent de le tuer, il se réunit, avec toute la communauté des animaux
souterrains, pour réorganiser une vie en terriers, coincés qu’ils sont par les chasseurs qui les guettent
à la sortie ; ensemble, ils creusent des tunnels pour accéder, toujours de façon souterraine, aux
réserves de nourriture des paysans. C’est pour eux l’occasion de se réjouir, à l’abri des chasseurs en
embuscade, d’un grand festin qu’ils s’offrent à leurs dépends.) Il y a quelque chose de follement
excitantiv à ce type d’aventure, du fait de se savoir sous la vie humaine, et de savoir que notre
présence est parfaitement ignorée de ceux qu’on espionne.
En outre, l’isolement et l’absence de d’ouverture, faisant du terrier un mini-espace clos, en
fait également un œuf. « Par bien des traits, la grotte permet de retrouver l’onirisme de l’œuf, tout
l’onirisme du sommeil tranquille des chrysalides. Elle est la tombe de l’être quotidien, la tombe d’où
l’on sort chaque matin, fort du sommeil de la terre. 18» Habiter un terrier est la promesse d’une
renaissance quotidienne. Nous ne voulons pas faire de symbolisme psychanalytique infondé ou
inspiré à l’excès, mais force est d’admettre que la puissance imaginative du terrier ou de la grotte
14 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, p. 209 15 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, p. 216 16 Kafka, Le terrier, Pléiade, Œuvres complètes II, p. 738 17 Nous revient une histoire de marins, qui n’a certes rien à voir avec le terrier : Sur un bateau, au cours d’une longue traversée, un homme décède. Le capitaine fait mettre le cadavre dans un tonneau de rhum afin qu’il ne pourrisse pas. Des marins assoiffés, ignorant la chose, et voulant boire du rhum en cachette, se cachent sous le plancher du bateau où était entreposé le rhum, et creusent un trou dans le bois à travers le tonneau, jusqu’à ce que la boisson coule à leur bouche. Ils devaient être fiers de leur malice, mais ils avaient bu sans savoir la saumure d’un macchabée ! 18 P. 227
peut être rattachée à la réminiscence utérine, et qu’ainsi, sortir du terrier, c’est naître, et renaître à
volonté. Ainsi chez Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra :
« Lorsque Zarathoustra fut âgé de trente ans, il quitta son pays (…) et s’en fut dans la
montagne. Là jouit de son esprit et de sa solitude et dix années n’en fut las. Mais à la fin
son cœur changea, - et un matin, avec l’aurore, il se leva, face au Soleil s’avança, et ainsi lui
parlait :
« Ô toi, grand astre ! (…) Dix années durant jusqu’à ma caverne tu es monté ; (…) De ma
sagesse voici que j’ai satiété, telle l’abeille qui de son miel trop butina (…) 19»
Certes, ici nous avons affaire à une caverne, et pas à un terrier ; mais ces deux motifs ont en
commun cette proximité avec l’utérus. Zarathoustra, sortant de la caverne, passe de l’ombre à la
lumière ; il renaît en même temps que le soleil. D’où l’importance de l’absence de fenêtre : il faut
sortir du terrier pour profiter de ce phénomène, passer de l’obscurité à la lumière (casser la
coquille !), à la manière de l’hirondelle dans Poucette, d’Andersen, qui, alors qu’on la croyait morte
du froid de l’hiver, se réveille au printemps grâce aux soins de Poucette : « Pendant tout l’hiver, à
l’insu de la souris et de la taupe, la petite Poucette soigna ainsi l’hirondelle avec la plus grande
affection. À l’arrivée du printemps, lorsque le soleil commença à réchauffer la terre, l’oiseau fit ses
adieux à la petite fille, qui rouvrit le trou pratiqué autrefois par la taupe. 20»
Dans le Dame Holle des Frères Grimm, la chute et la sortie du puits peuvent être interprétées
symboliquement comme respectivement la mort et la renaissance, le coq chantant, comme pour
accueillir le nouveau jour, quand les jeunes filles reviennent de « l’autre monde ». Certes, il s’agit ici
d’un puits, et non d’un terrier, mais les deux ne sont-ils pas des trous profonds s’enfonçant dans les
entrailles de la terre, tous deux obscurs et mystérieux (le puits est si profond qu’il est souvent
impossible d’en estimer la profondeur à l’œil ; de même, le terrier ne laissant voir que son entrée, on
ne peut savoir jusqu’où il va) ?
Le terrier porte en lui la force de la terre, qui est de donner la vie. Les graines y germent, et
des choses en sortent comme par magie. Comment peut-on interpréter ce passage de Riquet à la
houppe, de Perrault ? :
« Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avoit trouvé Riquet à la Houppe, pour rêver plus commodement à ce qu’elle avoit à faire. Dans le tems qu’elle se promenoit, rêvant profondement, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant presté l’oreille plus attentivement, elle ouït que l’un disoit : « Apporte-moy cette marmite » ; l’autre : « Donne-moy cette chaudiere » ; l’autre : « Mets du bois dans ce feu. » La terre s’ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d’officiers necessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de vingt ou trente rotisseurs, qui allerent se camper dans une allée du bois, autour d’une table fort longue, et qui tous, la lardoire à la main et la queuë de renard sur l’oreille se mirent à travailler en cadence, au son d’une chanson harmonieuse. La princesse, estonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travailloient.
19 Friedrich NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, traduit par Maurice de Gandillac, Folio essais 20 Andersen, Poucette
« C’est, Madame, luy répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la Houppe, dont les nopces se feront demain. » 21»
Etrange péripétie que ce soudain surgissement de cuisiniers du sol d’une forêt ! On a du mal à comprendre ce qui a poussé le conteur à une telle invraisemblance, qui apparaît comme tel puisque le lecteur n’avait pas été habitué, dans le reste du conte, à de tels phénomènes spatiaux. Nous pensons que le jaillissement de cette vie sous-terraine à la surface survient comme la résolution d’un problème, comme la solution à l’intrigue du conte : la princesse ne sais pas quoi faire, elle va dans les bois pour réfléchir à une solution, et c’est là que la solution sort de dessous terre. Si la vie sous terraine n’a pas d’importance dans l’intrigue (les cuisiniers auraient pu sortir de derrière un caillou, l’histoire n’en aurait pas été changée), c’est la brutalité de son dévoilement souterrain qui compte. Quand le monde ne nous convient pas, une alternative peut se trouver sous terre, dans un monde à part (Cf. Alice au Pays des Merveilles ou Dame Holle). C’est de sous terre que germent les réponses. De sous terre jaillissent des messages, comme dans la légende du Roi aux oreilles de cheval : le héros, porteur d’un lourd secret (il est le seul a savoir que le Roi a des oreilles de cheval, mais n’en doit rien dire à personne), décide de se confier en parlant dans un trou ; il rebouche le trou, et des roseaux poussent à cet endroit ; un musicien se fait une flûte de ces roseaux, et dès qu’il en joue, cette flûte dévoile le terrible secret. Ainsi, le secret enterré a germé comme une plante, comme si la terre avait été capable de porter en elle une graine de message et de le faire murir en attendant de le dévoiler.
Bachelard écrit :
« C’est dans cette ombre de la cavité parfaite que Lawrence totalise « les ténèbres de la
germination », et les ténèbres de la mort ». Ainsi il retrouve cette grande synthèse du
sommeil, le sommeil qui est repos et croissance, qui est « morte vivante ». La mystique de
la germination, si puissante dans l’œuvre de Lawrence, est ici une mystique du sommeil
souterrain, une mystique de la demi-vie, de la vie d’interrègne, qu’on ne peut saisir que par
le lyrisme de l’inconscient. Souvent l’intelligence et le bon goût sont d’accord pour faire des
objections à cette vie lyrique du rêveur. 22»
Aussi on peut lire dans Germinal : « Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse,
qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la
germination allait faire bientôt éclater la terre. 23» Comme le mineur dans les galeries, le rêveur du
terrier est appelé à germer. Cela signifie, encore une fois, qu’il est en gestation, amené à naître sous
forme de plante. Il est donc végétal et végétatif.
Cet état est celui du paresseux immobile.
« Il est extrêmement curieux que les êtres très intelligents soient souvent inaptes à
traduire les vérités du sommeil, les forces de l’inconscient végétant qui, dans la cavité
parfaite, comme une graine, absorbe « le secret de tout un monde en ses éléments ».
Pour peu qu’on s’oriente dans l’ombre, loin des formes, quittant le souci des dimensions,
on ne peut manquer de constater que les images de la maison, celles du ventre, celles de la
grotte, celles de l’œuf, celles de la graine, convergent vers la même image profonde. 24»
21 Perrault, Riquet à la houppe, éditions Barbin, 1687 22 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, p. 230 23 Emile ZOLA, Germinal, final 24 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, pp. 230-231
C’est en effet une certaine perfection qu’offre le terrier : « Le héros enseveli vit dans les
entrailles de la Terre, d’une vie lente, ensommeillée, mais éternelle. 25» Nous pensons que ce n’est
pas par hasard que Kafka prend pour héros de sa nouvelle une taupe plutôt qu’un autre animal
« sous terrain » : quand le mulot, la musaraigne, ou le lapin, ont une vie énergique et dynamique, la
taupe, elle, a une vie lente, végétative. Elle est myope, presque aveugle ; ses membres sont courts ;
son corps est raide ; et comme si tout cela ne suffisait pas, elle est laide : tous ces handicaps la
condamnent à une vie diminuée, sous-terraine et ensommeillée. C’est ce type de vie qui incite
Poucette à ne pas épouser la taupe « à la pelisse de velours noire » : « La taupe se présenta pour
emmener la petite Poucette sous la terre, où elle ne verrait plus jamais le brillant soleil, attendu que
son mari [la taupe] ne pouvait pas le supporter. 26» Aux côtés de la vie éclatante du plein jour, il faut
donc apposer la demi-vie du terrier.
Cette demi-vie ensommeillée, c’est clairement le sommeil de l’hibernation. Le terrier, à
l’instar de la grotte de l’ours, couve en lui cette rêverie du sommeil qui dure tout un hiver. « C’est là
que je dors le doux sommeil de la paix, du désir assouvi, du but atteint, du propriétaire. 27» Cette vie
de tranquillité, sans trouble, où l’on n’a plus qu’à dormir et manger, donne à rêver. La taupe du
Terrier de Kafka aime à contempler ses provisions : « De plus – c’est peut-être assez sot, mais il faut
dire la vérité – l’amour-propre souffre toujours quand on ne voit pas ses provisions en un seul tas,
quand on ne peut pas embrasser d’un seul coup d’œil tout ce qu’on possède. 28» Ce fantasme du
garde-manger va de pair avec le plaisir du terrier. On en retrouve une trace de ce binôme dans Le
Hobbit de Tolkien (Bilbo le Hobbit voit son garde-manger bien garni pillé par la troupe des Nains
voraces, perturbation qui va pour ainsi dire déclencher l’intrigue et conduire Bilbo à quitter son trou).
Le terrier est donc la promesse d’une vie sereine, où l’on a un toit et un garde-manger bien
rempli, soit une vie sans trouble, une vie d’ataraxie.
De même que l’imagination peut créer une montagne d’or en mêlant l’idée de montagne et
l’idée d’or29, elle peut créer un terrier merveilleux en mêlant les idées de confort et de trou de lapin.
Le terrier se prête bien à accueillir, dans l’imagination du rêveur, tout un imaginaire domestique,
tous les phénomènes de confort, de maison, de tranquillité, de silence.
Si le terrier est si merveilleux, c’est donc parce qu’il évoque à lui seul tous ces phénomènes :
fascination de l’habitat souterrain et de la facilité d’habiter, malice souterraine, plaisir de la cachette,
de l’isolement, de la solitude, jouissance de la protection, plaisir domestique et familial, jouissance
de la conquête et de la propriété, jouissance de la miniaturisation et de la puissance d’exister, force
terreuse de la germination, de la renaissance au jour, plaisir de l’hibernation, de la vie végétative et
paresseuse. Autant de phénomènes que l’enfant et l’adulte recherchent, en construisant cabanes et
25 Gaston BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, José-Corti, Paris, 1948, p.234 26 Andersen, Poucette 27 Kafka, Le terrier, Pléiade, Œuvres complètes II, p. 740 28 Kafka, Le terrier, Pléiade, Œuvres complètes II, p. 743 29 « Mais, bien que notre pensée semble posséder une liberté illimitée, nous trouverons, en l'examinant de plus près, qu'elle est en réalité resserrée en de très étroites limites, et que tout le pouvoir de création de l'esprit se ramène à rien de plus que la faculté de mêler, transposer, accroître ou diminuer les matériaux que nous offrent les sens et l'expérience. Quand nous pensons à une montagne d'or, nous ne faisons qu'unir deux idées compatibles, celle d'or et celle de montagne, qui nous sont déjà connues. » Hume, Enquête sur l’Entendement Humain
maisons, et en rêvant de terrier. Celui-ci offre à l’imagination le modèle d’une maison aux
caractéristiques exagérées.
Grâce à l’imagination et à sa tendance rêveuse à amplifier les phénomènes du normal et du
banal, le quotidien devient, ou redevient, merveilleux. Le conte et la littérature sont là pour revivifier
les phénomènes : ainsi l’apparition du terrier dans les livres a pour effet de revaloriser et de
ressusciter dans notre esprit le plaisir et le bien-être domestiques.
iiiCf. Loulou, de Grégoire Solotareff, où l’on voit Tom, le lapin, dans son terrier, confortablement installé.



















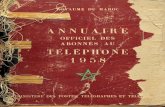





![“Le Monde à son image: le cinéma et le mythe d’Icare [Guest Lecture].”](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633d5f5ad0a2f101870ab50b/le-monde-a-son-image-le-cinema-et-le-mythe-dicare-guest-lecture.jpg)