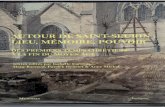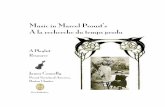Le temps profond et le temps perdu
Transcript of Le temps profond et le temps perdu
LE TEMPS PROFOND ET LE TEMPS PERDUUsages des neurosciences et des sciences cognitives en histoireRafael Mandressi Ed. Sc. Humaines | Revue d'Histoire des Sciences Humaines 2011/2 - n° 25pages 165 à 202
ISSN 1622-468X
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2011-2-page-165.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandressi Rafael, « Le temps profond et le temps perdu » Usages des neurosciences et des sciences cognitives en
histoire,
Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2011/2 n° 25, p. 165-202. DOI : 10.3917/rhsh.025.0165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Ed. Sc. Humaines.
© Ed. Sc. Humaines. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. © E
d. Sc. H
umaines
Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 2011, 25, 165-202.
Le temps profond et le temps perduUsages des neurosciences et des sciences cognitives en histoire
raFaeL Mandressi
RésuméDe même que dans d’autres sciences humaines et sociales, on a assisté en histoire, au cours de deux dernières décennies, à des tentatives de constitution d’un champ interdis-ciplinaire sur la base d’un croisement avec les neurosciences et/ou les sciences cogni-tives. Cette entreprise a donné lieu à la « neuro-histoire », à l’« histoire cognitive », aus-si bien qu’à d’autres formes, moins précisément définies, de travail historique attentif aux sciences du cerveau et de l’esprit afin de faire émerger un « nouveau paradigme ». Cet article vise à décrire ce paysage intellectuel et académique en expansion, ainsi qu’à en identifier les principaux domaines et enjeux – neuro-histoire de l’art, histoire cogni-tive des sciences, histoire des émotions, l’histoire dite « profonde », l’histoire littéraire, entre autres. On indiquera également, pour en proposer une analyse critique succincte, quelques-uns des problèmes théoriques et épistémologiques, non résolus, inhérents à ce type d’approche.
Mots-clés : Neuro-histoire – Histoire cognitive – Bio-histoire – Historiographie – Tour-nant cognitif – Historicité.
Abstract : Deep time and lost time : uses of neuroscience and cognitive science in historyAs in other human and social sciences, the constitution of an interdisciplinary subfield based on the « blending » of history and neuroscience and/or cognitive science has been pursued in the last two decades. These attempts gave rise to « neurohistory », « cognitive history », as well as to other forms, not so precisely defined, of historical work making much case of brain and mind sciences in order to build a « new para-digm ». This article aims to describe this intellectual and academic wide spreading landscape, and to identify its main areas and issues – neuro-art-history, cognitive histo-ry of science, the history of emotions, the so-called « deep history », historical literary studies, among others. Some of the theoretical and epistemological unsolved problems inherent to these approaches will also be pointed out and briefly analyzed from a cri-tical point of view.
Key-words : Neurohistory – Cognitive history – Biohistory – Historiography – Cogni-tive turn – Historicity.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
166
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
« Comment les neurosciences peuvent-elles nous aider à comprendre le passé ? » C’est pour répondre à cette question qu’un appel à communications lancé en février 2011 annonçait un workshop programmé les 6 et 7 juin au Rachel Carson Center de la Ludwig-Maximilians Universität à Munich1. D’autres questions déclinaient ensuite plus précisément les enjeux qu’on se proposait d’aborder : « Quelles idées et méthodes développées par les neuroscientifiques peuvent être utilisées par les historiens pour éclairer le passé d’un nouveau jour (et vice versa) ? Quelles nouvelles questions de recherche peuvent être suggérées aux historiens par les neurosciences (et vice versa) ? Quels sont les plus grands défis dans le développement de la neuro-histoire comme champ [de recherche] et comment peuvent-ils être surmontés ? Comment la neuro-histoire pourrait-elle éclairer l’interaction entre les individus et leur environnement, aussi bien dans le passé que dans le présent ? » Neuro-histoire : le mot, qui donne son titre au workshop en question, sert à désigner ce que les organisateurs définissent comme une « synthèse », en invoquant à ce propos les travaux de l’historien Daniel Lord Smail, notamment son ouvrage Deep History and the Brain (2008).
Dans un paysage intellectuel et disciplinaire des sciences humaines et sociales comme on tente dans ce dossier d’en dresser la cartographie, où la référence aux neurosciences et aux sciences cognitives a progressivement gagné une place significative, l’irruption de la « neuro-histoire » est donc récente. Il convient toutefois de préciser que Smail n’est pas le premier à employer le terme et n’est donc pas son créateur ; la « neuro-histoire » sert en effet à désigner, depuis au moins une dizaine d’années, dans certains milieux, l’histoire des neurosciences2. Or cette neuro-histoire n’est évidemment pas celle qui nous intéresse ici, mais bien celle que Smail introduit dans le quatrième chapitre de son livre, intitulé « The New Neurohistory » (p. 112-156), où l’usage du préfixe correspond à une opération analogue à celles ayant cours ailleurs dans la galaxie « neuro » en sciences humaines et sociales, c’est-à-dire la proposition d’établir un nouveau champ interdisciplinaire par le croisement, voire l’hybridation, de l’histoire et des sciences du cerveau.
1 Voir le texte de l’appel et le programme du workshop à l’adresse : www.carsoncenter.uni-muenchen.de/events_conf_seminars/event_history/2011/conf_ws_sem/neurohistory/index.html
2 C’est le cas de l’International Society for the History of Neurosciences (ISHN), fondée en 1995, et du journal officiel de la société, le trimestriel Journal of the History of the Neurosciences, fondé en 1992 par le neurologue britannique Frank Clifford Rose – voir aussi www.neurohistory.nl, site web de l’actuel éditeur en chef de la revue, le neurologue néerlandais Peter J. Koehler. Citons encore l’European Federation of Neurological Societies (EFNS), qui dans ses congrès annuels organise des « Neurohistory Tours », le premier ayant eu lieu à Vienne en 2002 (voir www.efns.org/ EFNS-Congresses.262.0.html). Si on voulait synthétiser à l’extrême, on pourrait définir cette « neurohistoire » en paraphrasant l’expression naguère utilisée pour caractériser une certaine histoire de la médecine, à savoir, en l’occurrence, une histoire des neurosciences faite par des neurologues pour des neurologues.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
167
Rafael Mandressi
Vingt ans de mariages
Voilà le propos de Daniel Smail, professeur au département d’histoire de l’université de Harvard, médiéviste dont le terrain de recherche principal a été, dès sa thèse de doctorat soutenue en 1994, les institutions de justice et les pratiques sociales à Marseille au xiVe siècle3. Ce propos, qui depuis 2008 a donné lieu à des suites et à des discussions dont il sera question plus loin, n’épuise pas, pourtant, les démarches tendant à allier la recherche historique et les études sur le cerveau et la cognition. Il s’en faut : la neuro-histoire reste, sur le plan quantitatif, largement minoritaire face à l’« histoire cognitive », qui apparaît d’abord au sein de l’histoire des sciences dans les années 1980 déjà4, pour être envisagée ensuite dans d’autres secteurs de la recherche historique – l’histoire des religions, par exemple5 – ainsi que dans des tentatives d’application plus générales à l’histoire culturelle dans son ensemble, voire de mise en œuvre d’une « historiographie cognitive »6. L’appellation, cependant, n’implique pas toujours le recours aux sciences cognitives, mais renvoie aussi à une histoire intellectuelle revisitée, ou à une histoire des systèmes conceptuels7. En histoire cognitive des sciences telle qu’elle existe depuis une vingtaine d’années, les allusions critiques sont fréquentes au « moratoire » de dix ans prôné par Bruno Latour « sur les explications cognitives de la science et de la
3 Voir, outre une vingtaine d’articles et de chapitres d’ouvrages collectifs, sMaiL, 1999 et 2003. Parmi ses quelques textes en français, citons son article paru dans les Annales (sMaiL 1997) et les plus récents sMaiL, 2005 et 2007.
4 L’étude de Reviel Netz sur la déduction dans les mathématiques grecques anciennes (netz, 1999) est souvent considéré comme ayant été sinon le fondateur de l’histoire cognitive, du moins le premier à l’avoir évoquée explicitement. Le terme était cependant déjà en usage, par exemple chez nersessian, 1987 et 1995, 202 ss. Voir aussi andersen et nersessian, 2000, PaLMieri, 2003 ; barker, 2006.
5 Un groupe très actif en la matière existe au département d’Études bibliques de la Faculté de Théologie de l’Université d’Helsinki, autour de Petri Luomanen, directeur du projet « Explaining early jewish and Christian Movements: Ritual, memory and identity » (www.helsinki.fi/teol/pro/rimi/project/index.htm). Ce projet, lié également à l’Helsinki Collegium for Advanced Studies, a été mis en place et réunit six chercheurs, dont Risto Uro, directeur du département d’Études bibliques. Petri Luomanen est par ailleurs le coordonnateur du « Nordic Network » « Socio-Cognitive Perspectives on Early Judaism and Early Christianity », où collaborent des chercheurs des universités d’Helsinki, Copenhague, Oslo, Heidelberg, de la MF Norwegian School of Theology à Oslo et de l’École de Théologie de Stockholm (THS). Pour ce qui est des publications liées directement ou indirectement à ces projets, voir, entre autres, LuoManen, Pyysiäinen et uro, 2007, où les auteurs promeuvent, à l’adresse des historiens des religions, le « paradigme radicalement nouveau » des « études cognitives de la religion » ; CzaChesz 2007a, 2007b et 2008 ; CzaChesz et bíró, 2011 ; uro, 2011a et 2011b. Signalons aussi la parution de plusieurs ouvrages annoncés pour 2011- 2013 par la maison d’édition londonienne Equinox, qui accueille nombre de travaux sur l’histoire et l’étude des religions dans des collections telles que « Religion, Cognition and Culture » : geertz et sinding Jensen, 2011 ; geertz, 2012, CzaChesz, 2012 ; syMonds, badoCk et oLiVer, 2012 ; xygaLatas et McCorkLe, 2013, CzaChesz et uro, 2013. Voir, enfin, le site web « Religion and Cognition » (www.religionandcognition.com) d’István Czachesz, « Privatdozent » à l’Université d’Heidelberg et fellow a l’Helsinki Collegium for Advanced Studies, dont on a cité ci-dessus quelques-uns des travaux.
6 Martin et sørensen, 2001.7 Voir par exemple LeFaiVre et tzonis, 2004, qui entendent proposer une « histoire cognitive de
l’émergence de l’architecture moderne », qu’ils situent dans une longue période allant de l’an 1000 jusqu’au début du xixe siècle. L’entreprise consiste à offrir une histoire des idées qui ne se limite pas au seul examen des textes théoriques sur l’architecture, mais à élargir l’idée même de « théorie » dans le sens de la trame « de désirs et de croyances, de principes et de catégories qui rendent possible la pensée architecturale » ; le but d’une histoire cognitive est ici de reconstruire « ce système conceptuel » (3-4).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
168
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
technologie » (sa « septième règle de méthode ») ; or dans l’édition de 1995 de la Science en action, Latour s’est cru obligé de préciser que ce moratoire « a été mal compris », puisqu’il ne désignait pas les sciences cognitives « fondées depuis peu8 » ; il « ne visait que l’obsession des épistémologues pour les idées, détachée de toute pratique scientifique »9.
À la neuro-histoire et à l’histoire cognitive il faudrait encore ajouter ce que d’aucuns ont appelé la « bio-histoire ». À la différence des deux premières, l’accent principal n’est pas mis ici sur les savoirs sur le cerveau, mais des zones de contact, voire de superposition, et des convergences fortes existent, en particulier avec les perspectives neuro-historiques mises en avant par Daniel Smail. On y reviendra. Rappelons seulement, dans ce premier tour d’horizon des « nouvelles interdisciplinarités » censées renouveler le regard et la recherche historiques, que la bio-histoire se définit, pour reprendre le titre d’un ouvrage du Britannique Stephen Boyden, comme l’étude de « l’interaction entre la société humaine et la biosphère », dans un cadre évolutionniste où, sur la base des savoirs biologiques, on tente de cerner l’émergence des capacités humaines à produire de la culture10. Vétérinaire et immunologiste de formation, Boyden est un des plus connus des tenants – et des vulgarisateurs – de cette histoire biologique des civilisations humaines à laquelle on rattache souvent aussi les travaux de Jared Diamond, physiologiste qui, après être passé par l’ornithologie et l’écologie, enseigne aujourd’hui au département de Géographie de l’université de Californie à Los Angeles11. Or la bio-histoire est aussi affaire d’historiens ; le plus représentatif en est sans doute Robert McElvaine, professeur au département d’Histoire du Millsaps College à Jackson dans le Mississipi et spécialiste reconnu de la Grande Dépression aux États-Unis. McElvaine est notamment l’auteur d’Eve’s Seed : Biology, the Sexes, and the Course of History (2001), où il s’attache à expliquer la domination masculine – « pourquoi la vie a été dramatiquement injuste avec les femmes » – en l’attribuant à une compensation par la subordination culturelle de ces dernières de l’« insécurité » qu’engendrerait chez les hommes leur incapacité naturelle à porter et nourrir les enfants – ce que McElvaine appelle l’« envie de l’utérus » et l’« envie du sein » : « la grossesse, l’accouchement et l’allaitement ont toujours constitué un “no-man’s land” », écrit-il. Deux « modes d’enquête » sont mobilisés dans cette entreprise : l’histoire des femmes et la « perspective néo-darwinienne qui est apparue dans le domaine de la
8 La référence est faite par rapport à la première édition de l’ouvrage, en 1987. L’appel à ce « moratoire » avait en réalité été lancé en 1986, dans le postscriptum à la deuxième édition états-unienne de Laboratory Life, co-écrit par Latour et Steve Woolgar (Latour et wooLgar, 1986, 280).
9 Latour, 1995, 596-597. Cette explication, donnée par Latour dans une note en bas de page, se complète par une appréciation générale sur l’intérêt des sciences cognitives, en particulier dans le domaine des études sur les sciences : « Le terme-parapluie de “sciences cognitives” est composé pour un tiers d’épistémologie qu’il faut donc continuer à combattre, pour un autre tiers de passionnants travaux en sciences biologiques et en intelligence artificielle auxquels il faut bien sûr s’intéresser comme à toutes les autres sciences, et pour un dernier tiers, enfin, d’études empiriques sur la pratique de la connaissance située et distribuée qui permet une étroite camaraderie avec le domaine des “sciences studies” ». Pour la critique du moratoire latourien du point de vue de l’histoire cognitive des sciences, voir, à titre d’exemple, Nersessian, 1995, 200-202.
10 boyden, 1992. Voir aussi boyden, 1987 et 2004.11 Voir diaMond, 1997 et 2005; diaMond et robinson, 2010.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
169
Rafael Mandressi
biologie évolutionniste12 ». Il s’agit, en somme, de « réunir la biologie évolutionniste néo-darwinienne et l’histoire afin de former une nouvelle manière de comprendre l’expérience humaine : la bio-histoire »13, où une place est réservée à la neurobiologie, en l’occurrence concernant les différences dans l’anatomie et les opérations cérébrales entre les sexes14.
Différentes mais apparentées, complémentaires à certains égards, la bio-histoire, l’histoire cognitive, la neuro-histoire – on pourrait ajouter aussi l’archéologie cognitive15 – appartiennent à un même continent intellectuel que l’on voit émerger dans les années 1990, globalement caractérisé par la volonté de s’attaquer à la question de la « nature humaine », de réintroduire le transculturel16 et les invariants de l’espèce comme des problématiques non seulement légitimes mais vertébrales dans la réflexion historique, et de mobiliser pour cela, de manière plus ou moins intensive, les neurosciences et/ou les sciences cognitives aux côtés de la biologie et de la psychologie évolutionnistes, la génétique, l’éthologie, la primatologie. Précisons toutefois que l’inventaire des travaux se réclamant d’une « histoire cognitive » en laisserait dehors un nombre significatif qui n’y font pas explicitement mention mais où on ne fait pas moins appel aux sciences cognitives – l’inverse, on l’a dit, est tout aussi vrai. Il en est de même pour la neuro-histoire vis-à-vis des neurosciences. Rappelons par ailleurs, si besoin est, que neurosciences et sciences cognitives comparaissent très souvent ensemble, quoique diversement articulées entre elles. Ajoutons enfin que non seulement ces disciplines ne constituent pas en elles-mêmes, comme on sait, des blocs unitaires, mais que de surcroît les usages qui en sont faits varient eux aussi, en fonction principalement de la poursuite d’objectifs théoriques différents : on adopte une approche plutôt qu’une autre, on n’exploite de ce qui est disponible qu’un faisceau de travaux et d’idées dont on privilégie certains aspects, on prend parti, bref, on opère des choix, circonscrits en outre par la capacité à atteindre un seuil de compétence dans les domaines dont on se sert – autrement dit, par les connaissances qu’on aura réussi à y acquérir pour pouvoir les manier.
Il en résulte un ensemble hétérogène, que l’expression « tournant cognitif » ne suffit pas à spécifier. On ne peut pas ici rendre compte de cette hétérogénéité dans le détail, mais elle se dessinera dans la description, nécessairement succincte, des principales lignes de force qui traversent les territoires où se jouent les tentatives d’alliage entre l’histoire et les sciences du cerveau et de l’esprit. Le corpus qui en est issu peut dans un premier temps être caractérisé par quelques traits particulièrement manifestes. La langue, d’abord, massive : à quelques exceptions près, la littérature en question est en anglais, traduisant une prédominance qui dépasse de beaucoup la part, déjà
12 MceLVaine, 2001, 3-5. Voir aussi le site web consacré à cet ouvrage : http://eveseed.net.13 Id., 6 ; c’est l’auteur qui souligne ; je traduis. Voir aussi, du même McElvaine, The Relevance of
Biohistory, The Chronicle of Higher Education, 49/8, 2002, b10 (le texte peut être lu à l’adresse : http://chronicle.com/article/The-Relevance-of-Biohistory/8186/).
14 Id., chapitre 3, p. 58-81, en particulier p. 61 ss.15 Parmi les travaux récents dans ce domaine, voir renFrew, Frith et MaLaFouris, 2009 ; MaLaFouris
et renFrew, 2010.16 Le terme « transculturel » est celui qu’on a cru correspondre le mieux en français au sens dans lequel
l’expression « cross-cultural » est employée dans les textes examinés ici, très majoritairement publiés en langue anglaise.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
170
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
majoritaire, de la langue anglaise dans les sciences humaines et sociales en général17. Plus spécifiquement, c’est aux États-Unis que l’essentiel de ces travaux sont produits ; d’où une coloration dans les questionnements et dans les prises de position qui fait souvent écho à des débats ayant cours dans les milieux universitaires états-uniens. Dans le même sens, rares sont les références à des textes publiés dans d’autres langues ou à des auteurs non-anglophones.
Pour ce qui est de la périodisation, on a indiqué précédemment que les débuts des usages des sciences cognitives en histoire datent du milieu des années 1990. Certes, des antécédents pourraient être cités si on acceptait de reprendre les filiations que les auteurs se donnent à eux-mêmes et à leur entreprise. On s’en abstiendra, dès lors qu’il s’agit moins de mises en perspective historiographiques que de la construction d’une autorité généalogique floue18. On assiste à une augmentation significative ainsi qu’à une diversification croissante des publications dans les années 2000, au cours desquelles les neurosciences font leur véritable entrée à part entière dans le champ historique – c’est-à-dire non pas uniquement comme composante des sciences cognitives, notamment dans l’obédience connexionniste, mais aussi en dehors de ce cadre – et trouvent leur premier moment de cristallisation effective avec l’introduction de la neuro-histoire à partir et autour du livre de Daniel Smail.
Sur le plan des accents thématiques, des objets, des terrains et des champs disciplinaires ou sous-disciplinaires on constatera, outre l’histoire des sciences et celle des religions dont on a déjà fait mention, d’autres zones de densité : l’histoire de l’art, que ce soit dans un périmètre classique ou élargi à la « culture visuelle », l’histoire littéraire, surtout marquée par une approche philologique, l’histoire culturelle, dans une moindre mesure la « world history »19, ou encore la critique historiographique. Dans ce dernier registre, on ne peut que citer encore une fois l’ouvrage de Smail, mais on retiendra aussi un court essai d’Aurelio Musi, professeur d’histoire moderne à l’université de Salerne, qui mobilise la neurobiologie de la mémoire afin d’étayer un propos contraire à « l’analogie entre linguistique et histoire », à « la vision de l’histoire comme langage » et au « primat du constructivisme et du subjectivisme dans la recherche historique », ses cibles principales étant les Annales, l’épistémologie de l’histoire de Paul Veyne et les idées de Hayden White20. Il en est de même pour le dernier livre de Geoffrey E. R. Lloyd, Cognitive variations : quoique davantage tourné vers une discussion aux confins de l’histoire et de l’anthropologie, Lloyd n’en poursuit pas moins, en faisant intervenir les sciences du cerveau et de la cognition, l’entreprise d’« en finir avec les mentalités » qu’il avait entamée en 1990 avec Demystifying mentalities21. Dans les deux ouvrages, le point de départ est la critique de la notion de « mentalité primitive » de Lucien Lévy-Bruhl et de l’« influence profonde » qu’elle a exercée – « surtout
17 Toutes les citations tirées de ces textes ont été traduites par mes soins.18 Les rares exceptions dans cette démarche ne proviennent d’ailleurs pas de l’histoire, le cas le plus
notoire étant à cet égard la sociobiologie d’Edward O. Wilson.19 Voir, par exemple, wiLLs, 2009.20 Musi, 2008, 12-13, 17, pour les citations. Le livre de Musi est préfacé par le neurobiologiste italien
Alberto Oliverio, ancien directeur de l’Institut de psychobiologie et psychopharmacologie de Rome.21 LLoyd, 2007. Pour en finir avec les mentalités est le titre de la traduction française (1993) de l’ouvrage
de 1990.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
171
Rafael Mandressi
en France mais pas exclusivement » – dans diverses disciplines, à commencer par l’histoire dans la tradition des Annales ; la Chine et la Grèce anciennes sont, aussi bien dans Demystifying mentalities que dans Cognitive variations, les terrains d’où Lloyd tire l’essentiel des exemples à l’appui de ses démonstrations22, mais c’est dans le plus récent des deux livres que ces dernières portent sur « l’unité et la diversité de l’esprit humain », analysées tour à tour à propos de la perception de la couleur, la « cognition spatiale », les types (kinds) naturels d’animaux et de plantes, les émotions, le « self », la causalité, la raison.
Si, toujours dans la tentative de dresser un premier portrait de notre corpus, on se tourne vers les périodes historiques concernées, on note que les époques moderne et contemporaine sont moins intensivement fréquentées que le Moyen Âge et l’Antiquité. On observera par ailleurs que les spécialistes de ces périodes sont plus enclins que les autres à la production de textes à vocation théorique ou programmatique : c’est le cas de l’antiquisant Geoffrey Lloyd, ou des médiévistes Daniel Smail et Barbara Rosenwein, ou encore de William Reddy, qui a consacré de nombreux travaux à la France postrévolutionnaire avant d’en venir récemment à l’histoire médiévale23. Aussi bien Rosenwein que Reddy, professeurs à l’université Loyola de Chicago et de Duke, à Durham en Caroline du Nord, respectivement, mènent depuis une quinzaine d’années des recherches sur l’histoire des émotions, au sein de laquelle l’un et l’autre se sont tournés vers la psychologie cognitive et/ou les neurosciences en en intégrant des aspects, de façon certes différente, dans des propositions pour un cadre méthodologique général24.
Les thématiques, les objets, les périodes, et a fortiori leur croisement, se reflètent naturellement dans le profil des revues qui accueillent les articles mêlant histoire, neurosciences et/ou sciences cognitives – « mélange » (blend) est en effet un des termes le plus souvent employés par les auteurs. Il en est ainsi d’importantes revues anglophones de philosophie et d’histoire des sciences, comme Philosophy of Science, d’études littéraires comme Poetics Today et New Literary History, spécialisées dans les mondes anciens et les études classiques comme Arethusa, ou à visée plus expressément interdisciplinaire, comme Configurations. On ne sera guère surpris de retrouver en bonne place parmi ces titres History and Theory, dont l’identité éditoriale est définie, depuis un demi-siècle, par la théorie et la philosophie de l’histoire. Articles, dossiers thématiques le cas échéant, revues critiques et comptes rendus d’ouvrages dessinent, dans ces publications périodiques, une surface historiographique dont on peut à certains égards discerner plus finement l’image qu’à travers les livres. Or cette surface, certes ordonnée par l’existence des quelques « attracteurs » qu’on vient de passer en revue, n’en est pas moins le lieu d’une dispersion tout aussi réelle. Alors que le nombre
22 LLoyd, 1990, 11-15, 163-204, passim. Je cite d’après la traduction française.23 Son dernier livre, dont la parution est annoncée pour l’automne 2012 chez les presses de l’université
de Chicago, est une histoire comparée des doctrines sur l’amour, le désir et la sexualité du xe au xiie siècle en Europe, en Asie du Sud-Est et au Japon (Voir reddy 2012).
24 Voir rosenwein, 2001, 2002, 2006, 2010 ; reddy, 2001a, 2001b, 2008, 2009a, 2009b, 2010 (cette dernière référence est une revue critique de l’ouvrage de Smail On deep history and the brain). Cf. les entretiens avec Rosenwein, Reddy et Peter N. Stearns sur l’histoire des émotions publiés dans la revue History and Theory dans PLaMPer, 2010. On reviendra sur ces questions plus loin.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
172
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
d’articles publiés est considérable, les dossiers thématiques, par exemple, sont rares – on ne peut citer, à proprement parler, que deux : « Literature and the Cognitive Revolution », et « The Cognitive Turn ? A Debate on Interdisciplinarity », parus dans les numéros du printemps 2002 (23/1) et de l’été 2003 (24/2) de Poetics Today25. On n’est pas, pour l’heure, en présence d’un « programme » véritablement structuré, mais plutôt d’un faisceau de convergences et de dénominateurs communs. On se propose dans ce qui suit d’en dégager les principaux, en faisant à la fois état, le cas échéant, des écarts et des divergences.
Arts et sciences
On s’y prendra en abordant en premier lieu deux des champs sous-disciplinaires, l’histoire des sciences et l’histoire de l’art, les plus fortement traversés par la tentation des tournants neuronal et cognitif. Des tournants – ou la volonté de les prendre – qu’il importe ici de ne pas confondre, précisément en ce qu’ils marquent de leurs prégnances respectives les mouvances tournantes, pour ainsi dire, chez les historiens des arts et ceux des sciences : du côté des premiers c’est le neuronal qui prévaut, tandis que le cognitif domine parmi les seconds. Il y a certes de la brutalité à résumer ainsi le clivage, les neurosciences en question étant, pour une bonne partie des travaux en histoire de l’art, des neurosciences cognitives.
C’est le cas du prolifique David Freedberg, historien de l’art, professeur à l’université Columbia et directeur de l’Italian Academy for Advanced Studies de la même université, qui dès la fin des années 1980 a « compris », écrit-il, que c’était « impossible d’étudier les réactions émotives à l’œuvre d’art sans connaître les principes de ce qui était alors la jeune neuroscience cognitive », que « le vieux formalisme était en train de mourir, et qu’on aurait pu récupérer les réactions émotives précisément à travers l’étude des systèmes neuronaux et des connexions synaptiques entre la rétine, le cortex visuel et d’autres parties du cerveau26 ». Ce spécialiste de l’art néerlandais et flamand des xVie et xViie siècles publie aussi bien dans The Art Bulletin ou Ricerche di Storia dell’Arte que, plus récemment, dans Trends in Cognitive Sciences et Frontiers in Human Neuroscience, où il n’est pas le seul signataire des articles27. Ses coauteurs sont, dans un cas, Sarah Lisanby, directrice du département de psychiatrie et des sciences du comportement de l’université Duke, et Fortunato Battaglia, de la Division de stimulation cérébrale du département de psychiatrie de Columbia ; dans l’autre, Vittorio Gallese, professeur de physiologie au département de neuroscience de la faculté de médecine
25 Des deux parties qui composent le premier des deux dossiers, seule la deuxième (« Cognitive Historicism: Situating the Literary Mind ») concerne des questions historiques, évoquées dans l’introduction générale par ailleurs. La publication de ce dossier, dirigé par Alan Richardson et Francis Steen, suscita un article critique de Hans Adler et Sabine Gross, paru dans le numéro suivant de la revue (23/2, été 2002, 195-220). Le second dossier réunit des répliques à ce texte. Deux autres dossiers, quoique non consacrés au thème du « tournant » ou de la « révolution » cognitive ni aux neuro-humanités, y sont néanmoins indirectement connectés. Tous les deux ont été publiés dans la revue History and Theory en 1999 et 2001 respectivement : « The Return of Science: Evolutionary Ideas and History » (38/4) et « Agency after Postmodernism » (40/4).
26 Freedberg, 2009b, 85.27 Freedberg et gaLLese, 2007 ; gaLLese et Freedberg, 2007 ; battagLia, Lisanby et Freedberg, 2011.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
173
Rafael Mandressi
de l’université de Parme, et membre du comité scientifique de la Fondation Fyssen en France. Gallese, dont les recherches en neuroscience cognitive à Parme comportent un axe sur « l’étude des corrélats neuronaux de l’expérience esthétique », faisait partie de l’équipe dirigée par Giacomo Rizzolatti qui a mis au jour, dans les années 1990, les « neurones miroirs », censés être impliqués dans les phénomènes d’empathie28. Gallese est de ceux qui défendent cette idée, mobilisée dans la littérature sur la neuro-esthétique29 ainsi que dans les travaux de David Freedberg sur la « neuroscience of response30 » en matière d’histoire de l’art. Empathie, émotion, mouvement, mémoire en sont au cœur, sur la base des « nouvelles découvertes sur les neurones miroirs, la simulation corporelle, l’imitation, la vision par action et la top-down modulation of bottom-up responses, c’est-à-dire la modulation cognitive de réponses de bas niveau qui atteignent le domaine corporel31 ». La voie neurocognitive empruntée par Freedberg répond à une conviction qui s’affirme chez lui surtout à partir du début des années 2000, à savoir qu’on devrait pouvoir « tracer quelques connexions entre la manière selon laquelle les images apparaissent et celle selon laquelle les spectateurs leur répondent sur le plan des émotions et des sentiments », et que « tout ceci devrait être démontrable en termes neuroscientifiques32 ». Ainsi la Lamentation de Giotto dans la chapelle des Scrovegni, le Compianto su Cristo morto en terre cuite de Niccolò dell’Arca à Santa Maria della Vita à Bologne (1485 ca.), la Pietà de Rosso Fiorentino au Louvre, Los desastres de la guerra de Goya, la Déposition de croix du Caravage au Vatican, mais aussi des photographies de Robert Capa ou de Don McCullin viennent illustrer, assez brièvement dans la plupart des cas, la démarche qu’il préconise : focaliser l’attention, à l’aide des neurosciences, sur la « réponse empathique » suscitée par une œuvre en interrogeant, entre autres, « la relation entre le mouvement corporel et l’expression de l’émotion » et « les voies par lesquelles la perception visuelle peut se transformer chez le spectateur en un sens du poids, de la sensation et des mouvements des corps représentés33 ».
Movement, embodiment, emotion, voilà les mots-clés de l’histoire de l’art neurocognitive de David Feedberg, proche de celle qu’entend pratiquer Pamela Sheingorn par « l’application des découvertes de la neuroscience et des études cognitives – spécialement dans les domaines de la perception, de l’evocriticism (une approche qui voit dans la narration une adaptation évolutive), les fonctions des neurones
28 Sur les neurones miroirs, voir, en français, la traduction de l’ouvrage de vulgarisation co-écrit par Rizzolatti et le philosophe des sciences Corrado Sinigaglia (rizzoLatti et sinigagLia, 2006).
29 Voir, dans ce même dossier, l’article de Fernando Vidal.30 J’ai préféré laisser l’expression en anglais pour éviter de choisir entre des équivalents possibles en
français du mot response aussi insatisfaisants que « réponse » ou, plus encore, « réception ».31 Freedberg, 2009b, 86 ; la phrase en anglais est dans l’original italien que je traduis.32 Freedberg, 2007b, 20-21. Le texte que je cite, publié en italien dans un ouvrage collectif, est une
version remaniée et augmentée d’un autre texte, publié en anglais la même année sous un titre identique (Freedberg, 2007a). Le livre italien auquel Freedberg contribue avec ce chapitre est paru chez le même éditeur que l’ouvrage de Rizzolatti et Sinigaglia cité en note 27.
33 Freedberg, 2011, 342-343. Même si les textes de Freedberg des dix dernières années reprennent tous assez largement les mêmes propos, on renverra aussi, pour en compléter l’aperçu, à Freedberg, 2006 et 2009a.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
174
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
miroir, et le cognitive blending »34. Et Sheingorn de rappeler qu’elle est « loin d’être la seule à prendre ce tournant », celui de la neuro-histoire de l’art (neuroarthistory), auquel participent John Onians, David Freedberg et Barbara Stafford35. On pourrait ajouter aux noms indiqués par Pamela Sheingorn ceux de Norman Bryson et Michael Baxandall36. Dans les marges ou à l’extérieur de l’histoire de l’art, citons le philosophe Denis Dutton, décédé en 2010 et auteur de The Art instinct : beauty, pleasure and human evolution (2009), reçu avec circonspection par Onians, qui trouve trop réductrice sa thèse sur l’enracinement d’un universel artistique dans une « inclination mentale unitaire » modelée par la sélection sexuelle à partir du pléistocène37. Thomas Habinek, spécialiste de la Rome antique et professeur de lettres classiques à l’université de Caroline du Sud, n’apprécie guère non plus l’idée d’un « instinct artistique » chère à Dutton ; il en prend distance dans un texte où il étend au domaine de l’art la perspective « naturaliste (ou, si l’on préfère, bio-matérialiste) » qu’il a adopté dans son champ d’études d’origine, la littérature latine. Tout comme la littérature, la religion, mais aussi la musique, la danse ou la cuisine, écrit-il, l’art n’est pas « naturel » au sens d’« inévitable ou universel dans chacune de ses manifestations particulières » ; les phénomènes regroupés sous cette appellation sont plutôt « le résultat et l’expression de stratégies différentielles produites par la nature de l’interaction humaine avec le reste de l’univers matériel, les autres humains y compris ». Étant donné la « plasticité » et la « connectivité » neuronales qui relient l’intérieur et l’extérieur de l’organisme humain, « on ne devrait pas être surpris que quelque chose comme l’art (ou la littérature ou la religion) apparaissent dans tous les contextes humains connus ; on ne devrait pas non plus être surpris que l’art, la littérature et la religion soient si différents d’un contexte à un autre38 ». Point d’« instinct de l’art » donc, mais un système nerveux central en prise avec l’environnement physique et social, une sorte de boucle neuro-culturelle où intervient un processus de « ritualisation » 39 : des traits formels sont sélectionnés, modelés et investis dans la production d’artefacts ; en retour, ceux-ci effectuent, au moyen de leur forme, « la ritualisation nécessaire des processus biologiques de la perception ». L’usage universel d’artefacts ritualisés – la ritualisation étant elle-même
34 sheingorn, 2010, 65-66. J’ai préféré garder l’anglais pour les deux mots en italiques : dans le cas d’« evocriticism » car il n’y a pas, à ma connaissance, d’équivalent français – cela pourrait être « évo-critique », mais ce n’est sans doute pas pertinent de créer ici un néologisme à des fins de traduction ; pour ce qui est de « cognitive blending » (ou « conceptual blending », ou encore « intégration conceptuelle »), il s’agit d’une théorie avancée en linguistique cognitive, notamment par Gilles Fauconnier et Mark Turner, dont la théorie de la métaphore a été un des champs d’application (voir, dans ce dossier, l’article de Jean-Michel Fortis) mais qui a été largement étendue à d’autres domaines (voir FauConnier et turner, 2002). Mark Turner lui-même s’est engagé, en ce sens, dans « l’étude cognitive de l’art, du langage et de la littérature » (tel est le titre de l’article qu’il a publié dans le numéro thématique de Poetics Today, 23/1, 2002, cité supra), et a dirigé un ouvrage collectif sur « la science cognitive et l’énigme de la créativité humaine », intitulé The Artful Mind – le quatrième chapitre du livre est Freedberg, 2006. Voir turner 2002, 2006.
35 onians, 2007 ; staFFord, 2007.36 bryson, 2003; baxandaLL, 1995, en particulier chap. III: « Shadows and Information ».37 onians, 2009, 109-110.38 habinek, 2010, 217, 218-219.39 habinek s’inspire dans son propos des travaux de l’anthropologue Roy Rappaport, de ceux de
l’archéologue et préhistorien Steven Mithen sur l’évolution et la ritualisation du langage, et du « darwinisme neuronal » de Gerald Edelman (voir raPPaPort, 1999 ; Mithen, 2005 ; edeLMan, 2004.)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
175
Rafael Mandressi
un trait universel – est ce qui « rend légitime l’application transculturelle de termes tels que “littérature” et “art” », sous réserve qu’ils soient accompagnés de qualifications relatives à des contextes spécifiques ; voilà pourquoi, nous rassure Habinek, « on peut tranquillement être un moniste matérialiste […] et étudier l’art, même l’art ancien ». Or ce qui vaut pour l’art ne vaut pas pour l’esthétique, car il n’y a « rien dans la pensée actuelle sur l’évolution humaine ou les neurosciences qui requière ou même autorise l’isolation ou la modularisation d’une faculté esthétique distincte, faisant partie de la constitution psychologique des producteurs ou des observateurs d’artefacts ritualisés – verbaux, visuels, ou autres40 ».
Après un appel à intégrer l’étude de la littérature latine dans une histoire des « embodied practices », attentive aux contributions des sciences cognitives à une meilleure compréhension du rôle des textes dans l’organisation de la capacité humaine de mimesis41, Habinek plaide pour la mise en œuvre d’une théorie du « cerveau étendu » dans l’approche de « ce que nous appellons art », en ébauchant ensuite un parallélisme entre la physique des stoïciens et les sciences du cerveau et de la cognition contemporaines42. C’est la conception d’un « esprit tentaculaire », qu’il reprend, plus récemment encore, dans un ouvrage collectif consacré à « tendre des ponts » entre les humanités et les neurosciences43. Ce livre, qui se présente comme « a field guide to a new meta-field », a été dirigé par Barbara Stafford : historienne de l’art, professeur émérite à Chicago, ancienne disciple d’Ernst Gombrich (tout comme John Onians, d’ailleurs), elle est, selon son éditeur (The University of Chicago Press), « à l’avant-garde d’un mouvement grandissant qui appelle les humanités à se confronter avec les réalités matérielles du cerveau44 ». Stafford met aussi volontiers en avant une deuxième compétence en histoire des sciences, ou plutôt des relations entre les arts et les sciences45. C’est en cette qualité qu’elle a publié en 2006 un assez long et très élogieux compte-rendu du livre The Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution (2004), de sa collègue de Columbia University Pamela Smith. On y apprend toutefois davantage sur les préférences théoriques et les travaux de Stafford que sur l’ouvrage commenté, qu’on lira avec profit, nous est-il recommandé, « à la lumière des recherches neurobiologiques contemporaines » 46.
La thèse de Smith sur le surgissement d’une « épistémologie artisanale » aux xVe et xVie siècles apporterait, en effet, de l’eau au moulin de l’« embodiment » comme clé d’un « nouveau type d’histoire », « cognitivement infléchie », que Stafford souhaite voir gagner du terrain. Avant de la mettre plus longuement en œuvre en 2007 dans Echo objects, elle s’était déjà attelée en 2004 à en fournir la « démonstration pratique et théorique » dans un article de la revue Configurations où, à la manière de Habinek avec les stoïciens, elle suggère des affinités fondamentales entre les théories de la connaissance des philosophes empiristes associationistes britanniques du xViiie siècle
40 habinek, 2010, 221-222.41 habinek, 2005.42 habinek, 2010, 229.43 habinek, 2011 ; staFFord, 2011a.44 staFFord, 2007, quatrième de couverture.45 Voir, par exemple, son étude sur l’imagerie médicale au xViiie siècle (staFFord, 1991).46 staFFord, 2006, 135.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
176
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
– David Hume au premier chef – et celles suggérées par les neurosciences cognitives. L’objectif est double, car il s’agit à la fois « de réinsérer le biologique dans la recherche sur les pratiques culturelles [et] d’insérer des indices (evidence) tirés des états mentaux du passé dans la recherche cognitive contemporaine »47. Les références de Stafford en la matière sont, d’une part, les mêmes qu’on retrouve quasiment partout ailleurs : Antonio Damasio et son Looking for Spinoza (2003), la Philosophy in the Flesh de George Lakoff et Mark Johnson (1999), Andy Clark et sa théorie de l’« extended mind »48. Viennent s’y ajouter les principaux tenants de la neuro-esthétique – Semir Zeki, Vilayanur Ramachandran –, les auteurs du numéro spécial, décidément influent, de Poetics Today, et le philosophe Daniel Dennett, dans ce dernier cas pour s’en démarquer en tant que « représentant clé » des « branches computationnelles des neurosciences […], lourdement tributaires de la linguistique et la philosophie analytique »49. Stafford leur préfère les efforts d’un Damasio ou d’un Clark en vue de redéfinir l’esprit comme « un organe biologique », très éloigné du « dispositif de raisonnement logique qu’on privilégie dans certains secteurs de l’intelligence artificielle »50. Mieux encore, et c’est une invocation moins courante, elle assoit sa démarche sur « la description énactive ou neuro-phénoménologique de l’intelligence logée dans le corps » – d’où le renvoi aux travaux de Humberto Maturana et Francisco Varela. À l’en croire, c’est aussi le cas de l’ensemble des auteurs qui ont participé, sous sa direction, à l’ouvrage collectif cité plus haut : « Nous sommes du côté des partisans d’une cognition énactive, incorporée (embedded), phénoménologique, et distribuée51. »
C’est un tout autre sillon qu’a choisi de creuser le philosophe canadien Paul Thagard, beaucoup plus attiré, précisément, par l’intelligence artificielle et les approches computationnelles de l’esprit. Son milieu académique, ses interlocuteurs intellectuels, ses supports de publication, son univers de références n’ont pratiquement aucune zone de contact avec ceux des Stafford, Freedberg, Habinek, et autres neuro-historiens de l’art et/ou de la littérature. Thagard s’occupe des sciences, mais ce n’est pas dans l’objet ou le terrain de ses recherches qu’il faut chercher (toutes) les raisons de cette différence – Stafford, on l’a dit, a aussi un pied dans l’histoire des sciences. On pourrait tout simplement l’attribuer à la pluralité de niches offertes par le tournant cognitif – c’est bien de lui au sens strict qu’il s’agit en l’occurrence. Or Thagard a pris ce tournant assez tôt. Suffisamment tôt, en réalité, pour ne pas omettre la chronologie d’une trajectoire qui est d’ailleurs représentative d’un courant bien caractérisé en histoire et philosophie des sciences – Nancy Nersessian, Hanne Andersen, Ronald Giere, Peter Barker et Xiang Chen en font aussi partie –, qui s’exprime notamment à travers les publications de la Philosophy of Science Association des États-Unis : les Proceedings de ses rencontres biannuelles et la revue Philosophy of Science, qui a par ailleurs absorbé les
47 staFFord, 2004b, 317.48 Voir CLark, 1997, CLark et ChaLMers, 1998 et CLark, 2008.49 staFFord, 2004b, 316.50 staFFord, 2006, 133.51 staFFord, 2011, 1. Sur la neuro-phénoménologie, voir dans ce dossier l’article de Wolf Feuerhahn.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
177
Rafael Mandressi
Proceedings en 199452. Pour ce qui est de Thagard, il se prononce dès 1980 « contre l’épistémologie évolutionniste » et plaide pour un modèle alternatif d’épistémologie historique concernant l’accroissement des connaissances scientifiques ; deux ans plus tard, une première version d’un modèle de son cru fait entrer l’intelligence artificielle dans ce qu’il appelle alors la « philosophie de la découverte » ; en 1986, ce sont des « modèles computationnels » qu’il propose, pour en venir en 1988 à une « philosophie computationnelle des sciences ». L’année suivante, enfin, il souhaite la « bienvenue à la révolution cognitive », qui permet à ses yeux de dépasser le « programme fort » en sociologie des sciences ainsi qu’une histoire ayant trop mis l’accent sur le contexte social au détriment des idées scientifiques53.
Directeur du Cognitive Science Program et du Computational Epistemology Lab à l’université de Waterloo, au Canada, Thagard a développé des outils informatiques dans le but de simuler les processus de découverte, d’évaluation et d’utilisation des théories, le tout en tenant spécialement compte de l’état des connaissances disponibles à chaque moment historique. Ce dernier point est crucial pour situer l’entreprise dans un horizon post-positiviste et la rendre compatible avec « les descriptions de la structure et du développement du savoir scientifique » offertes par des « historical philosophers of science » comme Thomas Kuhn ou Larry Laudan, « plus riches et historiquement plus adéquates » qu’il n’est possible d’en donner dans un cadre positiviste, mais qui souffrent néanmoins de « beaucoup d’imprécision et d’ambiguïté »54. On n’entrera pas dans les détails techniques du modèle computationnel élaboré par Thagard en collaboration avec le psychologue cognitif Keith Holyoak. Qu’il suffise de dire qu’il est issu d’une approche qui emprunte sa démarche aux « branches non-logistiques » de l’intelligence artificielle, et qu’il se concrétise en un programme informatique baptisé PI (pour « Processes of Induction »), dans lequel les structures de données de base sont des règles et des concepts, le processus central étant la résolution de problèmes (problem solving)55. Celui-ci donne lieu, quand il est actif, au déclenchement de plusieurs types d’apprentissage de nouvelles règles et de nouveaux concepts : généralisation, spécialisation, combinaison conceptuelle, abduction. Une fois qu’un problème a été résolu, la solution est stockée de telle sorte qu’elle peut être activée pour un usage analogique afin de suggérer la solution à un nouveau problème. Le problem solving analogique faisant usage des solutions stockées dans un réseau conceptuel, affirme Thagard, « capture » beaucoup de ce que Kuhn entend par la notion de paradigme56.
52 Voir, par exemple, pour les Proceedings of the Biennial Meeting of the PSA, les volumes contenant les « Symposia and invited papers » des années 1990 (section « Implications of the Cognitive Science for the Philosophy of Science », 419-448) et 1994 (section « Integrating Cognitive and Social Models of Science », 277-310). Cf. le numéro 67 de Philosophy of Science (septembre 2000), qui publie la seconde partie des Proceedings de l’année 1998 (section « Kuhn, Cognitive Science, and Conceptual Change », S208-S255).
53 thagard, 1989, 653-654. Ce texte fait partie d’un dossier spécial de la revue Social Studies of Science sur « Computer Discovery and the Sociology of Scientific Knowledege » ; cf. sLezak, 1989. Pour les autres articles qu’on vient d’évoquer, voir thagard, 1980, 1982, 1986, 1988, Le nombre des publications de Paul Thagard est considérable ; on ne retiendra ici que quelques-unes parmi les plus directement liées à notre propos. On pourra consulter la liste complète à l’adresse : http://cogsci.uwaterloo.ca/Biographies/pault.html.
54 thagard, 1986, 330 ; cf. thagard 1988, 35-37.55 Pour une description par le menu de PI et son fonctionnement, voir thagard 1988, 15-32, et 201-224.56 thagard, 1986, 331.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
178
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
« Ma conclusion », écrit-il en 1989, quand il était encore au laboratoire de sciences cognitives de l’université de Princeton, est que « les sociologues et les historiens des sciences devraient embrasser avec enthousiasme les nouveaux styles cognitivistes d’explication ». Et Thagard d’ajouter, à l’adresse de Bruno Latour et Steve Woolgar au sujet de leur appel à un « moratoire » de dix ans sur les explications cognitives de la science : « Un sociologue ou historien qui évalue le développement scientifique sans prêter attention aux objectifs intellectuels et aux processus cognitifs des scientifiques impliqués est comme un anthropologue qui fait du travail de terrain auprès d’une tribu étrangère sans connaître sa langue57. »
Dès 1990, Thagard met son modèle en application pour proposer des analyses historiques : il fait ainsi paraître une étude sur « la structure conceptuelle de la révolution chimique », où les techniques de l’intelligence artificielle sont mises au service d’un éclairage cognitif du « développement conceptuel » de Lavoisier entre 1772 et 1789, conduisant à la découverte de l’oxygène et à l’abandon de la théorie du phlogistique de Georg Ernst Stahl58. Dans Conceptual Revolutions, de 1992, ce cas est repris et augmenté de l’examen, sous le même angle, des « révolutions » copernicienne et darwinienne, alors que parallèlement, dans la poursuite de ses critiques à l’encontre des versions fortes de la sociologie des sciences, Thagard s’attache à montrer ce que pourrait être une approche « soft » où les explications cognitives, logiques et sociales du changement conceptuel seraient vues comme complémentaires et, par conséquent, intégrées dans un seul cadre capable de tenir compte des « interdépendances complexes de l’esprit et de la société ». De la nature aussi, dans un triangle dont on ne comprend que de façon limitée les « interactions causales » et qui nécessite, pour les mettre en lumière, de la psychologie, de la sociologie et de l’histoire. La situation qu’il convient d’encourager dans les études sur les sciences, estime Thagard en 1994, doit s’inspirer de celle de la « neuroscience cognitive », marquée par l’émergence d’une relation d’« interpénétration » plutôt que de « réduction » ou d’autonomie entre la psychologie et les neurosciences59.
L’intérêt pour le « changement conceptuel » et les « révolutions scientifiques » met les travaux de Thagard directement et explicitement en dialogue avec les thèses de Thomas Kuhn. Ce dialogue, moins fortement ancré dans l’intelligence artificielle, se prolonge jusque dans les années 2000 chez les autres auteurs déjà cités : ainsi Xiang Chen et Peter Barker avancent un modèle théorique sur le changement conceptuel au cours des « révolutions scientifiques » en utilisant des méthodes de la psychologie cognitive ; leur relecture de Kuhn dans cette perspective vise à contredire l’idée que les changements survenus au cours de ces épisodes « révolutionnaires », en particulier les changements taxonomiques, représenteraient une discontinuité60. Hanne Andersen et Nancy Nersessian, de leur côté, estimaient, en 2000 également, que « le développement du champ de la science cognitive au cours des trois dernières décennies a conduit à une compréhension de la représentation, du raisonnement et de l’apprentissage humains
57 thagard 1989, 654, 656.58 thagard, 1990.59 thagard, 1994a, 644, et 1994b, 301-303.60 Chen et barker, 2000, s209.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
179
Rafael Mandressi
qui confortent nombre des intuitions de Kuhn sur la pratique scientifique et fournissent des moyens pour s’attaquer à plusieurs des problèmes non résolus posés par le programme de recherche de Kuhn61 ». De même que Chen et Barker, elles s’intéressent à la problématique du changement conceptuel en relation à la représentation des concepts ; tout comme eux, elles avaient déjà beaucoup publié auparavant sur ces questions, et le feront encore par la suite, individuellement ou en collaboration : pour donner une « vision historico-cognitive » du problème de l’incommensurabilité62, pour proposer une étude de cas – par exemple « l’histoire cognitive » de la « révolution copernicienne », thème « kuhnien » s’il en est63 – pour faire le point sur « Kuhn et la science cognitive64 », pour tenter une synthèse65, ou encore pour définir les contours d’un programme d’histoire cognitive des sciences : c’est Nancy Nersessian qui s’y met, dans un article paru en 1995 dans la revue Osiris, c’est-à-dire dans un périodique plus historien que ceux habituels pour ce groupe post-kuhnien, naturellement plus proche de ce que réclamait Kuhn dans l’introduction à son ouvrage de 1962 – « un rôle pour l’histoire » – que d’une « histoire historienne des sciences » telle que pouvait la concevoir Jacques Roger66.
L’article de Nersessian est, comme elle l’écrit elle-même, « largement program-matique ». Son but est de « discuter les présupposés théoriques de l’histoire cognitive – elle nous append, au passage, que l’expression lui appartient – et d’esquisser un échantillon de projets de recherche et de problèmes » propres à cette « frontière » émergente. L’objectif dse Nersessian est d’« introduire les historiens des sciences aux développements accomplis dans les sciences cognitives », de donner un aperçu des recherches qui pourraient être menées en histoire des sciences sur la base d’une collaboration avec les « cognitive scientists », et d’y attirer les historiens67. L’histoire cognitive des sciences, rappelle l’auteur, met l’accent sur les « pratiques de pensée » à travers lesquelles les scientifiques créent, changent, et communiquent « leurs représentations de la nature » ; elle vise à « reconstruire les dimensions cognitives » des processus par lesquels des « spéculations vagues » sont articulées dans des propositions scientifiques qui en viennent à « remplacer les représentations existantes » dans un domaine donné. On étudiera en ce sens la mise au point et l’exécution d’expériences réelles et de « thought experiments », la construction d’arguments, l’invention et l’usage d’outils mathématiques, la création d’innovations conceptuelles, la conception de moyens pour communiquer les idées et les pratiques, et l’entraînement des praticiens. On s’interrogera, poussé par l’adoption de l’histoire cognitive, sur certains « enjeux métathéoriques centraux » pour l’histoire des sciences, tels que le statut des différents types de sources (« des journaux, des cahiers de laboratoire, des publications, de la correspondance, l’équipement expérimental, des dessins, des diagrammes, et des notes et des textes pédagogiques »), « ce qui compte comme “méthode” en science »,
61 nersessian et andersen, 2000, S224-S225.62 nersessian et andersen, 1997 ; barker, 2002.63 barker, 2007.64 nersessian, 1998 ; Chen, andersen et barker, 1998.65 andersen, barker et Chen, 2006 ; nersessian, 2008.66 kuhn, 1983, 17 ; roger, 1995.67 nersessian, 1995, 194.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
180
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
et comment les ressources culturelles à l’intérieur et à l’extérieur de la science « entrent dans le contenu représentationnel d’une théorie ». Ce qui pour Nersessian rend « cognitive » cette méthode d’analyse – la question méritait à ce stade d’être posée – est que « ses interprétations créent une synthèse de travail entre des études de cas sur des pratiques scientifiques historiques et les investigations des sciences cognitives sur le raisonnement et les représentations humains ». En d’autres termes, « l’histoire cognitive assume que la science est un produit de l’interaction de l’esprit humain avec le monde et avec d’autres humains. Elle présuppose que les pratiques cognitives inventées et développées par les scientifiques au cours de l’histoire sont des excroissances sophistiquées de la pensée ordinaire. La compréhension de la façon dont la science se développe et change requiert la connaissance aussi bien de ce que sont les pratiques concrètes des scientifiques et de la manière par laquelle les capacités et les limites cognitives humaines produisent et contraignent ces pratiques »68.
On peut légitimement se dire que dans l’exposé de Nersessian l’histoire cognitive des sciences ne diffère guère de l’histoire des sciences tout court. Des éléments additionnels sur les contributions spécifiques que pourraient y apporter les sciences cognitives sont évoqués par la suite, mais restent plutôt abstraits et à peine suggérés. La modélisation par des programmes en intelligence artificielle peut fournir des moyens pour réfléchir sur le degré de contingence et de fluidité inhérent aux processus historiques de découverte scientifique, nous est-il dit en rappelant les travaux de Frederic Holmes, historien de la chimie et de la médecine, sur le cycle de l’omithine découvert par Hans Krebs. Or le rôle de l’intelligence artificielle dans l’histoire cognitive était à l’époque pour Nersessian essentiellement indirect ; il en allait de même pour les neurosciences, dont les analyses dans le champ des activités cognitives humaines se situaient « à un niveau trop élémentaire ». Reste la psychologie cognitive, qui avait alors, toujours selon Nersessian, « le plus à offrir dans l’immédiat à l’histoire des sciences ». L’offre en question tient encore une fois en une énumération : elle concerne les analyses « centrées sur le développement cognitif et le changement conceptuel, et sur la résolution de problèmes, la compréhension et le raisonnement – en particulier, les domaines de la résolution analogique de problèmes, le raisonnement expert et novice, le raisonnement qualitatif, le raisonnement hétérogène et la modélisation mentale69 ».
Si ce texte demeure incontestablement laconique quant aux contenus véritablement opérationnels du « programme » qu’il avance, il est plus clair dans la désignation de ses adversaires intellectuels. Son titre, « Opening the black box », suffit à identifier l’espace polémique dans lequel il s’insère : l’allusion est on ne peut plus claire à l’image, employée par Bruno Latour, des « boîtes noires dont le fonctionnement n’a nul besoin d’être connu ». Empruntant l’expression aux cybernéticiens, qui l’utilisent « pour désigner un appareil ou une série d’instructions d’une grande complexité », et qui « dessinent une petite boîte dont ils n’ont rien besoin de connaître d’autre que ce qui entre et ce qui en sort », Latour s’en sert pour mettre entre parenthèses, dans sa méthodologie pour la sociologie des sciences, les propriétés épistémologiques des
68 Ibid., 194-195.69 Ibid., 197-198.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
181
Rafael Mandressi
artefacts scientifiques, partant leur analyse sous cet angle70. Or au-delà de Latour, c’est bien évidemment une certaine sociologie des sciences et une histoire des sciences qui s’en inspire qui sont visées, comme on l’a vu précédemment dans le cas de Thagard. « La rhétorique de beaucoup d’études “socio-historiques”, écrit Nersessian, est réductionniste et ouvertement anti-cognitive » ; une « conception particulière de la nature et de la production de la science » est mise en avant, face à laquelle l’histoire cognitive répond que « même s’il est vrai que la science est une construction sociale, elle est aussi la plus cérébrale des entreprises et les activités cognitives complexes du scientifique en tant qu’individu sont tout autant pertinentes pour une compréhension historique du résultat et des processus à travers lesquels celui-ci est produit ». Le postulat « réductionniste », ajoute-t-elle, qui prétend que « la production des connaissances n’est qu’un pur produit d’influences de l’environnement a de curieuses résonances avec la psychologie behavioriste71 ». Alors que le scientifique individuel a été transformé en boîte-noire (« black-boxed ») par l’analyse socio-historique telle que la pratique, par exemple, un Steven Shapin, l’histoire cognitive « tente d’ouvrir la boîte et de montrer comment le cognitif et le social sont imbriqués dans la construction de savoir par le scientifique ». Si, en définitive, on voulait situer l’histoire cognitive sur le plan historiographique, les intérêts et les préoccupations dont elle est porteuse ont des points de contact, d’après Nersessian, avec celles de l’histoire intellectuelle d’autrefois ; or elle entend « donner une analyse plus globale et nuancée du savoir scientifique ». La place qu’elle occupe se trouve ainsi, à l’instar de l’histoire des mentalités, « entre une histoire traditionnelle des idées scientifiques et une nouvelle histoire sociologique des sciences qui tend à marginaliser la dimension cognitive des pratiques scientifiques72 ».
Émotions et profondeur
Le Paul Thagard des toutes dernières années mis à part, nos historiens cognitifs des sciences, qui « abordent des problèmes habituellement traités sous les rubriques de révolutions scientifiques, découverte scientifique et créativité individuelle », dont les recherches « comprennent des travaux sur le changement conceptuel, les pratiques théoriques et expérimentales, et l’innovation méthodologique et technologique », ne font pas grand cas des émotions73. C’est exceptionnel. On a vu, incidemment, des neuro-historiens de l’art comme Barbara Stafford et, plus encore, David Freedberg, mettre les émotions au cœur des dimensions fondamentales à considérer dans l’optique de rendre « brain-based » l’étude des phénomènes et des objets historico-artistiques. Il en va pareillement pour la « poétique cognitive », que l’on a déjà retrouvée en évoquant à plusieurs reprises quelques numéros de la revue Poetics Today : dans une perspective
70 Latour, 1995, 21, 26.71 nersessian, 1995, 201.72 Ibid., 202.73 nersessian, 995, 202. Il faut noter, concernant Thagard, que quand il fait entrer la question des
émotions dans son travail, ce n’est pas à propos des sciences mais de littérature (voir, par exemple, thagard, 2011). On le voit également s’engager davantage dans le neuronal que par le passé.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
182
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
historique ou non, les émotions y figurent aussi en bonne place74. Ce n’est pas un pur effet de l’intérêt pour l’affectif qu’on associe usuellement à la saisie des pratiques esthétiques. L’émotionnel apparaît surtout comme un des enjeux transversaux de la mouvance neuro-historienne, en art comme ailleurs, en particulier à partir des écrits des neurobiologistes Antonio Damasio ou Joseph LeDoux75, inlassablement invoqués. Mieux : l’histoire des émotions en est elle-même un des foyers. On assisterait, à ce sujet, à une sorte de double tournant, ou de tournants emboîtés l’un dans l’autre, car il y aurait – on l’évoque en tout cas – un « emotional » ou « affective turn » en sciences humaines, tout spécialement en histoire76. Les « tournants » sont certes à accueillir avec la réserve qu’impose le constat de leur accumulation : une poignée de publications en quelques mois suffit parfois à les proclamer. Or l’histoire des émotions en a suscité bien plus qu’une poignée. Elle a donné lieu par ailleurs à la constitution d’équipes et de centres de recherche, au lancement de programmes d’étude77, à la tenue régulière de colloques, workshops et autres rencontres scientifiques. Si cela traduit ou non l’éclosion d’un tournant est une question qui ne mérite pas qu’on s’y attarde ; on préférera redire, en revanche, que ce « domaine bourgeonnant78 » a été propice aux questionnements neuro-historiques, d’une manière qu’illustre singulièrement l’itinéraire intellectuel de Daniel Smail.
74 Sur la poétique cognitive, voir, à titre de fenêtre vers une production assez abondante, tsur, 1983 et 1992 ; stoCkweLL, 2002 ; gaVins et steen, 2003 ; voir aussi le numéro 9/2 de l’European Journal of English Studies (2005). Pour des études historiques, le sous-dossier « Cognitive historicism: Situating the Literary Mind » du numéro 23/1 de Poetics Today (2002) et Lundhaug, 2008, parmi d’autres. La question des émotions est traitée, par exemple, dans oatLey, 1992, ainsi que dans les travaux de Reuven Tsur indiqués ci-dessus. Tsur, professeur émérite de théorie littéraire et de littérature hébraïque à l’université de Tel Aviv, y est à l’origine du Cognitive Poetics Project. Il est utile sans doute de préciser que la poétique cognitive n’est qu’une partie des études cognitives de la littérature, dont l’histoire littéraire neurocognitive.
75 Voir daMasio, 1994, 1999 et 2003 ; Ledoux, 1996.76 Voir par exemple, PLaMPer, 2010 ; CLough tiCineto, 2007, ainsi que le dossier de la Slavic Review
intitulé « Emotional Turn? Feelings in Russian History and Culture » (68/2, 2009, 229-334), avec des contributions, entre autres, de William Reddy, qui s’inscrit aussi dans l’autre tournant, celui neuro-cognitif (voir Supra). Citons également un autre dossier, publié cette fois-ci dans la revue Isis, où l’histoire des émotions est articulée à l’histoire des sciences, à titre de tournant interdisciplinaire au sein duquel une place singulière est faite aux neurosciences et aux sciences cognitives : « The Emotional Economy of Science », Isis, 100/4, 2009, 792-851 ; pour la mise en perspective de l’ensemble, voir l’introduction de Paul White, p. 792-797. Ajoutons encore les deux premiers numéros de la revue Écrire l’histoire (printemps et automne 2008), entièrement consacrés aux émotions, et le dossier spécial « History of Emotions » de l’Emotion Review (1/4, 2009).
77 Mentionnons le Centre of Excellence for the History of Emotions (Europe 1100-1800) de l’Australian Research Council (http://www.emotions.uwa.edu.au/), le Centre for the History of Emotions de Queen Mary University of London (http://www.qmul.ac.uk/emotions/), le Center for the History of Emotions (Geschichte der Gefühle) du Max-$lanck-Institut für Bildungsforschung à Berlin (http://www.mpib-berlin.mpg.de/de/forschung/geschichte-der-gefuehle), le réseau international CHEP (Cultural History of Emotions in Premodernity) créé à l’université d’Umeå en Suède, et, dans le domaine francophone, le programme EMMA: Les émotions au Moyen âge, coordonné par Damien Boquet et Piroska Nagy. Signalons également l’existence de deux projets de recherche en cours à l’Institut d’histoire de la médecine et de la santé de l’université de Genève (http://histmed.unige.ch/projects.php). Pour une vision d’ensemble très complète et actualisée de la recherche en histoire des émotions, on se reportera au site web du programme EMMA (http://emma.hypotheses.org/).
78 PLaMPer, 2010, 237.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
183
Rafael Mandressi
Avant d’en venir à sa proposition générale sur la neuro-histoire en 2008, Smail a en effet consacré nombre d’études aux émotions dans le cadre de la Marseille médiévale dont il est un spécialiste : en se penchant sur les gestes de l’émotion, mais surtout sur la haine et la colère, Smail plaide pour un nouveau regard historiographique sur la civilisation médiévale, « infantilisée » en raison même des excès émotionnels présumés qui en prouveraient « l’immaturité ». En ligne de mire, le Johann Huizinga de l’Automne du Moyen Âge et le Marc Bloch de la Société féodale, mais aussi le Norbert Elias du Processus de civilisation79. Ce point de vue est partagé par Barbara Rosenwein, une des historiennes les plus représentatives de la recherche en histoire des émotions80. Cette spécialiste du monachisme médiéval, qui en 1998 dirigea un ouvrage collectif sur les « usages sociaux » de la colère au Moyen Âge et forgea la notion de « communautés émotionnelles81 », a aussi en commun avec Daniel Smail – outre des remerciements réciproques pour des lectures critiques croisées de leurs textes respectifs – la description d’un modèle « hydraulique » de l’émotion82. Rosenwein est plus prolixe à ce propos – et, disons-le, plus approximative sur le plan de l’histoire des représentations du corps : dans ce modèle hydraulique, « largement dérivé de la conception des humeurs telle que la médecine médiévale l’avait élaborée et donc en accord avec les notions populaires occidentales concernant les passions », les émotions étaient perçues, « au sein de chaque personne, comme de grands liquides, enflant et moussant, avides de s’épandre vers l’extérieur ». Compatible avec les théories de l’énergie en vigueur lorsqu’écrivaient Darwin et Freud et encore dominant, selon Rosenwein, dans la première moitié du xxe siècle, le modèle hydraulique « fut détrôné, dans de nombreux cercles scientifiques, par la psychologie cognitive », qui fit passer les émotions « du champ des pulsions irrationnelles à celui de la pensée non-verbalisée ». Ceci s’est produit dans les années 1960 ; une décennie plus tard « apparut une autre théorie, encore moins hydraulique que la précédente : le constructionnisme social », qui peut être « fort » ou « mou » mais qui en tout cas soutient l’idée que « les émotions et leurs manifestations […] sont constituées et mises en forme par la société au sein de laquelle elles opèrent ». Le « constructionnisme83 », en somme, nie l’existence d’émotions fondamentales, à l’encontre de ce qu’avancent les « psychologues modernes » comme Paul Ekman. « Il me semble, conclut Rosenwein, que nous devons nous appuyer sur les thèses psychologiques actuelles », en les soumettant certes à un examen critique – c’est le cas vis-à-vis d’Ekman, par exemple –, sans oublier les travaux des neurobiologistes comme Damasio ou LeDoux ; il faut « arrêter d’imaginer que les modèles hydrauliques de
79 sMaiL, 2001, 92. Cf. sMaiL, 2003 et 2005.80 rosenwein, 2001, 317-318 ; et 2002, 823.81 rosenwein, 1998 ; en 2010, Rosenwein affirmait avoir introduit la notion de « communautés
émotionnelles » dans un article publié en 2002 dans The American Historical Review, intitulé « Worrying about Emotions in History » ; en réalité elle en faisait état déjà en 2001, dans un texte en français publié dans la revue Hypothèses : « Émotions en politique : perspectives de médiéviste ». Voir aussi rosenwein, 2006.
82 L’expression est du philosophe états-unien Robert Solomon, abondamment cité dans les travaux des historiens des émotions que nous considérons. Voir notamment soLoMon, 1993. Sur ses écrits en la matière, voir le dossier « Remembering Robert Solomon » de l’Emotion Review, 2/1, 2010.
83 Tel est le mot par lequel on traduit, dans le texte français d’où ces citations sont extraites, le terme anglais « constructionism » ; on aurait pu lui préférer « constructivisme », couramment employé également dans ce sens, qu’on a déjà utilisé ici et qu’on gardera dans ce qui suit.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
184
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
l’émotion sont valides » et laisser de côté, en conséquence, « deux mythes qui président à l’histoire des émotions » : celui qui les considère comme plus irrationnelles que la pensée, et celui selon lequel elles sont « des passions innées qui peuvent être exprimées directement sans être médiatisées par la culture84 ».
L’étude des émotions médiévales requerrait ainsi, dans cette vision, le concours de la psychologie cognitive, des neurosciences et d’un constructivisme social bien tempéré, moins difficilement conciliables qu’on aurait tendance à le croire. En effet, « cognitivistes et constructivistes sociaux […] abordent deux questions complémentaires » qu’on pourrait synthétiser ainsi : « la capacité physique et mentale d’avoir des émotions est universelle, mais les manières selon lesquelles les émotions sont elles-mêmes provoquées, ressenties, et exprimées dépendent des normes culturelles aussi bien que de propensions individuelles »85. Sur ce point, les vues de Rosenwein sont partagées par Damien Boquet et Piroska Nagy dans leur essai introductif au volume qu’ils ont codirigé sur Le Sujet des émotions au Moyen Âge (2009) : « Il existe deux constructivismes, radical ou modéré, dont le premier considère l’émotion comme totalement culturelle, tandis que le second laisse une place à une émotion pré-culturelle, naturelle ; enfin, est apparue une approche bio-culturelle de l’émotion qui cherche à concilier les tendances86. » L’aspect décisif, d’après Boquet et Nagy, réside dans le « changement de paradigme » intervenu au cours du dernier quart de siècle, au lendemain duquel « les approches scientifiques semblent de plus en plus s’accorder sur un point : on ne peut plus opposer raison et émotions, facultés cognitives et volitives d’un côté et l’affectivité corporelle et inconsciente de l’autre, comme l’a fait la pensée occidentale pendant des siècles87 ». Il s’agit de la remise en cause « d’un des fondements plus solides de la pensée occidentale du sujet », à laquelle ont contribué dès les années 1950-1960 les sciences du cerveau et la psychologie ; celles-ci « ont montré l’enracinement des émotions dans le cerveau même, en action dans les processus de décision “rationnels” ». Parmi les sciences « les plus exactes », poursuivent les auteurs, « la biochimie prouve aujourd’hui que les émotions, le “comment je me sens”, s’enracinent dans des processus se déroulant au niveau moléculaire », alors que parallèlement, « comme une réaction à une psychologie qui avait vu l’émotion du côté du physiologique, des courants nouveaux en psychologie (le cognitivisme) et en philosophie (la philosophie de l’esprit, philosophy of mind) sont venus souligner la composante cognitive à l’œuvre dans les mécanismes de l’affectivité »88. En tout état de cause, « l’opposition raison-émotion n’est plus revendiquée par personne dans les disciplines de l’émotion » aujourd’hui ; on admet la « relation conjointe
84 rosenwein, 2001, 318-319 et 323. Les mêmes arguments sont repris dans rosenwein, 2002, 835-837. Elle y revient encore, un peu plus longuement, dans rosenwein, 2010.
85 rosenwein, 2002, 836-837.86 boquet et nagy, 2009, 23. Le titre de ce premier chapitre de l’ouvrage est « Pour une histoire des
émotions. L’historien face aux questions contemporaines », p. 15-51. Celui du deuxième, qui complète le bloc introductif, est « Émotions et affects ; contribution de la psychologie cognitive » (p. 53-84), signé par Annie Piolat, professeur de psychologie cognitive et expérimentale à l’université de Provence et Rachid Bannour, à l’époque doctorant en psychologie dans la même université. Cf. nagy, 2007 ; boquet et nagy, 2008.
87 Ibid., 28.88 Ibid., 19-20.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
185
Rafael Mandressi
des émotions, et plus généralement de l’affectivité, avec les registres corporels et cognitifs […]. Par conséquent, le débat entre culturalistes et naturalistes, ou entre les deux réductionnismes, semble à peu près clos ; tous partagent ce qu’on peut appeler le cognitive turn survenu dans les trente dernières années »89. Pour l’historien, l’exigence est de ne pas se satisfaire d’une vision purement « naturelle » des émotions, mais il doit au contraire tenir compte du fait qu’entre le « substrat biologique fait de sécrétions hormonales et de réflexes psychomoteurs et les mises en situation dans les sources, il y a une multiplicité d’opérations (langagières, culturelles, institutionnelles, etc.) qui constituent ensemble l’objet émotion […] et lui confèrent une identité historiquement déterminée »90.
William Reddy est plus enclin que Rosenwein, Boquet et Nagy à combattre le constructivisme dans ses approches historiques et anthropologiques de l’émotion. « Une description cohérente du changement émotionnel doit trouver une dynamique, un vecteur d’altération, explique Reddy, en dehors des structures discursives et des pratiques normatives » ; les paroles et les gestes de l’émotion ne peuvent pas être adéquatement caractérisés « par la notion de “discours” dérivée des théories poststructuralistes de Foucault ni par celle de “pratique” dérivée des écrits théoriques de Bourdieu, Giddens et autres ». Ces notions ne tiennent pas compte de la « capacité unique » des énoncés et des actes émotionnels « d’altérer ce à quoi ils se “réfèrent” ou ce qu’ils “représentent” », une capacité qui en fait des énoncés autres que « constatifs » ou « performatifs », mais relevant d’un troisième type à part entière. Un énoncé émotionnel « est un effort du locuteur pour offrir une interprétation de quelque chose qui n’est pas observable pour aucun autre acteur », à savoir ce que le locuteur ressent effectivement. Un tel effort a un « impact direct sur les sentiments en question » : quand on demande à quelqu’un s’il est triste, cette personne peut authentiquement se sentir plus triste si la réponse est « oui », ou moins triste au cas où la réponse serait « non ». Inversement, « l’expression d’un sentiment peut facilement résulter en sa rapide dissipation » le cas échéant. En tout état de cause, « des modèles stables d’énoncés de ce type, répétés sur des années, ont des effets très profonds, déterminants dans la conformation émotionnelle » des individus. Reddy propose d’appeler « emotives » ces énoncés de l’émotion en vertu desquels le référent même de l’énoncé est transformé. C’est la notion-clé de son schéma théorique en vue d’échapper au relativisme que représente le « constructivisme émotionnel », étant entendu que « le caractère dynamique des énoncés et des gestes émotionnels est un facteur universel, central dans la configuration et l’altération du “discours” de l’émotion dans n’importe quel contexte »91.
Aux « emotives » vient s’additionner, chez Reddy, la notion de « régimes émotionnels », à la base selon lui de tout régime politique stable, et qu’il définit comme « l’ensemble des émotions normatives et les rituels officiels, les pratiques et les “emotives” qui les expriment et les inculquent92 ». Le cas auquel Reddy fait appel pour illustrer empiriquement ce cadre théorique est celui dont il est spécialiste, c’est-à-
89 Ibid., 31.90 Ibid., 37.91 reddy, 1997, 327, 331.92 reddy, 2001a, 129.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
186
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
dire la France entre 1700 et 1850. Toute la seconde moitié de son livre The Navigation of Feeling consiste ainsi en une étude historique des « régimes émotionnels » successifs qui ont à ses yeux marqué cette période dans le contexte français. Dans la première moitié de l’ouvrage, intitulée « What are Emotions ? », on retrouve deux groupes de réponses à cette question : celles de la psychologie cognitive (chapitre I, p. 3-33) et celles de l’anthropologie (chapitre II, p. 34-62) où réapparaît la défiance envers le constructivisme. Dans le chapitre suivant, « Emotional Expression as a type of Speech Act », Reddy s’emploie à élaborer « une nouvelle approche théorique des émotions capable d’intégrer les résultats » des deux autres, convaincu qu’il est que « la recherche en psychologie cognitive peut être enrôlée pour aider à résoudre les obstacles conceptuels qui sont apparus en anthropologie93 ». Or Reddy, un des rares historiens à ne pas se contenter des ouvrages de vulgarisation sur la psychologie et les neurosciences cognitives, ne se prive pas d’y jeter un regard critique et d’en appeler à un usage raisonné : « je ne recommande pas à tous les historiens de s’immerger dans la recherche en psychologie cognitive ou en neurosciences. Il faut noter, cependant, que les sociologues, les chercheurs en sciences politiques, et les économistes sont en train de développer activement des sous-domaines […] dont les paradigmes de recherche reposent sur les neurosciences cognitives. Je crois que la discipline de l’histoire peut s’en bénéficier de la même manière. En même temps, je crois aussi qu’“utiliser” simplement de façon acritique les résultats de la recherche dans ce domaine est une erreur sérieuse. […] Il n’y a pas de modèle général de la cognition ou du fonctionnement cérébral que les historiens puissent “emprunter”94 ».
Ces propos de Reddy ont été recueillis par Jan Plamper, lui-même chercheur au Centre pour l’histoire des émotions du Max-Planck-Institut für Bildungsforschung à Berlin, et publiés dans la revue History and Theory avec deux autres entretiens avec des historiens des émotions, Barbara Rosenwein et Peter Stearns. Ce dernier, professeur à l’université George Mason à Fairfax, dans l’État de Virginie aux États-Unis et fondateur en 1967 du Journal of Social History, est au départ, comme Reddy, un spécialiste de l’histoire de la France – du XIXe siècle en l’occurrence – qui a étendu ses centres d’intérêt à la « World History » et à l’histoire des émotions. Tout comme Reddy aussi, et comme Rosenwein d’ailleurs, Stearns a d’abord travaillé sur la colère – en collaboration avec son épouse Carol Zisowitz, médecin psychiatre – pour aborder par la suite la jalousie, l’autocontrôle et dernièrement la peur, le tout dans l’histoire des États-Unis, dont il a dirigé en 1998, avec Jan Lewis, une « histoire émotionnelle »95. Si les « emotives » et les « régimes émotionnels » sont les concepts créés par Reddy et les « communautés émotionnelles » celui que Rosenwein a proposé pour encadrer leurs interprétations historiques, Stearns a avancé, dès 1985, celui d’« émotionologie », qui renvoie aux normes qui dans une société régissent l’expression des émotions, visant par là une distinction entre les attitudes culturelles et l’expérience – l’émotion elle-même96. Dans ses réponses à Plamper, Stearns précise néanmoins que son intention
93 Ibid., 54-55.94 In PLaMPer, 2010, 249.95 stearns et stearns, 1986 ; stearns, 1989, 1999, 2006 ; stearns et Lewis, 1998.96 stearns et stearns, 1985.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
187
Rafael Mandressi
n’est pas de désigner l’« émotionologie » comme le foyer principal de l’histoire des émotions ; il ne s’agit que de souligner que quand on travaille sur la culture on ne décrit pas nécessairement l’expérience réelle, et que « la culture est beaucoup plus accessible ». Et Stearns de se déclarer « entièrement favorable aux efforts, comme ceux de Reddy et Rosenwein, pour aller au-delà de la culture ». C’est ce que lui-même a fait depuis son premier livre sur la colère, et, ajoute-t-il à propos des « découvertes dans les sciences de la vie » et des théories d’Antonio Damasio, « nous [historiens] avons besoin de nous en servir pour guider le travail historique, afin d’éviter entre autres les affirmations trop péremptoires sur le rôle de la culture et du changement contingent par opposition aux bases biologiques97 ». Les historiens, renchérit Rosenwein, doivent lire et absorber ce qui se fait dans les sciences de la vie, « en se méfiant toutefois des biais “présentistes” et “universalistes” » de celles-ci. Méfiances mises à part, « les émotions ont une réalité biologique, et elles peuvent être associées à certaines parties du cerveau et de la musculature faciale » ; les émotions, certes « “câblées” (hard-wired) », dit-elle, sont « comme des notes dans une gamme » : en contexte, leurs manifestations sont différentes, parfois autant « qu’une fugue de Bach et un rap hip-hop »98.
Daniel Smail n’est pas interrogé par Jan Plamper, Stearns ne le cite pas dans ses réponses, pas plus que Reddy ou Rosenwein, peut-être parce qu’il est déjà ailleurs, dans les plus vastes horizons de la neuro-histoire. L’étude de certaines émotions marseillaises au Moyen Âge tardif est pourtant une des pistes qui a conduit Smail dans cette voie. On reconnaît en effet, dans ses travaux sur la haine, l’embryon des idées qu’il développera par la suite, non seulement les références à des disciplines comme la psychologie, les sciences cognitives ou l’anthropologie cognitive à l’heure de rappeler, par exemple, que « la haine et la colère sont des traits caractéristiques normaux et même souhaitables de la conscience et de la société humaines », mais aussi à certains psychologues évolutionnistes qui soutiennent que « les sentiments moraux de la haine et de la colère ont évolué dans l’environnement ancestral de l’homo sapiens pour des raisons spécifiques qui ont à voir avec la formation de groupes, la punition des parasites non coopératifs, et la recherche du prestige ». Aussi « la haine sert-elle, comme toutes les émotions, d’importantes fonctions politiques et sociales dans les sociétés primates99 ». On voit dans ces passages de 2001 pointer déjà les deux volets qui s’articulent dans l’ouvrage de 2008 : l’histoire « profonde » et le cerveau. Le livre de Smail est en effet organisé autour de deux thèses, ou plutôt de deux plaidoyers, l’un concernant la chronologie et les périodisations en histoire – c’est le « deep » –, l’autre l’approche interdisciplinaire qu’il encourage à adopter en vue, précisément, d’embrasser cette histoire profonde à travers un objet qui lui paraît le mieux à même pour y parvenir – c’est le « brain ». La première thèse a vu le jour trois ans avant la parution du livre, dont l’introduction et les deux premiers chapitres reprennent assez largement un article publié par Smail dans The American Historical Review, où il décrit et conteste « l’emprise de l’histoire sacrée » sur les limites de l’intervalle chronologique
97 In PLaMPer, 2010, 262, 264.98 Ibid., 259-260.99 sMaiL, 2001, 93.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
188
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
à l’intérieur duquel se cantonne « l’histoire disciplinaire100 ». Tout se passe, selon Smail, comme si on reconduisait tacitement le récit chrétien de la création du monde il y a environ six mille ans, tout ce qui précède étant par conséquent exclu du champ de l’histoire stricto sensu et livré à des disciplines dont l’affaire serait, précisément, ce qu’on a désigné comme préhistoire. Il faut au contraire, écrit Smail, effacer cette frontière, sortir de la « chronologie courte », « déchirer le voile de la préhistoire » et faire entrer le paléolithique dans la sphère historienne. Il a écrit son livre à l’intention de lecteurs « intéressés par les origines et qui croient que l’histoire devrait commencer au commencement » et là où elle a commencé, en Afrique, ce dont même les synthèses en « world history » ne tiennent pas compte de manière significative101.
La « deep history » consiste donc, dans une première définition générale, à entreprendre un « récit qui reconnaisse la chronologie complète du passé humain ». Elle a en ce sens des points de contact avec la bio-histoire de Robert McElvaine, mais aussi avec la « big history » telle qu’elle se fait depuis les années 1990, elle-même ancrée dans une perspective de convergences disciplinaires avec les sciences de la vie et de la terre et apparentée, quoiqu’en dise Daniel Smail, avec la « world history »102. Les thèmes d’une « histoire profonde » peuvent « fusionner » autour de fils narratifs variés ; celui que Smail propose est « centré sur la biologie, le cerveau, et le comportement » ; en d’autres termes, afin de mettre au jour la « connexion » entre les mondes paléolithique et « postlithique », il a choisi de « prendre le dispositif (device) le plus évident pour rendre intelligible le passé profond, c’est-à-dire le cerveau ». La décennie du cerveau dans les années 1990 est passée par là qui a laissé aux historiens, entre autres, des enseignements qui se sont traduits sous la forme du « tournant biologique ou cognitif103 ». Smail entend capitaliser ces enseignements dans l’échafaudage d’une histoire nouvelle, la neuro-histoire telle qu’il la présente dans la seconde moitié de son ouvrage : le chapitre 4, qui lui est expressément consacré, et le chapitre 5, « Civilisation et psychotropes », où il explore quelques-unes des hypothèses historiques qui peuvent être élaborées à partir de ce que l’on sait sur la grande sensibilité à l’« input » culturel que présente la chimie du cerveau associée aux sentiments, à l’humeur et aux émotions. Ce dernier chapitre traite ainsi des activités et de la consommation de substances capables d’altérer les états affectifs – les techniques psychotropes – en agissant sur l’économie neurochimique de telle sorte que des changements collectifs durables peuvent en être induits. Tel est le cas, dans l’analyse de Smail, du xViiie siècle européen – certes moins « deep » que le paléolithique – qui a vu se développer considérablement les techniques psychotropes disponibles, du thé et du café aux pratiques érotiques. Voilà qui illustrerait une neuro-histoire appliquée, sous-tendue par l’idée, centrale, que le cerveau et la culture
100 sMaiL, 2005.101 sMaiL, 2008, 1-2, 9. « En nous déplaçant du sacré vers l’humain, d’un temps historique encadré par
la chronologie mosaïque à un temps défini par le cerveau et la biologie, nous apprenons à penser à l’Afrique comme notre patrie » (Ibid., 10).
102 Sur la « big history », voir notamment sPier, 1996 et, plus récemment, Christian, 2004 et 2011. Sur les rapports entre « big » et « world history », voir les articles de David Christian, professeur d’histoire à l’université de San Diego, en Californie, publiés dans le Journal of World History (Christian, 1991 et 2003). Notons au passage que l’expression « deep history » avait été employée avant Smail aussi bien dans le domaine de l’archéologie que par l’économiste marxiste David Laibman (LaibMan, 2007).
103 Ibid., 3, 7.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
189
Rafael Mandressi
interagissent constamment, se façonnent réciproquement, que la culture, en somme, « en un certain sens fondamental » est « un phénomène biologique. Câblée (wired) dans la neurophysiologie, se modelant sous la forme de réseaux neuronaux et de récepteurs, [elle] peut agir d’une manière relativement mécanique, quasi-biologique ». Si les historiens de l’Europe des xViiie et xixe siècles « avaient une meilleure connaissance de l’effet de la consommation de caféine sur le développement fœtal, ils pourraient être capables de suggérer quelques-unes des conséquences neurophysiologiques à grande échelle, quoiqu’entièrement involontaires, de la croissance rapide de la consommation de thé et de café ». En un mot, « la culture est rendue possible par la plasticité de la neurophysiologie humaine »104.
Pour en arriver à cette assertion, Smail a précédemment tracé, dans le chapitre sur la « nouvelle neuro-histoire », les contours de sa carte théorique. Damasio, LeDoux, Edelman sont, sans surprise, mobilisés à ces fins. Des archéologues, des paléontologues, des biologistes moléculaires, des généticiens, des primatologues aussi, qu’ils soient nommément cités ou non – ils sont « aussi des historiens, dit Smail, au-delà des archives qu’ils consultent »105. La sociobiologie d’Edward O. Wilson – à distinguer, souligne Smail, de la « pop sociobiology » – entre en ligne de compte comme antécédent, Stephen Jay Gould a une place importante en tant qu’introducteur du concept d’exaptation, « central pour l’idée de neuro-histoire », qui désigne « un trait, comme le gros cerveau cognitif, ayant évolué pour servir une fonction mais qui est ensuite devenu disponible pour des finalités totalement différentes »106. Hormones, neurotransmetteurs, « câblages » neuronaux, structures cérébrales, la chimie de l’organisme traversent ce que Smail définit comme « l’espace dans lequel l’histoire peut être informée par quelques développements récents en biologie, en neurophysiologie et en sciences cognitives »107. Il y a « un substrat biologique universel qui ne peut tout simplement pas être ignoré » ; les émotions sociales de base sont très certainement universelles, mais les comportements qui leur sont associés sont souvent plastiques : « une perspective neuro-historique de l’histoire humaine est construite autour de la plasticité des synapses qui relient une émotion universelle, comme le dégoût, à un objet ou un stimulus particulier, une plasticité qui permet à la culture de s’incorporer (embed) elle-même dans la physiologie ». Les « normes de genre (gender), comme constructions culturelles », par exemple, sont « embedded » dans la physiologie, et c’est « l’existence d’un tel câblage qui a fait que de nombreux observateurs aient commis l’erreur de croire que les caractéristiques de genre sont génétiques plutôt que culturelles »108. Aussi l’historien doit-il être attentif aux changements d’« écosystème neurophysiologique », à l’émergence de « nouvelles configurations neuronales ». Il doit également, en engageant sont travail dans la voie de l’histoire profonde, reconnaître « un legs génétique et comportemental du passé »109. Or la neuro-histoire n’est pas seulement profonde. Elle est aussi une « world history », dès lors que « l’équipement [neuronal] est partagé par tous les humains, même s’il est construit, manipulé, et orienté de façon
104 Ibid., 154.105 Ibid., 11.106 Ibid., 127.107 Ibid., 118.108 Ibid., 114-115, 153.109 Ibid., 118.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
190
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
différente par des cultures différentes ». L’histoire profonde, enfin, est une histoire avec laquelle « beaucoup d’entre nous pouvons nous connecter. Nous voudrons toujours savoir d’où viennent nos nations et nos économies. Nous voulons connaître les origines aussi bien des droits de l’homme que de l’intolérance. Nous voulons suivre les histoires d’hommes et de femmes et leurs modèles de sexualité. Mais nous voulons aussi comprendre pourquoi nos cerveaux et nos corps fonctionnent comme ils le font. Cette compréhension est impossible sans l’histoire ». Bref, « en introduisant la neurophysiologie dans l’histoire, nous introduisons l’histoire dans la neurophysiologie »110.
Les guerres et le temps
La traversée que nous avons faite jusqu’ici du sous-continent bio-neuro-cognitif de l’histoire a été rapide ; aussi son exploration n’a-t-elle pas été exhaustive, il s’en faut. Elle ne l’a pas été quant à sa surface : on n’a considéré que certaines régions, les plus peuplées sans doute, alors qu’il existe une périphérie composée d’isolats où on retrouve, pêle-mêle, des études cognitives sur les mentalités anglo-saxonnes, les couleurs dans la « world history », l’archéologie de la mémoire, l’humanisme de la Renaissance ou l’épique homérique111. Elle ne l’a pas été non plus pour ce qui est de l’épaisseur, car on ne pouvait pénétrer dans l’orographie fine de ce relief historiographique qu’au détriment, précisément, de la vision qu’on a voulu donner de sa surface – on n’a donné que quelques indications, par exemple, sur l’histoire cognitive des religions. On n’a pas tenté, enfin, une analyse critique de cette littérature ; volontairement, puisque ce n’était pas le propos ici. Elle reste donc à faire, et on se bornera, pour conclure, à renouer quelques fils pour une synthèse, provisoire, qui fera néanmoins état de quelques éléments pouvant annoncer des questionnements critiques à venir.
Relevons en premier lieu ce qu’on pourrait appeler un état d’esprit qui imprègne toute cette historiographie : l’enthousiasme, à la limite parfois du militantisme, qui a sa manifestation la plus évidente dans une rhétorique de la nouveauté. On n’est pas avare de proclamations de tournants ou de paradigmes radicalement nouveaux, voire d’annonces d’une nouvelle ère, à l’instar de ce qui est devenu coutumier dans une certaine écriture des neurosciences elles-mêmes. Les historiens n’en ont certes pas l’apanage, comme l’ensemble des articles de ce dossier le montre. Ce n’est pas non plus uniquement chez les historiens qu’on assiste à une sorte de traduction en langage neuronal, neuroscientifique ou cognitivisant de propos qui pourraient être formulés – ou qui l’ont déjà été – sans y faire appel. Les sciences du cerveau et de la cognition paraissent ne remplir, à ce sujet, qu’une fonction de marqueur sans influence aucune sur les modes d’analyse, le découpage des objets ou le traitement des sources. Ainsi par exemple l’hispaniste Carla Rahn Phillips, spécialiste de l’histoire navale et maritime espagnole à l’époque moderne, offre dans cette veine une étude sur La Vierge des Navigateurs, la pièce centrale d’un retable peint à Séville au xVie siècle par Alejo Fernández ; Phillips a été orientée vers la littérature sur les sciences cognitives, dit-elle, par le docteur James McIlwain ; elle a lu
110 Ibid., 201 ; c’est l’auteur qui souligne.111 harbus, 2010 ; FinLay, 2007 ; sutton, 2008, gouwens, 1998 ; MinChin, 1992.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
191
Rafael Mandressi
Baxandall et Cognition and the Visual Arts de Robert Solso (1994). Aussi s’en sert-elle en commentant la description du tableau faite en 1536 par un officier anonyme : celui-ci, écrit l’historienne, a déplacé son regard suivant « instinctivement et inconsciemment […] la trajectoire que la science cognitive moderne aurait prédite pour les spectateurs d’une œuvre d’art : du centre vers la périphérie, et des éléments les plus importants aux moins importants »112. On se demandera si le recours aux sciences cognitives était réellement nécessaire pour avancer cette assertion, mais on n’en saura pas davantage, car on n’y fera plus allusion dans la suite de l’article, qui fait en revanche appel à des outils pré-tournant. On peut penser que ce type d’usage des neurosciences et des sciences cognitives correspond à ce que Daniel Smail écrit, quelque peu naïvement, pour convaincre ses collègues de s’y adonner : « le public lecteur est tout à fait au courant des révolutions neuroscientifique et génétique des années 1990, et largement bien disposé envers elles. Les historiens risquent de s’aliéner ce public s’ils continuent d’ignorer cette partie de notre histoire qu’est le passé profond »113.
La profondeur : voilà un autre dénominateur commun, qui ne s’arrête pas aux confins de la « deep history » telle que Smail la promeut. Chez Smail lui-même, le profond ne concerne pas seulement la chronologie, mais transmet ses connotations à l’ensemble de sa démonstration. On a affaire, dans ses écrits aussi bien qu’ailleurs, à ce qui « sous-tend » (underlie), aux aspects de base, élémentaires, primaires, de l’expérience humaine. On vise à saisir cette expérience, « ce qui se passe véritablement », plutôt que les discours qui cherchent à l’exprimer. Il s’agit de « comprendre comment s’élabore une compréhension du monde en dehors d’un mode conscient », pour reprendre les termes de Lynn Hunt en expliquant son intérêt pour « les sciences du cerveau et de l’esprit114 ». Hunt, professeur à UCLA et spécialiste de la révolution française, de l’histoire culturelle de l’Europe, de l’histoire du genre et de l’historiographie, adhère au nouveau paradigme neuro-historien en tant que moyen pour passer des méthodes qui privilégient les énoncés à d’autres faisant une place à des matériaux plus représentatifs de l’expérience : « le monde n’est pas seulement discursivement construit. Il est aussi construit à travers l’embodiment, le geste, l’expression faciale, et les sentiments, à travers des modes de communication non linguistiques qui ont leurs logiques propres »115. La perception, les émotions, la religion, satisfont en tant qu’objets cette quête du profond, qui pour l’être doit nécessairement être « incorporé » et qui requiert, pour y accéder, d’une clé : le cerveau, lieu de convergence de toutes ces profondeurs qu’il faut par conséquent faire entrer dans l’histoire comme « cause matérielle ». C’est Jeremy Burman, chercheur au programme d’histoire et théorie de la psychologie à l’université York de Toronto, qui l’affirme ; après la « history from below », ajoute-t-il, la neuro-histoire, que Smail caractérise comme « une histoire culturelle profonde », représente l’avènement d’une « history from within116 ».
Pour bâtir cette nouvelle manière de concevoir et de pratiquer l’histoire, l’interdisciplinarité s’impose. Un des maîtres-mots à cet égard est « consilience »,
112 PhiLLiPs, 2005, 828..113 sMaiL, 2008, 10.114 In downs, 2003, 21.115 hunt, 2009, 674 ; cf. hunt, 2008.116 burMan, 2011.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
192
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
qu’Edward O. Wilson a choisi d’ailleurs pour donner titre à un des ouvrages, sous-titré « l’unité de la connaissance » (1998), dont on se réclame volontiers. Il convient de s’interroger sur les manières selon lesquelles cette interdisciplinarité est organisée, mais aussi sur le fait qu’elle est mise en avant comme une fin en soi. Smail : « qu’avons-nous à gagner d’une histoire profonde centrée sur l’héritage neurophysiologique de notre passé profond ? Eh bien, un des bénéfices est un nouveau type d’interdisciplinarité qui réunit les humanités et les sciences sociales aves les sciences physiques et les sciences de la vie. C’est, j’espère, quelque chose que nous aimerions tous viser »117. Pour y parvenir, on se fera une culture biologique et neurocognitive par la lecture des ouvrages de vulgarisation écrits par des spécialistes ; on les a déjà cités à plusieurs reprises : Antonio Damasio, Gerald Edelman, Joseph LeDoux, ou, plus localement circonscrits à certains domaines, Giacomo Rizzolatti, Humberto Maturana et Francisco Varela, Vilayanur Ramachandran. Des critiques surgissent alors de la part des quelques historiens plus versés que les autres en cette matière : William Reddy, féru de neurosciences et s’estimant raisonnablement compétent pour examiner les travaux de ses collègues sous cet angle, objecte ainsi à Smail son usage non suffisamment averti des champs scientifiques sur lesquels il veut asseoir son « blend » interdisciplinaire118. Il aurait pu adresser ce reproche à d’autres dont la démarche est analogue à celle de Smail – David Freedberg serait sans doute un des rares à y échapper.
Réviser, dépasser, à l’occasion rejeter les « anciens paradigmes » est une composante obligée dans l’élaboration ou la justification d’un paradigme nouveau. On a vu ce dont on veut prendre distance dans les diverses figures du « tournant » neuronal et cognitif ; ce qui suscite sinon l’unanimité du moins le consensus dans le rôle de repoussoir est le poststructuralisme, le postmodernisme, le tournant linguistique ou culturel, le déconstructionnisme, le relativisme, le « new historicism », le constructivisme. On touche ici à un aspect qui doit être mis en relation avec le contexte de floraison néo-paradigmatique en question, à savoir le milieu académique anglophone, plus particulièrement états-unien ; « l’idée de construction sociale est, parmi beaucoup d’autres, une idée farouchement combattue dans le cadre des guerres culturelles américaines », écrivait Ian Hacking en 1999119. Or les combats ne sont en l’occurrence quasiment jamais à mort ; on livre des batailles pour faire des prisonniers. En prenant bien soin de distinguer, chez l’adversaire, ce qui relève d’un programme « fort » et d’un autre « modéré » ou « faible ». En postulant aussi que l’approche neurocognitive de l’histoire est à même d’englober, de digérer pourrait-on dire, les tournants et paradigmes antérieurs. L’histoire cognitive des sciences n’est pas « réactionnaire », se défend étonnamment Nancy Nersessian, « puisque ceux qui la pratiquent ne se considèrent pas en conflit avec la sociologie des sciences120 ». On n’a pas besoin, dit Lynn Hunt, « de tourner le dos au marxisme ni au poststructuralisme. Il convient maintenant de revenir en arrière et de repérer les plages qui n’ont pas été éclairées, puis construire une boîte à outils mieux adaptée à la compréhension du fonctionnement des choses121 ». Freedberg
117 sMaiL, 2008, 9-10.118 reddy, 2010.119 haCking, 1999, Vii; par « américaines » il faut entendre « états-uniennes ».120 nersessian, 1995, 201.121 In downs, 2003, 21.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
193
Rafael Mandressi
abonde en ce sens, quoique de façon un peu moins œcuménique : « la résistance que les sciences humaines opposent à des affirmations générales sur le cerveau de l’homme, écrit-il, se fonde sur la crainte […] que l’accueil des découvertes scientifiques n’implique la capitulation du contexte, qu’il soit social ou historique. C’est une idée conventionnelle, faible et dépassée ». Et ailleurs : « la neurologie informe l’histoire. On n’a pas besoin d’être un matérialiste médical [sic] pour reconnaître cette possibilité. […] Étant donné la quantité de recherches récentes consacrées à la compréhension du substrat neuronal des réponses corporelles et émotionnelles, cela ne devrait être plus possible de parler de la construction sociale du comportement dans des termes qui ne soient pas infléchis par la prise en compte attentive de l’anatomie, la biologie et la chimie du cerveau humain122 ».
Si celle-ci est la principale « guerre américaine » dans ce qui nous intéresse ici, elle n’est cependant pas la seule. Daniel Smail en rappelle deux autres qu’il est utile de mentionner. La première d’entre elles enrôle la neuro-histoire profonde dans la lutte contre « l’essor du littéralisme biblique » : à une époque « où les présidents mettent en doute la vérité de l’évolution, ou l’enseignement de la biologie évolutionniste aux États-Unis est en train d’être rabaissé et les school boards parlent sérieusement sur la science de la création et l’intelligent design, il est d’autant plus important que les historiens soutiennent leurs collègues des sciences biologiques. Nous pouvons le faire en construisant une histoire humaine qui s’affranchisse de l’emprise de l’histoire sacrée » ; d’où l’intérêt de la « chronologie longue ». La troisième « guerre américaine » se livre intramuros : elle concerne la communauté historienne, confrontée dans nombre de départements universitaires au rétrécissement de la place qu’y occupent les périodes les plus anciennes à l’intérieur même de la « chronologie courte » et à leur marginalisation croissante. L’Antiquité « est déjà tombée de la falaise en éboulement qui représente la limite du temps historique. L’histoire médiévale de l’Europe vacille dangereusement sur le bord, et les modernistes s’y déplacent avec anxiété en voyant le sol se fissurer sous leurs pieds ». La neuro-histoire sert à renverser ce processus de mutilation du temps historique, un temps perdu pour la discipline que le recul explosif de la chronologie doit permettre de réintégrer ; on gagnera de la sorte de l’espace « non seulement pour l’histoire profonde mais aussi pour notre histoire moyenne, cette époque qu’on en est arrivé à appeler “pré-moderne” » au fur et à mesure que le temps se contractait vers le xxe siècle123.
Le temps historique. Consacrons-lui les dernières lignes. C’est probablement le principal enjeu, sur le fond, que l’histoire neuro-orientée et/ou cognitive invite à examiner. La question pourrait être posée en termes d’historicité, ou d’inscription historique des phénomènes et des objets étudiés, dès lors que ceux-ci sont traités à la lumière et même en fonction de propriétés biologiques, « câblées », enracinées dans les structures et les mécanismes cérébraux. On a pu faire état du principal critère de réponse : ce « câblage », ces structures et ces mécanismes, ces propriétés sont soumises au changement, partant traversées et travaillées par l’histoire. Elles sont en résonance, en interaction avec l’environnement culturel, les liens entre biologie et culture comportent
122 Freedberg, 2007b, 16 et 2007a, 17.123 sMaiL, 2008, 10-11.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
194
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
des influences réciproques, la dimension neurobiologique humaine s’insère dans une temporalité historique, elle se situe par conséquent à l’intérieur de l’histoire et non pas au dehors. Ces quelques principes, agrémentés notamment par des considérations plus ou moins érudites sur la plasticité des réseaux neuronaux, sont habituellement énoncés sous la forme d’avertissements. Ils traduisent, ou trahissent, le souci de ne pas laisser s’échapper une historicité qui rendrait l’entreprise neuro-historienne stérile. « C’est la nature humaine qui construit la diversité culturelle, et ce que nous appelons culture altère la “nature” biologique aussi bien de l’individu que de l’espèce », résume Thomas Habinek124. Des assertions analogues, presque interchangeables, ponctuent l’ensemble des exposés neuro-historiques et historico-cognitifs, donnant lieu parfois à des développements plus détaillés, mais toujours selon un mode théorique, plutôt abstrait, et reposant sur les synthèses déjà opérées, à l’intention d’un lectorat de non-spécialistes, par les scientifiques de référence. Elles ne sont certes pas pour autant moins recevables, ne serait-ce qu’en attente de travaux empiriques plus nombreux et plus achevés susceptibles d’en montrer la fécondité éventuelle. Pour l’heure, on ne dispose que de professions de foi qui, à force d’être répétées, risquent de se transformer en truismes. On récuse le « présentisme » et la téléologie, on écarte, pour cette raison, la psychologie évolutionniste du panier de disciplines scientifiques mises à contribution, on souligne que « reconnaître la réalité physique ou neuronale des humeurs et des prédispositions n’est pas adopter un déterminisme génétique cru » ; il s’agit encore moins, ajoute-t-on, de « la quête illusoire d’une nature humaine essentielle mise en place par la sélection naturelle dans le passé lointain, une position qui ne peut conduire qu’à une histoire-sans-changement naïve125 ».
On acceptera sans difficulté les réfutations anticipées que ces historiens opposent au grief qui pourrait leur être fait de fixer la matière mouvante de l’histoire au support prétendument immobile du neurocognitif. Le problème de l’historicité se pose de façon plus aiguë dans un autre registre. Le cerveau et son fonctionnement sont historiques. Soit. Son commerce avec la culture, avec un environnement physique lui-même changeant, le sont a fortiori. La nature humaine, si on consent à en localiser le foyer principal dans la matière cérébrale, l’est tout autant. Tout est soumis à une historicité irréductible, tout possède un mode d’existence historique qui réclame à être saisi dans sa singularité temporelle. Tout sauf les savoirs sur le cerveau et l’esprit. Des savoirs contemporains, qui sont censés fournir de quoi interpréter le passé en termes de synapses, de neurotransmetteurs, d’hormones, de prolactine et d’ocytocine, de neurones miroir et de darwinisme neuronal. Des théories scientifiques qui sont pourtant, comme toute autre, des artefacts historiques qui reflètent un état du savoir promis à des réaménagements et, dans une large mesure, à l’obsolescence. En historicisant le cerveau, tout se passe comme si on oubliait de dénaturaliser les savoirs scientifiques qui l’ont pour objet. Un temps s’est perdu apparemment en chemin, celui qui fait l’historicité des neurosciences.
Rafael manDressi
CNRS, Centre Alexandre-Koyré[email protected]
124 habinek, 2010, 216.125 sMaiL, 2008, 114.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
195
Rafael Mandressi
Bibliographies
andersen H et nersessian N. J., 2000, Nomic Concepts, Frames, and Conceptual Change, Philosophy of Science, 67, S224-S241.
andersen h., barker P, et Chen x., 2006, The Cognitive Structure of Scientific Revolutions, Cambridge, Cambridge University Press.
barker P., 2002, Kuhn, Incommensurability, and Cognitive Science, Perspectives on Science, 9/4, p. 433-462.
barker P., 2006, Towards a cognitive history of the Copernican revolution, Organon, 35, 61-72.
battagLia, F., Lisanby S.H., et Freedberg d., 2011, Corticomotor facilitation during observation and imagination in a work of art, Frontiers in Human Neuroscience, 5, 1-6.
baxandaLL M., 1995, Shadows and Enlightenment, Londres et New Haven, Yale University Press.
boquet D. et nagy P., 2008, Émotions historiques, émotions historiennes, Écrire l’histoire, 2, Les Émotions (2), 15-26.
boquet D. et nagy P., éd., 2009, Le sujet des émotions au Moyen âge, Paris, Beauchesne.boyden S. V., 1987, Western Civilization in Biological Perspective : Patterns in
Biohistory, Oxford, Clarendon Press.boyden S. V., 1992, Biohistory : the interplay between human society and the biosphere,
Paris, Unesco ; Carnforth, Lancs (RU) et Park Ridge (N.J.), Parthenon Pub. Group.
boyden S. V., 2004, The biology of civilisation : understanding human culture as a force in nature, Sydney, UNSW Press.
bryson n., 2003, The Neural Interface, in neidiCh, w., Blow-Up : Photography, Cinema and the Brain, New York, Distributed Art Publishers ; Riverside (CA), UCR-California Museum of Photography.
burMan J.t., 2011, History from within ? Contextualizing the new neurohistory and seeking its methods, History of Psychology, 14/3, n.p. Advance online publication. doi : 10.1037/a0023500
Chen x., andersen H.. et barker P., 1998, Kuhn’s Theory of Scientific Revolutions and Cognitive Psychology, Philosophical Psychology, 11, 5-28.
Chen x. et barker P, 2000, Continuity through Revolutions : A Frame-Based Account of Conceptual Change during Scientific Revolutions, Philosophy of Science, 67, S208-S223.
CLark a., 1997, Being there : putting brain, body, and world together again, Cambridge, MIT Press.
CLark a. et ChaLMers d., 1998, The Extended Mind, Analysis, 58/1, 7-19.CLark a., 2008, Supersizing the mind : embodiment, action, and cognitive extension,
Oxford, Oxford University Press.CLough tiCineto P., éd., 2007, avec haLLey J., The Affective Turn : Theorizing the
Social, Durham, Duke University Press.Christian d., 1991, The Case for Big History, Journal of World History, 2, 223-238.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
196
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
Christian d., 2003, World History in Context, Journal of World History, 14/4, 437-458.Christian d., 2004, Maps of time : an introduction to big history, Berkeley, University
of California Press.Christian d., 2011, et al., éd., Big history, Great Barrington (MA), Berkshire.CzaChesz i., 2007a, The transmission of early Christian thought : Toward a cognitive
psychological model, Studies in Religion/Sciences Religieuses, 36/1, 65-83.CzaChesz i.., 2007b, Magic and mind : Toward a new cognitive theory of magic, with
special attention to the canonical and apocryphal Acts of the Apostles, Annali di Storia dell’Esegesi, 24/2, Il cristianesimo antico e la « magia », 295-321.
CzaChesz i.., 2008, Metamorphosis and mind. Cognitive explorations of the grotesque in Early Christian literature, in seiM, T.K. et økLand, J., éd., Metamorphoses. Resurrection, body and transformative practices in early Christianity, Berlin, De Gruyter, 207-230.
CzaChesz i.., 2012, The grotesque body in early Christian literature, Londres, Equinox.CzaChesz i.. et bíró t., éd., 2011, Changing Minds : Religion and Cognition through
Ages, Louvain, Peeters.CzaChesz i.. et uro, R. (éd.), 2013, Mind, morality and magic. Cognitive science
approaches in biblical studies, Londres, Equinox.daMasio A.R., 1994, Descartes’error : emotion, reason, and the human brain, New York,
Putnam. [Tr. fr. : L’erreur de Descartes : la raison des émotions, Paris, O. Jacob, 1995]daMasio A.R., 1999, The feeling of what happens : body and emotion in the making of
consciousness, New York, Harcourt Brace. [Tr. fr. : Le sentiment même de soi : corps, émotions, conscience, Paris, Odile Jacob, 1999.]
daMasio A.R., 2003, Looking for Spinoza : joy, sorrow, and the feeling brain, Orlando, Harcourt. [Tr. fr. : Spinoza avait raison, Paris, Odile Jacob, 2003.]
diaMond J., 1997, Guns, Germs, and Steel : the Fates of Human Societies, New York, W. W. Norton. [tr. fr. : De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire, Paris, Gallimard, 2000.]
diaMond J., 2005, Collapse : how societies choose to fail or succeed, New York, Viking. [tr. fr. : Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2006.]
diaMond J. et robinson J., éd., 2010, Natural experiments of history, Cambridge (Mass.), The Belknap press of Harvard university press.
downs L.L., 2003, Lynn Hunt, de la révolution française à la révolution féministe, Travail, genre et sociétés, 10/2, 5-26.
edeLMan G.M., 2004, Wider than the sky. The phenomenal gift of consciousness, New Haven, Yale University Press. [Tr. fr. : Plus vaste que le ciel. Une nouvelle théorie générale du cerveau, Paris, Odile Jacob, 2004.]
FauConnier G. et turner M., 2002, The Way We Think : Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York, Basic Books.
FinLay r., 2007, Weaving the Rainbow : Visions of Color in World History, Journal of World History, 18, p. 383-431.
Fitzhugh M. L. et LeCkie W. h. Jr., 2001, Agency, Postmodernism and the Causes of Change, History and Theory, 40, 58-81.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
197
Rafael Mandressi
Freedberg, d., 2006, Composition and emotion, in turner, M., éd., The Artful Mind, Oxford, Oxford University Press, 73-89.
Freedberg d., 2007a, Empathy, Motion and Emotion, in herding k. et krause wahL a., éd., Wie sich Gefühle Ausdruck verschaffen. Emotionen in Nahsicht, Berlin, Driesen, 17-51.
Freedberg d., 2007b, Empatia, movimento ed emozione, in LuCignani G. et Pinotti A., éd., Immagini della Mente. Neuroscienze, arte, filosofia, Milan, R. Cortina, 13-68.
Freedberg d., 2009a, Movement, Embodiment, Emotion, in duFrêne t. et tayLor, a. C., éd., Cannibalismes disciplinaires : quand l’histoire de l’art et l’anthropologie se rencontrent, Paris, INHA/Musée du quai Branly, 37-61.
Freedberg d., 2009b, Immagini e risposta emotiva : la prospettiva neuroscientifica, in ottani CaVina, a., éd., Prospettiva Zeri, Turin, Umberto Allemandi & C., 85-105.
Freedberg d., 2011, Memory in art : History and the neuroscience of response, in naLbantian S., Matthews P.M. et McClelland J. L., éd., The Memory Process : Neuroscientific and Humanistic Perspectives, Cambridge (MA), MIT Press, 337-358.
Freedberg d. et gaLLese V., 2007, Motion, Emotion and Empathy in Esthetic Experience, Trends in Cognitive Sciences, 11/5, 197-203.
gaLLese V. et Freedberg d., 2007, Mirror and canonical neurons are crucial elements in esthetic response, Trends in Cognitive Sciences, 11/10, 411.
gaVins J. et steen g., 2003, Cognitive Poetics in Practice, Londres, Routledge.geertz A. w. éd., 2012, Origins of religion, cognition, and culture, Londres, Equinox.geertz A. w. et sinding Jensen J., éd., 2011, Religious narrative, cognition and culture,
Londres, Equinox.gouwens k., 1998, Perceiving the Past : Renaissance Humanism after the “Cognitive
Turn”, The American Historical Review, 103, 55-82.habinek t., 2005, Latin Literature between Text and Practice, Transactions of the
American Philological Association, 135, 83-89.habinek t., 2010, Ancient Art Versus Modern Aesthetics : A Naturalist Perspective,
Arethusa, 43, 215-230.habinek t., 2011, Tentacular Mind : Stoicism, Neuroscience, and the Configurations
of Physical Reality, in staFFord B.M., éd., A field guide to a new meta-field : bridging the humanities-neurosciences divide, Chicago, University of Chicago Press, 64-83.
haCking i., The Social Construction of What ? Harvard University Press, 1999. [Tr. fr. : Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ? Paris, La Découverte, 2001.]
harbus a., 2010, Cognitive Studies of Anglo-Saxon Mentalities, Parergon, 27, 13-26.hunt L., 2009, The experience of revolution, French Historical Studies, 32, 671-678.hunt L., 2008, Measuring time, making history, Budapest, Central European University
Press.kuhn T. 1983, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion.LaibMan d., 2007, Deep history : a study in social evolution and human potential,
Albany, State University of New York Press.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
198
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
Latour B. et wooLgar s., 1986, Laboratory life : the construction of scientific facts, with a new postscript and index by the authors, Princeton, Princeton University Press. [Tr. fr. : La Vie de laboratoire : la production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, 1988.]
Latour b., 1995, La Science en action. Introduction à la sociologie des sciences, Paris, Gallimard.
Ledoux J., 1996, The Emotional Brain : The mysterious underpinnings of emotional life, New York, Simon & Shuster. [Tr. fr. : Le Cerveau des émotions : les mystérieux fondements de notre vie émotionnelle, Paris, Odile Jacob, 2005.]
LeFaiVre L. et tzonis a., 2004, The Emergence of Modern Architecture : a documentary history from 1000 to 1810, Londres, Routledge.
LLoyd, G. e. r., 1990, Demystifying mentalities, Cambridge, Cambridge University Press. [tr. fr. : Pour en finir avec les mentalités, Paris, La Découverte, 1993.]
LLoyd, G. e. r., 2007, Cognitive variations. Reflections on the Unity and Diversity of the Human Mind, New York, Oxford University Press.
LuoManen P., Pyysiäinen I. et uro r., 2007, éd., Explaining Christian Origins and Early Judaism : Contributions from Cognitive and Social Science, Leyde, Brill.
Lundhaug h., 2008, Cognitive Poetics and Ancient Texts, in østreng w., éd., Complexity. Interdisciplinary Communications 2006/2007, Oslo, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters, 18-21.
MaLaFouris L. et renFrew C., éd., 2010, The cognitive life of things : recasting the boundaries of the mind, Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research.
Martin L. h. et sørensen J., éd., 2011, Past Minds : Studies in Cognitive Historiography, Londres, Equinox.
MceLVaine r., 2001, Eve’s Seed : Biology, the Sexes, and the Course of History, New York, McGraw Hill.
MinChin e., 1992, Scripts and Themes : Cognitive Research and the Homeric Epic, Classical Antiquity, 11, 229 – 241.
Mithen S.J., 2005, The singing Neanderthals : the origins of music, language, mind and body, Londres, Weidenfeld & Nicolson.
Musi a., 2008, Memoria, cervello e storia, Naples, Alfredo Guida.nagy P., 2007, Les émotions et l’historien. De nouveaux paradigmes, Critique, 716-
717, Émotions médiévales, 10-22.nersessian n. J., 1987, A Cognitive-Historical Approach to Meaning in Scientific
Theories, in nersessian n. J., éd., The Process of Science : Contemporary Philosophical Approaches to Understanding Scientific Practice, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 161-178.
nersessian n. J, 1995, Opening the Black Box : Cognitive Science and History of Science, Osiris, 2nd Series, 10, Constructing Knowledge in the History of Science, 194-211.
nersessian n. J. et andersen h., 1997, Conceptual Change and Incommensurability : A Cognitive-Historical View, Danish Yearbook of Philosophy, 32, 111-152.
nersessian n. J., 1998, Kuhn and the Cognitive Revolution, Configurations, 6/1, 87-120.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
199
Rafael Mandressi
nersessian n. J., 2008, Creating scientific concepts, Cambridge, MIT Press.netz r., 1999, The Shaping of deduction in Greek mathematics : A study in cognitive
history, Cambridge, Cambridge University Press.oatLey K., 1992, Best Laid Schemes : The Psychology of Emotions, Cambridge,
Cambridge University Press.onians J., 2007, Neuroarthistory : from Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, New
Haven et Londres, Yale University Press.onians J.., 2009, Evolved Tastes, The Wilson Quarterly, 33/2, 109-110.PaLMieri P., Mental models in Galileo’s early mathematization of nature, Studies in
History and Philosophy of Science, 34, 2003, 229-264.PhiLLiPs C.R., 2005, Visualizing Imperium, Renaissance Quarterly, 58, 815-856.PLaMPer J., 2010, The history of emotions : An interview with William Reddy, Barbara
Rosenwein, and Peter Stearns, History and Theory, 49/2, 237-265.raPPaPort r., 1999, Ritual and religion in the making of humanity, Cambridge,
Cambridge University Press.reddy W.M., 1997, Against Constructionism : The Historical Ethnography of Emotions,
Current Anthropology, 38/3, 327-351.reddy W.M., 2001a, The Navigation of Feeling : A Framework for the History of
Emotions, Cambridge, Cambridge University Press.reddy W.M., 2001b, The Logic of Action : Indeterminacy, Emotion, and Historical
Narrative, History and Theory, 40, Theme Issue : Agency after Postmodernism, 10-33.
reddy W.M., 2008, Emotional Styles and Modern Forms of Life, in karaFyLLis, n. et uLshöFer, g., éd., Sexualized Brains : Scientific Modeling of Emotional Intelligence from a Cultural Perspective, Cambridge, MIT Press, 81-100.
reddy W.M., 2009a, Saying something new : Practice theory and cognitive neuroscience, Arcadia : International Journal for Literary Studies, 44, 8-24.
reddy W.M., 2009b, Historical Research on the Self and Emotions, Emotion Review, 1, 302-315.
reddy W.M., 2010, Neuroscience and the fallacies of functionalism, History and Theory, 49, 412-425.
reddy W.M., 2012, The Making of Romantic Love : Longing and Sexuality in Europe, South Asia, and Japan, 900-1200 CE, Chicago, University of Chicago Press.
renFrew C., Frith C. et MaLaFouris L., éd., 2009, The sapient mind : archaeology meets neuroscience, Oxford, Oxford University Press.
rizzoLatti G. et sinigagLia C., 2006, So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni specchio, Milan, Raffaello Cortina. [Tr. fr. : Les Neurones miroirs, Paris, Odile Jacob, 2008.]
roger J., 1995 (1984), Pour une histoire historienne des sciences, in roger J., Pour une histoire des sciences à part entière, Paris, Albin Michel, 43-73.
rosenwein B.H., éd., 1998, Anger’s past : the social uses of an emotion in the Middle Ages, Ithaca (NY), Cornell University Press.
rosenwein B.H., 2001, Émotions en politique. Perspectives de médiéviste, Hypothèses, 2001/1, 315-424.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
200
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
rosenwein B.H., 2002, Worrying about Emotions in History, The American Historical Review, 107, 821-845.
rosenwein B.H, 2006, Emotional communities in the early Middle Ages, Ithaca (NY), Cornell University Press.
rosenwein B.H., 2010, Problems and methods in the history of emotions, Passions in Context, 1, 1-32.
sheingorn P., 2010, Making the Cognitive Turn in Art History : A Case Study, in baiLar, M., éd., Emerging Disciplines : Shaping New Fields of Scholarly Inquiry in and beyond the Humanities, Houston, Rice University Press, 65-110.
sLezak P., 1989, Scientific Discovery by Computer as Empirical Refutation of the Strong Programme, Social Studies of Science, 19/4, 563-600.
sMaiL d., 1997, Démanteler le patrimoine : les femmes et les biens dans la Marseille médiévale, Annales HSS, 2, 343-368.
sMaiL d., 1999, Imaginary Cartographies : Possession and Identity in Late Medieval Marseille, Ithaca, Cornell University Press.
sMaiL d., 2001, Hatred as a Social Institution in Late-Medieval Society, Speculum : A Journal of Medieval Studies, 76, 90-126.
sMaiL d., 2003, Enmity and the Distraint of Goods in Late Medieval Marseille, in Jaritz g., éd., Emotions and Material Culture, Vienne, Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 17-30.
sMaiL d., 2003, The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca, Cornell University Press.
sMaiL d., 2005, Emotions and Somatic Gestures in Medieval Narratives : The Case of Raoul de Cambrai, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 138, 34-47.
sMaiL d., 2005, In the Grip of Sacred History, The American Historical Review, 110, 1337-1361.
sMaiL d., 2005, La justice comtale à Marseille aux xiVe et xVe siècles, in boyer J.-P., MaiLLoux a. et Verdon L., éd., La Justice temporelle dans les territoires Angevins aux xiiie et xive siècles : théories et pratiques, Rome, École Française de Rome, 221-232.
sMaiL d., 2007, Témoins et témoignages dans les causes civiles à Marseille, du xiiie au xVe siècle, in ChiFFoLeau J., gauVard C. et zorzi a., éd., Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École Française de Rome, 423-437.
sMaiL d., 2008, On deep history and the brain, Berkeley, University of California Press.sMaiL d., 2010, On The Possibilities for a Deep History of Humankind, in baiLar M.,
éd., Emerging Disciplines : Shaping New Fields of Scholarly Inquiry in and beyond the Humanities, Houston, Rice University Press, 9-24.
sMaiL d., 2010, An Essay on Neurohistory, in baiLar M., éd., Emerging Disciplines : Shaping New Fields of Scholarly Inquiry in and beyond the Humanities, Houston, Rice University Press, 201-228.
soLoMon r., 1993, The Passions : Emotions and the Meaning of Life, Indianapolis, Hackett.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
201
Rafael Mandressi
sPier F., 1996, The structure of big history from the big bang until today, Amsterdam, Amsterdam University Press.
staFFord B.M., 1991, Body Criticism. Imaging the Unseen in Enlightenment Art and Medicine, Massachussets, MIT Press.
staFFord B.M, 2004a, Leveling the New Old Transcendence : Cognitive Coherence in the Era of Beyondness, New Literary History, 35/2, 321-338.
staFFord B.M., 2004b, Romantic Systematics and the Genealogy of Thought : The Formal Roots of a Cognitive History of Images, Configurations, 12/3, 315-348.
staFFord B.M., 2006, Working Minds, Perspectives in Biology and Medicine, 49/1, p. 131-136.
staFFord B.M., 2007, Echo objects : the cognitive work of images, Chicago, University of Chicago Press.
staFFord B.M., éd., 2011a, A field guide to a new meta-field : bridging the humanities-neurosciences divide, Chicago, University of Chicago Press.
staFFord B.M., 2011b, Crystal and Smoke : Putting Image back in Mind, in staFFord B.M., éd., A field guide to a new meta-field : bridging the humanities-neurosciences divide, Chicago, University of Chicago Press, 1-63.
stearns C.Z.. et stearns P. n., 1985, Emotionology : Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards, The American Historical Review, 90/4, 813-836.
stearns C.Z.. et stearns P. n., 1986, Anger : the struggle for emotional control in America’s history, Chicago, University of Chicago Press.
stearns P. n, 1989, Jealousy : the evolution of an emotion in American history, New York, New York University Press.
stearns P. n., et Lewis J., éd., 1998, An emotional history of the United States, New York, New York University Press.
stearns P. n, 1999, Battleground of desire : the struggle for self-control in modern America, New York, New York University Press.
stearns P. n., 2006, American fear : the causes and consequences of high anxiety, New York, Routledge.
stoCkweLL P., 2002, Cognitive Poetics : An Introduction, Londres, Routledge.sutton J., 2008, Material agency, skills and history : distributed cognition and the
archaeology of memory, in knaPPett C. et MaLaFouris L., éd., Material Agency : towards a non-anthropocentric approach, New York, Springer, 37-55.
syMonds J., badoCk A. et oLiVer J. (éd.), 2012, Historical archaeologies of cognition, Londres, Equinox.
thagard P., 1980, Against Evolutionary Epistemology, PSA : Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Volume One : Contributed Papers, 187-196.
thagard P., 1982, Artificial Intelligence, Psychology, and the Philosophy of Discovery, PSA : Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Volume Two : Symposia and Invited Papers, 166-175.
thagard P., 1986, Computational Models in the Philosophy of Science, PSA : Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Volume Two : Symposia and Invited Papers, 329-335.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines
202
Revue d’Histoire des Sciences Humaines
thagard P., 1988, Computational philosophy of science, Cambridge, MIT Press.thagard P., 1989, Welcome to the Cognitive Revolution, Social Studies of Science,
19/4, 653-657.thagard P., 1990, The Conceptual Structure of the Chemical Revolution, Philosophy
of Science, 57/2, 183-209.thagard P., 1992, Conceptual revolutions, Princeton, Princeton University Press.thagard P., 1994a, Mind, Society, and the Growth of Knowledge, Philosophy of
Science, 61, 629-645.thagard P., 1994b, Explaining Scientific Change : Integrating the Cognitive and the
Social, PSA : Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Volume Two : Symposia and Invited Papers, 298-303.
thagard P., 2011, The Brain is Wider than the Sky : Analogy, Emotion, and Allegory, Metaphor and Symbol, 26, 131-142.
tsur r., 1983, What is Cognitive Poetics ? Tel Aviv, Katz Research Institute for Hebrew Literature.
tsur r., 1992, Toward a Theory of Cognitive Poetics, Amsterdam, Elsevierd ; 2e éd. corr. et augm. : Brighton, Sussex Academic Press, 2008.
turner M., 2002, The Cognitive Study of Art, Language, and Literature, Poetics Today, 23/1, 9-20.
turner M., éd., 2006, The artful mind : cognitive science and the riddle of human creativity, Oxford, Oxford University Press.
uro R., 2011a, Kognitive Ritualtherien : Neue Modelle für die Analyse urchristlicher Sakramente, Evangelische Theologie, 71, 272-288.
uro r., 2011b, Cognitive and Evolutionary Approaches to Ancient Rituals : Reflections on Recent Theories, in turner, J. T., Dunderberg, I., BuLL, C. H. et Ingeborg Lied, L., éd., Mystery and Secrecy in Late Antique Thought and Praxis, Leyde, Brill.
wiLLs J.E. jr., 2009, Putnam, Dennett, and Others : Philosophical Resources for the World Historian, Journal of World History, 20, 491-522.
xygaLatas D. et McCorkLe, W. M. jr. (éd.), 2013, Mental Culture. Towards a cognitive science of religion, Londres, Equinox.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
bib
lio_s
hs -
-
193.
54.1
10.3
5 -
08/0
5/20
12 0
9h42
. © E
d. S
c. H
umai
nes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - biblio_shs - - 193.54.110.35 - 08/05/2012 09h42. ©
Ed. S
c. Hum
aines