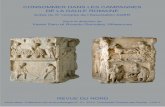Nouvelles données sur l'atelier d'amphores d'Albinia (Orbetello, Italie) : campagnes de fouilles...
Transcript of Nouvelles données sur l'atelier d'amphores d'Albinia (Orbetello, Italie) : campagnes de fouilles...
Monographies d’archéologie Méditerranéenne
hors-série n°5
Publication de l’uMR 5140 du cnRS« Archéologie des Sociétés Méditerranéennes »
Lattes2013
itinéraires des vins roMains en gaule iiie-ier siècles avant J.-c.confrontation de faciès
Actes du colloque européen organisé par l’UMR 5140 du CNRSLattes, 30 janvier-2 février 2007
Édités par
Fabienne OLMER
auteuR2
Les Monographies d’Archéologie Méditerranéenne sont destinées à promouvoir les résultats des recherches archéologiques conduites dans les régions bordant les rivages de la Méditerranée nord-occidentale (France, Italie, Espagne).
Les ouvrages constituant cette série sont à la fois limités et ouverts : limités à l’archéologie de la Préhistoire récente (Néolithique, Chalcolithique), de la Protohistoire (Âges du bronze et du fer) et de l’Antiquité (du début de l’Empire Romain au début du Moyen-Âge) ; limités à une approche scientifique du patrimoine antique des régions méditerranéennes ; ouverts vers toutes les disciplines et les champs d’investigation intéressant l’archéologie, et aux résultats des travaux de terrain comme aux synthèses thématiques ; ouverts enfin à tous les acteurs de l’archéologie, quelle que soit leur institution de rattachement.
Adresses
Rédaction, échanges - Monographies d’Archéologie MéditerranéenneCentre de Documentation Archéologique Régional390, Avenue de Pérols, F-34970, LattesFAX : 04.67.22.55.15 — e-mail : umrlat@cnrs. fr
Édition- Association pour le Développement de l’Archéologie en Languedoc-Roussillon (ADAL)Centre de Documentation Archéologique Régional390, Avenue de Pérols, F-34970, LattesFAX : 04.67.22.55.15
Diffusion- Librairie Archéologique, BP 90, 21803, QuétignyTel : 03.80.48.98.60 — FAX : 03.80.48.38.69 — e-mail : librarch@club-internet. frInternet : http ://www. libarch. com- Librairie Epona, 7 rue Jean-du-Bellay, 75004, ParisTel : 01.43.26.40.41 — FAX : 01.43.29.34.88 — e-mail : archeoli@club-internet. fr- ArqueoCat, C/Dinamarca, 3 nau 8, 08700, Igualada (Barcelona, España)Tel : 34.93.803.96.67 — FAX : 37.93.805.58.70 — e-mail : arqueocat@ciberia.
Rédaction des Monographies d’Archéologie Méditerranéenne
Directeur de la publication : Éric Gailledrate-mail : [email protected]
Comité de pilotage : Guy Barruol, Directeur de recherche honoraire au CNRS ; Pierre Garmy, Conservateur du Patrimoine ; Éric Gailledrat, Chargé de recherche au CNRS ; Jean-Pierre Giraud, Inspecteur général de l’Architecture et du Patrimoine/Archéologie ; Xavier Gutherz, Professeur de Préhistoire ; Thierry Janin, Professeur de Protohistoire ; Michel Py, Directeur de recherche honoraire au CNRS ; Claude Raynaud, Directeur de recherche au CNRS ; Martine Schwaller, Conservateur du Patrimoine honoraire.
Les manuscrits proposés aux Monographies d’Archéologie Méditerranéenne font l’objet de rapports par des experts extérieurs nommés par le Comité de pilotage.
Mise en page : Marie-Caroline Kurzaj, Eric GailledratTraitement du manuscrit et des illustrations : Marie-Caroline Kurzaj, Fabienne OlmerTraductions : André Rivalan, Franca Cibecchini, Nuria Rovira, Bettina Rautenberg-Célié
ISBN 978-2-912369-27-4ISSN 2111-7411
Sommaire
- Fabienne OLMERAvant-propos...................................................................................................................................................................................5
- Réjane ROURELes circulations entre Languedoc et Berry au Ve siècle avant notre ère : le champ des possibles (hypothèses et pistes d’étude)........................................................................................................................................................7
- Pierre SÉJALONLes faciès amphoriques précoces en Languedoc occidental......................................................................................................15
- Bernard DEDET et Jean SALLES L’Ermitage d’Alès (Gard): un oppidum-marché du Ier siècle avant J.-C. et la question des antécédents de la voie cévenole.........................................................................................................................................................................................23
- Élian GOMEZLes productions de vin et d’amphores tardo-hellénistiques à Saint-Michel (Agde-34)............................................................39
- Stéphane MAUNÉ La production d’amphores vinaires en Gaule Transalpine. État des lieux et perspectives (IIe-Ier siècle av. J.-C.)....................................................................................................................................................................57
- Michel PASSELAC Sur la voie d’Aquitaine : les amphores d’époque républicaine d’Eburomagus..........................................................................75
- Florence VERDIN, Frédéric BERTHAULT et Corinne SANCHEZ Le puits 41 de l’oppidum de l’Ermitage d’Agen (Lot-et-Garonne) : aperçu du faciès amphorique et questions de chronologie..................................................................................................................................................................................125
- Laurence BENQUET Les importations d’amphores au Ier siècle av. J.-C. : le faciès Toulousain...............................................................................139
- Frédéric BERTHAULT Bordeaux et le faciès girondin : entre Dressel 1 et Pascual 1...................................................................................................159
- Jean-Marc SÉGUIER et Lionel IZAC-IMBERTLes amphores italiques de deux sites du sud-Albigeois : Castres, « Lameilhé » et Montfa, « La Chicane » (Tarn)..............179
- Jaime MOLINA VIDAL Commerce et marchés de vin italique dans le sud de l’Hispanie Citérieure (IIIe-Ier siècles av. notre ère).............................195
- Joaquim TREMOLEDA TRILLA et Pere CASTANYER MASOLIVERLas ánforas republicanas itálicas de Catalunya (siglos III-I a.C.) : estado de la cuestión .....................................................213
auteuR4
- Verònica MARTÍNEZ FERRERAS La diffusion commerciale des amphores vinaires de Tarraconaise à Lattara (Lattes, Hérault)............................................257
- Céline BARTHÉLEMY-SYLVAND Les amphores républicaines en Région Centre : hiérarchie des voies commerciales............................................................275
- Yvan BARAT et Fanette LAUBENHEIMER Importation et consommation du vin chez les Carnutes de La Tène finale à Auguste...........................................................287
- Jean-Marc SÉGUIER La consommation des vins italiens chez les Sénons, les Meldes et les Parisii........................................................................295
- Fanette LAUBENHEIMER,Yves MENEZ et Solenn LE FORESTIER (en cours de relecture)Les amphores de Paule (Côtes d’Armor) et le commerce du vin au Second âge du Fer dans le nord-ouest de la Gaule............................................................................................................................................................................................315
- Andrew P. FITZPATRICK Republican Amphorae in Iron Age Britain...............................................................................................................................327
- Grégory VIDEAU Les amphores tardo-républicaines dans les habitats ruraux de la vallée de la Saône et la vallée du Doubs........................345
- Ulrike EHMIGLes traces des dernières Dressel 1 entre Rhin et Danube........................................................................................................371
- Stefanie MARTIN-KILCHER, Eckhard DESCHLER-ERB, Muriel ROTH-ZEHNER, Norbert SPICHTIG et Gisela THIERRIN-MICHAELLes importations en amphores dans la civitas Rauracorum (IIe/Ier siècle av. J.-C. – Ier siècle apr. J.-C.) : Bâle-usine à gaz, Sierentz, Sausheim, Bâle-colline de la cathédrale, Augst...........................................................................377
- Franca CIBECCHINI et Claudio CAPELLI Nuovi dati archeologici e archeometrici sulle anfore greco-italiche: i relitti di III secolo del Mediterraneo occidentale e la possibilità di una nuova classificazione....................................................................................................................................423
- Luc LONG, Giuliano VOLPE et Maria TURCHIANOL’épave tardo républicaine de La Ciotat : Les amphores, la céramique et les hypothèses épigraphiques............................453
- Simonetta MENCHELLI, Claudio CAPELLI, Marinella PASQUINUCCI, Giulia PICCHI, Roberto CABELLA et Michele PIAZZA Nuove scoperte d’ateliers di anfore repubblicane nell’Etruria settentrionale costiera .........................................................471
- Claudio CAPELLI, Roberto CABELLA et Michele PIAZZAAlbinia o non Albinia ? Analisi in microscopia ottica su anfore Dressel 1 rinvenute in Francia meridionale ....................479
- Gloria OLCESE, Stefania GIUNTA, Ioannis ILIOPOULOS et Claudio CAPELLI Indagini archeologiche e archeometriche preliminari sulle anfore di alcuni relitti della Sicilia (metà III-I sec. a.C.)....................................................................................................................................................................485
- Laurence BENQUET, Daniele VITALI et Fanette LAUBENHEIMERNouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) : campagnes de fouille 2003-2006........................513
- André TCHERNIATransport et choix des vins : quelques règles............................................................................................................................531
- Sébastien BARBERAN, Valérie BEL, Nathalie CHARDENON, avec la collaboration d’Anne BOUCHETTE (†), Vianney FOREST et Antoine RATSIMBA Le vin dans les pratiques funéraires du Midi de la Gaule aux IIe-Ier siècles av. J.-C. : l’exemple de la tombe du Mas Vigier à Nîmes (Gard)...............................................................................................................................................................................535
- Guillaume VERRIERLes faciès des céramiques à vernis noir entre Arvernes et Éduens (Auvergne, Forez, Bourgogne) aux trois derniers siècles avant notre ère............................................................................................................................................................................565
- Planches hors-texte................................................................................................................................................................575
Avant-propospar Fabienne Olmer
À la mémoire de Thérèse Panouillères etJean-Luc Fiches
Ce volume des Monographies d’Archéologie Méditerra-néenne porte les actes du colloque «Itinéraires des vins romains en Gaule (IIIe-Ier siècle avant J.-C.). Confrontations de faciès» qui s’est tenu à Lattes au musée Lattara - Henri Prades du 30 jan-vier au 2 février 2007, une réunion pluridisciplinaire et interna-tionale qui a réunit les compétences de chercheurs et d’ensei-gnants-chercheurs de trois disciplines majeures : l’archéologie, l’histoire économique et l’archéométrie. Il a permis d’aborder le sujet du grand commerce à l’époque tardo-républicaine au travers de thèmes novateurs qui doivent beaucoup aux résultats de l’archéologie préventive, qui grâce aux foisonnantes données nouvelles, conduisent à un renouvellement des interprétations économiques et sociétales pour cette partie de l’Antiquité, et qui accompagnent les résultats de nombreuses opérations de fouilles programmées et de travaux en laboratoire. Il est apparu fondamental d’effectuer un point sur les faciès pour tendre à mettre en évidence des voies puis à terme des filières d’appro-visionnement, ce qui se conçoit dans une perspective écono-mique, faisant intervenir des marchands de toutes les parties de Méditerranée occidentale : Romains, Gaulois, Grecs, Ibères... En effet, la recherche sur les diffusions de vin italique à l’époque tardo-républicaine a été, ces cinquante dernières années, sou-vent très théorique, s’appuyant sur des exercices typologiques voués à leurs contenants, les amphores, alors que les modalités des approvisionnements ont été souvent négligées. Dresser un inventaire des faciès régionaux apparaissait comme une étape préliminaire et incontournable à ces objectifs et permettre d’avancer dans d’autres directions.
Le programme correspondait à ces attentes scientifiques et de très nombreux collègues (54 intervenants) ont été conviés à présenter leurs travaux sur les faciès amphoriques très divers de l’ensemble du monde gaulois occidental et ses marges. Un point important sur les ateliers et leurs productions au regard des nouveaux programmes de recherche en Italie a également été réalisé. De nombreuses institutions ont ainsi collaboré à
cette manifestation : le CNRS, le Ministère de la Culture, l’Uni-versité, l’INRAP, les collectivités territoriales, le monde asso-ciatif, et les instances ou universités étrangères qui ont compté pour une part relativement importante : le Service archéolo-gique Cantonal du Valais, Suisse ; l’Università degli studi di Genova, Italie ; la Goethe-Universität, Frankfurt, Allemagne ; l’Université de Sotton, Grande-Bretagne ; la Surrintendance archéologique de la province de Naples, Italie ; l’Università de-gli Studi di Foggia, Italie ; l’Université de Berne, Suisse ; l’Uni-versité de Barcelone, Espagne ; l’Università degli Studi di Pisa, Italie ; l’Université d’Alicante, Espagne ; le Centre d’Arqueo-logia Subaquàtica de Catalunya, Girone, Espagne ; le Museu d’Arqueologia de Catalunya, Bercelone, Espagne ; l’Université de Fribourg, Suisse ; le Museu d’Arqueologia de Catalunya, Empúries, Espagne.
Les 35 contributions réunies proposent une vision large et riche des échanges durant près de trois siècles, de leur orga-nisation, de leurs mutations et de surtout du potentiel de la recherche future. J’espère que cette publication va permettre au plus grand nombre de nos collègues de mieux appréhen-der ces thématiques et d’en faire naître de nouvelles. Jean-Luc Fiches avait effectué les conclusions de ce colloque, avec cette fraîcheur intellectuelle qui le caractérisait.
Des collègues de l’UMR 5140 «Archéologie des Sociétés Méditerranéennes» ont apporté leur contribution au cours de la préparation et de l’organisation : Pierre Garmy, Christine Lucand, Albane Burens, Véronique Matthieu et Thérèse Pa-nouillères, qui nous a quitté peu de temps après.
Je remercie également David Lefèvre, directeur scienti-fique du Labex Archimède (Université de Montpellier III) pour le soutien apporté à cette publication (Labex ARCHIMEDE, programme IA ANR-11-LABX-0032-01). Je remercie enfin Eric Gailledrat, qui a accepté l’ouvrage dans la collection des Mo-nographies d’Archéologie Méditerranéenne, ainsi que Marie-Caroline Kurzaj pour le travail de mise en forme.
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) : campagnes de fouille 2003-2006
par Laurence BENQUET, Daniele VITALI et Fanette LAUBENHEIMER (1)
L’intérêt des chercheurs pour la vaste plaine qui s’étend autour de l’embouchure de l’Albegna a débuté dans les années 1970 (fig. 1). Dès 1977, D.P.S. Peacock signale dans un article la présence d’un vaste atelier d’amphores républicaines lon-geant la via Aurelia moderne aux environs du centre urbain d’Albinia (Peacock 1977 : 266-267). L’existence d’un ancien quai mentionné par des sources anciennes, dans Itinerarium maritimum par exemple, sur les rives de l’Albegna près de son embouchure avec la mer tyrrhénienne a conditionné de nouvelles recherches afin de démontrer l’ampleur du site. Les campagnes de prospections menées par l’université de Sienne sous la direction de D. Manacorda et les fouilles pratiquées par la Surintendance des Biens Archéologiques de Toscane sous la direction de G. Ciampoltrini démontrent la complexité de cet établissement articulé autour d’importantes zones ar-tisanales, dont les productions circulaient par voie terrestre grâce à la proximité de la via Aurelia et par voie maritime grâce aux installations portuaires mises en évidence dans la localité de Torre Saline (Ciampoltrini 1984 ; Hesnard et al. 1989 : 21-24).
Depuis 1999, la plaine comprise entre la rive droite de l’Albegna, la via Aurelia, le tracé de la voie ferroviaire reliant Pise à Rome et la ville d’Albinia, a fait l’objet d’investigations annuelles de terrain de la part du département archéologique de l’Université de Bologne dans le cadre d’un programme de recherche italiano-français né de la participation de l’équipe aux fouilles sur l’oppidum de Bibracte. La problématique de cet axe de recherche est centrée sur les aires géographiques de production des amphores et la diffusion du vin romain en Gaule. Suite aux travaux sur les amphores découvertes en Bourgogne qui ont permis de mettre en évidence une voie commerciale privilégiée entre les régions viticoles d’Etrurie et les sites de consommation longeant l’axe Rhône-Saône durant les deux derniers siècles avant notre ère (Olmer 2003 : 200-203), F. Olmer et D. Vitali ont coordonné entre 1999 et 2001 un
projet de recherche sur le territoire d’Albinia. L’attention s’est focalisée sur la zone signalée de manière imprécise par Peacock afin de repérer topographiquement les vestiges décrits ; tout d’abord par un ramassage de surface de matériel céramique (1999), puis par un programme de prospections géophysiques (2000) enfin une concession pour une fouille fut accordée par la Surintendance de Toscane (Olmer et al. 2001-2002) (2).
1. présentation générale
Les fouilles menées depuis 2001 (Olmer, Vitali 2002 ; Vi-tali et al. 2004 ; Vitali et al. 2005a) ont mis au jour un vaste complexe artisanal d’environ 1500 m² spécialisé dans la pro-duction d’amphores mais également dans celle de matériaux de construction (briques, tuiles, tomettes…) ainsi que dans celle de vaisselle de cuisine et de table (fig. 2). Durant deux siècles, au gré des inondations de l’Albegna les sols furent rehaussés et les fours se superposèrent les uns sur les autres. Grâce à cette stratigraphie une chronologie relative des productions ampho-riques a pu être établie (Benquet, Mancino 2006).
Le site se développe comme un grand bâtiment rectangulaire (fig. 3) orienté est-ouest renforcé par des contreforts extérieurs quadrangulaires et fermé par de longs murs en blocs de calcaire dont le plus important vestige court sur près de 30 m du côté de la via Aurelia. À l’intérieur de cet espace, les restes de quatre grands fours (F1, F2, F6 et F7) subsistent. De plan rectangulaire, deux batteries formées de deux fours accolés se font face et sont séparées par un couloir central de circulation ouvert sur l’extérieur à chaque extrémité. Deux séries de bases de pilastres quadrangulaires distribuées avec régularité ont été localisées dans les deux secteurs opposés à l’arrière des batteries de fours. Ce réseau de pilastres correspond à des espaces couverts similaires à des appentis nécessaires à l’activité des potiers : modelage et séchage des amphores et également, peut-être à leur stockage après cuisson.
Laurence BENQUET et al.514
Fig. 1 : Situation géographique du site d’Albinia (Grosseto, Italie).
Fig. 2 : Photographie aérienne du site après la campagne de fouille 2005 (photo A. Gottarelli).
Fig. 3 : Plan de la fouille (relevé C. Calastri).
Fig. 4 : Four F1, vue du sud (photo C. Calastri).
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 515
Bâtis en briques, ces fours de plan rectangulaire classique de 8,5 x 3,5 m (fig. 4) sont assimilables au type II/b de la clas-sification de N. Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 1971). Au-cun four n’a conservé son élévation, le four 6 est entièrement détruit et se réduit à une grande fosse de spoliation. Les longs côtés des fours sont bordés d’une épaisse strate formée d’une accumulation de fragments d’amphores pris dans de l’argile servant de réfractaire afin de retenir et diffuser la chaleur. L’es-pace séparant les deux fours d’une même batterie, quant à lui, est constitué d’une robuste maçonnerie de briques crues qui garantit la nécessaire flexibilité de dilation durant les phases de cuisson et de refroidissement (fig. 5).
La chambre de combustion se présente comme un rec-tangle long de presque 6 m et large de 1,20 m pavé de briques quadrangulaires (fig. 6). Elle est munie d’un vaste couloir central d’accès et ses parois sont scandées longitudinalement par une série de murettes en briques sur lesquelles reposaient les arcades qui soutenaient la sole perforée de la chambre de cuisson. Aucun vestige de cette dernière ni de l’élévation n’a été retrouvé, certainement détruites lors de l’abandon du site. Dans leur dernier état (fig. 7), le four 1 était pourvu de neuf arcades tandis que le four 2 n’en présentait que sept. Sur le mur du fond, une cheminée quadrangulaire est aménagée afin de garantir le tirage et le refroidissement homogène de la chambre de cuisson. Deux variantes existent avec la pré-sence (four 2) ou non (four 1) d’une cloison centrale scindant la cheminée.
Selon une méthode déjà pratiquée sur d’autres sites de production (Leenhardt 2001 ; Pallecchi 2007 : 184-185), une évaluation de la capacité de ces fours a été calculée sur la base des dimensions d’une Dr. 1B. La surface de la sole est d’environ 28 m², 150 amphores peuvent y être disposées verticalement, l’embouchure du col vers le bas. Quatre niveaux équivalent à 3,50 m de haut, hauteur qui n’est pas incompatible avec les expérimentations pratiquées sur d’autres sites. Entre 350 et 600 amphores pouvaient être cuites en une seule fournée selon leur positionnement (Vitali 2007 : 44-45).
2. la batterie de fours 1 et 2
La durée d’activité de ce centre de production a été évaluée à environ deux siècles. Les indices matériels permettant d’éta-blir une chronologie affinée sont pratiquement absents sur le site, seules deux monnaies ont été découvertes, l’une de l’épo-que augustéenne datant de 23 av. J.-C. et l’autre de l’époque trajane (Fabry 2007 : 113). C’est donc la typologie des ampho-res produites sur le site, les formes varient de la gréco-italique à la Dr. 2-4, et les comparaisons effectuées avec les épaves ou les grands centres de consommation qui assoient l’hypothèse d’une activité effective située entre la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle de notre ère. L’hypothèse d’une superposition des fours, les uns sur les autres, au fur et à me-sure des reconstructions liées à une intense activité a été émise.
Fig. 5 : Entre F1 et F2 (photo L. Benquet).
Fig. 6 : Chambre de combustion (photo C. Calastri).
Fig. 7 : Plan de la batterie des fours F1 et F2 (relevé C. Calastri).
Laurence BENQUET et al.516
Afin de vérifier cette allégation, des sondages à l’intérieur de la chambre de combustion du four 1 et 2 ont été effectués.
2.1. Une superposition de structures
Après avoir entièrement vidé l’ultime comblement de la chambre de combustion de F1 (US. 2082), un sondage d’en-viron 2 m² a permis de relever une succession de couches, té-moins de ses diverses phases d’activité (fig. 8). Le dernier plan de travail du four (US. 2225) est constitué d’une couche très compacte de cendres de 10 à 15 cm d’épaisseur ; au-dessous une épaisse strate composée d’argile verdâtre (US. 2243), riche en tessons d’amphores et en fragments de briques, vestiges du four antérieur, oblitérait un premier plan de travail (US. 2256) sur lequel gisait un amas de fragments de briques, vestiges d’un panneau de fermeture (USM. 2255). Ce dernier plan de travail recouvrait une fine couche d’argile cuite comprenant de petits fragments de briques (US. 2260) qui elle-même recouvrait un sol horizontal cimenté d’un cailloutis calcaire lié par un mor-tier grisâtre très compact (USM. 2261). Ce dernier sol, situé à 2,10 m de profondeur, concorde avec la fondation des murs périphériques et de ses contreforts quadrangulaires qui cernent la fabrique mis en évidence par le sondage epsilon effectué côté est, à l’extérieur de l’enceinte. Il semble faire partie de la plate-forme primaire du four.
Un sondage a été effectué dans le four 2 afin de vérifier une nouvelle fois la présence de cette plateforme primaire. Sous le niveau de pavage correspondant au dernier état de fonctionne-ment du four, on rencontre une séquence alternée de niveaux d’oblitération et de niveaux de travail similaire à celle rencon-trée dans le four 1.
Fig. 8 : Stratigraphie du sondage effectué dans F1 (photo C. Calastri).
Fig. 9 : Système d’évent dans F4 (photo D. Vitali).
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 517
Durant la période d’activité de la batterie, un troisième four (n°4), réplique en miniature des grands, est sans doute destiné à la cuisson de briquettes de pavement (fig. 9). Il est construit contre l’entrée du praefurnium du four 2 sur une plateforme for-mée de gros fragments de briques, de tuiles et d’amphores (US. 2148) recouverte d’une épaisse couche de cendres compacte provenant de l’activité du four 2. De forme quadrangulaire de 2,5 m de côté, les murs (USM. 2131) entourant la chambre de combustion sont faits de briques de récupération liées entre elles par de l’argile. La partie inférieure du mur ouest est percée de deux conduits d’aération (US. 2166 et 2167) obtenus à partir de cols d’amphores Dr. 1 emboîtés l’un dans l’autre qui conver-gent de façon oblique dans la chambre de combustion afin d’en augmenter le tirage.
2.2. Le matériel amphorique
Les recherches menées dans les chambres de combustion des fours 1 et 2 confirment l’hypothèse de la superposition de structures caractérisées par deux plans de travail. Le matériel présent dans les couches de comblement est principalement constitué de matériaux de construction, provenant de l’effon-drement de l’élévation de la structure antérieure, et de tessons d’amphores. L’étude de cette céramique permet une première analyse de l’évolution des formes.
Les intempéries survenues lors de la campagne de fouille 2006 ont rapidement submergé les sondages et ont empêché le bon déroulement des investigations dans le four 2. Le maté-riel étudié provient en très grande majorité du four 1 (fig. 10). L’épaisse couche d’obstruction (US. 2243) située entre les deux plans de travail est constituée d’un amas de brique et d’ampho-res. Plus d’une centaine de kilogrammes de céramique a été dégagée. Le panel typologie du matériel est varié et est consti-tué en grande majorité d’amphores Dr. 1 (50,7 %), suivi par les Dr. 1B (35,2 %) et en quantité moindre de Dr. 1C (8,5 %) et de gréco-italiques (5,6 %).
Le comblement final du four 1 (US. 2022 à 2024, 2031 à 2033, 2082) est (fig. 11), quant à lui, constitué majoritairement d’amphores de type Dr. 1B (70,8 %) ainsi que de Dr. 1A et Dr. 1C en proportion identique (14,6 %).
Cette séquence stratigraphique permet de confirmer l’image que nous renvoient les cargaisons d’épaves, c’est-à-dire une contemporanéité de la production des amphores de type Dr. 1A et Dr. 1C ainsi que, postérieurement, des Dr. 1B qui sem-blent devenir exclusives lors des dernières phases d’activité des fours 1 et 2. Cette hypothèse est corroborée par la quasi-ex-clusivité des formes Dr. 1B découvertes dans le dernier niveau de comblement du four 2 et dans celles situées à l’avant du praefurnium du four 1. Le sondage zeta effectué à l’avant de F1, a permis de déterminer les dynamiques des plans de travail extérieurs au complexe formé par la batterie des fours 1 et 2, c’est-à-dire la séquence des périodes d’utilisation et de vidange des fours. Le matériel présent dans les différentes strates indi-
vidualisées est identique à celui décrit précédemment et dans les mêmes proportions.
Concernant le timbrage, la pérennité des noms semble être de mise à l’instar de Sotic qui est estampillé tant sur une lèvre de Dr. 1A (fig. 11 n° 1) que sur celle d’une Dr. 1B (fig. 11 n° 8). Néanmoins, la graphie des lettres et la forme du cartouche changent. Les premières productions relatives aux gréco-ita-liques ne sont guère présentes dans ce secteur. Un niveau lié au premier stade de l’activité des fours a néanmoins été individua-lisé dans le sondage epsilon au niveau de la plateforme initiale et a livré quelques exemplaires de gréco-italiques à large em-bouchure, lèvre courte et fortement inclinée.
3. une pièce enterrée
À l’arrière de la batterie constituée des fours 6 et 7 se développe une grande pièce rectangulaire enterrée maçonnée de 15 x 6,5 m de côté et profonde de plus d’un mètre dont la fonction exacte reste encore à déterminer (fig. 12). Deux hypothèses ont été émises, celle d’un bassin servant à la préparation de l’argile (Vitali et al. 2005a : 290) et celle d’un accès à la chambre de cuisson pour le chargement des amphores (Pallecchi 2008 : 327).
3.1. Essai d’interprétation
La présence d’une épaisse couche d’argile tapissant le sol de la pièce laisse supposer que cette structure servait de bassin pour la décantation de l’argile ou plus généralement pour son stockage et la préparation de la matière première nécessaire aux potiers. Les restes d’un tuyau en plomb encore encastrés dans la cloison médiane délimitant la moitié est de la pièce étaient certainement destinés à un apport d’eau. À 8 m au sud de l’extrémité méridionale de la zone de fouille, une carrière destinée à l’extraction d’argile a été découverte. Ces deux indi-ces tendent à corroborer cette première hypothèse.
Cependant, le chargement des amphores à l’intérieur de la chambre de cuisson aurait pu se faire à partir d’une pièce si-tuée sur le côté opposé à l’accès au praefurnium. Cet état de fait a déjà été observé dans divers autres contextes artisanaux com-me sur l’atelier de Giancola à Brindes (Manacorda 2001 : 230 ; Pallecchi 2007). La justification d’une telle implantation serait de limiter le trafic des hommes, des animaux et des chariots dans les espaces de travail durant les diverses phases d’élabo-ration, de le canaliser dans des couloirs de circulation et éga-lement d’éviter le contact des amphores encore crues avec les cendres provenant du curage des chambres de chauffe.
Quelle que soit la fonction de cette pièce, elle perd sa fonc-tionnalité certainement lors de la destruction du grand four 7. Elle sert alors de décharge et est entièrement comblée de maté-riaux de construction (provenant de l’effondrement du four 7 ?) et d’amphores. Le secteur est ensuite recouvert d’une couche de limon provenant d’une inondation de l’Albegna et un nouveau sol est réalisé.
Laurence BENQUET et al.518
0 3cm
1 2
4
5 6
7 8
9
10 11
1312
3
Fig. 10 : Comblement intermédiaire de F1 : n° 1-2 gréco-italique, n° 3 à 8 Dr. 1A, n° 9-10 Dr. 1C, n° 11 à 13 Dr. 1B (dessins L. Benquet sauf timbres F. Laubenheimer).
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 519
0 3cm
1 2
3 4
5
6
7
8
9
10
1211
Fig. 11 : Comblement final de F1 : n° 1-2 Dr. 1A, n° 3-4 Dr. 1C, n° 5 à 12 Dr. 1B (dessins L. Benquet sauf timbres F. Laubenheimer).
Laurence BENQUET et al.520
Fig. 12 : La « pièce enterrée » après la pluie (photo D. Vitali).
Fig. 13 : Comblement de la « pièce enterrée » (photo D. Vitali).
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 521
3.2. Comblement de la structure
Plus d’une tonne de fragments d’amphores a été dégagée dans cette pièce (fig. 13). Le comblement semble avoir été très rapide comme en témoigne le panel typologique réduit des amphores constitué de Dr. 1A, Dr. 1C et de quelques ra-res amphores ovoïdes. La pièce a été entièrement vidée au fil des campagnes de fouille par secteur. Extrêmement compact, le comblement est constitué de gros fragments de briques, de tuiles et d’amphores pris dans de l’argile. Seules les différences de couleur de cette dernière et la proportion de matériel cé-ramique ont permis d’individualiser plusieurs phases de rem-blaiement intervenues après la démolition du four 7 et/ou après une nouvelle crue du fleuve.
Les Dr. 1A présentent deux modules dont le plus petit est caractérisé par une courte lèvre au diamètre à l’embouchure inférieure à 140 mm (fig. 14 n° 1 à 4) ; le plus grand correspond aux nombreux profils diversifiés observés dans les chargements d’épaves (fig. 14 n° 5 à 14). Les Dr. 1C sont extrêmement bien représentées et forment 47 % du total des amphores récupé-rées. Si le profil de leur lèvre est globalement homogène, mal-gré de fortes variations de hauteur, les caractéristiques prin-cipales sont un diamètre étroit à l’embouchure compris entre 130 et 140 mm ainsi qu’une attache supérieure des anses très enveloppante et présentant un décor de volutes (fig. 15). Les principaux timbres imprimés sur les lèvres ne sont pas moins étonnants puisqu’il s’agit de séries à trois lettres : AR.S, DA.S et DI.S dont la signification reste pour l’instant énigmatique et aucune comparaison n’a pu être faite (Laubenheimer 2007 : 71-76). Une centaine d’exemplaires a été découverte. De rares amphores ovoïdes à lèvre en bourrelet et court pied en bouton complètent ce comblement.
4. le drainage
Lors d’un sondage effectué en 2003 entre la pièce située à l’arrière de la batterie de fours 6 et 7 et le mur de clôture occidental une série d’amphores déposées horizontalement a été découverte servant à la bonification de cette zone humide proche du cours de l’Albegna (fig. 16). Dans ce secteur, les dé-bordements du fleuve sont documentés à quatre reprises par la présence de strates d’argile très pure.
4.1. Aménagement
Une première consolidation de 40 cm d’épaisseur a d’abord été aménagée grâce à un amas compact de tessons d’amphores et de fragments de briques. Toutefois l’inefficacité de cette solution, qui peu à peu s’enfonçait dans l’argile molle, conduit à la réalisation d’un ultime dépôt. À partir du côté extérieur du mur occidental de la pièce enterrée, on a déposé sur un même plan sableux des centaines d’amphores en files étroitement serrées et parallèles jusqu’à rejoindre le mur de fermeture
occidental. Chaque file est composée d’amphores encastrées les unes dans les autres avec une modalité constante : le pied d’une amphore s’enfonce d’une vingtaine de centimètres dans le col de la précédente. En 2003, une centaine de conteneurs disposés sur 14 files a été récupérée ; la prolongation des fouilles dans ce secteur l’année suivante a permis d’agrandir la collection d’une cinquantaine d’autres amphores. La présence de pilastres préexistants a fait obstacle au développement ininterrompu de ces files et a contraint à leur contournement en utilisant aussi bien des amphores décolletées que des cols. Afin de remplir les dépressions et niveler le sol on utilisa d’autres tessons d’amphores, plus petits, et des briques semi cuites provenant de la démolition des fours préexistants. Cette bonification devait s’étendre sur au moins 200 m² (fig. 17) pour un total de 400 à 500 amphores (Vitali et al. 2005a : 293). L’observation attentive des objets a permis de détecter un défaut sur chacun d’entre eux, découlant peut-être d’un problème survenu durant la phase de séchage qui, par conséquent, s’est traduit par une malformation lors de la cuisson. L’évaluation du nombre d’amphores constituant le drainage est sensiblement équivalente à celle de la capacité d’un four. L’aménagement de cette bonification a été permis grâce à une fournée mal venue.
L’utilisation d’amphores entières pour bonifier et drainer les sols humides est coutume courante dans l’Antiquité tant en Italie - à Ostie dans la maison de l’Atrium ou en Vénétie sur le site de Concordia Sagittaria par exemple - qu’en Gaule, dans le port de Marseille ou sur l’oppidum de Montfo dans l’Hérault (Laubenheimer 1998). À Albinia, elle semble également très répandue puisque les travaux de curage des canaux reliés à l’Albegna et les fouilles menées autour de Torre Saline ont mis au jour des files d’amphores entières analogues à celles découvertes sur le site de l’atelier (Ciampoltrini 1997 : 256 et 263, fig. 6d).
4.2. Les amphores
Au cours des campagnes de fouille de 2003 et 2004, 77 amphores entières et 56 panses décolletées ont été récupérées. À l’exception de quatre amphores ovoïdes, tous les conteneurs appartiennent au type Dr. 1B. Elles présentent les mêmes caractéristiques morphologiques de la Dr. 1B « classique » définies par F. Benoît : une hauteur totale supérieure à 1,10 m, un angle vif à la liaison col-panse et un pied de plus de 150 mm de haut. En effet, tous les exemplaires complets répondent à cette description : d’une hauteur totale comprise entre 1,10 et 1,20 m ; l’épaulement dont le diamètre varie entre 260 et 280 mm présente un « plateau » sur lequel se rattachent les anses et un angle vif le séparant nettement de la panse terminée par un haut pied massif pouvant peser à lui seul jusqu’à 7 kg (fig. 18 n°1 à 20). D’autres caractéristiques leurs sont communes comme le long col cylindrique compris entre 410 et 450 mm de haut surmonté d’une lèvre épaisse en bandeau, d’une hauteur comprise entre 40 et 54 mm, à large
Laurence BENQUET et al.522
0 3cm
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Fig. 14 : Amphores découvertes dans la « pièce enterrée » : n°1 à 4 Dr. 1A petit module, n°5 à 14 Dr. 1A, n°15-16 amphores ovoïdes (dessins L. Benquet).
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 523
0 3cm
10
11 12
13
14
15
12
3
4
5 6 7
8
9
Fig. 15 : Amphores découvertes dans la « pièce enterrée » : n°1 à 15 Dr. 1C (dessins L. Benquet, sauf timbres F. Laubenheimer).
Laurence BENQUET et al.524
embouchure d’une moyenne de 195 mm. Massives, leur poids moyen est de 29 kg pour un volume compris entre 27 et 29 l, elles ont donc un rapport poids/capacité volumique très faible. 95 estampilles identiques ont été recensées (fig. 18 n°22 à 26). Elles se présentent sous la forme d’un petit cartouche ovale de 1 cm très souvent mal imprimé sur le pied et/ou sur la lèvre. La lecture de ce timbre est malaisée, il a été interprété dans un premier temps comme deux lettres ligaturées AE (Vitali et al. 2005a : 295, Vitali et al. 2005b : 274-275) mais l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’un symbole est actuellement privilégiée. La répartition de ces timbres sur le site est particulièrement intéressante. Outre les amphores estampillées provenant du drainage, elles sont abondantes dans le comblement terminal de F2, avec huit exemplaires, et dans les niveaux de destruction de F6, avec cinq exemplaires. Cette observation permet de supposer que leur production est l’une des dernières effectuées dans le grand four 2.
Quatre exemplaires, dont deux entiers (fig. 18 n° 21), sont associés au type générique des amphores ovoïdes italiques encore assez mal connu mais dont la production a été identifiée dans les ateliers de Canneto et d’Astura dans le Latium (Hesnard et al. 1989 : 24). Il s’agit d’amphores trapues d’une hauteur totale comprise entre 83 et 89 cm et d’une capacité de 26 l. Elles présentent un col court, des anses fléchies ornées de nervures sur leur face externe et une panse ventrue terminée par un pied assez court. Les exemplaires se rapprochant morphologiquement de ces amphores ont été repérés comme complément de cargaisons dans des navires transportant des Dr. 1A et des Dr. 1B. Ces derniers sont, pour la plupart, datés entre le dernier quart du IIe siècle et le premier tiers du Ier siècle av. J.-C., telles que les épaves de l’îlot Barthélémy à Saint-Raphaël ou celle de San Andrea B proche des côtes de l’île d’Elbe (Benquet, Mancino 2006 : 470).
5. dernière phase d’occupation du site
L’ensemble du site lors de l’ouverture de la fouille était en-tièrement jonché de fragments d’amphores appartenant aux dernières productions de l’atelier, principalement des Dr. 2-4. Aucun tesson de cette forme n’a été identifié dans le comble-ment terminal des fours 1 et 2. Toutefois, il existe des indices de la continuité de la fréquentation de cette zone.
5.1. Les derniers vestiges
Les vestiges d’un pavage surélevé, formé de grandes tuiles, et réalisé au-dessus d’une série de lignes de solins, parallèles les unes aux autres, ont été identifiés dans la partie centrale de la cour séparant les deux batteries de fours. Cet aménagement correspond à l’installation d’une série de petits fours construits après l’abandon de l’activité des grands fours. Trois fours à céra-mique de petites dimensions ont été identifiés, tous en très mau-vais état de conservation. Ils présentent le même plan grossière-ment quadrangulaire, de 1,4 m de côté pour le plus petit (four 3, fig. 19) à 4 x 3 m pour le plus grand (four 5) et une sole soutenue par des cols d’amphores délabrés enfoncés verticalement dans la chape de préparation du soubassement (Vitali et al. 2005b : 267-268). Le four 8 est l’unique à être aménagé dans l’enceinte même de l’ancien grand complexe ; le four 3 est construit entre les contreforts nord du mur attenant au four 1 ; quant au four 5, il se situe bien à l’extérieur à 20 m à l’ouest contre le mur de clôture parallèle à la voie Aurelia. La production céramique semble être plus particulièrement spécialisée dans la vaisselle commune de cuisine et de table : mortiers, marmites, bols, olla, pichets, amphorettes, lampes à huile… (Cottafava 2007). Quelques formes céramiques à parois fines ont également été produites mais en moindre proportion dans le four 8.
Fig. 16 : Découverte du drainage en 2003 (photo D. Vitali).
Fig. 17 : Reconstitution hypothétique du drainage (montage D. Vitali).
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 525
0 20cm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1:1
22 23 24 25 26
Fig. 18 : Amphores du drainage : n°1 à 20 Dr. 1B, n°21 amphore ovoïde (dessins L. Benquet) ; n°22 à 26 marques sur amphores Dr. 1B (dessins N. Fabry).
Laurence BENQUET et al.526
Si l’on n’a pas encore individualisé les fours ayant servi à la cuisson des dernières productions d’amphores, de grandes zones de décharge liées à cette activité ont été repérées à l’ex-térieur de l’enceinte, le long du mur est. Le sondage epsilon (fig. 20) effectué sur le côté latéral du four 2 a révélé une vaste zone de décharge. Celle-ci est formée d’amas hétéroclites de cendres et de charbons provenant du nettoyage des praefurni des fours environnants, de tessons d’amphores, de céramiques mal venues à la cuisson et de matériaux de construction issus du démantèlement des structures préexistantes… Les sondages kappa et Mi creusés sur le flanc est de la pièce enterrée ont per-mis d’observer une superposition, à deux reprises, d’épaisses couches pratiquement stériles d’argile alluvionnaire verdâtre, alternées d’un amas de vestiges de structures maçonnées et de fragments d’amphores. Cet aménagement est destiné à la pré-paration d’un nouveau sol de circulation couvert d’une toiture de tuiles soutenue par des pilastres monolithes.
À une période indéterminée précisément, au cours du Ier siècle de notre ère, la production d’amphores et de céra-miques s’arrête, le site est complètement abandonné et les dernières structures encore en élévation s’écroulent comme en témoignent les tuiles qui jonchaient les derniers niveaux de circulation (fig. 21).
5.2. Les dernières productions d’amphores
L’abandon de l’activité des grands fours marque un change-ment radical dans la production. La Dr. 1B qui avait supplan-té toutes les autres formes est abandonnée. Faisant face à la concurrence de nouveaux centres viticoles, comme la province de Tarraconaise, exportant vers les nombreux marchés gaulois des conteneurs plus légers et de plus grande capacité (Pascual 1, Oberaden 74…), une nouvelle forme apparaît se démarquant radicalement des précédentes. La morphologie de ces Dr. 2-4 est inspirée des formes orientales (fig. 22 n°1 à 15), elles mesu-rent moins de 1 m de haut et sont caractérisées par une petite lèvre en anneau surmontant un col court entouré d’anses bifi-des ; la panse est fuselée terminée par un petit pied en bouton orné d’une cannelure rappelant celle située sur le bas du col.
Si ce type d’amphores est principalement destiné à l’exporta-tion par voie maritime, comme le suggère sa forme globalement longiligne, un autre type de production se développe, affecté au commerce local ou à moyenne distance. Il s’agit de conteneurs à fond plat dont la morphologie n’est pas totalement standar-disée. Deux grands types ont été individualisés : les petites am-phores à col étroit et lèvre en anneau proches des amphores de Forlimpopoli (fig. 22 n°16 à 18) et les amphores de plus grande capacité à panse ovoïde (fig. 22 n°19 à 21) se rapprochant des Gauloises 3 et 7 (Benquet, Mancino 2006 : 473-474).
Bien que les recherches soient très loin d’être terminées, le site d’Albinia est riche en informations concernant les moda-lités de production d’amphores à la fin de la République et au tout début de l’Empire. Cet atelier est le premier situé sur les
Fig. 19 : Plan du four F3 destiné à la cuisson de céramique (relevé E. Cottaffava).
Fig. 20 : Sondage epsilon, zone de décharge (photo D. Vitali).
Fig. 21 : Effondrement des dernières structures (photo S. Pallecchi).
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 527
0 3cm
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
11 12
13 14
15
16 17 18
19 20 21
Fig. 22 : Dernières productions : n°1 à 15 Dr. 2-4 (dessins C. Mancino) ; n°16 à 18 amphores à fond plat type « Forlimpopoli » ; n°19 à 21 amphores à fond plat type Gauloise 5-7 (dessins L. Benquet).
Laurence BENQUET et al.528
(1) Laurence Benquet, INRAP GSO, UMR 5608 TRACES ; Daniele Vitali,
Université de Bourgogne ; Fanette Laubenheimer, CNRS, UMR 7041 ARSCAN .
(2) Depuis six ans, une fouille de six semaines est menée chaque année. Les
résultats présentés dans cet article sont issus de l’étroite collaboration entre di-
verses institutions. Les fouilles sont menées sous la direction du professeur D. Vi-
tali secondé de C. Calastri, tous deux de l’université de Bologne, et de Silvia Pal-
lecchi de l’université de Sienne. Des étudiants des ces deux universités ainsi que
de celle de Grosseto participent aux recherches de terrain et certaines probléma-
tiques font l’objet de travaux universitaires. L’étude du matériel amphorique est
effectuée par L. Benquet (INRAP, GSO) et celle des timbres par F.Laubenheimer
(CNRS, Arscan). Nous avons choisi de présenter la fouille secteur par secteur en
illustrant chaque structure par des photos et des planches de dessins.
côtes tyrrhéniennes italiques à faire l’objet d’une fouille pro-grammée et, de ce fait, nous apporte les premières estimations du rendement de sa propre production mais aussi de celles des vignobles environnants.
Sur la base des dimensions de la chambre de combustion et grâce aux comparaisons avec des structures similaires connues dans le monde romain, il est possible de reconstituer le charge-ment des fours. Chacun pouvait contenir entre 250 (Pallecchi 2008) et 600 amphores (Vitali 2007 : 44) pour une seule cuisson. Si l’on imagine que les deux batteries fonctionnent en cycle al-terné à un rythme d’une fournée tous les 20 jours, la production peut être évaluée entre 1 500 et 4 000 par mois. Si l’on estime une capacité moyenne de 27 l par amphores, le potentiel peut se monter entre 40 000 et 100 000 l de vin, soit entre 77 et 192 cullei pouvaient être stockés dans les amphores. Columelle cal-cule le rendement d’une vigne à environ 6 000 l/ha (Columelle 3, 3) tandis que Caton - De Agricultura, 11 - l’estime à 10 000 l/ha. Si l’on considère que l’atelier ne fonctionnait que durant la saison la plus sèche, c’est-à-dire entre juin et septembre (Ca-randini 1988 : 248-251 et 277-278), sa capacité de stockage était alors équivalente à la récolte d’un vignoble s’étendant entre 16 et 26 ha pour la fourchette la plus basse et entre 40 et 66 ha pour la fourchette la plus haute. Ces résultats démontrent que nous ne sommes pas en présence d’un petit établissement arti-sanal répondant à la demande d’une seule villa ou d’un marché local mais d’une véritable manufacture vraisemblablement liée à la production intensive des grandes villas esclavagistes.
Durant plus de deux siècles, l’atelier a produit divers conteneurs dont la forme évolue selon la demande sans que l’on puisse fixer précisément la chronologie. Au tout début, la production se concentre autour des amphores vinaires, les gréco-italiques puis les Dr. 1A, puis tout en poursuivant la fabrication de ce dernier type, apparaît la forme Dr. 1C probablement destinée au transport des sauces de poisson élaborées dans les pêcheries voisines (Benquet, Mancino 2006 : 475 ; Laubenheimer 2007 : 77). Au cours du premier quart du Ier siècle av. J.-C., la forme Dr. 1A évolue vers la Dr. 1B, la morphologie s’allonge et s’alourdit sans que sa capacité volumique n’augmente. L’apparition des amphores ovoïdes semble indiquer une nouvelle exigence, celle d’un conteneur destiné, peut-être, au transport de l’huile comme le suggère la forme de sa panse. Le dernier tiers du Ier siècle av. J.-C. voit des changements radicaux, l’activité des grands fours est abandonnée, une nouvelle forme de conteneurs est créée afin de contrer la concurrence naissante sur les marchés gaulois
des provinces ibériques, la Dr. 2-4. La production se tourne également vers les marchés locaux et de moyenne distance grâce à la diffusion des amphores à fond plat. L’atelier d’Albinia semble être abandonné au cours de la première moitié du Ier siècle de notre ère, période correspondant au déclin des grandes villas esclavagistes.
S’il est possible de chiffrer la production annuelle de l’atelier, il semble bien plus difficile d’évaluer l’ampleur de leur diffusion. En l’absence d’étude pétrographique, il est difficile de restituer les voies commerciales qu’ont empruntées les amphores d’Albinia. L’établissement d’une carte de répartition des timbres découverts sur le site n’est pas chose aisée car les noms uniques sont peu nombreux et sont utilisés dans plusieurs ateliers dans des régions différentes et pour des productions diverses. Le cognomen NICIA, par exemple, est présent à Albinia estampillé tant sur des gréco-italiques que sur des Dr. 1 (Laubenheimer 2007 : 69), l’est également sur des gréco-italiques provenant du site de production de Dugenta en Campanie (Hesnard et al. 1989 : 29 fig. 14) et est connu sur des amphores vinaires de l’Adriatique de type Lamboglia 2 (Mercando 1975-81 : 73 fig. 7, 10, 12). De plus, de récentes études pétrographiques menées sur du matériel amphorique provenant de grands centres de consommation tels que Bibracte, Alès ou Vieille-Toulouse (Capelli et al. 2007 et Capelli et al., ce volume) ont démontré que les timbres dits « codés » à deux ou trois lettres ne seraient pas tous issus des ateliers d’Albinia (Olmer 2003). Ainsi, même si les voies commerciales Rhône-Saône et Loire semblent être privilégiées pour la diffusion des amphores d’Albinia, il faut rester prudent sur la répartition des timbres et ne comparer que ce qui est comparable, c’est-à-dire ne pas négliger la position des estampilles sur l’amphore, la forme et la graphie des timbres… En l’absence d’étude pétrographique systématique des pâtes, il est préférable de se tenir à une description normalisée des matrices et du dégraissant (Thierrin-Michael 2002).
Grâce à la pugnacité des divers membres de l’équipe de fouille, il est certain que dans les années à venir la compré-hension du fonctionnement de cet atelier sera mieux appré-hendée. Les diverses phases de production, le rôle de chaque acteur dont les noms nous sont partiellement parvenus par les estampilles et la diffusion des amphores dans le bassin médi-terranéen occidental pourront être reconstituées.
NOTES
Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) 529
BIBLIOGRAPHIE
Benquet, Mancino 2006 : L. Benquet, C. Mancino, Les amphores d’Albinia : première classification des productions, dans Actes du colloque de la SFECAG (Pézenas, 25-28 mai 2006), 2006, p. 465-476.
Fabry 2007 : N. Bianca Fabry, I materiali numismatici degli scavi di Albinia e la cronologia del sitio, dans Le fornaci e le anfore di Albinia : primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico, Atti del Seminario Internazionale (Ravenna 6-7 maggio 2006), Bologna, 2007, p. 109-114.
Carandini 1988 : A. Carandini, Schiavi in Italia, Roma, 1988.Capelli et al. 2007 : C. Capelli, R. Cabella, M. Piazza, Analisi
archeometriche sui materiali litici e ceramici dell’atelier di Albinia, dans Le fornaci e le anfore di Albinia : primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico, Atti del Seminario Internazionale (Ravenna 6-7 maggio 2006), Bologna, 2007, p. 115-124.
Ciampoltrini 1984 : G. Ciampoltrini, Un insediamento tardorepubblicano ad Albinia, dans Rassegna di Archeologia, 4, 1984, p. 149-180.
Ciampoltrini 1997 : G. Ciampoltrini, Albinia, Fluvius habet positionem. Scavi 1983-88 nell’approdo alla foce dell’Albegna (Orbetello, GR), dans Rassegna di Archeologia Piombinese, 14, 1997, p. 253-295.
Cottafava 2007 : E. Cottafava, Il vasellame comune di Albinia : le forme. Le Fornaci e le anfore di Albinia : primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico. Atti del seminario internazionale, Ravenna, 6-7 maggio 2006, p. 81-97.
Cuomo di Caprio 1971 : N. Cuomo di Caprio, Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi nell’area italiana. Dalla preistoria a tutta l’epoca romana, dans Sibrium, 11, 1971, p. 371-461.
Hesnard et al. 1989 : A. Hesnard, M. Ricq, P. Arthur, M. Picon et A. Tchernia, Aires de production des gréco-italiques et des Dr. 1, dans Amphores romaines et histoire économique : dix ans de recherche, Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986), Rome, 1989, p. 21-65.
Laubenheimer 1998 : F. Laubenheimer, L’eau et les amphores. Les systèmes d’assainissement en Gaule romaine, dans Bonifiche e drenaggi con anfore in epoca romana : aspetti tecnici e topografici, Atti del seminario di studi di Padova (19-20 ottobre), Modena, 1998, p. 47-70.
Laubenheimer 2007 : F. Laubenheimer, A propos de timbres d’amphores de l’atelier d’Albinia (Prov. De Grosseto, Italie). Vin et poisson, dans Le fornace e le anfori di Albinia : primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico, Atti del Seminario Internazionale (Ravenna 6-7 maggio 2006), Bologna, 2007, p. 67-87.
Leenhardt 2001 : M. Leenhardt, L’atelier de Sallèle d’Aude, fours et bâtiments : mode d’emploi, dans 20 ans de recherches à Sallèle d’Aude, 2001, p. 241-252.
Manacorda 2001 : D. Manacorda, Le fornaci di Giancola (Brindisi) : archeologia, epigrafia, archeometria, dans 20 ans de recherches à Sallèle d’Aude, 2001, p. 229-240.
Mercando 1975-81 : L. Mercando, Relitto di nave romana presso Ancona, dans Forma Maris, 11-12, 1975-81, p. 69-78.
Olmer et al. 2001-2002 : F. Olmer, D. Vitali, C. Calastri, Scavi e ricerche archeologiche ad Albinia e nel territorio (1999-2001), dans OCNUS, 9-10, 2001-2002, p. 287-298.
Olmer, Vitali 2002 : F. Olmer et D. Vitali, Albinia, dans MEFRA, 114, 2002, p. 459-467.
Olmer 2003 : Les amphores de Bibracte 2. Le commerce du vin chez les Eduens d’après les timbres d’amphores, coll. Bibracte 7, Glux-en-Glenne, 2003.
Pallecchi 2007 : S. Pallecchi, Le fornaci da anfore di Giancola (Brindisi) in età repubblicana, un caso di studio, dans Le fornaci e le anfore di Albinia : primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico, Atti del Seminario Internazionale (Ravenna 6-7 maggio 2006), Bologna, 2007, p. 181-188.
Pallecchi 2008 : S. Pallecchi, Le fornaci romane di Albinia : identificazione delle unità funzionali e prima ricostruzione delle linee di produzione, dans Materiali per Populonia, 7, 2008.
Peacock 1977: Peacock D.P.S., Recent discoveries of roman amphora kilns in Italy, dans The Antiquaries Jounal, LVII, 2, 1977, p. 262-269.
Thierrin-Michael 2002 : G. Thierrin-Michael, Classification des amphores vinaires italiques par l’examen macroscopique des pâtes : possibilités et limites, dans Actes du congrès de la SFECAG (Saint-Romain-en-Gal, 29 mai – 1er juin), 2002, p. 319-323.
Vitali, Laubenheimer 2004 : D. Vitali, F. Laubenheimer, Albinia - Torre Saline (Prov. Di Grosseto) : il complesso produttivo con fornaci (II-I sec. A.C. / I sec. D.C.), dans MEFRA, 116, 2004, p. 591-604.
Vitali et al. 2004 : D. Vitali, F. Laubenheimer, L. Benquet, Albinia (prov. de Grosseto). Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 2004, p. 14 -31.
Vitali et al. 2005a : D. Vitali, F. Laubenheimer, L. Benquet, Albinia, dans MEFRA, 117, 2005, p. 282-299.
Vitali et al. 2005b : D. Vitali, F. Laubenheimer, L. Benquet, E. Cottafava, C. Calastri, Le fornaci di Albinia (GR) e la produzione di anfore nella bassa valle dell’Albegna, dans Materiali per Populonia, 4, 2005, p. 259-279.
Vitali 2007 : D. Vitali, Le strutture archeologiche dalla foce dell’Albegna alle fornaci di Albinia : problemi di cronologia relativa, Le fornaci e le anfore di Albinia : primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico, Atti del Seminario Internazionale (Ravenna 6-7 maggio 2006), Bologna, 2007, p. 25-46.