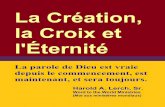Voyages depuis et vers l'étranger au 2 janvier - Gouvernement
Chapitre 2 LES CAMPAGNES PRESIDENTIELLES DEPUIS 1965
Transcript of Chapitre 2 LES CAMPAGNES PRESIDENTIELLES DEPUIS 1965
1
Chapitre 2 LES CAMPAGNES PRESIDENTIELLES
DEPUIS 1965
Jacques Gerstlé
Lorsqu’il est élu président de la République en 1958, le
général de Gaulle recueille 62 394 voix dans un collège de
notables dépassant à peine les 80 000 grands électeurs. Sept
ans plus tard, après avoir fait adopter le principe de
l’élection présidentielle au suffrage universel direct par le
référendum de 1962, il est élu par un peu plus de treize
millions d’électeurs. C’est assez dire combien la légitimation
électorale du chef de l’Etat change de nature la prétention à
diriger. Depuis cette réforme fondamentale des institutions de
la Vème République, les Français ont été convoqués à neuf
reprises pour choisir leur président, parmi quatre-vingt-onze
candidats retenus, à l’issue de campagnes électorales de durée
variable et de caractère politique différent.
Deux d’entre elles vont être impromptues. En 1969, le
général de Gaulle quitte le pouvoir avant la fin de son mandat,
se sentant désavoué par l’échec du référendum du 27 avril sur
la réforme du Sénat et la régionalisation. En 1974, le décès de
son successeur, Georges Pompidou, interrompt aussi le
septennat. Ces deux campagnes électorales s’ouvrent donc dans
des conditions précipitées alors que la première, en 1965, est
« inaugurale » et que les six dernières (1981, 1988, 1995,
2
2002, 2007 et 2012) semblent moins marquées par les
circonstances. Mais d’autres critères de distinction et de
regroupement peuvent être sollicités lorsqu’on cherche à rendre
compte des campagnes menées depuis 1965. Ainsi, Jean Massot
retient-il leur signification politique pour caractériser
successivement les quatre premières élections : la fondation de
la nouvelle présidence, l’héritage et la survie de
l’institution, la petite alternance avec la « mise en minorité
du gaullisme » et la grande alternance avec la victoire de la
gauche et son intégration aux mécanismes du régime. On pourrait
prolonger cette interprétation en considérant qu’aux phases
gaullienne (1965 et 1969) et des alternances (1974 et 1981),
1988, 1995 et 2002 ajoutent l’épreuve des cohabitations. 2007
présente un caractère atypique du fait du renouvellement de
l’offre électorale et des thèmes de campagne de Nicolas Sarkozy
centrés sur la rupture, tandis que 2012 est au contraire marqué
par la nouvelle candidature pour la cinquième fois d’un
président sortant.
L’élection de 1981 se présente comme la césure principale
de l’alternance entre la droite et la gauche qui dès lors se
substitueront l’une à l’autre en 1986, 1988, 1993, 1997 et 2002
et 1995, 2012. Des groupes d’élections non chronologiques
peuvent aussi être évoqués : ainsi, en 1965, 1988 le président
sortant domine la compétition à venir et adopte des stratégies
voisines, comme la déclaration de candidature tardive et
l’accent placé sur l’information plus que sur la campagne. De
même 1981, 1988 et 2012 sont des élections qui s’analysent
comme permettant des alternances « complètes », à la fois
3
présidentielle et législative, ou qui mettent à l’unisson
l’exécutif et le législatif.
Aux critères de circonstances et aux critères politiques,
pouvons-nous ajouter des critères de communication pour
distinguer les neuf campagnes? Le juriste définit la campagne
électorale comme « à la fois une période précédant l’élection,
pendant laquelle les candidats sont autorisés à faire valoir
leurs idées et l’ensemble des actions qu’ils entreprennent dans
ce but ». Etre en campagne, c’est entreprendre des actions de
propagande c’est-à-dire « l’ensemble des procédés grâce
auxquels chaque candidat (...) entend développer son programme
et mettre en avant ses mérites pour obtenir le vote des
électeurs »1. La perspective sociologique est plus large en
visant la formation des représentations et les pratiques qui
concourent à la mobilisation des électeurs et recourent à des
ressources symboliques et politiques qui ne relèvent pas
nécessairement d‘un encadrement juridique. La campagne concerne
l’ensemble des actions mises en œuvre pour informer, propager
des conceptions politiques, persuader des électeurs et elle
englobe tous les efforts menés par des acteurs individuels ou
collectifs en compétition pour désigner le titulaire de la
fonction présidentielle. Faire campagne, c’est mobiliser pour
rallier des suffrages sous la contrainte d’un encadrement
juridique de la compétition. C’est mobiliser des ressources
matérielles (le financement), humaines (les militants et
bénévoles), organisationnelles (les forces politiques),
idéologiques (les représentations), symboliques (les signes).1 Jean-Claude Masclet, « Campagne électorale (droit de la) », « Propagande électorale », dans Pascal Perrineau, Dominique Reynié (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001.
4
Le but est de capter l’attention des électeurs, susciter leur
intérêt, éveiller ou réveiller leurs convictions pour former
des préférences à l’égard des candidats et de leurs
propositions. Au-delà de l’action, la campagne pour l’élection
présidentielle désigne aussi une séquence de la vie politique
française dont l’importance est attestée par la reconnaissance
et/ou la construction de la prééminence présidentielle. Elle
est centrale dans le spectre des campagnes électorales car
l’enjeu de pouvoir y est, par définition juridique et par
construction politique2, capital.
On optera donc pour une perspective dynamique qui conduit
à repérer des évolutions sensibles à différents niveaux
d’observation : l’émergence d’un encadrement juridique resserré
des campagnes, la rationalisation des pratiques, et la
transformation des formes de médiatisation du message
électoral.
I- LE RENFORCEMENT DE L’ ENCADREMENT JURIDIQUE
Les contraintes légales dans lesquelles se déroule la
compétition électorale tendent à se renforcer depuis près de
cinquante ans sous trois aspects. Tout d’abord, les limites de
la campagne se précisent, tant en termes de limitation des
candidatures qu’en termes temporels. Ensuite, la propagande
électorale et l’information font l’objet de restrictions,
d’interdictions et de surveillance étroite, une place
grandissante étant faite aux médias audiovisuels et, à partir2 Sur la construction de l’institution présidentielle, voir BernardLacroix, Jacques Lagroye (direction), Le Président de la République. Usages et genèsed’une institution, Presses de la FNSP, Paris, 1992.
5
de 2007, aux moyens offerts par internet. Enfin, les conditions
de financement de la campagne sont définies par le droit
positif et font l’objet d’un contrôle institutionnel.
1.1- Les limites de la campagne
La définition juridique de la campagne électorale pourrait
être simplifiée en formulant la question : qui peut faire
quoi et quand ? Autrement dit : quels candidats ? quels actes
de propagande ? à quels moments ? Pour qu’il y ait campagne il
faut qu’il y ait des candidats et parfois la candidature est
même l’élément essentiel de la campagne, comme le remarque
Jean-Claude Colliard à propos de François Mitterrand en 19883.
On conviendra que le nombre et la variété des candidats en lice
est une variable importante, tant pour la qualité
représentative de l’offre électorale que pour les stratégies de
communication des candidats, ou les coûts d’information des
électeurs et les exigences du travail médiatique. Qu’en est-il
de l’accès à la candidature ? Elle repose, sans s’y réduire,
sur un acte de communication : pour être candidat, il faut se
« déclarer », être désigné ou investi, être présenté, être
soutenu, toutes choses qui requièrent une manifestation dont le
droit s’empare. Ainsi les règles de candidature imposent aux
protagonistes des contraintes juridiques particulières
d’éligibilité, inchangées depuis la réforme de 1962, et de
parrainage, qui deviennent plus sélectives de 1958 (50
présentations recueillies dans le collège électoral) à 1962,
puis 1976. En 1965, 1969 et 1974, le candidat doit en effet
être parrainé par 100 signatures, anonymes, d’élus provenant3 Jena-Claude Colliard, « Le processus de nomination des candidats etl’organisation des campagnes électorales », dans Nicolas Wahl et Jean-LouisQuermonne (dir.), La France présidentielle, Paris, Presses de Sciences po, 1995.
6
d’au moins dix départements. Cette condition n’ayant pas permis
de limiter l’augmentation des candidatures, successivement au
nombre de six, sept et douze, on relève en 1976 la barre de
l’accès officiel à la candidature en exigeant 500 signatures,
rendues publiques, d’élus provenant de trente départements et
au maximum 1/10 du même département. Ceci permet de limiter le
nombre des candidatures à dix en 1981, neuf en 1988 et 1995
mais on revient à seize en 2002, douze en 2007 et dix en 2012.
Dans sa définition formelle, une campagne présidentielle
est d’une brièveté remarquable. Depuis 1962, sa durée est de
moins de quinze jours pleins avant le premier tour et de huit
jours avant le second. Cette délimitation temporelle de la
campagne peut paraître très éloignée de la réalité des
pratiques qui attestent que les candidats se sont effectivement
mis en campagne sans attendre son ouverture officielle4.
Pendant le temps de la campagne officielle des principes
intangibles s'appliquent: égalité des candidats, neutralité de
l’autorité administrative et loyauté des procédés utilisés. Le
principe de l’égalité absolue est réaffirmé dans la loi de 1962
qui exige que l’Etat accorde les mêmes facilités aux candidats.
D’autre part, la campagne officielle correspond à la mise en
œuvre de moyens qui lui sont spécifiquement attachés comme
l’affichage officiel, la profession de foi, les émissions
radiotélévisées ; depuis 1990 le recours à d’autres
moyens, comme la publicité commerciale est interdit pendant
trois mois avant le scrutin, de même que, de 1977 à 2002, la
4 Ainsi en 2007, certains candidats, souvent ceux des formations très minoritaires, annoncent leur candidature plus d’un an avant la date du scrutin, ceux des formations de gouvernement ne font pas mystère de longs mois auparavant de leur intention d’être présents.
7
publication de sondages pendant la semaine précédant chaque
tour.
1.2.-La réglementation de la propagande
Il convient de distinguer d’une part, les procédés
traditionnels et nouveaux, d’autre part les périodes de
campagne et de précampagne, voire d’y ajouter la dichotomie
propagande officielle et propagande parallèle. S’agissant des
actes de propagande officiels, le principe d’égalité absolue
s’applique aux moyens traditionnels c’est-à-dire aux affiches,
panneaux d’affichage, aux bulletins de vote et aux professions
de foi. S’agissant des moyens nouveaux, il faut distinguer
entre les moyens audiovisuels et les procédés de la propagande
parallèle utilisés tout au long de la campagne : tracts,
journaux électoraux, affichage commercial, sondages et
enquêtes, conseils marketing et communication, démarchage, etc.
Il se révèle beaucoup plus difficile de contenir la propagande
parallèle dans les limites du principe d’égalité. Les candidats
recourent souvent à des tracts ou journaux électoraux et des
formes d’affichage « sauvage » sur des emplacements non
réglementaires, c’est-à-dire des procédés contraires aux
dispositions du code électoral. Ainsi, l’achat d’espaces
publicitaires, les actions de publipostage (ou mailing, c’est-à-
dire envoi de courrier ciblé), comme d’ailleurs le marketing
téléphonique (ou télématique) échappent au principe d’égalité.
Pour juguler le développement de certains procédés et prévenir
l’explosion des dépenses électorales, des dispositions
limitatives ou prohibitives ont été adoptées.
8
L’égalité en matière audio-visuelle s’applique à la
campagne officielle à la radio et à la télévision où un temps
d’antenne égal est donné à chaque candidat. Les règles de la
propagande radiotélévisée vont progressivement se multiplier et
se diversifier selon un critère temporel (distinction entre
période de campagne et de pré-campagne), selon la nature des
émissions concernées (distinction entre propagande officielle
et autres programmes).
C’est donc principalement dans le domaine de la propagande
parallèle et de la propagande radiotélévisée que l’encadrement
juridique s’est considérablement renforcé, venant s’ajouter aux
innovations concernant le financement. La restriction ou
l’interdiction concernent ainsi le recours aux sondages, la
publicité commerciale par voie de presse ou audio-visuelle,
l’affichage commercial dans les trois mois qui prècèdent le
scrutin et, dans les mêmes délais, l’utilisation d’un numéro
téléphonique (ou télématique) gratuit.
1.2.1. L’interdiction de la publicité électorale
Une place particulière doit être faite à la publicité dans
la mesure où le législateur freine son développement pour
limiter les dépenses électorales. Rappelons rapidement quelques
points de repère récents de cette évolution. Depuis 1976, la
loi interdit pendant la durée de la campagne présidentielle
l’utilisation de tout procédé de publicité commerciale par voie
de presse. La loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de la
communication innove en prévoyant que « les émissions
publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées
qu’en dehors des campagnes électorales ». Mais depuis 1988 et
9
notamment les scandales politico-financiers qui sont apparus à
l’approche de l’élection présidentielle, la volonté de rendre
plus transparente la vie politique française s’est imposée. Le
11 mars 1988, en pleine campagne électorale présidentielle, est
adoptée une nouvelle législation relative à la transparence
financière de la vie politique. Enfin, la loi du 15 janvier
1990 prévoit l’interdiction permanente des émissions
publicitaires à caractère politique à la radio et à la
télévision. S’agissant de l’affichage non-officiel relatif à
l’élection, la même loi l’interdit pendant les trois mois
précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la
date du jour de scrutin. Dans ce même délai, est interdit
l’usage de tout procédé de publicité commerciale par voie de
presse ou tout moyen de communication audiovisuelle. La
publicité téléphonique (ou télématique) par mise à la
disposition gratuite du public d’un numéro d’appel est
interdite aussi pendant cette même période.
1.2.2. L’utilisation des sondages
Le développement spectaculaire de la pratique des sondages
politiques en France a incité le législateur à en réglementer
l’usage dans les conjonctures électorales. La loi du 19 juillet
1977 concerne, en effet, « tout sondage d’opinion ayant un
rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection
présidentielle ou l’une des élections réglementées par le code
électoral ainsi qu’avec l’élection des représentants à
l’Assemblée des Communautés européennes. » Des garanties de
fiabilité technique et de transparence sont requises et
contrôlées par une commission des sondages instituée pour
10
veiller au respect des règles déontologiques dans ce domaine.
Mais surtout la loi prévoit que « pendant la semaine qui
précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le
déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que
ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout
sondage. » L’interdiction concerne tous les médias lors des
élections présidentielles, européennes, référendaires et celles
qui sont régies par le code électoral. Il est à remarquer que
la réalisation de sondages reste possible si la connaissance
des résultats n’est pas rendue publique. Enfin, l’interdiction
n’empêche pas les opérations “estimations” électorales, qui
sont organisées par les instituts de sondages et les médias,
dont les résultats sont diffusés après la fermeture des bureaux
de vote. La loi de 1977 ne pouvait anticiper le développement
de l’internet et l’accès qu’il offre à l’information publiée
hors de France, comme ce fut le cas avec La Tribune de Genève
donnant le résultat d’un sondage de la dernière semaine lors
de l’élection de 1995. Elle témoignait alors de l’inadaptation
de la législation à l’environnement de la communication sans
frontières. C’est pourquoi le 19 février 2002 a été adoptée une
nouvelle loi autorisant la publication des sondages jusqu’à la
fin officielle de la campagne, c’est-à-dire l’avant-veille du
jour de chaque tour de scrutin et le jour du vote (voir le
chapitre 3)5.
1.3. La réglementation de la communication audiovisuelle
5 Cette nouvelle disposition a aussi pour but d’assurer l’égalité entre citoyens. Nombreuses étaient les enquêtes effectuées la semaine de l’interdiction de publication mais leurs résultats étaient souvent présentés devant des publics choisis instaurant ainsi une inégalité de faitdans l’accès à l’information.
11
Le décret du 14 mars 1964 applique le principe d’égalité à
l’audiovisuel ; mais le droit positif a évolué ces dernières
années pour s'adapter aux changements profonds du paysage
audiovisuel français, en raison notamment du mouvement de
privatisation. Une autorité administrative indépendante, en
charge de la régulation de l’audiovisuel, vient ajouter sa
réglementation spécifique à la réglementation générale de la
propagande électorale. La loi du 29 juillet 1982 instaure la
Haute Autorité de l’Audiovisuel. Une loi de 1986 lui substitue
la Commission Nationale de la Communication et des Libertés
(CNCL), remplacée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(CSA) en 1989. En 1988, pour la première fois en France, une
autorité administrative indépendante de la communication a donc
organisé et contrôlé la campagne radiotélévisée de l’élection
présidentielle.
Des problèmes d’harmonisation des compétences se sont
faits jour avec les institutions déjà existantes, comme la
Commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle
qui a pour vocation d’intervenir depuis 1964 « le cas échéant,
auprès des autorités compétentes, pour que soient prises toutes
mesures susceptibles d’assurer l’égalité entre les
candidats... ». La Commission nationale veille au respect en
dernière instance du principe d’égalité entre les candidats et
garde tous ses pouvoirs en matière de propagande écrite.
Rappelons qu’au sommet de la hiérarchie des organes protecteurs
de l’égalité se trouve le Conseil Constitutionnel qui, en vertu
de l’article 58 de la Constitution, “veille à la régularité de
l’élection du Président de la République”. Ces différentes
12
instances successives de régulation se sont donc vues confier
le soin de fixer les règles concernant les émissions
officielles sur les chaînes du secteur public (production,
programmation et diffusion). L’instance actuelle de régulation,
le CSA, exerce un double contrôle: d’une part, sur
l’organisation de la campagne officielle, avec notamment les
émissions diffusées par les sociétés nationales de programme et
d’autre part, sur le traitement de l’information assuré dans
les programmes d’information de ces sociétés et des autres
services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés.
1.3.1. La campagne officielle à la radio et à la télévision
Le code électoral prévoit que pour les élections d’ampleur
nationale, c’est-à-dire au moins les présidentielles et les
législatives, soient diffusées des émissions officielles de
radio et de télévision par les sociétés nationales de
programme. Les services privés de télévision ne sont pas placés
dans l’obligation d’offrir du temps d’antenne aux candidats.
Pour la présidentielle, le décret du 14 mars 1964 prévoit que
deux heures de télévision et deux heures de radio sont
accordées aux candidats avant chaque tour. Une stricte égalité
des temps de parole accordés aux candidats est respectée, avec
tirage au sort des ordres de passage. Ce crédit d’heures peut
être réduit si les candidats sont nombreux ; ce fut le cas pour
toutes les campagnes postérieures à 1965. A cet effet le décret
de 1964 est actualisé par celui du 8 mars 2001: « Chaque
candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et
13
d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés
nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée
est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel
après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être
inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour.
Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure
sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire
cette durée ».
A partir de 1988, la réglementation spécifique se développe. La
CNCL fixe les règles de production, de programmation et de
diffusion des émissions officielles. Tenant compte de la
concurrence faite aux programmes électoraux par les chaînes
privées, elle a essayé de moderniser la forme des émissions
officielles. Ainsi elle augmente la proportion autorisée de
documents vidéographiques ou sonores. Déjà, à l’occasion des
élections européennes de 1984 et des élections législatives de
1986, la Haute Autorité de l’Audiovisuel avait accepté
l’insertion de vidéogrammes réalisés aux frais des listes ou
partis dans la proportion de 30% de chaque intervention
officielle à la télévision. A partir de 1988 la proportion
admise monte à 40%, en 1995 c’est la moitié du temps des
émissions courtes et moyennes et en 2007 les vidéogrammes ne
peuvent dépasser 50% du temps total de la campagne pour le
premier tour. En 2012, pour la première fois, les équipes des
candidats ont pu utiliser dans les messages de la campagne
jusqu’à 75 % d’inserts réalisés par leurs propres moyens. Mais
cet assouplissement progressif est assorti d’un encadrement
strict, d’où il ressort les interdictions suivantes : recourir
14
à un moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision
les autres candidats ; utiliser l’image de personnalités sans
l’accord écrit et préalable de celles-ci ou de leurs ayants
droit ; faire apparaître des lieux officiels dans les éléments
de décor ; utiliser les hymnes nationaux ; faire usage du
drapeau français ou de la combinaison des trois couleurs bleu,
blanc, rouge. De plus, on offre aux candidats la possibilité de
tourner en extérieur une émission officielle. Les moyens de
tournage sont mis à la disposition des candidats en respect du
principe d’égalité, alors que l’insertion des vidéogrammes est
laissée à leurs frais.
1.3.2. Le traitement de l’information dans la couverture de
l’actualité
Les profondes transformations du paysage audiovisuel
français, notamment depuis le mouvement de privatisation, ont
eu pour conséquence d’élargir les choix des téléspectateurs.
Les émissions électorales, qui étaient autrefois retransmises
sur les trois chaînes du service public, étaient
incontournables du fait du monopole. Aujourd’hui la concurrence
des télévisions privées, non assujetties aux obligations de
retransmettre la propagande électorale, se traduit par une
baisse d’audience des programmes électoraux au profit des
programmes alternatifs sur les autres chaînes. Ceci renforce
donc l’impact virtuel des émissions d’information comme le
journal télévisé, réputé non partisan et qui couvre
quotidiennement la campagne. Toute une réglementation a été
élaborée par les instances de régulation successives. Leur
vocation était de veiller au respect des principes de
15
pluralisme, d’équilibre et d’égalité selon les phases de la
campagne électorale. Le décret du 14 mars 1964 demande le
respect du principe d’égalité entre les candidats pour ce qui
concerne les programmes d’information, et notamment la
reproduction ou les commentaires à propos des candidats, ainsi
que la présentation de leur personne. Depuis 1’élection de
1988, l’instance de régulation adresse des recommandations aux
sociétés nationales de programme, puis aux exploitants des
services de communication audiovisuelle (pendant la campagne
officielle), pour assurer le pluralisme et le traitement
équilibré des candidats, selon des principes évoluant
progressivement de la règle des trois tiers (jusqu’en 2009) au
respect du principe d’égalité. La norme requise des médias en
conjoncture ordinaire était de couvrir dans des proportions
équivalentes les activités du gouvernement, de la majorité et
de l’opposition. Le « principe de référence » s’est ensuite
imposé à partir de 2000, ajoutant aux trois acteurs précédents
les formations politiques non représentées au Parlement qui
doivent bénéficier d’un temps d’intervention « équitable »..
Les indicateurs d'évaluation du pluralisme sur les chaînes nationales
hertziennes
Le pluralisme est apprécié depuis à la lumière d'une série d'indicateurs.
Le temps d'antenne
C’est la totalité du temps consacré au sujet : plateau, reportages,
interventions. Cet indicateur permet d'appréhender le poids d'un sujet dans
l'actualité, ce dont les seuls temps de parole ne peuvent rendre compte.
Le temps de parole
C’est le seul temps pendant lequel une personnalité s'exprime.
L'audience des temps de parole
16
Au-delà du seul volume de temps de parole, il est important d'apprécier
dans quelles conditions "d'exposition" ont été diffusées les interventions.
En effet, l'audience varie suivant les éditions des journaux télévisés.
Ces différents indicateurs permettent ainsi au Conseil de savoir :- qui a
parlé, - sur quel sujet, - pendant combien de temps, - devant quelle
audience ?
Le rythme d'appréciation du respect du pluralisme
La mesure reste mensuelle, mais l'évaluation du respect du pluralisme
portera à la fois sur les résultats d'un mois et sur ceux d'un trimestre
glissant (par exemple pour le mois de mars, analyse des temps de mars et de
la période janvier-février-mars ; pour le mois d'avril, analyse des temps
d'avril et de la période février-mars-avril, etc). Les trois mois glissants
ont l'avantage d'atténuer les répercussions des événements de l'actualité
sur un mois donné. Pour les magazines d'information et les autres émissions
du programme (hors journaux télévisés), l'appréciation restera
semestrielle. Le bilan annuel récapitulera les résultats de chaque
trimestre glissant.D’après : http://www.csa.fr
A partir de septembre 2009 le temps de parole « non
régalien » du président de la République est aussi décompté.
Les temps de parole des collaborateurs du chef de l’État et les
interventions de ce dernier lorsqu’elles relèvent du débat
politique national sont désormais intégrées dans le bloc
majoritaire. Pour les trois dernières campagnes, le tableau
suivant résume les principes applicables à la surveillance du
respect du pluralisme selon les périodes.
Campagne de 2002
Jusqu’au 31/12/2001 Précampagne (1 janvier-
7 avril)
Campagne officielle
(8 avril-3 mai)Principe d’équilibre Actualité non liée à Principe d’égalité
17
entre gouvernement,
majorité et opposition
parlementaire.
l’élection : principe
de référence.
Actualité liée à
l’élection :
Principe d’équité.
stricte.
Campagne 2007Période préliminaire :
(1 Décembre2006/18 mars
2007)
Période intermédiaire :
(19 mars/8 avril 2007)
Campagne officielle
(9 avril/4 mai)
Principe d’équité
applicable au temps
d’antenne et de parole.
Principe d’équité pour
le temps d’antenne.
Principe d’égalité pour
le temps de parole.
Principe d’égalité
applicable au temps
d’antenne et de parole.
Campagne 20121 janvier / 19 mars
2012
(20 mars/8 avril 2012) (9 avril/6 mai 2012)
Principe d’équité
applicable au temps
d’antenne et de parole
Principe d’équité pour
le temps d’antenne.
Principe d’égalité pour
le temps de parole.
Principe d’égalité
applicable au temps
d’antenne et de parole.
1.4. -La réglementation du financement
Jean-Claude Colliard résume en peu de mots l’essentiel de
l’évolution : « C’est le sujet mystérieux par excellence, qui
18
donne naissance à toutes les rumeurs et à toutes les
hypothèses. Il faut là considérer deux situations bien
différentes, avant et après l’intervention de la loi du 11 mars
1988 ( modifiée par les lois des 15 janvier et 10 mai 1990) :
ou comment passer du brouillard à la lumière ...tamisée. »
Avant 1988, on dispose soit d’évaluations plus ou moins
impressionnistes, soit des niveaux légaux de remboursement
public. Ainsi est-il prévu de rembourser une somme forfaitaire
pour frais de campagne de 100 000 F, qui passe à 250 000 F à
partir de 1980 pour les candidats qui obtiennent 5% des
suffrages exprimés, et de 10 000 F de remboursement du
cautionnement en plus des autres formes de contributions de
l’Etat : prise en charge des affiches, professions de foi,
bulletins et mise à disposition gratuite du temps d’antenne
radiotélévisé. A partir de 1988, la situation évolue rapidementcomme l’indique le tableau ci-dessous :
Année d’élection Montant maximal des
dépenses du 1er tour
Montant maximal des
dépenses du 2ème tour
1988 120 millions de
francs
140 millions de
francs
1995 90 millions de
francs
120 millions de
francs
2002 14,8 millions
d’euros
19,8 millions
d’euros
2007 16,2 millions
d’euros
21,6 millions
d’euros
19
2012 16,851 millions
d’euros
22,509 millions
d’euros
En outre, pour couvrir ces dépenses, les candidats peuvent
faire appel aux dons de personnes physiques (qui ne peuvent
excéder 4 600 euros par personne), aux contributions des
partis, aux recettes d’opérations commerciales et à leurs
ressources personnelles. L’Etat rembourse 50% des dépenses
retracées dans le compte de campagne (dans la limite du plafond
des dépenses) des candidats ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés et seulement 1/20ème pour les autres soit 7
millions d’euros pour les candidats du premier tour qui ont
dépassé 5% des suffrages et 10 millions pour ceux du second
tour. De plus l’Etat verse une avance forfaitaire de 153000
euros à chaque candidat ayant obtenu 500 parrainages au moment
de la publication de la liste officielle des candidats.
Au total, il est manifeste qu’en ce qui concerne le cadre
juridique, la campagne présidentielle s’est vue
considérablement précisée, spécifiée et règlementée dans ses
multiples aspects, allant de l’accès à la candidature aux
conditions de financement en passant par la communication et le
traitement de l’information. Cette institutionnalisation par
solidification des contraintes juridiques s’accompagne
logiquement d’une tendance à la rationalisation des campagnes
présidentielles.
II- LA RATIONALISATION DES PRATIQUES
20
Les ressources à coordonner pour la mobilisation électorale
sont multiples et se sont diversifiées : maîtriser la dimension
individuelle de la candidature, susciter les soutiens
collectifs, recourir aux experts et assurer le financement. Les
efforts de coordination des acteurs politiques ont, en effet,
tendu à s’ajuster aux nouvelles conditions de la compétition
pour le pouvoir, en veillant davantage aux aspects stratégiques
nouveaux, en sophistiquant les techniques et en les intégrant
dans une démarche plus rationalisée mais plus coûteuse.
2.1. La gestion de la candidature et des soutiens
La candidature est un élément central de la campagne. Sa
déclaration fait la transition entre la période de préparation,
plus ou moins longue et silencieuse et la période active. « Si
la candidature résulte d’un acte individuel, première
manifestation du « caractère » que doit montrer un candidat à
la présidence, elle se doit d’apparaître comme immédiatement
soutenue par une adhésion collective » écrit Jean-Claude
Colliard.
Quand le candidat entre-il en campagne ? Prenons l’exemple
de 1988. François Mitterrand entre-t-il en campagne lors de
l’annonce faite au journal télévisé de 20 heures, un mois
avant le scrutin ? Est-ce lors des voeux du 31 décembre 1987 où
le président affirme aux Français qu’il aura besoin de leur
soutien dans les mois à venir ? Est-ce dès la défaite
électorale des socialistes qui met le président à l’épreuve de
la cohabitation au printemps 1986 ? Est-ce dès la victoire de
1981 qu’il doit anticiper les comptes à rendre à la prochaine
21
échéance ? La durée de la campagne est donc très variable selon
l’angle de vue que l’on adopte.
L’élection de 1965 avait créé un précédent, Ch. de Gaulle
annonçant sa candidature lors d’une allocution radiotélévisée
seulement un mois avant le premier tour, précédé de deux mois
par François Mitterrand et de deux semaines par Jean Lecanuet.
Les élections de 1969 et de 1974 interviennent de façon brutale
consécutivement à une démission et un décès, ce qui précipite
toutes les entrées en campagne. Il est cependant à remarquer
que Georges Pompidou déclare en janvier 1969 qu’il briguera la
succession du général de Gaulle, bien avant le référendum
d’avril qui va mener à l’élection de juin. En 1981, Valéry
Giscard d’Estaing entre en lice le 2 mars, un mois après
Jacques Chirac, alors que François Mitterrand se déclare début
novembre 1980, trois semaines après que Michel Rocard ait
« proposé aux socialistes d’être leur candidat », le premier
tour se déroulant le 26 avril 1981. François Mitterrand
s’inspire en 1988 du précédent gaullien, alors que Jacques
Chirac officialise sa candidature plus de trois mois avant le
scrutin. En 1995, en l’absence de président sortant, l’ordre
d’entrée sur la scène de la campagne est le suivant : Jacques
Chirac le 4 novembre 1994, Edouard Balladur le 18 janvier 1995,
et Lionel Jospin le 3 février par le vote des socialistes, le
premier tour de scrutin ayant lieu le 23 avril. En 2002,
Jacques Chirac prècède de quelques jours en février son
concurrent Lionel Jospin et en vue de 2007 c’est Ségolène
Royal qui démarre la première en se déclarant le 29 septembre
2006, alors que Nicolas Sarkozy fait part de son intention le
22
30 novembre. F.Hollande se déclare candidat depuis Tulle le 31
mars 2011 alors que N.Sarkozy annonce au JT de TF1 le
renouvellement de sa candidature le 15 février 2012.
En général, les candidatures s’appuyant sur une notoriété
plus faible ou émises d’une position politique éloignée du
pouvoir institutionnel sont déclarées de façon plus
précoce : en 1965, Jean-Louis Tixier-Vignancour, candidat
de l’extrême droite, se lance 7 mois avant le scrutin. En
1988, J-M. Le Pen se déclare un an avant l’élection et en
1995 il le fait 7 mois avant. Dès octobre 2005 il confirme
son intention d’être candidat en 2007. Marine Le Pen est
élue présidente du Front national face à Bruno Gollnisch
le 16 janvier 2011. Sa candidature à l'élection
présidentielle est validée à l'unanimité par le bureau
politique du FN quatre mois plus tard.
La candidature est un acte de communication stratégique
qui indique un type de relation établi avec les citoyens.
Comparons les choix de deux présidents sortants qui se
représentent. En 1981, Valéry Giscard d’Estaing adopte la
posture du « citoyen-candidat » : il « redescend » au niveau
des citoyens ordinaires pour qu’ils le distinguent comme leur
chef. Sa communication est « symétrique ». En 1988, François
Mitterrand fait le choix inverse : sa communication est
« complémentaire ». Il joue à plein la légitimité
institutionnelle du président sortant qui préside jusqu’au bout
et qui va continuer à présider demain parce qu’il faut
s’opposer aux « clans et aux factions ». La Lettre à tous les Français,
23
deux semaines après l’annonce officielle, vient prolonger cette
stratégie par un récit de la cohabitation où est narré comment
le président s’est imposé au Premier ministre.
La candidature viable suscite une adhésion collective qui
se traduit par un soutien partisan. Comme le soulignent Jean et
Monica Charlot, « au début de la Vème République, non seulement
le candidat est plus important que le parti, mais c’est lui qui
donne naissance à un parti à différentes reprises.... A partir
de 1981, les choses changent et l’influence des partis se
manifeste par la présentation d’une candidature spécifique
quelle que soit la taille du parti»6. De même, Jean Massot
écrit «Pures démarches personnelles en 1965, les candidatures
sont devenues plus nettement des décisions des appareils des
partis ». En 1974, le PS demande à son premier secrétaire
d’être son candidat après que ce dernier ait annoncé sa
candidature. En 1981, il est le premier candidat réputé
éligible à solliciter une désignation partisane officielle.
Pour Jean-Claude Colliard, au contraire, les partis de la Vème
République sont « construits ou captés pour servir la
candidature présidentielle ». De l’autoproclamation ratifiée
par les soutiens immédiats à la procédure des primaires mise en
œuvre par les socialistes en 1995, en 2006 et élargie en 2011,
on observe que la relation candidat-parti constitue une
dimension incontournable de la stratégie électorale. Par
ailleurs, la candidature se construit dans le temps. Sa
qualification évolue en fonction des soutiens partisans et
témoigne de la position du candidat à l’égard du parti
6 Jean et Monica. Charlot, “France”, in D.Butler, A.Ranney (eds.),Electioneering, Oxford, Oxford university Press, 1992.
24
susceptible de le soutenir : songeons à Michel Rocard, candidat
« virtuel » en 1981 et 1988 puis « naturel » du PS en 1994 ; à
François Mitterrand, candidat « unique de la gauche » au
premier tour de 1965 puis « candidat des républicains » au
second tour, et « candidat commun de la gauche » en 1974.
Dans l’organisation de la campagne, la contribution du
parti est sensible tant au niveau national qu’au niveau local.
D’abord, les partis mènent une campagne au service du candidat
qu’ils soutiennent et utilisent à cet effet leur potentiel
militant, organisationnel, logistique et leurs réseaux
associatifs, syndicaux et sociaux. Selon Roger-Gérard
Schwartzenberg, en 1969 « Jacques Duclos utilise à fond les
immenses ressources du parti » comme Georges Pompidou peut
s’appuyer sur des « militants UDR intensément mobilisés à tous
les niveaux ». Ensuite, les partis constituent un vivier où les
candidats viennent recruter les personnalités présentes dans
les émissions télévisées et les membres des structures mises en
place pour la campagne. Ces équipes autonomes sont constituées
pour symboliser l’indépendance du candidat mais leurs membres
évoluent souvent dans la mouvance des partis qui le
soutiennent. Par exemple, on retrouve en 1969, autour de
Georges Pompidou, Edouard Balladur en charge des « dossiers et
rencontres », Michel Jobert (coordination), Pierre Juillet
(déplacements en province), Marie-France Garaud (relations avec
les parlementaires) et Anne-Marie Dupuy (liaison avec l’UDR).
Parallèlement aux campagnes des partis qui le soutiennent,
Mitterrand dispose en 1974 d’une équipe personnelle en charge
des déplacements, de la distribution des affiches officielles,
25
de la liaison avec les délégués départementaux : « Comme en
1965, le fond de l’équipe se compose d’anciens dirigeants de la
CIR, d’anciens membres des cabinets ministériels de François
Mitterrand, [mais aussi] de nombreux membres du Bureau exécutif
et du Comité directeur du Parti »7. De même, on remarque dans
ses campagnes deux futurs chefs du gouvernement : Pierre Mauroy
en porte-parole du candidat en 1981 et Pierre Bérégovoy en
directeur de la campagne en 1988. Dans l’entourage de Jacques
Chirac en 1995 se trouvent Alain Juppé, Philippe Séguin, Alain
Madelin, Jacques Toubon, Bernard Pons, Jean-Louis Debré, c’est-
à-dire le cercle des « politiques » qui complète le cercle
familial et le cercle des permanents, selon Jean Charlot. En
2007, les conseillers et membres de l’équipe de campagne de
Nicolas Sarkozy vont largement peupler les gouvernements Fillon
I et II. Il en va de même en 2012 pour ce qui concerne François
Hollande.
2.2 La professionnalisation des techniques de campagne
L’élection du président de la République au suffrage
universel est concomittante de transformations technologiques
et techniques qui vont concourir à la professionalisation des
pratiques politiques. Ainsi en va-t-il de la télévision, des
sondages d’opinion et des techniques de marketing qui, utilisés
de façon convergente, renouvellent les conditions de la
communication politique. Les prémices du processus se
manifestent dès 1965 avec l’irruption de la télévision qui
donne une réalité au pluralisme dans les médias et même des
visages pour le personnifier, le principe d’égalité à l’œuvre
7 Sylvie Colliard, La campagne présidentielle de F.Mitterrand en 1974, Paris, PUF, 1979, p. 37.
26
contrastant singulièrement avec l’ordinaire de la télévision
très fortement contrôlé par le pouvoir gaulliste. Le taux
d’équipement des ménages en télévision double entre 1962 et
1965 et atteint plus de 45%. Aux Etas-Unis où le processus de
« modernisation » est plus précoce qu’en France, la couverture
totale du territoire par la télévision intervient dès 1952 et
se développe alors le recours à la publicité télévisée dont on
sait aujourd’hui le poids dans la compétition électorale outre-
atlantique. Les sondages d’opinion s’y généralisent à partir de
la présidentielle de 1960. En France, c’est la campagne de 1965
qui installe télévision et sondages dans le paysage politique
et fait une place plus limitée à la publicité et au marketing.
La publicité n’est pas vraiment une nouveauté dans la mesure où
faire campagne, c’est aussi de longue date « s’afficher ». Mais
le publicitaire est, aujourd’hui sans doute, en France, la
figure emblématique de la communication politique
professionnalisée8, peut-être parce qu’il a su mieux que
d’autres faire connaître sa contribution. Le marketing est
réputé faire son entrée dans la politique française avec la
campagne de Jean Lecanuet par transposition de l’expérience
américaine de 1960 (importance de l’image personnelle, tour de
France du candidat, utilisation des médias,..) sans déboucher
sur une généralisation irrésistible. Aucun des candidats de
1969 n’y a recours et il faut attendre 1974 pour voir8 Il suffit de mentionner quelques acteurs particulièrement en vuedans différentes campagnes présidentielles : Georges Beauchamp (1965) pourF. Mitterrand, Jacques Hintzy (1974,1981 pour V. Giscard d’Estaing),Jacques Séguela (1981, 1988, 1995 pour F. Mitterrand et L. Jospin), BernardBrochand, Jean-Michel Goudard (1988, 1995, 2007 pour J. Chirac et N.Sarkozy), Philippe Michel (1988 pour R. Barre), Jacques Pilhan (1988 pour FMitterrand puis J. Chirac en 1995 après son élection), Jean-M. Goudard(2012 pour N.Sarkozy).
27
s’appliquer véritablement sa logique. D’une manière générale,
différents types de compétences plus ou moins
professionnalisées interviennent progressivement dans les
campagnes et ont partie liée tout en se faisant concurrence :
le conseil en image (catégorie la plus précoce), le sondeur, le
publicitaire, le conseil en communication.
L’innovation première consiste à découvrir le rôle de
« l’image » du candidat comme élément distinct du programme et
du parti qui le soutient. L’image est constituée par un
ensemble de connaissances, croyances et opinions associées à un
candidat. Elle se spécifie dans le positionnement du candidat
comme « sous-ensemble de l’image composé de traits saillants et
distinctifs »9. Pour le spécialiste de marketing, le choix du
positionnement est la décision majeure de campagne puisqu’elle
constitue « l’épine dorsale assurant unité et cohérence » en
combinant des orientations politiques et des qualités
personnelles. Selon Denis Lindon, simplicité, attrait,
crédibilité et originalité sont les qualités requises d’un
positionnement politique satisfaisant. Plus précisemment,
disons que le positionnement doit être lisible (perceptible et
intelligible par le public), adéquat aux attitudes et
péoccupations des électeurs, crédible (compatible avec l’image
mémorisée) et discriminant (distinctif par rapport aux
concurrents). L’allure et la présentation individuelle font
l’objet d’une attention particulière pour correspondre à des
« attentes » ou façonner des perceptions publiques. Ainsi Jean
Lecanuet en 1965 et surtout Valéry Giscard d’Estaing en 1974
9 Denis Lindon, « Le positionnement des candidats », Médiaspouvoirs n° 9, janvier-mars 1988.
28
apparaissent-ils comme les candidats les plus représentatifs de
cette nouvelle génération de pratiques électorales. Bien que
cette dernière campagne soit inopinée, elle atteste un état
certain de préparation et de croyance aux vertus du marketing
et d’instruments tels que sondages, meetings, affiches,
discours, ou matériel de propagande inspiré par la publicité
électorale américaine. L’élection de 1974 est la véritable
inauguration spectaculaire du processus de modernisation des
pratiques de campagne. « La victoire de M. Giscard d’Estaing
est celle d’un homme, plutôt que d’une politique ou d’un
parti » écrivent Denis Lindon et Pierre Weill10. S’appuyant sur
un modèle du comportement électoral11, ils considèrent que sa
victoire sur Jacques Chaban-Delmas au premier tour s’explique
par l’ajustement de l’image et des intentions de vote. La
publication des sondages d’intention de vote révèle le
retentissement de la candidature giscardienne dans l’électorat
et réduit la crédibilité réputée supérieure du candidat
gaulliste. On note au passage qu’il s’agit là, et pour la
première fois, de la reconnaissance ouverte d’un effet direct
des sondages sur les perceptions politiques. Pour les auteurs,
le candidat gaulliste commet trois erreurs de positionnement :
se présenter comme le candidat le mieux placé pour battre
François Mitterrand (les sondages montrent le contraire) ;
l’insistance sur la politique sociale (alors que François
Mitterrand est le candidat commun de la gauche) ; vouloir
paraître le candidat du centre (alors qu’il provient de l’UDR
10 Denis Lindon, Pierre Weill, « Autopsie d’une campagne : pourquoiM.Giscard d’Estaing a-t-il gagné ? », Le Monde, 22 mai 1974.11 Denis Lindon, Pierre Weill, Le choix d’un député. Un modèle explicatif ducomportement électoral, Paris, éd. de Minuit, 1974.
29
et qu’il affronte un républicain indépendant). La victoire sur
François Mitterrand au second tour tient au comportement de 14%
de l’électorat (segment critique) qui reste indécis après le
premier tour et non aux noyaux de 43% acquis à chacun des deux
candidats. C’est la supériorité de son image personnelle qui
assure la victoire de Valéry Giscard d’Estaing parce que les
électeurs flottants, peu politisés, ont tendance à valoriser
les considérations personnelles comme critère de choix. Il faut
ajouter que ce modèle explicatif a été utilisé en cours de
campagne pour éclairer le candidat Mitterrand et formuler des
recommandations stratégiques12.
Le discours télévisé est sensible à cette stratégie de
cibles dans la mesure où chacun des candidats a tendance avant
le premier tour à s’adresser à ses électeurs acquis avec un
vocabulaire partisan typé. Au second tour les deux candidats,
visant la même cible des segments critiques, tendent à
neutraliser leurs propos pour attirer l’électeur médian. Deux
points ressortent bien de cette illustration par la campagne de
1974. D’abord, l’importance nouvelle des facteurs personnels
dans la détermination des décisions de vote entre en résonance
avec la personnalisation de la candidature présidentielle qui
constitue un terrain privilégié pour l’expansion de ces
stratégies d’image. Ensuite, l’application au politique d’une
conceptualisation inspirée par la logique de marché s’épanouit
dans une démarche très balistique du marketing électoral : le
corps électoral est segmenté et ciblé pour être atteint par des
messages calibrés, susceptibles de susciter l’adhésion de
l’électeur. La campagne de Mitterrand en 1974 est « sans12 Sylvie Colliard, op.cit., pp 81-93.
30
commune mesure » avec celle de 1965, selon Sylvie Colliard. Non
seulement parce qu’il est devenu le leader de l’opposition et
le candidat commun de la gauche, mais aussi parce qu’on y passe
« de l’artisanat au modernisme » en faisant « l’apprentissage
du marketing politique ». « Elle peut être considérée comme la
première campagne moderne de la gauche » en raison de l’usage
des médias, du marketing et des méthodes de financement.
Sa campagne victorieuse de 1981 contre le président
sortant manifeste une accentuation du recours au marketing sans
pour autant renoncer à être politique sur le plan du contenu.
La campagne d’affichage est exemplaire de cet amalgame, comme
déjà l’expriment les slogans des affiches conçues par l’équipe
de Jacques Séguela pour les législatives de mars 1978 : « Le
Socialisme, une idée qui fait son chemin. François Mitterrand »
ou plus connu pour la présidentielle : « La force tranquille.
Mitterrand Président ». Le sacrifice à la personnalisation se
fait encore plus net qu’en 1974 et facilite le réalignement
électoral et la grande alternance. Mais le caractère
profondément politique du choix est moteur dans la dynamique de
la campagne, et ce critère a tendance à prévaloir
progressivement chez les électeurs. Ainsi le positionnement de
François Mitterrand en 1981 associe-t-il la lutte contre les
injustices sociales et le chômage d’une part à la « force
tranquille » d’autre part. Si donc Valéry Giscard d’Estaing a
pu construire principalement son succès sur l’attraction de son
image personnelle en 1974 (jeunesse, modernisme, compétence,
notamment), François Mitterrand semble devoir le sien plutôt au
contenu politique de sa campagne. En effet, au cours de la
31
campagne, le poids des considérations personnelles
(personnalité et compétences) ne cesse de décroître au profit
des considérations politiques (parti et programme)13 dans les
critères de décision individuelle, et ce rééquibrage profite au
candidat socialiste.
L’élection de 1988 présente une tout autre allure dans la
mesure où l’essentiel de la campagne se joue à travers la
cohabitation14 et le jeu de rôles entre le Président, candidat
in fine, et le Premier ministre qui cherche à contrer la
légitimité institutionnelle supérieure de son adversaire. La
position de pouvoir est discriminante dans la perception des
candidats potentiels : ceux qui l’exercent (F. Mitterrand et J.
Chirac) se distinguent de ceux qui en sont éloignés (R. Barre,
M. Rocard)15. La crédibilité du président repose sur son
« image de chef d’Etat, capable de rassembler, possédant une
expérience des situations difficiles et sachant faire respecter
les libertés des Français ». Celle du Premier ministre vise à
garantir la sécurité des personnes et comme le Président, à
assurer la place de la France dans le monde. On comprend que
dans ces conditions, la campagne des principaux protagonistes
passe par l’information ordinaire et les perceptions qu’elle
induit concernant l’exercice du pouvoir, beaucoup plus que par
une communication de candidat16. Cette campagne apporte,13 Roland Cayrol, « Le rôle des campagnes électorales », dans DanielGaxie, dir., L’explication du vote, Paris, Presses de la FNSP,1985.14 Sur la légitimation progressive de la cohabitation dans les médias,voir Michael Lewis-Beck, Richard Nadeau, « La visibilité médiatique et lapopularité de la cohabitation », dans Jacques Gerstlé, dir., Les Effetsd’information en politique, L’Harmattan, Paris, 2001.15 Gérard Grunberg, Elisabeth Dupoirier, « Les cibles de la campagne »,Médiaspouvoirs n° 9, janvier-mars 1988.16 L’ouvrage le plus complet sur la communication dans la campagne de1988 est comparatif : Lynda L. Kaid, Jacques Gerstlé, R Keith Sanders,
32
cependant, un second enseignement concernant la difficulté à
modifier l’image politique individuelle construite de façon
cumulative dans le temps et notamment à l’épreuve du pouvoir17.
Les décisions prises par les dirigeants servent de marqueurs et
permettent de les classer et de les différencier. Elles
constituent des « actes lourds » qui composent durablement
l’image politique.
1995 se présente comme une campagne qui prolonge et qui
innove, ne serait-ce qu’en raison du cadre juridique plus
contraignant. Marquée en termes de candidatures socialistes par
des renoncements précoces (M. Rocard, J. Delors) et une
primaire socialiste tardive (L. Jospin), elle est dominée par
la compétition E. Balladur-J. Chirac, ultra-personnalisée au
moins dans les médias. Ce dernier démarre tôt une campagne très
active. Cette démarche ne porte néanmoins ses fruits qu’en
février, après que le Premier ministre, Edouard Balladur, ait
annoncé sa candidature et l’ait vue ruinée par une série
d’affaires et de maladresses en cascade. Le chef du
gouvernement qui optait pour une stratégie « tuilée », le
faisant glisser de Matignon à l’Elysée, se devait alors de
présenter un bilan satisfaisant et rester en adéquation avec
l’image de la fonction présidentielle. La conjoncture et sa
façon de la gérer ne lui a pas permis de remplir ces
conditions. « Pour que le message chiraquien résonne
positivement auprès des électeurs, il fallait d’abord que celui
eds., Mediated Politics in Two Cultures. Presidential Campaigning in the United States and France,Praeger, New York, 1991.17 J.-L. Parodi, « Ce que tu es parle si fort, qu’on entend pas ce quetu dis. Réflexions sur l’équilibre et le marketing de l’apparence dans ladécision électorale », Hermès, IV, CNRS, 1989.
33
d’Edouard Balladur fut rejeté. Alors que Jacques Chirac faisait
campagne sur les mêmes thèmes depuis trois mois, il ne
parvenait pas à emporter l’adhésion. Il a fallu la concomitance
de l’entrée en scène d’Edouard Balladur et de Lionel Jospin et
la fatale cascade de « difficultés » gouvernementales
affaiblissant de façon irréversible la légitimité et la
crédibilité du Premier ministre-candidat pour que le message
chiraquien trouve enfin un écho favorable. En ce sens, la
disqualification du Premier ministre-candidat a précédé et
rendu possible l’adhésion à une promesse de droite alternative»18.
La campagne de 2002 est singulière en ce sens qu’elle
vient ponctuer une expérience de longue cohabitation au terme
de laquelle beaucoup pensent que les deux cohabitants seront
les ultimes adversaires du second tour. Ceci conduit les médias
à se tourner en cours de campagne vers les candidatures de
moindre « importance » et à favoriser donc leur légitimité
comme vote de substitution au premier tour. Le grand nombre de
candidats, seize, spécialement à gauche (huit) , entraîne une
dispersion des votes. Enfin, la pression d’un agenda
particulièrement sécuritaire depuis plus d’un an dans les
médias, en écho aux représentants de la droite, oriente
l’attention publique vers ce type de considérations pour
l’installer en critère premier du choix électoral.
La campagne de 2007 n’est pas moins singulière car l’offre
politique, très renouvellée, s’y met en place très tôt.
Spécialement côté socialiste où Ségolène Royal à l’issue d’une18 Jacques Gerstlé, « La dynamique sélective d’une campagne décisive »,dans P. Perrineau, C. Ysmal, dirs, Le Vote de cise, Presses de sciences po,Paris, 1995.
34
campagne d’opinion largement relayée par les médias parvient à
conquérir l’investiture des militants socialistes dès novembre
2006. Son concurrent direct, Nicolas Sarkozy, préside aux
destinées de l’UMP depuis 2004 et occupe depuis 2002 les
ministères de l’Intérieur, puis de l’Economie et à nouveau de
l’Intérieur. Ces différentes fonctions lui ont permis de se
mettre largement en évidence dans les médias et de préparer
l’échéance électorale pour laquelle il est désigné candidat le
14 janvier 2007 par un congrès extraordinaire de l’UMP. La
campagne est marquée par une très grande volatilité de l’agenda
où les épisodes se succèdent à un rythme soutenu sans qu’on
puisse considérer qu’un thème dominant s’impose. A la campagne
interne des socialistes font suite les voyages de Ségolène
Royal au Moyen-Orient et en Chine, puis la désignation de
Nicolas Sarkozy. La lutte des Enfants de Don Quichotte en
faveur des sans logis, le pacte écologique médiatisé par
Nicolas Hulot, le discours-programme de Villepinte de Ségolène
Royal, le chiffrage des programmes, les controverses sur les
patrimoines et la fiscalité, sur l’identité nationale et
l’immigration se succèdent avant que l’insécurité ne revienne
en fin de campagne. A défaut d’une thématique centrale c’est
donc le style ou l’image qui semblent avoir prévalu, la
télévision y contribuant largement19.
La campagne de 2012 est marquée par l’élimination dès le
printemps 2011 du favori des sondages, Dominique Strauss-Kahn,
précédée de la déclaration de candidature discrète de
F.Hollande en mars 2011. Puis à la rentrée 2011, le choix des
socialistes, où se réunissent les voix des militants et des19 Piar, Christophe, Comment se jouent les élections, INA Editions, 2012.
35
sympathisants pour la première fois, désigne F.Hollande qui bat
Martine Aubry au second tour de primaires ouvertes. Son envolée
médiatique et sondagière consécutive au discours du Bourget en
janvier 2012 précipite l’entrée en campagne du président
sortant en février 2012. Ne pouvant rééditer sa stratégie de
rupture, le président-candidat égraine des mesures ponctuelles
comme en témoigne son discours de Villepinte fortement centré
sur l’identité et les frontières de l’Europe. L’affaire Merah
en mars 2012 vient consolider la posture droitière donnée à son
image par N.Sarkozy qui paye largement dans son échec
l’antisarkozysme virulent qu’avait fait naître son mandat
présidentiel.
2.3 L’intensification du recours aux sondages
L’instrument du sondage occupe une place stratégique dans
le dispositif des pratiques nouvelles de campagne. Une démarche
de positionnement politique requiert au moins trois types
d’études où le sondage, sans être un outil exclusif, est le
plus utilisé: la connaissance de l’image du candidat, qu’il
s’agise de ses qualités personnelles ou bien de ses
orientations politiques ; la connaissance des attentes et des
préoccupations des électeurs ; la connaissance du
positionnement des concurrents car tous les candidats sont
stratégiquement interdépendants. De plus, ce type d’enquête
sert à identifier des segments critiques de l’électorat, des
cibles stratégiques, à tester les thèmes et à calibrer les
messages de campagne. Le sondage est donc un instrument de
préparation de la persuasion, mais aussi de persuasion tout
court lorsqu’une publication de résultats en temps opportuns
36
est susceptible d’être exploitée pour provoquer des effets
d’opinion. Mais indépendamment des usages stratégiques du
sondage par les candidats, la demande des médias est une
seconde source d’intensification du recours aux sondages. Pour
les besoins d’une couverture spectaculaire de la compétition
électorale, journaux et médias audiovisuels commandent des
enquêtes dont la publication alimentera le feuilleton de la
course à la présidence, ce que les anglo-saxons nomment le
« horse-race coverage ».
La « victoire médiatique et populaire des sondages
électoraux », selon les termes de Roland Cayrol, date de 1965.
Pour voir leur développement freiné il faut attendre la loi du
19 juillet 1977 qui interdit de publier les résultats de
sondage dans la semaine précèdant chaque tour de scrutin. La
commission des sondages enregistre et contrôle néanmoins 111
enquêtes pour la campagne présidentielle de 1981. Au-delà des
intentions de vote et même si elles restent largement
dominantes, les sondages autorisent l’analyse de nombreuses
dimensions de l’opinion publique : popularité et image du
Président, choix du meilleur candidat socialiste (F. Mitterrand
ou M. Rocard, par exemple), soutien aux candidats selon la
préférence partisane, crédibilités comparées, perceptions de
campagne, souhaits et prédictions du vote20. Entre janvier et
mai 1988, on a encore enregistré 153 sondages publiés et connus
par la Commission. La situation de 1995 est encore plus
favorable au développement des sondages électoraux dans la
mesure où « l’indécision des électeurs le dispute, en effet, à
20 Howard R. Penniman, ed., France at the Polls,1981 and 1986, Durham, DukeUniversity Press, Durham,1988.
37
l’incertitude des candidatures »21. La conjonction de cette
montée en puissance continue des sondages, leur
« hypermédiatisation » et leurs médiocres performances en 1995
( ils avaient surestimé au premier tour le score de J. Chirac
et sous-estimé celui de L. Jospin) a fait éclater une polémique
sur leur fiabilité, leur impact et l’opportunité des
restrictions depuis 197722.
Leur impact sur le public est plus complexe à apprécier
parce qu’il se traduit par des effets directs sur les
préférences des électeurs mais aussi indirects. Dans ce second
cas, les sondages pèsent sur les représentations des
journalistes (ne serait-ce qu’en terme de hiérarchisation de
l’information) et ces représentations pèsent secondairement sur
le public. Cet aspect est examiné plus loin à travers le
problème de la pression exercée sur et par l’information,
notamment le phénomène du cadrage discriminant. « On peut
estimer que dans les élections françaises, la publication des
sondages a accéléré, dans le camp de la droite, la polarisation
au profit d’un candidat (Giscard en 1974, Chirac en 1988 et
1995), et au détriment d’un autre (Chaban-Delmas en 1974, Barre
en 1988, Balladur en 1995), les électeurs prenant en compte les
évolutions mesurées par les instituts pour se porter sur le
meilleur candidat contre la gauche », estime Roland Cayrol23.
Les sondages feraient alors de l’électeur un stratège. En 2002
les instituts de sondages ont interrompu leurs enquêtes après
le premier tour, compte tenu de la surprise de la qualification
21 Jean Charlot, op.cit. 22 Table ronde, « Haro sur les sondages ? », Revue Politique et Parlementaire, n° 977, mai-juin 1995, p. 4-26.23 Roland Cayrol, Encyclopaedia Universalis.
38
de Jean-Marie Le Pen, mais en 2007 ils ont repris de plus belle
leur activité pour atteindre une production inégalée (voir
chapite 3). Au soir du second tour de 2012, le nombre de
sondages publiés pour cette campagne devrait approcher le
nombre de 400. Avec un tiers de plus qu’en 2007, il s’agit d’un
nouveau record, selon la commission des sondages.
2.4. Le coût des campagnes
Le remboursement public forfaitaire des frais de campagne est
limité à 5 % du montant du plafond de dépenses électorales pour
les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages et à 50 %
de ce même montant pour ceux qui ont obtenu plus de 5 % des
voix. Mais la somme prévue est loin de permettre aux candidats
de faire face à l’explosion des coûts de campagne, par ailleurs
bien difficiles à connaître avant 1988. Selon Roger-Gérard
Schwartzenberg, les coûts de campagne en 1965 auraient été de 1
MF pour François Mitterrand (hors campagne des partis), 5 MF
pour Jean Lecanuet et plus du double pour le général de Gaulle.
En 1969, celle d’Alain Poher, considérée comme peu onéreuse,
aurait coûté près de 3 MF et celles de candidats moins en vue
environ dix fois moins. Michel Rocard avance 310 000 francs
(essentiellement pour payer les affiches, la location d’un
local, l’emploi de quelques collaborateurs, la location de
salles de réunion et des déplacements). Le PCF annonce 1,5 MF
pour la campagne nationale de Jacques Duclos et autant au
niveau des fédérations, sections et cellules. S’agissant de
Georges Pompidou, les coûts s’élèveraient considérablement,
mais aussi le mystère qui les entoure24. Côté socialistes, « A
la fin de la campagne 1974 on avouait des dépenses de l’ordre24 Jean et Monica Charlot, op.cit.
39
de quatre à cinq millions. Il semble raisonnable d’évaluer le
montant total de l’opération à sept millions de francs environ,
soit deux fois ce qu’avait dépensé Alain Poher en 1969, et
quatre à cinq fois moins que les sommes engagées à l’époque par
Georges Pompidou (plus de trois milliards d’anciens francs,
dit-on) »25. Le coût estimé de la campagne de Valéry Giscard
d’Estaing serait approximativement de 14,5 MF. Pour 1981, les
chiffres avancés attestent au moins la disproportion des
budgets puisque L’Humanité chiffre à 15 MF la campagne du PCF
mais les candidats les plus riches iraient jusqu'à 30, voire 60
MF. A partir de 1988, les comptes de campagne sont disponibles
mais les chiffres semblent sous-estimés. Par exemple, Jean-
Marie Le Pen avance un chiffre officiel de 36,5 MF, mais une
estimation plus crédible conduit à 60 MF26.
Les dépenses officielles des candidats en 1988 et 1995 en
millions de francs1988
F.Mitterr
and
J.Chirac R.Barre J-M.Le
Pen
A.Lajoini
e
A.Waechte
r
P.Juquin A.Laguill
er
P.Boussel
99.8 96 64,1 36,5 33,3 6,9 6,8 6,4 4 1995
J.Chirac L.Jospin E.Balladu
r
J-M.Le
Pen
R.Hue A.Laguill
ier
Ph.de
Villiers
D.Voynet J.Chemina
de
116,6 88,2 83,8 41,3 48,7 11,3 24,1 7,9 4,7
(Voir note s’agissant des recettes27).
25 Sylvie Colliard, op.cit., p 96.26 Christophe Hameau, La campagne de Jean-Marie Le Pen pour l’élection présidentielle de1988, LGDJ, Paris, 1992.27 S’agissant des recettes, est à remarquer la contribution des partis
puisqu’elle s’élève en 1988 à 40 MF pour Jacques Chirac et 37 MF pour
François Mitterrand.
40
Les dépenses officielles des candidats en 2002, 2007 et 2012 en
millions d’euros
2002J.Chirac L.Jospin J-M. Le Pen F.Bayrou J-P.Chevènement R.Hue N.Mamère
A.Madelin A.Laguiller Ch.Boutin… ...D.Gluckstein
18,007 12,519 12,126 8,892 9, 707 5,344 4,184
3,202 2,381 1,585 0,573
2007N.Sarkozy S.Royal F.Bayrou J-M.Le Pen M-G.Buffet Ph. De Villiers A. Laguiller D.Voynet J.Bové O.Besancenot F.Nihous Schivardi21,038 20,172 9,7 9,7 4,8 3,1 2,1
1,4 1,2 0,900 0,800 0,700
2012F.Hollande N.Sarkozy J-L.Mélenchon M.Le Pen F.Bayrou E.Joly N.Dupont-Aignan Ph.Poutou N.Arthaud J.Cheminade21,769 : 21,339 : 9,514 : 9,095 : 7,042 : 1,812 :1,237 : 0,824 : 1,022 : 0,498 :
On voit bien le lien qui existe entre technicisation,
professionnalisation et augmentation du coût de la vie
politique, limité par le renforcement de la réglementation
depuis la fin des années 1980 pour préserver l’égalité des
candidatures, favoriser l’expression du pluralisme et, au
total, donner un caractère plus démocratique à la compétition
électorale. La comparaison des sommes déclarées pour 2002, 2007
et 2012 par familles politiques illustre l’impact de la
règlementation, l’adéquation entre les moyens et l’influence
politique et révèle pour la plupart des candidats une certaine
similitude dans le niveau des dépenses à cinq années
d’intervalle.
41
3. LES TRANSFORMATIONS DE LA MEDIATISATION
Comme le signale Jean Massot28, le rôle des médias est,
avec l’utilisation des techniques de sondage, le phénomène qui
a contribué depuis 1965 à faire de l’élection présidentielle un
« événement » particulièrement mobilisateur. Les comportements
et pratiques des gouvernés et gouvernants montrent une
dépendance croissante à l’égard des médias. Pour les premiers,
ils représentent des sources privilégiées d’acquisition de
l’information politique. Pour les seconds, ce sont des vecteurs
de communication stratégique. Mais l’efficacité présumée des
médias est trés inégalement distribuée et la télévision s’est
rapidement acquise une position dominante. La médiatisation des
campagnes électorales passe davantage par des moyens
audiovisuels qui n’ont pas échappé à des changements
importants, ni fait disparaître les moyens traditionnels de
persuasion.
3.1. les moyens traditionnels de propagande : déclin et
permanence
Le code électoral prévoit l’utilisation de certains moyens
conventionnels tels que les affiches officielles, les
professions de foi29 adressées à chaque électeur inscrit, les
réunions électorales, mais bien d’autres procédés peuvent être
utilisés par les candidats pour faire campagne : le web et ses
dérivés (blogs et podcasts), les tracts, les livres et
28 Jean Massot, La présidence de la République, op.cit.29 Les professions de foi des candidats sont reproduites dans la sérieTextes et Documents relatifs aux élections présidentielles ainsi que dans Ballet (Marion),2010, édités par la Documentation Française.
42
brochures, les objets et photos, etc., bref ce qu’il est
convenu d’appeler le matériel de propagande.
L’écrit conserve une place indéniable sous différentes
formes. En 1969, Alain Poher fait tirer à huit millions
d’exemplaires un journal spécial diffusé par des militants
alors que L’Humanité-Dimanche diffuse en même quantité mais avec
son circuit autrement plus structuré et performant.
La biographie, plus ou moins hagiographique ou polémique,
du candidat est un genre constant. Le livre signé par le
candidat a sans doute un statut particulier dans cet ensemble
pour ce qu’il représente de culture et de programme, de projet
ou de vision, comme on dit plus volontiers aujourd’hui.
En novembre 1980, François Mitterrand avait publié Ici et
maintenant. Il adresse en 1988 une Lettre à tous les Français. Six mois
avant La France pour tous, Jacques Chirac publie en juin 1994 Une
nouvelle France, Réflexions 1 dont 190 000 exemplaires sont diffusés ;
vingt millions de francs sont consacrés à la distribution d’une
sorte de digest du livre sur les marchés, par courrier ou porte
à porte. Edouard Balladur publie dans la collection Livre de
poche ses discours et articles antérieurs dont la diffusion
atteind presque 100 000 exemplaires. Nicolas Sarkozy publie en
juillet 2006 Témoignage dont il assure la promotion durant tout
l’été, ce qui est l’occasion de partir à la rencontre des
Français y compris sur leurs lieux de vacances et en avril 2007
Ensemble alors que Ségolène Royal publie Maintenant en mars 2007.
En février 2012, F.Hollande publie « Changer de destin » après
« Le rêve français » en août 2011 et N.Sarkozy hésite à faire de
même puis y renonce au profit d’une « Lettre au peuple français » en
43
avril 2012 où il prolonge l’exemple donné par F.Mitterrand en
1988.
La Lettre à tous les Français rédigée par le président Mitterrand
en 1988 est une forme d’écrit allégé (une cinquantaine de
feuillets), d’apparence familière qui combine subtilement
philosophie du pouvoir, récit stratégique de la cohabitation et
orientations programmatiques. Elle n’a pas été « postée », pour
des raisons de coûts, mais publiée en espace acheté dans la
presse quotidienne et tirée à trois millions d’exemplaires par
le PS.
En mars 1988, une enquête indique les préférences des
électeurs30 : La télévision est le moyen le plus utile pour
savoir comment voter selon 62% des personnes interrogées, loin
devant les journaux (37%), la radio (30%), les conversations
(20%), les sondages (12%), les meetings (6%), les affiches
(4%), les tracts (4%). Globalement cette hiérarchie est assez
stable de 197431 aux années 2000. En 2006 la hiérarchie des
médias les plus utiles pour s’informer en politique s’établit
ainsi selon le Baromètre Politique Français du CEVIPOF32 : la
télévision (58%), la radio (17%), la presse écrite nationale
(10 %), la presse écrite régionale (9 %), internet (5 %), la
presse gratuite (1 %). Une place particulière doit être faite à
l’internet et aux réseaux sociaux émergents. Le nombre de
français qui utilisent internet comme première source
30 Sofres, Télérama, n°1995, 6 Avril 1988.31 Jay Blumler, Roland .Cayrol, Gabriel Thoveron, (dirs), La télévision fait-elle l’élection ?, Presses de la FNSP, Paris, 1978.32 Vincent Tiberj, Thierry Vedel, « Les effets de l’informationtélévisée sur les évaluations politiques et les préoccupations desélecteurs français, 2ème vague 2006 », dans Les Cahiers du Cevipof, BaromètrePolitique Français, n° 46, avril 2007.
44
d’information politique atteint vraisemblablement les 15%
aujourd’hui (ils étaient 12% en décembre 200933). Certes, la
révolution en 140 signes n’a pas encore eu lieu mais on est
obligé d’observer chez les électeurs la montée de ce vecteur
d’information et de communication34. Et pourtant les candidats
continuent à écrire des livres, des lettres, à organiser des
réunions électorales. Ils continuent à faire campagne, à
« serrer les mains et tenir les murs»35. Deux modalités de la
propagande traditionnelle sont remarquables en ce qu’elles
connaissent des évolutions opposées : l’affiche est en
régression, du fait de la loi, alors que le contact direct
garde tout son attrait.
3.1.1. Tenir les murs : le déclin de l’affiche
L’affichage est une pratique de propagande
traditionnelle qui prend diverses formes : officiel, commercial
et sauvage, mais la deuxième n’est plus possible trois mois
avant le scrutin depuis la loi de 1990. Contre cette
interdiction vitupèrent, bien sûr, les publicitaires
économiquement intéressés. Mais d’autres arguments sont
recevables dans le sens du maintien: celui du handicap de
visibilité dans les grands médias pour les candidats considérés
comme mineurs ou bien celui de l’opportune présence sur le
domaine public, la rue, des traces de la confrontation
électorale en des temps de reflux de la citoyenneté. 33 Jouet(Josiane), Vedel (Thierry), Comby (Jean-baptiste), Political information and interpersonal conversations in a multimedia environment, European Journal of Communication, 26(4) 361–375.34 Yves-Marie, Cann, La web campagne :entre permanences et renouvellements, RevuePolitique et Parlementaire, N° 1062 : Présidentielle 2012 : les attentes desfrançais, Mars 2012.35 Michel Offerlé, Un homme, une voix ? Histoire du suffrage universel, Gallimard,Paris, 1993.
45
L’affiche favorise probablement la mémoire du politique
par les repères qu’elle fixe en associant slogan et image. Ce
n’est peut être pas le cas de l’affiche où de Gaulle est « Pour
le succès de la France » ou celle de François Mitterrand « Un
président jeune pour une France moderne » en 1965, ni celui de
Georges Pompidou « Avec la France, pour les Français » opposé à
Alain Poher « Un Président pour tous les Français » en 1969. Ca
l’est davantage, au moins pour une génération d’électeurs de
1974, en ce qui concerne François Mitterrand associé au slogan
« La seule idée de la droite est de garder le pouvoir, mon
premier projet est de vous le rendre » affrontant au premier
tour « Un vrai président, Giscard d’Estaing » ; alors que
l’opposition du deuxième tour se fait entre « Un président pour
tous les Français » et « Giscard d’Estaing, le président de
tous les français », photographié avec sa fille. En 1981, « Il
faut un Président à la France » de V.G.E. est confronté à « La
force tranquille. Mitterrand Président » et à « Jacques Chirac
le président qu’il nous faut ». Pour 1988, « La France Unie »
et « Génération Mitterrand » ont mieux résisté au temps que
« Nous irons plus loin ensemble » ou que la vague « Volonté,
courage, ardeur, il rassemble, il construit » de Jacques
Chirac. A partir de 1995, c’est le repli sur l’affichage
officiel. L’affichage commercial est interdit dans les trois
mois qui précèdent le scrutin.
Quoiqu’il en soit de leur impact et de leur postérité, les
affiches électorales expriment de manière symbolique, par le
dialogue qu’elles permettent d’instaurer dans le temps et dans
l’espace partisan, l’interdépendance des positionnements
46
stratégiques. En 2012 les affiches principales des candidats
majeurs présentées ci-dessous laissent voir les slogans
homogènes à l’offre politique très personnalisée de chacun des
candidats:
3.1.2. Serrer des mains : la permanence du contact
Dans la société de communication la technologie est
omniprésente et il peut paraître paradoxal de souligner
combien, même pour une élection nationale, l’expérience du
contact direct (ou son simulacre) est une figure imposée de la
campagne présidentielle. Réunions, meetings, déplacements,
visites, prises de parole, quelle que soit la forme, il faut
concéder au terrain cette furtive impression de proximité pour
susciter l’identification, la projection ou la sympathie,
réchauffer la préférence partisane, en tout cas donner corps à
la volonté de rassemblement. Le président en exercice (de
Gaulle en 1965, Giscard d’Estaing en 1981, Mitterrand en 1988
et Chirac en 2002) est moins présent, à cet égard, car il
dispose d’une légitimité institutionnelle et d’une prime
médiatique sans égales. L’absence de campagne du premier est
dans la logique de sa conception du rôle présidentiel. Les deux
47
autres ne concèdent qu’une campagne brève où leur participation
est physiquement limitée. Le choix stratégique de « citoyen-
candidat » oblige davantage Valéry Giscard d’Estaing en 1981
que celui de François Mitterrand en 1988 lorsqu’il exploite
totalement les ressources de la légitimité présidentielle. Ce
dernier ne prend part qu’à quatre meetings avant le premier
tour (Rennes, Lyon, Montpellier, Le Bourget) et trois ensuite
(Lille, Toulouse, Strasbourg). Certains candidats font preuve
d’une mobilité et d’un activisme exceptionnel comme François
Mitterrand en 1965 et Georges Pompidou en 1969. Le premier
« sillonne la France de part en part, visitant la plupart des
villes de grande ou moyenne importance »36. Malgré la briéveté
de la campagne inopinée de 1969, Georges Pompidou tient 44
réunions: en quinze jours, 15 000 km sont parcourus et 21
régions visitées. Si bien qu’une semaine avant le deuxième
tour, Alain Poher finit par sacrifier à la mobilité intensive :
13 villes en cinq jours. La campagne du candidat peut
bénéficier de l’animation active du parti qui le soutient comme
c’est le cas de Jacques Duclos et des 400 réunions publiques
des membres du Comité central à travers tout le pays.
Le candidat commun de la gauche de 1974 participe à une
trentaine de meetings dans toute la France. Il bénéficie de
l’organisation d’une douzaine de meetings unitaires auxquels il
ne contribue personnellement qu’à deux reprises, notamment au
Palais des Sports devant cent mille personnes. Son concurrent
ne ménage pas sa peine pour « regarder la France au fond des
yeux » à l’occasion de 44 réunions publiques.
36 Roland Cayrol, Jean-Luc Parodi, « Propagandes », dans Cevipof,L’élection présidentielle de décembre 1965, Presses de la FNSP, Paris, 1970.
48
La campagne présidentielle de 1995 est, à ce niveau,
particulièrement intéressante. On y voit des candidats très
actifs. Lionel Jospin visite 40 départements, participe à 57
réunions et à 6 grands meetings régionaux. De style
initialement institutionnel, la campagne du Premier ministre ne
prévoyait que 6 ou 7 meetings, puis elle prend un tour nouveau
en offrant « une part de lui-même aux Français » : c’est « La
fête à Edouard », manifestation populaire organisée fin mars.
Mais comme Alain Poher en 1969 et Jacques Chaban-Delmas en
1974, la tentative de rectification d’Edouard Balladur illustre
les limites de la métamorphose artificielle de l’identité en
politique.
Sans atteindre les records de Robert Hue avec 80
déplacements et 74 réunions publiques, Jacques Chirac présente
aussi une belle constance dans sa campagne. Il visite 52
départements et tient 40 réunions, organisées méthodiquement à
la façon de George Bush en 1988 sur le mode « un jour, un lieu,
un thème ». « Chirac à l’écoute des Français, défenseur des
exclus contre l’establishment, la technostructure et sa pensée
unique, joint le geste à la parole : il va à la rencontre des
gens sur le terrain à travers des catégories de public. Cette
technique présente l’avantage de porter le candidat vers les
électeurs (bénéfice d’image de proximité et de dynamisme), de
susciter la couverture médiatique au moins locale (bénéfice de
visibilité) et de mobiliser les soutiens et militants pour
relayer le message (bénéfice d’activation des leaders
d’opinion) »37. De prouver aussi, du fait des kilomètres37 Jacques Gerstlé, « La dynamique sélective d’une campagne décisive », in Pascal Perrineau, Colette Ysmal, dirs, Le vote de crise, Presses de sciences po,Paris, 1995.
49
parcourus et du nombre de discours prononcés, sa résistance
physique et nerveuse et donc son aptitude à endosser de lourdes
responsabilités.
2007 a été incontestablement une campagne intensive de
meetings où il fallait faire nombre. Après sa phase
participative, S.Royal s’est mise à la réunion massive car,
entre temps, Nicolas Sarkozy avait montré sa force au congrès
extraordinaire de l’UMP où il fut désigné le 14 janvier devant,
théoriquement, cent mille militants présents pour un coût total
de 3,5 millions d’euros. Entre janvier et début mai 2007,
Ségolène Royal participe à 54 déplacements sous forme de
visites ou de meetings dont un déplacement aux Antilles fin
janvier. Nicolas Sarkozy atteint le chiffre de 88 déplacements
dont Londres en janvier, Berlin et La Réunion mi février,
Madrid à la fin du même mois, les Antilles fin mars38.
La campagne de 2012 innove par le retour à des réunions en
plein air qui ont pour mérite essentiel d’être économiques car
n’impliquant pas de frais de location d’espace. Ainsi le
meeting de la Bastille où J-L.Mélenchon a réuni une foule de
120.000 personnes (selon les organisateurs) ou bien ceux de
Toulouse (70.000) et de Marseille (120.000) sont-ils
exemplaires, de même que ceux organisés le même jour à Paris
pour N. Sarkozy sur la place de la Concorde ou pour F. Hollande
sur le cours de Vincennes. « Devant les caméras, c’est à qui
battra le record de participants, occupera l’espace le plus
gigantesque et offrira le spectacle d’un parti soudé autour de
son leader ». Ces meetings révèlent un engouement particulier
38 Marion Ballet (2010) fournit la liste exhaustive des déplacements des candidats en 2002 et 2007.
50
des chaînes d’information en continu pour lesquels ils sont
largement mis en scène ainsi que pour la twittosphère politique
dont il ne faut cependant pas exagérer l’influence : seuls 5%
des Français, environ, se tiennent informés via les tweets des
candidats ou des journalistes politiques . Une autre pratique
ancienne a resurgi au plan national : il s’agit du porte à
porte plus généralement utilisé au niveau local. Couplée avec
l’usage d’internet, le « canvassing », inspiré par la campagne
d’Obama en 2008, a permis de développer une campagne de
terrain très active chez les socialistes39.
3. 2. la campagne dans l’audiovisuel : entre désaffection et
rénovation
Plusieurs types de contribution des médias à la campagne
électorale peuvent être distingués. Dans les limites de la
réglementation, les candidats contrôlent tout le contenu et la
forme qu’ils donnent aux messages diffusés par la campagne
officielle à la radio et à la télévision. Bien que non inclus
parmi les émissions de la campagne officielle, intervient
depuis 1974 un débat opposant en direct à la radio et à la
télévision les deux candidats du second tour. De plus, la
couverture de l’actualité - à travers l’information quotidienne
- pèse sur les perceptions publiques, aussi bien à travers le
traitement de la campagne elle-même qu’à travers celui de
l’actualité. La pression des candidats sur l’information et de
l’information sur le public s’exerce de façon sensible, au
point d’induire des effets persuasifs.
39 Jacques Gerstlé, Communication politique et médiatisation de la vie politique, Les Cahiers Français, (370), Quelle Vème République demain ?, septembre-octobre 2012.
51
3.2.1. La campagne officielle radiotélévisée
Les émissions radiotélévisées officielles, on l’a vu, sont
encadrées par un dispositif juridique de plus en plus resserré.
Il faut, au-delà de ces contraintes, examiner l’évolution des
formes d’émission et leur audience pour saisir un processus de
modernisation. Chaque candidat doit bénéficier d’un temps
d’antenne identique pour chacune des tranches horaires de la
campagne et se voir attribuer un rang de passage différent. Le
tableau donne, pour les neuf campagnes présidentielles, les
temps d’antenne mis à disposition des candidats avant chaque
tour de scrutin. A ceci s’ajoute depuis 1974 le temps du débat
radiotélévisé.
Temps d’antenne attribué aux candidats à la radio et à la
télévision (*)
Elect
ion
1965 1969 1974 1981 1988 1995 2002 2007 2012
Tour I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
III
IIDurée
TV
120
120
100
100
65
75
70
65
105
60
90
79**
48
60
45
6043
60(*) Campagne officielle sur les chînes publiques, en minutes. ** temps
effectif.
Seules les chaînes publiques diffusent les émissions
officielles. En 1988 et 1995, la durée des émissions est la
même pour France 2 et France 3, mais les horaires de diffusion
sont différents. A cette date, on retira 45 minutes d’antenne
sur les deux heures imparties à chaque candidat pour les
affecter au débat. La même opération est reproduite
ultérieurement.
52
Le format des émissions a été fortement réduit. En 1965, chaque
candidat dispose de deux grandes émissions de 28’, quatre de
14’ et une dernière de 8’. A partir de 1974, la fourchette de
temps entre l’émission la plus courte et la plus longue se
rétrécit progressivement au premier tour.Durée des émissions officielles (de la plus brève à la plus longue) de 1974
à 2012.
1974 1981 1988 1995 2002 2007 20125’
25’
5’
20’
5’
15’
1’
15’
1’ 5’ 1’
5’30
1’30
3’30
En 1995, les 90 minutes pour chacun des neuf candidats sont
répartis en émission courte (1 et 2’), moyenne (5’) et longue
(15’). En 2007, les 45’ le sont en émissions d’1’, de 2’30 et
de 5’30. En 2012, les 43 minutes du premier tour sont réparties
en dix modules de format court d’une durée de 1 minute 30
secondes et huit modules de format long d’une durée de 3
minutes 30 secondes. Pour le second tour, les 60 minutes sont
réparties en cinq émissions de deux minutes et dix émissions de
cinq minutes.
Les émissions sont programmées à des horaires différents sur
chaque chaîne compte tenu de leur durée (les modules longs ont
une programmation tardive) et certaines sont rediffusées. En
1988, les candidats du second tour s’accordent sur la durée
totale de 60 minutes. De même en 1995, Jacques Chirac et Lionel
Jospin s’entendent sur une durée bien inférieure au plafond de
deux heures.
Le rétrécissement des émissions de la campagne officielle entre
1965 et 2012 à été justifié par l’adaptation aux attentes des
53
télespectateurs. Le changement du paysage audiovisuel français
s’est, en effet, accompagné d’une désaffection pour la
communication électorale de la campagne officielle. En avril
1990 encore, le CSA recommande « une réforme radicale de la
campagne radiotélévisée officielle frappée de désaffection
massive ». Pour accroître l’audience, différentes solutions
sont mises en œuvre. L’expérience de la campagne présidentielle
de 1988 montre que la diffusion à des heures variables (9 h, 13
h, 17 h, 19 h, 22 h), avec des combinaisons variables selon les
chaînes, améliore les possibilités d’écoute. On a aussi
assoupli depuis 1986 les contraintes de formes des émissions.
La forme prise se diversifie de 1965 à 1988 entre monologue,
discussion avec différents soutiens ou entretien avec un
journaliste. A partir de 1988, l’innovation du « clip » se veut
attractive en substituant de l’image et du son à du discours.
Contrairement au « spot » à l’américaine, le clip ne constitue
pas, par définition légale, un message autonome : c’est un
produit vidéo inséré (clipé), bref (10 à 190 secondes en 1988)
et coûteux (de 3 000 à 20 000 francs/seconde en moyenne). Son
modèle remarqué est produit pour François Mitterrand avec 500
images en 80 secondes retraçant l’histoire de la France dans le
monde depuis 1789 et « verrouillage » sur image fixe de
l’affiche « La France Unie ». Utilisé par presque tous les
candidats dès 1988, il se réduit par la suite souvent à des
jingles d’introduction40. Il faut cependant ajouter que la
vidéo est utilisée dans les meetings : pour Lionel Jospin, un
film de 11 minutes lorsque le candidat est absent et pour
40 Jean-Paul Gourevitch, » Le Clip politique », Revue Française de sciencepolitique, vol.39/1, février 1989.
54
Jacques Chirac, un film de 20 minutes qui reprend des extraits
de son programme. En 1995, en 2007 puis en 2012 sont assouplies
les contraintes sur le genre de l’intervention et augmentées
les possibilités d’insertion vidéo (voir supra).
L’audience recueillie par la campagne audiovisuelle officielle
ne doit pas être confondue avec son impact. Si en 1965 à peine
un foyer sur deux dispose d’un récepteur l’effet de l’irruption
de l’opposition à la télévision, d’où elle est quasiment
absente depuis 1958, est sans doute important, même s’il est
difficile à mesurer. S’agissant de la candidature Lecanuet, on
a néanmoins montré que la télévision n’avait pas fait son
succès, contrairement aux commentaires fréquents à ce sujet41.
Pour la présidentielle de 1969, le taux d’équipement en
télévision n’est encore que de 66%. Il passe à 82% en 1974 et,
pour les émissions précédant le premier tour, selon le Centre
d’études d’opinion de l’ORTF, l’audience moyenne se situe entre
45 et 50% de téléspectateurs alors que sur l’ensemble de
l’année on en compte de 65 à 70 % dans la même tranche horaire.
En 1981, on atteint presque 91% d’équipement et l’audience TV
de la campagne officielle fléchit très nettement42 avec
respectivement pour chaque tour 23,5 % et 34,1 % (débat entre
les deux candidats du second tour inclus). La déperdition
quotidienne de l’audience par rapport aux périodes hors-
campagne se monte à sept millions de téléspectateurs. Le
mouvement de désaffection se retrouve dans la hiérarchie des41 Jean Stoetzel, « Les sondages et l’élection présidentielle de1965 », Revue Française de Sociologie, vol. 7/2, avril 1966.42 Nicole Casile, « Pour qui sont ces discours ? », dans Jean-MarieCotteret et al., Démocratie cathodique, 1981. L’audience TV de la campagneofficielle y est évaluée à 47% pour le premier et 55% pour le deuxièmetour.
55
préférences suggérée par les enquêtes43. Les faibles résultats
d’audience conduisent l’instance de régulation à moderniser
l‘organisation de la campagne officielle pour la rendre
accessible au plus grand nombre. Pour 1995, la Commission
nationale de contrôle44 rapporte ainsi sa satisfaction de ce
point de vue strictement quantitatif: « Quant à la campagne
officielle radiotélévisée diffusée sur France 2, France 3,
France Inter, RFO et RFI, elle a atteint un public plus large
que lors de la précédente élection : pour le premier tour, elle
a touché en dix jours 80 millions de téléspectateurs contre 52
millions en 1988 » et d’imputer ce succès aux efforts de
modernisation et de programmation. En 1995, l’audience cumulée
en millions de contacts se monte à 88 % pour le premier tour et
à 39 % pour le deuxième. En 2002, les données équivalentes se
montent à 60 % pour le premier tour et 48 % pour le second.
Pour 2007, le CSA note que pour la télévision « durant les
trois semaines de diffusion des émissions de la campagne
officielle, la campagne a touché une audience agrégée de plus
de 115 millions de contacts/individus de 15 ans et plus, contre
un peu plus de 108 millions en 2002 »45. Il propose en outre 16
recommandations d’évolution « dans le sens de l’assouplissement
des règles et de l’enrichissement du débat démocratique » pour
la prochaine échéance présidentielle. En 2012, du 9 avril au 4
43 « Selon vous, quels sont, parmi les genres d’émissions télévisées suivantes, ceux qui vous informent le mieux sur la campagne électorale? : Les émissions qui mettent un ou plusieurs journalistes face à un homme politique (50 %); les face-à-face entre hommes politiques (38 %) ; les émissions politiques en présence d’un public (23 %); les émissions officielles de la campagne (5 %). ( Sondage Louis Harris réalisé du 10 au 12 Mars 1988).44 Rapport de la CNC, dans Election Présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995. Lerapport du CSA indique 94 millions de téléspectateurs touchés durant lesdeux premières semaines et 39 millions dans la dernière semaine.45 http://www.csa.fr/infos/publications/publications_divers.php
56
mai, Kantar Media et Médiamétrie se sont penchés sur la
visibilité des candidats pour les deux tours de la campagne,
sur trois chaînes de France Télévisions (France 2, France 3,
France 4). La campagne officielle aurait touché près de 64% de
la population avec une montée en charge progressive jusqu’au
premier tour. Mais pour chaque candidat, c’est moins de la
moitié de la population qui est touchée (40% environ). Les
proportions de population touchées sont équivalentes pour tous
les candidats. A partir du second tour, les deux derniers
candidats ont touché seulement 10% de téléspectateurs en plus.
3.2.2. Le débat radiotélévisé entre les deux tours
Lors des premières campagnes présidentielles, des débats
sont organisés par les stations de radio privées. Ainsi, en
1965, sur les ondes d’Europe 1, Pierre Mendès-France débat-il
avec Michel Debré par deux fois à une semaine d’intervalle,
alors que la campagne officielle est ouverte46. En 1974 encore,
Jacques Chaban-Delmas affronte à la radio François Mitterrand
le 17 avril, avant que le 25 et le 2 mai ce dernier n’affronte
dans les mêmes conditions Valéry Giscard d’Estaing. Ils se
retrouveront, à la télévision cette fois, le 10 mai pour
innover avec le débat qui met aux prises en direct les deux
candidats présents au deuxième tour. A chaque élection
présidentielle suivante, cette formule est reprise pour devenir
rituel même si, à chaque occasion, les conditions de
réalisation font l’objet d’âpres négociations entre les
candidats. La promotion médiatique dramatisante de cet
événement de communication en fait un point culminant de la
46 Ces débats font même l’objet d’une publication intégrale : M. Debré,P. Mendès-France, Le Grand Débat, Gonthier, Paris, 1966.
57
campagne présidentielle, où la personnalisation et les
conditions d’interaction polémique garantissent même aux
indifférents un minimum de spectacle, ou comme le dit mieux
l’anglais de contest excitment. A y regarder de plus près, le
contenu politique47 n’est pas toujours à la hauteur de ces
annonces. Mais là encore, les résultats du premier tour
imposent aux candidats et à leurs conseillers des impératifs
stratégiques en termes d’axes de communication et de cibles
prioritaires pour rassembler autour d’eux les électeurs des
candidats éliminés ou bien indifférents. Ceci transforme le
débat argumentatif en face-à-face de postures où les qualités
personnelles sont davantage en jeu que les orientations de
politique publique. Cette évolution est plus sensible dans les
débats de 198848 et 199549 que dans les deux premiers. En
197450et en 198151, le contraste des offres politiques en
présence est si fort que la nature des arguments sollicités
s’en ressent, même si des choix d’image et de gestion de
l’interaction inspirent aussi les performances. Les deux
phrases chocs le « Vous n’avez pas le monopole du cœur » contré
sept ans plus tard par « Vous êtes devenu l’homme du passif »
restent dans toutes les mémoires.
Le débat de 1995 met aux prises des protagonistes aux
objectifs complémentaires : la recherche de la crédibilité
47 Les textes des débats sont disponibles dans la série Textes et Documents relatifs à l’élection présidentielle.48 Jean-Baptiste Legavre, “Face to face : the 1988 French debate”, in Lynda L. Kaid, et al., op.cit.49 Jean Charlot, op.cit., p 194 et s.50 Jean-Marie Cotteret, et al., Giscard d’Estaing/Mitterrand : 54774 Mots pour convaincre, PUF, Paris, 1976.51 Jacques Gerstlé, « Eristique électorale. Le débat du 5 mai 1981 »,in Jean-Marie Cotteret et al., Démocratie cathodique, op. cit.
58
présidentielle pour Lionel Jospin et le souci du dialogue pour
Jacques Chirac. A défaut d’être consensuelle, la communication
est au moins coopérative. En 2002 Jacques Chirac a refusé
d’être opposé à Jean-Marie Le Pen motivant ainsi sa décision :
« face à l’intolérance et à la haine, il n’y a pas de
transaction possible, pas de compromis possible, pas de débat
possible ». 2007 offre un débat sans surprise, chaque candidat
sachant les jeux faits, il est la dernière occasion pour la
candidate socialiste de tenter de limiter son écart. La
nouveauté est venu du débat difficilement organisé, en dehors
de toute règle et campagne officielles, qu’elle mène avec
François Bayrou sur BFM TV une semaine avant le second tour.
2012 connaît une innovation importante avec pour la
première fois dans l’histoire la participation à l’émission Des
Paroles et des Actes diffusée par France 2 de la totalité des
candidats à deux débats à cinq prenant la forme d’interviews
successifs sans interaction entre candidats avant le premier
tour. Le débat télévisé de 2012 a donné lieu à un affrontement
particulièrement âpre entre candidats : N.Sarkozy voulait que
trois débats soient consacrés respectivement aux questions
économiques et sociales, aux questions de société et aux
problèmes internationaux. F.Hollande a refusé cette offre au
motif que des arrières pensées stratégiques commandaient le
souhait de son adversaire.
En termes d’audience, on enregistre à ces occasions des
scores élevés : 23 millions de personnes et 71% du public
potentiel en 1974 (81% des personnes interrogées par la Sofres
disent avoir vu le débat) ; 23,4 millions, c’est-à-dire 60% des
59
télespectateurs en 1981 ; 30 millions pour la totalité des
diffusions directes (TF1, A2) et différées (FR3, la Cinq et M6)
en 1988, avec une audience variant entre 45 et 49%. En direct,
le débat a touché 15 millions de télespectateurs contre 17 en
1995, auxquels s’ajoutent les auditeurs et le public du différé
sur Arte, M6, TV5 et Cinquième. En 2007, le débat Royal-Sarkozy
dure 2h40 minutes et réunit plus de vingt millions de
télespectateurs en direct. Les deux finalistes de la campagne
de 2012 se sont affrontés pendant près de deux heures cinquante
dans une confrontation largement dramatisée par les médias
d’information qui ont ainsi promu un spectacle politique très
ritualisé attirant plus de dix sept millions de
téléspectateurs.
Genre contraint et quelque peu anachronique dans le contexte
audiovisuel actuel, mais à préserver, la campagne officielle
doit encore, selon le CSA dans son rapport sur l’élection de
1995, être rénovée pour s’adapter aux évolutions de la réalité
télévisuelle. Recommandation réitérée en 2002 et 2007, le CSA
souhaitant donner plus de liberté de création aux candidats
dans le respect du principe d’égalité afin d’accroître
l’attractivité des émissions officielles.
3.3. La pression sur l’information quotidienne
La campagne électorale dans les médias passe non seulement
par la propagande ou la communication mais aussi par
l’information ordinaire. Les électeurs reçoivent
quotidiennement un flot d’informations qui n’est pas focalisé
sur la campagne électorale et qui s’est considérablement
60
amplifié depuis 1965. A la chaîne unique de télévision, à la
radio d’Etat et aux trois stations périphériques a succédé
depuis la libéralisation des ondes après 1981, et avec les
progrès de diffusion satellitaire et les nouvelles technologies
de l’information, un paysage médiatique plus que foisonnant.
Dès 1965, on a vite compris que le lien entre
l’information électorale et l’information non électorale
méritait d’être établi, car l’électeur l’établit lui-même de
façon plus ou moins maîtrisée selon son degré de compétence
politique. D’autre part, les candidats cherchent à
instrumentaliser ce lien s’ils sont soucieux du principe de
résonance évoqué plus haut. Autrement dit, un candidat pour
être en résonance avec son milieu doit s’efforcer de suivre ou
de créer l’actualité, de contrôler l’agenda52. Pour maîtriser
la dynamique de sa campagne, le candidat doit, en effet,
surveiller trois moteurs essentiels : l’agenda politique,
l’agenda public et l’agenda médiatique qui vont contribuer à
composer l’agenda électoral53. A ce principe de portée générale
s’ajoutent des raisons plus contextuelles. La première tient à
l’interdiction de la communication de type publicitaire qui
fait basculer l’acheminement du message électoral, et donc la
pression, sur les médias d’information de masse.D’autant plus
que la couverture médiatique est gratuite contrairement à
52 On observera que la dérision par la satire médiatique (à laquelle onprête des effets sans doute excessifs) est un prolongement particulier dutraitement de l’actualité. Sur cette dimension satirique, voir AnnieCollovald, « The Bébête Show : Satire in the 1988 French campaign », inLynda L.Kaid et al., op.cit. ; pour la campagne de 1995, voir EmmanuelFraisse, « Les politiques et leurs marionnettes à la télévision »,Médiaspouvoirs n° 38, 1995.53 Jacques Gerstlé, « Agenda électoral », dans Pascal Perrineau,Dominique Reynié, dirs, Dictionnaire du vote, op.cit.
61
l’espace publicitaire. En France, l’attente d’information est
d’autant plus forte que la désaffection pour la campagne
officielle est réelle lorsque le télespectateur n’est plus
captif d’une programmation exclusive, comme ce fut le cas
jusqu’en 1981. Enfin, la perte de confiance dans le personnel
politique pousse également le public à se fier davantage à des
médias professionnalisés qui peuvent de plus se parer du
concours de la technique pour couvrir le monde. Cette confiance
est d’ailleurs d’autant plus facile à donner qu’elle est peu
coûteuse. En effet, les médias abaissent les coûts individuels
d’acquisition de l’information pour l’électeur en décryptant
pour lui les messages politiques.
La pression déplacée sur l’information conduit à
interroger ses usages stratégiques, d’autant plus qu’ on
connaît mieux les mécanismes persuasifs de l’information54. Il
faut renoncer à l’idée d’une innocuité de l’information de
masse. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment les
médias ont couvert l’élection présidentielle de 1965. Si la
presse écrite, aux sympathies partisanes variées, permet
l’expression forte de la concurrence, l’information télévisée
adopte plus volontiers un « rôle de relais de la candidature
présidentielle »55. L’information peut donc être biaisée et
ceci de différentes façons : par l’accès différentiel aux
médias des différents candidats, par un traitement partial de
leur identité ou de leur action, ou plus indirectement par
l’accent mis dans l’actualité sur des thèmes qui sont pour eux
inégalement stratégiques. L’exemple du thème de l’insécurité en54 Jacques Gerstlé, dir., Les Effets d’information en politique, L’Harmattan,2001 ; et Jacques Gerstlé, La communication politique, Colin, 2008.55 Monica Charlot, Le journal télévisé, dans Cevipof, op.cit..
62
2002, celui du pouvoir d’achat ou du comportement de certains
dirigeants de grands groupes financiers et industriels en 2007
en sont des exemples. En 2012 les tueries de Montauban et
Toulouse ont été largement couvertes par les médias et ne sont
pas sans relation avec le statut du chef de l’Etat.
En premier lieu, l’information contrôle la visibilité des
candidats, et la publicité donnée à leurs actions et
programmes. Est ainsi conditionné l’accès global du public à
l’offre électorale. On observe dans chaque pré-campagne le non-
respect du principe d’égalité dans le traitement de
l’information télévisée, celle dont la consommation est la plus
massive et la plus socialement répandue. Les producteurs de
l’actualité hiérarchisent les candidats en leur donnant une
visibilité différentielle qui sur-légitime les « grands » et
délégitime les « petits »56. La classe dominante est constituée
par les présidentiables : Mitterrand, Chirac, Barre en 1988 et
Chirac, Jospin, Balladur en 1995, Chirac, Jospin en 2002,
Royal, Sarkozy en 2007 puis Hollande et Sarkozy en 2012 . Puis
viennent les candidatures qui peuvent peser sur le résultat :
Le Pen, Lajoinie en 1988 et Le Pen, Hue, de Villiers en 1995,
Le Pen, Chevènement en 2002 ; enfin le reste des candidatures
dont la présence médiatique est très aléatoire. En 2007, Le Pen
et Bayrou, qui va se hisser quelques temps dans la catégorie
des « grands », représentent la seconde et tous les autres la
dernière. En 2012, si Hollande et Sarkozy représentent bien la
première catégorie, Marine Le Pen, Bayrou et Mélenchon
représentent la seconde.Ce déséquilibre est multiplicateur d’un56 Jacques Gerstlé, Olivier Duhamel, Dennis K. Davis, « La couverturetélévisée des campagnes présidentielles. L’élection de 1988 aux Etats-Uniset en France », Pouvoirs n° 63, 1992.
63
ordre politique naturalisé qui s’apparente pourtant bien à un
« cens médiatique »57. Les émissions politiques télévisées
reproduisent aussi bien que le JT cette représentation
atrophiée de l’espace politique et ainsi peut-on imaginer les
effets de renforcement produits à travers tout l’univers de
seconde main construit par les médias d’information58. Ceci est
moins vérifié dans la période de campagne officielle en raison
de la contrainte du principe d’égalité dans le traitement de
l’information.
En deuxième lieu, l’information contrôle l’image ou la
représentation des candidats par le biais du « cadrage
discriminant »59, c’est à dire par l’accentuation de certains
aspects de la candidature ou de la situation politique qui va
produire des différences de perception. Par exemple, en 1988,
l’information consolide la présidentialité des cohabitants en
exercice et marginalise celle de Raymond Barre. Les premiers
sont traités de façon plus complète en examinant leurs soutiens
et adversaires, leurs actions de campagne, leurs positions
sondagières dans la course électorale mais aussi leurs
programmes. Il font donc l’objet d’une analyse en termes de jeu
(beaucoup) et d’enjeux de politiques publiques (un peu).
Raymond Barre est au contraire cantonné dans le périmètre du
jeu politique avec une lancinante question qui revient sans
57 Guillaume Sainteny, « Le cens médiatique. L’accès des petites forcespolitiques à l’audiovisuel », Médiaspouvoirs n° 38, 1995. Voir aussi MarlèneCoulomb-Gully, Radioscopie d’une campagne. La représentation politique au journal télévisé,Kimé, Paris, 1995.58 Sur la formation des enjeux politiques à travers les émissionstélévisées en 1988, voir Mathieu Brugidou, L’élection présidentielle : discours et enjeuxpolitiques, L’Harmattan, Paris, 1995.59 Jacques Gerstlé, « La persuasion de l’actualité télévisée », Politix, Télévision et Politique, n° 37, 1997.
64
cesse comme une mise en doute de sa viabilité politique : « Qui
soutient Barre ? ». Sans qu’aucun jugement ne soit énoncé, par
le seul effet d’un cadrage discriminant, est opéré le travail
de marginalisation d’un présidentiable. La candidature de
François Mitterrand bénéficie, au contraire, d’une visibilité
et d’un cadrage qui mettent en pleine lumière le cœur même de
sa stratégie, la légitimité présidentielle. L’information le
montre président plus que candidat, et président dans les
figures les plus actives de la cohabitation contre le Premier
ministre. L’information relaye sa stratégie, sa stratégie
s’appuie sur l’information. Il n’a pas besoin de faire
campagne, l’information porte son message.
En troisième lieu, l’information oriente l’attention du
public. Les cas de Le Pen en 1988 et de Balladur en 1995, de
Chirac et Le Pen en 2002 sont ici exemplaires. La visibilité du
candidat Le Pen s’accroît sensiblement pendant la campagne
officielle de 1988, non seulement à cause de la campagne
audiovisuelle mais aussi de l’information. Dans le même temps,
l’actualité non-électorale est dominée par une série de sujets
saillants à caractère sécuritaire ou résonant avec le discours
du FN : otages français au Liban, événements sanglants de
Nouvelle-Calédonie, question du vote des immigrés (réactivée
par le Président). La concomittance entre les montées en
visibilité (présence médiatique, actualité, intentions de vote
Le Pen) signalent un effet d’amorçage : l’information valide le
discours d’un candidat et mobilise l’attention sur des thèmes
qui deviennent suffisamment saillants pour devenir des critères
d’évaluation des candidats, l’effet sera encore plus marqué en
65
2002. C’est un processus comparable qui en 1995 aboutit à la
désintégration de la candidature Balladur60. Alors qu’il
bénéficie d’une position réputée avantageuse dans la pré-
campagne électorale, le Premier ministre déclare sa candidature
puis réinvestit ses fonctions gouvernementales. L’information
déplace alors l’attention publique vers une actualité non
électorale : les difficultés du gouvernement et de son chef à
travers une série de dossiers délicats en cascade (affaire
Maréchal-Schuller, écoutes téléphoniques, affaires GSI).
L’actualité met en avant des critères d’évaluation qui se
transposent du Premier ministre au candidat d’autant mieux que
celui-ci a opté pour une stratégie tuilée, de glissement de
Matignon vers l’Elysée. Autrement dit, le transfert d’attention
médiatique et publique appelle le changement irrémédiable
d’évaluation : l’effondrement brutal et concomittant de toutes
les ressources d’image (crédibilités sectorielles, qualités
personnelles, présidentiabilité, etc.) signale bien un effet
d’opinion qui prend sa source dans l’information immédiate. En
2002 la pression est excessivement forte sur l’agenda
sécuritaire qui se déploie dans l’information télévisée depuis
plus d’un an. Elle contribue largement à installer cet enjeu
comme critère décisif d’évaluation des candidats61.
L’information accomplit donc un travail persuasif, c’est-à-dire
qui pèse sur les perceptions et les évaluations pour orienter
des choix électoraux. En 2007 on assiste à la même focalisation
60 Jacques Gerstlé, « L’information et la sensibilité des électeurs àla conjoncture », Revue Française de Science Politique, vol 46/5, 1996.61 Jacques Gerstlé, « Une fenêtre d’opportunité électorale », dansPascal Perrineau, Colette Ysmal, dir., Le vote de tous les refus, Presses desciences po, 2003, p. 29-52.
66
de l’attention publique sur les deux candidats principaux
pendant toute la pré-campagne, en d’autres termes sur une
logique d’anticipation du deuxième tour qui constitue une
prophétie autoréalisatrice.
On se rend alors compte que certains problèmes ou
évènements ont provisoirement marqué les esprits ou durablement
laissé des traces chez les électeurs en raison de leur
traitement médiatique singulier (cadrage) ou particulièrement
développé (agenda, amorçage). C’est encore le cas pour la
dernière campagne de 2012 avec la succession d’évènements
fortement médiatisés : l’organisation des primaires socialistes
à l’automne 2011, la crise de la zone euro et la perte du
triple A en décembre et janvier 2012, le discours du Bourget de
François Hollande en janvier 2012, l’entrée en campagne de
N.Sarkozy en février, les évènements de Montauban et Toulouse à
la mi-mars 2012, le 1er tour de l’élection présidentielle et
ses résultats. Ainsi "l'affaire Merah", c'est-à-dire les
évènements de Montauban et de Toulouse, a eu un impact majeur
dans l’espace médiatique français en seulement 4 jours.
Ces effets sont encore renforcés par l’intervention accrue
des chaînes d’information en continu. Dans la période du 1er
janvier 2012 au 20 avril, on observe, en effet, un fort
décalage entre les 262 heures de temps d’antenne des journaux
et magazines d’information diffusées par les chaînes
généralistes (TF1,F2,F3,F5,F6, Canal + en clair, M6, Direct 8,
TMC) et les 830 heures diffusées par trois chaînes
d’information en continue (BFM TV, I-Télé, LCI). Cette
domination pèse aussi sur les candidats et les incite à
67
égrainer leurs propositions pour faire du « buzz ». Au total,
aucune campagne n’aura autant été couverte par les médias que
celle de 2012. De nouvelles émissions d’actualité politique ou
de débat ont joué un rôle essentiel dans le dynamisme télévisé
de la campagne présidentielle. Parmi ces émissions «Des paroles
et des actes» (avec une moyenne de 4,4 millions de
téléspectateurs en 9 éditions), «Mots croisés» (France 2),
«Paroles de candidat» (TF1), «C politique» (France 5), «Le
grand journal» et «Le petit journal» (Canal +) offrent un
espace dédié à un temps de parole électoral long et commenté.
*
* *
Consolidation de Mitterrand, marginalisation de Barre,
actualisation de Le Pen, désintégration de Balladur,
qualification de Royal et Sarkozy, de Hollande et Sarkozy :
voilà entre 1988 et 2012 quelques processus à l’œuvre dans les
dernières campagnes présidentielles qui attestent le poids de
l’information et la pression qui pèse sur elle. Ces phénomènes
sont d’autant plus importants qu’on sait la dépendance
croissante des électeurs au court terme et le caractère
aujourd’hui plus tardif de la décision de vote, phénomènes
attestés par le caractère incertain de la mobilisation
électorale et un choix qui reste souvent hésitant.
Mais au total, l’insistance que l’on a mis à comprendre
les mécanismes de communication et d’information ne doit pas
faire perdre de vue leur caractère auxiliaire dans la vie
politique, même si à certains moments leur apparence semble
68
essentielle. Comme le montrent entre autres l’importance des
positions de pouvoir, le poids des soutiens collectifs ou la
résistance des identités politiques, dans l’élection comme en
dehors, le politique l’emporte toujours sur la communication.
BIBLIOGRAPHIE
Ballet, Marion, Campagnes présidentielles de 2002 et 2007, La
documentation Française, 2010.
Benoît, J-M., Benoît, P., Lech, J-M., La politique à l’affiche.
Affiches électorales et publicité politique 1965-1986, Ed. du
May, Paris, 1986.
Berne, J., La campagne présidentielle de Valéry Giscard d
‘Estaing, PUF, Paris, 1981.
Blumler, J., Cayrol, R., Thoveron, G., La télévision fait-elle
l’élection ?, Presses de la FNSP, Paris, 1978.
Cayrol, Roland, Charon, Jean-Marie, Médias, opinions et
présidentielles, INA Editions, 2012.
Conseil supérieur de l’audiovisuel, Rapport sur la campagne
présidentielle 2007, novembre 2007.
Cevipof, L’élection présidentielle de décembre 1965, Presses de
la FNSP, Paris, 1970.
Charlot, J., Pourquoi Jacques Chirac ?, Ed.de Fallois, Paris,
1995.
Colliard, S., La campagne présidentielle de François Mitterrand
en 1974, PUF, Paris, 1979.
Cotteret, J-M, Emeri, C., Gerstlé, J., Moreau, R., Giscard
d’Estaing/Mitterrand : 54774 Mots pour convaincre, PUF, Paris,
1976.
69
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995, Textes et
documents rassemblés par Didier Maus, Les études de La
documentation Française, Paris, 1996.
Gerstlé, J., La Communication politique, Colin, Paris, 2008.
Hameau, Ch., La campagne de Jean-Marie Le Pen pour l’élection
présidentielle de 1988, LGDJ, Paris, 1992.
Kaid, L.L., Gerstlé, J., Sanders, R.K., eds., Mediated Politics
in Two Cultures. Presidential Campaigning in the United States
and France, Praeger, New York, 1991.
Massot, J., La Présidence de la République en France. Vingt ans
d’élection au suffrage universel. 1965-1985, Notes et études
documentaires, 4801, La documentation Française, Paris, 1986.
Médiaspouvoirs, Les médias font-ils l’élection ?, (38), 1995.
Perrineau, P., Reynié, D., dirs., Dictionnaire du vote, PUF,
Paris, 2001.
Piar, Christophe, Comment se jouent les élections, INA
Editions, 2012.
Pouvoirs, Elire un Président, n°14, PUF, Paris,1980.
Pouvoirs, Campagne électorale, n°63, PUF, Paris, 1992.
Pouvoirs, Voter, n° 120, PUF, Paris, janvier 2007.
Regards sur l’Actualité, « Elections et campagnes
électorales », La documentation Française, n°329, mars 2007.
Schwartzenberg, R-G., La Guerre de succession, PUF, Paris,
1969.
Schwartzenberg, R-G., La campagne présidentielle de 1965, PUF,
Paris, 1967.
70
Textes et documents sur la pratique institutionnelle de la Vème
république, rassemblés par Didier Maus, La Documentation
française, CNRS, Paris, 1978.
Textes et documents relatifs à l’élection présidentielle des 5
et 19 décembre 1965, Notes et Etudes documentaires, 3203, La
documentation Française, Paris, 1966.
Textes et documents relatifs à l’élection présidentielle des 5
et 19 mai 1974, rassemblés par Didier Maus, Notes et Etudes
documentaires, 4201-02-03, La documentation Française, Paris,
1975.
Textes et documents relatifs à l’élection présidentielle des 26
avril et 10 mai 1981, rassemblés par Didier Maus, Notes et
Etudes documentaires, 4647-48, La documentation Française,
Paris, 1981.
Textes et documents relatifs à l’élection présidentielle des 24
avril et 8 mai 1988, Rassemblés par Didier Maus, Notes et
Etudes documentaires, 4865, La documentation Française, Paris,
1988.
Vedel, Th., Comment devient-on président(e) de la République ?,
R.Laffont, 2007.