Le Mammouth du Brassus - problématique de l'extinction des grands mammifères
La monétarisation des grands domaines ruraux de Gaule septentrionale : une problématique nouvelle....
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La monétarisation des grands domaines ruraux de Gaule septentrionale : une problématique nouvelle....
CONSOMMER DANS LES CAMPAGNESDE LA GAULE ROMAINE
Actes du Xe congrès de l’Association AGER
Sous la direction deXavier Deru et Ricardo González Villaescusa
REVUE DU NORDHors série. Collection Art et Archéologie N° 21. 2014. Université Charles-de-Gaulle - Lille 3
L’étude de la circulation monétaire en milieu rural« aisé » – nous parlons des grandes villae – a connudepuis longtemps un essor considérable en Grande-Bretagne, région pour laquelle nous disposons denombreuses données quantitatives. Elles ont servi debase à une brève réflexion socio-économique de lapart de R. Reece dès 19881.
La situation est fort différente sur le continent etplus particulièrement en Gaule septentrionale, alorsque l’abondance et l’ancienneté des fouilles menéessur les grands domaines ruraux, particulièrement fré-quents dans certaines régions (Hesbaye liégeoise,Picardie…), laisseraient supposer une documentationpléthorique2. Malgré le nombre important de grandesvillae fouillées selon des méthodes dites « modernes »depuis les années 1970, nous disposons en réalité detrès peu d’informations relatives à la « consomma-tion » de la monnaie sur ce type de site.
D’une manière générale, les caractéristiques (éven-tuelles) de la circulation propre aux villae continen-tales3 ne semblent par avoir retenu l’attention spéci-fique des numismates. Nous mentionnerons seulementles quelques pages, soigneusement argumentées, queleur consacre J. van Heesch dans sa thèse publiée en1998, thème qu’il a repris récemment4. Il est toutefoisclair que la monétarisation véritable relève essentiel-lement de l’Antiquité tardive : le monnayage antérieurà 260 est généralement limité à quelques dizainesd’unités au maximum, même si quelques exceptionsnotables méritent d’être relevées. Ceci sans oublierque les espèces d’argent ou de bronze du Haut-Empire
constituent encore une composante structurelle de lacirculation au cours du premier tiers du IVe siècle5.
On a dès lors l’impression que les occupations tar-dives s’accompagnent d’une profonde mutation éco-nomique, nécessitant systématiquement la manipula-tion de nombreuses monnaies de faible valeur, alorsque les phases antérieures semblent se passer très lar-gement de l’usage de la monnaie, et ce malgré l’opu-lence dont témoignent aussi bien la taille des fundi quel’architecture ou la décoration de la pars urbana desgrands sites ruraux.
Il est effectivement assez surprenant de constaterl’absence de lien direct entre l’indéniable richessearchitecturale des grandes villae et les petits objets– monnaies comprises – qui en proviennent6. Sanschercher à en dresser un inventaire à valeur exhaustivecitons d’abord, du nord au sud, quelques sites « monu-mentaux » parmi les mieux lotis en numéraire (tab. 1).
Des valeurs identiques se rencontrent dans le sud del’Aquitaine et en Narbonnaise (tab. 2).
En revanche d’autres sites majeurs, fouillés parfoisrécemment, n’ont livré que quelques unités, voiredeux ou trois dizaines de monnaies antiques, un nom-bre dérisoire par rapport à la durée de l’occupation et àl’étendue des substructions dégagées et examinéesselon des méthodes « modernes » (tab. 3).
La même faiblesse quantitative se marque toutautant sur certains grands sites méridionaux : citons,parmi de nombreux autres : Saint-Cernin-de-Larche
*. — Jean-Marc DOyEN, Laboratoire HALMA-IPEL-UMR 8164,Université de Lille 3 / CReA-Patrimoine, Université libre de Bruxelles.1. — REECE 1988.2. — Notons cependant une synthèse récente inédite : VAN HEESCH (àparaître).3. — La situation est, comme d’habitude, fort différente en Grande-Bretagne, grâce aux innombrables travaux de R. Reece, résumés dans
REECE 1988. Sur la circulation monétaire en milieu rural, voir parexemple HOwGEGO 1992. 4. — Van Heesch 1998, p. 116-118 ; VAN HEESCH à paraître.5. — DOyEN 2007b, p. 275-281 ; DOyEN 2009, p. 58-64.6. — Aucune monnaie n’est par exemple signalée parmi les trouvaillesde Mercin-et-Vaux, dans l’Aisne : CAG 02/477/001.
JEAN-MARC DOYEN*
La monétarisation des grands domaines ruraux de Gaule septentrionale : une problématique nouvelle
REVUE DU NORD - N° 21 HORS SÉRIE COLLECTION ART ET ARCHÉOLOGIE - 2014, P. 267-276
(Corrèze), avec treize exemplaires7, Naveil (Loir-et-Cher), avec six exemplaires8, La Croisille-sur-Briance(Haute-Vienne)9 avec un unique exemplaire, La Garde(Var)10 et « Pardigon 3 », avec respectivement seize etquinze exemplaires11.
Notons que pour les mêmes sites, un inventaire por-tant cette fois sur les fibules nous offrirait sans douteune image très proche.
Différentes explications peuvent être avancéesquant à l’éventuelle faiblesse de la monétarisation desites ruraux. L’une est méthodologique : nos échan-tillons sont-ils un reflet véritable du numéraire perdusur les villae. L’autre est évidemment liée à l’usagemême de la monnaie en milieu rural.
D’une part, les techniques de fouilles appliquéesjusqu’il y a peu sur les habitats antiques (absence sys-tématique de l’usage du détecteur de métaux) ne per-mettaient pas la récolte méthodique des monnaiesqu’elles soient en contexte ou dispersées dans les
268 JEAN-MARC DOyEN
7. — LINTz 1981, p. 66.8. — CAG 41, p. 122. 9. — DUMASy-MATHIEU 1991, p. 75.10. — BRUN et alii 1989, p. 136-137, mentionnent seize monnaies dansce qui est considéré par l’auteur comme la plus grande huilerie deGaule (mais dont la pars urbana n’a été que partiellement fouillée).11. — BRUN et alii 1988, p. 54, citent quinze monnaies du Haut-Empire.
Cités Sites Province /département Pré-260 % Post-260 TotalMenapii Blandain1 Hainaut, B 17 4,9 333 350Condrusi/Tungri Anthée2 Namur, B 84 86,6 13 97Condrusi/Tungri wancennes3 Namur, B 12 23,5 39 51Nervii Vaulx-Vraucourt4 Pas-de-Calais 37 13,6 236 273Atrebates Ecoust-Saint-Mein5 Pas-de-Calais 106 17,9 488 594Atrebates Biache-Saint-Vaast6 Pas-de-Calais 45 14,2 273 318Morini wacquinghen7 Pas-de-Calais 236 50,8 229 465Treviri Echternach8 G.-D. de Lux. 17 12,8 116 133Lingones Andilly-en-Bassigny9 Haute-Marne 82 43,2 102 190
Tableau 1. — Numéraire issu de quelques grandes villae de Gaule septentrionale.1. VAN HEESCH 1998, p. 232. 2. THIRION 1969 ; BRULET 2008, n° 197 p. 561-564. 3. DEVILLERS 1971-1972 ; BRULET 2008, n° 169, p. 511-512. 4. « LaVoie Jacqueline » : DELMAIRE, NOTTE 1996, p. 111-124. 5 Ibid., p. 111-124. 6. Chronique Numismatique XXI, p. 174-175 et XXII, p. 236-237. 7. Sitede villa (selon R. Delmaire) précédemment non précisé et simplement localisé « au N.-E. de Boulogne-sur-Mer » pour éviter le pillage. Cette villa setrouve en réalité à cheval sur les localités de wacquinghen et d’Offrethun (CAG 62/387 et 582). La présence de 103 monnaies gauloises, dont de nombreuxexemplaires en or, de 26 Républicaines, essentiellement des deniers, pose des problèmes d’identification de la phase la plus ancienne du site. 8. METzLER,zIMMER, BAkkER 1981, p. 374-382. 9. fouilles de Cl. Serrano, matériel en cours de publication.
Cités Sites Province /département Pré-260 % Post-260 TotalVolques Tect. Montmaurin1 Haute-Garonne 56 10,6 471 527Volques Tect. Martres-Tolosane2 Haute-Garonne ? ? ? 151Santones Saint-Saturnin-du-Bois3 Charente-Maritime ? ? ? 200Salluvii Cavalaire-sur-Mer4 Var 2 2,5 77 79
Tableau 2. — Numéraire issu de quelques grandes villae de Narbonnaise et d’Aquitaine.1. LABROUSSE 1969, p. 335-381. 2 « Chiragan », documentation V. Geneviève, à paraître. 3 Ibid. 4 Villa de Pardigon 2, fouilles 1990. Documentationinédite communiquée par L. Severs.
Tableau 3. — Numéraire issu de quelques grandes villae peumonétarisées de Gaule septentrionale.
1. DE BOE 1974-1976 ; BRULET 2008, n° 110, p. 425-429. 2. SEVERS1980, p. 116-117, qui cite 1 denier, 5 sesterces et 1 dupondius, deTibère à Septime Sévère ; BRULET 2008, n° 19, p. 297-299. 3. ASAN 21(1895) p. 205 ; ASAN 21 (1895) p. 302 ; BRULET 2008, n° 168, p. 509-511 ; DENGIS 2011, p. 124, R.283. 4. VAN OSSEL, DEfGNÉE 2007,p. 149-150. ; BRULET 2008, n° 185, p. 535-540. 5. VAN HEESCH 1998,p. 275 ; BRULET 2008, n° 63, p. 348-349. 6. Informations N. Paridaens(CReA-Patrimoine, Université Libre de Bruxelles). Données hors tré-sor (4 sesterces et 122 antoniniens) : PARIDAENS et alii 2010. 7. CAG76, n° 116. 8. DOyEN 2007a ; BRULET 2008, n° 209, p. 577-579. 9. CAG55, 351/1*. 10. LUTz 1972, p. 75-80. Nous ne prenons pas en compteles 34 ex. venant d’un fanum. 11. CAG 52/137.
Cités Sites Province / Totaldépartement
Tungri Haccourt1 Liège, B 11Tungri Basse-wavre2 Brabant wallon, B 7Tungri Maillen « Ronchinne »3 Namur, B 9Tungri Hamois4 Namur, B 13Nervii Nouvelles5 Hainaut, B 33Nervii Merbes-le-Château6 Hainaut, B 5Veliocasses Boos7 Seine-Maritime 32Remi Treignes8 Namur, B 51Treviri Montmédy9 Meuse +/- 40Mediomatrici Saint-Ulrich10 Moselle 40Lingones Colmier-le-Bas11 Haute-Marne 4
labours. De ce fait, les périodes les plus récentes, sou-vent attestées par des réaménagements ténus aux Ve etVIe s., n’ont généralement pas été reconnues. Cesphases sont effectivement marquées par l’usage detrès petites dénominations, d’une masse inférieure augramme.
D’autre part, on relève des manquements systéma-tiques dans la gestion même des données spatiales :insuffisance généralisée des catalogues des monnaiesrécoltées, médiocrité des inventaires lorsqu’ils exis-tent, absence quasi systématique de relevés précis dulieu de découverte, absence de réflexion sur le type dedéposition du numéraire. Or les monnaies portent biend’autres informations que celles de simples marqueurschronologiques, rôle auquel la plupart des responsa-bles d’opération les cantonnent encore et toujours.
De plus, le développement de l’archéologie préven-tive au détriment des recherches programmées a limitél’exploration complète des grands domaines ruraux,même si la situation s’est nettement améliorée aucours de la dernière décennie. Dès lors, seuls des élé-ments épars de la pars rustica ou du corps de logis ontété étudiés. Des vues exhaustives de l’emploi dunuméraire sur de tels sites demeurent donc inexis-tantes : la villa d’Andilly-en-Bassigny (Haute-Marne), fouillée depuis les années 1960 et richementpourvue en numéraire, fait ici figure d’exception etnous servira par la suite d’exemple12.
Contrairement à une opinion bien ancrée chez lesnumismates, les pertes de monnaies sur les sites (toutcomme d’ailleurs le petit mobilier et la vaisselle) necorrespondent généralement pas aux périodes d’occu-pation les plus intenses, mais bien aux phases de rup-ture : modifications architecturales, changement destatut du propriétaire (par exemple lors de successionsimpliquant un appauvrissement ou un enrichissementdu nouveau possesseur), récupération de matériauxaprès abandon définitif. Ceci explique sans doute l’ab-sence de liaison probante entre les périodes les plusfastes de la villa d’Andilly suggérées par l’étudearchitecturale, et les moments des plus fortes pertes denuméraire.
La création de la plupart des grandes villae deGaule septentrionale se place à l’époque tibéro-clau-dienne (14-54), sous Néron (54-68) et les flaviens(69-96). Ces vastes structures polyvalentes prennentassez souvent le relais de « fermes indigènes » sur lestatut desquelles nous sommes encore mal documen-
tés mais qui semblent bien attestées dès la fin du IIe s.av. J.-C.13. Deux grandes catégories de villae peuventêtre distinguées : celles, d’une part, qui ne connaissentune véritable monétarisation qu’à date tardive, dans laseconde moitié du IIIe s., et ce souvent après plus dedeux siècles d’un fonctionnement parfois fort dyna-mique ; et d’autre part, celles qui témoignent d’unusage ténu de la monnaie depuis la fin del’Indépendance. Ce simple constat permet de poserdes questions pertinentes sur le fonctionnement éco-nomique des grands domaines ruraux et sur le rôle quela monnaie pouvait y jouer. La fin du IIIe s. montre detoute évidence un changement structurel majeur. Il estmarqué par un certain dynamisme qui s’oppose au« misérabilisme » hérité d’une vision erronée et réduc-trice – typique du XIXe s. – de l’impact des « invasionsbarbares » et de leurs très hypothétiques séquelles enGaule intérieure14.
L’étude de la répartition spatiale du numéraire(microcontextualisation), lorsqu’il est correctementcatalogué et chronologiquement phasé, permet d’en-trevoir le rôle extrêmement particulier joué par lamonnaie dans les grands domaines.
Plusieurs questions se posent quant à la monétarisa-tion des sites ruraux.1. Existe-t-il une différence quantitative dans l’usage
de la monnaie entre les sites urbains et les sitesruraux ?
2. Existe-t-il une différence qualitative entre les deuxtypes de sites ?
3. Existe-il une différence chronologique dans l’usagede la monnaie ?
4. Quel rôle la monnaie joue-t-elle au sein des grandsdomaines ?1. Travaillant sur les cités des Nerviens et des
Ménapiens mais en limitant son enquête à la périodeantonine (96-192 ap. J.-C.), J. van Heesch relève 233sites ayant livré du numéraire de cette longuepériode15. La zone étudiée comprend quatre villes,environ quinze agglomérations secondaires, trois sitesmilitaires et trois sanctuaires majeurs. Dès lors 208sites relèvent du « monde rural » lato sensu qui tota-lise à lui seul 89 % des découvertes. Il est toutefoisdifficile d’affirmer, sur cette seule base, qu’unedizaine de pourcents de la population vivait en milieuurbanisé, d’autant que ce décompte porte non pas surle nombre de monnaies récoltées mais sur le nombre
LA MONÉTARISATION DES GRANDS DOMAINES RURAUX DE GAULE SEPTENTRIONALE... 269
12. — ALONSO et alii à paraître. Autre exemple à Saint-André-de-Codols (Gard) : BERDEAUX-LE BRAzIDEC 2012.13. — fICHTL 2013.14. — RUffING 2008, dresse un inventaire des domaines économiquesflorissants dans la seconde moitié du IIIe s.
15. — Il s’agit de la période d’émission de ces monnaies et bien sûr pasde leur période de circulation. Rappelons que les bronzes des Antoninssont encore fort fréquents dans des contextes des années 280-320, voire320-340.
de lieux de découverte. On sait que les grands centresurbains, souvent décrits comme autophages, livrentbeaucoup moins de monnaies que les agglomérationssecondaires : le facteur est généralement de 1 à 10 enfaveur des vici et autres bourgades. L’usage quotidiende la monnaie en est peut-être la principale cause.Toutefois, nous ignorons totalement l’importancequantitative du personnel occupé dans les grandesexploitations agricoles de Gaule septentrionale. Ànotre connaissance, aucune évaluation ne repose surdes critères objectifs (superficie habitable au sein desvillae / taille des cuisines / quantification de la vaisselleculinaire et de table / restes alimentaires / nombre mini-mum d’individus nécessaire pour exploiter le fundus /importance des nécropoles). En revanche, on observeen ville une densité de l’ordre de cent habitants par hec-tare bâti16. La question de l’éventuelle différence quan-titative entre les utilisateurs ruraux et ceux vivant enville, en terme de « nombre de monnaies/habitant » netrouve aucune réponse au stade actuel.
2. La problématique de la différence qualitative estplus aisée à cerner. Contrairement à l’opinion de J.van Heesch, les récoltes monétaires effectuées sur lessites de villae ne sont pas essentiellement « des trou-vailles de surface qui sont par définition uniquementle reflet de la circulation de la petite monnaie ». Eneffet, les découvertes de deniers d’argent ou d’antoni-niens à haut titre sont très fréquentes et même, danscertains cas, exceptionnellement abondantes. Ainsi lesite de villa (?) de wacquinhen/Offrethun (Pas-de-Calais) évoqué précédemment (tab. 1) a livré un qui-naire et dix deniers républicains (dont deux fourrés),et pas moins de quarante-quatre deniers impériaux17.De la République à 192 ap. J.-C., l’argent représente47 % des trouvailles (44/94), une valeur totalementexceptionnelle18.
Bien plus, la découverte d’aurei ou de solidi isoléssur de grands sites ruraux est loin d’être l’exception.Pour la seule cité des Tongres, citons par exempleJeneffe19, Rognée20, Vodelée21 et finalementTreignes22.
En ce qui concerne l’éventuelle différence entre lesespèces circulant en milieu rural et celles propres aux
centres urbanisés, nous disposons de récoltes abon-dantes de monnaies dans deux grands domainesproches d’agglomérations.
La villa d’Anthée23 a été implantée dès l’époqueflavienne à 2 km de la voie antique menant de Bavay àla Meuse. Cette dernière coule à 8 km à peine dudomaine et permet de rejoindre facilement le centreurbain antique de Namur qui se situe à 25 km enaval24. Le numéraire namurois a fait l’objet d’unemonographie détaillée offrant une excellente vue de lacirculation locale sous l’Empire25.
La villa d’Andilly-en-Bassigny (Haute-Marne) estune création augustéenne qui succède à une fermeindigène26. Elle se situe à 3,5 km de la voie Langres-Trèves et à 1,5 km de celle menant de Langres àStrasbourg. Le chef-lieu de la cité des Lingons,Langres (Andemantunnum) se situe à environ 20 km.La circulation monétaire peut y être appréhendéegrâce à une synthèse assez récente27.
Les deux cas de figures sont topographiquementidentiques : de très grands domaines dotés d’un corpsde logis de type palatial, reliés par des routes impor-tantes à des agglomérations dont le numéraire est rela-tivement bien documenté.
À Anthée (fig. 1), nous constatons que les valeursfortes sont toutes en léger retrait par rapport à cellesobservées en ville. C’est le cas pour l’argent (denierset antoniniens à haut titre) mais également pour le ses-terce et pour le dupondius. La dénomination de base,l’as de cuivre, est en revanche nettement plus abon-dante. En revanche, les divisionnaires de ce dernier, lesemis et le quadrans, font totalement défaut. Noussavons que ce petit numéraire est peu utilisé dans lescampagnes, où les petits achats sont regroupés ou tro-qués (on ne paie probablement pas en liquide une sim-ple pomme, qui se vend un quadrans à Rome), alorsqu’en ville, les petits services demandent une monnaied’appoint. Nous avons du reste quantifié l’usage de la« petite monnaie » en Gaule à partir des données deReims sous Auguste et les Julio-claudiens28.
Andilly-en-Bassigny présente un faciès différent decelui observé dans son centre urbain le plus proche
270 JEAN-MARC DOyEN
16. — 60 000 ou 80 000 habitants à Reims sous les Antonins (600 ha),30 000 à Trèves au Bas-Empire (285 ha) : DOyEN 2007b, p. 360.17. — 1 d’Auguste, 2 de Tibère, 3 de Claude Ier (1 fourré), 1 deVitellius, 1 des Guerres Civiles de 68-69 ap. J.-C., 4 des flaviens (1fourré), 19 des Antonins (2 fourrés), 13 de Septime Sévère (3 four-rés), etc.18. — La longueur de la période couverte par ces deniers, à cheval surla réforme monétaire de Néron qui provoque la disparition totale desespèces d’argent impériales antérieures à l’année 64, montre que nousne nous trouvons pas en présence d’un trésor dispersé.19. — Aureus de Néron RIC 52 : BCEN 39/3, 2002, p. 246.20. — Solidus d’Arles de Valentinien I : BCEN 46/2, p. 166.21. — Aureus d’Hadrien RIC 320c : BCEN 40/3, 2003, p. 314, attribué
à un site indéterminé du sud de la province de Namur. Il s’agit en réalitéde la villa de Vodelée : BRULET 2008, n° 178, p. 524-525.22. — Aureus de Claude et Agrippine RIC 80 : DOyEN 2007a. Notonsque ce site se trouve apparemment chez les Rèmes, juste au-delà de lafrontière des Tongres.23. — Commune de Onhaye, prov. de Namur, B. : BRULET 2008,p. 562, fig. 509.24. — BRULET 2008, p. 551-559.25. — LALLEMAND 1989.26. — CAG 52/1, p. 100-108, n° 009.27. — POPOVITCH, AMANDRy, DHENIN 2001.28. — DOyEN 2007b, p. 111 et 133.
(fig. 2). Nous y relevons en effet que les valeurs fortes– antoniniens de billon, deniers et surtout sesterces – ysont nettement plus fréquentes qu’en ville. Le cas estparticulièrement flagrant pour le sesterce, deux foisplus abondant à Andilly qu’à Langres. Le dupondiuset l’as, en revanche, sont moins bien attestés dans lavilla.
Nous constatons donc deux types de comporte-ments différents face à la monnaie : l’un privilégie lespetites valeurs (Anthée), l’autre les valeurs fortes(Andilly).
On peut dès lors conclure qu’il existe bel et bienune différence qualitative dans le numéraire circulanten milieu rural. Mais il ne s’agit pas systématique-ment d’une dissemblance allant soit vers l’appauvris-sement, soit vers l’enrichissement des espèces« consommées ». Plutôt que d’y voir une différencedans le statut même des sites ou dans celui de leurspropriétaires, il convient de s’interroger sur la finalitéde la présence du numéraire et donc sur leur véritablestatut économique.
3. La date de la monétarisation des villae ne paraîtpas fort différente de celle observée en milieu urbain.C’est du moins ce que nous pouvons constater chezles Nerviens et les Ménapiens lors de l’examen de lacarte de répartition des monnaies d’Auguste29. Maisnotons une fois encore qu’il s’agit d’une distributioneffectuée selon la date de frappe de ces espèces, et nonselon leur date de perte, même si ce numéraire circuleessentiellement avant le règne de Vespasien. En réa-lité, c’est seulement à partir des règnes de Claude-Néron (41-68 ap. J.-C.) et surtout sous les flaviens,que le monnayage impérial devient abondant dans les
villae. Dans les agglomérations, en revanche, desapports sensibles apparaissent dès les années 30-20av. J.-C.
Une caractéristique importante se marque dans lemonnayage d’époque flavienne. Celui-ci se répartitgénéralement en deux groupes qualitatifs suivant lesétats d’usure. Le plus frais apparaît vraisemblable-ment au cours du dernier tiers du Ier s. de n. è. ; il estaccompagné de la céramique typique de l’époque fla-vienne (entre autres de la sigillée de LaGraufesenque). L’autre ensemble, généralement extrê-mement usé, doit voir sa date de perte largement ven-tilée au cours des deux siècles suivants, avec sansdoute une concentration dans les années 260-320.
4. Quant au rôle que joue la monnaie au sein desgrands domaines ruraux, force est de constater l’indi-gence de nos informations. En effet, si nous disposonsau départ de peu de données quantitatives concernantle numéraire issu de tels sites, la répartition dans l’es-pace des découvertes est impossible à réaliser dans laplupart des cas. Assez curieusement, le catalogue deM. Labrousse annexé à la publication de la plusancienne fouille réellement utilisable, celle deMontmaurin en 196930, nous donne la localisationindividuelle de 527 monnaies31. Ce type de donnéemanque largement pour les autres villae citées précé-demment.
À Andilly-en-Bassigny, le pointage systématiquedes trouvailles effectuées depuis 1961 a permis àCl. Serrano de localiser sur plan la quasi totalité des200 monnaies issues de la fouille (fig. 3). L’examendes plans de répartition par phase permet des constata-tions extrêmement intéressantes.
LA MONÉTARISATION DES GRANDS DOMAINES RURAUX DE GAULE SEPTENTRIONALE... 271
29. — VAN HEESCH 2013, fig. 3.30. — fOUET 1969, p. 338-381.
31. — Données malheureusement peu utilisées dans le texte, et nonreportées sur le plan du site.
0
10
20
30
40
50 Anthée
Namur
semisasdupondiussesterceAnt + den0
10
20
30
40
50 Andilly
Langres
semisasdupondiussesterceAnt + den
fIG. 1. — Comparaison entre les différentes dénominations duHaut-Empire (27 av. J.-C.-260 ap. J.C.) provenant du vicus de
Namur et de la villa d’Anthée (prov. de Namur, B).
fIG. 2. — Comparaison entre les différentes dénominations duHaut-Empire (27 av. J.-C.-260 ap. J.C.) provenant de Langres
et de la villa d’Andilly-en-Bassigny (Haute-Marne, F).
Ainsi, très peu de découvertes figurent dans le sec-teur thermal – ce qui est normal – mais encore dans lalongue galerie de façade et dans les pièces d’apparatqui s’y ouvrent. Le numéraire se concentre dans lesailes, voire dans les bâtiments à fonction économique.En outre, les ailes ne paraissent pas fonctionner simul-tanément, alors qu’elles existent toutes deux à datehaute. Le numéraire du Haut-Empire se concentredans l’aile nord-est, avec une zone de dispersion rela-tivement étendue. Celui de l’Antiquité tardive appa-raît dans l’aile sud-est, avec une très nette tendance àla concentration dans les angles des salles ouvertesvers l’extérieur. Pour les deux périodes, nous consta-tons une tendance au regroupement des monnaies
dans les corridors et passages. Une observation simi-laire a été effectuée par S. Martin à propos des décou-vertes monétaires de la « domus à l’atrium fleuri » defréjus (Var) (fig. 4). À Andilly, cette répartition privi-légiée est particulièrement flagrante pour le Haut-Empire (fig. 3).
Dès lors, il semble assuré que, quelle que soit sonépoque, la monnaie joue un rôle très spécifique auniveau du domaine d’Andilly-en-Bassigny. On peutsans doute penser à des activités commerciales dedétail. Peut-on aller jusqu’à avancer l’hypothèse devéritables petits « marchés privés », sorte de nundi-nae, nécessitant la manipulation de petites sommes ?On relève effectivement sur le site un très faible pour-
272 JEAN-MARC DOyEN
fIG. 3. — Plan de répartition des monnaies dans la villa d’Andilly-en-Bassigny. DAO Cl. Serrano.
LA MONÉTARISATION DES GRANDS DOMAINES RURAUX DE GAULE SEPTENTRIONALE... 273
fIG. 4. — Plan de répartition des monnaies découvertes dans la « domus à l’atrium fleuri » de Fréjus.D’après Martin 2011, fig. 2, p. 241.
centage de deniers, 2,2 % seulement, mais une grandeabondance de sesterces. Quoi qu’il en soit, les activi-tés faisant usage de numéraire sont limitées à deszones bien précises de la pars urbana, la seule actuel-lement fouillée de manière intensive32. Le développe-ment de cette forme de « vente aux particuliers » dansdes pièces d’accès aisé et s’ouvrant directement sur lacour intérieure, prend un essor véritable entre 280 et320, profitant peut-être du déclin du pouvoir politique.La systématisation de la topologie phasée des décou-vertes monétaires en milieu rural devrait confirmerces observations liminaires sur l’usage réel de la mon-naie au sein des villae.
CONCLUSIONS
On peut se poser la question de savoir quel typed’événement a pu nécessiter l’apparition de la mon-naie en milieu rural.
Pour l’époque romaine, on peut avancer que lamonétarisation est liée, d’une manière ou d’une autre,à la création de taxes régulières exigées en numéraire.J. van Heesch évoque également le problème des sitesruraux ayant livré des monnaies gauloises : il metcette présence en relation avec une économie de mar-ché qui se développerait seulement au début del’Empire, voire à l’extrême fin de la République, maisde toute façon largement après la Conquête. Or, il estclair que le phénomène de monétarisation des« fermes indigènes », ces prédécesseurs extrêmementfréquents des grandes villae d’époque impériale, esttrès largement antérieur aux campagnes césariennes.L’usage, encore fort limité il est vrai, de la monnaie enmilieu rural se développe certainement dès les années150-140 av. J.-C. (début de LT D1a), chez les Rèmespar exemple, mais quelques attestations plusanciennes (LT C2) existent probablement. En tout étatde cause, nous relevons un peu partout l’existence desites agricoles monétarisés dès 80-70 av. n. è., avantmême le passage souvent rapide de l’usage des mon-naies coulées de potin au profit de celles frappées enbronze. En Gaule du nord, cette mutation technolo-gique se situe grosso modo juste avant la Conquête.
Pour le Haut-Empire, nous pouvons relever troisclasses de sites : ceux qui ne livrent absolumentaucune monnaie, ceux qui en fournissent d’impor-tantes quantités, principalement d’époque julio-clau-dienne, flavienne ou antonine, et finalement ceux qui,malgré leur taille imposante, ne disposent au cours destrois premiers siècles que d’un numéraire extrême-
ment limité en quantité et dont l’état d’usure permetde supposer une date de perte essentiellement tardive(post-260).
On serait, de prime abord, tenté d’y voir le signed’une activité économique d’intensité variable, lessites riches en monnaies étant évidemment les plusactifs. Apparemment, l’hypothèse inverse semble laplus probable. Il est en effet assuré que certains de cesgrands domaines ruraux de l’hinterland travaillaientuniquement pour l’administration impériale – l’arméeessentiellement – et exportaient en bloc la totalité deleur production, qu’elle soit minière33, agricole ouissue de l’élevage. Nous ignorons qui étaient cesgrands propriétaires terriens, qui pouvaient d’ailleurscumuler de nombreux domaines, mais il est possibleque ceux-ci vivaient en ville ou dans des villae luxueu-sement aménagées, en Gaule ou même en Italie. Dèslors, certains grands domaines n’avaient sans doutepas d’usage direct de la monnaie, la totalité du person-nel relevant du statut de simple « employé » (servileet/ou libre ?). Le fundus produisant l’essentiel sinon latotalité des produits nécessaires à la vie quotidiennedes ouvriers agricoles, le bénéfice de la productionétait dès lors directement versé au propriétaire sanstransiter par la villa.
La cartographie systématique des grands domainesruraux n’ayant livré aucune monnaie révélerait peut-être des concentrations de sites non monétariséstémoignant de vastes zones dont la production étaittotalement acquise par l’armée (qui était peut-êtreindirectement propriétaire des villae en question).L’archéozoologie pourrait d’ailleurs confirmer cesdonnées puisqu’elle permet de mettre en évidence desméthodes d’élevage spécifiquement tournées vers laproduction de surplus destinés à une consommationurbaine et/ou militaire34.
En revanche, le cas est plus complexe en ce quiconcerne les sites fortement monétarisés. Peut-on pen-ser qu’il s’agit justement de villae ne vivant pas desfournitures à l’État romain ? De ce fait, du numérairedevait circuler en abondance, témoignant des transac-tions avec une clientèle privée. La distribution spatialedes monnaies d’Andilly-en-Bassigny semble plaideren faveur de cette hypothèse.
Nous observons une rupture généralisée, enBretagne comme sur le Continent, à partir de laDyarchie, dans les années 285-290. Cette période estmarquée par l’arrivée en Gaule du nord des émissionsitaliennes médiocres de Gallien et de ses successeurs,
274 JEAN-MARC DOyEN
32. — La situation évolue progressivement puisque les campagnes defouilles de ces dernières années portent plus spécifiquement sur lesbâtiments annexes.
33. — DUMASy-MATHIEU 1991, p. 22.34. — C’est le cas en Hesbaye liégeoise, comme l’ont montré f. Pigièreet A. Lepot au cours de ce colloque.
suite au décri (vers 283) du numéraire des empereursgallo-romains. Elle est suivie par la production d’in-nombrables imitations radiées qui meublent la pénuriede monnaies officielles entre 290 et 310-320. Lacésure n’est apparemment pas imputable aux « inva-sions germaniques » des années 259-275/635 puisquenous nous situons près d’une génération plus tard.
À partir des années 285-290 donc, la modificationest remarquable : subitement sont envahis de petitemonnaie à peu près tous les sites qui ont survécu à lacrise économique des années 230-280 – mais les aban-dons sont-ils aussi nombreux qu’on ne l’avance géné-ralement ? Les antoniniens officiels ou illégaux ycôtoient d’anciens bronzes sénatoriaux très usés maisencore des antoniniens de métal blanc de Gordien IIIet de ses successeurs : ils jouent le rôle d’espèces« fortes » à un moment où l’État n’a plus les capacitésde produire un monnayage d’argent pur36.
On peut réfléchir aux causes profondes de cesmutations dans l’usage de la monnaie. Peut-être faut-ily voir un contrecoup de l’état de délabrement du limesrhénan, avec la disparition momentanée du systèmed’approvisionnement de troupes précédemment mas-sées aux frontières de façon permanente et désormaiséparpillées en fonction des opérations militaires à lafois contre les Barbares, mais encore et surtout contreles innombrables prétendants au trône entre 248 et29737. En revanche cette explication, valable pour leIIIe s., n’est plus d’actualité pour le siècle suivant. Deschangements majeurs dans la politique agricole desgrands domaines pourraient-ils être évoqués ? Onpense à l’abandon de certaines formes de culture(s) oud’élevage destinées à une clientèle spécifique, au pro-fit d’une diversification entraînant une rétraction d’unmarché plus restreint, passant du régional au local.Toutefois les données relatives au fonctionnement desgrandes villae de Gaule septentrionale sous la dynastiethéodosienne (379-455 ap. J.-C.) sont encore fortténues, essentiellement pour des raisons méthodolo-giques38. L’usage systématique (à des fins strictementscientifiques, s’entend) du détecteur de métaux sur leschantiers du Nord – Pas-de-Calais ou en Champagne-Ardenne, montre désormais l’importance quasi systé-matique des (ré)occupations tardives, postérieures à400, sur des sites ruraux dont les niveaux les plus
récents ont été systématiquement rabotés par leslabours.
Mots-clés : villes romaines, numismatique antique,circulation monétaire, économie rurale (Antiquité),marchés.
BibliographieAlonso, Coutelas et alii à paraître : ALONSO L., COUTELAS A.,DELAGE R., DOyEN J.-M., PRAT B., RIVIèRE f., SERRANO C,« La villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny (Haute-Marne), un état des lieux à la lumière des études récentes »,BSAC, à paraître.BerdeAux-Le BrAzideC 2012 : BERDEAUX-LE BRAzIDEC M.-L., « Les monnaies », dans POMAREDES H., BARBERAN S.,MAUfRAS O., SAUVAGE L., La villa de Saint-André-de-Codols(Nîmes, Gard) du Ier au xIIe s. de n. è. : évolution de l’habitat etde l’espace rural nîmois de l’Antiquité au Moyen Âge, Lattes,2012, p. 347-361. (Monogr. d’Archéologie Méditerranéenne,32)BruLeT 2008 : BRULET R. (dir.), Les Romains en Wallonie,Bruxelles, 2008.Brun et alii 1988 : BRUN J.-P. et alii, « La villa gallo romainede Pardigon 3 », dans Autour d’Heraclea Caccabaria.Archéologie de la Côte des Maures, Toulon, 1988, p. 41-59.Brun et alii 1989 : BRUN J.-P. et alii, « La villa gallo-romainede Saint-Michel à La Garde (Var). Un domaine oléicole auHaut-Empire », Gallia, 1989, 46, p. 103-162.CAG 02 : PICHON Bl., L’Aisne, Paris, 2002. (Carte archéolo-gique de la Gaule, 02)CAG 41 : PROVOST M., Le Loir-et-Cher, Paris, 1988. (Cartearchéologique de la Gaule, 41)CAG 52/1 : THÉVENARD J.-J., La Haute-Marne, Paris, 1996.(Carte archéologique de la Gaule, 52/1)CAG 52/2 : JOLy M., Langres, Paris, 2001. (Carte archéolo-gique de la Gaule, 52/2)CAG 55 : MOUROT f., La Meuse, Paris, 2001. (Carte archéolo-gique de la Gaule, 55)CAG 62 : DELMAIRE R., Le Pas-de-Calais, Paris, 1994, 2 vol.(Carte archéologique de la Gaule, 62)CAG 76 : ROGERET I., La Seine-Maritime, Paris, 1997. (Cartearchéologique de la Gaule, 76)Chronique numismatique : publication annuelle (depuis 1981)dans la Revue du Nord.de Boe 1974-1976 : DE BOE G., Haccourt I. Vestiges d’habitatpré-romain et premières périodes de la villa romaine,
LA MONÉTARISATION DES GRANDS DOMAINES RURAUX DE GAULE SEPTENTRIONALE... 275
35. — DEMOUGEOT 1969, p. 493-534.36. — Au niveau de la circulation quotidienne, la réforme de 294 etl’introduction d’un argenteus (taillé au 1/96e de livre, soit 3,41 g) fai-sant revivre le denier néronien, est un échec puisque ce monnayage estsystématiquement thésaurisé, souvent avec de la vaisselle d’argent :DEPEyROT 2006, p. 164.
37. — La tendance actuelle est de voir dans l’instabilité politique et lamultiplication des règnes au IIIe s. une des causes majeures de l’infla-tion et de la crise économique, plutôt qu’une conséquence de celle-ci.38. — VAN OSSEL 1992, p. 42-43 et passim.
Bruxelles, 1974 (Arch. Belgica, 168) ; ID., Haccourt II. Lecorps de logis de la grande villa, Bruxelles, 1975 (Arch.Belgica, 174) ; ID., Haccourt III. Les bains de la grande villa,Bruxelles, 1976 (Arch. Belgica, 182).deLmAire, noTTe 1996 : DELMAIRE R. et NOTTE L.,Trouvailles archéologiques dans la région de Bapaume.Prospections et fouilles d’Edmond Fontaine (1926-1987),Arras, 1996. (Mém. de la Comm. départ. d’Hist. et d’Arch. duPas-de-Calais, 32)demougeoT 1969 : DEMOUGEOT E., La formation de l’Europeet les invasions barbares. Des origines germaniques à l’avène-ment de Dioclétien, Paris, 1969.dengiS 2011 : DENGIS J.-L., Trouvailles et trésors monétairesen Belgique. Ix. Province de Namur. La période gallo-romaine,wetteren, 2011. (Collection Moneta 123)dePeyroT 2006 : DEPEyROT G., La monnaie romaine. 211 av.J.-C.-476 ap. J.-C., Paris, 2006.deviLLerS 1971-1972 : DEVILLERS L., « La villa dewancennes », Annales Soc. Arch. de Namur, 56, 1971-1972,p. 97-132.doyen 2007a : DOyEN J.-M., Les monnaies antiques de la villade Treignes (prov. de Namur, Belgique) : étude préliminaire,2007, 20 p., accessible en ligne sur http://www.academia.edu/2427110/Les_monnaies_antiques_de_la_villa_de_Treignes_prov._de_Namur_Belgique_etude_preliminaire.doyen 2007b : DOyEN J.-M., Économie, monnaie et société àReims sous l’Empire romain. Recherches sur la circulationmonétaire en Gaule septentrionale intérieure, numéro mono-graphique du Bulletin de la Société ArchéologiqueChampenoise, t. 100, 2007, n° 2 et 4 (2008). (ArchéologieUrbaine à Reims, 7).doyen 2009 : DOyEN J.-M., « Les monnaies », dans CATTELAINP., PARIDAENS N. (dir.), Le sanctuaire tardo-romain du « Boisdes Noël » à Matagne-la-Grande. Nouvelles recherches (1994-2008) et réinterprétation du site, Bruxelles – Treignes, 2009,p. 52-76. (Études d’Archéologie 2 – Artéfacts 12)dumASy-mAThieu 1991 : DUMASy-MATHIEU fr., La villa duLiégeaud et ses peintures. La Croisille-sur-Briance (Haute-Vienne), Paris, 1991. (Documents d’archéologie française, 31)FiChTL 2013 : fICHTL St., « Die gallische villa von Batilly-en-Gâtinais (Loiret) und die frage nach dem Ursprung derGroßenvillae “à pavillons multiples alignés” », AlemanischesJarhbuch : Römische Villen, 2013, p. 9-26.FoueT 1969 : fOUET G., La villa gallo-romaine de Montmaurin(Haute-Garonne), Paris, 1969. (Gallia, suppl. 20)howgego 1992 : HOwGEGO Chr., « The supply and use ofMoney in the Roman world 200 B.C to A.D.300 », Journal ofRoman Studies, 82, 1992, p. 1-31.LABrouSSe 1969 : LABROUSSE M., « Études des monnaies »,dans fOUET 1969, p. 335-381.LALLemAnd 1989 : LALLEMAND J., Les monnaies antiques dela Sambre à Namur, Namur, Musée Archéologique, 1989.
(Documents relatifs à l’archéologie de la région namuroise, 3)LinTz 1981 : LINTz G., Carte archéologique de la Gauleromaine, fascicule xVI, Corrèze, Paris, 1981.LuTz 1972 : LUTz M., « Le domaine gallo-romain de Saint-Ulrich (Moselle) (II) », Gallia, 30 (1), 1972, p. 41-82.mArTin 2011 : MARTIN St., « Some remarks on coin use inProvence. New data from fréjus (Var, france) », Journal ofArchaeological Numismatics, 1, 2011, p. 237-244.meTzLer, zimmer, BAkker 1981 : METzLER J., zIMMER J.,BAkkER L., Ausgrabungen in Echternach, Luxembourg, 1981.PAridAenS et alii 2010 : PARIDAENS N., AUTHOM N., CLERBOISS., DELPLANCkE M.-P., VAN HEESCH J., « Une cachette d’objetsde valeur des années 260 ap. J.-C. dans une villa de la cité desNerviens (Merbes-le-Château, Belgique) », Gallia, 67 (2),2010, p. 209-253.PoPoviTCh, AmAndry, dhenin 2001 : POPOVITCH L.,AMANDRy M., DHENIN M., « Les monnaies », dans CAG 52/2,p. 153-269.reeCe 1988 : REECE R., « Coins and villas », dans BRANIGANk., MILES D. (ed.), The Economics of Romano-British Villas,1989, p. 34-41.ruFFing 2008 : RUffING k., « Die wirtschaft », dans JOHNEk.-P. (éd.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise undTransformation des römischen Reiches im 3. Jahrhundert n.Chr. (235-284), Berlin, 2008, Band II, p. 817-860.SeverS 1980 : SEVERS L., « La villa belgo-romaine de Basse-wavre. Étude du matériel archéologique et essai d’interpréta-tion chronologique », Wavriensia, 29 (4), 1980, p. 89-156.Thirion 1969 : THIRION M., « Les monnaies de la villad’Anthée », Annales de la Soc. Arch. de Namur, 51, 1969,p. 29-46.vAn heeSCh 1998 : VAN HEESCH J., De muntcirculatie tijdensde romeinse tijd in het noordwesten van Gallia Belgica. Decivitates van de Nerviërs en de Menapiërs (CA 50 V.C.-450N.C.), Bruxelles, 1998.vAn heeSCh (à paraître) : VAN HEESCH J., « Coins and thecountryside : coin use in Roman « villas » in Northern Gaul »,dans fREy-kUPPER S. et STANNARD Cl. (éd.), Contextes etcontextualisation de trouvailles monétaires / Contexts and theContextualization of Coin Finds, Lausanne, à paraître. (Étudesde numismatique et d’histoire monétaire)vAn oSSeL 1992 : VAN OSSEL P., Établissements ruraux del’Antiquité tardive dans le nord de la Gaule, Paris, 1992.(Gallia, suppl. 51).vAn oSSeL, deFgnée 2007 : VAN OSSEL P., DEfGNÉE A.,Champion, Hamois. Une villa romaine chez les Condruses.Archéologie, environnement et économie d’une exploitationagricole antique de la Moyenne Belgique, Namur, 2007.(Études et Documents, Archéologie, 7)
276 JEAN-MARC DOyEN
Sommaire
Préface Michel Reddé 9Xavier Deru,
Discussion préalable autour du concept de consommation. Ricardo González Villaescusa 13
Se nourrirL’essor des blés nus en France septentrionale : Véronique Zech-Matterne,systèmes de culture et commerce céréalier autour de Julian Wiethold et Bénédicte Pradatla conquête césarienne et dans les siècles qui suivent. avec la coll. de Françoise Toulemonde 23Mouture de subsistance, d’appoint et artisanat alimentairede rendement. Les meules gallo-romaines entre villeset campagnes dans le nord de la Gaule. Paul Picavet 51Le matériel de mouture des habitats du Pôle d’activités Alexandre Audebert,du Griffon, à Barenton-Bugny et Laon (Aisne). Vincent Le Quellec 67Les meules rotatives en territoire carnute : provenances et consommation. Boris Robin 85La consommation des poissons en France du nord àla période romaine. Marqueur socio-culturel et Benoît Clavel etartefacts taphonomiques. Sébastien Lepetz 93Coquillages des villes et coquillages des champs :une enquête en cours. Anne Bardot-Cambot 109La consommation des ressources animales en milieu rural :quels indices pour quelle caractérisation de cet espacesocio-économique ? Tarek Oueslati 121Caractérisation de la consommation d’origine animale et Sophie Lefebvre,végétale dans une exploitation agropastorale du début de Emmanuelle Bonnaire, Samuel Lacroixl’Antiquité à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais). et Oscar Reverter-Gil 129La diversité morphologique du porc en tant qu’indicateurdes mécanismes de gestion de l’élevage porcin et del’approvisionnement des villes romaines. Apport de l’analyse Tarek Oueslati,du contour des troisièmes molaires inférieures du porc. Catherine Cronier 151Une économie de marché entre la ville de Tongres etson arrière-pays ? Les exemples de la gestion des ressources animales et de l’approvisionnement en Fabienne Pigière etcéramique. Annick Lepot 155De la viande et des pots dans la proche campagne David Germinet,d’Avaricum (Bourges-Cher) : exemple de la villa Emmanuel Marot,de Lazenay et mise en perspective. Marilyne Salin 171La céramique des quatre habitats du IIIe siècle du« Pôle d’activité du Griffon » à Barenton-Bugny etLaon (Aisne). Amélie Corsiez 181La consommation alimentaire d’après la céramique enChampagne : comparaisons raisonnées entre la capitale Anne Delor-Ahü,des Rèmes et son territoire. Pierre Mathelart 193
La consommation de denrées méditerranéennes dans lesmilieux ruraux de la Cité des Tongres : le témoignage desamphores. Noémie Nicolas 219
Se logerLa circulation des terres cuites architecturales dans lesud-est de l’Entre-Sambre-et-Meuse et zones contiguës, Laurent Luppens etd’après la répartition des estampilles. Pierre Cattelain 227Diffusion des tuiles dans le nord de la Gaule : Guillaume Lebrun,le cas de la région d’Orchies (Nord). Gilles Fronteau 249
Échanger
La monétarisation des grands domaines ruraux de Gaule septentrionale : une problématique nouvelle. Jean-Marc Doyen 267La circulation monétaire dans les campagnes du Languedoc à l’époque gallo-romaine : une première approche. Marie-Laure Berdeaux-Le Brazidec 277
Guillaume Varennes, Cécile Batigne-Vallet, Christine Bonnet,François Dumoulin, Karine Giry,Colette Laroche, Odile Leblanc,Guillaume Maza, Tony Silvino et
Apports de l’ACR Céramiques de cuisine d’époque l’ensemble des collaborateurs deromaine en région Rhône-Alpes et Sud-Bourgogne à l’ACR Céramiques de cuisine d’époque la question des faciès céramiques urbains et ruraux : romaine en région Rhône-Alpes et bilan, limites et perspectives. Sud-Bourgogne 291
Consommer à l’échelle du site et de la régionMatthieu Poux avec la coll. deBenjamin Clément, Thierry Argant,Fanny Blanc, Laurent Bouby,Aline Colombier, Thibaut Debize,Arnaud Galliegue, Amaury Gilles,Lucas Guillaud, Cindy Lemaistre,Marjorie Leperlier, Gaëlle Morillon,
Produire et consommer dans l’arrière-pays colonial de Margaux Tillier, Yves-Marie ToutinLugdunum et de Vienne : étude de cas. Aurélie Tripier 323La Vulkaneifel occidentale comme lieu de consommation et de production du Ier au IVe siècle. Peter Henrich 357
Résumés (français, anglais). 365













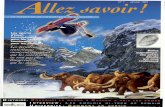











![J. C. VIZUETE MENDOZA: La construcción de la imagen literaria de don Diego Ramírez de Villaescusa. [Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLVI (2013) 525-554]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63220ba9807dc363600a4170/j-c-vizuete-mendoza-la-construccion-de-la-imagen-literaria-de-don-diego-ramirez.jpg)







