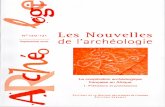Recomposition sociodémographique, transformations des territoires et valorisation des paysages des...
Transcript of Recomposition sociodémographique, transformations des territoires et valorisation des paysages des...
1
Gérald Domon ■ Sylvain Paquette ■ Julie Ruiz ■ Louis Roy
Recomposition sociodémographique, transformations des territoires et valorisation des paysages des milieux ruraux du sud du Québec
bilan et enseignements de 10 ans de recherche (1998-2008)[présentation partielle]
Image du Québec rural demeure marquée par son passé agricole…
… un passé dont certaines traces demeurent bien visibles
Or, cette image est rudement mise à l’épreuve
1. Au plan physico-spatial
Superficies totales mises en valeur par l’agriculture(Terres en culture, pâturages et jachères)
Un rétrécissement marqué de l’écoumène agricole
1951
2001
(Ruiz et Domon, 2005b)
Apparition de nouvelles cultures
1. Au plan physico-spatial
Source : Statistiques Canada, recensements de l’agriculture 1951-2001
Maïs
1951 12 km²
2001 4 360 km²
Soya
Superficies en culture (ha)
Or, cette image est rudement mise à l’épreuve
2001
(Ruiz et Domon, 2005b)
Émergence de zones de plus en plus contrastées : zones d’intensification, zones de déprise
1. Au plan physico-spatial
Zones d’intensification
agricole
Zones de déprise agricole
Or, cette image est rudement mise à l’épreuve
(Ruiz et Domon, 2005b)
2. Au plan sociodémographique
Diminution spectaculaire du nombre de fermes et de la population rurale agricole
1951
Source : Statistiques Canada, recensements de l’agriculture 1951-2001
2001
Densité des fermes
Or, cette image est rudement mise à l’épreuve
Pop. rurale Pop. agricole
Nombre En % de la pop. Rurale
1951 1 360 000 767 000 56%
1971 1 170 000 305 000 26%
1991 1 540 000 128 000 8%
2001 1 420 000 97 000 7%
(Ruiz et Domon, 2005b)
2
► Zone d’intensification
Un double constat à la base de nos recherches
1. Diminution du nombre de fermes pose le risque de dévitalisation des communautés
Besoin de retenir les résidents, besoin d’attirer de nouveaux résidents
► Zone de déprise
2. Dissociation marquée des dynamiques agricoles et des dynamiques démographiques
Montréal
Un double constat à la base de nos recherches
(Paquette et Domon, 1999)
Montréal
Un double constat à la base de nos recherches
2. Dissociation marquée des dynamiques agricoles et des dynamiques démographiques
(Paquette et Domon, 1999)
- Dans quelle mesure le paysage est-il un facteur attractif ?
Questions soulevées
- Y a-t-il véritablement une «nouvelle» population rurale ?
- Quelle est-elle ? Quelles sont ses motifs d’implantation ?
L’importance du paysage : quelques évidences empiriquesDes questions de recherche approfondies sur trois territoires distincts
États-Unis
Ontario
Zone d’intensification
agricole
Zone de déprise agricole
3
Des questions de recherche approfondies sur trois territoires distincts
États-Unis
Ontario1. Havelock
Zone de déprise agricole
2.2. Bassin versant du ruisseau-des-Aulnages
Zone d’intensification agricole
2.1 Quatre municipalités de Lanaudière
Zone d’intensification agricole
Des questions de recherche approfondies à partir d’un même cadre théorique
(Ruiz et Domon 2005a, inspiré de Domon et al 2000)
Le paysage renvoie à la réalité matérielle (territoire) mais aussi aux individus , àleurs perceptions du territoire et aux usages qu’ils en font.
Territoires étudiés à la fois sous l’angle physico-spatial…
1950 2000
Exemple type d’évolution d’un paysage des Appalaches
… et sous l’angle social (individus)
Caractéristiques individuelles Représentations
Perceptions
Usages, pratiques
1. Étude de cas en zone de déprise agricole
2. Études de cas en zone d’intensification agricole
3. Bilan et synthèse : vers un modèle de lecture
des enjeux de la recomposition des milieux
ruraux
1 Les zones de déprise agricole
4
Recomposition sociodémographique des campagnes
- Au Québec, phénomène documenté à l’échelle macro (ex.: dynamique démographique);
- Malgré l’étendu des territoires concernés et l‘ampleur des changements sociospatiaux en présence, peu de travaux ont cherchéà mettre au jour la particularité des nouveaux rapports envers le territoire rural à l’échelle locale.
Mise en contexte Questionnements de recherche
Posent l'importance relative de ces nouveaux rapports sociaux auterritoire dans l’analyse des dynamiques rurales actuelles ?
- En quoi l’attrait de certains attributs du territoire module-t-il la redéfinition socio-spatiale des campagnes ?
- En quoi l’émergence de nouveaux modèles d’occupation du territoire, de nouveaux usages, de nouveaux regards entretenus envers le territoire permet-il de repenser les frontières entre les différents segments de population ?
Territoire d’étude : Canton de Havelock (Haut-Saint-Laurent)
QUÉBEC
ONT.
U.S.A.
N.B.
N.S.
N.
Montréal
États-Unis
Profils agricoles (1991)Par subdivision de recencement unifiée
Agriculture intensive de type maraîcherAgriculture intensive de type céréalierAgriculture modérément intensiveAgriculture extensive d'élevageAgriculture marginaliséeDonnées non-disponibles
(Paquette et Domon 1999)
Havelock
1. Dynamiques d’implantation résidentielle
Caractérisation du contexte physico-spatial des emplacements résidentiels (ex.: situations topographiques et caractéristiques visuelles) associée à un examen du profil des occupants
Documentation des rapports au territoire : deux approches
Documentation des rapports au territoire : deux approches
1. Dynamiques d’implantation résidentielle
Quelques tendances (181 ménages rencontrés en 1998) :
- Les nouveaux segments de populations ne se déploient pas de manière uniforme sur le territoire
- Certains attributs du territoire (ex.: accès à une vue panoramique, à un cadre naturel de qualité) orientent effectivement le choix résidentiel des individus
- Association étroite entre certains contextes physico-spatiaux et certains profils types (ex.: profession libérale, migrant en provenance de Montréal)
2. Discours sur le territoire dans l’expérience de migrationÀ partir des témoignages individuels, il s’agissait de susciter un discours sur le territoire, les expériences qu’il évoque, les pratiques qu’il suggère, les enjeux qu’il soulève
Documentation des rapports au territoire : deux approches
5
Enquête: aperçu méthodologique
Objectifs:- Cerner les motivations de départ des citadins ayant élu domicile en campagne; - Identifier les attributs du rural que ces migrants valorisent; - Baliser les pratiques témoignant de leur façon d’utiliser le territoire.
Discours sur le territoire dans l’expérience de migration
Enquête: aperçu méthodologique
Discours sur le territoire dans l’expérience de migration
Approche biographiqueEnquête en 2002 menée auprès de 36 ménages (50 informateurs) parmi les 181 ménages rencontrés en 19981ère phase d’analyse: 20 ménages de nouveaux résidants (20/62) représentatifs de situations différentes
Lieu de naissance; langue maternelle; occupation; attributs de la propriété (taille, localisation)
Enquête: aperçu méthodologique
Discours sur le territoire dans l’expérience de migration
Thèmes abordésHistorique de leur présence dans la municipalité:
itinéraire résidentiel, motifs de migration, démarches entreprises, localité et emplacement recherchés
Expériences de séjour antérieur en campagnePratiques domestiques (ex.: rénovations, potager, lieux et parcours fréquentés, etc.)
Enquête: quelques résultats
Profils des ménages rencontrés (20)
• Groupes d’âge:
• 40-59 (9)
• 60 et + (11)
• Niveau de scolarité atteint:
• Secondaire (2)
• Collégial (7)
• Universitaire (11)
Discours sur le territoire dans l’expérience de migration
Profils des ménages rencontrés (20)
• Lieu de travail:
• Haut-Saint-Laurent (5)
• Montréal (9)
• Retraité (6)
• Ancienneté de résidence:
• 4 ans et - (4)
• 5 à 14 ans (7)
• 15 ans et + (9)
Enquête: quelques résultats
Discours sur le territoire dans l’expérience de migration
Enquête: quelques résultats
Discours sur le territoire dans l’expérience de migration
Itinéraire résidentiel et expérience de séjour (20)
• Statut résidentiel avant l’établissement en campagne:
• Propriétaire – ville (13)
• Propriétaire – banlieue (6)
• Locataire – ville (1)
• Expérience de séjour en milieu agricole:
• oui (18)
• non (2)
6
Enquête: quelques résultats
Discours sur le territoire dans l’expérience de migration
Itinéraire résidentiel et expérience de séjour (20)
• Connaissance préalable de Havelock:
• aucune (14)
• Visite ou bref séjour (6)
• Attache familiale (0)
Motivations de départ (20 ménages)
Désir d’espace et d’isolement«La vraie pauvreté dans notre société, c'est le manque d'espace ... À la campagne y a un élément de refuge … »
Accès à la nature«Ça serait une autre municipalité pis c'est pareil. Ce que j’apprécie le plus, c'est la nature qui est partout. »
Expérimentations/projets«On cherchait un endroit pour jardiner, pour s'occuper un p'tit peu de la forêt, pour planter, nettoyer … Ici, j'ai des projets pour 50 ans.»
Discours sur le territoire dans l’expérience néorurale
Qualités de l’emplacement recherché (20 ménages)
S’établir en milieu agricole, en marge des secteurs touristiques«On cherchait là où il y avait de la forêt, des terres agricole... On cherchait la beauté. Qu'il y ait des gens qui habitent là depuis longtemps. Un endroit où les gens travaillent.»
«People work here, it's a living piece of country. I think that is something significant... People here, coming here to work, or live...
Discours sur le territoire dans l’expérience néorurale
- Lieux de réminiscence, d’isolement, d’expérimentation et de rapprochement à la nature
- Un désir d’améliorer sa qualité de vie
- Les nouveaux ruraux s’attachent davantage à l’idée de s’établir en territoire rural plutôt qu’à l’idée de s’inscrire dans un nouveau réseau de sociabilité (d’interconnaissance)
Constats: nouvelles « manières d’habiter » en milieu rural
Valorisations distinctes à propos:
1.du rapport d’appartenance au rang;
2.de l’interconnaissance et du rapport à la communauté;
3.des dimensions qualitatives du territoires.
Quelques éléments de tensions
1. Valorisation distincte du rang
Des anciens:
«Chaque voisin qui part, qui déménage, qui vend sa terre, pour moi c'est un tiroir qui se ferme. C'est comme une cassette qu'yest finie.»
« Quand une place est à vendre, c'est quelqu'un de l'extérieur qui achète. Notre communauté n’est plus la même.»
Quelques éléments de tensions
7
2. Valorisation distincte de l’interconnaissance
Un ancien:«On ne connaît plus nos voisins. Je ne sais pas d’où ils viennent. […] On ne se parle pas! On ne se rencontre pas!.»
Un néo:« Quand je suis chez moi, je veux avoir la paix. J’ai assez d’amis. Je n’ai pas besoin de mes voisins! […] Ma maison me sert de refuge ».
Quelques éléments de tensions
3. Valorisation distincte des qualités du territoire
Un ancien:« C'est sûr que si seulement des gens de la ville se ramassent en campagne, il va peut-être y avoir moins de culture. Ça va peut-être devenir juste des endroits pas cultivés, des belles places entretenues autour de la maison, mais que la terre elle a poussé en branches. »
Un néo:«Ils prennent la nature pour acquis. Ils coupent, ils saccagent. Ils pensent que c'est sans conséquence.»
Quelques éléments de tensions
Vis-à-vis l’expansion de certains modes de production agricole (ex.: élevage porcin, grande culture fortement dépendante d’intrants chimiques, etc.) – producteurs non résidants (itinérants)
Vis-à-vis du développement résidentiel incontrôlé … et de l’arrivée en trop grand nombre de résidants d’origine urbaine
Des préoccupations partagées face au devenir du territoire Constats de recherche (1998-2002)
1. Incite à repenser les différents segments de populations au-delà des binômes traditionnels (rural/urbain; agriculteur/non agriculteur);
2. Suggère de mettre l’accent sur les valorisations socialesentretenues envers le territoire plutôt que sur l’origine des individus… afin de dépersonnaliser les débats;
3. Il s’agit moins de savoir qui est rural mais de chercher à comprendre comment on est rural (Mormont et Mougenot, 2002).
2 Les zones d’intensification agricole
Des paysages transformés par les mutations de l’agriculture moderne
loin de présenter les attributs des zones de déprise agricole
peu de recherches sur la manière dont la ruralité contemporaine s’y déploie
8
Étude de cas dans Lanaudière
Objectif (partiel) :Mettre à jour les éléments des paysages des zones d’intensification agricole valorisés par les populations locales et leurs motifs de valorisation
Méthodologie :46 entrevues semi-dirigées d’une heure
Échantillonnage « boule de neige »
Thèmes abordés : perception du paysage et éléments valorisés au niveau local et régional, usages du territoires
(Vouligny 2007; Vouligny et al. 2008)
Étude de cas dans Lanaudière, principaux résultats
1 est agriculteur
Ils se répartissent au sein des différents groupes d’âges et présentent des niveaux d’éducation variables12Ne s'applique pas
7Campagne hors village
18Village
9Ville
Lieu de résidence antérieure
Profils des répondants
Les néoruraux
12
16
7
2
Toute sa vie
Plus de 20 ans
10-19 ans
0-9 ans
Ancienneté de résidence sur le territoire3
1
5
24/46 sont agriculteurs
Étude de cas dans Lanaudière, principaux résultats
- Pas de différences significatives dans les valorisations entre les populations agricoles et non agricoles
Nécessité de dépasser ces dichotomies confirmées en zone d’intensification agricole
- C’est l’expérience actuelle et passée avec le territoire qui influence le plus les éléments valorisés au sein de ces paysages
serait-il possible de comparer les individus sur cette base plutôt que sur des catégories définies a priori ?
La notion de communautés de relations au territoire
- S’inspire de la notion de communautés esthétiques définies par Berléant (1994)
- Définition :
La communauté de relations au paysage regroupent des individus « qui ont une expérience commune, à travers une utilisation similaire du territoire. Les valorisations, les préoccupations et les aspirations de développement qu’ils partagent amènent les individus membres d’une même communauté à des modes similaires d’appropriation des espaces et des types semblables d’aménagement des lieux » (Poullaouec-Gonidec et al. 2003; p.12).
- Cette notion propose ainsi de regrouper et comparer les individus sur la base de leur expérience avec le territoire, de leurs valorisations et de leur vision d’avenir.
Étude de cas en Montérégie
Objectifs
- Identifier les relations que les populations locales entretiennent avec le territoire
- Mettre à jour des communautés de relation au territoire
(Ruiz et Domon 2008a, 2008b)
Étude de cas en Montérégie, territoire d’étude
- 30 km2
- Recomposition sociodémographique
- Agriculture : porc, maïs et soya dominant
- Une partie des producteurs engagés dans une démarche de restauration environnementale
9
- Approche qualitative
- 27 individus rencontrés lors d’entrevues semi-structurées de 2h (2007)
-Approche biographique du territoire autour des thèmes suivants :-Histoire du territoire et de la propriété-Perception des changements passés-Perception et usage du territoire actuel-Avenir probable et souhaité du territoire et de la propriété
Étude de cas en Montérégie, méthodologie
Opérationnalisation de la notion de communautés de relations au territoire :
- S’inspire de la construction des idéaux types en sociologie (Weber, 1965)
- Prend appui sur le cadre théorique pour identifier les dimensions des relations au territoire
Étude de cas en Montérégie, méthodologie
Typologie des relations avec le
territoire
Typologie des communautés de relations avec le
territoire
Éléments valorisés et dévalorisésMotifs de valorisationsPratiques associées
Étude de cas en Montérégie, méthodologie
Éléments et attributs du
territoire valorisés
Relations avec le territoire
Lecture décontextualisée
du corpus de données
Lecture contextualiséedu corpus de
données
Phase d’analyse 1
Phase d’analyse 2
Étude de cas en Montérégie, résultats
- 17 / 27 vivent sur une ferme
- Ancienneté de résidence sur le territoireToute sa vie 11De 20 à 30 ans 12De 10 à 20 ans 3De 5 à 10 ans 0Moins de 5 ans 1
- Lieu où l’individu a passé la majorité de sa vieSur le territoire 16Autre région rurale agricole 4Autre région rurale forestière 1En milieu urbain 6
Profil des répondants
Étude de cas en Montérégie, résultats
- 2 vivent sur une ferme
- souvent implantés depuis plus de 20 ans
- seul un ne possédait pas de lien avec l’agriculture
Profil des néoruraux- total : 6
Profil des répondants
Étude de cas en Montérégie, résultats
Profil des néoruraux
Motifs d’implantation
Profil des répondants
- Rapprochement familial
- Agrandir l’espace domestique tout en demeurant à proximité de la ville (emploi et services)
« Nous on habitait en ville pis on voulait avoir du terrain, de l’espace... c’est ça qui nous a amené à la campagne... mais moi je suis née à la campagne... fais que j’avais déjà une idée... c’était pour avoir de l’espace, du grand air... pis on est pas tellement loin de la ville... Je voulais avoir un jardin, je voulais avoir des plantes... ici j’ai tout ca... »(ENT6)
- Présence de vieux bâtiments sur la propriété
10
Étude de cas en Montérégie, résultats
Comparaison avec les motifs d’implantation des ruraux
Profil des répondants
- Idem
- Manque de moyen financier pour aller ailleurs« On se cherchait un emplacement en campagne parce que mon mari il a des
chevaux... mais ici y’a rien qui nous a attiré... c’est juste ce qu’on a pu trouver dans nos moyens. »
3 Bilan et synthèse : une ruralité plurielle
3.1 L’importance du paysage
Le paysage est bel et bien un facteur de recomposition
L’implantation ne se fait pas également partout sur le territoire
Certaines situations (secteurs présentant des attraits immédiatement saisissables : vue, caractère boisé, naturel) sont soumises à des pressions significatives (risque perçu autant par les néo que par les locaux)
Les secteurs qui ne présentent pas de tels attraits risquent une certaine forme de dévitalisation
3.2 Des valorisations et des préoccupations communes
Les antagonismes sont souvent magnifiés par des a priori et des généralisations
Or, néoruraux et locaux, agriculteurs et non-agriculteurs partagent des valorisations et des préoccupations communes (ex.: avenir des communautés)
Bibliographie sélective
Domon G, Beaudet G, Joly M (2000) Évolution du territoire laurentidien, caractérisation et gestion des paysages. Éds. Isabelle Quentin, Montréal
Paquette S, Domon G (1999) Agricultural trajectories (1961-1991), resulting agricultural profiles and current sociodemographic profiles of rural communities in Southern Quebec (Canada) : a typological outline. Journal of rural studies 15:279-295
Paquette S, Domon G (2000) Le paysage comme agent de recomposition des communautés rurales du sud du Québec. Nouvelles possibilités, nouvelles exigences. In: Carrier M, Côté S (eds) Gouvernance et territoires ruraux. Élements d'un débat sur la responsabilité du développement, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, pp 190-222
Paquette S, Domon G (2001a) Rural domestic landscape change : a survey of the residential practices of local and migrant populations. Landscape Research 26:367-395
Paquette S, Domon G (2001b) Trends in rural landscape development and sociodemographic recomposition in southern Quebec (Canada). Landscape and urban planning 55:215-238
Paquette S, Domon G (2003) Changing ruralities, changing landscapes: exploring social recomposition using a multi-scale approach. Journal of rural studies 19:425-444
Paquette S, Domon G, Roy L (2004) De l'agricole ...au paysage. Anciennes et nouvelles frontières socio-spatiales dans la recomposition des espaces ruraux du sud du Québec. In: Arlaud S, Jean Y, Royoux D (eds) Rural-urbain, nouveaux liens, nouvelles frontières, Presses universitaires de Rennes, Rennes, pp 213-224
Poullaouec-Gonidec P, Domon G, Saumier G et al (2003) Caractérisation des valorisations du littoral métissien. Rapport de recherche, Chaire en paysage et environnement, Université de Montréal, Montréal
Poullaouec-Gonidec P, Tremblay F, Chouinard B et al (2001) Développement d'une approche de prise en compte des enjeux de paysage soulevés par les dérivations de rivière à l'aide du cas de la dérivation partielle Cabonga-Dozois. Rapport déposé à Hydro-Québec, Chaire en paysage et environnement, université de Montréal, Montréal
Roy L, Paquette S, Domon G (2005) La campagne des néoruraux : motifs de migration, territoires valorisés et usages de l'espace domestique. Recherches sociographiques XLVI:35-65
Ruiz J, Domon G (2005a) Integrating physical and human dynamics in landscape trajectories: exemplified at the Aulnages watershed (Québec, Canada). . In: Tress B, Tress G, Fry G et al (eds) From landscape research to landscape planning: Aspects of integration, education and application, Wageningen UR Frontis Series, Volume 12, Springer, Dordrecht Wageningen pp 67-81
Ruiz J, Domon G (2005b) Les paysages de l’agriculture en mutation. In: Poullaouec-Gonidec P, Domon G, Paquette S (eds) Paysages en perspective, Presses de l’université de Montréal, série « Paysages », Montréal, pp 47-97
Ruiz J, Domon G (2008a) Land change trajectories within areas of intensive agricultural use and their effects on the multifunctional character of landscapes . Soumis à Landscape Ecology
Ruiz J, Domon G (2008b) Relationships with landscapes of the rural dwellers in intensive agricultural areas : case study in Québec (Canada). En préparation pour Journal of Rural Studies
Vouligny É, Domon G, Ruiz J (2007) Assessment of ordinary landscapes by expert and lay people: landscape values in areas of intensive agricultural use. Soumis à Land Use Policy