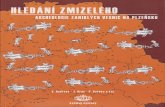Indices de mobilité au Premier Age du fer, au sud et au nord des Alpes
ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES DU NORD
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES DU NORD
2
ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES FRANCAISES
DU NORD DU NÉOLITHIQUE AUX AGES DES MÉTAUX
Aimé BOCQUET
De nombreux documents archéologiques sont cités sans détail dans le texte ou les notes; la liste
n'en est pas exhaustive. Des inventaires plus complets, comme la bibliographie, sont consultables
sur le site Web : http://aimebocquet.perso.sfr.fr/
ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DES ALPES FRANCAISES DU NORD
AU NEOLITHIQUE ET AUX AGES DES METAUX
par Aimé Bocquet*
Résumé: Le peuplement des Alpes du Nord françaises est déterminé par le relief, les
voies naturelles de circulation et la position de la région entre Suisse, plaine du Pô et vallée du
Rhône. Le Néolithique ancien est peu représenté par quelques communautés de chasseurs en voie
de néolithisation depuis le Rhône supérieur au Nord et les civilisations méridionales au Sud, dès
5300/5200 BC.
Au Néolithique moyen les premières colonisations de territoires vierges arrivent du Sud
(Civ. chasséenne) et de Suisse (Civ. de Cortaillod). Un domaine alpin d'altitude se crée en haute
Maurienne et haute Tarentaise directement relié au Val d'Aoste et au Val de Suse par les cols,
sous l'influence des "Cortaillod" établis en Valais sur le haut Rhône pour exploiter les roches
vertes destinées aux haches polies. Au Néolithique final, le même partage entre influences
méridionales (Néolithique récent méridional) et helvétiques (Néolithique récent rhodanien) se
manifeste avec la conquête de nouveaux territoires.
Les premiers bronzes sont issus de la civilisation du Rhône au Bronze ancien puis de la ci-
vilisation des Tumulus au Bronze moyen sans qu'il y ait de véritable production locale. Celle-ci
apparaît avec la lente et progressive imprégnation technique et culturelle issue de l'Europe
moyenne, de Suisse, de France orientale et d'Italie au Bronze final. Les Alpins ont alors des pro-
ductions métalliques originales, souvent influencées par les contacts avec l'Italie qui complètent
celles des nouveaux ateliers installés au bord des lacs.
* Centre de Documentation de la Préhistoire alpine. 53 rue du Drac, 38000 Grenoble.
3
A la fin du Bronze final se met en place une métallurgie spécifique en altitude dans les
Hautes-Alpes. Puis se placent les premières atteintes hallstattiennes avec soit l'installation de
"colonies" sur le Buech et la Durance dans les Hautes-Alpes, soit la prise de contrôle du com-
merce transalpin par les hautes vallées et les cols; les indigènes profitent de ce trafic qui les enri-
chit et facilite la création d'une véritable civilisation alpine originale, fondée sur le bronze et les
productions locales à la fin du 1er âge du Fer. Les Gaulois ne poursuivent pas, au 2ème âge du
Fer, l'utilisation des cols mais les Alpins conserveront leur originalité et leur puissance qui fera
obstacle à la pénétration romaine jusqu'à Auguste.
La protohistoire des Alpes est marquée par trois stades majeurs: la néolithisation au Ve
millénaire et la création d'un peuplement alpin d'altitude en Savoie lié à la fabrication des haches
polies, la généralisation du bronze à la fin du IIe millénaire et l'incorporation des Alpes à la vie
économique européenne à partir du VIIe siècle, favorisant la naissance d'une civilisation alpine
originale. Ces stades s'accompagnent de modifications techniques mais aussi et surtout de
changements dans les mentalités, les statuts sociaux et la maîtrise du territoire.
Abstract Les Alpes du Nord montrent une grande originalité tant par la nature variée du
territoire que par la qualité des hommes qui ont su s'y adapter et les soumettre à leurs besoins.
Les communications transalpines facilitées par la disposition des vallées et des cols ont rendu la
barrière des montagnes perméable au trafic et aux influences, en particulier avec le versant ita-
lien.
Cinq millénaires ont été nécessaires pour que les hommes s'implantent complètement
dans les Alpes du Nord. Le début de la néolithisation a affecté, dès 5300/5200 BC, seulement
quelques communautés mésolithiques acculturées par le nouveau mode de vie, suivant deux axes
de pénétration: la région septentrionale touchée par le courant venu de Suisse qui s'arrête entre
les latitudes de Chambéry/Grenoble et les influences du Midi remontant un peu plus vers le Nord.
Une véritable colonisation affecte l'Ouest des massifs internes, au Néolithique moyen, due
aux Chasséens et aux Cortaillod, ceux-ci ne franchissant pas vers le Sud la limite déjà définie: la
province de Savoie se distingue déjà du Dauphiné.
La conquête des hautes vallées savoyardes, à l'est, s'est effectuée à partir du versant italien
par les Cortaillod venus du Valais et porteurs du rite funéraire en coffre Glis-Chamblandes; une
communauté homogène de montagnards occupe les régions placées à cheval sur la frontière pour
exploiter les roches vertes nécessaires à la fabrication des haches polies très largement utilisées
dans le Sud-Est de la France, en Suisse occidentale et en Italie.
4
Pendant le IIIe millénaire, au Néolithique récent, le courant nord helvétique et le courant
Sud méditerranéen se manifestent encore, affirmant plus fortement la différence Dauphiné-Sa-
voie.
L'apparition du bronze marquera la fin du courant méridional car les centres métallurgi-
ques et les civilisations qui les nourrissent sont issus de la Suisse rhodanienne puis de l'Europe
moyenne. Leur puissance et leurs nouveautés techniques s'imposeront d'abord par la diffusion
commerciale des produits finis puis par une expansion des idées, des savoir-faire ou/et des
peuples à la fin de l'âge du Bronze. La société en petites communautés rurales à statut néolithique
aura disparu définitivement avec l'apparition de nouvelles techniques métallurgiques et cé-
ramiques diffusées dans toute la région à partir du XIVe siècle; ce changement s'accompagne
l'organisation du territoire par les premiers "princes", contrôlant les productions diverses et le
trafic entre l'Europe occidentale et le monde méditerranéen.
Les Hallstattiens s'installeront ensuite dans l'avant-pays laissant les Alpins se développer
dans les montagnes tout en restant maître du commerce et du trafic transalpin. Les Gaulois les
remplaceront dans leur contrôle du territoire en abandonnant l'usage des grands cols après leur
expulsion de la plaine du Pô.
Les Alpins seront des bronziers tant à l'extrême fin de l'âge du Bronze dans les Hautes-Al-
pes que durant tout l'âge du Fer où prennent naissance dans chaque vallée interne des groupes
culturels et techniques originaux. Ces différences entre plaines et montagnes perdureront plus de
deux millénaires puisque les arts et les traditions populaires nous les illustraient encore il y a
moins de cent ans.
La protohistoire des Alpes est marquée par trois stades majeurs: la néolithisation au Ve
millénaire et la création d'un peuplement alpin d'altitude en Savoie lié à la fabrication des haches
polies, la généralisation du bronze à la fin du IIe millénaire et l'incorporation des Alpes à la vie
économique européenne à partir du VIIe siècle, favorisant la naissance d'une civilisation alpine
originale. Ces stades s'accompagnent de modifications techniques mais aussi et surtout de
changements dans les mentalités, les statuts sociaux et la maîtrise du territoire.
5
AVANT-PROPOS
Le passé est présent; il s'insinue dans le temps
où nous sommes en y déployant ses effets. Jean-Paul II
Les documents dont nous disposons aujourd'hui pour écrire la préhistoire des Alpes sont,
pour beaucoup, des trouvailles anciennes rassemblées entre 1840 et 1960 par des érudits locaux
et autres collectionneurs. Ceux-ci, conscients de la valeur du patrimoine et par esprit civique, ont
récolté ou acheté ces témoins aujourd'hui si précieux; tous n'étaient pas de grands savants mais il
faut rendre hommage à leur oeuvre de sauvegarde. Ces découvertes ne sont pas accompagnées de
leur contexte archéologique mais elles gardent la force d'un témoignage irremplaçable. Issues des
travaux agricoles ou des aménagements faits à la pelle et à la pioche, elles furent plus nombreu-
ses malgré le faible volume de terre remué, que celles livrées par les fouilles et les terrassements
depuis cinquante ans1. On frémit à la pensée de ce qui a été perdu ainsi des traces de notre passé,
en particulier depuis que les "amateurs" bien implantés dans les régions, véritables rabatteurs de
l'archéologie, disparaissent peu à peu2. Cet aspect négatif sera atténué par une archéologie nou-
velle qui naît à la faveur des travaux d'aménagements du territoire; des problématiques renouve-
lées et des examens du terrain sur de grandes longueurs permettent la mise en évidence des sé-
quences d'occupation3 et l'évolution géo-morphologique des terroirs en fonction de l'anthropisa-
tion.
Les cartes de répartition matérialisent l'origine et l'expansion des peuplements, la diversité
des cultures et leurs évolutions de manière synthétique. En pays de montagne les sites en grotte,
qui ont été particulièrement exploités, offrent des stratigraphies d'occupations, souvent temporai-
res, dont le matériel n'illustre pas toutes les activités d'un habitat normal mais qui est culturelle-
ment significatif. Les régions calcaires peuvent sembler ainsi sur-représentées par rapport aux
stations de plein air où les conditions liées au relief amènent des sédimentations qui les cachent
ou des érosions qui les ont fait disparaître. La rareté des sites est donc parfois trompeuse, ne cor-
respondant pas à la réalité: à Charavines par exemple, les pollens attestent une présence humaine
autour du lac de Paladru à partir du Néolithique moyen alors que seul un site du Néolithique ré-
1 Deux exemples: nous connaissons 5 dépôts d'objets de bronze découverts avant 1850, 29 entre 1850 et 1900, 17 entre 1900 et
1960 et seulement 3 depuis 1960; 92% des 500 trouvailles de haches polies isolées ont été faites avant 1960... 2 Les connaissances acquises depuis 30 ans sont l'oeuvre, pour une bonne part, de non professionnels bénévoles auxquels je désire
rendre un hommage particulier: J.Bellet, P.Benamour, M.Billard, Y.Billaud, B.Caillat, R.Castel, G.Chaffenet, R.Chemin, J.Clerc,
J.C.Daumas, P.Dufournet, J.P.Ginestet, A.Héritier, M.Hudry, R.Laudet, R.Laurent, P.Lequatre, M.Malenfant, A.Muret, P.Persoud,
R.Picavet, A.Piccamiglio, G.Pion, M.Pons, J.Prieur, B.Reffienna, M.Rossi, J.Ulysse, etc. 3 L'exemple récent de la Valdaine et du Tricastin dans la Drôme est significatif avec la découverte de 70 sites, dont seulement 5 en
surface, sur la tracé du T.G.V.
6
cent a été découvert. Les cartes reflètent aussi la dispersion inégale des chercheurs... Malgré les
lacunes et les imperfections, nous disposons pourtant de suffisamment d'informations pour que la
cartographie soit un élément primordial de compréhension de la dynamique du peuplement
comme des modalités des échanges.
La variabilité géographique, géologique et climatique des pays de montagne intervient sur
la nature et l'évolution techno-culturelle des groupes humains, parfois très morcelés ou isolés par
le relief. Contrairement à ce qui se passe dans les régions largement ouvertes et sans contrainte
de relief, en montagne les entités géographiques sont multiples (Fig. 2), quelquefois peu éten-
dues: elles correspondent toujours à des entités culturelles et humaines différenciées. Pour les
reconnaître, ici plus qu'ailleurs, il est nécessaire d'examiner avec une grande attention le matériel
archéologique qu'il soit issu des productions locales, touchées ou non par les influences extérieu-
res, ou que ce soient des importations d'objets finis. Ainsi se dégage une dynamique du peuple-
ment, de ses changements et de ses originalités avec l'arrivée de quelques hommes, de migrants
ou seulement par acculturation de voisinage. La présence soudaine et abondante d'un matériel
nouveau a une autre signification que celle de quelques pièces "étrangères" qui marquent des
rapports "commerciaux" ou des "dons courtois" sans obligatoirement s'accompagner de modifi-
cations du substrat technique ou culturel. Une copie locale où se perçoivent des caractères exo-
gènes inconnus jusqu'alors, va plus loin car elle assimile des influences qui modifient plus ou
moins les traditions et les habitudes et qui peuvent varier d'une région à l'autre.
Parmi les contacts entre les hommes tous n'ont pas la même nature donc le même impact
ni la même portée; les différences existant entre migration ou acculturation, importation ou in-
fluence et tous autres degrés intermédiaires doivent être examinées sous un angle de vue histori-
que large, replacées dans le contexte régional ou européen. Pour comprendre ces nuances, gar-
dons à l’esprit les formes diverses que prennent les rapports entre les peuples, les nations ou les
continents: colonisation ou conquête, mainmise industrielle ou recherche des marchés commer-
ciaux, exploitation de ressources lointaines, domination territoriale, culturelle ou politique, etc.
Comparer les comportements d'hier à ceux d'aujourd'hui est toujours profitable pour pénétrer les
processus historiques en évitant les schémas simplistes. Par contre le monde matériel que nous
cotoyons diffère tant de celui de la préhistoire que nos préjugés intellectuels de citadins défor-
ment trop souvent notre compréhension d'un passé fondé sur des techniques et des mentalités ru-
rales dont le souvenir, déjà très atténué aujourd'hui, s'effacera de plus en plus. C'est un écueil
toujours difficile à éviter.
Les Alpes souffrent de la rareté des fouilles et des analyses pluridisciplinaires dans
de grands sites, études nécessaires pour affiner la chronologie, mieux comprendre les processus
7
du peuplement, l'évolution et la diffusion des techniques. Ainsi l'exploitation moderne de quel-
ques stations littorales lacustres serait fondamentale pour l'avancement de notre savoir; mis à part
quelques sondages et des analyses dendrochronologiques, la seule exploitée quasi exhaustive-
ment fut celle de Charavines. Nous n'oserons donc pas comparer, pour le Néolithique et l'âge du
Bronze, nos résultats à ceux obtenus par nos collègues suisses en particulier. La documentation
sur les Alpes du Nord Est encore bien incomplète4 par rapport à d'autres régions mis à part la
connaissance des environnements végétaux et climatiques qui commencent à être bien maîtrisés
tant en plaine qu'en altitude. L'espoir est de voir s'étoffer une politique cohérente de recherches
d'envergure, d'inventaires systématiques et d'analyses qui doivent affecter les anciennes tout
comme les nouvelles découvertes.
Le professeur H. de Lumley a désiré un bilan synthétique des cinq derniers millénaires av.
J.C. dans les Alpes du Nord françaises pour lequel une longue pratique des Alpes, de son terri-
toire comme de son patrimoine préhistorique m'a permis de ressortir des documents significatifs,
négligés ou oubliés. En les incorporant aux plus récentes découvertes, des interprétations fondées
sur la connaissance de la vie et des traditions rurales susciteront la réflexion et soulèveront des
questions auxquelles l'avenir devra répondre5. Je reste toutefois conscient des aléas d'une telle
entreprise qui tente de retracer l'histoire des hommes et de leur génie pendant 5000 ans dans un
espace a priori ingrat et peu accueillant, sans oublier que "ce que nous appelons histoire est un
récit imaginaire fondé sur quelques vestiges reconstituant pour l'esprit une réalité qui n'a pas
existé, telle quelle, en soi" (Georges Minois).
LES ALPES
L'originalité des Alpes tient dans leur morphologie aux multiples aspects, et dans les ré-
ponses qu'ont donné les hommes aux contingences du climat et du relief. Ce sont ces réponses
accumulées au fil des siècles qui constituent une civilisation particulière dont il est possible de
retrouver encore aujourd'hui bien des caractères dans nos montagnes, la civilisation alpine.
4 En particulier dans les Hautes-Alpes où la céramique est pratiquement absente des anciennes collections qui ont privilégié silex et
bronzes comme se fut souvent le cas ailleurs. 5 Les Actes du colloque de Clermont-Ferrand publiés en 1996 ont fait le point sur l'âge du Bronze ancien en Europe. Plusieurs
"spécialistes" ont dressé des cartes de répartition d'objets significatifs de la Civilisation du Rhône: deux exemples me fortifient dans
la nécessité d'un tel bilan. Pour les points de découverte de poignards à manche massif dans les Alpes du Nord, seulement six sur
onze sont indiqués, pour ceux des haches de type Neyruz huit sont mentionnés et sept manquent. Tout commentaire est superflu...
8
LE CADRE GEO-MORPHOLOGIQUE (Fig. 1)
La région est limitée par le Rhône au Nord, les abords du couloir rhodanien à l'Ouest et la
frontière franco-italienne à l'est. Vers le Sud elle s'arrête à la frontière du Dauphiné et de la Pro-
vence, à la latitude de Sisteron où commencent les régions méditerranéennes. En plus, souvent
référence sera faite au versant oriental des Alpes, Piémont et Val d'Aoste, à cause de son rôle
dans la genèse de certaines occupations et de multiples influences.
Par la variété des sols et des reliefs, les vallées et les pentes alpines ont offert aux hom-
mes un pays aux multiples possibilités avec ses terrains cultivables, ses zones de refuge, ses voies
de passage et de pénétration. Les ambiances climatiques aussi conditionnent les implantations et
les ressources alimentaires; elles ont changé suivant l'époque, l'altitude et les versants, sur un es-
pace souvent très restreint permettant la coexistence d'économies diverses, donc de populations
aux traditions différentes. L'observation du monde alpin, des habitats et des terroirs, nous mon-
trait il y a encore peu de décennies les parties du territoire qui ne pouvaient pas être occupées en
l'absence d'infrastructures lourdes: abords des rivières dont l'impétuosité imprévisible et non
maîtrisable ravine ou alluvionne au gré des crues, zones soumises aux éboulements ou aux ava-
lanches, etc. L'évidence du milieu montagnard, varié et contraignant, doit rester à l'esprit pour
comprendre la mise en place et l'évolution du peuplement, ses changements et ses stagnations,
forçant l'homme à faire preuve de beaucoup d'imagination et de courage dans des conditions de
vie difficiles.
L'installation et le développement des communautés étant directement liés à la géographie
et à la géologie, il est indispensable d'en connaître les grands traits avant une approche archéolo-
gique. Les Alpes françaises du Nord peuvent être schématisées en trois grands blocs structuraux
allongés en arc de cercle suivant une direction Nord-Sud, depuis le lac Léman jusqu'à la haute
Provence (Fig. 2).
- Une zone montagneuse occidentale, calcaire, de largeur variable, avec du Nord au Sud
les massifs du Chablais, des Bornes, des Bauges, de Chartreuse, du Vercors, du Dévoluy et du
Diois, d'altitude moyenne. Ces massifs préalpins dominent vers l'Ouest les plateaux peu élevés de
piedmont, molassiques et quaternaires qui constituent les marges du sillon rhodanien: le Gene-
vois et le plateau savoyard, le Nord et le Bas-Dauphiné et la plaine de la Drôme.
- Une zone montagneuse orientale d'altitude plus grande, constituée de roches granitiques
et métamorphiques avec les massifs dits "centraux" du Mont-Blanc, de Belledonne, de l'Oisans et
du Pelvoux; elle se poursuit vers l'Est avec les massifs complexes et tourmentés de la zone
9
"briançonnaise" de la Vanoise, du Queyras et de l'Ubaye. Plus à l'est, les Schistes lustrés se déve-
loppent surtout sur le versant italien à partir de la ligne de crêtes, mise à part la très haute vallée
de l'Arc où ces schistes arrivent à Modane.
- Ces deux masses montagneuses, orientale et occidentale, sont séparées par une dépres-
sion orientée grossièrement Nord-Sud, plus ou moins large, plus ou moins marquée, le "sillon al-
pin" occupé par les grandes rivières (Arly, Isère, Drac) avec la Combe de Savoie, le Grésivaudan,
le Trièves. Ce sillon structural se poursuit à partir du Dévoluy par les vallées du Buech et de la
Durance.
10
Fig. 2. Carte des Alpes du Nord (Map of Northern Alps).
Cols transalpins: 1. Grand-Saint-Bernard, 2469m (entre Rhône et Doire Baltée); 2. Petit-Saint-Bernard,
2188m (entre Doire Baltée et Isère); 3. Montcenis, 2083m (entre Doire Ripaire et Arc); 4. L'Echelle,
1791m (entre Clarée et Doire Ripaire); 5. Mont-Genèvre, 1850m (entre Durance et Doire Ripaire et Chi-
sone); 6. La Croix, 2600m (entre Guil et Pellice); 7. Longet, 2646m (entre Ubaye et Varaïta); 8. Larche,
(1995):m (entre l'Ubaye et la Stura di Desmonte).
Cols entre régions alpines occidentales: 9. Vanoise, 2515m (entre Tarentaise et Maurienne); 10. Glan-
don, 1908m (entre Maurienne et Oisans); 11. Lautaret, 2051m (entre Oisans et Briançonnais). 12. Bayard,
1246m (entre le Drac et Gapençais); 13. Lus-la-Croix-Haute, 1176m (entre Trièves et le Buëch); 14. Ca-
bre, 1180m (entre la Drôme et le Buëch); 15. Saulce, 1180m (entre Nyons et le Buëch).
En gros pointillé: le Sillon alpin. En petit pointillé: frontière franco-italienne (ligne de partage des eaux) et
franco-suisse.
Les massifs centraux et préalpins sont morcelés transversalement par de profondes vallées
ou des dépressions dont l'importance est évidente pour la pénétration des hommes, à l'intérieur
des massifs et même pour l'accès au versant oriental, vers l'Italie. Ces entailles dans les Préalpes
sont les cluses de l'Arve, d'Annecy-Faverges, de Chambéry-lac du Bourget, de Voreppe-Grenoble
puis les vallées de la Drôme, de l'Aygue et de l'Ouvèze. Dans les zones orientales, les hautes val-
lées de l'Isère, de l'Arc, de la Romanche, de la Durance, du Guil et de l'Ubaye forment la Taren-
taise, la Maurienne, l'Oisans, le Briançonnais, le Queyras et l'Ubaye, toutes régions ouvertes sur
le Val d'Aoste et le Piémont par les grands cols transalpins. De plus ces vallées sont toujours en
relation Nord-Sud par des cols, ce qui facilitera les échanges intra-alpins.
Le versant italien ne comporte que des vallées qui coupent les massifs schisteux suivant
un axe grossièrement est-Ouest, massifs qui s'arrêtent brusquement sur la plaine padane par quel-
ques moraines et collines molassiques. Les plus importantes sont le Val d'Aoste, le Val de Suse,
le Val Chisone, le Val Pellice, le Val du Pô, le Val Varaïta... Toutes aboutissent aux cols vers la
France et leur occupation est en général cantonnée aux thalwegs et à leurs abords immédiats; seul
le Val d'Aoste offre plusieurs vallons latéraux (Valtournanche, Valgrisanche, etc.) qui augmen-
tent les possibilités d'habitat et de ressources vivrières. Mais ces vallées transversales, séparées
par de hautes barrières montagneuses, ne communiquent pas entre elles ou très difficilement.
Les Alpes offrent aux hommes la variété de leurs vallées et de leurs montagnes pouvant
servir de refuge et de voies aux influences et aux hommes, voies plus ou moins aisées mais tou-
jours praticables aux marcheurs patients et courageux, tels que devaient l'être nos ancêtres
d'avant l'histoire.
LA CONQUETE DE LA MONTAGNE
Le progrès nous fait trop souvent oublier ce que devait être la vie en montagne avant les
réalisations techniques modernes que n'ont pas connues nos arrière grands-parents. On se de-
11
mande parfois quelles raisons économiques ou humaines ont poussé les hommes, dans les temps
les plus anciens et malgré toutes les difficultés, à la mise en valeur des terres d'altitude élevée.
Les voies de communications
Si, pour en connaître les causes nous sommes réduits aux hypothèses (utilisation des alpa-
ges, exploitation des ressources diverses, ouverture des voies, zones de refuge, etc.), tentons au
moins d'en comprendre les mécanismes. Autrefois comme aujourd'hui, les moyens de communi-
cations sont indispensables et accompagnent toute conquête, toute mise en valeur de territoire
comme la diffusion des cultures et des techniques. Cela est particulièrement vrai en milieu mon-
tagnard où les chemins, rares et difficiles à tracer dans la complexité géographique ne sont pas
nés d'un seul coup. Les massifs ont été progressivement visités et connus, d'abord par les chas-
seurs et les pasteurs qui ont su en discerner les richesses naturelles animales, végétales et miné-
rales. Cette connaissance a ensuite permis une implantation permanente dans les sites jugés les
plus favorables au cours de siècles d'observation; ces communautés courageuses devaient prati-
quer une économie agro-pastorale susceptible de les nourrir toute l'année. La permanence de l'oc-
cupation a facilité le développement des réseaux de sentiers qui sillonnent la montagne, indispen-
sables aux déplacements des hommes et des troupeaux sur les deux versants et entre les deux
versants. En plaine les cours d'eaux, grands ou petits, sont des voies qu'il est facile de suivre pour
se déplacer, par contre en montagne les torrents ont creusé souvent des gouffres infranchissables
qu'il est nécessaire de contourner; les possibilités de remonter les vallées ou d'aller d'une vallée à
l'autre sont le résultat de l'expérience du terrain qui s'est transmise de génération en génération.
Bien que l'occupation des diverses zones montagneuses n'ait pas été simultanée, le processus en
fut toujours le même, à toutes les époques.
Habitat et société
Les villages actuels sont pour la plupart dans la continuité des habitats anciens autour et à
l'intérieur desquels se retrouvent tombes ou vestiges. Les maisons6 occupent les meilleurs empla-
cements: bonne exposition au soleil, abrités du vent, hors des couloirs d'avalanches, sur des ter-
rains non sujets à des glissements et environnés de terres cultivables. Quand les villages sont im-
plantés en fond de vallée ils occupent un cône de déjection surélevé et ailleurs ils sont disposés
sur les replats et les vallons latéraux, au-dessus des talwegs. Cette nécessité des terrains sûrs et
exploitables explique que les basses vallées, trop encaissées et sans dégagements latéraux, de
l'Arc, de l'Isère ou de la Romanche sont restés longtemps inoccupés.
6 En bois édifiées sur soubassement de pierres comme le montent des fouilles suisses et des figurations du Val Camonica
13
Fig. 3. Tableau chronologique des Alpes du Nord.
D'après (After) Bintz P., Bocquet A., Borel J.L. et Olive P. (1989):, modifié par l'auteur.
En pays de montagne la structure sociale de la communauté doit être "organistique", c'est
à dire comporter tous les corps de métier, toutes les spécialités élémentaires pour assurer au vil-
lage une autonomie complète ou quasi complète à toute époque de l'année; ce qui n'empêche pas
des productions destinées à la vente. En plaine où contacts et déplacements des hommes et des
marchandises sont plus aisés en toutes saisons dans un tissu commercial complexe, des commu-
nautés peuvent se consacrer à des artisanats spécialisés en fonction des savoir-faire et des goûts;
cela est moins vrai en montagne où la polyvalence des activités et des talents est une règle d'or.
Economie
L'économie vivrière des peuples alpins était d'une part fermée et autonome et d'autre part
elle ne donnait pas lieu à des surplus importants capables d'encourager des échanges au-delà d'un
trafic local réduit. Les besoins étaient satisfaits entièrement sur place par la chasse, la cueillette,
la culture et l'élevage, le bois fournissant le matériau des maisons et aussi celui de nombreux
outils et ustensiles dont l’archéologue ne trouve plus trace. Pourtant cette autonomie économique
n'engendrait pas l'isolement. Qu'ils échangent ou non leurs productions spécifiques avec les ré-
gions alentour les Alpins sont toujours restés en contact avec elles, recevant sans retard les in-
fluences et les techniques nouvelles; ils les ont assimilées sans pour cela changer leur mode de
vie fondamental parfaitement adapté aux conditions contraignantes du milieu montagnard.
Si dans l'avant-pays alpin, en zone de plaine ou de faible relief, économie agricole et éco-
nomie pastorale peuvent s'exclure en se développant chacune dans des terroirs différents, il n'en
est pas de même au coeur des montagnes où elles sont complémentaires dans une économie né-
cessairement agro-pastorale. L'agriculteur a besoin de l'animal pour sa nourriture mais aussi
comme bête de bât en terrain accidenté. Très important encore est l'appoint indispensable que
l'animal apporte au chauffage hivernal soit par cohabitation dans une pièce commune, soit pour
le combustible formé par les excréments séchés utilisés quand l'habitat est au-dessus de la limite
de la forêt.
Leur connaissance intime du terrain a permis aux montagnards la découverte et l'exploita-
tion des ressources minérales quand celles-ci ont été nécessaires à la fabrication des outils en si-
lex, en roches dures ou à la métallurgie: ces ressources ont pu être à l'origine d'un haut niveau de
vie comme à l'âge du Fer. En outre quand les grandes civilisations européennes ont eu besoin
d'utiliser les passages transalpins pour le commerce "international", les montagnards ont mis à
14
leur service leur pratique des chemins, leur habitude à transporter les charges et leur robustesse.
Souvenons-nous que ce sont les "gens du pays" qui ont aidé, de gré ou de force, l'armée de Bona-
parte à traverser le col du Grand-Saint-Bernard...
Le rôle important des hommes
En l'absence de textes, l'archéologie écrit l'histoire à la lumière du déterminisme de la
géographie, des climats, de l'économie et de bien d'autres contingences matérielles, plus contrai-
gnantes encore dans un environnement défavorable. Mais dans les Alpes, plus qu'ailleurs, le rôle
des hommes a été primordial pour penser et juger les événements, imaginer des réponses techni-
ques ou mentales adaptées aux situations extrêmes.
Ceci m'amène à considérer un aspect étroitement lié à la vie en montagne et aux échanges
par les voies à travers les Alpes, c'est l'existence d'un régime de paix et de solidarité entre les
communautés. Il ne fait aucun doute que la civilisation alpine était nécessairement pacifique; elle
n'a pas connu véritablement d'armes au cours de la préhistoire. Elle était fondée sur l'entraide
dans les travaux et sur le respect des droits de chacun, solidarité indispensable à la survie dans un
milieu difficile, hostile même. Cela a duré tant que les Alpins ont été les seuls maîtres de leur
destin et que les puissances politiques voisines ne leur ont pas imposé une domination liée au
contrôle et à la libre disposition des passages transalpins, c'est à dire à partir de l'époque romaine.
Le rôle des gens de la montagne commencera alors à s'effacer et d'autres profiteront des voies
qu'ils avaient ouvertes et entretenues; ils conserveront au cours de l'histoire quelques libertés en
s'isolant dans les vallons les plus reculés, isolement qui les séparera parfois des bienfaits du pro-
grès et exacerbera chez eux un conservatisme qui nous étonne mais dont ils attendaient une pro-
tection.
Cette civilisation alpine ne s'est pas seulement individualisée entre France et Italie; elle
procède des mêmes causes, a utilisé les mêmes moyens et possède les mêmes caractéristiques
générales dans tout l'arc alpin, de l'Autriche à la Méditerranée, caractéristiques encore bien vi-
vantes qui étonnent toujours le touriste citadin...
LA NEOLITHISATION ET LE NEOLITHIQUE
Nos connaissances sur la fin du Mésolithique et le début du Néolithique se sont considé-
rablement étendues depuis dix ans7. En effet la région que l'on considérait comme presque dé-
serte au cours des VIIe et VIe millénaires, se trouve avoir été parcourue par nombre de chasseurs
à outillage microlithique qui installaient leurs campements sur les cols, sur les axes de passage et
7 Avec les recherches de P.Bintz, G.Pion, R.Picavet et J.P. Ginestet
15
près des gisements de silex en Vercors, en Chartreuse et en Oisans à des altitudes le plus souvent
supérieures à 1000m. Les résultats qui s'accumulent permettront de mieux connaître le substrat
humain et culturel au moment où se prépare la néolithisation.
NEOLITHISATION ET NEOLITHIQUE ANCIEN env. 5300 à 4500 av. J.C. (Fig. 4 et 5)
Quels sont les marqueurs archéologiques de la néolithisation? Pour simplifier, le Néolithi-
que est installé quand céréales, élevage, hache polie et céramique sont réunis. Mais entre le stade
de chasseur-cueilleur exclusif et celui de paysan intégral les étapes sont longues et diverses; l'as-
sociation de quelques uns de ces éléments atteste seulement un début de néolithisation. C'est ce
qui se passe pour les Alpes au milieu de la période Atlantique.
16
Près du Rhône à Seyssel, Haute-Savoie, dans quelques stations de surface des silex de
type mésolithique étaient associés à de petites haches polies, mais sans céramiques ni faune. Un
niveau, malheureusement peu documenté, est placé vers 5350 BC à la Grande Gave, la Balme en
Savoie. Dans une couche d'occupation datée8 de 4800 BC en Haute-Savoie9, chèvre et mouton
atteignent 20% de la faune consommée, dans un contexte totalement dépourvu de céramique
mais avec une industrie à microlithes d'inspiration helvétique. Pour comparaison signalons la
couche découverte à Sion-Planta en Valais, datée de 5300 BC qui possède 95% de faune élevée
et de la céramique du Néolithique ancien valaisan.
Choranche10, en Vercors occidental, une couche de 5150 BC contient silex mésolithiques
et céréales. Tout à côté11, pas de céramique mais boeuf et porc représentent 54% de la faune, à
4940 BC. Près de Grenoble12 la date d'environ 5100 BC a été obtenue dans un niveau sans céra-
mique qui comportait chèvre et mouton. Près du lac de Bouvante en Vercors des adeptes du nou-
veau mode de vie possèdent les mêmes silex (Fig. 5, 4), une petite hache polie et de la cérami-
que. Ces groupes mésolithiques en voie de néolithisation sont porteurs généralement de la tech-
nique castelnovienne. Près du col de Lus-la-Croix-Haute, Drôme, entre la vallée du Buëch et le
Trièves13, sont associées céramique impressionnée, hache polie et une faune sauvage dominante
(cervidés, aurochs). En Diois14 de la céramique est associée à des silex mésolithiques et une cou-
che à céramique15 attribuée au Néolithique ancien est datée de 4870 BC. Dans l'industrie lithique
il y a toujours des flèches tranchantes traduisant encore la vocation de chasseurs des néolithisés.
A l'est, à limite du Gapençais et du Champsaur, aucun site n'est attribuable à cette période
mais S.Wegmüller retrouve dans les pollens de la tourbière de la Lauza, à 1130m d'altitude, des
indices de déforestation recouverts par des niveaux argileux dus à une érosion intense des sols.
On est en droit d'imaginer la création de pâtures qui seront de courte durée car les déboisements
ne reprendront qu'au Bronze final.
8 Les dates données sont de deux types: soit les dates radiocarbone calibrées par le progamme de Stuyver et Pearson, 1993 et
exprimées avec BC (ces dates n'ont pas de valeur précise mais elles ont l'avantage de fixer rapidement les idées), soit absolues et
calendaires, obtenues par la dendrochronologie; elles sont inscrites avec le signe (-). Pour plus de précision voir la liste en fin
d'article. 9 Abri de la Vieille Eglise à Balme-de-Thuy (Haute-Savoie) sur le haut Fier 10 Grotte de Couffin sur le versant ensoleillé de la vallée de la Bourne (fig. 5-3) 11 Abri de Balme Rousse voisin de la grotte de Couffin 12 Sassenage (Isère), la grotte de la Grande Rivoire s'ouvre à l'entrée des gorges du Furon vers le Vercors (fig. 5-2) 13 Grotte des Corréardes à Lus-la-Croix-Haute (Drôme) (Fig. 5-1) 14 La Motte-Chalancon et Chauvac (Drôme) 15 Le Trou Arnaud à Saint-Nazaire-le-Désert (Drôme)
17
En attendant d'être mieux éclairés le début de la néolithisation des Alpes du Nord, ces té-
moins sont déjà lourds de signification, qui voient haches polies, animaux domestiques et parfois
céramiques ou céréales associés aux petits silex habituels dans la région durant le Mésolithique.
Actuellement les gisements sont rares ce qui permet de penser que le Ve millénaire présente une
très faible densité d'occupation, avec une prédilection pour les altitudes moyennes. Selon toute
vraisemblance quelques groupes de chasseurs de tradition mésolithique ont adopté quelques par-
ties des pratiques néolithiques qui se diffusaient dans la vallée du Rhône, soit par le Nord avec le
Néolithique ancien rhodanien en Savoie, soit par l'Ouest et le Sud avec la civilisation cardiale.
Fig. 5. Néolithique ancien (Early Neolithic). env.5300 à 4500 av. J.C.
1: Céramiques à impressions et silex, Lus-la-Croix-Haute, Drôme; 2: Sassenage, Isère; 3: Choranche, Isère;
4: Bouvante, Drôme. (échelles diverses). D'après: 1: Chaffenet et 4: Héritier in Bocquet et Lagrand
1976; 2: Picavet 1991; 3: Bintz 1991.
18
Quelques manifestations de l'Epicardial apparaissent depuis peu: à la Grande Rivoire,
Sassenage, Isère, un niveau à céramique épicardiale méridionale daté de 4710 BC où l'élevage at-
teint 40% de la faune; ce faciès qui coexistera avec le début du Chasséen commence à être mieux
connu avec des gisements comme celui de Barret-de-Lioure en Diois, Drôme. Mais actuellement
il ne semble pas avoir eu un gros impact dans les Alpes.
Sur le versant italien des chasseurs à la grotte de Boira Fusca dans la vallée de l'Orco n'ont
pas de céramique mais un horizon à grands triangles, tout à fait comparable à ceux des Préalpes,
est pratiquement inconnu en Italie. Dès le Néolithique ancien des nomades néolithisés occupent
les Alpes sur les deux versants: existe-t-il un Néolithique ancien spécifique aux Alpes occidenta-
les, c'est une hypothèse qu'émet F.Fedele.
NEOLITHIQUE MOYEN env. 4500 à 3200 av. J.C. (Fig. 6 et 7)
Les groupes mésolithiques acculturés survivront-ils au cours du IVe millénaire? Rien au-
jourd'hui ne l'assure. Par contre se développera une autre forme de néolithisation représentée par
une véritable colonisation, c'est-à-dire l'implantation de communautés venues d'ailleurs. Les an-
ciens occupants ne seront pas capables de concurrencer des organisations sociales et techniques
déjà élaborées dans des systèmes économiques plus cohérents et probablement plus complexes. Il
ne faut pourtant pas exclure la possibilité de coexistence entre eux et les colons, dans un espace
suffisamment vaste pour que tous puissent y vivre longtemps selon leurs traditions, encore que
nous n'en ayons pas de preuve archéologique.
Au cours du Ve millénaire se développera dans les Alpes le mouvement lié à une hypo-
thétique poussée démographique pour rechercher de nouveaux terroirs à partir des régions médi-
terranéenne et helvétique où agriculture et élevage s'étaient mis en place dès le début du VIe
millénaire. La conquête de nouvelles terres va atteindre le piedmont des massifs alpins dont la
couverture arborée atteint son maximum à la période Atlantique. La civilisation chasséenne du
Néolithique moyen coexistera dans les régions Nord avec la civilisation de Cortaillod arrivée
plus tardivement de Suisse occidentale. Cette première colonisation constituera le début de l'oc-
cupation permanente au cours des Ve et IVe millénaires. Cette longue durée, tout comme la
rareté des sites actuellement découverts, expliquent la lenteur de l'implantation des communautés
venues du Sud et du Nord qui s'établissent chacune sur des terrains conformes à leurs traditions,
agricoles et sociales, mais dont les contacts entre elles sont indéniables.
19
Sur des territoires faiblement peuplés, la mise en exploitation est révélée par la déforesta-
tion, la présence de céréales et de plantes rudérales dans les analyses polliniques. Un exemple est
donné à Francillon, Drôme, dans le premier niveau du Néolithique moyen avec une forte et bru-
tale diminution des pollens d'arbres. Mais les cultures sur terrain essartés ne sont pas permanen-
tes et sont abandonnées après un laps de temps difficile à mesurer, probablement suivant un cycle
d'installation semi-temporaire liée à la technique du brûlis et à la fertilité des sols. Très démons-
trative est l'évolution de la végétation lors de la colonisation des coteaux orientaux du Vercors
20
près de Grenoble à Seyssinet-Pariset (Fig. 14) à la fin du IIIe millénaire. Là, à 500m d'altitude,
trois niveaux archéologiques correspondent à trois phases principales de déforestation avec pré-
sence de céréales, séparées par trois phases de reboisement traduisant un abandon de longue du-
rée. Même si, à partir de la fin du Néolithique, des abandons surviennent encore ils sont bien plus
courts, traduisant une pression démographique plus forte qui s'accentuera progressivement jus-
qu'au début du Bronze moyen.
Courant méridional et Civilisation chasséenne env. 4500 à 2700 av. J.C. (Fig. 7-A)
Depuis le Languedoc et la Provence les Chasséens suivront deux voies: celle de la Du-
rance vers les Hautes-Alpes et celle du couloir rhodanien à partir duquel des courants se dirigent
vers l'est pour emprunter les axes de pénétration que sont les cluses de l'Isère, du Rhône et de
Chambéry, s'ouvrant entre les massifs préalpins16 pour atteindre le Sillon alpin. Adaptés aux ter-
roirs ensoleillés et secs du Midi, les Chasséens choisiront des terres conformes à leurs habitudes,
c'est-à-dire des zones d'altitude moyenne ou basse, aux sols secs avec une préférence nette pour le
Sud de la région (Drôme et Hautes-Alpes). Ce n'est pas encore une colonisation de grande am-
pleur que montrent les sites possédant leur céramique bien modelée et bien cuite ainsi que leurs
outils façonnés sur lame et lamelle associés à des pointes de flèches triangulaires (Fig. 7-A).
Pour en suivre les premières péripéties on ne dispose que de quelques dizaines de gise-
ments entre la deuxième moitié du Ve et du début du IIIe millénaire; bien peu ont fourni des da-
tations. S'ils offrent du matériel attribuable au Chasséen les structures d'habitats ou les données
sur l'économie et la vie quotidienne sont plus rares actuellement dans les Alpes que dans la vallée
du Rhône où des recherches récentes les mettent en évidence.
Le Dauphiné
Dans sa partie méridionale, Diois et marges du couloir rhodanien17 sont colonisés par les
Chasséens à partir de 4500 BC jusqu'à 2600 BC. Plus à l'est ils atteignent le confluent de la Du-
rance et du Buëch18, sans s'infiltrer semble-t-il le long du cours amont de la Durance vers le
Briançonnais. Les récents travaux du Centre de recherches préhistorique de Valence19 concernant
16 Du Nord au sud: Bauges, Chartreuse, Vercors 17 Avec les principaux sites de Saint-Uze, Montmaur-en-Diois, Francillon, Menglon, Barret-de-Lioure, Saint-Nazaire-le-Désert,
Châteauneuf-du-Rhône, Boulc-en-Diois, Vercoiran, Allan dans la Drôme. Les déforestations apparaissent dans les pollens de Saou
(Drôme) 18 Tarrin à Orpierre, Le Bersac, Serres, Monetier-Allemont et des grottes à Sigottier, la Faurie, Montmorin, etc. Hautes-Alpes 19 Centre de recherches préhistoriques de Valence avec A.Beeching, J.L.Brochier et leurs collaborateurs dont les sondages et les
prospections sur la basse Drôme, les collines de piémont et le Diois établissent la nature et l'évolution géo-morphologiques des
terroirs occupés depuis le Néolithique ancien. Cette recherche a établi l'abondance des vestiges (140 points avec vestiges chasséens
21
l'implantation des sites ont montré la densité de l'occupation sur les terrasses, rebords de pla-
teaux, éperons, cols ou hauteurs, dont les restes sont le plus souvent enfouis dans d'anciens che-
naux ou dépressions comblés par colluvion et arasement liés aux activités anthropiques, cultures
et déboisements. Près de Die des fosses dépotoirs ressemblent à celles mis au jour en grand nom-
bre dans les sites chasséens de la plaine du Rhône.
Fig. 7. Néolithique moyen (Middle Neolithic). env.4500 à 3200 av. J.C.
A- Chasséen- 1 et 2: Fontaine, Isère; 3: St-Alban-Leysse, Savoie; 4: Vercoiran, Drôme; 5: St-Na-
zaire-le-Désert; 6 et 7: Vif, Isère; 8: Bressieux, Isère. (échelles diverses).
découverts) mais aussi leur difficile interprétation dans le cadre d'une archéologie extensive: cela nous aide à imaginer l'importance
des occupations préhistoriques dans tous les territoires et nous fournit le modèle à suivre pour les explorations futures
22
B- Cortaillod- 9 et 13: Injoux, Ain; 11: Fontaine, Isère; 10, 12, 14 et 15: Chaumont, Haute-Sa-
voie. (échelles diverses). D'après: 1, 2, 6, 7, 8 et 11: Bocquet 1969; 3: Combier et 4: Gras et 9, 10, 12 à
15: Gallay in Bocquet et Lagrand 1976.
Au Nord du col de Lus-la-Croix-Haute, le Trièves20 a livré anciennement des silex chas-
séens sur un éperon au-dessus de l'Ebron. Les occupants venaient-ils du Sud, de la vallée du
Buëch ou du Nord, de la cuvette grenobloise? Rien ne permet de le préciser, seule est sûre la pré-
sence de paysans au Néolithique moyen dans cette région du Sillon alpin où les larges terrasses
du Drac et ses affluents offrent des terroirs propices qui mériteraient des prospections.
Une abondante série de lames et lamelles chasséennes découverte en plein air21 sur une
terrasse latérale de la fertile et large dépression de la Bièvre-Valloire située entre le Rhône et la
cluse de l'Isère. En l'absence de vestiges sur le cours de la basse Isère, entre Voreppe et Romans,
je ferai de cette plaine la voie de pénétration chasséenne vers le carrefour grenoblois à partir du
couloir rhodanien au Néolithique moyen.
Les fouilles de H. Müller, au début du siècle, ont surtout porté sur la région grenobloise amenant
la découverte de plusieurs stations en grotte avec silex, céramique et faune. Malheureusement la
céramique chasséenne d'une phase assez tardive22 se trouve mélangée dans les tiroirs des collec-
tions, ce qui diminue considérablement les renseignements que l'on pourrait en attendre. Des
fouilles récentes23 y datent du Chasséen vers 4520 et 4230 BC.
Sur le Rhône moyen dans le Nord-Dauphiné, le Néolithique moyen bourguignon se mani-
feste par deux vases, mélangés à des récipients chasséens, à la Balme-les-Grottes, Isère, dans un
ossuaire daté de 4060 BC.
Très étrange est l'habitat perché de Vif, au Sud de Grenoble, avec des silex chasséens
mais aussi un fond de cabane rond et enterré comportant des éléments24 faisant penser à la
civilisation de Fiorano de Lombardie. Bien que non daté, ils témoigneraient, si le rapprochement
se confirme, de contacts à la deuxième moitié du Ve millénaire avec la plaine du Pô pourtant fort
éloignée, mais par quel passage des Alpes? Ces vases sont encore les seuls de leur espèce à
l'Ouest des Alpes.
20 Saint-Martin-de-Clelles (Isère) 21 Bressieux (Isère) (Fig. 7-A 8) 22 Grotte de Balme de Glos et abri de Barne-Bigou (Fig. 7-A 1 et 2) 23 Sassenage (La Grande Rivoire) et Claix par R.Picavet 24 Plusieurs vases dont un à carène basse et bouton opposé à l'anse en ruban
23
La Savoie
La province de Savoie n'a pas attiré les Chasséens car les sites sont très rares. C'est la
Balme-de-Thuy, Haute Savoie, qui nous éclaire toujours par une couche comportant de la cérami-
que et des lamelles chasséennes, datée de 4020 BC. Le cerf est l'espèce la plus représentée avec
présence de l'ours et de l'aurochs prouvant l'importance de l'environnement forestier; chèvre,
mouton et porc complètent l'alimentation carnée. Le Rhône coupe les derniers chaînons du Jura
méridional au défilé de Pierre-Châtel, voie naturelle de pénétration vers l'Est par un étroit canyon
entre la Balme et Yenne, jalonné de nombreuses grottes où de la céramique chasséenne a été ré-
coltée au début du siècle25; comme pour toutes les fouilles anciennes nous ne pouvons pas en sa-
voir davantage mais depuis peu une couche avec des tessons chasséens a été datée d'environ 4140
BC26. Juste en face, en rive droite du fleuve, un petit foyer daté de 4530 BC contenait aussi quel-
ques fragments de vases chasséens27.
Céramiques et silex existent en grotte près d'Aix-les-Bains et dans un habitat de plein air
sur les hauteurs de Chambéry28. Sur la terrasse de Francin, au-dessus de l'Isère, des fonds de ca-
bane avec céramiques et silex sont datés de 2910 BC et les pollens les situent dans la deuxième
partie de l'Atlantique: ici les derniers Chasséens perdurent dans un contexte favorable à leur éco-
nomie. Les analyses palynologiques ont montré par ailleurs une déforestation par brûlis et une
culture intense des céréales qui nous renseignent sur les modes culturaux en usage.
Courant helvétique et Civilisation de Cortaillod env. 4500 à 3200 av. J.C. (Fig. 7-B)
La Civilisation de Cortaillod imprègne l'avant-pays savoyard29 à partir du plateau helvéti-
que30 aussi bien sur les rives du lac Léman qu'en sites terrestres en Chablais31. Cette présence
Cortaillod au Sud du lac Léman est confirmée par des tombes en coffre "Glis-Chamblandes"32
qui sont à rattacher directement au groupe vaudois et valaisan; à Lugrin une date obtenue sur les
os (3850 BC) concorde avec celles de Suisse, entre 4500 BC et 3500 BC33.
25 Par A.Blanc à la Grande Gave, la Balme (Savoie) en rive gauche 26 Par F.Ballet à la Grande Gave 27 Grotte des Romains, Virignin (Ain) par R.Desbrosse 28 Grotte de la Biolle et oppidum de Saint-Saturnin à Saint-Alban-Leysse (Savoie) 29 On verra plus loin ce qui se passe dans les massifs centraux 30 Marquée par la céramique à profil sinueux et boutons sous les bords, écuelles carénées, flèches à base concave ou rectiligne, etc. 31 Corsier, Chens-sur-Léman, Sciez et Douvaine (Haute-Savoie) 32 A Chens, Douvaine, Etrembières, Lugrin et Thonon (Haute-Savoie). Les tombes de ce type descendent le long du Rhône jusqu'à
Saint-Sorlin-en-Bugey, Ain et il en existerait une près d'Aix-les-Bains à Grésy-sur-Aix. 33 On a pu penser que la perle en cuivre très pur d'Annecy pourrait se rattacher par sa composition à celles de Bürgaschi en Suisse
mais sa forme est atypique et les conditions de découverte excessivement douteuses, ce qui lui enlève toute signification
24
Plus au Sud le Cortaillod se manifeste en grotte34 près d'Aix-les-Bains (3790 BC) avec la
présence d'un "proto-Cortaillod" présentant quelques caractères chasséens et en plein air35 près
de Chambéry. Sur les bords du Rhône, en rive droite et en rive gauche, des grottes comme des
stations de plein air jalonnent un axe de diffusion vers l'Ouest, le long du fleuve36. Quelques
dates ont été récemment obtenues sur des pieux du lac d'Annecy (-3783) et du lac du Bourget37
(-3842); ici il y a un peu de matériel Cortaillod parmi lequel se distinguerait aussi une influence
du Néolithique moyen bourguignon. De toute manière l'implantation et les influences Cortaillod
ne dépassent pas vers le Sud la latitude de Grenoble où quelques céramiques à boutons en sont
les plus méridionales38.
En Savoie, la civilisation de Cortaillod efface-t-elle les rares implantations chasséennes
ou bien les deux types d'économie coexistent-ils? Il est difficile de trancher mais à la Balme-de-
Thuy un niveau Cortaillod (3980 BC) est sus-jacent à un niveau chasséen d'environ 4020 BC.
Pendant que les Cortaillod vivent en Savoie, les Chasséens se sont-ils maintenus là où ils s'étaient
implantés? on n'est pas en mesure de le discerner, les vestiges étant trop rares et mal datés.
Influences italiques avec la présence de Vases à bouche carrée (VBQ)
Quelques tessons de Vases à bouche carrée (VBQ) ont été reconnus par J.Vital à Sasse-
nage près de Grenoble, à Chatelus dans le Sud-Ouest du Vercors, à Montmaur en Diois, à Ballons
en Baronnies et en Bugey au Nord du Rhône. Ce faciès du début du Néolithique moyen occupe la
Lombardie et un peu plus tardivement en Piémont. Par où sont-ils arrivés à l'Ouest des Alpes?
Evidemment ces vases lombards sont présents dans plusieurs sites des vallées de la Doire Ri-
paire, de l'Orco, du Chisone, dans le bas Piémont et sur le haut Rhône à Sion; mais il n'y en a
nulle trace en Maurienne ni en Tarentaise pour servir de relais et nous verrons que ces deux ré-
gions des Alpes internes ne sont pas encore ouvertes vers l'Ouest. Actuellement il est plus sage
d'envisager une origine méridionale, de Ligurie, dans le sillage de l'Epicardial dont les VBQ sont
contemporains comme nous incitent à le penser deux dates de Chatelus (4510 et 4460 BC).
34 La Biolle (Savoie) 35 Saint-Saturnin à Saint-Alban-Leysse (Savoie) 36 Injoux, Montagnieu et Saint-Sernin-en-Bugey (ces deux derniers avec des tombes Glis-Chamblandes) et Virignin, Ain. A
Chaumont en Genevois (Haute-Savoie) et la Balme (Savoie) (Fig. 7-B). 37 A Saint-Jorioz (Haute-Savoie) et Saint-Pierre-de-Curtille (Savoie) 38 A Fontaine (Barne-Bigou; Fig. 7-B 11) et Sassenage, la Grande Rivoire (Isère)
25
LA FIN DU NÉOLITHIQUE env. 3750 à 2100 av. J.C. (FIG. 8 À 16)
Au Néolithique récent, le climat se refroidit légèrement au début du Sub-Boréal avec de
courtes périodes de petits assèchements comme celui mis en évidence à Charavines, sur le lac de
Paladru, entre -2700 et -2600. Là encore vont s'accoler et s'interpénétrer deux courants. Le cou-
rant méridional introduit le rite des tombes collectives en grottes sépulcrales et en hypogées arti-
ficiels39. Comme avec les Chasséens se sont les terroirs secs et les versants bien ensoleillés qui
sont choisis. Un autre courant d'origine helvétique occidentale et rhodanienne correspond à des
populations qui affectionnent plutôt les terres lourdes ou humides, les bords de lacs et de rivières
plus fréquentes dans le Nord de la région.
39 Avec un matériel très caractéristique: lithique (lames à retouches marginales, flèches foliacées, etc.), parure (perles et pendentifs
en os ou en roche verte, etc.), céramique à cordon, etc. (Fig. 10-A, 1 à 8)
26
Les analyses palynologiques indiquent des déforestations dans de nouvelles zones de peu-
plement qui se mettent en place au cours du IIIe millénaire, par exemple les régions de Chamo-
nix vers 2500 BC, de la Chartreuse40 vers 2230 BC. Là, les pollens de Saint-Thibaud-de-Couz
montrent une pratique agricole particulièrement intéressante: la déforestation de la vallée de
l'Hyère est totale mais non destinée à la culture, seulement à la création de pâturages. Ceux-ci
étaient exploités selon un mode intensif, ce qui ne permettait pas aux graminées d'arriver au stade
de maturité, continuellement broutées qu'ils étaient par le bétail. La pratique de la stabulation li-
bre était déjà en honneur!
La carte de répartition des haches polies (Fig. 13), toutes périodes confondues, donne une
bonne idée de l'occupation du territoire à la fin du Néolithique: celle-ci fut large à l'exception de
certaines zones de haute montagne ou celle au sol particulièrement ingrat (Bas-Dauphiné entre
autre).
Courant helvétique et la civilisation "pré-Saône-Rhône" et Saône-Rhône env. 3100 à
2350 av. J.C. (Fig. 8 et 9)
Dans la partie Nord de la région, à la période qui correspond à la Civilisation de Horgen
en Suisse les lacs Léman, d'Annecy et d'Aiguebelette possèdent des pieux datés -3190 à Lépin,
-3049 à Thonon et -3041 à Annecy-le-Vieux; mais ces sites n'ont pas encore fourni de matériel
typologiquement déterminable41. Il en est de même pour une sépulture collective sans mobilier
près de Chambéry (3290 BC), d'une tombe près de Grenoble de 3140 BC et d'un niveau non chas-
séen de 3370 BC42. Il n'est pas possible d'attribuer ces vestiges à un faciès culturel précis et ils
témoignent seulement de la persistance de la présence humaine à la fin du IVe millénaire. Il n'y a
pas hiatus dans le peuplement mais seulement dans nos connaissances et nos possibilités de diag-
nostic, car peu avant 3200/3000 BC, et bien que nous ne disposions d'aucun site dans le Grési-
vaudan, les pollens du lac Luitel à 1350m d'altitude montrent que l'emprise de l'homme se fait
brusquement plus grande puisqu'elle atteint les flancs du massif de Belledonne qui sont fortement
déboisés. Il ya là des problèmes à résoudre...
La Civilisation Saône-Rhône (ou Néolithique récent rhodanien), plus récente puisqu'elle
commence en Suisse vers -2800, étend son influence sur la Savoie et le Nord du Dauphiné jus-
40 Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie) (analyses palynologiques M.Girard) 41 Par exception l'influence de Horgen est reconnue dans un habitat en tourbière, malheureusement non daté, à Passins au sud-est
du massif de Crémieu. 42 St-Alban-Leysse (Savoie), Saint-Paul-de-Varces et Seyssinet (Isère), ici avec quelques céramiques de type "néolithique" sans
caractères particuliers
27
qu'à Grenoble, illustrée par de nombreux gisements au bord des lacs ou des cours d'eau (comme à
Thuellin prés du Rhône)43.
La dendrochronologie les situe entre -2670 et -2580 sur le lac de Paladru, entre -2548 et
-2440 sur le lac du Bourget et à -2435 sur le lac d'Annecy44. Sur le lac d'Aiguebelette le radiocar-
bone des pieux oscille entre 2700 et 2530 BC45. D'autres sites sont identifiés au Nord d'Annecy
avec une date d'environ 2790 BC, sur le lac d'Annecy, sur le lac du Bourget, en Nord-Dauphiné,
en grotte sur le Rhône et près de Grenoble46. Il faut attendre la fin des prospections actuelles47
pour savoir si des sites existent sur les rives du Léman.
Les sites de la civilisation Saône-Rhône s'intègrent bien dans un ensemble techno-culturel
qui s'étend sur le Jura et les Alpes du Nord; c'est très net à Charavines où les ressemblances avec
le "Groupe de Chalain" sont frappantes tant dans la céramique que le silex. Si des échanges avec
la Suisse occidentale existent on ne peut en mesurer l'importance, par contre les éléments
languedociens sont exceptionnels48.
Les villages de Charavines et la vie au Néolithique dans les Alpes (Fig. 9)
Des fouilles subaquatiques au Sud du lac de Paladru, dans les collines du Nord-Dauphiné,
à Charavines, ont exploité un gisement dont l'étude complète permet de le considérer actuelle-
ment comme le modèle des villages néolithiques alpins, dans le domaine de la civilisation Saône-
Rhône tout au moins. Bien qu'aucun autre site n'ait été retrouvé dans la région du lac de Paladru,
les pollens indiquent sans ambiguïté de la présence de paysans depuis 3500 BC environ. Une
baisse prolongée du niveau du lac a permis l'installation de maisons de bois sur la rive même, où
elles furent bien conservées par la montée ultérieure des eaux. Placé à 500m d'altitude, au coeur
de forêts denses, ce site a fourni de multiples témoins de la vie quotidienne en particulier ceux en
matières périssables, des données précises sur l'architecture des maisons, les modes culturaux,
l'alimentation végétale et carnée, etc.
43 Ils sont caractérisés par les céramiques globuleuses, tronconiques, cylindriques et en tonneau non décorées, par une abondance
de silex taillés sans soin et par la présence de silex du Grand Pressigny. Celui-ci est retrouvé sur les lacs Léman, de Paladru, du
Bourget, d'Aiguebelette et d'Annecy, à La Balme-les-Grottes en Nord Dauphiné, à Seyssinet et à Fontaine près de Grenoble. 44 A Charavines (Isère), Conjux (Savoie) et Talloires (Haute-Savoie) 45 A Novalaise, Saint-Alban et Lépin (Savoie) 46 A Aviernoz, Annecy et Veyrier (Haute-Savoie), Brison-Saint-Innocent (Savoie), Montalieu-Vercieu, La Balme-les-Grottes et
Seyssinet (Isère) 47 par le Centre national de recherches archéologiques subaquatiques (devenu le DRASSM) sous la direction d'A.Marguet 48 Vases à cordons horizontaux (probablement importés) et absence des parures spécifiques: perles à ailettes ou pendeloques
segmentées, etc.
28
Les villages successifs
Une communauté de 50 à 60 personnes venue des environs proches se fixera, en -2670,
sur la rive méridionale du lac couverte par une forêt où dominent les sapins accompagnés de frê-
nes, aulnes, hêtres, etc. Le village naît d'abord avec deux maisons, puis trois autres quatre ans
plus tard qui abriteront au maximum sept familles durant 15 à 18 ans; ensuite quatre familles
resteront encore quelques années avant d'abandonner volontairement le site peu après -2650. Un
village le remplacera au même endroit en -2613, soit moins de quarante ans plus tard, pour une
nouvelle et dernière occupation de 20/22 ans sans que la région proche soit désertée pour autant;
en effet les pollens montrent plusieurs déforestations ultérieures, accompagnées de la présence de
céréales.
L'occupation du territoire
Ce système d'habitat semi-permanent et cyclique est adapté à une agriculture de type hor-
ticole, pratiquée après brûlis des terres lourdes et argileuses, au moyen de courtes pioches en bois
de cerf par culture en sillon; les sols se trouvaient ainsi épuisés rapidement. Quand le finage envi-
ronnant n'avait plus un rendement suffisant pour alimenter le groupe, il fallait partir et recons-
truire le village quelques kilomètres plus loin, au milieu de terres vierges ou régénérées par la
végétation après un abandon antérieur. Donc, voyant se rapprocher l'échéance de trop faibles ré-
coltes certains membres de la communauté allaient édifier un nouveau village puis toutes les
familles déménageaient deux à quatre ans plus tard; l'organisation sociale est bien au point pour
l'exploitation optimum du territoire et la continuité dans la production agricole. La densité de
l'occupation était déjà telle que les communautés étaient obligées de revenir vivre dans leurs an-
ciens terroirs régénérés par la végétation. Les zones occupées successivement étaient-elles affec-
tées à un même groupe et à sa descendance dans une sorte de consensus accepté par tous les
groupes dans une vaste région: c'est possible car à Charavines ceux qui sont revenus faisaient
partie du groupe précédent49. En outre les rares villages connus ne comportent aucune trace de
défenses (fortification, rempart ou palissade robuste) qui attesteraient l'éventualité de conflits.
Les ressources
Possédant une haute technicité dans l'artisanat du bois (fabrication de cuillères, de pei-
gnes, d'épingles), de la vannerie (paniers), du textile (nattes, tapis, toiles et velours) les habitants
de Charavines profitaient de toutes les ressources de la forêt. La chasse (50 à 55 % de cerf dans
l'alimentation carnée) qui complète l'élevage du porc, du mouton et de la chèvre avec très peu de
49 Même artisanat du bois (épingles, peignes, cuillères, etc) en particulier
30
Fig. 9. Néolithique récent (Civilisation Saône-Rhône). Villages de Charavines. 2670 à 2580 av. J.C.
1: Plan du premier village en 2666 av. J.C.; 2: et 3: poignards en silex du Grand-Pressigny avec manches
en écorce de bouleau et enroulement de sapin sur plaquette de hêtre; 4: bouteille en pâte fine; 5 à 10, 17 et
18: différents types de récipients; 11 à 13: pointes de flèches; 15: racloir à encoches ayant servi de couteau
à moissonner; 16: racloir biface portant des traces de colle (bétuline). (échelles diverses). Dessins
A.Bocquet, R. Doulière et N. Papet.
bovins car les parcelles étaient ouvertes seulement pour la culture et non pour la production du
foin. La cueillette de fruits (pommes, noisettes, prunelles, mûres, etc.) s'ajoutait à la culture de
l'épeautre, de l'orge, du pavot; des pollens de seigle ont été reconnus mais aucun grain n'en a été
retrouvé. D'autres fibres végétales étaient aussi ramassées pour s'ajouter au lin dans les textiles.
Ces villages étaient incorporés dans un maillage de relations qui permettait les échanges
entre communautés, souvent à longue distance50. Leurs vases à goulot rétréci et épaulement,
toujours en pâte fine ont des termes de comparaison bien difficiles à préciser: "invention" locale
ou bien idée venue d'Italie septentrionale ou centrale avec les civilisations de Remedello ou de
Rinaldone? Des vases fabriqués à Charavines sont exportés à Chalain dans le Jura et à Sutz au
bord du lac de Bienne en Suisse.
Courant méridional au Néolithique récent env. 3000 à 1800 av. J.C. (Fig. 8 et 10-A)
En même temps que prospèrent les "Saône-Rhône" rattachés au Nord, un courant origi-
naire du Midi (Néolithique récent méridional), se met en place dans le territoire colonisé pendant
plus d'un millénaire par les Chasséens. Dans les vallées du Rhône, de ses affluents et de la Du-
rance la conquête est marquée par la progression du nombre des sites en grotte (habitats et
ossuaires collectifs) et en plein air51. En Diois et autour de la vallée du Buech de nombreuses
stations utilisent du silex gris local52 et des dizaines de haches polies parsèment la région.
J.L.Brochier a déterminé que plusieurs grottes d'altitude ont longtemps servi de bergerie dans le
haut Diois53, ce qui laisse supposer un usage pastoral de la montagne comme cela se pratique
encore. Les dates radiocarbone permettent de fixer le Néolithique récent entre 2880 BC et 2000
BC, dans la Drôme. A l'intérieur des Alpes les ossuaires, que nous verrons ultérieurement, sont
plus rares tout comme les gisements de surface ou en grotte54.
50 Avec l'ambre de la Baltique, le silex du Grand-Pressigny, les haches en roches vertes du Val d'Aoste ou du Piémont, une perle en cuivre et un
grand vase cylindrique à cordon du Languedoc, un vase à anses rostriformes de type "Artenac", une hache-marteau de Suisse occidentale
51 Avec un matériel très caractéristique: lithique (lames à retouches marginales, flèches foliacées, etc.), parure (perles et pendentifs en os ou en
roche verte, etc.), céramique à cordon, etc. (Fig. 10-A, 1 à 8)
52 A Romeyer, Plan-de-Baix, Saillans, Die, Vesc, Boulc, La Motte-Chalancon, Chatillon, etc. Drôme; Sigottier, Orpierre, Chabestan, Laragne,
Saint-Cyrice, Ribeyret, l'Epine, etc. (Hautes-Alpes)
53 A Montmaur-en-Diois, Treschenu, etc. (Drôme)
54 Près de Grenoble à Fontaine, Seyssinet, Saint-Egrève, Quaix, Meylan, la Buisse et Voreppe
31
Fig. 10. Néolithique récent et final env. 3200 à 2000 av. J.C.
A- Néolithique récent méridional. 1: lame et perles en os, Saint-Paul-de-Varces; 2: lame, Fon-
taine, Isère; 3: bouton en V, perles en os et cuivre, la Batie-Neuve, Hautes-Alpes; 4: flèches et perle de cui-
vre, Saint-Cyrice, Hautes-Alpes; 5: lame, la Buisse, Isère; 6: lame, Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme; 7: pa-
rure, Montmaur-en-Diois, Drôme; 8: bracelet de schiste, la Buisse, Isère; 9: dépot de haches, la Bégude-de-
Mazenc; 10: pointes de Sigottier, Montmaur-en-Diois, Drôme; 11: lame et pointe de Sigottier (Gr. du Vi-
32
vier), Sigottier, Hautes-Alpes, 12: lames, flèches et pointes de Sigottier (gr. du Grapelet), Sigottier, Hautes-
Alpes. (échelles diverses) D'après: 1, 2, 5 et 8 Bocquet 1969; 4 et 10: Héritier in Bocquet et Lagrand
1976; 11 et 12: Dreyfus 1958; 6: dessin Bocquet.
B- Ateliers de taille du Vercors. 1: nucléus en "livre de beurre" de type pressignien, P51, Vas-
sieux; 2: grattoir denticulé et nucléus prismatique, Macrolithique récent, aire 40 Vassieux; 3: chapeau de
gendarme et outil à face plane, Montmorencien, aire 22 Vassieux; 4: pic, Campignien, aire 77 Vassieux,
Drôme. (échelles diverses). Dessins M.Malenfant.
Les trouvailles de haches polies isolées (Fig. 13) indiquent une présence néolithique, sans
pouvoir apporter de précisions culturelles et chronologiques, dans la vallée du haut Drac et le
Trièves55 vers le Champsaur et le Gapençais; celles des vallées de la Romanche56 et de la Gui-
sane vers Briançon dans des zones d'alpages ne prouvent pas forcément une implantation perma-
nente. La Chartreuse possède quelques haches et aussi des zones de taille du silex57. Dans le
coeur du Vercors plusieurs stations de surface découvertes par le Dr Malenfant, difficiles à dater,
sont les restes de la fréquentation, au moins par des chasseurs, de l'intérieur du massif aux forêts
denses. Les très nombreux ateliers de taille installés sur les affleurements de silex sont plus si-
gnificatifs de l'occupation liée à une activité spécifique, pas forcément permanente mais qui
s'étala sur de très nombreux siècles. Bornes et Bauges resteraient des régions délaissées si on se
fie à l'absence actuelle de vestiges.
Imprégnation par les Campaniformes env. 2600 à 2000 av. J.C. (Fig. 11 et 12-A)
Dans certains sites néolithiques récents viennent s'ajouter des éléments campaniformes;
abondants dans le couloir rhodanien, ils pénètrent le Diois et le rebord Ouest du Vercors58. Le
Sillon alpin et l'avant-pays en sont bien pourvus: près de Grenoble, du lac du Bourget, du Rhône
et en Haute-Savoie59; des niveaux avec tessons campaniformes sont datés à Seyssinet de 2290
BC et à Saint-Paul-de-Varces une tombe collective avec un gobelet se place à 2160 BC. Le style
des campaniformes n'est pas homogène: pan-européen60, septentrional61 et méridional62, tradui-
sant des influences variées. Ces gobelets couvrent une longue période entre les plus anciens de
type pan-européen et ceux d'inspiration méridionale à décor gravé ou estampé d'âge plus récent.
55 A Prunières, Corps, Sainte-Luce, Mens, etc. (Isère)
56 A Venosc et Mont-de-Lans (Isère)
57 Au Col de Bovinant, Saint-Pierre-d'Entremont (Isère) 58 A Francillon (Drôme) et Choranche (Isère) 59 Autour de Grenoble à la Buisse, Fontaine et Sassenage; à Conjux, La Balme en Savoie; à Cranves et Saint-Cergues (dans des
dolmens), à la Balme-de-Thuy en Haute-Savoie 60 A La Buisse, Fontaine, Seyssinet, Verna (Isère) et la Balme de Thuy (Haute-Savoie) 61 A Saint-Paul-de-Varces, Seyssinet (Isère) et Cranves (Haute-Savoie) 62 A Francillon, Boulc, Saint-Nazaire-le-Désert et Montmaur (Drôme); Choranche et Seyssinet (Isère); Conjux (Savoie)
33
Contrairement à certaines théories le matériel campaniforme ne semble pas posséder un caractère
de prestige mais se mêle souvent, et en bonne quantité, au mobilier domestique des habitats63.
A Vernas, dans une allée couverte près du Rhône un poignard "occidental" (Fig. 12-A 6)
est en cuivre à mince languette; un autre au Lauzet en Ubaye, dans un dolmen où certains os da-
tés de 2510 BC sont peut-être antérieurs au dépôt de la pièce. Quelques haches plates en cuivre64
sont des trouvailles isolées non datables exactement, comme le poignard triangulaire court de la
Tronche près de Grenoble. Des perles et alênes de cuivre en Grésivaudan65, dans les Hautes-
63 A Seyssinet et Choranche (Isère) et Balme-de-Thuy (Haute-Savoie) 64 A Annecy-le-Vieux, Sévrier, Faverges en Haute-Savoie, Saint-Pierre-d'Albigny, La Balme en Savoie (Fig. 12-A 4 et 5),
Vercoiran en Diois, Ribiers dans les Hautes-Alpes. 65 A Sainte-Marie-du-Mont, Fontaine et Vif (Isère)
34
Alpes66 et une perle de plomb à la Buisse complètent l'inventaire du métal dans le piedmont et
les massifs sub-alpins dont l'âge s'étale sur le Chalcolithique et le Bronze ancien. A rattacher au
phénomène campaniforme seraient les grands vases à perforations multiples sous le bord, pré-
sents de chaque coté des Alpes67 que M.Besse attribue à une céramique d'accompagnement aux
campaniformes.
Dans les Alpes nous n'avons aucune preuve archéologique de l'exploitation des mines de
cuivre au Néolithique récent ou final et les métal des objets attribuables à cette période semblent
d'origine lointaine68, Rhin moyen, Languedoc ou Allemagne du Nord-Est.
66 A Etoile-Saint-Cyrice et la Batie-Neuve (Hautes-Alpes) 67 A Saint-Marcel-Bel-Accueil près de Bourgoin, Collonges (Haute-Savoie) et Villar Dora près de Suse en Piémont 68 La teneur en argent est forte (>0,65%) à Ribiers, Vercoiran, Faverges et Annecy-le-Vieux (2%) sur les six analysées (Sévrier
0,1% et Saint-Pierre-d'Albigny 0,08%); ce n'est pas fortuit et probablement en rapport avec l'origine du métal. Il ne semble pas que
les minerais alpins contiennent de l'argent et le métal pourrait venir dela région de l'Adlerberg ou des Causses qui ont généralement
des cuivres à bonne teneur en argent, ce qui est rare ailleurs sauf en Allemagne du Nord-Est.
35
Fig. 12. Néolithique final (Late Neolithic)
A- Campaniforme. 1: Fontaine; 2: Saint-Paul-de-Varces, Isère; 3: Conjux, Savoie; 7 et 8: Fran-
cillon, Drôme. Haches plates en cuivre: 4: Sévrier, Haute-Savoie; 5: Saint-Pierre-d'Albigny, Sa-
voie. Poignard: 6: Vernas, Isère. D'après: 1 à 3: Bocquet et Ballet 1987; 4 à 6: dessins Bocquet; 7
et 8: Vignard in Bocquet et Lagrand 1976.
B- Civilisation de Remedello. 4: plan de la tombe N° 1 de Fontaine-le-Puits, Savoie; 1: poignard;
2: hache plate; 3: "pendeloque"; 5: retouchoir en cuivre enfoncé dans un andouiller; 6: hallebarde en cuivre
d'une autre tombe de Fontaine-le-Puits. D'après: Combier in Bocquet et Lagrand 1976.
C- Civilisation Cordée. 7: Hache-marteau de Saint-André-en-Royans, Isère. D'après Bocquet
1969.
Quelques traces de la civilisation Cordée (Fig. 11 et 12-B)
Seules des haches-marteaux en roche verte illustrent la Civilisation Cordée, une quinzaine
étant éparpillée entre Suisse et Hautes-Alpes avec une densité particulière près du lac Léman au
Nord de la Haute-Savoie et dans les zones marécageuses du Nord-Dauphiné69. Aucune cé-
ramique du Cordé n'a été découverte ou conservée des anciennes trouvailles dans les Alpes du
Nord, à l'exception de la rive Sud du Léman où d'anciens ramassages ne sont pas très signifi-
catifs. La hache-marteau, outil symbolique et caractéristique de cette civilisation, semble d'après
les données actuelles, avoir été exportée sans être accompagnée d'autres influences.
Les rites funéraires du Néolithique
Dans une couche chasséenne un dolicocéphale de type méditerranéen70, à Fontaine, était
inhumé dans une fosse en position repliée sur le côté gauche; il y avait autour les restes épars de
six individus de petite taille. J'ai évoqué les tombes localisées sur la rive Sud du Léman caracté-
ristiques du type de Glis-Chamblandes: ce sont des coffres de dalles contenant plusieurs corps en
position latérale souvent repliée. Complétons par l'ossuaire collectif en grotte de la Balme-les-
Grottes qui comportait des tessons chasséens avec les deux vases attribués à l'influence du Néoli-
thique moyen bourguignon. A la Balme-de-Sillingy, près d'Annecy, des corps malheureusement
sans mobilier étaient allongés sur le dos en deux groupes sur le sol d'une grotte: ils sont datés de
3050 BC et 2220 BC. Toujours sans mobilier, un corps, avec la même disposition, dans une fis-
sure de rocher obturée volontairement par un bloc, date de 3100 BC à Saint-Paul-de-Varces au
Sud de Grenoble. Dans ces deux derniers cas on n'est pas étonné de l'absence de mobilier car ils
correspondent à une période où aucuns caractères culturels ne peut être discernés, après le Néoli-
thique moyen et avant les influences de la Civilisation Saône-Rhône.
69 A Chens-sur-Léman, Fillinges, Andilly, Annecy, Rumilly, Arenthon en Haute-Savoie; Passins, Charavines, la Balme-les-Grottes,
tourbières de la vallée de la Bourbre, Bourgoin (Isère) en Nord Dauphiné; Virignin, Ain sur le Rhône; Seyssinet près de Grenoble;
Saint-André-en-Royans (Isère) à l'Ouest du Vercors; Eourres (Hautes-Alpes) près du Buech. 70 avec des traces de trépanation guérie et des coups ayant vraisemblablement entrainés la mort; le mobilier était constitué d'une
défense de sanglier, d'un ciseau en os, d'un racloir et de trois nucléus de silex et de deux fragments de limonite
36
Aucune sépulture n'est attribuable avec certitude à la civilisation Saône-Rhône; je lui rat-
tache pourtant le groupe funéraire de Saint-Quentin-Fallavier en Nord-Dauphiné placé au coeur
d'une région aux terres lourdes et marécageuses plus conformes aux habitudes des "Saône-
Rhône" que des Méridionaux. Nous sommes en présence d'un cimetière et non d'une nécropole
collective, car plusieurs tombes individuelles plates, entourées de dalles, étaient alignées sur le
côté Est d'un bloc erratique portant de nombreuses cupules. Le mobilier comportait de longues
perles en lignite, une pioche en bois de cerf et des lames de silex assez irrégulières qui ne rappel-
lent en rien celles venant du Midi ou du Grand-Pressigny.
La civilisation de Remedello est à l’origine à Fontaine-le-Puits, Tarentaise, de plusieurs
sépultures individuelles71 parfaitement conformes aux tombes remedelliennes anciennes de la
région lombarde (Fig. 12-B). Ces régions centrales des Alpes seront traitées plus loin.
Les ossuaires collectifs inspirés par le Néolithique récent méridional sont nombreux dans
le Sud du Dauphiné (Drôme, Ouest des Hautes-Alpes et Isère) et remontent jusqu'au lac du Bour-
get; ceci est en accord avec la dispersion que nous avons vue pour les sites habités. Leur âge va
de 2875 à 2310 BC. Ils sont en grottes dans les pays calcaires ou en hypogées artificiels sur les
terrains molassiques des collines du piedmont72. Les silex (flèches, lames) et les parures de ces
tombes sont toujours d'origine méditerranéenne.
71 Dont une avec hallebarde en cuivre et une autre avec flèches dans deux carquois, hache plate, poignard, pendeloque et retouchoir
de cuivre, grosses haches polies autour d'un corps replié sur le coté 72 Drôme:Buis-les-Baronnies, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans (avec un poignard de type Remedello importé vraisemblablement
par la Provence), Romeyer, Die, Montmaur-en-Diois, Saillans, Sainte-Jalle, Plan-de-Baix, Mours, etc.Dans les Hautes-Alpes à
Sigottier, Orpierre, Etoile, Montmorin, etc. Dans l'Isère à Saint-Quentin-sur-Isère, La Buisse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Egrève,
Claix et Creys-Malville, Saint-Marcel-Bel-Accueil près du massif de Crémieu en Nord-Dauphiné. En Savoie ceux de Saint-Jean-
d'Arvey, Saint-Alban-Leysse, La Biolle, La Balme et Traize en sont les plus septentrionaux.
38
Fig. 14. Diagramme pollinique de la grotte des Sarrasins à Seyssinet-Pariset, Isère.
On suit les processus de mise en place de l'occupation du terroir, à 500m d'altitude sur les pentes
du Vercors près de Grenoble, depuis le Néolithique récent jusqu'à la fin de l'âge du Fer.
39
Les Mégalithes (Fig. 15)
Les dolmens et les menhirs alpins sont très localisés dans deux régions, Chablais au Nord
et Champsaur-Gapençais au Sud; ils furent détruits pour la plupart à la fin du XIXe siècle afin de
faciliter les travaux agricoles et seuls les anciens comptes-rendus permettent d'en retrouver la
trace. En Chablais deux dolmens sont encore en place bien qu'entièrement vidés73, et les autres
ont disparu74. Ceux de Saint-Cergues et de Cranves ont livré des gobelets campaniformes com-
plétés à Cranves par une épingle du Bronze ancien (Fig. 20-A, 8). Les anciens auteurs signalent
des menhirs et des cromlechs75 en Chablais. Faut-il rattacher cette petite région de mégalithes à
la Suisse occidentale, ce sera difficile à prouver car pour la plupart on en ignore l'architecture. En
Tarentaise un cromlech est toujours visible au col du Petit-Saint-Bernard et son âge exact est en-
core discuté: Néolithique ou âge du Fer?
Dans le Gapençais-Champsaur le dolmen de la Batie-Neuve (dont il demeure des traces
du tumulus qui le recouvrait) fouillé en 1956 a donné des parures méridionales76. Les anciennes
relations en localisent d'autres77 et l'allée couverte de Tallard fut le dernier monument détruit en
1926. Des menhirs auraient existé dans une zone un peu plus vaste78 mais on ne saurait en dire
plus. En Ubaye dans le dolmen du Lauzet un abondant mobilier méridional et campaniforme79
accompagnait les corps. Le dolmen de Torre Pellice, exemple unique sur le versant italien, dans
la vallée du Pellice reliée au Queyras par le col de la Croix doit-il leur être rattaché?
A Vernas en Nord-Dauphiné, une allée couverte, à demi détruite au début du XIXe siècle
fut étudiée en 1971, ce qui a permis de comprendre son évolution architecturale complexe entre
le Néolithique récent et le Bronze ancien par trois agrandissements successifs de la chambre fu-
néraire qui a livré un poignard à languette en cuivre de type "occidental" et un gobelet pan-euro-
péen campaniformes, une tasse du Bronze ancien. Cet exemple isolé placé en dehors des groupes
que nous avons vus, était rapproché par le Dr Arnal de l'allée couverte de Tallard80.
73 A Saint-Cergues et Reignier (Haute-Savoie) 74 A Etrembières, Cranves, Bons-en-Chablais, Brens, Cervens, Dingy, Pers-Jussy, Scientrier (Haute-Savoie) 75 Menhirs à Amancy, Collonges, Mésigny, La Roche-sur-Foron, cromlech au Sappey et à Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie) 76 Perles à ailettes, segmentées et en cuivre, boutons en os perforés en V 77 A Gap, Saint-Jean-Saint-Nicolas, Chateauroux , deux à la Fare-en-Champsaur (Hautes-Alpes) 78 A Gap, Serres, Orpierre, La Rochette, Rambaud, Château-Queyras, Aiguilles (Hautes-Alpes) 79 dont un poignard à languette en cuivre (fouilles G.Sauzade en 1980) 80 in littera; il voyait dans la troisième et ultime modification un coffre accolé à l'allée couverte par les Campaniformes après
avoir détruit le monument, ce qui parfaitement vraisemblable au regard de ce qu'ils ont fait à Sion en Valais ou à St-Martin-de-
Corléans en Val d'Aoste
40
Figure 15
Tout récemment à Die, la découverte de cinq monolithes de calcaire seraient du type sta-
tue-menhir dont deux décorées d'un "pectoral" gravé constituent les plus anciennes sculptures de
la région, bien qu'encore mal datées entre Néolithique moyen et final.
41
Les ateliers de façonnage de la pierre (Fig. 8 et 10)
Le cuivre s'est diffusé lentement en Europe occidentale à partir de quelques centres de
production de Suisse nord-orientale, Italie du Nord, Languedoc, etc. dès la fin du IVe millénaire.
C'est dire que les populations avaient connaissance des objets métalliques, même si elles ne pou-
vaient pas toujours les acquérir. A Charavines le premier métal alpin bien daté, entre -2670 et
-2590, est représenté par deux perles dont une en cuivre stibié d'origine languedocienne et deux
petits poinçons bipointes. Haches et poignards en cuivre faisaient rêver ceux qui se contentaient
des outils de pierre que le nouveau matériau était appelé à faire disparaître. Pour résister à cette
concurrence, les tailleurs de silex et les façonniers de lames polies ont montré un grand savoir
faire.
Le silex
En Vercors existent de nombreux gisements de silex dans les roches calcaires ou dans les
sables des grottes: certains, dans la partie méridionale du massif, ont été exploités tout au long du
Néolithique81. D'autres sont inclus dans l'argile et exploités en ateliers disséminés sur des centai-
nes d'hectares pour extraire des lames suivant des techniques utilisées spécifiquement au Grand-
Pressigny; ils ont laissé sur place d'énormes quantités de déchets et de nucléus en "livre de
beurre" (Fig. 10-B 13)82. La plupart des sites qui ont reçu les produits de ces très importants ate-
liers nous sont inconnus mais on dispose depuis peu d'indications du plus haut intérêt: quelques
lames de silex d'Autrans ont été retrouvées dans des niveaux Horgen (datés entre -3107 et -3093)
et d'autres en silex de Vassieux avec un contexte Saône-Rhône (datés entre -2780 et -2701), à
Portalban sur le lac de Morat en Suisse occidentale. Ces déterminations récentes83 montrent que
le silex du Vercors était exporté loin et les dates précisent le terminus post quem de la mise en
exploitation de ces ateliers, c'est à dire la fin du IVe millénaire; cette ancienneté peut surprendre
car au Grand-Pressigny même il n'y a pas de dates aussi hautes et la question peut se poser main-
tenant de savoir qui, du Vercors ou de la Touraine a initié la taille pressignienne...
Le Vercors a fourni d'autres sites de taille (Fig. 10-B) avec des productions fondées sur
des techniques bien différentes: faciès macrolithique (Villard-de-Lans, Vassieux), montmoren-
cien (Vassieux) et campignien (Vassieux). Les richesses de ce massif en gîtes de silex ont attiré
durant toutes les époques des artisans dont les fabrications ne sont pas situés chronologiquement
avec précision.
81 A Treschenu avec plusieurs exploitations en grotte, col de Lus-la-Croix-Haute, etc. Drôme 82 A Villard-de-Lans, Méaudre, Autrans (Isère) au Nord et Vassieux (Drôme) au sud. 83 Renseignements dus à D.Ramseyer, Archéologie cantonale et Université de Fribourg, Suisse
42
De plus, mises à part les basses vallées marginales, en Vercors, aucun site d'habitat n'a
encore était indidualisé, qui serait l'indice d'une implantation permanente; ce dont on dispose
actuellement fait penser plus à des exploitations très temporaires ou saisonnières.
Dans le Diois et à l'Ouest des Hautes-Alpes les tailleurs de silex ont rivalisé d'habileté
pour imiter les lames métalliques en fabriquant des couteaux dits "pointes de Sigottier" (Fig. 10-
A, 10 à 12) en silex local à la fin du Néolithique et au début de l'âge du Bronze, dont l'usage res-
tera limité à la Drôme orientale et à l'Ouest des Hautes-Alpes.
Les roches vertes
Si durant les périodes anciennes du Néolithique certaines petites lames polies ont pu être
confectionnées à partir de galets issus des moraines et des alluvions qui s'étalent dans les plaines,
les pièces plus grandes qui apparaissent à la fin du Néolithique moyen sont issues des centres de
fabrication implantés sur des gisements de roches vertes de bonne qualité. Tout un commerce et
des techniques de fabrication sont encore à découvrir par l'analyse pétrographique fine des ha-
ches polies et des gîtes de roches dures alpines. On sait déjà que des ateliers installés sur les
schistes lustrés du Val d'Aoste (Excenevex), du Val de Suse, du Val de Lanzo, du Val Chisone,
encore bien peu connus ou pas étudiés, ont fourni beaucoup de haches polies de la Suisse rhoda-
nienne et du Sud-Est de la France. Ces ateliers ont été exploités par des populations installées de
manière permanente et il est probable, comme j'en donnerai les raisons plus loin, que ces outils si
recherchés ont transité par le Grand-Saint-Bernard vers le haut Rhône pour alimenter le domaine
de la Civilisation Saône-Rhône (la pétrographie prouve l'origine italique des haches de Charavi-
nes). Dans le travail des roches vertes le Val de Suse, le Val Chisone et la haute Maurienne se
sont fait une spécialité avec les flèches losangiques polies qui se retrouvent en Valais, à Annecy
et à Charavines; ceci confirme la voie envisagée pour la diffusion des haches italiques vers le
haut Rhône et de là vers les Alpes du Nord84.
De récentes études pétrographiques montrent que des lames polies chasséennes du Sud du
Dauphiné et du couloir rhodanien proviennent de la Vallée de Cunéo et du Mercantour, probable-
ment par le Mont-Genèvre ou le Queyras. Dans la Drôme, à la Bégude-de-Mazenc et en Diois à
Charens, deux dépôts de haches polies ont vraisemblablement la même origine. Ils rassemblent
des haches terminées (respectivement de 10 et 13 lames) mais jamais utilisées; leurs dimensions
comme leur qualité indiquent qu'elles ont été taillées dans des ateliers installés sur les affleure-
ments mêmes de roches vertes. A la Bégude certaines sont très longues, jusqu'à 35cm, et 7 d'entre
elles portent un piquetage annulaire (Fig. 10-A, 9) pour une fixation sans gaine en bois de cerf, ce
84 Les ophiolites de la zone du Mont-Cenis ont été aussi exploitées et utilisées localement en Maurienne à Sollières-Sardières
43
qui signifie un changement dans la technique d'emmanchement, changement que l'on retrouve
aussi sur quelques pièces régionales85.
Exceptionnels sont les six grands anneaux-disques en ophiolite polie de Chambéry, trou-
vés ensemble et pour qui se pose le problème de leur origine: objets uniques dans le Sud-Est, à
quelle civilisation les attribuer? Bien connus dans celles de Vho et Fiorano dans la plaine padane,
il en existe de semblables à Turin; est-ce là qu'il faut en chercher la provenance?
" Mégalithisme alpin" et art rupestre (Fig. 16)
Pierres à cupules et "roches aux pieds", reconnues depuis longtemps, parsèment les deux
versants des Alpes, manifestation du "mégalithisme alpin". Des recherches systématiques récen-
tes86 ont considérablement élargi nos connaissances en Maurienne et en Tarentaise avec la dé-
couverte de très nombreux sites, en particulier ceux comportant des dalles gravées87 et pas seule-
ment couvertes de cupules. Certaines pourraient remonter au Néolithique mais des études com-
plémentaires restent à faire pour le préciser.
A qui doit-on ces manifestations spectaculaires dont la datation est toujours difficile?
Beaucoup sont placées en altitude, au-dessus de la limite de la forêt, et sont-elles toujours l'oeu-
vre de bergers? Il en existe aussi près de zones habitables toute l'année88, position identique à
celle des dalles gravées placées à coté du site néolithique moyen de Saint-Léonard en Valais
(3750 BC à 3250 BC). De nombreuses figurations sont d'âge plus récent et seront évoquées ulté-
rieurement.
Les prospections d'autres chercheurs ont révélé des pierres à cupules en bas et Nord-
Dauphiné, dans le Grésivaudan, dans le Chablais près du Léman et dans le Bugey savoyard où
des dates, 2920 BC et 1890 BC, obtenues à Billième sur des charbons de bois de deux couches
qui jouxtaient la base de la pierre, prouvent l'ancienneté de leur fréquentation. La grande dalle de
fermeture du dolmen de Tallard, au Sud de Gap, couverte de cupules est de forme grossièrement
anthropomorphe dans le style de certaines stèles ardéchoises. L'étude de cet art rupestre, actuelle-
ment en plein essor, permettra de mieux connaître la religiosité des peuples alpins en rapport
avec leurs implantations, leurs activités et l'origine des influences subies.
85 A Saint-Priest, Rhône et Grenoble 86 De F.Ballet et P.Raffaeli 87 Cupules, sillons, anthropomorphes, spirales, labyrinthes, etc. (Fig. 16) 88 A Aussois et Sollières-Sardières (Savoie)
44
Fig. 16. Art rupestre alpin de Savoie.
1: Gravures diverses et pédiformes, Néolithique et âge des métaux, Lanslevillard; 2 et 4: Chasse au bou-
quetin avec chiens; 3 et 5: Soldats casqués avec lance; 6: Chasse avec chiens et soldats casqués à cheval et
à pied; Chasse avec chiens et cavalier. (2 à 6: âge du Fer, Aussois; 7: âge du Fer, Sollières). (échelles di-
verses). Relevés F. Ballet et P.Raffaelli.
De la fin du Néolithique seraient les peintures de Saint-Jean-d'Arvey près de Chambéry
sur les parois d'un abri-sous-roche. Sur cinq mètres se développent des panneaux de ponctuations,
de traits et de signes à l'ocre rouge, jaune et orangé où se distinguent des figures rayonnantes et
45
deux anthropomorphes en forme d'ancre renversée. Cette composition peinte serait, selon
P.Ayrolles, d'inspiration ibérique dans la ligne de celles de l'Ardèche, placées comme celle-ci
loin de toute zone habitable. Vraisemblablement du même âge et de la même origine seraient les
27 grilles et résilles peintes à l'ocre de l'abri d'Eson à Pont-de-Barret en Diois. Plus difficiles à
dater sont les gravures pariétales d'abris-sous-roche ou de rochers en Vercors et en Diois89 dues
peut-être à des bergers et étalées sur une longue période, protohistorique et historique.
DÈS LE NEOLITHIQUE, LE PREMIER DOMAINE ALPIN
S'il est un exemple où archéologie, géographie et géologie sont étroitement liées c'est la
région des vallées supérieures de l'Arc et de l'Isère en Savoie, et celles des Doires Baltée et Ri-
paire sur le versant italien, là où se met en place le premier peuplement de la haute montagne, au
coeur des Alpes (Fig. 17).
L'archéologie
Quels sont les faits: sur une centaine de trouvailles ou sites néolithiques de Savoie, près
d'une cinquantaine se placent en Maurienne et en Tarentaise, densité élevée peu commune à cette
époque pour des régions montagnardes aux surfaces exploitables relativement restreintes, attes-
tant une forte implantation humaine. En outre ces derniers vestiges sont exclusivement localisés
à la partie haute des vallées, en amont de Moûtiers sur l'Isère, en amont de Saint-Jean-de-Mau-
rienne sur l'Arc. En haute Tarentaise, à Aime, une nécropole avec tombes de type Glis-Cham-
blandes est datée de 3450 BC, datation qui ne concerne qu'une tombe et ne fixe pas la durée
d'utilisation de la nécropole riche de plus d'une dizaine de coffres. D'autres du même type, an-
ciennement découvertes à Aigueblanche et un vase à Bozel sont aussi des éléments Cortaillod.
En haute Maurienne, les Balmes de Sollières, fouillées depuis 1978 par P.Benamour, ont livré un
récipient en écorce de bouleau contenant des céréales et une pendeloque de type Port-Conty dans
des niveaux datés de 3660 BC et 3400 BC; c’est un Cortaillod récent en accord chronologique
avec la nécropole d'Aime et les dates du Valais (3800 à 3200 BC).
Au Néolithique moyen ces deux régions présentent donc une imprégnation culturelle
identique par le faciès valaisan et vaudois de la civilisation de Cortaillod avec tombes et maté-
riels caractéristiques. Or entre Tarentaise et Maurienne les communications sont aisées par le col
de la Vanoise (Fig. 17) qui relie l'Isère et l'Arc, voie fréquentée depuis toujours par les paysans et
les marchands locaux.
89 A Corrençon, Autrans, Engins et Choranche en Vercors (Isère), à Bourdeaux en Diois (Drôme) etc.
46
L'origine de ce peuplement en Savoie se trouve sur le versant oriental italien, en Val
d'Aoste sur le cours supérieur de la Doire Baltée, lui-même arrivé du Valais suisse à travers le col
du Grand-Saint-Bernard comme en témoignent huit nécropoles à multiples coffres Glis-Cham-
blandes. Dans le Val de Suse la nécropole de Chiomonte-la Maddalena et son habitat avec cé-
ramique Cortaillod, datés de 4000 à 3600 BC, ont la même provenance culturelle. Entre les por-
tions supérieures du Val d'Aoste et du Val de Suse il n'existe aucune possibilité de communica-
tion aisée à travers les chaînes orientées Ouest-est; le Val de Suse a dû être atteint à partir de l'est
par le canal de la Tarentaise puis de la Maurienne.
Val d'Aoste et Valais avec les sites cultuels et funéraires contemporains et très sembla-
bles de Saint-Martin-de-Corléans et de Sion, inspirés probablement des monuments de Franche-
Comté, montrent avec éclat les liens qui unissent les deux régions de part et d'autre du Grand-
Saint-Bernard; il reste à trouver, sur un cône de déjection savoyard leur équivalent français!
Un argument supplémentaire de l'unité culturelle alpine est celui de l'art rupestre gravé
sur les blocs erratiques et les dalles polies par les glaciers: les motifs ont de grandes similitudes
avec ceux, aussi très abondants, du Val de Suse et du Val d'Aoste. La parole est aux spécialistes
de l'art qui pourraient nous en dire plus sur les concordances dont les études sont en cours.
Le nom des torrents, sept Doires (Doria) en Val d'Aoste et deux en Val de Suse, huit Do-
rons en Savoie, quatre Drances en Valais et quatre Dranses en Chablais90 marquent encore au-
jourd'hui l'homogénéité du domaine rhodanien des tombes Glis-Chamblandes et du premier peu-
plement des Alpes internes, il y a 6000 ans, homogénéité qui persistait encore au moment où ces
hydronymes sont apparus et dont il est impossible de fixer la date.
La géographie
La géographie explique aussi l'isolement et l'identité culturelle que démontre l'archéolo-
gie: ces deux régions, haute Maurienne et haute Tarentaise, communiquent avec le Sillon alpin à
l'Ouest par 30 à 40 km de gorges profondes qui entaillent des terrains métamorphiques durs. Les
bords abrupts, le fond étroit et les rivières tumultueuses rendent le passage quasi impossible sans
infrastructures même si quelques sentiers précaires et malaisés ont été tracés sur les pentes boi-
sées inhospitalières. Aujourd'hui encore ces gorges recèlent peu de villages. Par contre, en amont,
les roches plus tendres ont été modelées en relief adouci par les érosions glaciaires et offrent des
90 Val d'Aoste: Dora di Veni, di Ferret, di Valgrisanche, di Verney, di Rhèmes, Baltea. Val de Suse: Dora Riparia, di
Bardonecchia. Tarentaise: Dorons de Bozel, des Allues, de Champagny, de Pralognan, de Belleville, de Chavière, de Valpremont.
Maurienne: Doron de Termignon. Valais: Nant de Drance, Drances de Bagnes, de Ferret, d'Entremont. Chablais: Dranse, Dranses de
Morzine, de la Manche, d'Abondance
47
bassins étagés propices à l'habitat, à la culture et à l'élevage sur des replats ensoleillés; des cols
aisément praticables, le Petit-Saint-Bernard et ceux de la zone du Mont-Cenis, les font commu-
niquer sans difficulté avec le Val d'Aoste et le Val de Suse. Une barrière à la pénétration humaine
à partir du Sillon alpin s'établit non pas à la ligne de partage des eaux placée sur les plus hautes
crêtes, sur la frontière actuelle, mais bien plus à l'Ouest au niveau de la chaîne granitique des
massifs centraux qui s'étend entre le Mont-Blanc et Belledonne, seulement entaillée par l'Arc et
l'Isère.
F.Fedele dès 1976 puis A.Bertone en 1990 ont déjà défini une unité entre les vallées de
l'Arc, de la Doire Baltée et du Chisone remarquant "que les gisements se concentrent dans les
parties moyennes et hautes des vallées et des vallons latéraux, zones placées en amont des sillons
morphologiques caractérisés par un accès difficile à partir de la plaine", bien que le Val de Suse
s'ouvre sans contrainte géographique majeure sur la plaine piémontaise.
J'irai plus loin que mes collègues en rassemblant les quatre hautes vallées alpines, celles
de la Doire Ripaire, de la Doire Baltée, de l'Arc et de l'Isère après avoir dit que leur peuplement
initial provient du haut Rhône en Suisse, entre 4000 et 3500 BC. C'est le début d'une entité alpine
disposée de chaque coté de la ligne de partage des eaux (Fig. 2) et des cols transalpins sur des
terroirs favorables à une économie agro-pastorale, à une époque où le climat était plus clément
que l'actuel91.
La géologie
Un peuplement établi dans de telles conditions peut surprendre car pourquoi affronter les
difficultés de l'altitude et du climat alors que les terres vierges et fertiles ne manquent pas à des
altitudes plus clémentes pour les agriculteurs?
Il s'explique bien, par contre, si on envisage l'exploitation, dès le Néolithique moyen, des
roches vertes abondantes et variées dans ces régions; n'oublions pas que la plupart des lames po-
lies trouvées entre Rhône et Durance proviennent de là, sans parler des zones plus lointaines où
elles ont diffusé au Nord, à l'Est et à l'Ouest92. L'exploitation des roches vertes a-t-elle induit le
peuplement de la haute montagne ou bien n'est-elle que la conséquence d'une occupation motivée
par d'autres raisons? un argument fait pencher pour la première hypothèse car les tombes de type
Glis-Chamblandes ne débordent pas, vers l'est, la limite géologique des gîtes de roches vertes tant
91 La limite supérieure de la forêt était 200/250m plus haute qu'aujourd'hui comme le montrent les pollens de la tourbière du
Besset en Maurienne. 92 Comme les haches de prestige de Carnac en Bretagne en omphalite du Val d'Aoste...
48
dans le val de Suse qu'en val d'Aoste. Au Néolithique moyen les hommes s'installent donc bien
sur les zones de roches aptes à la fabrication des lames de hache.
L'évolution du "domaine alpin" d'altitude
Mais pour homogène que soit son peuplement lors de sa formation, cette région a été en
contact précoce avec des influences extérieures, probablement comme conséquence des échanges
liés à l'exportation des haches polies. Ainsi la grotte des Balmes à Sollières a livré quelques tes-
sons d'allure chasséenne associés à des dentales de la Méditerranée. Sur le versant italien, la val-
lée de Suse, à Chiomonte-la Maddalena et San Valeriano à Borgone-di-Susa, possèdent aussi de
la céramique chasséenne tardive93, des lames et lamelles en silex provenant de la basse vallée du
Rhône ou de Provence et même de l'obsidienne sarde. Se pose le problème de la voie de leur ar-
rivée car la Maurienne ne semble pas encore ouverte à l'Ouest vers le Sillon alpin, ce qui laisse
penser que le Chasséen méridional est parvenu à partir du versant italien. Deux possibilités s'of-
frent alors: soit le tracé occidental de la Durance par le col du Mont-Genèvre vers la Doire Ri-
paire puis, dans un mouvement récurrent, vers la haute Maurienne par les cols du Mont-Cenis;
cette voie a la préférence de F.Fedele à laquelle s'oppose le fait que Briançonnais et haute Du-
rance n'ont toujours pas livré de sites chasséens qui traduiraient une présence au Néolithique
moyen. La deuxième hypothèse serait une remontée de Chasséens sur le versant oriental des Al-
pes à partir des sites de Ligurie puisque le Piémont, la plaine du Pô et même l'Emilie les connais-
sent assez largement; plusieurs spécialistes piémontais adoptent actuellement cette opinion.
Les contacts des vallées savoyardes avec la Lombardie sont marqués, entre 3000 et 2500
av. J.C., par quelques témoins de la civilisation de Remedello à Fontaine-le-Puits en Tarentaise,
avec la première présence du métal au coeur des Alpes françaises. Aux Balmes de Sollières une
plaquette en nacre et un vase à métope incisé se rattachent à la même influence.
La Maurienne possède des éléments du Néolithique récent méridional: parures94 et alêne
losangique en cuivre toujours à Sollières-Sardières avec une date de 2500 BC. Méridionales aussi
pourraient être les 17 lames trouvées avec de nombreux ossements au pied d'un rocher à Fontcou-
verte en Maurienne. Ces témoins sont à rapprocher de l'ossuaire en grotte à Boira Fusca (vallée
de l'Orco) et de la tombe collective d'Alto (Val Varaïta) à forte saveur méridionale95 et des vases
à cordons horizontaux languedociens de Chiomonte en Val de Suse et de Roure-Balm'Chanto
(datés de 2570 BC) en Val Chisone. A l'Ouest du lac de Garde le rite funéraire habituel est la
tombe collective en grotte ou en abri sous roche, pratique retrouvée à Modane dans une grotte et
93 Décors gravés sur marli, baguettes multiforées, anses en cartouchière, etc. 94 Perles à ailettes, pendeloques à crochet, dentales et coquilles marines 95 Qui possèdent aussi lames de silex et colliers de dentales
49
Figure 19 : Domaine alpin d'altitude
à Foncouverte au pied d'un gros bloc avec de "grands couteaux " de silex. A-t-on là l’influence
méridionale ou celle du Piémont? le matériel est perdu et les anciens comptes-rendus ne sont pas
assez explicites pour en décider. Pour atteindre les vallées italiennes et la Maurienne le courant
méridional est-il passé par la Durance et le col du Mont-Genèvre; c'est probable car nous n'avons
50
pas encore de preuve du désenclavement vers l'Ouest des hautes vallées savoyardes et ce faciès
culturel est absent de la Combe de Savoie et du Grésivaudan en amont de Grenoble, zone qui au-
rait pu servir de relais. En outre nous savons que dans les Hautes-Alpes le Néolithique récent
méridional est très largement représenté, remontant jusqu'au col du Mont-Genèvre ce qui n'était
pas le cas au Néolithique moyen.
Des populations établies sur les versants occidental et oriental ont prospéré pendant des
millénaires dans les bassins élevés, reliés entre eux par de nombreux cols, profitant de la clé-
mence du climat qui régnait à la fin de l'Atlantique. Cette implantation permanente déterminée, à
l'origine, par l'exploitation des roches vertes a mis en valeur la haute montagne alpine, malgré les
péjorations climatiques ultérieures auxquelles il fut fait face avec de grandes capacités d'adap-
tation; les premiers Alpins ont su se plier aux dures réalités montagnardes et tirer profit des res-
sources et des voies de communications. Quand les infrastructures routières héritées de l'empire
romain sont tombées en ruine, aux VIIIe-IXe siècles, l'évêque de Moutiers est devenu suffragant
de celui de Sion, ce qui prouve que même à cette époque il était plus aisé pour un Tarin de se
rendre en Valais plutôt qu'à Chambéry: les anciens chemins plusieurs fois millénaires reprenaient
du service...
L'homme de Tarentaise et l'Homme du Similaun
En 1908, à Fontaine-le-Puits en haute Tarentaise, furent ouvertes des tombes96 dont une
fut l'objet d'une fouille méticuleuse. Comme pour la découverte récente de la momie sur la fron-
tière autrichienne, il y avait une hache de cuivre, un couteau de silex et un carquois avec pointes
de flèches en silex. Un autre élément identique accentue la comparaison, celui d'un outil d'usage
quotidien, rarement reconnu: le retouchoir à silex pour raffûter briquet, couteau ou pointes de
flèche: c'est un fragment de bois de cerf enfoncé dans une branche de tilleul pour l'homme du
Similaun et une petite barre de cuivre enfoncée dans un andouiller pour le Savoyard. Autre détail
troublant mais significatif, dans les deux cas le corps était accompagné par une petite lame de
silex tranchante trapézoïdale quasi identique. Si les ressemblances sont frappantes entre les deux
découvertes en ce qui concerne l'équipement des hommes de cette époque, la sépulture de Taren-
taise montre que les vestiges de cuivre comme le rite funéraire ont leur origine culturelle et
technique dans la civilisation de Remedello en Italie du Nord. Le défunt de Tarentaise faisait
probablement partie d'un groupe de "Lombards" qui avaient remonté la Doire Baltée pour péné-
96 Les corps repliés sur le coté, le mobiler avec hache plate, poignard, pendeloque en cuivre, lames de silex, haches polies, etc sont
caractéristiques de Remedello. Une hallebarde en cuivre dans une autre tombe (Fig. 12-B) est la seule connue sur le versant Ouest
alors qu'elles ne manquent pas en Italie du Nord figurant sur des stèles gravées dans le Val Camonica et le Trentin où s'était établie
une métallurgie du cuivre très précoce avant 3000/3200 BC.
51
trer dans le coeur du domaine alpin puis franchi le col du Petit-Saint-Bernard; se sont-ils installés
définitivement en formant une colonie parmi les indigènes, gardant leurs armes, leurs outils et
leur religion? Etaient-ils des prospecteurs de cuivre dans une région qui en est bien pourvue?
PREMIÈRES DIFFUSIONS DU BRONZE
La diffusion du métal dans les Alpes suivra deux processus bien différents. Au Bronze an-
cien comme au Bronze moyen, le métal parviendra de centres de fabrication lointains, à la fin de
leur apogée, quand ceux-ci verront leurs propres marchés saturés et qu'ils devront trouver hors de
la zone directement soumise à leur emprise des débouchés indispensables à leur survie économi-
que. Ceci explique le retard relatif pris par les Alpes du Nord dans l'équipement métallique par
rapport aux régions de productions.
Ces exportations de bronzes ne s'accompagneront pas d'influences culturelles significati-
ves, même si des petits foyers secondaires d'extraction de minerai et de façonnage se mettent en
place sous l'égide et avec les procédés des "étrangers", au Bronze ancien. Dès le début du Bronze
final au contraire la diffusion du métal sera entourée de tout un ensemble culturel, technique et
probablement humain qui se traduit par la métallurgie, la céramique, les rites funéraires dépas-
sant très largement ce que laissent de simples contacts commerciaux. Ces deux processus ne sont
en rien comparables et répondent à des modalités de mise en place bien différentes: le déplace-
ment des hommes (hors des marchands, bien sûr) n'intervient pas pour le premier mais prend une
grande importance pour le second.
Jusqu'au XIVe siècle les Alpes ont vécu avec une économie et des techniques héritées du
Néolithique et lentement mûries par l'évolution générale où l'impact campaniforme n'est pas à né-
gliger comme substrat à la diffusion du métal. Celui-ci est importé et s'il marque des échanges et
des contacts extérieurs, il n'a pas bouleversé les traditions mais a apporté une simple amélioration
à la vie quotidienne. Un changement plus radical dans les mentalités, dans les activités et dans
les sociétés interviendra à partir du Bronze final.
Le cadre chronologique (Fig. 3)
Le système chrono-typologique de l'Est de la France défini dans les années 50 par J.J.Hatt
a été peu à peu modifié dans ses limites chronologiques des âges du Bronze ancien et moyen avec
les résultats des nouvelles recherches et surtout depuis l'utilisation des données dendrochronolo-
giques et la calibration du radiocarbone. Ces limites sont aussi fonction des critères appliqués par
les spécialistes pour définir la fin d'une période et le début de la suivante, c'est assez dire qu'elles
sont floues et toujours subjectives. A l'avenir il serait préférable de parler en dates, en siècle par
52
exemple, et non en "âge" qui prend aujourd'hui une signification plus culturelle que chronologi-
que; comme le dit J.P. Millotte "je persiste à croire que ces divisions typo-chronologiques doi-
vent être manipulées avec souplesse et que les datations archéométriques risquent, dans cin-
quante ans, de rendre ces séquences obsolètes.
C'est ainsi qu'en Suisse occidentale et en France de l'Est, le Bronze ancien ne débute plus
vers 1800 mais vers 2100 av. J.C. et sa partition tripartite est conservée par la plupart des auteurs.
Il se terminait vers 1500 avec le début du Bronze moyen que l'on fait commencer aujourd'hui vers
1650/1600 av. J.C. Nous avons parfois été gêné par l'absence d'une période de transition entre
Bronze moyen et Bronze final identique au Bronze D des auteurs germaniques; elle correspond
en effet à des modifications culturelles et techniques qui se placent, chez nous, à cheval sur le
Bronze moyen et le Bronze final. C'est cette difficulté qui a obligé J.Vital à reprendre
l’appellation "Bronze récent" pour le matériel de Donzère placé entre 1450 et 1300 av. J.C., pa-
rallèlisable grosso modo au Bronze moyen III de J.J.Hatt. Afin de ne pas bouleverser les concep-
tions de la plupart des auteurs, je préfère ne pas utiliser ce terme mais celui de Bronze final pour
recouvrir, dès leur début, les changements sociaux, techniques et culturels aussi bien germani-
ques, de France orientale que d'Italie du Nord qui se mettent en place après le Bronze moyen. De
toute façon les chevauchements des différentes "civilisations" ne s'accommoderont jamais d'un
carcan chronologique et culturel trop rigide et les évolutions sont toujours progressives et pleines
de nuances à l'intérieur d'un continuum en perpétuelle mutation.
Les matériaux de la métallurgie: le cuivre et l'étain
Le cuivre
Le cuivre n'est pas rare dans les Alpes et la carte de répartition de ses gisements (Fig. 18)
parle d'elle-même. Ce sont les massifs métamorphiques internes qui en sont les mieux pourvus
toutefois certaines zones calcaires en possèdent, au Sud du lac Léman en Chablais-Faucigny, au
Sud-Est d'Annecy, autour du Buech et de Gap et dans les Baronnies. La présence du cuivre n'im-
plique pas forcément une exploitation de minerai cependant quelques concordances entre gîtes
minéraux et points de découvertes d'objets en bronze97 ne sont pas toujours le fruit du hasard.
97 Il sera fait allusion à plusieurs reprises à des analyses des métaux; bien que des progrès aient été faits dans cette science, les
résultats ne sont encore qu'indicatifs des grandes tendances d'évolutions techniques et les productions régionales sont mal connues.
Il en sera ainsi tant que tous les bronzes, pièces ou fragments ainsi que bien des minerais, ne seront pas analysés car la méthode des
échantillonages aléatoires se révélant décevante. Cela est vrai aussi de la dendrochronologie qui est vraiment utile seulement quand
tous les bois d'un site sont analysés...
53
Figure 18 : Gisements de cuivre
Tous les minerais de cuivre n'ont pas un égal intérêt pour le bronzier ancien dont les
techniques restaient encore assez rudimentaires; ce sont, semble-t-il, les carbonates et les sulfures
à haute concentration de métal98 qui ont été les premiers exploités. Nous ne pourrons connaître
98 Malachite et azurite, carbonates souvent présents dans les têtes de filons et repérables par leur teinte bleu-vert. La bornite et les
cuivres gris ( ou fahlerz: sulfo-antimoniures et sulfo-arséniures de cuivre) sont généralement plus profonds. Quant à la chalcopyrite
(sulfure double de fer et de cuivre) très abondante, sa métallurgie plus complexe est probablement plus tardive.
54
véritablement l'origine du métal des objets seulement quand nous disposerons d'analyses tant de
ces objets que des divers minerais présents dans les Alpes; actuellement nos conclusions ne peu-
vent être que conjecturales.
A l'âge du Cuivre
En Tarentaise près des gîtes cuprifères de Macot, Pesey, Saint-Bon et Champagny se pla-
cent les sépultures de Fontaine-le-Puits qui ont pour origine la civilisation chalcolithique de Re-
medello qui a fleurit en Lombardie au IIIe millénaire; il n'est pas impossible que les métallurgis-
tes aient traversé les cols à la recherche de nouveaux gisements dans les massifs centraux. A
l'Ouest, les haches en cuivre d'Annecy-le-Vieux, de Sévrier et de Faverges près du lac d'Annecy
ne sont pas très éloignées des gîtes de Montmin, Saint-Ferréol et Ugine. Une autre à Saint-Pierre-
d'Albigny dans la Combe de Savoie est proche de ceux de la région d'Albertville et d'Aiguebelle.
Dans les Hautes-Alpes la hache de Ribiers99, sur la Durance, est à 25km en aval du cuivre gris de
Remollon. Remarquons que j'ai cité toutes les haches (sauf une) en cuivre connues dans l'avant-
pays et qu'elles ne sont pas éloignées de gîtes de cuivre exploitable; pourtant la plupart des pièces
sont à forte teneur en argent donc fabriquées à partir de minerais extérieurs aux Alpes, comme on
l'a vu; les prospecteurs, si prospecteurs il y a, n'auraient pas encore été métallurgistes... De le
même façon le dolmen de La Bâtie-Neuve, Hautes-Alpes, avec ses perles de cuivre et son mobi-
lier à saveur languedocienne, est bien voisin des filons du dôme de Remollon, d'Avançon ou de
Théus.
Aux Bronze ancien et moyen
Au Bronze ancien, la civilisation du Rhône a exploité activement les mines de cuivre du
Valais et dans les Alpes françaises il est intéressant de constater que plusieurs objets issus de
cette civilisation sont groupés dans la haute vallée de l'Isère. Il semble donc très possible que les
Valaisans aient ouvert quelques uns des gisements cuprifères de la Tarentaise à partir des cols du
Grand et du Petit Saint-Bernard. La Maurienne possède des sites100 mais pas de matériel métalli-
que: ses gisements de cuivre sont formés de chalcopyrite dont le traitement difficile ne sera
connu que plus tard, au Bronze final.
Plus au Sud, cette civilisation se trouve bien représentée aussi dans les Hautes-Alpes, en
particulier dans la vallée du Buëch, de la Durance et de la haute Drôme, ainsi que dans les Baron-
99 Elle est en cuivre avec 2% d'antimoine et les gîtes de cuivre voisins sont formés de panabase, minerai qui contient aussi de
l'antimoine; portant des rebords nets, de type Bronze ancien, on peut imaginer que cette pièce a été réutilisée et que ses cotés ont été
martelés tardivement. 100 Céramique à Sollières-Sardières
55
nies. Pour ces régions, pratiquement toutes les découvertes archéologiques (que nous verrons
plus loin) sont proches de gisements de cuivre101. Dans la haute vallée de la Durance, l'exemple
de Champcella avec plusieurs sépultures de riches personnages, à côté de gîtes, est tout à fait
éloquent. L'exploitation des mines de cuivre de Saint-Véran102 en Queyras est datée par des tes-
sons du Bronze ancien-moyen trouvé dans l'habitat voisin de Pinilières.
Au Bronze moyen, il n'existe pas d'objets fabriqués dans les zones alpines et rien ne per-
met d'affirmer une quelconque exploitation minière.
Au Bronze final
Au début du Bronze final, une densité particulière de vestiges touche la basse vallée de l'-
Arve, le Faucigny et le Chablais, ce qui n'est peut-être pas sans rapport avec le cuivre de Belle-
vaux, Reyvroz, Sixt, Onnion, le Biot, etc.
Au cours du Bronze final certains des nombreux filons de Tarentaise et de Maurienne ont
dû être exploités103: ceux du massif des Sept-Laux104 ont-ils fourni une partie du cuivre des dé-
pôts de Goncelin, d'Albertville105, de Thénésol et des haches issues de la métallurgie locale mal-
gré la présence de lingots italiques? Il y a une densité particulière des dépôts du XIe siècle dans
la Combe de Savoie et au Nord du Grésivaudan.
Au Sud, dans les Hautes-Alpes l'abondance des dépôts d'altitude dont les caractères très
originaux les font attribuer avec certitude à une production locale, sont très certainement en rap-
port avec les richesses en minerai de la région, même si ce n'est pas la seule raison de leur pré-
sence.
A l'âge du Fer
Aux âges du Fer, l'occupation des hautes vallées alpines est intense. Les vestiges provien-
nent de l'abondant mobilier des tombes plates caractéristiques des Alpes parmi lequel la typolo-
gie nous permet de retrouver des groupes correspondant aux grandes vallées de pénétration:
groupe de la Tarentaise-Maurienne, groupe de Rochefort-Oisans et pour les Hautes-Alpes, groupe
101 A Avançon, Remollon, Théus, Espinasse, Savines, les Crots, Orpierre, Saléon (Hautes-Alpes); Propiac, Beauvoisn et Buis-les-
Baronnies (Drôme). 102 Aux Clausis il y a un creuset, une tuyère et des scories 103 Sollières-Sardières près des filons de Termignon comme ce sera évoqué plus loin 104 Albertville, Bonvillard, Monvillard, Saint-Paul-sur-Isère, Aiguebelle, Montgilbert, Monsappey, Petit-Coeur, la Table, le
Bourget-en-Huile, Argentine, Presles, Saint-Pierre-d'Allevard, Allevard, Pinsot, Theys. 105 Ce dépôt provient en réalité de Saint-Pierre-d'Albigny, à une vingtaine de kilomètres en aval d'Albertville
56
du Haut-Drac (Champsaur), groupe de la moyenne Durance, groupe de la Haute-Durance, groupe
du Queyras-Ubaye. Dans chacune de ces régions le cuivre est toujours abondant ce qui peut ex-
pliquer pourquoi les habitants des Alpes internes sont restés bronziers, voulant ignorer la métal-
lurgie du fer jusqu'à l'arrivée des Romains.
Il est évident que certaines productions de bronze de l'avant-pays ont dû avoir recours aux
cuivres alpins mais analyses et études approfondies manquent pour l'attester avec certitude.
L'étain
L'étain n'existe pas dans le domaine alpin sous quelque forme que ce soit et son origine
sera bien difficile à préciser tant qu'on ne disposera pas d'analyses mesurant ses traces ou ses
isotopes. Son origine peut toutefois être approchée de manière indirecte. Dans les Alpes, au dé-
but du Bronze final, la première trace accompagnant le trafic de l'étain, indispensable autant à la
métallurgie régionale qui s'installe qu'aux pays méditerranéens, est représentée par cinq haches à
talon de type normand disséminées du Nord au Sud de la région106. Ce serait l'indice d'une prove-
nance britannique par la voie de la Seine et du couloir Saône-Rhône. Plus tard, à la fin du Bronze
final et au début de l'âge du Fer ce n'est plus l'Angleterre qui fournit l'étain mais la Bretagne
comme l'indiquent les haches à douille carrée ou rectangulaire107 toujours d'origine bretonne. La
concentration de six d'entre elles, entre le Rhône et le col du Mont-Genèvre, désigne l'axe d'un
courant commercial qui alimenterait en étain l'Italie du Nord. Pour juger de l'importance de ces
importations et de ce trafic, remarquons que le territoire suisse a fourni seulement deux haches à
douille carrée alors que nous en avons quinze ou seize sur un espace bien plus restreint... Par
contre le Midi en est aussi très largement pourvu, vraisemblablement en rapport avec le com-
merce entre l'Occident et Marseille ou les autres comptoirs grecs dès le VIIe siècle108.
AGE DU BRONZE ANCIEN env. 2100 à 1650 av. J.C. (Fig. 19 et 20-A)
Le défrichement subit une accélération dès la fin du IIIe et au début du IIe millénaire que
traduisent les modifications du milieu végétal et qu'on perçoit en sites archéologiques ou en
tourbières109. Cela correspond à de nouvelles influences qui imprégneront les Alpes du Nord à
106 A Doussard (Haute-Savoie), Vaulx-Milieu et La Balme-les-Grottes en Nord Dauphiné, Grenoble (Isère) et Châteauroux
(Hautes-Alpes); au Nord du massif de Crémieu, à peu de distance du Rhône existe une lance à oeillets anglaise de la fin du Bronze
moyen, trouvée à St-Georges-de-Remens, dans le lit de l'Albarine à son confluent avec l'Ain 107 A Thonon, Pontcharra (dépôt de quatre pièces), Grenoble, Villard-Notre-Dame,Vienne, le Pègue, Ballons, Bésignan, Saint-
Pierre-Avez , la Beaume, Saint-Clément et la vallée de l'Ubaye. Au Nord du massif de Crémieu on a aussi la hache des environs de
Belley, très près du Rhône 108 Voir l'épave de Rochelongue à Agde 109 Choranche et Seyssinet-Pariset (Fig. 14) en Vercors, Hières-sur-Amby et Chirens en Nord Dauphiné et Lyon-Vaise
57
partir du Valais et du Chablais vaudois; quatre régions sont à distinguer dans les Alpes où cette
influence se manifeste de manières différentes.
L'avant-pays à l'Ouest du Sillon alpin
La rive Sud du lac Léman est directement intégrée au noyau de la civilisation du Rhône
tant par le matériel métallique110 que par le rite funéraire en coffre de pierres111 à l'instar de ce
qui existe sur la rive Nord du lac Léman. Plus au Sud l'imprégnation rhodanienne est moins nette,
plus diffuse sans pour autant être absente. La station littorale de Veyrier sur le lac d'Annecy, avec
une hache de Neyruz, et une autre sans matériel, découverte récemment à Sévrier (datée de
-1665), pourraient être les symétriques des stations installées au Nord du lac Léman, comme
Morges. Tout en restant prudent en l'absence d'autres vestiges, ces deux sites entrent parfaitement
dans le courant qui a installé des habitats littoraux au Sud de l'Allemagne et en Suisse à la fin du
Bronze ancien.
La vallée du Rhône supérieur et le couloir rhodanien sont parcourues par ces influences
marquées seulement par du métal, souvent abondant comme dans la région de Vienne et la vallée
de la Bourbre, ou par quelques céramiques caractéristiques en Savoie, au Sud de Lyon, en Dau-
phiné112. Dans les zones subalpines plus orientales la céramique rhodanienne typique est rare
mais les récipients courants changent de forme113; les importations métalliques, le plus souvent
tardives114, ne s'accompagnent pas de modification des rites funéraires qui restent collectifs et en
grotte115. L'influence rhodanienne est dominante, quand on considère la densité particulièrement
élevée des bronzes116 mais quelques objets parviennent en plus de la zone rhénane de l'Adlerberg
et du domaine dit "nord-alpin" par les auteurs suisses117.
110 A Thonon, Cranves et Etrembières (Haute-Savoie) 111 A Thonon, Chens-sur-Léman et Allinges (Haute-Savoie) 112 Haches des Roseaux et de Neyruz, poignards triangulaires et à manches massifs ou céramique à décor en résille à La Balme-
les-Grottes, Vernas, vallée de la Bourbre (Cessieu, etc.), Ternay, Chasse, Vienne (Isère); Loriol, Mirabel-aux-Baronnies, Vaison-la-
Romaine (Drôme). 113 Tasse des Roseaux à la Buisse au débouché de la cluse de Grenoble, céramiques à "saveur du Rhône" à Choranche en Vercors
occidental, vase à cordon à Vercoiran dans les Baronnies (Drôme) etc. Les formes sinueuses de type helvétique apparaissent 114 La hache type Neyruz de Chanas (Isère), en cuivre et à bords faiblement martelés est plus ancienne que les haches-spatule de
Saint-Sulpice (Savoie), au dessus du lac du Bourget, de Pontcharra (Isère), en Grésivaudan, et les haches type Neyruz d'Aix-les-
Bains (Savoie); de Chasse ou de Ternay dans la vallée du Rhône et de Sinard (Isère), en Trièves plus au sud; épingle de type du
Broc avec une tasse des Roseaux à Nyons, céramiques à Chastel-Arnaud (Drôme) 115 Ossuaires de Claix, la Buisse, Saint-Quentin-sur-Isère autour de Grenoble, Mours-Saint-Eusèbe (Drôme) dans les collines de la
basse Isère, Plan-de-Baix, Montmaur et Saint-Nazaire-le-Désert en Diois et Sigottier, Montmorin près du Buech (Hautes-Alpes),
etc. 116 Et qui va être confirmée par le matériel des Hautes-Alpes 117 Une épingle en écusson gravée à Etrembières (Haute-Savoie), et un petit vase cylindrique à décor géométrique gravé à
Seyssinet près de Grenoble. Le poignard à manche massif de Rochegude, dans les Baronnies, est d'origine nord-alpine avec ses 7
rivets, sa nervure médiane prononcée et l'absence de gravure
58
Figure 19 : Bronze ancien
Des couches du Bronze ancien en grotte sont datées de 1930 BC à Montmaur-en-Diois, -
1750 BC à Claix, 1620 BC à Sassenage et 1610 BC à Seyssinet près de Grenoble, 1720 BC à
Choranche en Vercors. Ailleurs les niveaux stratifiés sont confondus, par absence de fossiles di-
recteurs, avec ceux attribués à la fin du Néolithique, ce qui démontre une continuité technique
59
couvrant la fin du IIIe et le début du IIe millénaire. Les Alpes du Nord voient se mélanger inti-
mement les influences méridionales et helvétiques celles-ci étant plus nettes au Nord, celles-là
plus marquées au Sud118.
Fig. 20. Age du Bronze ancien (Early Bronze Age). env. 2100 à 1650 av. J.C. et âge du Bronze
moyen (Middle Bronze Age). env.1650 à 1350 av. J.C.
A- Bronze ancien. 1, 2 et 3: Sépultures en grotte, Champcella, Hautes-Alpes; 4 à 7: Sépulture
collective en coffre, Allinges; 8: Cranves, Haute-Savoie; 9: Nyons, Drôme; 10 et 11: Dépot des Taburles,
Avançon, Hautes-Alpes; 12: Vercoiran, Drôme; 13: Lagrand, Hautes-Alpes. (échelles diverses).
B- Bronze moyen. 14: Dépot de Porcieu-Amblagnieu, Isère; 15: Cognin, Isère; 16, 19 et 20: Dé-
pot de Douvaine, Haute-Savoie; 17: Notre-Dame-de-Briançon, Savoie; 18, 21 et 22: Sépultures à inhuma-
tion, Saint-Paul-de-Varces, Isère; 23: Bons-en-Chablais, Haute-Savoie. (échelles diverses).
D'après: 1 à 3, 10, 11 et 13: Courtois 1960; 4 à 9, 16, 19 et 20, 23: Oberkampf 1984; 9 et 12: Gras in
Bocquet et Lagrand 1976; 14, 15,21 et 22: Bocquet 1969; 17: Combier 1971.
118 Une grotte à Montmaur-en-Diois est caractéristique avec des éléments méridionnaux et une hache de Neyruz.
60
Les Hautes-Alpes
Dans les Hautes-Alpes une sorte de "foyer secondaire" de la Civilisation du Rhône se dé-
veloppe, marqué par le dépôt119 des Taburles près de Gap, des haches, épingles ou poignards120.
A Champcella sur la Durance, les riches sépultures en grotte de défunts de rang élevé121 et celle
d'une cavité voisine bien pourvue en mobilier de bronze122 confirment l'importance de cette ré-
gion dans le commerce du métal (ou sa fabrication ?) sous l'égide des Valaisans ou leurs affidés.
Plus au Sud, des haches123 témoignent de l'occupation de l'Ubaye dès le XVIIe siècle bien qu'au-
cun habitat ne soit encore signalé.
Cette concentration d'objets rhodaniens sur un territoire restreint dans les Hautes-Alpes
n'est pas fortuite; elle doit être liée à l'exploitation des mines de cuivre illustrée par celle de
Saint-Véran que nous avons vu datée du Bronze ancien-moyen. L'influence valaisane a pu y par-
venir soit depuis le couloir rhodanien, à l'Ouest, par la vallée de la Drôme, elle-même marquée
par plusieurs ossuaires en grotte et par des bronzes124, soit par le Sillon alpin jalonné par des ha-
ches125. De toute façon ce foyer haut-alpin a pu servir de relais à la diffusion du matériel rhoda-
nien en Provence orientale126.
Les Baronnies
La présence plus fréquente qu'ailleurs de bronzes127 de type Civilisation du Rhône dans
cette partie de la basse Drôme est probablement liée aussi à l'exploitation des filons de cuivre de
cette région; l'abondance des ossuaires collectifs en grotte ou en hypogées montre une forte
densité du peuplement qui reste culturellement rattaché à la sphère méridionale, en particulier le
Languedoc très touché aussi par la civilisation du Rhône.
119 Quatre poignards à manche massif et cinq haches de Neyruz (Fig. 20-A, 10 et 11) 120 A Valdrôme (Drôme) la Beaume, Aspremont, Barret-le-Bas, Lagrand, Ribeyret, Serres et Sigottier (Hautes-Alpes) 121 Avec un poignard, une hache-spatule et un gorgerin en tôle gravée 122 A Freissinières avec une hache des Roseaux, un petit poignard triangulaire à deux rivet du type Lussan et un fragment de
hache-spatule; remarquons que ces sites sont très proches des gîtes de cuivre de Champcella... 123 Du type des Roseaux et de Neyruz à Saint-Pons, Fours et Faucon 124 Hache type Neyruz de Montmaur (grotte de Solaure ou du Fournet et non d'Antonnaire comme l'indique J.Bill, 1973),
hache-spatule de la Beaume, poignard à manche masif de Valdrôme 125 A Pontcharra et Sinard en Isère 126 Haches de Neyruz et poignards de Solliès-Pont, Var, etc. 127 Haches de Rochegude, épingle de Nyons, deux poignards de Mirabel-aux-Baronnies
61
Les massifs internes de Savoie
Par où sont arrivés les poignards rhodaniens et la hache-spatule de Tarentaise128 et les mi-
neurs qui ont exploité des filons de cuivre près de Moutiers129? Une tombe à Bourg-Saint-Mau-
rice en Tarentaise est datée de 1880 BC; en Maurienne le site des Balmes de Sollières nous ap-
porte encore de précieux renseignements avec de la céramique rhodanienne dans un niveau daté
de 1890 BC130. Ainsi ces régions sont touchées par la mouvance rhodanienne bien que la vallée
de l'Arc n'ait encore livré aucun bronze, comme nous l'avons vu.
Hommes ou influences venus du Valais ont-ils suivi une voie occidentale avec ouverture
de la vallée de l'Isère entre Moutiers et Albertville, de la vallée de l'Arc entre Combe de Savoie et
Modane ou bien est-ce encore la voie orientale par le Val d'Aoste et le col du Petit-Saint-Bernard
qui fut utilisée? Cette dernière hypothèse est la plus plausible compte tenu de l'absence de vesti-
ges du Bronze ancien dans la partie aval des vallées; elle prolonge la diffusion culturelle du com-
plexe rhodano-Cortaillod par le Grand-Saint-Bernard, mise en place au Néolithique moyen. Cette
arrivée par l'Italie n'est pas incongrue car haches rhodaniennes et céramique en résille du Piémont
occidental131 indiquent que cette région a été touchée, elle aussi, par la civilisation du Rhône et a
probablement fabriqué elle-même des bronzes car des lingots sont associés aux objets dans le dé-
pôt d'Avigliana.
A la fin du Bronze ancien le vide archéologique en aval de Feissons-sur-Isère et en aval
de Saint-Jean-de-Maurienne traduit encore l'absence d'occupation permanente des basses vallées,
mais n'y a-t-il pas eu un début de leur utilisation pour les échanges avec l'Ouest et le Sillon alpin?
Le poignard et la hache132 de la Combe de Savoie sont-ils arrivés par l'Est ou par le Nord-Ouest?
La question reste donc en suspens avec possibilité d'ouverture de la voie alpine occidentale à la
fin du Bronze ancien, sans que cela signifie forcément que bronzes et mineurs "rhodaniens" de
Tarentaise ne sont pas arrivés par le versant italien.
128 Poignards de Séez près du col du Petit-Saint-Bernard, de Feissons-sur-Isère et hache-spatule de Moûtiers (Savoie) 129 Dans une galerie de laquelle a été trouvée la hache-spatule de Moûtiers. Il n’y a pas de cuivre à Moûtiers mais une mine
anciennement esploitée à Saint-Marcel qui est à côté. 130 Grand vase à décor en résille et une tasse décorée identique à une trouvée au Petit-Chasseur à Sion en Valais 131 Haches à Pignerol, Bio, Ivrée, Carignano, Trana, dépôt d'Avigliana, tombe de Vallare et céramiques à Bussoleno et Chiomonte,
Val de Suse 132 Poignard à manche massif à Saint-Pierre-d'Albigny et une hache du type de "la Baraque" à Aiguebelle, au débouché de la
Maurienne dans la Combe de Savoie
62
A la fin de la période un vase à anse en poucier de la Polada a été importé à Sollières tra-
duisant la poursuite des contacts avec le versant oriental italique133.
La première aristocratie alpine
Les marques de prestige que sont les poignards à manche massif et les haches-spatule134,
tout particulièrement abondantes entre Rhône et Durance135 à la fin du Bronze ancien, laissent
supposer la présence d'une classe "aristocratique" directement liée, techniquement, commercia-
lement ou politiquement, aux centres industriels du Valais. Particulièrement représentée en Ta-
rentaise, dans le Gapençais-Embrunais et dans les Baronnies, nous avons vu qu'elle devait être en
rapport avec les richesses en cuivre de ces régions. Toutefois cette classe sociale se conformant
aux rites funéraires traditionnels en grotte en usage autour d'elle, on est en droit de penser qu'elle
ne représente pas une intrusion de migrants helvétiques mais plutôt la promotion d'autochtones
dans les activités métallurgiques fort rémunératrices; ainsi se créait une structure sociale nouvelle
par une hiérarchisation ostensiblement affirmée, inconnue jusqu'alors.
Dans les Alpes une constatation troublante concerne la présence de traces d'occupation
avec céramique dans des grottes souvent très isolées et sur des hauteurs faciles à défendre (que
je n'ose pas nommer "oppidum" en l'absence de fouilles et de structures défensives mises en évi-
dence); ces traces sont attribuées au Néolithique final/Bronze ancien, au sens large, et à la fin de
l'âge du Bronze sur lesquelles nous reviendront. L'utilisation de ces sites, souvent inconfortables,
est-elle liée à des temps troublés et à la recherche de sécurité au moment où émerge une classe
dirigeante qui a pu avoir pour but le contrôle du territoire et des marchés offerts à ses produc-
tions? C'est une hypothèse à envisager.
Les rites funéraires
Au Bronze ancien le Sud du lac Léman possède des tombes en coffre136 ce qui l'incorpore
au domaine propre à la civilisation du Rhône. Les dolmens du Chablais et du Gapençais étaient
toujours utilisés à la fin du Bronze ancien137. Les rites funéraires helvétiques n'ont pas été adop-
tés par ceux qui ont reçu ou élaboré du matériel métallique ou céramique; l'influence est donc
133 En Tarentaise existe, selon une ancienne relation et sans provenance précise, un poignard à manche massif qui n'est pas
rhodanien mais trouverait son origine dans le Nord de l'Europe 134 Les haches-spatule doivent, dans le domaine rhodanien, tenir le même rôle et avoir la même signification emblématique que les
hallebardes en Italie du Nord et en Europe moyenne, qui sont, elles, absentes à l'est du Rhône 135 Treize poignards dans les Alpes du Nord .. contre dix au coeur de la civilisation du Rhône, dans les cantons de Vaud et du
Valais 136 Allinges et Thonon (Haute-Savoie) 137 Epingle à tête sphérique perforée à Cranves (Haute-Savoie), et une hache à épaulement du type la Baraque à Saint-Jean-Sait-
Nicolas (Hautes-Alpes)
63
restée plus technique que culturelle car les tombes demeurent à inhumation simple: en grotte
dans les Hautes-Alpes et en coffres individuels à Bourg-Saint-Maurice en Tarentaise. Au Sud de
Chambéry138 les ossuaires collectifs d'inspiration méridionale du Néolithique final, sont encore
très largement utilisés au Bronze ancien sans rupture ni hiatus apparent; ils ont déjà été cités.
AGE DU BRONZE MOYEN env. 1650 à 1350 av. J.C. (Fig. 21 et 20-B)
Une brève et sévère péjoration climatique
Des analyses effectuées sur des sédiments extraits à Conjux, sur les rives du lac du Bour-
get, montrent "qu'après le Néolithique final/Bronze ancien la région est pratiquement abandon-
née; seules quelques traces venues d'une présence humaine lointaine sont décelables" d'après
M.Magny et H.Richard. La cluse de Chambéry, pourtant particulièrement propice à la culture, est
désertée. Entre les XVIIe et XVe siècles un épisode de dégradation climatique apparaît dans les
diagrammes polliniques de Seyssinet-Pariset près de Grenoble (Fig. 14), correspondant à un ni-
veau argileux varvé de ruissellement daté de 1540 BC; cela se traduit par des changements agro-
pastoraux car la culture du sarrasin remplace celle des céréales et le porc devient dominant dans
le cheptel. Cette dégradation qui affecte l'Europe se fait sentir jusque sur les bords de la Méditer-
ranée et elle se traduit par l'avancée des glaciers suisses et autrichiens (stade de Loebben). L'em-
prise humaine subit-elle quelque diminution au vu d'une certaine rareté des gisements ou bien le
mode de vie change-t-il au profit d'une économie de type semi-nomade?
Ces observations traduisent une crise environnementale au cours du Bronze moyen, crise
dont il est encore difficile d'évaluer l'impact exact sur les activités et l'occupation; à Seyssinet la
pression anthropique sur l'environnement végétal ne diminue pas. Par contre les pollens du lac
Luitel, au pied du massif de Belledonne, à 1000m d'altitude, indiquent une moindre déforestation
par rapport aux époques antérieures donc une activité plus faible: cela traduit peut-être un dépla-
cement vers des altitudes moins élevées. Entre les XVIIe et XVe siècles les mauvaises conditions
climatiques, accentuées par l'effet des reliefs, fragiliseront le peuplement dont les traditions tech-
no-culturelles, en quelque sorte restées inchangées depuis trois millénaires, ne sont plus aptes à
en surmonter les difficultés. Les Alpes du Nord sont peut-être marquées par une désertification
relative mais surtout une certaine apathie technique apparaît dans le matériel archéologique,
apathie qui contraste avec l'activité et les mutations sociales qui affectent alors l'Europe
moyenne, atlantique et méditerranéenne.
138 Tout récemment un ossuaire collectif du Bronze ancien en grotte a été découvert, plus au Nord, dans le Val de Fier en Haute-
Savoie
64
Figure 21
Les influences changent d'origine
Dans les Alpes du Nord on assiste au changement complet de l'origine géographique et
culturelle des bronzes. Ceux-ci proviennent maintenant d'une sphère plus septentrionale, du Sud-
Ouest de l'Allemagne, de l'Alsace ou de Suisse occidentale et non plus du haut-Rhône comme à
65
la période précédente139; les exploitations alpines de cuivre et les productions (?) des Hautes-
Alpes ou des Baronnies ainsi que les "aristocrates" qui les accompagnaient disparaissent aussi.
Mais les importations métalliques ne s'accompagnent pas de céramiques; les vases alpins
sont des évolutions locales peu caractéristiques dans la filiation des types du Bronze ancien140,
évolution identique à celle constatée dans toute la zone influencée par la civilisation du Rhône
disparue. Seul le métal141 traduit la marque du Nord-Est par des importations répandues dans
l'avant-pays jusque dans les Hautes-Alpes: haches à rebord de forme simple, poignards à lan-
guette et à rivets, haches à talon de type Haguenau, épingles à corps fusiforme gravé, faucilles à
bourrelet142. La présence de céramique à décor excisé, du type de Saint-Vérédème, en Sud Dau-
phiné, à Bésignan, signe la montée d'influences languedociennes.
L'avant-pays
Les sites attribuables avec certitude à cette époque sont peu nombreux et reconnus pour la
plupart seulement dans quelques stratigraphies de grottes143. On ne dispose de datations qu'à
Saou dans l'Ouest du Diois (1390 BC), à Seyssinet (1540 BC) et à Injoux-Génissiat sur le haut
Rhône (1570 BC).
Des bracelets aux gravures géométriques144, aux extrémités effilées ou avec de petits tam-
pons, sont disséminés du Nord au Sud de notre zone. Ceux-ci145 semblent faire partie de produc-
tions standardisées, issues probablement du Bade-Wurtemberg ou d'Alsace, et destinées à l'expor-
tation puisque le Sud-Est de la France, en particulier le Languedoc, est abondamment pourvu146
de pièces tout à fait identiques tant pour la forme que pour les décors.
139 Sans qu'on connaisse vraiment les causes de la disparition de la civilisation du Rhône: économiques locales, humaines par
expansion des civilisations d'Europe moyenne? La péjoration climatique a pu jouer un rôle important en affectant les conditions de
vie en haute montagne, dans le Valais, où est extrait le minerai 140 Avec persistance des anses en ruban, des languettes de préhension, des décors à cordons et apparition des décors peignés sur
barbotine et de formes en pot de fleur,etc. 141 Plus l'ambre balte à Saint-Paul-de-Varces (Isère) et une perle d'espacement à Sigottier (Hautes-Alpes) 142 Douvaine (Haute-Savoie); La Biolle et Aix-les-Bains (Savoie); Porcieu-Amblagnieu, Cessieu, Parmilieu, Vertrieu, Saint-Chef
et Oyeu en Nord Dauphiné; Cognin, Saint-Paul-de-Varces et Grenoble (Isère); Mirabel, Roussas-en-Baronnies (Drôme) et Rosans,
la Batie-Montsaléon, Aspremont, Trescléoux (Hautes-Alpes), Barcelonnette en Ubaye, etc. (Fig. 20-B) 143 Creys-Mépieu (Isère) en Nord Dauphiné, la Balme et la Biolle en Savoie, Allèves en Haute-Savoie, Boulc, Montmaur et Saint-
Nazaire-le-Désert en Diois (Drôme) 144 Chevrons, arcs de cercle doubles, dents de loup 145 au moins une trentaine de bracelets trouvés à Etrembières et dans le dépôt d'Annemasse (Haute-Savoie), dans la sépulture de
Saint-Paul-de-Varces (Isère), au sud de Grenoble (Fig. 20-B, 21 et 22) 146 Dépôt de Bard et Saint-Romain-la-Motte, Loire; Saint-Laurent-sous-Coiron, Ardèche; Pont-d'Ain, Ain; Tharaux, Seynes,
Goudragues et Meyrannes, Gard; Brissac, Hérault, etc
66
La plupart des objets métalliques correspondent à des fabrications tardives dans le do-
maine germanique, comme cela a été le cas au Bronze ancien pour ceux de la Civilisation du
Rhône. Ces objets sont toujours utilitaires: outils ou parures; l'absence des armes concorderait
avec la disparition ou l'effacement de la classe "aristocratique que j'ai déjà évoqué. Si cela s'avé-
rait exact et l'hypothèse est plausible, le phénomène serait révélateur d'un affaiblissement ou de
la disparition de la hiérarchie locale; ce changement dans la société irait de pair avec une absence
de dynamisme surtout constaté au début du Bronze moyen, car vers le XIVe siècle apparaissent
des signes de "reprise".
Ainsi le dépôt de Porcieu-Amblagnieu dans le Nord de l'Isère, sur le Rhône, composé de
haches assez originales pour avoir été individualisées en type éponyme, de bracelets, d'épingles
s'accompagne d'outils de bronzier147 montrant le début du façonnage local du bronze; l'Europe
moyenne n'exporte donc plus seulement ses productions mais aussi ses artisans. Certaines haches
à rebords, en particulier celles qui sont massives et peu galbées, pourraient être issues de ces ate-
liers ambulants. Une ère nouvelle dans les processus de production et de diffusion du métal dans
les Alpes commence. La position des dépôts148 rassemblés dans le Nord de la région incite à la
réflexion; c'est là que se concentrent les spécialistes aptes à transmettre sur place des techniques
et des savoir-faire que les Alpins sauront vite assimiler et mettre à profit dans leurs fabrications
régionales dès les XIVe/XIIIe siècles comme nous le verrons.
Les massifs internes
La Maurienne et la basse vallée de l'Arc ainsi que la Tarentaise sont maintenant désencla-
vées à partir du Sillon alpin149 mais la zone interne des Alpes, tant en Savoie qu'en Dauphiné,
semble un peu en marge du courant de diffusion du métal au Bronze moyen comme le montre la
rareté des vestiges.
Les rites funéraires
Le Bronze moyen est très pauvre en restes funéraires sûrs: une tombe plate à Oyeu, des in-
humations en fissure de rocher à Parmilieu et à Cessieu en Nord-Dauphiné et des inhumations
147 Avec petits lingots, spatules à modeler, marteau, enclume, ciseaux et ciselets à graver. Voir aussi l'enclume de Bons-en-
Chablais Fig. 20-B, 23. 148 Douvaine, Annemasse (Haute-Savoie) et Ternay (Isère), au sud de Lyon; celui de Porcieu-Amblagnieu est complété par un
autre, distant seulement de quelques kilomètres, sur la rive droite du Rhône: le dépôt de Lagnieu, (Ain) qui contenait des fragments
de lingots 149 Hache à bords droits de Pontamafrey, poignard à languette et à deux rivets à Notre-Dame-de-Briançon; hache de type La
Baraque d'Aiguebelle
67
multiples en grotte avec un riche mobilier funéraire à Saint-Paul-de-Varces150. La diffusion du
rite de l'inhumation tumulaire, habituel dans le Nord-Est de la France, ne dépasse pas le Jura
méridional; les Alpes poursuivent des traditions funéraires propres où a disparu l'usage des
ossuaires collectifs utilisés jusqu'à la fin du Bronze ancien et totalement abandonnés par la suite.
Des changements majeurs vont intervenir dans le peuplement
Que de chemin parcouru depuis le moment où quelques tribus de la fin du Mésolithique
pourchassaient le gibier et tentaient leurs premiers essais agricoles! L'outillage de pierre a été di-
versifié et adapté aux tâches nouvelles comme la maîtrise du bois, la coupe des céréales; l'habitat
est devenu confortable par des constructions en bois solides et durables; l'alimentation s'est di-
versifiée en alliant chasse et élevage, cueillette et culture, avec des conséquences biologiques in-
duisant une meilleure résistance aux carences et aux maladies; la culture et l'élevage ont atténué,
peut-être même effacé, les disettes et la sous-alimentation hivernale permettant la conquête de la
haute montagne. Des ustensiles, des outils nouveaux, le textile ont amélioré les conditions de vie.
Idées, tours de main et connaissances se sont échangés de plus en plus entre communautés régio-
nales et à longue distance. Une profonde pénétration du territoire alpin a permis de découvrir des
richesses minérales qu'un jour ou l'autre on saura exploiter et aussi d'explorer toutes les possibili-
tés de circulation. Beaucoup de toponymes sont, d'après les spécialistes, antérieurs aux Indo-Eu-
ropéens, prouvant une totale connaissance du terrain dès ces époques reculées.
LA GRANDE MUTATION DE LA FIN DE L'ÂGE DU BRONZE
Dans les Alpes du Nord, des changements fondamentaux vont se mettre en place, qui
effaceront complètement les retards accumulés au fil des siècles en montagne et dans les
piedmonts alors que les régions voisines (Est de la France, plaine du Pô, Midi méditerranéen, etc)
prospéraient au contact ou dans la mouvance des grandes civilisations.
Après la "crise" climatique, technique et humaine de l'âge du Bronze moyen les Alpes du
Nord seront un espace fragilisé où pourront se développer sans contraintes ni opposition les in-
fluences externes et je ne disserterai pas pour savoir si les migrations ou l'acculturation seule les
expliquent; le problème est surement bien plus complexe que ne le décrivent les simplifications
caricaturales dont les théoriciens se repaissent depuis 50 ans.
150 Avec une hache à rebords à Oyeu, des épingles gravées à Parmilieu et des bracelets, ambre, épingle et anneaux-spirales à Saint-
Paul-de-Varces; ici les inhumations ont étaient disposées au-dessus de corps mis en place au Néolithique final.
68
Au XIVe et XIIe siècles deux pôles civilisateurs européens auront suffisamment de dyna-
misme pour diffuser leurs emprises techno-culturelles et/ou s'implanter dans le Sud-Est de la
France: l'Italie du Nord et l'Europe moyenne. L'histoire des Alpes du Nord sera marquée, jusqu'à
l'âge du Fer, par cette dualité des influences qui favoriseront l'éclosion d'une civilisation alpine
où ces sources, domaine nord-alpin et domaine italique, se retrouvent toujours mais mêlées à une
bonne dose d'originalité régionale.
La multiplication des gisements à la fin de l'âge du Bronze traduit l'accroissement du peu-
plement pour diverses causes: à l'amélioration climatique se joignent des facteurs humains et
techniques: "gens" venus du Nord-Est, sédentarisation permanente en village que permettent les
meilleurs rendements agricoles dus à la diffusion de l'araire, de l'assolement, etc. Une certaine
uniformisation apparaît dans la vaisselle domestique et aussi dans la vaisselle fine: les mêmes
décors, les mêmes formes et les mêmes évolutions se retrouveront de part et d'autre des crêtes
alpines obligeant les spécialistes italiens à parler d'influences occidentales pour une certaine part-
ie de leur matériel. Cela traduit une unité culturelle et technique des alpins induite par le même
mode de vie adapté aux contingences de la montagne et surtout par les contacts habituels et fré-
quents entre les terroirs reliés par les cols.
Ces contacts dus au déplacement des troupeaux, à l'échange des productions agricoles ou
autres, étaient facilités par un climat clément rendant plus aisée la circulation en altitude. Témoin
privilégié des changements, la céramique grossière banale et omniprésente subira des modifica-
tions de forme et de décor qui se retrouveront identiques entre plaine du Pô et couloir rhodanien.
Sur le versant français, comme en Piémont, ces modifications sont difficiles à replacer chrono-
logiquement en l'absence de stratigraphies épaisses ou de matériel exogène bien daté. C'est la rai-
son des incertitudes, des imprécisions typo-chronologiques de la fin de l'âge du Bronze et de la
première partie de l'âge du Fer alors qu'en Italie du Nord des séries caractéristiques proto-Gola-
secca et Golasecca sont associées à cette céramique d'usage, ce qui permet d’en suivre
l’évolution précise.
Le cadre chronologique (Fig. 3)
J.J.Hatt partageait le Bronze final en cinq phases (B.F. I, IIa, IIb, IIIa, et IIIb). En ce qui
concerne les Alpes du Nord, dès 1976 je les avais regroupés en trois phases correspondant aux
trois faciès techno-culturels majeurs reconnus dans le matériel régional dont l'âge ne pouvait pas
être apprécié plus finement. Ainsi sont nées nos phases ancienne, moyenne et récente du Bronze
final alpin étant entendu que, lorsque cela est possible, le début ou la fin de la phase sont préci-
sés. Les limites chronologiques de ce schéma ont été modifiées en 1986 pour s'ajuster aux pre-
69
miers résultats dendrochronologiques151; depuis dix ans nouvelles fouilles et analyses ont encore
apporté des précisions dont il est tenu compte dans le tableau de la Fig. 3.
-Le début de la phase ancienne ne correspond plus à la fin du Bronze moyen de J.J.Hatt
(1250 av. J.C.): pour moi elle débute au XIVe siècle car je lui incorpore la période de transition
entre Bronze moyen/Bronze final dont j'ai parlé au chapitre précédent; en effet c’est à ce moment
que commencent la mutation techno-culturelle du Bronze final et l'essor des échanges avec l'Ita-
lie du Nord.
-La phase moyenne, regroupant le Bronze final IIb et IIIa, était comprise entre 1050 et 850
av. J.C.; en réalité sa durée fut plus courte, débutant vers -1070 pour se terminer vers -940/-930
au plus tard152.
-La phase récente se rapporte au Bronze final IIIb que J.J.Hatt plaçait entre 850 et 725 av.
J.C.; or nous venons de voir qu'elle débute autour de -940/-930, à la fin de la phase précédente.
La phase récente se prolonge au delà de la destruction des stations littorales autrefois fixée arbi-
trairement vers 750 et que l'on sait aujourd'hui légèrement antérieure à -800 au lac du Bourget.
Pour prendre en compte leur disparition qui fut un événement historique majeur quel qu'en soit la
cause, j'ai proposé en 1990 de scinder cette période en deux parties: une phase récente I avant
810/800 av. J.C., correspondant à la fin du Hallstatt B2 centre-européen, et une phase récente II
jusqu'au Hallstatt ancien vers 700 av. J.C. Cette bipartition du Bronze final IIIb a l'avantage de
subdiviser cette période bien longue (env. 230 ans) en regard des événements sociaux, géopoliti-
ques et économiques qui agitent l'Europe au VIIIe siècle. Cela se traduit par la nécessité où se
trouvent nos collègues italiens, suisses et allemands de partitionner la chronologie en période de
moins d'un siècle pour classer des matériels qui évoluent très rapidement.
Dans l'étude des corrélations que j'ai faite en 1989 entre les importations italiques et la
chronologie des Alpes du Nord, j'avais été amené à vieillir de quelques décennies le cadre chro-
nologique italien, pour le rendre plus conforme à nos données dendrochronologiques de l'époque,
ceci sur la base de la disparition des stations lacustres vers -850/840. Or de nouvelles analyses en
France rajeunissent cette limite vers -814/810 et dès lors la chronologie des matériels de part et
d'autre des Alpes se trouve en harmonie, à l'échelle de nos approximations et à quelques nuances
près comme la fin du Proto-Villanovien.
151 Dates obtenues sur les stations littorales alpines par le Centre National de Recherches Archéologiques Subaquatiques 152 Voir le tableau des dates en annexe
70
#1350 av. J.C. 1080/1070 -940/930 -800 # 700 av. J.C. Bronze final alpin
phase ancienne Bronze final alpin
phase moyenne Bronze final alpin
phase récente I Bronze final alpin
phase récente II Hallstatt ancien
Bronze moyen III
Bronze final I-IIa
Bronze final IIb-
IIIa
Bronze final IIIb Bronze final
IIIc ? Hallstatt ancien
Occupation des rives des lacs alpins
Proto-Villanovien Bologna I
et Tarquinia I Bologna
II
Bologna
III -1100 -900 -800 -760 -700
Chronologie en Italie du Nord (O.Frey et S.Gabrovec 1971)
Les ateliers de métallurgistes et de potiers sur les rives des lacs
L'installation des ateliers près des plans d'eau, lacs ou rivières, est un phénomène
qui commence en Europe moyenne où la géographie du territoire, sa diversité et les
ressources sont de mieux en mieux connues; le développement des voies de commu-
nication facilite le transport des matières premières, la croissance des productions et des
échanges, la conquête de marchés et le commerce. On a beaucoup glosé sur le rapport
entre l'occupation des rives et les regressions du niveau des lacs, l'homme s'installant près
de l'eau en périodes de "sécheresse". Si on ne peut nier l'avantage de disposer de terrains
plats et dégagés de végétation après une baisse du niveau de l'eau, je pense que bien
d'autres contingences et de raisons, comme le poids des traditions, les nécessités
techniques ou politiques, interviennent dans le choix de telles implantations.
Outre la commodité que représentait le flottage pour rassembler le bois des
constructions il faut se rappeler que l'élaboration des bronzes demande 200 à 300 kg de
bois pour obtenir un kilo d'objets finis à partir de 10 à 20 kg de minerai riche. Celui-ci
pouvant voyager facilement, il était avantageux de se rapprocher du combustible là où son
transport en grande quantité était facilité par le flottage. La cuisson des vases est tout
autant gourmande en bois, c'est pourquoi les ateliers lacustres ont toujours une double vo-
cation, métallurgique et céramique. De plus la concentration de la production permettait la
spécialisation des artisans potiers et bronziers liée à une haute technologie, sans oublier
les aspects commerciaux qui pouvaient être mieux contrôlés par ceux qu'on appellera déjà
des "industriels". Les stratégies de production changent donc progressivement dès le XVe
siècle en Autriche, en Allemagne méridionale ou en Bohème ainsi qu'en Italie du Nord, à
la fin du Bronze moyen et au début du Bronze récent.
Dans les régions de France orientale les ateliers se mettent en place bien plus
71
tard153; ceux de Suisse occidentale (en -1107) précèdent ceux de Savoie installés trente à
quarante ans après (environ -1080/-1070). On sait actuellement, d'après les ramassages et
les sondages, que les centres savoyards n'atteignent probablement pas le nombre ni l'im-
portance de leurs homologues helvétiques. Les sites des lacs Léman (rive française), d'An-
necy et d'Aiguebelette ont livré moins de matériel que ceux du Bourget mais ce ne peut
être dû qu'à la présence de couches plus profondes que les anciens chercheurs d'antiquités
n'ont pas atteintes ou qui ont été érodées. Moins nombreux, moins productifs, on ne sait
pas, mais de toute façon les bronziers lacustres se sont trouvés en concurrence avec les
producteurs locaux déjà bien organisés dès la phase ancienne du Bronze final, comme
nous l'avons vu.
Certains ateliers littoraux des Alpes du Nord ont été implantés sur des îles ou des pres-
qu'îles154, pratique rarissime en Suisse ou en Allemagne. Cette volonté de s'isoler de la terre
ferme, qui complique autant la construction que les déplacements et la vie quotidienne, n'est pas
fortuite et répond au besoin de s'isoler pour se protéger d'attaques éventuelles. Les artisans redou-
taient certainement, à tort ou à raison, l'hostilité ou la convoitise de concurrents ou des autochto-
nes contrairement à d'autres pays européens. C'est un fait qu'il ne faut pas négliger pour apprécier
l'état de la région au début du XIe siècle.
PHASE ANCIENNE DU BRONZE FINAL ALPIN env. 1350 à 1070 Av. J.C. (FIG. 22, 23
ET 24)
Les XIVe et XIIIe siècles forment une période particulièrement intéressante dans les Al-
pes du Nord parce que les mentalités et les techniques subissent de grandes modifications dans la
mouvance de celles qui affectent l'Europe. Les temps modernes protohistoriques commencent
avec l'émergence de l'originalité alpine à l'intérieur de ce qui fut appelé la Civilisation des
Champs d'Urnes.
153 Sans tenir compte de découvertes qui pourraient intervenir sur villages littoraux de la phase ancienne du Bronze final, ce qui
sera évoqué plus loin 154 Dans les Alpes les sites de Sévrier et de Duingt sur le lac d'Annecy, de Petite Ile et de Grande Ile sur le lac d'Aiguebelette.
72
Fig. 23. Phase ancienne du Bronze final alpin. env.1350 à 1070 av. J.C.
Matériel de Nord et du Nord-Est
1: pichet excisé, La Balme, Savoie; 2: tasse à anse en X et 3: coupe cannelée à mamelons, La
Balme-les-Grottes, Isère; 4 à 7: vases cannelés, Fontaine,Isère; 8 et 9: bracelet cannelé et chai-
nette à pendeloque en "clé de contact", Optevoz, Isère; 10: hache à ailerons médians courts,
Saint-Jean-Tholomé, Haute-Savoie; 11: épingle cannelée, Petit-Coeur, Savoie; 12: épingle à
collerettes mobiles, Marcellaz, Haute-Savoie; 13: faucille sub-rectiligne, Grésy-sur-Isère, Sa-
voie; 14: couteau à un rivet, Chamagnieu, Isère; 15: épingle du type Villethierry, La Roche-sur-
Foron, Haute-Savoie; 16 et 17: épingles à tête de pavot et cannelée, Bourget-du-Lac, Savoie.
(échelles diverses). D'après: 1: Bocquet 1986; 2 à 7: Bocquet in Bocquet et Lagrand 1976; 8,9
et 14: Bocquet 1969; 10: Bocquet 1969-70; 12 et 15: Oberkampf 1984; 11,13,16 et 17: Com-
bier 1972.
73
Fig. 24. Phase ancienne du Bronze final alpin. env.1350 à 1070 av. J.C.
A- Matériel italique
1 et 3: épée à soie et hache à ailerons sub-terminaux, Annecy, Haute-Savoie; 2: épée à languette, Pont-de-
Claix, Isère; 4: poignard "Peschiera", Bourgoin, Isère; 5 à 11: dépot de vases en grotte, Sainte-Marie-du-
Mont, Isère. (échelles diverses). D'après: 1: Oberkampf 1984; 2: dessin Bocquet; 3, 4 et 12: Bocquet
1969; 5 à 11: Bocquet in Bocquet et Lagrand 1976;
B- Matériel alpin
12: hache à ailerons médians longs, Allevard, Isère; 13 à 15: haches à ailerons médians
courts et longs, décor de bracelet, dépot de Pignerol, Piémont; 16: décor de bracelet, dépot de La Balme,
Savoie; 17: bracelets, dépot de Saint-André-de-Rosans, Hautes-Alpes. (échelles diverses). D'après: 13,
14 et 15: Doro 1973-75; 16: Combier 1972; 17: Courtois 1960.
Amélioration climatique
Au début de la première phase du Bronze final alpin une amélioration climatique corrige
progressivement les effets réducteurs de l'ambiance froide et humide du Bronze moyen. A Seys-
sinet les céréales réapparaissent dans les pollens (Fig. 14) et le cheptel se diversifie de nouveau;
74
l'expansion territoriale en montagne s’en trouvera facilitée. Les grands décapages d'autoroutes li-
vrent depuis peu les restes de nombreux villages de cette phase, preuve évidente de nouvelles
implantations dans des zones délaissées qui vont reprendre vigueur. Le substrat culturel, techni-
que et très probablement humain des Alpes du Nord va se modifier en quelques siècles avec une
rupture nette dans les traditions en place depuis le Néolithique, alors que celles-ci avaient lente-
ment évolué en assimilant les influences exogènes successives.
Rupture typologique majeure
Dès le XIVe siècle apparaît parmi le matériel archéologique une "rupture typologique ma-
jeure" avec de nouvelles formes de bronzes et de céramiques fines ou grossières155. Même la cé-
155 Céramiques à caréne et ornées de cannelures légères, haches rectangulaires à ailerons médians courts, bracelets et épingles
cannelés ou à ailettes au décor obtenu à la coulée, épingles à collerettes mobiles, apparition du couteau, du rasoir, etc.
75
ramique domestique qui conserve habituellement longtemps ses caractères traditionnels, se trans-
forme aussi156. C'est assez dire que des influences se font prégnantes signant autre chose que de
simples contacts commerciaux. La diffusion de ces nouveautés se fera à partir de l'Est et du cen-
tre-Est de la France et elles atteindront la vallée du Buech, le Gapençais en laissant de nombreux
témoins sur leur route.
Acculturation ou migrations, la question n'est pas facile à régler. Doit-on les changements
à la diffusion d'un peuplement s'infiltrant parmi les communautés indigènes, qui perdent leurs
habitudes techniques mais conservent le rite de l'inhumation en grotte, ou bien assiste-t-on seu-
lement à une acculturation induite par de très petits groupes de migrants? Il n'est pas encore pos-
sible de le savoir, les deux processus ayant pu coexister en étant complémentaires. Devant plu-
sieurs évidences déjà évoquées je pencherais plutôt pour quelques "déplacements" de population
recolonisant un territoire157 affaibli par deux siècles de régression.
Les dates absolues sont rares, deux étant fournies par les sites stratifiés de Seyssinet, près
de Grenoble (1240 BC avec de la céramique à cannelures légères), Creys-Mépieu en Nord-
Dauphiné (1160 BC) et Jons près de Lyon avec une tasse à anse ad ascia des Terramare (1350
BC)158.
Les influences exogènes (Fig. 23 et 24-A)
Pour dater et classer le matériel qui apparaît après le Bronze moyen il serait nécessaire de
prendre chaque objet pour en faire une typologie chronologique fine afin de mettre en évidence
des séquences d'évolution; ce n'est pas le lieu ici où nous nous contentons d'interpréter les grands
changements.
Les premières influences venues du Nord ou Nord-Est imprègnent, au XIVe siècle, le cou-
loir rhodanien en direction de la Provence159. Quelques pièces à la Balme en Savoie, la Balme-
les-Grottes et Chamagnieu160 en Isère, toutes près du Rhône, s'intègrent bien à ce mouvement
ainsi que le pichet à décor cannelé de Chastel-Arnaud en Diois. Mais la céramique propre à ce
156 avec des panses qui s'angulent en carène, avec les décors d'impressions digitales larges disposées en bandes parallèles obliques
larges sur les panses et les cordons impressionnés rapportés que l'on retrouve dans les pays rhénans et dans l'est de la France 157 Les grands travaux qui se développent dans la vallée du Rhône depuis peu, amènent au jour de très nombreuses installations
du début du Bronze final... 158 La dendrochronologie ne peut pas intervenir car les rives des lacs, où les bois sont conservés, n'ont pas encore livré
d'occupations 159 Dépots de Vernaison (Rhône) et Reventin-Vaugris (Isère); Grottes de Donzère (Drôme) etc. En Provence C.Lagrand voit la
céramique nouvelle se métisser d'influences italiques qui s'étaient déjà manifestées dans la région à la fin du Bronze moyen 160 Respectivement pichet à décor excisé; tasse et pichet à anses en X; couteau à un rivet (Fig. 23, 1, 2 et 14)
76
courant initial ne pénètre pas à l'intérieur des Alpes du Nord; seulement quelques bronzes arri-
vent en Savoie occidentale161 ce qui ne nous éloigne pas beaucoup du couloir rhodanien. Cette
étape correspond au "Bronze récent" défini par J.Vital pour Donzère et la basse vallée du Rhône.
La progression des influences se suit de la même manière avec la céramique à cannelures
légères en habitat comme en sépulture jusque dans les Hautes-Alpes162. Formes et décors ne sont
pas seuls à changer, la texture des pâtes aussi. Les coupes apodes et les urnes fines portant des
cannelures légères ont un dégraissant sableux homométrique et une teinte bistre; certaines urnes
présentent une couverte sombre à base rougeâtre, desquamante, qui caractérise une technique de
fabrication inconnue jusqu'alors163. Toutefois à mesure que le temps avance les pâtes deviendront
plus "classiques", plus dures. Céramiques nouvelles, bronzes nouveaux cela traduit à l'évidence le
début de la mutation techno-culturelle qui s'affirmera dans les Alpes durant les siècles ultérieurs.
Une autre caractéristique de cette phase ancienne est mise en évidence par les analyses
des bronzes164 qui montrent que, comme dans toute l'Europe occidentale, leur teneur en impure-
tés est très faible, traduisant une même technique d'affinage et vraisemblablement le même type
de minerai. Là encore il y a rupture par rapport aux périodes antérieures.
Dans les dépôts toutes les pièces sont fragmentées volontairement en petits morceaux de
volume assez semblable165, comme c'est le cas dans de nombreux dépôts de cette époque tant en
France qu'en pays germaniques166. Il n'y a pas de raison technique pour un tel morcellement et on
se trouverait devant des trésors de "proto-monnaie" qui deviendrait nécessaire à un commerce en
expansion et pour lequel le troc ne peut plus résoudre toutes les transactions; cela traduirait des
changements dans la pratique et le volume des échanges.
Des villages existent-ils déjà au bord des lacs alpins?
Classiquement, dans l'Est de la France et en Suisse occidentale on admet que les premiers
villages lacustres du Bronze final ont été construits au IXe siècle mais certains vestiges obligent à
de nouvelles réflexions. Des épingles des XIIIe et XIIe siècles proviennent des vieux ramassages
161 Epingles cannelées et épingle à tête de pavot à Grésy-sur-Aix et au col du Chat au dessus du lac du Bourget (Fig. 23, 16) 162 Plusieurs grottes du Salève près de Genève, de la Balme en Savoie, de la Balme-les-Grottes (Isère) en Nord Dauphiné, de
Sassenage, de Fontaine, de Seyssinet, de Varces près de Grenoble; Choranche et Villard-de-Lans en Vercors, (Fig. 23, 3 à 7),
Chastel-Arnaud en Diois et Sigottier (Hautes-Alpes) 163 Qui se retrouve aussi sur la céramique italique de Canegrate de la même époque... 164 Sur près de 250 prélèvements effectués seuls 135, qui concernent seulement des sites de l'Isère (Savoie) et Haute-Savoie à
l'exception des stations du lac du Bourget, ont été analysés au Laboratoire des Musées de France et étudiés par A.Verney 165 Faucilles, haches, épingles, épées, bracelets, etc. des dépôts de Reventin-Vaugris et Vernaison au sud de Lyon et aussi de
Lullin-Couvaloup en Chablais et une part des objets de Genève 166 Dépôts de Cannes-Ecluse, Stockheim, etc.
77
effectués dans les stations lacustres167; cela reste énigmatique même pour la Suisse où des obser-
vations identiques ont été faites. Le cas de la station immergée du Port à Annecy ajoute encore au
trouble avec la présence de céramique à cannelures légères et un niveau organique daté de 1260
BC168: est-on en présence d'un habitat littoral, c'est probable.
Avant les grandes sécheresses de la fin de l'âge du Bronze marquées au lac du Bourget par
une forte régression, le niveau moyen du lac était de 1m70 en dessus de celui du début du Bronze
final: d'éventuels villages littoraux de cette époque seraient alors placés plus haut que ceux d'âge
ultérieur installés sur la rive après la baisse du plan d'eau. Ils n'auraient donc pas été protégés
postérieurement par la montée des eaux et reposeraient aujourd'hui sous les sédiments non im-
mergés des rivages. Si tel était le cas, l'installation de centres de productions métalliques et cé-
ramiques dans les Alpes du Nord et en Suisse occidentale serait quasi contemporaine de ceux
d'Europe moyenne et de Lombardie, accentuant encore l'unité des régions touchées par les chan-
gements du début de l'âge du Bronze final. Voilà des recherches à envisager...
Les contacts avec l'Italie (Fig. 24-A)
J'insisterai sur l'importance que prennent alors les cols transalpins dans les échanges entre
l'Europe occidentale et l'Italie du Nord qui se marquent tant par l'importation de bronzes et de cé-
ramiques que par les influences qui se retrouveront sur les productions locales, entre autre la
forme des haches. En effet la voie vers l'Italie entre le Sillon alpin et le col du Petit-Saint-Bernard
est maintenant bien ouverte169; les cols du Mont-Cenis fonctionnent aussi.
Formant un exceptionnel dépôt, sept vases jamais utilisés directement issus de la civili-
sation proto-Golasecca de Canegrate, seront empilés dans une fosse en l'absence de tout habitat à
1300m d'altitude dans le Grésivaudan170. L'influence de Canegrate est reconnue sur une urne bi-
conique à carène torse de Fontaine (Fig. 24, 9) et aussi sur plusieurs de Sollières en Maurienne.
Néanmoins le rite d'incinération lié à ce faciès italique ne nous atteint pas, ce qui montre sim-
plement que les échanges sont limités au matériel.
Les bronzes lombards171 apparaissent avec six épées de types "Monza, Trana, Terontola"
ou assimilés et quelques autres objets172. Le nombre de ces armes en provenance d'Italie du Nord
167 Epingles à cannelures, à ailettes, en crosse ou de type Champs d'urnes (ou Binningen dégénéré) à Chindrieux et Brison-Saint-
Innocent sur le lac du Bourget, Chens-sur-Léman et Nernier sur le lac Léman (Haute-Savoie) 168 Une épingle de type "Champs d'urnes ou Binningen dégénéré", découverte à cet endroit lors des dragages du siècle dernier,
confirmerait la présence d'un site de la phase ancienne 169 La basse Tarentaise possède à Petit-Coeur des tombes avec des épingles cannelées et à ailettes (Fig. 23, 11). 170 Grotte du Trou de la Rousse à Sainte-Marie-du-Mont (Fig. 24, 5 à 8, 10 et 11) 171 et aussi une tasse importée des Terramare à Jons (Rhône) datée de 1350 BC
78
ainsi que celui des fragments d'épées présents dans tous les dépôts173 est surprenant. Ce phéno-
mène est inhabituel pour les Alpes, même ultérieurement; doit-il être relié à une "aristocratie" re-
naissante en rapport avec les premiers métallurgistes et/ou le commerce de l'étain occidental dont
l'Italie du Nord a besoin? Dans les Alpes la première trace accompagnant ce trafic de l'étain, in-
dispensable aussi à la métallurgie régionale qui s'installe, est représentée par cinq haches à talon
de type normand du début du Bronze final, disséminées du Nord au Sud de la région174.
L'absence de types bretons contemporains serait l'indice de la provenance britannique de l'étain
par la voie de la Seine.
Premières productions métalliques alpines (Fig. 24-B)
Nous avons vu qu'à la fin du Bronze moyen des bronziers ambulants témoignaient d'une
"décentralisation" des productions métalliques, autorisant ainsi l'éclosion d'ateliers locaux par la
diffusion d'un savoir faire et de techniques jusqu'alors réservés à quelques spécialistes rassemblés
en grosses unités. Dans les Alpes du Nord j'ai été intrigué par la présence de bronzes qui n'appar-
tiennent pas à la panoplie de ceux largement diffusée en Europe occidentale d'origine médio-eu-
ropéenne ou italique. Leur originalité et leur densité m'a amené à envisager en 1976 l'existence
d'ateliers métallurgiques régionaux dès le début du Bronze final.
Une hache de forme inconnue jusqu'alors, à ailerons médians allongés175, apparaît mon-
trant certaines ressemblances avec des exemplaires d'Italie du Nord bien que nous ne disposions
pas pour en juger de tout le matériel italique176. Il y a 20 ans je pensais qu'on se trouvait devant
des productions locales inspirés d'Italie du Nord; des résultats d'analyses récentes ne sont pas as-
sez significatifs pour remettre en question cette hypothèse177, toutefois il faut quand même envi-
sager l'importation de haches d'Italie du Nord parallèlement aux épées comme nous l'avons vu.
Des bronziers autochtones auraient alors copié ces modèles italiques comme ils ont copié, mais
en taille plus faible, les haches rectangulaires à ailerons médians courts européennes178. Dans le
172 Epées de Genève, d'Aime (Savoie) en Tarentaise, d'Annecy, de Rumilly (Haute-Savoie), de Grenoble et de Pont-de-Claix
(Isère). Les haches des Terramare d'Annecy et de Genève, le poignard du type Peschiera de Bourgoin (Isère) (Fig. 24-A, 1 à 4) 173 Lullin-Couvaloup, Sion-Val-de-Fier (Haute-Savoie) et Reventin-Vaugris (Isère) 174 Doussard (Haute-Savoie), Vaulx-Milieu et La Balme-les-Grottes en Nord Dauphiné, Grenoble (Isère) et Châteauroux (Hautes-
Alpes) 175 Type d'Allevard; haches souvent lourdes et d'assez grande dimension dont les ailerons sont une hypertrophie des rebords dans
la ligne évolutive des modèles du Bronze moyen (Fig. 24-B, 12 et 13) 176 Brabbia, Noceto, etc. Les pièces sont nombreuses et encore inédites d'après des renseignements oraux de spécialistes italiens. 177 Les compositions des deux haches d'Allevard et une de Pignerol s'apparentent à celles des épes italiques de Rumilly, de
Grenoble et de la hache des Terramare d'Annecy; par contre les haches de la Balme, de Lullin-Couvaloup et de Reventin-Vaugris
s'en éloignent 178 dont la taille dépasse toujours 16 à 18cm alors que les imitations sont inférieures à 15cm
79
dépôt de la Balme, Savoie, une hache de chaque type179 était associée à deux bracelets; plus
d'une dizaine de trouvailles isolées de haches ou de bracelets parsèment la région entre le lac Lé-
man et les Hautes-Alpes180, à l'exception de la Drôme. La contemporanéïté des deux métallurgies
est manifeste dans les dépôts de Lullin-Couvaloup, Haute-Savoie, de Vernaison et de Reventin-
Vaugris sur le Rhône, ce qui démontre que les marchés sont abondés par les deux productions. Le
Piémont possède à Pignerol un lot tout à fait identique (Fig. 24-B, 13 et 14) à celui du dépôt de la
Balme, prouvant que les échanges Alpes du Nord-Italie s'opèrent dans les deux sens.
Des bracelets, à section en V ou en D à faibles tampons, portent un décor gravé avec arcs
de cercles, hachures et pointillés181 que le goût indigène apprécie depuis la fin du Bronze moyen
comme on l'a vu; ils ne sont pas sans rappeler certains motifs de Canegrate, ce qui conforte en-
core les échanges transalpins d'idées ou/et de productions.
Quand cette métallurgie alpine a-t-elle commencé? Les associations en dépôt nous font
admettre le XIIIe siècle, au moment de la diffusion des nouveaux types européens182 et de la
complète ouverture des passages alpins vers l'Ouest qui ont permis les contacts avec l'Italie. La
naissance et le développement de la métallurgie alpine seront mieux connus par des analyses sys-
tématiques de bronze tant alpin qu'italique et de nouvelles études fines du matériel.
PHASE MOYENNE DU BRONZE FINAL ALPIN env. 1070 à 930 av. J.C. (FIG. 25, 26 ET
27)
La conquête du territoire alpin se poursuit avec une augmentation de l'occupation et une
mise en valeur de terroirs d'altitude: au-dessus de Saint-Michel-de-Maurienne, dans la vallée de
Valloire, la tourbière de la Soie à 2110m, révèle des défrichements vers 1100/1000 BC qui cor-
respondent à l'importance que prend la Maurienne comme voie de passage transalpin et dans
l'exploitation des mines de cuivre. L'analyse des pollens de Conjux sur le lac du Bourget montre
aussi des défrichements importants à partir du niveau laissé par le premier village du Bronze final
dont des pieux sont datés, par ailleurs, de -1054.
179 dont le métal diffère de celui des objets italiques que nous venons d'évoquer 180 Domancy (Haute-Savoie); Saint-Pierre-de-Curtille et Villaroux (Savoie); Allevard, Grenoble, la Cote-Saint-André, Saint-
Marcellin, Pressins, Meyzieux (Isère); Orpierre, Réallon, Savournon (Hautes-Alpes), etc 181 Dépôts de Saint-André-de-Rosans (Hautes-Alpes), de la Balme (Savoie), de Reventin-Vaugris (Isère) et de Pignerol en
Piémont 182 Dépôts de Lullin-Couvaloup (Haute-Savoie) et Reventin-Vaugris (Isère) au sud de Vienne
80
Changements dans le matériel archéologique
Un nouveau changement dans le matériel régional intervient aux XIIe et XIe siècles avec
l'apparition des bronzes et des céramiques du faciès Rhin-Suisse-France Orientale (R.S.F.O.)
dans les habitats au bord des lacs183, dans quelques sépultures et dans de plus rares sites terres-
tres. Nous avons vu que la dendrochronologie place la création des premiers villages littoraux à
partir de -1071, soit 35 ans après les plus anciens de Suisse occidentale. Le sondage de Tougues à
Chens-sur-Léman a même individualisé deux niveaux de cette phase entre -1071 et -965. Selon
toute vraisemblance le faciès R.S.F.O. développé sur les lacs alpins parvient de Suisse occiden-
tale184 mais en présente-t-il toutes les productions, nous ne saurions répondre en l'absence de
183 Lacs Léman, d'Annecy, du Bourget et d'Aiguebelette 184 Pas de plat ou coupe avec décor en guirlande au peigne, pas d'écuelles à bord perforé par exemple
81
fouilles exhaustives. Par contre l'influence de l'Allemagne du Sud-Ouest ou de l'Est de la France
imprègne certains gisements terrestres185; faut-il imaginer deux courants, un venu de Suisse qui
installe, entre autres, les industries littorales et un plus occidental qui se répandrait ailleurs?
Une variante de faciès se dégage à la fin de cette période, reconnu sur la céramique de
quelques sites, dont l'origine se placerait plutôt dans le centre-Est de la France186 et que j'appel-
lerai le faciès "bourguignon" pour le séparer de celui, très typique, de Rhin-Suisse-France Orien-
tale aux affinités plus helvétiques.
Qu'elle soit "terrestre" ou "lacustre" la métallurgie de la phase moyenne diffère totalement
de celle de la phase précédente tant dans ses formes que par l'apparition d'outils nouveaux
comme la hache à douille187, outil qui est rare en Europe moyenne ou en Suisse. La composition
du métal change aussi avec une partition en deux groupes: celui, nouveau, avec plus d'impuretés
(arsenic, antimoine, nickel suivant le schéma Sb>As>Ni) provenant de l'utilisation des cuivres
gris (fahlerz) qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'âge du Bronze et celui à faible teneur d'impure-
tés (<0,3%) qui ne diffère en rien du métal de la période précédente. En l'absence d'analyses sur
le matériel lacustre il est impossible d'aller plus loin.
Le faciès Rhin-Suisse-France Orientale (Fig. 26)
Le phénomène le plus spectaculaire de cette période est la mise en place des premiers ate-
liers de fabrication céramique et métallurgique sur les rives des lacs subalpins, dans des villages
dont l'agriculture188 permettait leur autosuffisance. Actuellement leur nombre n'atteint pas celui
des stations suisses, encore que les prospections d'A.Marguet sur les lacs Léman et du Bourget
nous réservent des surprises. Leurs productions de haches, de bracelets et d'épingles ou de céra-
mique ne supplanteront pas celles des ateliers locaux qui poursuivront leur activité.
La vaisselle fine de type Rhin-Suisse-France Orientale189, abondante dans les nécropoles à
incinération et les palafittes, est fabriquée suivant de nouvelles techniques qui affectent les for-
mes, les décors et la pâte qui est dure, au lustrage externe très soigné, noir ou uniformément som
185 Seyssel et grotte au-dessus du lac d'Annecy à Veyrier (Haute-Savoie); Francillon (Drôme) avec des plats décorés en guirlande
au peigne; cette influence des pays rhénans se traduit par l'importation d'un vase à col gravé dans le village de Tougues sur le lac
Léman 186 Nord Bourgogne et Champagne 187 Moule et hache à lame pannelée large, à forte teneur en plomb, de Sévrier, lac d'Annecy 188 Attestée par la présence de pollens de céréales 189 Gobelets et écuelles à épaulement, urnes biconiques à haut col, plats à marli mouluré, utilisation de la gravure géométrique et
plus rarement de l'étain en lamelle pour les décors, etc (Fig. 26, 1 à 11)
82
Fig. 26. Phase moyenne du Bronze final alpin. 1070 à 940/930 av. J.C.
Faciès Rhin-Suisse-France orientale
1 à 6: divers vases cannelés et gravés, sépultures à incinération en grotte de La Balme-les-Grottes, Isère; 7 à
10: divers vases cannelés et à décor d'étain (9), sépultures en grotte de Sollières, Savoie; 11: gobelet et bra-
celet torse double, sépulture à incinération de Seyssel-Vens, Haute-Savoie; 12: couteau à soie, Vimines,
Savoie; 13: épingle à tête cylindro-conique, Fontaine, Isère; 14: épingle à grosse tête vasiforme, Seyssinet,
Isère; 15: épingle à tête cylindro-conique, Lazer, Hautes-Alpes; 16: couteau à soie, Trescléoux, Hautes-Al-
pes. (échelles diverses).
D'après: 1 à 10: Bocquet in Bocquet et Lagrand 1976; 11: Lebascle 1976; 12: Combier 1972; 13 et 14:
Bocquet 1969; 15 et 16: Courtois 1960.
83
bre, et cuite dans des fours où la température est bien maîtrisée190. C'est la période qui a vu l'art
de la céramique non tournée atteindre son apogée, apogée liée directement au faciès R.S.F.O. et
qui disparaîtra avec lui. A partir de cette époque la céramique sera façonnée soit dans des ateliers
spécialisés, lacustres ou non, soit artisanalement dans les familles: ceci donnera deux qualités
distinctes de produits, les formes étant le plus souvent communes avec une gamme de décors
plus restreinte et une cuisson moins bien maîtrisée hors des ateliers191.
Le faciès R.S.F.O. est illustré dans plusieurs stations littorales192 où le matériel récolté
n'est pas en rapport avec l'étendue supposée des sites; nous possédons seulement ce qui a été ra-
massé en surface au siècle dernier et les couches profondes ont très rarement été atteintes comme
le montrent les sondages récents de Conjux et de Tougues193. Les habitats terrestres bien docu-
mentés sont encore rares194 ainsi que les bronzes195. Pour les haches à ailerons ou à douille je se-
rai aussi indécis que les chercheurs suisses qui ne peuvent pas dégager clairement, dans leur
abondant matériel, de séries évolutives spécifiques à chacune des deux dernières phases du
Bronze final; ceci interdit de classer les pièces sans contexte, cas trop fréquent. Toutefois les ra-
res haches à ailerons subterminaux196 sont probablement à placer à cette phase. Nous verrons
plus loin les quelques nécropoles de cet âge, mais il ne faut pas s'attendre à trouver dans les sé-
pultures le reflet typologique exact des habitats jugés contemporains.
Les bronziers lacustres monteront en Maurienne pour exploiter des gîtes cuprifères, par
exemple ceux de Termignon; en effet tout à côté, les incinérations en grotte de Sollières asso-
cient céramiques R.S.F.O. et maillet à rainure votif197, outil habituel du mineur pour concasser le
minerai ou sa gangue.
190 Comme celui retrouvé à Sévrier sur le lac d'Annecy 191 Il serait absolument nécessaire de disposer d'analyses précises des céramiques lacustres pour apprécier les échanges et la part
qui revient aux fabrications domestiques 192 Conjux, Grésine à Brison-Saint-Innocent sur le lac du Bourget, Sévrier sur le lac d'Annecy et Tougues sur le lac Léman. 193 Bien fournis en céramiques, il semble que les bronzes de la phase moyenne des sites littoraux sont moins abondants qu'à la
phase suivante 194 Avec gobelets et écuelles à épaulement, plats à marli mouluré et plats à piédestal, etc. Existent à Etrembières (Haute-Savoie);
Sollières (Savoie); Fontaine, La Buisse, Seyssinet, Claix, Choranche (Isère); Saint-Nazaire-le-Désert et Sahure (Drôme) etc. et
encore aucun dans les Hautes-Alpes. 195 Couteaux à soie, épingles à tête cylindro-conique ou vasiforme de forte taille à Etrembières et Bossey, au pied du Salève,
Douvaine (Haute-Savoie); Aiguebelette, Vimines (Savoie) près de Chambéry; Hières-sur-Amby près de Crémieu, Fontaine,
Seyssinet près de Grenoble (Isère); Lazer, Eyguians, Trescléoux et Saint-Genis (Hautes-Alpes) près du Buech (Fig. 26, 12 à 17) 196 La Balme-de-Thuy, Sillingy, Chens-sur-Léman, Thonon, Reignier en Haute-Savoie; Saint-Chef (Isère) 197 En cargneule locale (dolomie) trop tendre pour fracturer un minerai ou sa gangue
84
Les contacts des sites R.S.F.O. avec l'Italie sont apparemment faibles avec seulement l'im-
portation d'une fibule proto-villanovienne au lac du Bourget. Nous verrons qu'il n'en sera pas de
même pour la métallurgie indigène alpine.
Un faciès "bourguignon" (Fig. 27)
Des urnes biconiques à rebord éversé et concave, des petits vases globuleux portant sur la
panse de larges ou très larges méplats horizontaux et des plats à rebord outrepassé, des panses
couvertes d'impressions digitales larges et jointives sont retrouvés dans quelques gisements ter-
restres198 et, jusqu'à aujourd'hui, jamais en palafittes199; nous les datons de la fin de la phase
moyenne (BF IIIa). Les décors géométriques gravés sont remplacés dans les habitats terrestres par
des décors en guirlandes ou en triangles faits au peigne ou à la cannelure. La forme générale des
récipients comme celle des rebords éversés et galbés annoncent celles qui fleuriront à la phase
récente, tant dans les palafittes qu'ailleurs. La fouille récente de Creys-Saint-Alban est démons-
trative car elle montre l'absence de céramique R.S.F.O. proprement dite à la fin de la phase
moyenne et la continuité d'évolution entre le BF IIIa et le BF IIIb.
Pour être mieux éclairé sur ces deux faciès, parmi lesquels il existe des convergences, il
nous manque des études stratigraphiques, en lacs surtout puisqu'ils contiennent la superposition
de toutes les phases. Ajoutons que ce faciès "bourguignon" de Creys est accompagné de frag-
ments de moules ce qui indique la présence d'artisans bronziers dans le village mais sans connaî-
tre les types de bronzes à lui rattacher. Son origine se retrouve plus facilement en pays rhénans et
en Bourgogne qu'en Suisse occidentale.
La métallurgie alpine continue avec d'étroits contacts italiques (Fig. 28)
Les productions de type Rhin-Suisse-France Orientale et les productions indigènes alpines
restent typologiquement bien séparées même si leurs ateliers respectifs sont parfois très proches:
ainsi des Alpins200 se trouvent à quelques kilomètres seulement des stations des lacs du Bourget
et d'Annecy où se pratique la métallurgie R.S.F.O. Une hache à ergots latéraux de type alpin a
même été trouvée sur le lac d'Aiguebelette ce qui montre les contacts entre les communautés la-
custres et terrestres201.
198 Creys-Mépieu (Grottes des Cresses et Saint-Alban) et la Balme-les-Grottes dans le massif de Crémieu, à Claix, Gresse-en
Vercors et Saint-Martin-le-Vinoux près de Grenoble (Isère) (Fig. 27) 199 Dans les Alpes françaises comme en Suisse occidentale 200 Dépôts de fondeurs aux éléments très fragmentés et avec lingots à Drumettaz (Savoie) et à Meythet (Haute-Savoie) 201 Le même phénomène se retrouve aussi dans les palafittes de Suisse occidentale
85
Fig. 27. Phase moyenne du Bronze final alpin. env. 1000 à 930 av. J.C.
Céramique du faciès "bourguignon"
1, 2 et 4: Creys-Mépieu (Saint-Alban); 3, 5, 6 et 9: Claix; 7 et 8: Saint-Martin-le-Vinoux, Isère. (échelles
diverses). D'après: 1, 2 et 4: Treffort 1993; 3, 5 à 9: Bocquet 1969.
La métallurgie "indigène" subit une très forte influence italique. Les Alpins ne possèdent
probablement pas le savoir-faire requis pour traiter le minerai car ils importent du métal brut de-
puis l'Emilie-Romagne sous forme de lingots-bipenne202. Mais il faudrait des analyses pour sa-
voir quels types d'objets contiennent le métal transalpin. Ce sont aussi des influences italiques
plus subtiles qui affectent la forme des haches locales avec leurs ailerons subterminaux et ergots
latéraux imités des modèles proto-villanoviens203. Ces haches aux caractères très reconnaissables
ont eu quelque diffusion autour des Alpes en Jura, dans l'Ain et jusque dans le Var204.
Les bracelets à section en D gravés, du début du Bronze final, voient leur décor se com-
pléter de chevrons, dents de loup et volutes205; ils vont évoluer en s'élargissant et devenir plats
avec une nervure médiane à la phase suivante. Ils coexistent avec ceux de section ronde et à fai-
bles tampons (issu du type "Geispolsheim") portant les mêmes motifs qui auront une grande vo-
gue dans la région. Les dépôts alpins contiennent aussi des épingles à large tête discoïde206 con-
nues dans l'Est de la France; ont-elles été fabriquées dans la région? Seuls trois dépôts à domi-
202 Aussois en Maurienne, Albertville (le dépôt d'Alberville a été trouvé en réalité à Saint-Pierre-d'Albigny, à 15km au sud
d'Albertville) et Thénésol dans la Combe de Savoie (Savoie) et Goncelin (Isère) en Grésivaudan (Fig. 28-A, 6 à 9) 203 Meythet, Messery et Domancy (Haute-Savoie); les Echelles, Drumettaz, Aiguebelette et Albertville (Savoie); Claix (Isère) près
de Grenoble; Villar d'Arêne et Réallon (Hautes-Alpes), etc. (Fig. 28-A, 1 à 5, 12) 204 Dépot de Larnaud, Equevillon, Jura; Thoissey, Ain; dépôt de Pourrières qui possède aussi des bracelets alpins, Var. 205 Dépôts de Goncelin (Isère); Drumettaz et Albertville (Savoie) (Fig. 28-A, 13 à 16) 206 Dépôts de Goncelin (Isère); Drumettaz-Clarafond et Albertville (Savoie) (Fig. 28-A, 17)
86
nante "alpine"207 possèdent des faucilles à languette et butée associées au modèle à bouton (Fig.
28-A, 10 et 11), bien datées de la phase moyenne en Allemagne et en Suisse, et qu'il n'en existe
pas ailleurs.
Fig. 28. Métallurgie alpine Phase moyenne et récente du Bronze final alpin.
A- Phase moyenne- 1 et 2, 10: dépôt de Meythet, Haute-Savoie; 3: les Echelles; 4, 6 et 7, 11 et 15: dépôt
d'Albertville, Savoie; 5: Claix; 8, 13 et 16: Dépôt de Goncelin, Isère; 9: Aussois, Savoie; 12, 14 et 17: dé-
pôt de Drumettaz-Clarafond, Savoie. (échelles diverses). D'après: 1 à 8, 10 à 17: Bocquet et Lebas-
cle1976; 9: dessin F.Vin.
207 Drumettaz-Clarafond et Albertville (Savoie) et Villar d'Arêne (Hautes-Alpes)
87
B- Phase récente- dépôt de Menthon, Haute-Savoie; 2: copie en métal massif de modèle palafittique
creux. (échelles diverses). D'après: Bocquet et Lebascle1976.
Des lingots plano-convexes et une faucille du dépôt alpin de Drumettaz ont plus de 1% de
plomb (alors que le taux en est très inférieur dans celui de Meythet) et trois haches à ailerons
sub-terminaux analysées en présentent plus de 1,5%208. Une partie de la métallurgie alpine sem-
ble n'avoir pas les mêmes sources d'approvisionnement que celle de R.S.F.O. de Suisse209; cette
particularité de la métallurgie autochtone se retrouvera à la phase suivante.
La nature et l'impact du faciès Rhin-Suisse-France orientale dans les Alpes du Nord
L'homogénéité des rites et du matériel dans les sépultures, comme l'homogénéité des pro-
ductions lacustres R.S.F.O.210 incite à penser qu'ils sont le fait de communautés spécifiques insé-
rées dans le tissu du peuplement en place à leur arrivée. Les contacts avec les autochtones ne
sont, bien sûr, pas absents211; si quelques céramiques fines perdurent durant la phase suivante, les
bronzes changeront de formes comme de décors212 par une rupture totale dans filiation typologi-
que. Le rite de l'incinération lié à R.S.F.O., en champs d'urnes souvent souterrains213, disparaîtra
aussi complètement. Tout se passe comme si cet épisode R.S.F.O. dans les Alpes du Nord avait
été un phénomène, bien caractérisé et assez court mais avec une influence limitée sur le conti-
nuum du peuplement, des techniques et des traditions religieuses214.
Les bronzes et les vases R.S.F.O marquent spectaculairement la phase moyenne mais l'im-
pact de la technologie nouvelle et des rites funéraires à incinération sur les "indigènes" n'a proba-
blement pas été aussi intense qu'on peut l'imaginer. Le préhistorien est habitué à constater
l'émergence de nouvelles techniques, de nouveaux rites funéraires et de les voir évoluer ensuite
lentement. Par contre il est très rare de les voir disparaître presque complètement, un siècle et
208 La Balme-de-Thuy, Sillingy, Chens-sur-Léman, Thonon, Reignier en Haute-Savoie 209 On est obligé de prendre ces références en Suisse en l'absence d'analyses sur le matériel français 210 Plats à méplats ou cannelures internes, plats à piedestal, plats à marli mouluré, gobelets à épaulement, urnes biconiques à haut
col et écuelles à épaulement interne ou à haut col; ces vases portent souvent des décors à lamelles d'étain et des gravures 211 Urne biconique avec décor de cannelures, de mamelons et une panse peignée habituel à la phase ancienne est en pâte fine, noire,
très lustrée et bien cuite caractéristique de R.S.F.O. 212 La plupart des formes céramiques évoquées ci-dessus disparaitra à l'exception des plats qui perdront piedestal et moulurages
complexes comme le décor gravé ou à l'étain. .Les couteaux à douille ou à fausse virole remplaceront les couteaux à soie, les
bracelets simples ou doubles à tige torse seront abandonnés ainsi que les épingles à grosse tête creuse, etc. 213 Sollières en Maurienne, la Balme-les-Grottes près du Rhône et Francillon dans la Drôme. Les descriptions et le grand nombre
de vases funéraires que nous avons à Veyrier-du-Lac (Gr. du Fortin) à coté du lac d'Annecy et à Collonges-sous-Salève (Gr. des
Sources) m'incitent à voir là aussi des "Champs d'Urnes souterrains" 214 Ce type d'influence, qui peut paraître marginale et en surimpression sur un fond indigène, semble se retrouver dans l'Ouest et le
sud-Ouest de la France; les caractères très particuliers et la qualité des productions issues des R.S.F.O attirent l'archéologue qui leur
attribue peut-être une influence culturelle plus importante qu'elle n'a été réellement
88
demi plus tard comme dans le cas de R.S.F.O. On imagine mal qu'une tradition funéraire puisse
être totalement et subitement abandonnée: soit elle a été imposée par la force et durera seulement
pendant la contrainte, soit elle n'a pas été adoptée par les communautés autochtones; dans les
deux cas les nouveautés n'auront pas de suite et c'est le cas des Alpes du Nord. A notre sens, cet
épisode R.S.F.O. représente l'intrusion de métallurgistes et de céramistes venus du Nord-Est215
installer des centres "industriels" dans des lieux qui répondaient aux nécessités techniques de
leurs productions pour alimenter des marchés en plein essor et ils ont disparu quelques généra-
tions plus tard.
Certains, avec P.Pétrequin, ont vu à ce moment-là une période de stabilité et d'uniformisa-
tion culturelle entre deux époques de crises (phase ancienne et phase récente du Bronze final).
L'uniformisation culturelle et technique touche seuls les R.S.F.O. et une certaine stabilité politi-
que ou économique a pu affecter toutes les communautés, encore que l'installation de certains
villages lacustres sur des îles tendrait à prouver le contraire. Dans les Alpes, comme en Langue-
doc-Provence par exemple, cette "uniformisation", si uniformisation il y a eu, sera de courte du-
rée, bouleversée par tout ce qui se met en place à la fin du Xe siècle et qui touche le matériel, les
rites, les mutations sociales et économiques, l'organisation géopolitique du pays, etc.
PHASE RÉCENTE DU BRONZE FINAL ALPIN env. 930 à 700 av. J.C. (FIG. 29, 30 ET
31)
Cette période couvre plus de deux siècles et voit se multiplier les sites tant dans les ré-
gions anciennement occupées que dans de nouveaux territoires; cela traduit un accroissement
démographique et une sédentarisation définitive de la plupart des habitats, facilités par l'accrois-
sement des rendements dû aux progrès et à la généralisation des outillages agricoles comme
l'araire, le char et l'attelage216 des bovidés.
Encore de nouveaux changements typologiques
A la fin du Xe siècle, sur le bord des lacs ou ailleurs, les populations ont des habitudes
techniques et culturelles totalement différentes de celles de R.S.F.O. Ce phénomène est-il dû à de
simples influences reçues du Nord, à la "réactivation" de traditions anciennes qui n'étaient qu'en
sommeil ou bien à de nouveaux mouvements humains? Dans ce dernier cas les arrivants auraient
manifesté plus de capacité que les R.S.F.O. à s'intégrer aux communautés existantes; peut-être
215 Pays de Bade, Alsace, Marne et/ou Suisse 216 En témoignent la roue de bois découverte récemment à Tougues, sur le lac Léman, le char à quatre roues attelé gravé sur roche
à Aussois en Maurienne ainsi que ceux gravés sur céramique à Moras-en-Valloire (Drôme)
91
Fig. 29. Phase récente du Bronze final alpin. 940/930 à env.700 av. J.C.
A- Stations palafittiques
1 et 2: plats peints en noir et rouge, Chindrieux; 3 à 18: diverses stations, lac du Bourget; 19: Duingt, lac
d'Annecy. (échelles diverses). Dessins: 1 à 5 I.Kérouanton; 6 à 18 A.Guillaumet; 19 M.C Lebascle.
B- Sites terrestres
1: plat décoré de cannelures et 2: Sassenage, Isère; 3: Montmorin, Hautes-Alpes; 4: Presles; 5: Barraud,
Isère; 6: Ribiers, Hautes-Alpes; 7: Saint-Siméon-de-Bressieux; 8: Crémieu, Isère. (échelles diverses).
D'après: 1 et 2, 4 et5, 7 et 8: Bocquet 1969; 3: Haussmann 1995; 6: Courtois 1960.
Fig. 30. Céramiques décorées et figurines d'argile cuite.
1, 2 et 3: plats à marli gravé, Moras-en-Valloire, Drôme; 4 et 5: plat gravé, Saou, Drôme; 6: plat à marli
gravé, Virignin, Ain; 7: chenet gravé, Brison-Saint-Innocent, Grésine, Savoie.
Anthropomorphes- 8, 9 et 10: Le Saut, Tresserve; 11: Chindrieux, Savoie; 12 et 13: fragment de
plaque d'autel et matrice à estamper, Brison-Saint-Innocent, Grésine.
Zoomorphes- 14 et 15: Brison-Saint-Innocent, Grésine, Savoie. (échelles diverses).
D'après: 1, 2 et 3: Nicolas in Bocquet et Lagrand 1976; 4 et 5: dessins Héritier; 6 et 13: dessin Bocquet;
7 à 10, 12, 14 et 15: dessins I.Kerouanton; 11; Billaud et Marguet 1992.
étaient-ils de même origine "ethnique", de mêmes traditions religieuses que ceux qui étaient arri-
vés dans les Alpes à la phase ancienne, au XIIIe siècle.
Dans les sites où s'était développé le faciès R.S.F.O. les éléments typiques de la cérami-
que s'effacent. Le sondage de Tougues, sur le lac Léman est démonstratif du changement complet
dans la morphologie et la décoration des vases entre la fin de la phase moyenne et le début de la
phase récente217. Les nécropoles sont désertées avec l'abandon du rite funéraire à incinération;
quand il y a continuité des habitats (palafittes entre autres) les couches sus-jacentes offrent du
matériel portant de nouveaux caractères. C'est une nouvelle rupture qui affecte le début de la
phase récente, mais celle-ci évoluera dans la longue durée contrairement à R.S.F.O...
On ignore encore si cette rupture se marque aussi par un abandon des stations littorales;
une seule donnée actuellement le laisserait supposer, c'est que l'emplacement des nouveaux villa-
ges est souvent quelque peu décalé par rapport à celui des anciens218, preuve d'une reconstruction
totale. Les activités pourtant restent identiques, métallurgie et poterie, dans des ateliers qui de-
meureront actifs jusqu'à leur disparition à la fin du IXe siècle.
Ultérieurement et pendant quelques siècles l'évolution des formes et des décors des cé-
ramiques se fera lentement: beaucoup perdureront comme le montrent les rares stratigraphies219
217 avec l'apparition dans la céramique des formes globuleuses et des rebords éversés et courbes et la disparition totale de toutes
formes à épaulement et à haut col. Un sondage à Conjux sur le lac du Bourget le confirme plus modestement. 218 D'après les analyses dendrochronologiques de quelques échantillons dispersés sur les stations, plusieurs villages ont existé
pendant les deux phases, sans que l'on sache s'ils sont parfaitement en continuité et superposés (voir le tableau des dates) 219 Adoucissement du profil des panses, passage progressif des motifs d'impressions digitales aux impressions à l'outil sur
céramique grossière, etc. Longue durée des plats ou des coupes à rebord vertical rentrant, etc. difficiles à dater avec précision dans
92
qui ne révèlent aucune rupture typologique. Il en sera de même pour les bronzes dont les formes
nouvelles apparues au début de la phase récente demeureront longtemps inchangées220. Seules de
petites variantes apparaîtront, dues à la multiplication des ateliers locaux221, variantes qui ne
peuvent pas être finement datées la plupart ayant été trouvées hors contexte archéologique. Bien
des bronzes attribués par leur forme à la phase récente ont donc été produits postérieurement sui-
vant des traditions et des procédés anciens en usage à la fin du Bronze final. En effet, ce n'est
qu'au Hallstatt final qu'apparaissent les premières haches à douille en fer222. Seules les Hautes-
Alpes feront preuve d'originalité avec la fabrication de parures spécifiques à la région.
En résumé, beaucoup de matériel de type "fin Bronze final" persistera au moins durant la
première partie du premier âge du Fer, ce qui explique la forte densité des sites attribués à la
phase récente du Bronze final, dont beaucoup seraient en réalité plus tardifs. La carte de répar-
tition de la fin du Bronze final est donc affectée par ces imprécisions et sera moins chronologique
que techno-culturelle.
L'avant-pays (Fig. 30)
Les villages lacustres occuperont parfois de grande superficie223 et on doit regretter en-
core l'absence de fouilles d'envergure sur ces sites qui nous privent des éléments dont disposent
nos collègues suisses. Leurs productions coexisteront avec celles des ateliers de bronziers locaux
intégrés dans les communautés224; par exemple les haches et herminettes à douille et à étrangle-
ment central225 sont absentes des productions lacustres alors que leur diffusion, généralisée dans
la moitié Sud de la France, témoigne d'une métallurgie alpine qui conserve une certaine origina-
lité dans ses inspirations et l'élaboration de ses fabrications.
L'influence des acheteurs alpins se retrouvent dans les productions du lac du Bourget (Fig.
30-A) qui s'adaptent aux goûts régionaux. Les haches perdent leur caractère galbé au profit de
les sites où le matériel est peu abondant, ce qui est fréquent. Cette continuité dans l'évolution lente dans la céramique est attestée
aussi à Boira Fusca en Piémont (renseignement F.Fedele) 220 Couteaux à douille, faucilles à bouton et épingles à tête vasiforme ou enroulée, etc. 221 Absence d'anneau latéral et massivité des haches à ailerons terminaux 222 A la Tour et Gruffy (Haute-Savoie) et au Pègue (Drôme). Les artisans métallurgistes de village se sont convertis au nouveau
matériau sans changer leurs techniques adaptées au bronze; en effet la douille est une aberration mécanique pour le fer. 223 Plus de dix hectares à Brison-Saint-Innocent, Grésine ou à Tresserve, le Saut sur le lac du Bourget 224 Dépôt de Menthon (Haute-Savoie) et trouvailles isolées de haches à ailerons terminaux rectangulaires, massives et sans anneau
(illustrées par le moule de Ribiers près du Buech). Dans le dépôt alpin de Menthon (Haute-Savoie) un bracelet à grandes ailettes
tente de copier maladroitement ceux des palafittes; trois couteaux à douille à extrémité arrondie pourraient être rattachés aussi aux
productions "terrestres". Il en serait de même pour une hache à douille cannelée à forte teneur en plomb de la Buisse qu'on ne sait à
quel type rapporter (Saxe?). 225 La Balme-les-Grottes, Ste-Marie-d'Alloix (Isère); Nyons (Drôme); dépôt de Ribiers (Hautes-Alpes)
93
celles, plus massives, de la tradition locale226. Beaucoup de bracelets sont conformes à ceux en
vogue à la fin du Bronze moyen et au début du Bronze final227 en évitant certaines formes exubé-
rantes et les décors trop riches (type de Saint-Genouph). Les épingles à tête vasiforme, usinées au
tour et celles à enroulement spiralé (Fig. 30-A, 10 à 12) sont très nombreuses bien qu'un peu
moins variées que celles des productions helvétiques.
La belle céramique (Fig. 30-A, 1 à 5) issue des ateliers palafittiques se retrouve228 rare-
ment dans les gisements terrestres de la région où la gamme des formes est toujours plus pauvre,
la cuisson moins régulière et les décors moins variés (Fig. 30-B, 1, 2 et 4). Les productions lacus-
tres sont-elles réservées à l'exportation lointaine229? Les éléments chronologiques actuels ne sont
pas assez précis pour le dire et les analyses céramologiques manquent.
Haches à ailerons terminaux et à douille, couteaux à douille, épingles à tête enroulée, par-
sèment le pays sans que l'on puisse savoir si l'origine en est lacustre ou non, à de rares exceptions
près230; leur nombre indique que l'usage du Bronze se généralise. Les bronziers, mêmes ceux des
palafittes, connaissent bien les haches armoricaines et les copieront par "surmoulage"231 ou en
imiteront les reliefs bouletés et les faux ailerons, ce qui montre assez leur impact sur l'économie
et les goûts locaux.
A la fin de la période, au VIIIe siècle, à Fillinges au Sud du lac Léman, sept cuirasses du
VIIIe siècle issues des ateliers du Danube (?), et une autre à Grenoble (Fig. 34, 8) révèlent une
présence militaire liée aux "princes" ou aux premiers Hallstattiens? Des influences hallstattiennes
apparaissent déjà à la fin du IXe siècle, aux Gandus à Saint-Ferréol-Trente-Pas232 et les grottes
du Diois ne sont pas avares en céramiques de cette époque233.
Un bracelet du dépôt haut-alpin de Bénévent-Charbillac est en bronze au plomb (9%) et
nous avons vu que bien des pièces du même âge ont une concentration en plomb supérieure à
0,8%. Ce phénomène débute dès la phase moyenne dans les Alpes (ce qui est inhabituel en Eu-
rope) et s'amplifie à la phase récente où les objets à faible teneur en plomb sont exceptionnels; le
226 Les préhistoriens suisses, qui connaissent bien cette époque par un abondant matériel livré par des dizaines de villages, l'ont
bien senti en isolant un "faciès lémanique"; nous en ferions plus volontiers un faciès alpin 227 Avec une section ronde, de petits tampons et des gravures géométriques (Fig. 30-A, 14, 16 et 17) 228 représentée par des coupes, jattes, plats, vases à panse très globuleuse aux décors peints ou imprimés, aux pâtes bien cuites 229 A Hières-sur-Amby (Isère); Saint-Uze, Saou, Die, Vercoiran, Le Pègue (Drôme); Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, etc. 230 Nous venons de voir l'exemple de trois couteaux 231 Dépôt de Porcieu-Amblagnieu, Sévrier (Haute-Savoie) (où une hache à douille et un couteau de la même station ont 1,2 et 1,9%
de plomb...), Chindrieux (Savoie) etc. 232 Forme des coupes et décors gravés sur pâte cuite par exemple (Fig. 34, 2 à 4) avec une date de 807 BC et une autre assez
approximative dendrochronologique de -835/825, représentant une intrusion hallstattienne en milieu technique de type Bronze final 233Francillon, Montmaur-en-Diois (Drôme) etc.
94
plomb remplace une certaine part d'étain dont la quantité diminue dans les bronzes par rapport
aux périodes antérieures; ce phénomène est général en Europe. Mais le plomb, s'il fluidifie aussi
bien que l'étain le métal à la coulée, ne procure pas au bronze les mêmes qualités mécaniques.
Les massifs internes
A cette période, la conquête des Alpes internes s'intensifie: elle atteint l'Oisans, en Dau-
phiné, jusqu'alors pratiquement ignoré234, et s'affermit dans les vallées du Guil et de l'Ubaye, en
Maurienne et en Tarentaise en colonisant les bassins latéraux235. Bien que l'on ait pas de vestiges
d'habitat, les pollens de la tourbière de Valloire en Maurienne, à 1800m, vers 800/700 BC tradui-
sent cette extension du peuplement par des déforestations.
Les contacts avec l'Italie du Nord
Ces contacts se poursuivent au IXe siècle avec divers objets villanoviens236 en provenace
d'Emilie ou d'Etrurie, les décors anthropomorphes sur céramique et les swastikas au lac du Bour-
get. On remarquera la grande diffusion de la mode des épingles, qui abondent au Nord et à
l'Ouest des Alpes mais aussi en Italie du Nord où les tombes en récèlent beaucoup dès le début du
Bologna I (début du IXe siècle) jusqu'au VIIe siècle; ici la variété des modèles étant moins
grande qu'en Suisse ou en France, il est probable que l'inspiration en arrive de ces régions. Le lac
du Bourget a livré un des plus anciens fers façonnés en France237, bien daté d'avant le VIIIe
siècle; l'origine en est-elle l'Italie ou l'Europe moyenne?
L'abandon des stations littorales
La disparition des stations littorales des lacs et des rivières est un phénomène qui affecte
l'Europe moyenne et occidentale dont la signification historique n'est pas considérée à sa juste va-
leur, probablement par l'incertitude de ses causes. Depuis le siècle dernier la couche supérieure
de ces sites, datée de la fin du Bronze final, a livré aux ramassages et aux fouilleurs une abon-
dance étonnante de céramique et de métal; l'eau les a recouvertes suffisamment vite pour que
bois et matières périssables y soient conservés.
Raisons climatiques ?
234 Freynet-d'Oisans et Villard-Notre-Dame (Isère); Villar-d'Arêne (Hautes-Alpes) 235 Tombe à Saint-Véran en Queyras, haches, épée, bracelets, lance ou céramiques à Sainte-Marie-de-Cuines, Albiez, Saint-Jean-
de-Maurienne, Villette, Pralognan, Châtel, Jarrier, Fontcouverte dans les Bellevilles, le pays d'Arvan, la Vanoise en Savoie, etc 236 Fibule, agrafes de ceinture, pinces à épiler, fibule serpentiforme et rasoir au lac du Bourget 237 Deux bracelets et deux épingles antérieurs à -814
95
Dans le passé l'explication la plus souvent avancée était qu'une forte péjoration climatique
avait fait monter le niveau de l'eau, très rapidement et définitivement, obligeant à l'abandon; dans
ce cas pourquoi la richesse constituée par les bronzes a-t-elle été laissée sur place? Cette hypo-
thèse parait aujourd'hui peu réaliste: les dates dendrochronologiques des derniers pieux plantés
dans les différentes stations ne sont pas identiques, avec des différences qui atteignent plusieurs
décennies entre la Savoie et la Suisse occidentale, ce qui élimine la contemporanéïté d'un phé-
nomène climatique généralisé238. Une dégradation climatique existe bien, celle du stade Goes-
chen I A, qui marque le début du Sub-Boréal expliquant la montée des eaux, mais ce n'est que
vers -790 que les chênes européens commencent à souffrir d'anomalies de croissance, d'après les
dendrologues, c'est à dire peu après, mais toujours après les derniers abandons d'après les don-
nées actuelles.
Prenons l'exemple de la disparition aux XIVe/XIIIe siècles des habitats terramaricoles de
la plaine du Pô; les auteurs italiens qui en voyaient aussi la cause dans les changements climati-
ques, penchent aujourd'hui , comme le dit A.Cardarelli pour "une explication d'ordre historico-
politique et/ou un facteur de crise et d'instabilité interne sur le plan économique et social". Cette
fin correspond d'ailleurs à un déplacement sur les sites défensifs de hauteur et les "castellieri"
deviennent nombreux dans les vallées piémontaises, comme un repli vers des régions naturelle-
ment protégées.
Raisons politiques, économiques ?
Pour les Alpes aussi d'autres motifs que climatiques doivent être envisagés pour expliquer
l'abandon des stations littorales à la fin du IXe siècle. Des traces d'incendie239 font penser à des
actions violentes qu'expliqueraient des raids destructeurs. Le processus serait alors comparable à
ce que les Vikings ont fait subir pendant le IXe siècle à l'Europe de l'Ouest avant leur implanta-
tion dans des territoires conquis ou concédés. On peut envisager des luttes entre "chefs ou prin-
ces" se disputant la possession du pays, des fabrications ou des marchés; ce peut être aussi les
premières incursions des cavaliers hallstattiens vers l'Ouest. Les traces archéologiques de ces
raids sont toujours difficiles à reconnaître et seuls les textes sont à même de nous renseigner avec
quelques précisions sur ceux des Normands du Moyen-Age.
238 En effet les dates placent la disparition des stations suisses vers -850/-840 et des résultats récents prouvent que ce fut plus
tardif dans les Alpes françaises: en -841 et -814 des pieux étaient encore plantés sur le lac du Bourget à Chindrieux et en -834 à
Messery sur le lac Léman. 239 Des bracelets de bronze, entiers et sans défaut, fondus sous l'action de la chaleur à Brison-Saint-Innocent et aussi quelques
pieux carbonisés
96
Ainsi se justifieraient les décalages chronologiques constatés dans les abandons entre
Suisse et Savoie et aussi se comprendrait mieux le déplacement du peuplement vers des zones de
refuge à l'intérieur des massifs centraux et dans les Hautes-Alpes, moins accessibles que le pied-
mont et aussi plus faciles à défendre. Ces temps troublés auraient incité à l'occupation temporaire
97
de très nombreuses grottes, souvent élevées au-dessus des vallées; pratiquement il n'existe pas de
cavités, même de faible dimension, autour et souvent à l'intérieur des massifs calcaires qui ne re-
cèlent pas quelques tessons attribuables à la fin du Bronze final, traces de séjour plus ou moins
prolongé. Doit-on à la même cause les enfouissements de dépôts240 qui ne sont pas des "trésors"
de bronziers car ils ne comportent que des haches entières?
L'organisation du territoire, occupation des sites de hauteur et les "princes"
Il est impossible de dater avec précision l'installation des places fortes dominant les voies
de passages241 et c'est regrettable car il serait bon de savoir si elle correspond, ou non, aux aban-
dons des stations lacustres. Ces oppidums sont installés sur les voies stratégiques traduisant ainsi
autant la prise de possession et le contrôle du territoire que la nécessité de se protéger d'incur-
sions destructrices. Une classe dirigeante concentre son pouvoir en organisant politiquement et
commercialement les communications et l'espace alpin, ce qui ne va pas forcément sans heurt ni
sans confrontation d'intérêts.
L'exemple le plus spectaculaire en est donné par l'oppidum de Larina à Hières-sur-Amby
près de gués sur le Rhône en Nord-Dauphiné, que l'on peut considérer comme une "résidence
princière" liée à la nécropole de tumulus de Saint-Romain-de-Jalionas. La plus riche des tombes,
datée du VIIIe siècle, témoigne de la richesse comme de la position sociale du défunt242. Dans la
fertile plaine de Bièvre-Valloire entre Isère et Rhône, dont les découvertes sont encore rares243, à
la Côte-Saint-André les restes d'un char à quatre roues de bronze coulé conservaient une jante en
chêne datée de -735/-725, remplaçant celle qui avait été posée auparavant; il y avait donc ici
aussi un "prince" dès la fin du IXe siècle244 dont il reste à trouver l'oppidum au carrefour de l'axe
est-Ouest de Bièvre-Valloire et celui Nord-Sud reliant la basse vallée de l'Isère à Bourgoin245. Se-
lon des hypothèses récentes ces princes domineraient une région bien déterminée. Le début du
contrôle des axes transalpins est confirmé par quelques tumulus placés entre Buech et Durance246
semblant liés à une aristocratie, riche sans être forcément princière, installée sur la route du
240 Saint-Siméon-de-Bressieux, Thodure, Porcieu-Amblagnieu, Sainte-Marie-d'Alloix (Isère) 241 A Hières-sur-Amby, oppidum de Larina en Isère; à Musièges, à Bossey et à Monnetier-Mornex (Petit-Salève) en Genevois
(Haute-Savoie); sur la basse Isère à Saint-Just-de-Claix; à Saint-Alban-Leysse (Saint-Saturnin) (Savoie) près de Chambéry; Varces
et Vif (Isère) au carrefour grenoblois; Quêt-en-Beaumont (Isère) sur le haut Drac entre le sillon alpin et le Champsaur, etc. 242Une épée en bronze, un couteau en fer qui copie fidèlement un modèle en bronze à manche coulé, une situle et une tasse origi-
naires d'Europe centrale et des bijoux d'or. Ce site funéraire doit être légèrement postérieur à l'abandon des stations littorales. 243 Dépôts de Saint-Siméon-de-Bressieux, de Thodure (Isère) 244 Ces roues seront adaptées au VIIe/VIe siècle à un char cultuel ce qui montre la très longue utilisation du matériel de prestige ou
religieux. 245 Au Moyen-Age comme encore aujourd'hui ce carrefour est important pour le trafic régional 246 Chabestan, Monetier-Allemont (avec une épée à soie plate) (Hautes-Alpes)
98
Mont-Genèvre dès le VIIIe siècle et que les deux siècles suivants verront croître et prospérer sous
la domination hallstattienne.
Le pied des Alpes du Nord possède des tombes à statut princier qui sont parmi les plus an-
ciennes de France, rattachées à un vaste ensemble centré sur le Nord-Est de la France, ce qui est
assez significatif de l'importance stratégique et commerciale de cette région dans le cadre de
l'aménagement l'Europe occidentale.
Art et religion (Fig. 31)
Des vases et des coupes du site de Moras-en-Valloire en Bas-Dauphiné, datables de la fin
du Bronze final, sont décorés d'incisions figurant des chars attelés, croix, swastikas, anthropo-
morphes, frises de danseurs et signes géométriques. Le même type de vases trouvés à Saou, en
Diois, portent des signes assez semblables mais dans un registre moins étendu, toujours en con-
texte archéologique identique. La station de Chatillon, Chindrieux, sur le lac du Bourget possède
une coupe bien connue avec une frise de danseurs obtenue par de fines lamelles d'étain, malheu-
reusement sans position stratigraphique connue247; des tessons incisés de chars ou d'attelage
proviennent de Virignin en rive droite du Rhône dans le défilé de Pierre-Châtel. A Sérézin-du-
Rhône, près de Vienne, une frise de danseurs gravés orne un plat dont la céramique associée date
de la fin de la phase moyenne (BF IIIa) ce qui situe le début de cette pratique. De nombreuses
études admettent que cet art sur céramique, largement répandu dans le couloir rhodanien, le Midi
méditerranéen248 jusque dans les Charentes et le centre de la France, se développe entre le Xe et
le VIIIe siècle. Quelques motifs, swastikas, cercles concentriques et anthropomorphes, comme
celui du méandre plus largement utilisé, ne sont probablement pas sans rapport avec les décors
villanoviens et les chars évoquent les gravures rupestres du Mont-Bégo ou du Val Camonica249.
Quadrupèdes, anthropomorphes, swastikas sénestrogyres, cercles concentriques, zig-zag incisés
sur céramiques, semblables aux motifs alpins et d'inspiration villanovienne, existent sur certains
vases Golasecca datés par nos collègues italiens du Golasecca II, donc plus tardifs.
Les petites figurines modelées en terre cuite du lac du Bourget sont soit anthropomor-
phes250, soit zoomorphes251. C'est dans la station du Saut à Tresserve que les ramassages du siè-
cle dernier ont récolté la quasi totalité des figurines anthropomorphes extraites du lac alors que
247 La technique aux lamelles d'étain ferait penser plutôt à la phase moyenne du Bronze final 248 En particulier à Castelnau-le-Lez, Hérault, Mailhac (Mailhacien I), Aude, etc. qui comportent des céramiques gravées de
grecques, chevaux, quadripèdes ou à Vidauque, Vaucluse, avec une frise de danseurs de même style que la coupe de Chatillon 249 Plus énigmatique est la coupe décorée de signes alphabétiformes de Grésine sur le lac du Bourget 250 dont la forme très spéciale n'est connue qu'au Bourget 251 Chindrieux, Brison-Saint-Innocent, Tresserve
99
les recherches se sont développées de la même façon sur tous les sites: soit c'est le fait du pur ha-
sard soit plus probablement existait là une structure spécifique à caractère "religieux" ou un cen-
tre de fabrication.
La tradition des statuettes d'animaux domestiques remonte au XIVe siècle en Hongrie
(Civilisation de Hatvan) et elle s'est vigoureusement implantée dans les Terramare d'âge proto-
villanovien du XIIIe au Xe siècles en Italie du Nord. Sur le versant italien, le pied des Alpes en
possède ainsi que les palafittes suisses252. Les vases-pygmée trouvés en abondance sur le lac du
Bourget, copies en miniature de toutes les formes alors en usage, sont aussi une tradition qui re-
monte aux Terramare. Statuettes zoomorphes et vases-pygmée seraient issus de l'influence di-
recte de l'Italie du Nord. Les figurines anthropomorphes, plus rares en Italie (Reggio Emilia)
avant le Villanovien final pourraient venir de la région de Cumes; leur diffusion est plus res-
treinte que les zoomorphes et elles existent en Champagne et en Ardèche253. Ces représentations
sont supposées être à vocation religieuse comme les plaques de foyer-autel domestique en demi-
cercle, ornées d'ocelles et de swastikas estampés provenant de Grésine à Brison-Saint-Innocent et
que connaît l'Italie centrale.
De tous ces documents il ressort que des influences méridionales et italiques se font nette-
ment sentir dans le domaine artistique ou religieux, en particulier au lac du Bourget dont le rôle
ne devait pas seulement être commercial et technique. Là en effet se rejoignent les traditions
centre-européennes avec les rouelles et les roues de char votif et le rituel des foyers-autels do-
mestiques de provenance méditerranéenne.
Les rites funéraires de l'âge du Bronze final
-Les tombes du début du Bronze final sont en inhumation plate, en plein air à Petit-Coeur
en Savoie et Crémieu, en grotte à La Balme-les-Grottes et Fontaine254 ou en fissure de rocher à
Parmilieu255. L'inhumation simple et l'incinération en urne coexistent dans le cimetière de Dou-
vaine près du lac Léman; seul de son espèce dans les Alpes du Nord, sa durée fut assez longue
couvrant les phases ancienne et moyenne du Bronze final ce qui explique la présence des deux
rites funéraires. Bien que non funéraire, il faut citer le dépôt votif d'un vase accompagné de cé-
réales et de noisettes caché dans une niche, à l'entrée d'une résurgence au coeur du Vercors256.
252 A Cuorgné-Belmonte en Canavese (porc?) et la province d'Alessandria; Auvernier (taupe?), Corcelettes (porc?), Pfeffingen, etc. 253 Euvy, Marne, Cergy, Val d'Oise, et Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche 254 En grotte la céramique fine abondante est associée à beaucoup de vases grossiers 255 A renflement fusiforme elles sont placées à la période de transition Bronze moyen-Bronze final 256 Villard-de-Lans
100
-A la phase moyenne ce sont des incinérations en urnes, soit en plein air257 soit en grot-
tes258 que nous considérons comme des "Champs d'urnes" souterrains où les ossements calcinés
ne sont pas faciles à déceler mais toujours avec une grande quantité de vases d'offrandes. Selon
certains la grotte de Sollières n'était qu'une réserve de nourriture à cause de l'abondance des vases
grossiers; mais dans tous les gisements cités comme funéraires les récipients grossiers sont tou-
jours nombreux, mêlés à la vaisselle funéraire fine comme les gobelets à épaulement ou les plats,
jamais aussi abondante dans les habitats259.
Dans ces nécropoles, à la Balme-les-Grottes en particulier, les urnes n'étaient pas enfouies
mais disséminées dans les recoins des cavités, ce qui a facilité leur destruction à une époque in-
connue mais certainement ancienne; c'est la raison pour laquelle il n'a pas été trouvé de bron-
zes260. Seule la zone funéraire de Sollières, placée au pied d'une diaclase, n'avait pas été violée.
Ces cimetières en grottes sont bien connus dans le Languedoc261 pour prendre un exemple.. L'uti-
lisation funéraire des fissures de rocher comme des grottes à un stade avancé du Bronze final
reste conforme à une vieille pratique alpine... Dans les hautes vallées de l'Isère et de l'Arc inciné-
rations et céramique R.S.F.O. traduisent la pénétration du nouveau mode funéraire sur les voies
transalpines et près de gîtes de cuivre262.
-A la fin du Bronze final, les rares inhumations connues sont simples263 et malgré l'impor-
tance des stations littorales il n'a pas été trouvé de cimetière dans leur voisinage264, comme cela a
été le cas en Suisse. Le tumulus réapparaît au Nord du Rhône, en Bresse et nous avons parlé de
ceux de Saint-Romain-de-Jalionas et de Chabestan au confluent Buech-Durance qui traduisent le
contrôle de territoires et/ou des voies commerciales au VIIIe siècle. Les sépultures en fosse de
jeunes enfants sous le niveau d'habitat de l'extrême fin de l'âge du Bronze à la Balme-de-Thuy,
Haute-Savoie et à Sainte-Colombe, Hautes-Alpes traduiraient un rite funéraire d'installation.
L'APOTHEOSE DES BRONZIERS ALPINS DANS LES HAUTES-ALPES
257 Seyssel (Haute-Savoie) et Hières-sur-Amby (Isère) près du Rhône; Sciez et Douvaine (Haute-Savoie) en Chablais; Bourg-
Saint-Maurice en Tarentaise; Villarodin en Maurienne 258 Collonges-sous-Salève, Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), Sollières (Savoie), la Balme-les-Grottes (Isère) et Francillon (Drôme)
dans le Diois. 259 Dans une grotte de Claix (Isère), la céramique grossière servait à recueillir l'eau de ruissellement et la céramique fine est très
rare; bien que du même âge ce n'est pas une cavité funéraire. 260 A la Balme-les-Grottes une urne qui avait été épargnée contenait encore quelques os calcinés et une bague en or. 261 A Tharaux (où dans la grotte du Hasard il a même une bague en bronze plaquée d'or identique à celle de La Balme-les-
Grottes), à Montclus, etc 262 En Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice; en Maurienne à Villarodin-Bourget et Sollières-Sardières, 263 Reignier en Faucigny, Sciez et Thonon au bord du Léman, Notre-Dame-de-Briançon en Tarentaise, Creys-Mépieu en Nord
Dauphiné, Saint-Véran en Queyras 264 A Tresserve, lac du Bourget, un crâne de jeune femme a été retrouvé seul et non incinéré dans un vase
101
Quelle est la cause qui fit des Hautes-Alpes le foyer d'une métallurgie abondante, origi-
nale mais limitée dans l'espace, au début du Ier millénaire et pendant quelques siècles? C'est
certainement la conjonction de circonstances économiques et/ou politiques qui ont trouvé dans
cette région des bonnes conditions pour se développer: minerais, savoir-faire des Alpins et
isolement dans des zones-refuges. Des déboisements sont constatés à la tourbière de la Lauza,
entre Champsaur et Gapençais, un peu avant 830 BC ce qui traduirait une poussée
démographique à peu près contemporaine du début de la métallurgie haut-alpine.
Les dépôts et leur matériel
Dans les Hautes-Alpes des objets aux formes et aux décors originaux ( Fig. 32) inspirés
par les modèles en usage à la fin du Bronze final, sont associés avec d'autres, plus courants, dans
des dépôts qui possèdent en général une très grande quantité de pièces265. Un seul, celui de Villar
d'Arêne, est un dépôt de fondeur aux éléments très fragmentés placé à 2000m d'altitude près de
filons de chalcopyrite et des restes de fonderie avec scories; les autres sont des "trésors" d'objets
entiers266. Quatre ensembles de pièces enfouis dans un même champ à l'Epine, près du col de
Saulce entre Diois et Buech267 et celui de Ribiers étaient concentrés sur une aire très restreinte.
Cinq autres se répartissent entre: Beaurières-Charens, Réallon (avec trois dépôts sur la même
commune) et la Fare-en-Champsaur268.
Une spécialité haut-alpine très prisée est celle des ceintures articulées ornées de diverses
pendeloques, connues dès la phase moyenne du Bronze final à Blanot, Côte-d'Or, ou à Billy, Loir
et Cher; sans être identiques entre elles, celles des Hautes-Alpes ont toutes un air de famille mais
un examen attentif et des analyses seraient à même de discerner si elles proviennent ou non d'un
même atelier alpin. Une autre particularité est celle des torques, souvent torses et à extrémités
enroulées, qui se retrouve en Valais suisse; peut-on y voir la persistance à travers les siècles d'une
mode locale héritée du Bronze ancien valaisan qui s'était bien implanté dans la région comme on
l'a vu?
265 On citera les 461 pièces de Réallon ou les 18kg de bronzes de la Fare-en-Champsaur. 266 Dépôts de parures à Bénévent-Charbillac, en Champsaur, avec ceinture articulée de 176 pièces, torques, boutons, bracelets,
rouelles et rasoir, à Saint-Bonnet-en-Champsaur avec ceinture composite articulée, torques, bracelets, boutons, et rouelles, à
Guillestre, en Queyras, avec ceinture, phalères et bracelets, à Réallon (dépôt de 1932) avec ceinture, torques, pendentifs et boutons,
à Lazer avec boutons, phalères et tubes. Le dépôt de Savournon avec huit faucilles et un ciseau évoque plus la vie rurale ou
artisanale (fig. 32). 267 Un avec une hache à ailerons, un poignard et une lance (en 1900), un avec huit faucilles et un ciseau (comme dans celui de
Savournon), un groupe de bracelets (en 1909) et un de parure avec pendeloques et rouelles (en 1949). Ce dernier était contenu dans
un vase dont des tessons, retrouvés en fouille par J.C Courtois à 50m d'un gros foyer ovale, étaient colorés de sels de cuivre. 268 Sont regroupés des outils (couteaux à Réallon, couteaux, haches et scie à Ribiers, couteaux, haches et faucilles à Beaurières et à
la Fare-en-Champsaur), des parures (bracelets, phalères, rouelles, pendeloques à Réallon, à Ribiers et la Fare, épingles, rouelles et
pendeloques à Beaurières), des armes (lances et épée à Ribiers, lance à Beaurières et à l'Epine) et un mors de cheval à Réallon. Ar-
mes et accessoires de harnachement évoquent l'existence d'une classe aristocratique.
102
De nombreux bracelets sont d'inspiration "alpine": en ruban gravé avec une nervure mé-
diane comme dans le dépôt de Menthon ou ceux issus du type Geispolsheim que nous avons vus
à Goncelin et au lac du Bourget. Les pendeloques en "boîtier de montre"269 ont leurs parallèles
près du Danube en Yougoslavie sans que le sens du courant d'influence puisse être déterminé. De
même se pose le problème de l'origine des bracelets de type Réallon-Saint-Genouph, creux, à
grandes ailettes et à riches gravures géométriques trouvés tant en Suisse occidentale qu'en France
de la Loire à la Garonne. Comme le suggère V.Rychner les influences entre les Alpes et les lacs
suisses ont dû être mutuelles. Par contre on doit s'étonner de l'absence totale de matériel haut-al-
pin spécifique dans une vallée bien proche, celle de l'Ubaye où pourtant les découvertes métalli-
ques ne manquent pas. Pour illustrer les contacts transalpins un dépôt avec torque, rouelles et
boutons, tout à fait identiques aux bronzes haut-alpins, a été trouvé à Laux en Val Chisone de
l'autre côté du col du Mont-Genèvre.
Les métallurgistes
Tous ces dépôts témoignent d'une métallurgie active centrée sur une petite région qui ne
manque pas de cuivre, oeuvre d'artisans qui possèdent un haut niveau technique. Leur composi-
tion en objets de parure, soit en outils ou armes, n'est pas sans raison. De plus la concentration
sur une faible superficie n'est pas sans signification.; le champ de l'Epine avec ses quatre groupes
d'objets est à ce propos très éloquent tout comme les trois dépôts sur la commune de Réallon.
Sommes-nous en présence de "tombes sans corps" ou de "dépôts personnels" pour honorer des
défunts riches ou puissants? Il ne faut donc pas exclure l'hypothèse de réserve de bronziers car
certains dépôts composites270 rassemblent des pièces qu'une typologie sommaire place à la phase
moyenne et à la phase récente du Bronze final; ces associations sont, en plus, d'un intérêt majeur
pour approcher la chronologie de ces dépôts.
Cette métallurgie exploitait les filons locaux de cuivre comme l'indique le dépôt de Villar
d'Arêne et la tombe de Saint-Véran, tous deux proches de minerais; l'étain provenait de l'Ouest
dont le commerce est accompagné par les haches à douille atlantiques que j'ai évoqué. A-t-elle vu
le jour au cours ou à la fin du Bronze final: nous venons de voir que plusieurs dépôts comportent
des bronzes de la phase moyenne issues de la métallurgie alpine qui marquerait le début de la
production dans cette région, parallèlement à celle que l'on a vu se développer entre le lac Léman
et les Hautes-Alpes. On ignore la durée des fabrications, aussi bien leur début que leur fin. En
effet les pièces typologiquement les plus anciennes ne pourraient être que des copies d'objets en-
269 Réallon et l'Epine (Hautes-Alpes) et Beaurières (Drôme) (Fig. 32, 7) 270 Villar d'Arêne, Réallon (1870) et Ribiers. Du dépôt de Bersac il ne reste qu'un couteau à soie et dos arqué vraisemblablement
de la phase moyenne, les hache, pendeloque et faucilles n'ayant pas été décrites
103
core habituels chez des utilisateurs très conservateurs; la réalisation des types plus récents a dû
aussi se poursuivre pendant de nombreuses générations, probablement au-delà de la fin de l'âge
du Bronze. Il est malheureusement difficile de les situer actuellement avec précision tellement
certains caractères sont inhabituels et les ensembles dépourvus d'objets importés facilement data-
bles. Ont-ils perduré au cours de l'implantation hallstattienne des vallées du Buech et de la Du-
rance, que l'on abordera plus loin?
On rapprochera cette activité bronzière alpine de celle, très originale aussi, qui s'est déve-
loppée dans le Languedoc-Roussillon à partir de la fin de l'âge du Bronze et durant le premier âge
du Fer, le Launacien; J.Guilaine l'appelle un épi-Bronze final, à une époque où les bronziers attei-
gnent l'apogée de leur art pour lutter contre la diffusion du fer dans le sillage des Hallstattiens.
Une étude exhaustive et critique de cette métallurgie et de l'interprétation socio-culturelle des
dépôts reste à faire; les spectaculaires documents des Hautes-Alpes apporteront de précieux élé-
ments pour la connaissance de cette époque charnière dans l'évolution des sociétés alpines.
NAISSANCE DE L'INDEPENDANCE ALPINE AUX AGES DU FER
Comme je l'ai dit plus haut, les périodes typo-chronologiques sont des cadres commodes
pour classer nos connaissances mais trop rigides pour correspondre aux réalités historiques et hu-
maines. La transition entre âge du Bronze et âge du Fer doit être traitée, comme le préconise J.P.
Millotte, spatialement et d'abord régionalement avant d'être considérée sur une plus large échelle;
ce sera notre angle de vue laissant à d'autres le soin d'incorporer les processus alpins à l'intérieur
de synthèses géographiquement plus vastes.
Bouleversements géo-politiques
J'ai exposé plus haut mes hypothèses sur la déstabilisation précoce des populations de
l'avant-pays alpin par des actions violentes (combats entre "princes" ou autres, raids de Hallstat-
tiens?...) à partir de la fin du IXe siècle, qui auraient visé à la destruction des centres industriels
bronziers et céramiques, source de puissance économique et de cohésion sociale d'une population
dont certains pouvaient craindre une résistance à leurs projets de conquête du territoire ou à leur
commerce. Nous verrons que la hallstattisation des Alpes du Nord ne sera pas le fait de migra-
tions massives (dont plus personne ne parle aujourd'hui) mais due au déplacement de petits grou-
pes, comme le pense depuis longtemps J.P. Millotte, ce qui n'exclut pas des intentions politiques
et/ou commerciales.
Le dernier millénaire av. J.C. verra de grands changements, sociaux et politiques, dans les
Alpes en rapport direct avec les événements européens liés d'abord à l'expansion hallstattienne et
104
Fig. 32. Le "Bel âge du Bronze" des Hautes-Alpes.
1 à 4, 6: Ceinture, rouelles, bracelet, torques, dépot de Bénévent-et-Charbillac; 5, 7, 9 à 12: Bracelets,
rouelle et pendeloque en "boitier de montre", ciseau et faucille, dépot de L'Epine; 8: Bracelet, dépot de
Villar d'Arêne. (échelles diverses). D'après: 1: Müller, Gap 1991; 2, 3, 5 à 7, 9 à 12: Courtois 1960; 4:
Haussmann 1995; 8: Bataille 1964.
ensuite à celle des Gaulois. Ces peuples nomades, toujours bien armés et que l'on soupçonne être
belliqueux, pratiquaient une économie pastorale et utilisaient largement le cheval alors que celui-
ci n'était qu'un symbole de prestige à la période précédente. Vont se trouver en présence, peut-
être s'affronter, deux modes de vie fort différents: l'agriculture sédentaire implantée depuis des
millénaires s'opposera à l'élevage nomade de cavaliers qui affectionneront les terres herbeuses et
105
de relief adouci. Cette opposition économique se traduira aussi par des comportements sociaux et
politiques différents qui transparaîtront dans les Alpes du Nord. Surtout dans la partie septentrio-
nale de l'avant-pays, en particulier le Plateau savoyard et le Nord-Dauphiné, la densité du peu-
plement semble diminuer aux VIIIe/VIIe siècles, ce qui pourrait n'être qu'une impression due à la
précarité de l'habitat des nomades qui laisse peu de vestiges. Mais la population a pu aussi réel-
lement baisser: les ethnologues en Afrique ont bien étudié chez les paysans cette constante qu'il
n'est de "richesse que d'homme" car il faut des bras pour travailler la terre; par contre chez les
106
pasteurs le comportement est différent, les pâturages ne permettant qu'un troupeau limité donc un
nombre restreint de bouches. C'est pourquoi un éleveur sait aligner son taux de fécondité sur ce-
lui de son cheptel, phénomène qui disparaît quand il se sédentarise ou s'incorpore dans une so-
ciété agricole.
Fig. 34. Premier âge du Fer (First Iron Age). env.700 à 450 av. J.C.
Matériel hallstattien-1: épée de Gundligen, Mirabel-aux-Baronnies, Drôme; 2: coupes St-Férreol-
Trente-Pas, Drôme; 3: coupe, Chabestan, Hautes-Alpes; 4: Coupe, Seyssinet, Isère; 5: disque ventral, Tal-
loires; 6, 7 et 9: bracelet, fibule à timbale et plaque estampée, Gruffy; 8: cuirasse, Fillinges; 10: bracelet-
tonneau, la Tour, Haute-Savoie; 11 et 15: coupe à décor de barbotine et urne à décor incisé, Sainte-Co-
lombe, Hautes-Alpes; 12 et 13: urne à décor incisé et urne pseudo-ionienne, le Pègue, Drôme; 14: poi-
gnard, Chabestan, et 16, urne à décor gravé, la Faurie, Hautes-Alpes. D'après: Bocquet 1991
Matériel italique- 17: coupe ionienne (VIe siècle), le Pègue, Drôme; 18: situle, VIe siècle, la
Côte-St-André, Isère, 19, hache à ailerons villanovienne (VIIe siècle), Etrembières; 20: fibules est-italiques
(VIIe/VIe siècle), Habere-Lullin, Haute-Savoie; 21: cruche est-italique (VIIe siècle), Chavignières, Hautes-
Alpes; 22: fibule a sanguisuga (VIIIe/VIIe siècle), Jussy, Haute-Savoie. (échelles diverses). D'après:
Bocquet 1976 et 1991.
107
Les changements climatiques successifs
Nous avons déjà parlé de la péjoration climatique qui commence au début du VIIIe siècle
(Goeschen I A). Une rémission vers 650 av. J.C.271 correspond au début de l'expansion du peupl-
ement et de la richesse dans les massifs internes; cette amélioration a eu une influence bénéfique
sur les ressources des montagnards et la durée de l'ouverture des cols. Puis le climat se dégrade à
nouveau un siècle plus tard (Goeschen I B), au moment de l'abandon de l'utilisation des grands
cols au profit de la voie du Rhône vers Marseille, comme nous le verrons plus loin. Les deux phé-
nomènes, climat et modification des axes de transit, sont-ils liés? ce serait tentant de le penser.
L'originalité de la civilisation alpine à l'intérieur des massifs internes
Archéologiquement la différence est nette entre l'avant-pays (piedmont et massifs préal-
pins) où les matériels ou les rites des arrivants préceltiques et celtiques se diffusent parmi les in-
digènes et les massifs internes qui acquièrent des caractéristiques spécifiques où ces influences
sont mineures, formant le début de la civilisation alpine.
Voici quelques constantes propres aux Alpins des massifs internes tout au long de l'âge du
Fer. Les tombes (Fig. 36-A) sont des inhumations plates entourées de petites dalles ou de gros ga-
lets souvent remplies par de volumineux cailloux272, ceci de la Savoie à l'Ubaye comme sur le
versant italique des Alpes. Des corps, parés parfois de centaines de bracelets et de perles d'ambre,
étalent une magnificence et une richesse jamais vues jusqu'alors. Cette richesse subira des fluc-
tuations, dans le temps comme dans l'espace suivant les régions, en rapport avec les mouvements
géopolitiques européens et les évolutions locales comme on le verra.
La métallurgie et l'usage du fer sont inconnus dans les Alpes internes et les rares objets de
ce métal sont de types hallstattiens ou gaulois donc toujours importés; par contre la métallurgie
du bronze est florissante, originale et de bonne qualité, chaque vallée ayant ses propres goûts
donc ses propres productions. Parmi des milliers d'objets aucune arme n'existe à l'Est du Sillon
alpin tant en Savoie qu'en Dauphiné; c'est assez extraordinaire à des périodes que l'on suppose
agitées mais les Alpins en avaient-ils besoin, protégés par le relief et la répulsion que celui-ci
devait inspirer aux gens des plaines? Ceci n'a pourtant pas empêché la résistance opposée à
Hannibal décrite par les historiens antiques; la défense du territoire et des passages obligés en
montagne a dû être assurée par des moyens simples mais efficaces.
271 Suffisamment intense pour permettre la mise en place de vignobles en Lombardie du Nord 272 Mais ce n'est pas un tumulus, tout au plus une marque extérieure signalant la tombe
108
Fig. 35. âge du Fer, Tombes ou nécropoles de type alpin du VIIe au IIe siècles
1- Groupe Maurienne-Tarentaise
2- Groupe Rochefort-Oisans
3- Groupe Champsaur-Briançonnais
4- Groupe Queyras-Ubaye
109
Fig. 36. âge du Fer alpin, productions régionales du VIIe au IIe siècles (Alpin Iron Age).
A- Tombe alpine en coffre de lauzes - Saint-Sorlin-d'Arves. D'après: Piccamiglio 1990
110
B- Maurienne et Tarentaise- 1 et 4: bracelets en "roue dentée", Saint-Jean-de-Maurienne; 2: bra-
celet à bossettes, Montdenis; 3: fibule à tablette, Saint-Sorlin-d'Arves; 5: crotales ovoïdes, Albiez-Mon-
trond. D'après Bocquet 1991
C- Rochefort-Oisans- 1 à 3: bracelets à décor incisé, Mont-de-Lans, Ornon, Seyssinet, Saint-Mi-
chel-les-Porte. D'après Bocquet 1969
D- Queyras et Ubaye- 1: bracelet-spirale, Jausiers; 2: pendentif, Guillestre; 3: fibule à disque,
Ubaye; 4: fibule, Jausiers; 5: bouton et bouton en barette, Saint-Paul et Guillestre; 6: bracelet avec crotale
piriforme, Guillestre; 7: bracelet à bossettes, Jausiers; 8: bracelets incisés formant brassard, Sisteron.
(échelles diverses). D'après Bocquet 1991.
HALLSTATT ANCIEN env. 700 à 550 av. J.C. (Fig. 33 à 37 et 41)
A partir du VIIIe siècle, le monde hallstattien et l'Italie augmentent leurs échanges: attraits
du mode de vie fastueux et des produits de luxe pour les uns, besoin de matière première (cuivre,
étain, ambre, produits agricoles, etc.) et de débouchés commerciaux (vin, bijoux, vases en bronze
ou en céramique, etc.) pour les autres. L'expansion hallstattienne, dans sa marche vers les rivages
méditerranéens en contournant les Alpes par l'Ouest, imprégnera l'avant-pays; en même temps
elle contrôlera les voies et les cols vers l'Italie, indispensables au trafic commercial entre occi-
dent et monde antique avant la création des comptoirs de Méditerranée occidentale par les Grecs,
au début du VIe siècle.
Le courant hallstattien pénétrera les Alpes suivant des modalités différentes. Les zones de
piedmont, au relief adouci, en présenteront une imprégnation diffuse; les agriculteurs semblent
avoir un peu déserté ces régions laissant aux pasteurs les libres espaces ouverts du Plateau sa-
voyard où le climat plus humide du début du Sub-Boréal favorisait la croissance des pâturages.
Dans le coeur des Alpes, les Hallstattiens auront besoin des voies ouvertes vers l'Italie au cours
des époques antérieures, voies tenues par les montagnards. Le contrôle des axes et des cols de
Maurienne, de Tarentaise, de l'Oisans, de l'Ubaye et du Guil s'effectuera sans occupation du ter-
rain contrairement à celui de la moyenne Durance et du Buech vers le col du Mont-Genèvre qui
véritablement colonisé.
Le fer sera encore peu utilisé, pour quelques bijoux et quelques outils ou armes, et il
n'existe aucune preuve de sa métallurgie; le métal affiné devait provenir d'ailleurs (France de
l'Est, Suisse?). Les analyses du Pègue montrent que le fer hallstattien tardif ne provient pas de la
région, qu'il est plus pur et plus dur que le fer gaulois élaboré plus tard à partir des minerais lo-
caux. Les plus anciens outils en fer sont des haches à douille, nous l'avons vu, placées à la fin de
la période (VIIe ou VIe siècle?).
111
Fig. 37. Age du Fer alpin, éléments importés du VIIe au Ier siècle (Alpin Iron Age).
A- Maurienne et Tarentaise- Hallstatt - VIIe et VIe siècles: 1: bracelet-tonneau, Montdenis; 2:
fibule à bouclettes, Saint-Jean-de-Belleville; 3: fibule à timbale, Saint-Jean-d'Arves; la Tène: 4: fibule lon-
gue (IIIe siècle), Saint-Jean-de-Belleville; 5: fibule de Nauheim (Ier siècle), Lanslevillard; 6: torque à tam-
pons (IVe siècle), Villarodin; 7: fibule à cabochon (IVe siècle), Villette; 8: bracelet (IIIe siècle), Saint-Jean-
de-Maurienne; Italique: 9 et 10: fibule à côtes Golasecca et chainettes-pendeloque (VIIe/VIe siècle),
Montdenis; 11: fibule a sanguisuga (VIIe siècle), Villarodin; 12: fibule Golasecca (IVe/IIIe siècle), Lansle-
villard; 13: rasoir villanovien (VIIe siècle), Pralognan, Savoie.
112
B- Rochefort-Oisans- Hallstatt - VIIe et VIe siècles: 1 et 3: bracelet de fer et bracelet creux,
Varces; 2: bracelet en lignite, Saint-Paul-de-Varces. Italique: 4: pendeloque est-italique (VIIe siècle), la
Motte-d'Aveillans; 5: fibule a sanguisuga (VIIe siècle), Oisans; 6: chainettes-pendeloque Golasecca
(VIIe/VIe siècle), Ornon, Isère.
C- Queyras et Ubaye- Hallstatt: 6: Bracelet à boule, région de l'Ubaye; la Tène: 9 et 12: fibule
longue et fibule de Munsingen (IIe et IVe siècles), Guillestre et Saint-Paul; Italique: 1: plaque à protome
d'oiseau est-italique (VIIe siècle), région de l'Ubaye; 2: fibule à protubérance est-italique (VIIe/VIe siècle),
Saint-Paul; 3: fibule type Halsau-Regelsbrunn (VIIe siècle), région de l'Ubaye; 4 et 5: agrafes de ceinture
Golasecca (Ve/IVe siècle), Guillestre et Jausiers; 7: pendeloque en panier Golasecca (IVe/IIIe siècle),
Guillestre; 8: fibule Golasecca (Ve siècle), Meyronnes; 10: fibule à cabochon type Tessin (IIIe siècle) et
11: fibule Certosa tessinoise (Ve/IVe siècle), région de l'Ubaye. (échelles diverses). D'après: Bocquet
1991, Willigens 1991 et von Eles 1968.
L'avant-pays
La hallstattisation de la partie Nord de la région semble plus tardive que celle de la partie
Sud, contemporaine de celle du Languedoc à partir du VIIIe siècle. Les premiers éléments pure-
ment hallstattiens sont les épées de bronze à soie plate (Fig. 34, 1) qui révèlent une présence mili-
taire, à la fin du VIIIe siècle, tout le long du couloir rhodanien en direction du Midi, particulière-
ment dans les Baronnies273. Les importations italiques dans l'avant-pays datées de la fin du VIIIe
et du début du VIIe siècle, proviennent d'Italie centrale ou orientale274 et peu de la sphère nord-
alpine275. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, il est difficile de faire la part chronolo-
gique entre ce qui revient à la fin de l'âge du Bronze et celle du début du Premier âge du Fer.
La région de la moyenne Durance et du Buech subit une véritable colonisation par des
communautés hallstattiennes arrivées probablement depuis la vallée du Rhône par le col de Saul-
ce276et qui s'implanteront dans le Midi à l'Ouest du Rhône: en effet le mobilier du tumulus 5 de
Chabestan a une saveur voisine de celui de certains tumulus de Mailhac et du Languedoc277. La
nécropole tumulaire installée à la fin de l'âge du Bronze sur la terrasse du Buëch à Chabestan
prend alors de l'ampleur et d'autres essaiment aux alentours278. La route du Mont-Genèvre est
ainsi contrôlée par une aristocratie hallstattienne riche qui échange avec l'Italie279 en prenant
vraisemblablement la suite de celle qui dominait à la fin de l'âge du Bronze pour les mêmes rai-
273 De type de Gundlingen à Crémieu (Isère), La Laupie, Châteauneuf-de-Bordette, Mirabel-aux-Baronnies, Chateauneuf-de-
Bordette, La Rochette-du-Buis (Drôme). A remarquer l'absence du type de Mindelheim . 274 Hache villanovienne d'Etrembières (Fig. 34, 19), les fibules adriatiques à protubérances d'Habère-Lullin en Faucigny (Fig. 34,
20) et de Lus-la-Croix-Haute entre Buech et Trièves; celles a sanguisuga et serpentiforme d'Italie centrale à Jussy (Haute-Savoie)
(Fig. 34, 22), à Moirans au débouché de la cluse de Voreppe et à Saint-Alban-Leysse près de Chambéry. 275 Céramique Golasecca à Seyssinet près de Grenoble 276 Voie marquée par un tumulus avec cheval à Rosans 277 Cazevieille, Causses de Blandas et de Montardier, etc. avec les urnes à col évasé, le poignard et les rasoirs en bronze 278 Rosans, Aspres-sur-Buech, Aspremont, Chavignières, Fressinières, Serres, Ventavon, Ancelle,la Batie-Vieille, etc. 279 Cruche d'Italie orientale à Chavignières (Fig. 34, 21), bassins à bords perlés de Serres, poignards de Chabestan (Fig. 34, 14), de
Ventavon et de Chavignières
113
sons commerciales. Mais la présence hallstattienne en fond de vallée n'empêche pas des
"indigènes" d'habiter les coteaux ou les vallons environnants et d'acheter les armilles hallstattien-
nes qui abondent dans leurs tombes plates entourées de pierres, suivant la tradition alpine280 que
l'on verra.
Les massifs internes
A l'intérieur des massifs internes du Nord et du Sud il n'y a pas installation de "colonies"
hallstattiennes, seulement une présence rare et épisodique parmi les Alpins dont les activités
agro-pastorales s'intensifient, comme l'indiquent les pollens de céréales dans la tourbière de la
Soie en Maurienne à partir des VIIIe/VIIe siècles.
- La haute vallée de l'Isère est marquée par un seul tumulus aux Allues et l'Arc par un tu-
mulus à incinération à Villarodin-Bourget; là, la présence de galène "votive" dans le mobilier fu-
néraire hallstattien n'est pas fortuite car la tombe se trouve au pied d'une mine de plomb argenti-
fère placée en altitude et pourrait être celle d'un responsable de l'exploitation.
- Au Sud de Grenoble le plateau de la Matheysine, autour de la Mure à 1000m d'altitude,
possédait quelques tumulus avec des pendeloques venues du Picenum, en Italie orientale, datées
du VIIe siècle comme les bracelets hallstattiens en tube de bronze. Ces vastes espaces déboisés et
battus par le vent ne devaient pas rebuter les pasteurs et le contrôle de la voie du col du Lautaret
en formation n'est certainement pas étrangère à leur présence. En effet la fibule a sanguisuga ita-
lique de Bourg-d'Oisans signifie que cette route est déjà ouverte mais celle-ci sera encore mieux
documentée, donc plus fréquentée, durant le siècle suivant.
- Dans la vallée du Guil quelques Hallstattiens ont laissé aussi un seul tumulus à Ristolas
placé significativement au pied du col de la Croix, sur une voie vers l'Italie, mais ni le reste du
Queyras ni l'Ubaye ne possèdent de vestiges ou de mobilier du Hallstatt ancien.
Ces très rares tumulus installés sur les routes principales vers l'Italie datent du début de la
période et ne semblent plus utilisés au VIe siècle. C'est un fait important qui traduit l'évolution
des rapports entre Alpins et Hallstattiens: ceux-ci ne pénètrent plus dans l'intérieur des Alpes une
fois que l'organisation technique et humaine du trafic fonctionne à leur convenance. Par la suite,
seuls des bijoux attestent la persistance des contacts entre gens des plaines et gens de la monta-
gne et s'il y a eu persistance du contrôle par les Hallstattiens, leur présence permanente n'était
plus nécessaire, d'autant que la vie en haute montagne ne devait pas satisfaire leur économie liée
280 A Veynes, Aspres-sur-Buech, la Batie-Montsaléon, Chateauroux, Crots, Lazer, Tallard (Hautes-Alpes), etc
114
aux grands espaces. Dans les Hautes-Alpes, à des altitudes plus faibles sur les larges terrasses
herbeuses des rivières, cela sera bien différent.
Du trafic commercial les Alpins conservent pour leur usage quelques pièces provenant
d'Italie orientale281, centrale282 et aussi de Golasecca283 pour la Maurienne et l'Oisans, ce qui tra-
duit de bons contacts avec les Alpins italiques et pas seulement avec les premiers Etrusques; ce
phénomène est nouveau que celui des échanges à l'intérieur même des communautés installées
sur une bonne partie de l'arc alpin et qui avaient atteint ensembles de hauts niveaux de vie, vrai-
semblablement pour des raisons identiques.
HALLSTATT FINAL ET LA TENE ANCIENNE I env. 550 à 400 av. J.C. (Fig. 34 à 38 et
41)
La puissance étrusque s’accroît en s'implantant dans la plaine du Pô et l'échiquier politi-
que et économique autour des Alpes s'en retrouvera bouleversé. Les premiers "raids" gaulois au
début du Ve siècle dans l'avant-pays ne modifieront en rien la vie dans les zones alpines. Un
changement se constatera seulement au moment de l'invasion gauloise de la plaine du Pô, au dé-
but du IVe siècle.
L'avant-pays
- Dans le massif de Crémieu la colonie hallstattienne qui a pris la suite des "princes" du
Bronze final, est en contact avec les Etrusques284 aux VIe et Ve siècles. La région se prêtait aux
déplacements des troupeaux et de plus le massif constitue une forteresse naturelle placée à l'inter-
section des grands axes est-Ouest et Nord-Sud285. L'oppidum de Larina, Hières-sur-Amby, reçoit
du Midi des amphores massaliotes, de la céramique pseudo-ionienne et de la "grise mono-
chrome". Plus au Sud, dans la plaine de Bièvre-Valloire à la Côte-Saint-André, un grand tumulus
contenait un char cultuel, dont l'origine des roues en bronze a déjà été expliquée, portant bassin
et situle italiques datés du VIIe/VIe siècle (Fig. 34, 18).
- Au VIe siècle, l'avant-pays savoyard connaît une "hallstattisation" dont l'origine se
trouve vraisemblablement sur le Plateau suisse et au pied oriental du Jura. Les bords du lac Lé-
281 La Motte-d'Aveillans (Isère) au sud de Grenoble (Fig. 37-B, 4) et en Ubaye (Fig. 37-C, 1 à 3) 282 Aux VIII-VIIe siècles, rasoir villanovien à Pralognan en Tarentaise, fibule à Bourg-d'Oisans (Fig. 37-B, 5) (Isère) et Guillestre
en Queyras 283 Fibules et chaînettes à Villarodin, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-Montdenis en Maurienne et Ornon en Oisans (Fig.
37-B, 6) 284 Vases en bronze et en céramique 285 Suisse méridionale-couloir rhodanien et voie du couloir rhodanien serpentant au pied des contreforts alpins et jurassiens
115
man et de l'Arve286 possèdent des sépultures (tumulus ?) avec fibules, brassards-tonneau ou paru-
res ventrales; dans le bassin d'Annecy il y a des tumulus et des sépultures non précisées287. Rap-
pelons que dans ces deux régions il y a des ressources en cuivre, mais y a-t-il un lien entre pré-
sence hallstattienne et minerai?
- Ailleurs dans l'avant-pays quelques gisements ont des niveaux datés typologiquement de
cette période avec du matériel indigène, preuve de la continuité de l'occupation; les éléments ty-
piquement hallstattiens y sont encore très rares288. Par contre le Pègue, dans le Sud de la Drôme
et magistralement étudié par C.Lagrand, constitue le site le plus riche en enseignement: la colline
Saint-Marcel est occupée par une population indigène très fortement influencée ou dominée par
les Hallstattiens qui en font une base de commerce avec Marseille dès la deuxième moitié du VIe
siècle. Le Pègue va se faire une spécialité dans la production de céramique "pseudo-ionienne"
dont la décoration s'inspire des motifs géométriques indigènes en usage (Fig. 34, 12, 13 et 17); sa
fonction d'habitat et de centre artisanal sera complétée au Ve siècle par une activité religieuse ou
cultuelle comme en témoignent les nombreuses stèles réemployées plus tard dans des murs gau-
lois.
- Au VIe siècle sur la moyenne Durance, les Hallstattiens abandonnent le commerce di-
rect transalpin avec l'Italie au profit des échanges transitant par le Midi méditerranéen. Sainte-
Colombe, près du Buech, village accroché à la pente, offre l'exemple du mélange des matériels et
des traditions indigènes et hallstattiens comme l'a démontré J.C Courtois; cette communauté
noue des liens tant avec la Franche-Comté et la haute Seine289 qu'avec les comptoirs de Marseille
qui lui fournissent céramiques phocéennes, étrusques et grecques au cours du VIe siècle.
L'avant-pays alpin et la moyenne Durance font partie de la mouvance hallstattienne et par-
ticipent aux échanges à l'intérieur même de ce monde; les paysans autochtones font preuve de
peu d'originalité avec une céramique banale, souvent difficile à reconnaître, et ils se fondent dans
un nouveau type de société. La métallurgie du fer n'y est pas attestée et c'est très récemment que
des fours ont été reconnus dans une vaste agglomération à Lyon-Vaise qui commerçait avec Mar-
seille et où se fabriquaient de petits outils.
-Au Ve siècle les Gaulois, vers 480 av. J.C., détruiront les places fortes290 ainsi que des ri-
ches villages bien intégrés dans le système hallstattien et dans le commerce avec Marseille
286 Chens, Anthy-sur-Léman et la Tour (Fig. 34, 10) 287 Gruffy avec un tumulus de 30m de diamètre (Fig. 34, 6 à 9), Pringy, Quintal, Menthon, Saint-Ferréol 288 Chastel-Arnaud, Sainte-Croix, Francillon en Diois; Choranche et Rencurel (Isère), au coeur du Vercors, etc. 289 Céramique "vixienne" aux décors géométriques à la barbotine, fibule ornithomorphe, etc. (Fig. 34, 11 et 15) 290 Soyons sur la rive droite du Rhône et le Pègue avec des trace d'incendie
116
comme le Pègue et Sainte-Colombe qui seront abandonnés. Dans le Nord de l'avant-pays sa-
voyard, les indigènes subiront aussi les nouvelles influences et la domination gauloise: dans la
région d'Annecy il y a continuité dans l'utilisation des tumulus hallstattiens à Gruffy qui reçoivent
des sépultures de soldats gaulois. Le casque des Avenières, sur le Rhône à côté du massif de
Crémieu, et la tombe de Saint-Laurent-en-Royans291 signalent la présence de soldats dès le Ve
siècle en Nord-Dauphiné et au pied occidental du Vercors; mais rien encore ne permet de suppo-
ser une implantation gauloise autre que celle de garnisons armées.
Les massifs internes (Fig. 35 et 36)
C'est à partir du VIe siècle que s'individualisent nettement les grandes "provinces" alpines:
Maurienne-Tarentaise, Oisans-Rochefort et Queyras-Ubaye; le Champsaur-Briançonnais ne pré-
sente pas une forte identité étant très ouvert sur les Hallstattiens du Gapençais (Fig. 35). L'origine
doit s'en trouver dans les activités liées au trafic intense entre le couloir rhodanien et l'Italie par
les cols alpins et aussi dans l'exploitation des ressources naturelles et agricoles292. Vente et por-
tage des marchandises sur des chemins qu'ils connaissaient bien, ont procuré de bonnes rémuné-
rations: un dynamisme jusqu'alors inconnu prend naissance qui aura un développement excep-
tionnel à l'intérieur des Alpes293.
-En Savoie les Hallstattiens continuent leurs rapports avec les Alpins, de la moitié du VIe
au début du Ve siècle, avec des intensités variables suivant les régions. En effet cette période voit
surtout l'extension et l'apogée de la richesse du groupe de Maurienne-Tarentaise avec la création
d'un artisanat local original, abondant et varié294. Ces productions sont complétées par quelques
bijoux295 issus de la sphère occidentale296 et par l'ambre venu de la Baltique à travers les cols
italo-helvétiques avec le relais de la sphère de Golasecca. Mais plus aucun matériel n'arrive de
l'Italie étrusque.
Ce développement correspondant à celui qui affecte aussi la zone de Golasecca est lié aux
échanges; en Savoie on est en droit d'évoquer les mêmes raisons qu'en Italie pour expliquer une
richesse induite par le trafic transalpin. Mais R.Peroni attribue l'éclat de l'aire de Golasecca au
VIe siècle, au moins autant à la qualité de son peuplement qu'au commerce avec les Etrusques;
l'archéologie des vallées savoyardes ne s'oppose pas à cette opinion car c'est seulement bien après
291 En inhumation plate et épée ployée 292 Exploitation du sel, du cuivre, du plomb et probablement aussi de l'argent 293 Pas seulement dans les Alpes occidentales françaises mais aussi dans les régions alpines plus orientales 294 Bracelets en "roue dentée", crotales ovoïdes, fibules à tablette, etc. (Fig. 34-B) 295 Armilles, fibules, brassards-tonneau (Fig. 37-A, 1 à 3), etc. 296 Bourgogne, Franche-Comté, Suisse ou Champagne
117
la mise à l'écart et l'isolement des hautes vallées alpines qu'apparaîtra leur appauvrissement cultu-
rel et matériel. Soulignons les remarques de F.Gambari qui décèle dans le Piémont occidental, la
persistance des contacts avec "le monde hallstattien alpin et transalpin" plus nets que ceux d'ori-
gine padane297 ce qui montre l'intensité des échanges intra-alpins allant de pair avec une certaine
homogénéité de culture ou de peuplement.
La Maurienne développe un art des gravures rupestres (Fig. 16) connues depuis peu et les
environs d'Aussois, en particulier, sont d'une richesse exceptionnelle avec leurs nombreuses dal-
les gravées. Des scènes de chasse au bouquetin, activité qui devait être habituelle tout comme
celle de "duels" avec des bâtons faisant encore partie du folklore alpin en Suisse. Par contre les
quelques figurations de cavaliers, parfois casqués et porteurs de lance, pourraient représenter des
soldats que les Alpins devaient voir à l'occasion. De rares scènes de chasse à courre (au loup?)
avec des chiens à Sollières-Sardières, qui ne devaient pas être dans les traditions locales, prouve-
raient que les aristocrates hallstattiens sont montés satisfaire leurs goûts cynégétiques au coeur de
la Savoie où leurs équipages ont frappé l'imagination des autochtones. Cet art est à rapprocher298
des styles IV A à D du Val Camonica datés 1000 à 450 av. J.C. Les études en sont encore à leur
début, d'autant que tous les ans apportent des découvertes nouvelles à F.Ballet et à P.Raffaelli.
Sur le Drac et la Romanche, bien que nettement moins riche, le groupe Oisans-Rochefort
suit la même évolution avec des bracelets indigènes à fausse torsade associés parfois à des brace-
lets hallstattiens de fer et de lignite299. Si la région grenobloise ne connaît pas de véritables éta-
blissements hallstattiennes comparables à celles de l'avant-pays les influences sont pourtant bien
nettes. Les Alpins s'implantent dans l'Oisans autour de la route du col du Lautaret vers la haute
Durance qui est jalonnée par des tombes en coffre de pierre de type alpin, au riche mobilier de
bronze et d'ambre300 avec quelques importations de Golasecca.
Sur le Guil et l'Ubaye, dans le Sud, le groupe du Queyras-Ubaye (Fig. 36-D et 37-C), très
isolé dans ses vallées, possède quelques rares bracelets hallstattiens (Ubaye, Vars, Jausiers), au-
cune fibule et peu d'ambre; cette région a encore peu de contact avec la sphère de Golasecca
contrairement à la Savoie ou à l'Oisans. Une production locale originale se manifeste dans de
lourds bracelets à côtes (à Jausiers) et d'innombrables anneaux étroits décorés d'incisions margi-
297 A Belmonte et Cascina Parisio en Val de Suse, à Castel Vecchio di Testona et dans les peintures rupestres de Monpantero 298 Avec des thèmes semblables de chasse avec chevaux et chiens, guerriers casqués à cheval ou à pied, scènes de chasse diverses,
etc. 299 Nécropoles de Varces, Seyssinet, Sassenage, Saint-Michel-les-Portes (Isère) (Fig. 37-B, 1 à 3) 300 Cette route depuis Grenoble passe par Brie-et-Angonne, Séchilienne, la Mure, Ornon, Venosc, le Mont-de-Lans, le Freynet, la
Grave et les Hières en évitant, par deux fois le long du parcours (entre Séchilienne et Rochetaillé et entre Bour-d'Oisans et le
Freynet), les redoutables gorges de la Romanche
118
nales, empilés pour former des brassards, dont la mode et la fabrication persisteront longtemps
(Fig. 36-D, 8). De l'autre coté de la ligne des crêtes et du col de la Croix, à Crissolo dans la haute
vallée du Pô, des tombes en coffre contenaient des fibules italiques, des bracelets alpins et aussi
des bracelets hallstattiens identiques à ceux que possèdent les tumulus de Chabestan; le versant
italien Est bien incorporé à la province alpine. Les importations italiques se restreignent à la fin
du VIe et au début du Ve siècle301 et se limitent à la sphère Golasecca du Tessin (Fig. 37-C, 4 et
5). Les Alpins du Sud commencent à copier avec exubérance les fibules serpentiformes à disque,
dont ils ont eu connaissance depuis l'Italie, pour créer leurs grandes fibules discoïdes qu'ils por-
taient sur la tête302.
Le commerce (Fig. 37)
Durant cette période, les voies transalpines occidentales ne sont plus fréquentées pour des
raisons liées probablement à des changements de stratégie commerciale et à l'obstacle que les
Etrusques constituent dans le plaine du Pô sans oublier les difficultés nées de la péjoration cli-
matique limitant la durée annuelle de possibilité de passage des cols.
L'arrêt des échanges transalpins entre le monde occidental et l'Italie centrale ou padane n'a
pas de conséquences immédiates. Nous avons vu que la prospérité de la "civilisation alpine" n'est
pas liée seulement au trafic "international" à travers les cols; celui-ci a seulement facilité l'expan-
sion alpine au VIIe et au début du VIe siècle à la faveur d'un climat amélioré et probablement
d'un dynamisme humain peu commun. Les ressources locales doivent être encore exploitées et
même échangées de part et d'autre des Alpes dans un trafic d'intérêt régional: bijoux non alpins,
hallstattiens et italiques, sont associés à ceux fabriqués localement dans les tombes où la richesse
est ostensiblement étalée, témoignage d'un niveau de vie toujours élevé.
Si les Etrusques ont commercé avec le Midi dès le milieu du VIIe siècle ce n'est qu'au
cours du VIe siècle que s'installe un courant vers le Nord par la vallée du Rhône et ses abords303:
à partir de 550 av. J.C., c'est Marseille qui monopolise les échanges entre le monde gréco-étrus-
que et l'Occident. Ce courant avec ses produits de luxe qui remonte vers l'Est de la France, la
301 Fibules tessinoises en Ubaye (type la Certosa) et à Meyronnes (Fig. 37-C, 8 et 11) 302 Voir l'exemple d'une tombe de Guillestre publiée par E.Chantre 303 Le Pègue troque avec Marseille ses productions agricoles contre des céramiques grecques ou phocéennes à partir de 540 av.
J.C.. La puissante colonie hallstattienne de la moyenne Durance acquiert au milieu du VIe siècle des vases phocéens, ioniens et
étrusques (à Sainte-Colombe); La Batie-Montsaléon reçoit un lécythe italo-corinthien au début du VIe siècle.
119
Suisse et le haut Danube304 est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'insister. Des pointes de flè-
ches grecques à trois ailerons du VIe siècle en marque la voie305.
Mais au Ve siècle Marseille entrera en crise, à la suite de l'écroulement du système com-
mercial hallstattien sous les coups des premières incursions gauloises; un autre système le rem-
placera près d'un siècle plus tard, quand les Gaulois auront défini d'autres rapports géopolitiques
et économiques avec le monde méditerranéen. La destruction du Pègue vers 480 av. J.C. sera
suivie d'une période obscure et les importations grecques y figureront de nouveau seulement à la
fin du Ve siècle.
LA TENE ANCIENNE II, III ET LA TENE MOYENNE env. 400 à 120 av. J.C. (Fig. 38 à
41)
L'avant-pays
Le Nord de la Haute-Savoie a connu une remarquable implantation gauloise marquée par
les cimetières mis en place tardivement, à la Tène ancienne III306 où les quelques vestiges que
l'on possède de la Tène moyenne307 attestent le plus souvent une présence militaire. Le même
phénomène affecte le massif de Crémieu, en Nord-Dauphiné et au débouché de la cluse de
Grenoble, avec des tombes de guerriers308; ceux-ci ont pénétré jusqu'à la Combe de Savoie309.
Dans plusieurs gisements, outre celui de Hières-sur-Amby, on a reconnu de la céramique gau-
loise, malheureusement ils restent à étudier pour la plupart310 afin mieux comprendre la prise de
possession du territoire et l'évolution du peuplement à partir de la fin du IVe au plus tôt et du IIIe
siècles.
304 Salins, Jura; Mont-Lassois à Chatillon-sur-Seine, Côte-d'Or; Châtillon-sur-Glane, FR, etc. ou la Heuneburg, Bade-Wurtemberg 305 de Châteauroux et Orpierre (Hautes-Alpes), de Siccieu en Nord Dauphiné. La céramique phocéenne a pénétré aussi en Val de
Suse (fouilles A.Bertone, renseignement F.Fedele) 306 Huit cimetières sont goupés sur les trois communes contigües de Douvaine, Nernier et de Chens, près du lac Léman. Bracelets
de Reignier (Fig. 39-A, 4) et de Cruseilles, tombe de soldat à Reignier (Fig. 39-A, 1) (Haute-Savoie) 307 Gaillard, Chens-Vérancy, Rumilly (Haute-Savoie); Traize (Savoie); Rives, Voreppe, Seyssinet (Isère); etc. 308 Tombes de guerriers à Crémieu et Chabons; Rives: incinérations sous tumulus (Fig. 39-B, 4 à 9) avec le rite des épées ployées
comme celle de la Tène ancienne I de Saint-Laurent-en-Royans (Fig. 39-A, 6 et 7); Voreppe: inhumations simples (Fig. 39-B, 1 à
3). On remarquera à Rives un exceptionnel baudrier porte-épée forgé identique à une pièce de Drna en Slovaquie démontrant la
caractère ubiquiste de l'armement 309 A Cruet et probablement à Cléry 310 Seyssinet, Noyarey, Sassenage, la Buisse, Voreppe, Varces, Choranche, Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Etienne-de-Crossey, la
Balme-les-Grottes en Isère; Chaumont, Collonges, Balme-de-Thuy en Haute-Savoie; la Balme, la Biolle, Saint-Alban-Leysse en
Savoie, etc.
120
Cette présence gauloise est-elle en rapport avec la métallurgie du fer? Les preuves direc-
tes, comme des fours, scories, etc., sont très rares311 mais les régions calcaires du Salève et des
monts du Chablais au Nord, du massif de Crémieu et du Royans au pied du Vercors possèdent
abondamment des sédiments sidérolithiques utilisés habituellement par la sidérurgie celtique eu-
ropéenne312. Là encore, comme pour les minerais de cuivre à l'âge du Bronze, on est étonné de la
convergence fréquente entre présence des premiers Gaulois et ressources minérales nécessaires à
la métallurgie.
311 Citons la présence de scories dans des niveaux gaulois du Pègue et les analyses qui ont montré que le fer gaulois, de moins
bonne qualité que le fer hallstattien, a été élaboré sur place à partir des minerais locaux 312 en particulier la limonite des terra rossa dans les sédiments tertiaires
121
Fig. 39. Deuxième âge du Fer (Second Iron Age). env. 450 à 50 av. J.C.
A- la Tène ancienne- 1 et 4: Reignier; 2 et 5: Gruffy, Haute-Savoie; 3 et 7: Saint-Jean-en-Royans,
Isère; 6: Salève, Haute-Savoie.
B- la Tène moyenne- 1 à 3: Voreppe; 4 à 9: Rives, Isère.
C- la Tène finale- 1 à 5: Mépieu, Isère. (échelles diverses). D'après: Bocquet 1991.
Le Sud de l'avant-pays poursuit ses échanges avec Marseille. Au Pègue, les céramiques
grecques sont assez nombreuses au début du IVe siècle mais la deuxième moitié de ce siècle est
la mieux représentée par les apports italiques: pré campanienne et campanienne ont succédé à
l'attique à figures rouges. Campaniennes A et B et amphores massaliotes marquent encore l'im-
portance de l'oppidum de Larina à Hières-sur-Amby; des campaniennes à Sassenage, près de
Grenoble et à Seyssel-Vens sur le haut Rhône jalonnent la route commerciale vers le Nord. Par
contre l'influence phocéenne disparaît de la moyenne Durance, qui semble désertée ou en nette
régression économique, sans qu'on comprenne pourquoi.
122
Figure 40 : les monnaies gauloises
Les massifs internes
Après la conquête de la plaine du Pô vers 390 av. J.C., les Gaulois sont établis de part et
d'autre des Alpes; en Piémont leur empreinte est bien visible au Sud du fleuve Tessin où les con-
tacts avec Golasecca qui se tarissent au IVe siècle, correspondent à une implantation seulement
militaire comme à l'Ouest des Alpes. En Val de Suse, au IIIe siècle, des tombes d'architecture al-
pine contiennent quelques éléments gaulois313 sans que cela signifie forcément une grande activi-
té sur les cols.
313 Chaîne de ceinture de type alpin et fibules gauloises d'origine occidentale dans des tombes féminines à Chiomonte (fouille
F.Fedele) et Villar Dora. Fibules de Oulx et Salbertrand.
124
Fig. 41. Schéma des influences et du commerce au cours de l'âge du Fer.
A- VIIe et VIe siècles:
Grosses flèches noires: courant hallstattien. Cercles: zones à tumulus (1: Annecy; 2:Crémieu;
3:Buech-Durance). Grosse flèches rouges: influences italiques. Les cols transalpins sont largement utili-
sés.
B- Ve et IVe siècles:
Grosses flèches noires: courant gaulois. Grosses flèches vides: courant massaliète et italo-grec.
Flèches vertes: influences de Golasecca. Cercles: 1-Groupe alpin de Maurienne-Tarentaise; 2- Groupe
alpin de Rochefort-Oisans; 3- Groupe alpin du Queyras-Ubaye. Les cols transalpins fonctionnent seule-
ment avec Golasecca.
C- IIIe et IIe siècles:
Grosses flèches noires: courant gaulois. Grosses flèches vides: Courant massaliète et italo-grec.
En vert: influence et objets de Golasecca. Cercles: régions alpines encore florissantes 1- Maurienne-Ta-
rentaise, 2- Queyras-Ubaye. Les cols transalpins sont à nouveau ouverts.
En Savoie l'influence de Golasecca314 dans son faciès tessinois continue. La grande nécro-
pole de Saint-Jean-de-Belleville est encore utilisée à la Tène moyenne mais on n'y discerne pas
314 Avec une fibule de Saint-Jean-de-Maurienne du IVe siècle, qui est la dernière attribuable à l'artisanat local disparu
complétement à la Tène ancienne II
125
de matériel caractéristique de la Tène ancienne II et III. Ici seuls des objets typiquement gaulois
illustrent la Tène ancienne III et la Tène moyenne. Encore est-il possible de faire une distinction
entre la Tène ancienne III315 où les fibules de Münsingen proviennent peut-être d'Italie et la Tène
moyenne que ceinture et bracelets de verre316 rapprochent davantage de l'aire occidentale helvéti-
que. Les objets de la Tène ancienne II sont absents à part un torque à Villarodin et les fibules tes-
sinoises. Les cols ont très naturellement été pratiqués puisque chaque versant possède du mobi-
lier gaulois. L'imprégnation gauloise de la Maurienne et de la Tarentaise fut un peu plus marquée
que l'influence hallstattienne si on se fie à la quantité respective des vestiges. Un changement
majeur intervient dans le peuplement marqué par une nette différence avec les VIe-Ve siècles qui
avaient vu fleurir à profusion les productions locales complétées par quelques importations; à
partir du IIIe siècle la population se réduit car le nombre des cimetières et des tombes diminue,
l'artisanat alpin disparaît et la richesse semble quasiment s'éteindre.
La région de l'Oisans-Rochefort, au Sud, est encore plus mal lotie: la rareté des restes la-
téniens montre sa mise à l'écart qui s'accompagne des mêmes conséquences qu'en Savoie.
La vallée de la Durance, vers le col du Mont-Genèvre, a pu servir au trafic mais il en reste
peu de choses: le torque en argent de Freissinières-Pallon (à côté de l'Argentière et de ses mines
d'argent!), spectaculaire copie indigène des modèles gaulois, quelques perles de la Tène moyenne
dans une tombe aux Orres. Dans cette zone qui fut si riche et prospère jusqu'au Ve siècle, la Tène
ancienne II et III et la Tène moyenne n'y sont pratiquement pas représentées. Absence de fouilles,
abandon du pays, crise économique il faudra bien un jour expliquer cet hiatus.
En Queyras-Ubaye, l'empreinte gauloise assez faible se fait sentir tardivement, pas avant
le IIIe siècle. Si les exubérantes productions locales des vallées du Guil et de l'Ubaye vont être
affectées du même déclin que celles de Savoie, ce sera avec deux siècles de retard, seulement au
cours du IIe siècle: en effet, à la Tène moyenne, quelques éléments gaulois sont encore associés à
de splendides et abondants mobiliers funéraires alpins (Fig. 37-C, 9). Les haut-Alpins font preuve
d'une grande richesse et d'originalité dans leurs productions317 au IVe, IIIe et probablement en-
core au IIe siècle. Quelques-uns de leurs bijoux s'exportent parfois fort loin318. Des bracelets
étroits et incisés et des crotales issus du Queyras se retrouvent aussi dans les Alpes internes
(Tarentaise-Maurienne, Oisans-Rochefort) ce qui indique la fréquentation des cols qui relient
315 Villarodin, Villette, Saint-Bon, Saint-Laurent-la-Côte en Tarentaise (Savoie) (Fig. 37-A, 6 à 8) 316 Jarrier, Saint-Sorlin-d'Arves en Maurienne (Savoie) 317 Bracelets en ruban étroit gravés, fibules discoïdes géantes, crotales piriformes, boutons en violon ou en barette, etc. (Fig. 36-D,
2 à 7) 318 En Piémont (Alessandria), sur la Durance (Sisteron), dans les Alpes-Maritimes (Saint-Vallier-de-Thieys), dans l'avant-pays
(Nyons) et jusqu'à Bourges (grandes fibules discoïdes dans des sépultures)
126
entre elles les grandes vallées transalpines du versant occidental. Comme en Savoie, un courant
vient de l'Italie nord-alpine à la Tène ancienne III319. Il est plus difficile de préciser de quel ver-
sant des Alpes sont arrivés les bracelets serpentiformes, les fibules "schéma la Tène II" de
Guillestre ainsi que la mode des ceintures de la Tène ancienne III et moyenne dont les Alpins
imaginent des copies exubérantes et complexes320.
La conquête de la plaine padane par les Romains, vers 220 av. J.C., et le reflux possible
de quelques tribus celtes vers la Gaule transalpine ne se traduit par aucune trace archéologique,
pas plus d'ailleurs que les passages de Bellovèse, vers 390, et d'Hannibal, en 218.
Le passage d'Hannibal
L'itinéraire suivi par l'armée d'Hannibal et ses trente éléphants pour traverser les Alpes a
fait couler beaucoup d'encre et soulevé bien des hypothèses: cols du Mont-Genèvre, du Mont-Ce-
nis, du Clapier, du Petit-Saint-Bernard, etc.? Les textes de Tite-Live et de Polybe se contredisent
souvent mais à notre sens celui de ce dernier serait plus fiable et plus cohérent; il a été écrit
moins de cent ans après les évènements et l'auteur est venu lui-même faire le trajet... L'avantage
d'arriver en Italie chez des "amis" et non dans des populations hostiles sont des considérations
politiques formulées par Polybe qui, jointes à quelques indications topographiques et les distan-
ces notées entre les étapes concordant avec la réalité du terrain, me font préférer le tracé par la
basse Savoie, Chambéry, la vallée de l'Isère et le col du Petit-Saint-Bernard vers le Val d'Aoste.
Les Alpins auraient, dans ce cas, fortement résisté dans les défilés en aval d'Aime en profitant de
la configuration du relief.
L'évolution de la civilisation alpine
La richesse de la civilisation alpine, dont j'ai expliqué les différences suivant les régions,
s'éteint archéologiquement à la fin de la Tène moyenne après la soumission des Allobroges par
Rome. Quelles peuvent être les causes historiques ou économiques du déclin des provinces des
Alpes internes, déclin qui ne s'est pas manifesté en même temps partout: Ve siècle sur la Du-
rance, IVe siècle au Nord en Savoie/Oisans, IIIe-IIe siècle en Queyras/Ubaye.
- Le Briançonnais et la voie du Mont-Genèvre étaient dominés dès le VIIIe siècle par la
présence des Hallstattiens largement implantés dans le Gapençais. Là peu de productions locales
originales, richesse limitée des tombes: les Hallstattiens sont maîtres de la région, de son organi-
319 Fibule de Münsingen de Saint-Paul-sur-Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence (Fig. 37-C, 12); fibule tessinoise à cabochon de
l'Ubaye (Fig. 37-C, 10) 320 Jausiers, Guillestre, Orcières-Busansayes en Champsaur, etc.
127
sation et de ses activités. Le trafic s'interrompt au Ve siècle et c'est immédiatement la chute bru-
tale vers une certaine pauvreté et la survie probable des populations dont pratiquement rien ne
nous est parvenu.
- Les Alpins de Savoie avaient organisé eux-mêmes le trafic transalpin sous l'égide et au
bénéfice des Hallstattiens au VIIe siècle dans un contexte climatique favorisant les productions
locales tant pour la subsistance que pour l'exportation. La mise en exploitation des mines de cui-
vre, d'argent ou de sel n'était pas étrangère au développement. Commerce "international" et ac-
tivités régionales sont à la source de l'expansion du peuplement et des richesses étalées dans les
tombes. La cause première du déclin est, bien sûr, la perte du commerce transalpin mais la
persistance des activités qu'il avait induites a permis une "survie dorée" en Savoie pendant plu-
sieurs générations. L'absence de revenus externes et de débouchés à leurs ressources amène
pourtant la régression au IVe siècle.
- La province de l'Oisans-Rochefort a eu une moindre importance à partir du VIIe siècle
sur la route du col du Lautaret entre le bassin de l'Isère et celui de la Durance. Son éclat ne fut
pas très marqué et son sort est lié à celui de la haute Durance et au col du Mont-Genèvre. Par
contre elle reçut longtemps du matériel de parure en provenance du Queyras.
- Le Queyras et l'Ubaye n'ont pas été traversés par un intense courant commercial entre
les deux versants; les cols n'ont eu qu'un intérêt local. La richesse et l'extension progressive du
peuplement, par de multiples communautés occupant tous les espaces habitables à partir des
VIIe/VIe siècles, sont dus plus à une dynamique régionale qu'à des facteurs extérieurs. C'est ce
qui explique la persistance tardive d'un haut niveau de vie dans un contexte général peu favora-
ble, entre les IVe et IIIe/IIe siècles.
LA TENE FINALE env. 120 à 50 av. J.C. (Fig. 38 à 41)
Les historiens de l'Antiquité nous renseignent sur la défaite des Allobroges en 121 av. J.C.
dans la vallée du Rhône et sur leurs révoltes successives. L'archéologue est toujours étonné d'ap-
prendre que les armées comportaient plusieurs dizaines de milliers de combattants, ce qui sous-
tend une population dense alors que les vestiges sont rares et clairsemés, très sûrement par ab-
sence de recherches321.
Le massif de Crémieu en Nord-Dauphiné continue d'être une région d'un grand intérêt
près des gués sur le Rhône. Il fut occupé par des communautés et des troupes: le tumulus à char
321 Les décapages effectués lors des travaux autoroutiers livrent actuellement de nombreux restes de la Tène tardive
128
de Vernas montre un personnage de haut rang accompagné de riches accessoires et armes en fer
dont la technique est parfaitement maîtrisée; cette tombe est proche de l'oppidum de Larina à
Hières-sur-Amby où abondent les céramiques peintes ou gravées et lieu d'un gros dépôt votif
d'ustensiles domestiques usuels. La présence d'oxydes de fer dans les calcaires du massif322 peut
conforter l'attrait que les Gaulois ont eu pour cette région en facilitant une sidérurgie locale. Les
tombes de guerriers dans les environs323 confirme cet intérêt stratégique et économique du Nord
Dauphiné dont les vestiges sont comparables en qualité et en chronologie à ceux de l'importante
cité gauloise de Vienne sur le Rhône.
Toujours dans le domaine défensif, les oppidums sont mieux connus au Nord de la Haute-
Savoie par les travaux de P.Broise324. Il est possible que la frontière entre Allobroges et Helvètes,
tribus belliqueuses, soit la cause de leur nombre; de toute façon ce territoire a dû être très celtisé
quand on considère la quantité de toponymes et d'hydronymes en "nant" (ruisseau, torrent en gau-
lois) qui sont conservés aujourd'hui. Quelques autres parsèment le reste des Alpes du Nord325.
La comparaison avec d'autres régions laisse supposer des activités agricoles et commer-
ciales avec création de grandes exploitations et de bourgades près des gués, des ponts, en des
points-clés de contrôle des communications326. La littérature gréco-latine fait état de la haute
qualité et de l'abondance des armes en fer allobroges dès le IIIe siècle, ce qui a permis de réarmer
des troupes après leur écrasement faisant suite aux soulèvements successifs de ce peuple belli-
queux. Nous attendons que les recherches viennent confirmer les textes en livrant les ateliers ou
les forges...
A peine illustré dans l'avant-pays, le Ier siècle offre peu de chose dans les massifs alpins:
des tombes à Lanslevillard et une fibule à Sollières au pied des cols de la zone du Mont-Cenis; en
Oisans un bracelet à Mont-de-Lans et une bague à La Motte-les-Bains. Villar d'Arêne en Oisans,
Barcelonnette et Méolans en Ubaye, Exilles dans le haut Val de Suse portent des noms gaulois
indiquant une organisation ou un contrôle du territoire par l'implantation de villages ou la celtisa-
tion de ceux qui existaient.
322 Encore en exploitation au siècle dernier... 323 A Creys-Mépieu (Fig. 39-C), Optevoz, Saint-Jean-de-Soudain, Genas et Bourgoin 324 Genève en rive gauche du Rhône, Champanges, Allonzier, Chevrier, Collonges, Dingy-Vuache, Dingy-Saint-Clair, Monnetier-
Mornex, Passy, etc. 325 Saint-Alban-Leysse près de Chambéry; en bas Dauphiné à Plan, Poliénas (Mont-Verdun) et Moirans au débouché de la cluse
de l'Isère; Varces au sud de Grenoble; au Pègue, Nyons et Vercoiran dans le sud de la Drôme; dans les Hautes-Alpes à Embrun et
Briançon sur la Durance, etc 326 On connaît, par quelques vestiges ou par la toponymie, les bourgs de Seyssel sur le Rhône, d'Yvoire sur le lac Léman, Annecy-
les-Fins (Boutae), Aix-les-Bains, Chindrieux entre Rhône et lac du Bourget, Conflans à la sortie de la Tarentaise, Barraux ("Bar" la
forteresse) en haut Grésivaudan, Grenoble, Le Plan, Varces et Voiron en Isère, Chorges et la Batie-Neuve près de Gap, la Bâtie-
Montsaléon et Chabestan près du Buech, etc...
129
Les voies, tracées ou esquissées au cours des millénaires antérieurs ont dû se fixer et
s'améliorer. Un exemple est donné avec la route préromaine qui permettait d'éviter le fond de la
vallée entre Saint-Quentin-sur-Isère et Grenoble, au pied des falaises du Vercors en rive gauche
de l'Isère: elle fut appareillée en très gros blocs et pourvue de solides murs de soutènement.
Il est probable que les mines d'argent, déjà mises en exploitation au premier âge du Fer en
Savoie interne327, ont contribué à la richesse des Allobroges, permettant la fabrication de leur
monnayage spécifique; la carte de répartition de ces monnaies (Fig. 40) démontre que les Alpins
des massifs centraux n'en possédaient pas; soit ils n'étaient pas suffisamment celtisés soit leurs
echanges n'étaient pas encore fondés sur la monnaie. Même s'ils fournissaient le métal précieux,
ils devaient être rémunérés de leur travail d'extraction par d'autres marchandises plus tradition-
nelles. Par contre de nombreux points de découverte de monnaies entre la vallée du Rhône et le
col du Mont-Genèvre jalonnent la voie vers l'Italie; cette route était donc ouverte au trafic trans-
alpin et peut-être était-elle la seule à la fin de l'époque gauloise si, comme au Moyen-Age, la
monnaie ne diffusait guère hors des grandes voies d'échanges.
Les Gaulois et les Alpins
La celtisation des Alpes du Nord a eu le même but et sensiblement a suivi les mêmes pro-
cessus que la "Hallstattisation", c'est à dire la prise de contrôle d'un territoire: installation de pla-
ces fortes aux points stratégiques et commerciaux dans l'avant-pays, troc avec les habitants des
massifs internes. Cette occupation fut marquée dès la fin du Ve siècle par des garnisons et elle
s'est affermie jusqu'à la fin du IIe siècle sans être une véritable colonisation de peuplement mais
seulement une emprise à dominante militaire, probablement destinée à protéger leur organisation
administrative et/ou commerciale du pays.
La domination gauloise qui s'est manifestée par des changements techniques avec la diffu-
sion et la banalisation du fer pour l'outillage domestique et agricole, n'intervint qu'au cours du IIe
et Ier siècles av. J.C.328. L'évolution des structures économiques, sociales et agraires, la mise en
place d'un urbanisme sont liées généralement à la colonisation plus tardive que dans d'autres ré-
gions, l'Est de la France et Suisse occidentale en particulier. Nous avons vu que la métallurgie
avait pu se développer autour des oxydes de fer abondants dans tout l'avant-pays. Des prospec-
tions et des études sur tous ces points sont nécessaires pour illustrer et mieux comprendre cette
époque qui, paradoxalement, est bien mal connue pour être si proche de nous.
327 Bagues en argent dans le mobilier de quelques tombes et galène argentifère dans le tumulus de Villarodin 328 On connait celui du massif de Crémieu; il y en eut probablement dans d'autres: régions d'Annecy, de Genève, Gapençais, etc.
130
Polybe note que les populations alpines sont différentes de celles des vallées du Rhône et
du Pô et pour Strabon il est clair que "la Gaule cisalpine est habitée par des nations ligures et des
nations celtiques; celles-là demeurant dans les montagnes, celles-ci dans les plaines"; on peut
admettre qu'il en était de même pour le versant français des Alpes. Tite-Live précise que les Al-
pes occidentales n'étaient pas peuplées de Gaulois mais d'autochtones, que les contacts entre Al-
pins et Celtes étaient fréquents car "les Gaulois sont fort peu éloignés par leur langue et par leurs
moeurs de ces montagnards". Les données archéologiques alpines dont j'ai souligné l'originalité
des productions métalliques, les rites funéraires spécifiques et d'autres particularités s'accordent
ainsi avec les textes historiques sur la dualité des populations occupant soit l'avant-pays soit les
montagnes.
L'histoire connaît le nom des tribus gauloises: les Allobroges au Nord de l'Isère, les Vo-
conces au Sud, les Avantici et les Caturiges sur la Durance, les Taurini en Piémont. Nous savons
aussi celui des peuplades alpines proprement dites329 d'après les inscriptions de l'arc de Suse en
Piémont et du trophée de la Turbie près de Nice; ces Alpins de l'intérieur n'étaient pas d'origine
gauloise mais, nous l’avons vu, seulement plus ou moins celtisés suivant les régions.
Entre 16 et 14 av. J.C. Auguste a eu beaucoup de difficultés à vaincre ces peuples alpins
qui continuaient à contrôler les vallées et les cols après la conquête de la Gaule, gênant les
échanges que Rome désirait voir s'amplifier de part et d'autre des Alpes. L'archéologue ne trouve
pas la trace matérielle de leur puissance qui arrêta si longtemps les légions romaines; cette résis-
tance est imputée à la facilité de défendre des zones accidentées avec peu de moyens, par des
hommes déterminés, comme les évènements nous l'ont encore montré en 1944 dans le Vercors,
en Oisans ou dans le massif des Glières.
Remerciements
Je remercie vivement mes collègues F.Ballet, P.Benamour, A.Bertone, P.Bintz, B.Caillat,
A.Cura, J.C. Daumas, J.Debelmas, C.Dormoy, A.Gattiglia, T.Gouin, L.Haussmann, R.Laudet,
A.Marguet, C.Orcel, D.Ramseyer, B.Reffienna, M.Rossi, J.Vital et tout particulièrement J.P.
Millotte et F.Fedele, pour leurs renseignements et leurs conseils.
329 Ceutrones en Tarentaise, Medulli en Maurienne, Iconii ou Ucenni en Oisans, Quariates en Queyras, Savincates en Ubaye.
131
Bibliographie sommaire 330
ANNA (d') A. (1991): Le Néolithique dans les Hautes-Alpes. Archéologie dans les Hautes-Alpes.
Musée Départemental de Gap. p. 71-75, 2 fig..
ANNA (d') A. (1991): Les stations de plein air néolithiques dans les Hautes-Alpes. Archéologie
dans les Hautes-Alpes. Musée Dép. Gap. p. 77-79, 3 fig.
ARCA A. (1990): Pietre incise e arte rupestre: un interesse rinnovato. Nuove ricerche e prospettive
in Basse Valle di Susa e Alta Moriana. Segusium. 27e année, n°28. p. 163-196, 12 fig. et ph.
ARGANT J. (1988): Analyses palynologiques de gisements quaternaires du bassin du Rhône.
Thèse. Doctorat ès Sciences, Univ. Cl. Bernard. Lyon I. Dép. Sc. Terre. 219 p., 26 fig., 12 ph., 12 tab.,
diag.;
AUDOUZE F. et COURTOIS J.C. (1970): Les épingles du Sud-Est de la France. Prähistorische
Bronzefunde. Abteilung XIII, Band 1. 105p., 30 Planches.
AYROLES P. et PORTE J.L. (1972): Nouvel abri à peintures de l'Age des Métaux. Le Trou de la
Féclaz (Savoie). Etudes Préhistoriques. n°3. p. 12-19, ph., croquis.
BAGOLINI B. (1993): Il Neolitico nell'Italia settentrionale. p. 274-305. Italia preistorica. Ed.
Laterza
BALLET F. (1976): La Balme (Savoie). Grotte de la Grande-Gave. Etude de la céramique pré et
protohistorique. Mémoire de Maîtrise, Université Grenoble II, 137 p.
BALLET F. et KEROUANTON I. (1994): La céramique du lac du Bourget. Ateliers de potiers de
la fin de l'âge du Bronze final (1000-800 av. J.C.). Coll. Musée Savoisien, Chambéry. "Terres de Rhône-
Alpes". Ed. Comp'Act, Seyssel-sur-Rhône. 85 p., fig., ph..
BALLET F. et RAFFAELLI P. (1990): Rupestres. Roches en Savoie, gravures, peintures, cupules.
Musée Savoisien. Chambéry. 147 p., fig., ph..
BALLET F. et RAFFAELLI P. (1993): L'art rupestre de Maurienne. Mémoire et Dococuments de
la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie. t. 95. p. 63-78, 18 fig..
BALLET F. et RAFFAELLI P. (1993): Les gravures rupestres anthropomorphes de Savoie:
évolution de la représentation humaine du Néolithique à l'âge du Fer. Congrès National des Sociétés
Savantes. C.r. 115e Session, Avignon, (1990): p. 181-196, 13 pl..
BAROCELLI P. (1956): La Valle d'Aosta. Parallelismi culturali tra Valle d'Aosta ed il Vallese
nella Preistoria. XXXIe Congresso. Storico Subalpino. Aosta. 9-11 sept. 1956. vol. 1. p. 4-28.
BARRUOL G. (1969): Les peuples préromains du Sud-Est de la Gaule. Revue archéologique de
la Narbonaise, suppl. N°1. 408 p. 8 pl.
BATAILLE A. (1964): Une nouvelle découverte dans les Hautes-Alpes: Casse-Rousse. Cachette
de fondeur (fin de l'âge du Bronze). Rhodania. fasc. 2. p. 4-21, fig.
BEAULIEU (de) J.L. (1977): Contribution pollenanalytique à l'histoire tardi-glaciaire et
holocène de la végétation des Alpes méridionales françaises. Thèse Doctorat ès Sciences. Univ. Aix-
Marseille II 358 p., 29 fig., 39 diagr. h.t.
BEECHING A. (1976): La question du Cortaillod et des stades culturels qui l'ont précédé. Etudes
Préhistoriques. n°13. p. 15-18, 2 fig..
BEECHING A. (1986): Le Néolithique rhodanien. Acquis récents et perspectives de la recherche.
Le Néolithique de la France. Hommage à G. Bailloud. Ed. Picard, Paris. p. 259-276.
BEECHING A. et BROCHIER J.L (1995): Drôme du Sud. Entretien de Géo-archéologie. Service
régional de l'archéologie de Lyon. (à paraître)
BENAMOUR P. (1979): La grotte des Balmes de Sollières-Sardières (Savoie) dans son contexte
alpin. D.E.A. Univ. Franche-Comté. Fac. Lettres et Sciences Humaines. 13 p. (texte) et 29 p. (pl.).
330 La bibliographie concernant les Alpes du Nord comporte 2650 titres d'ouvrages ou d'articles; nous ne pouvons donner ici que
les plus récents et les plus importants.
132
BENAMOUR P. (1993): Depuis 3 000 ans avant notre ère... Les Balmes à Sollières-Sardières, site
d'altitude et passage obligé. La Savoie avant l'histoire. Mémoire et Documents de la Société Savoisienne
d'Histoire et d'Archéologie. t. 95. p. 37-46, 5 fig..
BERTONE A. et alii (1986): Archeologia preistorica dell'Alta Valle di Susa, Chiomonte-La
Maddalena. Segusium. vol. 22. p. 3-36, 9 fig..
BERTONE A. (1990): Proposta di definizione di una facies calcolitica ad abito tradizionale sulle
Alpi occidentali. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial. Actes Ve Coll. Alpes Antiquité, 11-13
sept. (1987):, Aosta. p. 143-152, 4 fig..
BERTONE A. (1991): Tra Mediterraneo ed Europa. I grandi avvenementi culturali della Preistoria
e le loro tracce nella Valle di Susa. Quaderni di dialogi. Civ. Mus. Archeo. Chiomonte. 51 p., 45 fig..
BERTONE A. et FEDELE F. (1991): Découvertes récentes dans la vallée de Susa et le problème
des relations avec le Chasséen. Identité du Chasséen. Actes Coll. Intern. Nemours, 17-19 mai 1989. Mém.
Mus. Préh. Ile-de-France. n°4. p. 69-79, 8 fig., 1 tab..
BERTONE A. et FOZZATI L. (1990): Età del Bronzo medio-finale sulle Alpi occidentali
considerazioni di cronologia. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial. Actes Ve Coll. Alpes
Antiquité, 11-13 sept. (1987):, Aoste. p. 179-186, 5 fig..
BILL J. (1973): Die Glockenbecherkultur und die frühe Bronzezeit im französischen Rhonebecken
und ihre Beziehungen zur Südwestschweiz. Société Suisse de Préhistoire. 111 p., pl.., cartes
BILLAUD Y. et MARGUET A. (1992): Le site Bronze final de Tougues à Chens-sur-Léman
(Haute-Savoie): stratigraphie, datations absolues et typologie. Congrès National des Sociétés Savantes.
C.r. 116e Session, Chambéry, 24 avr.-4 mai 1991. p. 311-347, 25 fig..
BILLAUD Y., MARGUET A. et SIMONIN O. (1992): Chindrieux, Châtillon (lac du Bourget,
Savoie): ultime occupation des lacs alpins français à l'âge du Bronze? Congrès National des Sociétés
Savantes. C.r. 116e Session, Chambéry, 24 avr.-4 mai 1991. p. 277-310, 22 fig..
BINTZ P. et GRUNWALD C. (1990): Mésolithique et néolithisation en Chartreuse et en Vercors
(Alpes du Nord): évolution culturelle et économie du silex. Contribution to the Mesolithic Europe. Leuven
Univ. Press. p. 203-207.
BINTZ P. et PICAVET R. (1994): Le Mésolithique et la néolithisation en Vercors: évolutions
culturelles et approche territoriale. Mésolithique entre Rhin et Méditerranée. Table Ronde Chambéry, 26-
27 sept. 1992. A.D.R.A.S. p. 59-74, 11 fig..
BINTZ P., BOCQUET A., BOREL J.L. et OLIVE P. (1989): Tableau diachronique de l'Holocène
et du Tardiglaciaire dans les Alpes du Nord et leur piémont. Préhistoire et paléoenvironnement. Bull.
Société Préhistorique Française t. 86, n°2. p. 51-60, 1 tab..
BINTZ P., EVIN J. et PION G. (1990): Les datations radiocarbones du Bassin rhodanien de la fin
du Paléolithique supérieur au Néolithique ancien. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial. Actes Ve
Coll. Alpes Antiquité, 11-13 sept. (1987):, Aosta. p. 39-52, 9 fig..
BINTZ P., GINESTET J.P. et PION G. (1991): Mésolithique et néolithisation dans les Alpes
françaises du Nord. Données stratigraphiques et culturelles. Congrès National des Sociétés Savantes. C.R.
113e Session, Strasbourg, 5-9 avr. 1988. Mésolithique et néolithisation en France et dans les pays
limitrophes. p. 245-267, 6 fig..
BINTZ P., PICAVET R. et EVIN J. (1992): Evolutions chronoculturelles du Mésolithique au
Néolithique moyen en Vercors et dans les Alpes du Nord. in: XIe Renc. sur le Néolithique en Rhône-Alpes.
Coll. Ambérieu-en-Bugey, 19-20 sept. 1992. 31 p., 10 fig.
BLANC A. et COQUILLAT M. (1956): Le Trou Arnaud à Saint-Nazaire-le-Désert (Drôme).
Cahiers Rhodaniens. n°3. p. 22-32, 8 fig.
BOCKSBERGER O.J. (1964): Age du Bronze en Valais et dans le Chablais vaudois. Imp.
Centrale, Lausanne. 116 p., 8 pl., cartes.
BOCQUET A. (1969): L'Isère pré et protohistorique. Gallia-Préhistoire. t. XII. fasc. 1, p. 121 à
258 et fasc. 2, p. 273 à 400.
133
BOCQUET A. (1969-70): Collections pré et protohistoriques du Musée dauphinois. Catalogue du
Musée dauphinois. 2 vol. Texte et planches. Ed. Allier Grenoble
BOCQUET A. (1974): Note sur des poignards à manche massif de Savoie. Bull. Etudes Pré-
historiques Alpines. t.6. p. 47-52, 1 fig.
BOCQUET A. (1976): Les civilisations de l'âge du Bronze dans les Alpes. La Préhistoire
Française. t. II. IXe Congr. UISPP Nice. p. 483-494, 6 fig..
BOCQUET A. (1981): Les rapports entre les Alpes du Nord et l'Italie au Bronze final. Bull.
Société Préhistorique Française t. 78, n°5. p. 144-153, 11 fig..
BOCQUET A. (1983): La Préhistoire et le peuplement de la Savoie. in La Savoie des origines à
l'an mil. p. 53-122, 1 tab., 33 cartes, fig.. Editions Ouest-France
BOCQUET A. (1984): Quelques éléments sur les rapports entre les Alpes françaises du Nord et
l'Italie du Néolithique à l'âge du Fer. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. t. 16. p. 49- 62, 8 fig..
BOCQUET A. (1986): La céramique à décor excisé de la Balme (Savoie) et le début du Bronze
final alpin. Etudes Préhistoriques. n°17. p. 27-30, 4 fig.
BOCQUET A. (1989): Cohérence entre les dates dendrochronologiques alpines au Bronze final et
la chronologie typologique italique. Bull. Société Préhistorique Française. t. 86, n°10-12. p. 334- 339, 3
fig.
BOCQUET A. (1991): L'archéologie de l'âge du Fer dans les Alpes occidentales françaises. Les
Alpes à l'âge du Fer. Xe Coll. A.F.E.A.F., Yenne-Chambéry, 1986. Revue Archéo. Narbonnaise, suppl.
n°22. p. 91-155, 28 fig., 4 tab., annexes.
BOCQUET A. (1994): Charavines, il y a 5.000 ans. La vie quotidienne dans un village
néolithique au bord d'un lac des Alpes. Dossiers d'Archéologie. n°199 et éd. Faton, Dijon. 104 p., 110
dessins., 150 ph..
BOCQUET A. et BALLET F. (1987): Nouveaux témoins de la civilisation campaniforme dans les
Alpes françaises du Nord. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n°19. p. 9-22 5 fig.
BOCQUET A. et LAGRAND C. sous la direction de (1976): Néolithique et âge des métaux dans
les Alpes françaises. Livret-guide de l'excursion A9. IXe Congr. UISPP Nice. 205 p. et fig.
BONNAMOUR L. et DESBROSSE R. (1966): L'abri Gay à Poncin (Ain): fouilles 1965. Bull.
Soc. Linnéenne Lyon. 35e année, n°7. p. 319- 328, 5 fig..
BOREL J.L. (1976): La végétation pendant le Postglaciaire dans le Jura et les Alpes du Nord. La
Préhistoire Française. t. II. Les Civilisations néolithiques et protohistoriques de la France. IXe Congr.
UISPP Nice. p. 67-73, 2 fig..
BROCHIER J.L. et BEECHING A. (1988): Une nouvelle stratigraphie pour la protohistoire et
l'histoire des Alpes du Sud: la Tune de la Varaime à Boulc-en-Dios (Drôme). Rencontres néolithiques
Rhône-Alpes. Centre archéologique de la Drôme. N°4.
CARDARELLI A. (1993): Le età dei metalli nell'Italia settentrionale. in: Italia preistorica p. 368-
419. Ed Laterza.
CATALOGUE (1991): Vassieux: il y a 4.000 ans les premiers manufacturiers des Alpes. Musée
Site Préh. Vassieux-en-Vercors. 80 p., fig..
CHAIX L. (1976): La faune néolithique du Valais (Suisse). Ses caractères et ses relations avec les
faunes néolithiques des régions proches. Documents du Département d'Anthropologie de Genève. n°3. 380
p., fig., tab., 6 pl..
CHAIX L. (1976): 77 Les premiers élevages préhistoriques dans les Alpes occidentales. Bull.
Etudes Préhistoriques Alpines. t. 8-9. p. 67-76, 3 tab., 2 fig..
CHEMIN R. et BOCQUET A. (1978): Chronologie du Bronze final. Les premiers mineurs de
Maurienne. Archéologia. n°121. p. 46-49.
CIMA M. (1990): La Valle Orco nella preistoria del mondo alpino. Bull. Etudes Préhistoriques
Alpines. n° spécial. Actes Ve Coll. Alpes Antiquité, 11-13 sept. (1987):, Aoste. p. 317-350, 9 fig., 7 pl..
134
CLERC J. (1988): Recherches pollenanalytiques sur la paléoécologie tardiglaciaire et holocène
du Bas-Dauphiné. Thèse Docteur d'Etat, mention Sciences, Aix-Marseille. 179 p., 50 fig., 12 tab., 4
graph.., pl. h.t.
COLLECTIF (1991): L'archéologie dans les Hautes-Alpes. Musée de Gap. 349 P; et Fig.
COMBIER Jacqueline (1972): Bronze en Savoie, en dehors des stations palafittiques. Centre de
Documentation. Région Tarentaise. Académie de la Val d'Isère. Amis du Vieux Conflans. vol. 1. 82 p., pl
et fig.
COMBIER Jacqueline (1973): La Tarentaise avant les Romains (Pré et Protohistoire). 54 p.,
index, 38 fig., 3 cartes. Académie de la Val d'Isère
CONINCK (de) F. avec coll. MARCHANDISE B. et MARCHANDISE G. (1992): La traversée
des Alpes par Hannibal (selon les écrits de Polybe). Coll. "Les Grands Itinéraires de l'Histoire". vol. 1. Ed.
Ediculture, Montélimar. 128 p., fig., cartes, tab..
COURTOIS J.C. (1957): Objets de l'âge du Bronze trouvés dans le département des Hautes-Alpes.
Gallia t. 15 fasc. 3. p. 63-78.
COURTOIS J.C. (1960): L'âge du Bronze dans les Hautes-Alpes. Gallia-Préhistoire. t. 3. p. 47-
108, 54 fig.
COURTOIS J.C. (1961): Essai sur la Protohistoire des Alpes du Dauphiné. Revue Archéologique
de l'Est et du Centre-Est. t. 12, fasc. 4. p. 287-303, 13 fig., 1 pl.
COURTOIS J.C. (1968): Découvertes archéologiques de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer dans
les Hautes-Alpes (1955-1967). Extraits du Bull. Société d'Etudes des Hautes-Alpes. 144 p., 86 fig., 3
dépliants
COURTOIS J.C. (1975): Les habitats protohistoriques de Sainte-Colombe, près d'Orpierre
(Hautes-Alpes) dans le cadre des civilisations du premier âge du Fer des Alpes. Cahier C.D.P.A. n°3. in-
4°. 80 p., 55 fig.
DARTEVELLE H., LAMBERT G.N., MILLOTTE J.P. (1993): De la difficulté d'interpréter les
documents archéologiques: le passage de l'âge du Bronze à l'âge du Fer et les épées des "peuples cavaliers".
Mélanges Lévêque p.57-100. A.R.U.B.,463. Besançon.
DAUMAS J.C. et LAUDET R. (1981): L'habitat du Bronze final des Gandus à Saint- Ferréol-
Trente-Pas (Drôme). Etudes Préhistoriques. n°16. p. 1-32, 34 fig..
DAUMAS J.C. et LAUDET R. (1990): Archéologie de l'Oule à la Roanne (Drôme). Cahiers de
l'Oule, 39 p.
DAUMAS J.C. et LAUDET R. (1996): La préhistoire des Baronnies. Archéologie en Baronnies.
Les rencontres du Garde-notes baronniard N°2. Lachau, 22 oct. 1995 p. 13-35, 7 fig, 14 Pl.
DAUMAS J.C. et LAUDET R. (1996): Préhistoire et protohistoire du Diois. Revue Drômoise,
n°480, juin p. 64-74, 2 fig..
DORO A. (1969): Origine des trafics à travers les Alpes jusqu'à l'époque protohistorique. Actes du
colloque sur les cols des Alpes. Bourg-en-Bresse, 1969. p. 34-38.
DORO A. (1973-75): Un ripostiglio di Bronzi a Pinerolo. Considerazioni paletnologiche. Sibrium.
vol. 12. p. 205-222, 6 fig.
DREYFUS M.C. (1958): Etude du matériel du Néolithique, du Chalcolithique et de l'âge du
Bronze des Basses et Hautes-Alpes. Bull. Musée d'Anthropologie Préhistorique Monaco. n°5. p. 165-188.
ELES (von) P. (1967-68): L'Età del Ferro nelle Alpi occidentali francesi. Cahiers Rhodaniens.
n°14. 222 p., 63 fig., 20 pl..
FEDELE F. (1976): Stadi di popolamento nelle Alpi occidentali dal Neolitico all'Età del Ferro.
Atti VII. Ce. S.D.I.R., (1975):-76. p. 227-267, 5 fig.
FEDELE F. (1991): Le Alpi occidentali: biogeografia del popolamento umano preistorico.
Biogeographia. vol. 16. p. 451-477, 16 fig..
GALLAY A. (1976): Origine et expansion de la civilisation du Rhône. Les Ages des métaux dans
les Alpes. IXe Congr. UISPP, Grenoble, 10-11 sept. 1976. Colloque XXVI. p. 5-26, 7 fig., 2 tab..
135
GALLAY A. (1986): Le Néolithique et l'âge du Bronze ancien du Valais in: Chronologie,
Datations Archéologiques en Suisse. Soc. Suisse Préh. et Archéo. p. 50-72, 11 tab.
GALLAY A. (1989): La place des Alpes dans la néolithisation de l'Europe. Neolithisation. BAR
Intern. Series. n°516. p. 227-254, 5 fig.
GAMBARI F. (1995): Età del Ferro in Piemonte. Preistoria e Protostoria del Piemonte. XXXIIe
Riunione del Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Alba 1995. p. 16 à 21.
GAMBARI F.M. et VENTURINO GAMBARI M. (1990): Il periodo di transizione tra Neolitico
ed Eneolitico in Piemonte: evoluzione e cambiamento degli aspetti culturali. Bull. Etudes Préhistoriques
Alpines. n° spécial. Actes Ve Coll. Alpes Antiquité, 11-13 sept. 1987. p. 127-141, 5 fig..
GAMBARI F. et FOZZATI L. (1995): Età del Bronzo in Piemonte. Preistoria e Protostoria del
Piemonte. XXXIIe Riunione del Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Alba. p. 12 à 15.
GATTIGLIA A. et ROSSI M. (1987): Pour une histoire de la métallurgie protohistorique et
antique dans les Alpes occidentales: les sources de l'étude, les gisements, l'exploitation. Actes Coll. Les
mines et la métallurgie en Gaule et dans les provinces voisines. Caesarodunum XXII. 26-27 avr. 1986. p.
275-280.
GELY B. (1993): Les pratiques funéraires préhistoriques. Inventaire et analyse de sépultures de
la région Rhône- Alpes. Diplôme Ecole Pratique Hautes-Etudes. 289 p., 69 pl. h.t.
GELY B. et PORTE J.L. (1987): Fouilles de sauvetage d'une nécropole néolithique à Aime
(Savoie). Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n°19. p. 83- 90, 1 fig., 6 ph.
GELY B., OUGIER-SIMONIN P. et PORTE J.L. (1991): Fouilles de sauvetage d'une nécropole
néolithique à Aime (Savoie). Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial, n°2. Actes 6e Coll. Intern. sur
les Alpes dans l'Antiquité. Annecy, 23-24 sept. 1989. p. 41-55,
GILIGNY F., MARECHAL D., PETREQUIN P., PETREQUIN A-M. et SAINTOT S. (1995): La
séquence néolithique final dans les lacs de Claivaux et de Chalain (Jura). Actes du colloque d'Ambérieu-
en-Bugey, sept. 1992. Documents du département d'anthropologie et d'écologie de l'Université de
Genève, N° 20. pp. 313-346.
GINESTET J.P., BINTZ P., CHAIX L., EVIN J. et OLIVE C. (1984): L'abri sous roche de la
Vieille Eglise, La Balme-de-Thuy (Haute-Savoie). Premiers résultats. Bull. Société Préhistorique
Française. t. 81. p. 320-342.
GOUIN T. (1994): Contribution à l'étude de l'âge du Fer dans les Alpes du Nord. Mémoire de
maîtrise. Université Grenoble II. 2 vol. Texte et Planches.
GRAS R. (1976): 1. Oppidum de Saint-Luce, Vercoiran (Drôme). 2. Grotte des Sarrasins, Mirabel-
aux-Baronnies. (Drôme). 3. Le Dèves, Nyons (Drôme). U.I.S.P.P. Nice. IXe Congrès. Livret-Guide
Excursion A9. p. 65-72, 4 fig., 2 ph. et p. 73.
HAUSSMANN L. (1995): L'âge du Bronze dans les Hautes-Alpes. Mémoire de Maîtrise
Université Grenoble II. 2 vol. Texte et Planches.
HENON P. (1992): T.G.V. Rhône-Alpes: le site chasséen et Bronze final du "Clapier" à
Beauvoir-de-Marc (Isère). Bull. Société Préhistorique Française. t. 89, n°7. p. 197-198.
HENON P. (1993): Un ensemble céramique du début du Bronze final sur le site des Batailles à
Jons (Rhône): l'exemple de la fosse 1. Rencontres néolithiques Rhône-Alpes. Centre archéologique de la
Drôme. n°8. p. 79-92, 5 fig.
HERITIER A. (1977): Etat actuel de la recherche préhistorique dans la Drôme du Nord et le
Vercors. Etudes Dromoises. n°1. p. 3-17.
HERITIER A. (1979): Le Néolithique et les Ages des Métaux: station de surface de Bouvante. La
Préhistoire en Vercors. Courrier Parc Nat. Rég. Vercors. n°22. p. 36, 7 fig.
HERITIER A. (1984): Un nouvel habitat pré- et protohistorique à Saou. Etudes Dromoises. n°1. p.
13-15, 2 fig.
JEANNET C. et JAYET A. (1950): Le Néolithique du Malpas, près de Frangy (Haute- Savoie).
Mélanges Louis Bosset. Rouge et Cie, Lausanne. p. 65-82.
136
JEUNESSE C., NICOD P.Y., BERG (van) P.L. et VORUZ J.L. (1991): Nouveaux témoins d'âge
néolithique ancien entre Rhône et Rhin. Ann. Soc. Suisse Préh. et Archéo. vol. 74. p. 43- 78, 22 fig..
LAGRAND C. et THALMANN J.P. (1973): Les habitats protohistoriques du Pègue (Drôme). Le
sondage n°8 (1957-1971). Cahier n°2 du C.D.P.A. Grenoble. 159 p., 23 fig., 39 pl..
LE ROUX M. (1908): La palafitte néolithique du lac d'Annecy: outillage, industrie, faune.
Congrès Préhistorique de France. C.r. 4e Session, Chambéry, p. 547-566, 8 fig.
LEBASCLE M.C. et SAUTER M.R. (1978): Sur un groupe d'objets de l'âge du Bronze provenant
d'Etrembières (Haute-Savoie). Bull. Société Préhistorique Française. C.R.S.M. t. 75, n°5. p. 150-160, 6
fig..
LEPAGE L. (1966): Recherches métallurgiques sur des objets en acier provenant du Pègue.
Cahiers rhodaniens. n°13, p. 120-134, 3 fig., 1 tabl.
LUGAN B. (1995): Afrique. Ed. Christian de Bartillat, 390 p.
MAGNY M. et RICHARD H. (1985): Contribution à l'histoire holocène du lac du Bourget.
Recherches sédimentologiques et palynologiques sur le site de Conjux-la-Chatière (Savoie). Revue de
Paléobiologie. vol. 4, n°2. p. 253-277, 19 fig..
MALENFANT M. (1979): Le Néolithique et les Ages des Métaux. Ateliers de taille P 51 des aires
40, 41, 42 et des aires 77 et 22, Vassieux-en-Vercors. La Préhistoire en Vercors. Courrier n°22. p. 37-44
18 fig., 2 ph.
MALENFANT M. (1986): Notes sur le fait pressignien. Centre de Recherches Préhistoriques du
Vercors. Cahier n°2. p. 43.
MALENFANT M. (1993): Note préliminaire sur l'industrie lithique de l'aire 22 (Vassieux-en-
Vercors, Vercors): le Vassivin. Centre de Recherches Préhistoriques du Vercors. Bull. n°7. 19 p., 52 fig.
h.t..
MALLET N. (1991): Le Grand-Pressigny: ses relations avec la civilisation Saône-Rhône. Bull.
Ass. Amis Musée préhistorique du Grand-Pressigny. n°42. p. 18-27, 8 fig.
MARGUET A., ORCEL C. et ORCEL A. (1988): Problèmes posés par la fouille et l'interprétation
des vestiges d'habitats néolithiques dans le lac d'Annecy: le Petit-Port à Annecy-le-Vieux (74). Colloque
international sur le Néolithique. C.r. 12e Session, Lons-le-Saunier, 11-13 oct. 1985. p. 67-87, 25 fig..
MARGUET A. et BILLAUD Y. avec coll. CASTEL R. (1993): La fin de la Préhistoire dans le lac
du Bourget: trente siècles d'occupations littorales? La Savoie avant l'histoire. Mém. et Doc. Soc. Savois.
Hist. et Archéo. t. 95. p. 21-36, 15 fig..
MEZZENA F. (1975-76): Ricerche preistoriche in Valle d'Aosta. Risultati e prospettive. Revue
d'Etudes ligures. t. 41-42. 92 p.
MEZZENA F. (1981): La Vallée d'Aoste dans la Préhistoire et la Protohistoire. Archéologie en
Vallée d'Aoste. Industrie Grafiche. Ed. Musumeci. Quart-Aosta. p. 15-60, 38 fig..
MILLOTTE J.P. (1959): Les Ages des Métaux dans les Alpes françaises. Etat des questions et
problèmes. Congrès préhistorique de France. C.r. 16e Session, Monaco, 28 août-5 sept. 1959. p. 878-
887, 2 pl.
MILLOTTE J.P. (1974) Une ancienne découverte de l'Age du Bronze à Genève. Le dépôt de la
Maison Buttin-en-l'Ile. Archives Suisses Anthrop. Genève. t. 38, n°2. p. 119-134.
MULLER H. (1909): L'Age du Cuivre dans les Alpes françaises. Sépultures de Fontaine-le-Puits
(Savoie). Congrès préhistorique de France. C.r. 5e Session, Beauvais, 1909. p. 544-550, 2 fig.
MURET A. (1986): Montmorin, col des Tourettes, sauvetage programmé. Habitats du Mésoli-
thique au Gallo-romain. Sépultu res du Chalcolithique final/Bronze ancien. Notes d'information et de
liaison. n°3. Dir. Antiqu. Région PACA. p. 30-34, 3 fig.
MURET A. (1987): Note d'information sur les sépultures du col des Tourettes à Montmorin
(Hautes-Alpes). Rencontres Néolithiques Rhône-Alpes. Centre archéologique de la Drôme. N°3. p. 103-
110, 2 fig., 1 ph.
NICOLAS A., MARTIN B. et COMBIER J. (1972): La céramique incisée de Moras-en-Valloire
(Drôme). Etudes Préhistoriques. n°2. p. 35-43, 3 ph., 3 fig
137
NICOLLET F., CHAUSSE M. et CHAUSSE J.C. (1977): La grotte du Trou de la Chuire (Hières-
sur-Amby). Evocations. Bull. Et. Hist. et Géo. Bas-Dauphiné. n°4. Nelle série n°19. p. 115-121, 4 fig.
OBERKAMPF M. (1984): L'âge du Bronze en Haute-Savoie d'après les découvertes (en dehors
des stations littorales). Mémoire de Maîtrise. Fac. Lettres et Sc. Humaines, Besançon. 83 p., 8 fig., 6
cartes, 42 pl..
ORCEL C. et ORCEL A. (1990): Etat des recherches en dendrochronologie de la Préhistoire à
l'époque romaine dans les Alpes et leur piémont. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial. Actes Ve
Coll. Alpes Antiquité, 11-13 sept. (1987):, Aoste. p. 281-287, 2 annexes, 1 tab.
PAULI L. (1984): The Alps. Archaeology and early history. 304 p., 166 fig..
PELEGRIN J. avec coll. MALENFANT M. et MILLET- RICHARD L.A. (1993): Evaluation
technologique de séries lithiques post-paléolithiques du Vercors. Centre de Recherches Préhistoriques du
Vercors. Bull. n°6. p. 4-29, 6 fig., 1 tab..
PERRIN F. (1990): Un dépôt d'objets gaulois à Larina, Hières-sur- Amby (Isère). Documents
d'Archéologie en Rhône-Alpes. n°4. Circ. Antiquités Hist. Région Rhône-Alpes. 176 p., 144 fig., 4 graph..
PERSOUD P. (1989): Un tumulus dans la nécropole des Ages du Fer à Gruffy (Haute-Savoie).
Revue Savoisienne. 129e année. p. 135-148, 4 fig..
PICAVET R. (1989): La sépulture collective de Comboire (Claix, Isère) Centre de Recherches
Préhistoriques du Vercors. Bull. n°4. p. 1-58, 31 fig..
PICAVET R. (1991): L'abri sous roche de La Grande Rivoire, Sassenage (Isère). Mémoire de di-
plôme. Ecole Htes Etudes Sciences Sociales; Toulouse. 216 p., 94 p., tab., 4 annexes.
PRIEUR J. (1983): La Préhistoire et le peuplement de la Savoie. Les mégalithes et l'art rupestre.
La Savoie des origines à l'an mil. Histoire et Archéologie. p. 123-162, 25 cartes et fig..
RAMELLA P. (1986): Archeologia in Piemonte e Valle d'Aosta (con dati di storia antica). 406 p.,
fig.
RAMELLA P. (1988): 5000 anni fa Chiomonte. Mostra fotografica e grafica sulla scoperta
dell'accompamento neolitico di Chiomonte (Torino). Archeologia e Museo. Ass. Amici Mus. Canavese. p.
73.
REBILLARD J. et BOCQUET A. (1984): Gîtes cuprifères et Protohistoire dans les Alpes du
Nord. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n°16. p. 7-48 6 cartes.
RICHNER V. (1979): L'âge du Bronze final à Auvernier. Cahiers d'Archéologie romande N°15. 2
Vol. Texte et Illustrations.
RICQ de BOÜARD M. (1996): Pétrographie et sociétés néolithiques en France méditerranéenne.
L'outillage en pierre polie. Monographie du CRA N°16. 272 p., 82 fig., 5 tab. Editions du CNRS.
RITTATORE VON WILLER F. (1975): La civiltà del Ferro in Lombardia Piemonte Liguria.
Popoli e Civiltà dell'Italia Antica. vol. 4. p. 223-327, 7 cartes, 56 pl..
ROSSI M. (1992): Arrondissement de Briançon. Prospection-inventaire Bilan scientifique (1991):
Région PACA. Dir. Rég. Aff. Cult. Serv. Rég. Archéo. p. 56-59, 2 fig.
ROSSI M. avec coll. GATTIGLIA A., MAIO (di) M. et ROSTAN P. (1993): Prospection et
inventaire archéologiques du Briançonnais (Hautes-Alpes). La campagne (1992): en Queyras et l'état actuel
des recherches. Rapport. Antropologia Alpina. Ante litteram 4. 46 p., 34 fig..
ROSTAN P., GATTIGLIA A. et ROSSI M. (1995): Ricerche sulle miniere e sulla metallurgia dell'
Età del Bronzo nel Briançonnais (Hautes-Alpes, France). De Re Metallica. Miniere e materie prime alle
soglie del 3° millennio. Convegno, 1°-2 dec. 1994. Politecnico Torino. p. 173-181, 5 fig..
SANTACROCE A. (1972): Incisioni rupestri della Valle de Susa. Congrès Soc. Sav. Province de
Savoie. Saint-Jean-Maurienne, 7-8 sept. 1968. p. 29-44, 3 fig., 1 carte.
SANTACROCE A. et MANO L. (1992): Censimento delle incisioni rupestri delle Alpi occi-
dentali. Boll. Soc. Studi Storici, Archeo. ed Art. Provincia di Cuneo. n°106. p. 53-66.
SAUTER M.R. (1959): Sur une industrie en cristal de roche dans le Valais néolithique. Archives
Suisses Anthrop. Générales. t. 24, n°1-2. p. 18-40.
138
SAUTER M.R. (1968-69): Le Néolithique moyen du Valais et ses relations circumalpines. Bull.
Etudes Préhistoriques Alpines. t. 1. p. 46- 54.
SAUTER M.R. et GALLAY A. (1960): Les matériaux néolithiques et protohistoriques de la
station de Génissiat (Ain, France). Genava. t. 8. p. 63-111, 38 fig..
SAUZADE G. (1993): Le mégalithisme dans les Alpes. Archéologie dans les Hautes-Alpes.
Musée Dép. Gap. p. 93-100, 7 fig..
SEGLIE D. et alii (1990): Insediamenti preistorici nel Pinerolese (Alpi Cozie, Italia): cronologia e
collagamenti culturali. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial. Actes Ve Coll. Alpes Antiquité, 11-
13 sept. 1987. p. 351-367, 11 fig..
SEGLIE D., RICCHIARDI P. et BESSONE G. (1973): Incisioni rupestri del Pinerolese. Ricerche
Paletnologiche. nelle Alpi Occidentali. Convegno Studi Preist. C.r. 1e Session, Pinerolo, 6 oct. 1973. p.
127-137, cartes, fig., pl..
SEGLIE D., RICCHIARDI P. et CINQUETTI M. (1991): Il medaglione bronzeo di Pourrières ed
il corredo del Laux (Val Chisone, Alpi Cozie, Italia). Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial. n°2.
Actes 6e Coll. Intern. sur les Alpes dans l'Antiquité. Annecy, 23-24 sept. 1989. p. 81-88, 7 ph..
TREFFORT J.M. (1993). Saint-Alban. Locus B. Du Bronze final IIIa au Hallstatt ancien.
Stratigraphie, structures d'habitat et chronotypologie. Mémoire de maîtrise. Univ. Lumière, Lyon II. 2 vol
Texte: 114 p., 113 fig.
ULYSSE J. et GUILLAUME M. (1991): Tombe à incinération d'un guerrier gaulois à Sigoyer
(Hautes-Alpes). Archéologie dans les Hautes-Alpes. Musée Dép. Gap. p. 217-221, 4 fig.
VALENTIN F. (1992): 93 Aime et les populations humaines issues de cistes funéraires de type
Chamblandes. Bull. Etudes Préhistoriques et Archéologiques Alpines. t. 3-4. p. 153-156, 2 fig..
VENTURINO GAMBARI M. (1995): Neolithico ed Eneolitico. Preistoria e Protostoria del
Piemonte. XXXIIe Riunione del Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Alba. p. 5 à 11.
VERGER S. (1990): Du dépôt métallique à la tombe fastueuse. Autour de la tombe de Saint-
Romain-de-Jalionas,... Les premiers princes celtes. Musée Dauphinois. p. 53-71, 9 fig..
VERGER S. et GUILLAUMET J.P. (1988): Les tumulus de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère).
Premières observations. Les princes celtes et la Méditerranée. Coll. Rencontres Ecole du Louvre. p. 231-
240, 4 fig.
VERNEY A. (1994). Etude de la composition élémentaire d'un corpus d'objets base cuivre de
l'âge du Bronze final dans les Alpes françaises. Mémoire de Diplome d'études approfondies. Univ. Paris I
(Panthéon-Sorbonne). 2 vol Texte: 102 p., biblio. et Documentation: figures et Tableaux.
VIGNARD M. (1961): Quelques aspects du Chalcolithique et du Néolithique tardif de la Drôme.
OGAM t. 13, fasc. 4-5, n°76-77. p. 393-408.
VILAIN R. et DUFOURNET P. (1981): Les industries mésolithiques et protohistoriques des
plateaux de Bassy-Veytrens et de Seyssel-Vens (Haute-Savoie). Nouvelles Archives Museum Histoire
Naturelle de Lyon. fasc. 19. 122 p., 16 fig., 29 ph., 7 cartes, 20 pl..
VITAL J. (1990): Du Jura aux Alpes: l'économie, l'habitat, le territoire. Les premiers princes
celtes. Musée Dauphinois. p. 75-91, 10 fig..
VITAL J. (1990): Typologie et relations géographiques à l'âge du Bronze dans la moyenne vallée
du Rhône. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines. n° spécial. Actes Ve Coll. Alpes Antiquité, 11-13 sept.
1987, Aoste. p. 163-178, 12 fig.
VITAL J. (1992): Mutations culturelles/mutations techno-économiques à la fin du Néolithique et
au début du Bronze ancien dans la vallée du Rhône (Choranche). L'habitat et l'occupation du sol à l'âge
du Bronze en Europe. Coll. Intern., Lons-le-Saunier, 16-19 mai 1990. Documents Préhistoriques. n°4.
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. p. 259-268, 4 fig..
VITAL J. et BINTZ P et al. (1991): Les occupations protohistoriques et historiques des sites du
cirque de Choranche (Isère). Gallia-Préhistoire t. 33. p. 207-267, 40 fig., 4 tab..
139
VITAL J. et VORUZ J.L. (1991): Les tombes à incinération de la Tène ancienne de Chamboud à
Montalieu-Vercieu (Isère). Les Alpes à l'âge du Fer. Xe Coll. A.F.E.A.F., Yenne-Chambéry, 1986. Revue
Archéo. Narbonnaise, suppl. 22. p. 83-89, 6 fig.
VORUZ J.L. (1990): Chronologie de la néolithisation alpine. Bull. Etudes Préhistoriques Alpines.
n° spécial. Actes Ve Coll. Alpes Antiquité, 11-13 sept. 1987. p. 63-108, 18 fig., 2 annexes.
VORUZ J.L. (1992): Chronologie absolue du Bronze ancien et moyen. Cultures et sociétés du
Bronze ancien en Europe. Actes du 117e Congrès des societés savantes, Clermont-Ferrand (à paraître).
WEGMULLER S. (1977): Les défrichements à l'étage subalpin dans la région de Valmeinier et de
la vallée de Valloire (Haute-Maurienne, Savoie). Approche écologique de l'homme fossile. Travaux
Groupe Ouest Europe Comm. Intern. INQUA. p. 309- 315, 2 fig..
WILLIGENS M.P. (1991): L'âge du Fer en Savoie et Haute-Savoie. Les Alpes à l'âge du Fer. Xe
Coll. A.F.E.A.F., Yenne-Chambéry, 1986 Revue Archéo. Narbonnaise. Suppl. 22. p. 157-226, 8 fig., 26
pl..
WUILLAUME M. (1991): L'âge du Fer dans les Hautes-Alpes. Archéologie dans les Hautes-
Alpes. Musée Dép. Gap. p. 133-148, 4 fig..
WUILLAUME M. (1991): Les sépultures du second âge du Fer. Archéologie dans les Hautes-
Alpes. Musée Dép. Gap. p. 205-215, 9 fig.
LES RADIOCARBONE ET DENDROCHRONOLOGIQUES331
NEOLITHIQUE ANCIEN (5300 à 4500 av. J.C.)
Fourchette du Cardial: 5800 à 4300 av. J.C.
de l'Epicardial: 5300 à 3500 av. J.C.
du Néo. ancien du Valais: 5300 à 4600 av. J.C.
La Balme (73) Gr. Grande Gave 5425, 5398, 5383, 5351, 5349 cal. BC (5694-4940); Lyon 3413= 6460 +/-200 BP
Sassenage (38) Gr. Grande Rivoire 5204, 5173, 5137, 5115, 5084 cal. BC (5284-4916); Lyon 5185= 6195 +/-87 BP
Choranche (38) Gr. de Coufin 5216, 5156, 5146 cal. BC (5588-4576); Lyon 1730= 6230 +/- 240 BP
St Uze (26) Raverre 4942 cal. BC; Lyon 3511= 6060 +/-182 BP
La Balme (73) Gr. Seuil des Chèvres 4916 cal. BC (5263-4539); Lyon 3043=6020 +/- 150 BP
St-Nazaire-le-Désert (26) Gr. Trou Arnaud 4903,4874, 4859 cal. BC (4903, 4874, 4859); Lyon 4568= 5995 +/-246 BP
Balme-de-Thuy (74) Gr. Vieille Eglise 4808 cal. BC (5279-4371); Lyon 1934= 5940 +/- 210 BP
Sassenage (38) Gr. Grande Rivoire Epicardial 4712 cal. BC; Lyon 4447= 5820 +/- 142 BP
VASES A BOUCHE CARREE
Fourchette en Lombardie et dans la plaine du Pô: 5000 à 3750 av. J.C.
Chatelus (38) La Charmatte 4507 cal. BC; Lyon 3785= 5680 +/- 132 BP
Chatelus (38) La Charmatte 4462 cal. BC; Lyon 4381= 5630 +/- 113 BP
NEOLITHIQUE MOYEN (4500 à 3200 av. J.C.)
CHASSEEN
331 Les dates sont calibrées d'après le programme de calibration N° 3,03 de Stuiver et Pearson, 1993 (méthode A). En gras
médiane des dates BC calibrées; entre parenthèse les dates extrêmes pour deux écarts-type; le N° du laboratoire, la date brute BP et
son écart-type. Cette présentation a cours actuellement chez plusieurs spécialistes mais n'apporte aucune précision nouvelle sur les
dates issues des calculs statistiques. Je considère les dates radiocarbone comme seulement indicatives car elles sont souvent issues
de charbons de bois provenant du coeur des bois de chauffage ou des constructions détruites et non de la périphérie qui correspond à
la date d'abattage. Il est utopique de vouloir obtenir des précisions par calcul à partir de mesures dont beaucoup sont faussées au
départ par l'ignorance de la position exacte dans le bois des prélèvements analysés: par exemple la médiane calibrée de six
échantillons du village de Charavines-les Baigneurs est de 2915 BC (3040-2782); même la limite inférieure des deux sigmas est
supérieure à la date dendrochronologique qui fixe la durée entre 2670 et 2580 av. J.C...
140
Fourchette admise: 4500 à 2700 av. J.C.
Virignin (01) Gr. des Romains 4530 cal. BC (4787-4343); Lyon 229= 5700 +/- 130 BP
Sassenage (38) Gr. Grande Rivoire 4518 cal. BC; Lyon 4446= 5690 +/-103 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Antonnaire 4443, 4425, 4390, 4366 cal. BC (4718-4088); Lyon 4080= 5570 +/- 130 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Antonnaire 4443, 4425, 4390, 4366 cal. BC (4773-4042); Lyon 4081= 5570 +/- 150 BP
St-Nazaire-le-Désert (26) Gr.Trou Arnaud 4356 cal. BC (4571-4152); Lyon 4696= 5535 +/- 100 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Le Fournet 4327, 4275, 4265 cal. BC (4533-3975); Lyon 2434= 5440 +/- 130 BP
Balme-de-Thuy (74) Gr. Vieille Eglise 4239 cal. BC (4465-3955); CRG 411= 5384 +/- 130 BP
Claix (38) Gr. Comboire 4228 cal. BC (4318-4088); Lyon 4668= 5360 +/- 60 BP
St-Nazaire-le-Désert (26) Gr. Trou Arnaud 4228 cal. BC (4346-3957); Lyon 4697= 5315 +/- 90 BP
La Balme (73) Gr. Seuil des Chèvres 4216, 4201, 4141, 4120, 4086 cal. BC (4491-3704); Lyon 388= 5300 +/- 180 BP
St-Nazaire-le-Désert (26) Gr. Trou Arnaud 4039, 4012, 4008 cal. BC (4317-3827); Lyon 4698= 5255 +/- 75 BP
Balme-les-Grottes (38) Grotte de la B. 4074, 4064, 4043 cal. BC (4362-3775); Lyon 980= 5270 +/- 140 BP
Choranche (38) Gr. de Coufin 4070, 4041 cal. BC (4347-3789); Lyon 3321= 5260 +/- 120 BP
Balme-de-Thuy (74) Gr. Vieille Eglise 4035, 4020, 4002 cal. BC (4330-3797); Lyon 69= 5240 +/-100 BP
Balme-de-Thuy (74) Gr. Vieille Eglise 3960 cal. BC (4227-3698); CRG 412= 5135 +/- 108 BP
Sassenage (38) Gr. Grande Rivoire 3958 cal. BC (4036-3790); Lyon 6096
Crémieu (38) Gr. de Bethenaz 3930, 3875, 3808 cal. BC (4213-3640); Lyon 3444= 5060 +/- 113 BP
Francillon (26) Gr. de Baume Sourde 3777 cal. BC (4034-3521); Lyon 3598= 4990 +/- 120 BP
Châteauneuf-du-Rhône (26) La Roberte 3765 cal. BC (4233-3345); Lyon 2075= 4970 +/-200 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. d'Antonnaire 3663 cal. BC (3983-3351); Lyon 4079= 4890 +/-150 BP
Châteauneuf-du-Rhône (26) La Roberte 3639 cal. BC (3960-3132); Lyon 2076= 4830 +/-150 BP
Francillon (26) Gr. de Baume Claire 3615, 3584, 3531 cal. BC (3902-3099); Lyon 3599= 4760 +/-140 BP
La Balme (73) Gr. Grande Gave 3610, 3512, 3392, 3389 cal. BC (3771-3102); Lyon 3412=4730 +/-120 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Le Fournet 3508, 3400, 3387 cal. BC (3955-2912); Lyon 1407= 4720 +/- 200 BP
Balme-de-Thuy (74) Gr. La Vieille Eglise 3341 cal. BC (3642-2888); CRG 538= 4555 +/- 140 BP
Châteauneuf-du-Rhône (26) La Roberte 3028, 2975, 2930 cal. BC (3505-2613); Lyon 3798= 4400 +/- 150 BP
La Balme-de-Sillingy (74) Gr. de Lesvaux 2993 cal. BC (3335-2707); CRG 141= 4366 +/- 82 BP
Francin (73) 2908 cal. BC (3348-2498); Lyon 390= 4300 +/- 137 BP
Francin (73) 2898 cal. BC (3092-2625); Lyon 391= 4290 +/- 80 BP
Châteauneuf-du-Rhône (26) La Roberte 2586 cal. BC (3019-2147); Lyon 3799= 4080 +/- 150 BP
Francin (73) 2328 cal. BC (2876-1788); Lyon 389= 3870+/- 170 BP
CORTAILLOD ANCIEN ET CLASSIQUE
Fourchette admise: 5000 à 3200 av. J.C.
Date dendrochronologique des abattages
St-Jorioz (74) Les Marais (lacustre) -3783 Archéolabs
Dates Radiocarbone
Balme-de-Thuy (74) Gr. La Vieille Eglise 4223, 4191, 4158 cal. BC (4340-3982); CRG 302= 5335 +/- 72 BP
Balme-de-Thuy (74) Gr. La Vieille Eglise 3978 cal. BC (4344-3648); CRG 290= 5180 +/- 155 BP
Lugrin (74) Petit Tronc (tombe) 3940,3851, 3821 cal. BC (4316-3529); CRG 205= 5085 +/- 164 BP
St-Jorioz (74) Les Marais (lacustre) 3934, 3870, 3813 cal. BC (3934-3712); ARC 671=5070+/- 50 BP
La Biolle (73) Barme de Savigny 3787 cal. BC (4215-3388); Lyon 2077= 5010 +/- 140 BP
Sollières-Sardières (73) Les Balmes 3642 cal. BC (3795-3372); CRG 907= 4840 +/- 93 BP
Sollières-Sardières (73) Les Balmes 3511, 3394, 3389 cal. BC (3900-3034); CRG 531=4728 +/- 157 BP
Aime (73) Le Replat 3503 cal. BC (3707-3048); CRG= 4700 +/- 120 BP
Sollières-Sardières (73) Les Balmes 3491, 3483, 3372 cal. BC (3644-3048); CRG 617= 4650 +/-98 BP
NEOLITHIQUE INDETERMINE
Sévrier (74) Les Charetières (lacustre) 4219, 4148, 4099 cal. BC (4323-3986); ARC 706= 5315 +/- 56 BP
Sévrier (74) Les Choseaux (lacustre) 3624, 3573, 3538 cal. BC (3704-3361); ARC 473= 4775 +/- 79 BP
Lépin (73) Beau Phare (lacustre) 3357 cal. BC (3643-2920); Lyon 688= 4600 +/- 120 BP
St-Alban-Leysse (73) Abri Frantoli 3346 cal. BC (3372, 3105); Lyon 7545= 4570 +/- 35 BP
St-Paul-de-Varces (38) Les Râcles 3250, 3096 cal. BC (3494-2887); ARC 896= 4465 +/- 98 BP
141
St Jorioz (74) Les Marais (lacustre) 3091, 3055,3047 cal. BC (3347-2915); ARC 369= 4450 +/-50 BP
Balme-de-Sillingy (74) Gr. de Lesvaux 2191, 2158, 2146 cal. BC (2461-1936); CRG 204= 3774 +/- 82 BP
NEOLITHIQUE RECENT ET FINAL (3750 à 2350 av. J.C.)
PRE-SAONE-RHONE ET SAONE-RHONE
Fourchette admise: 3100 à 2350 av. J.C. (dendrochronologie)
Dates dendrochronologiques des abattages
Thonon (74) Port de Rives (lacustre) -3049 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Beauregard 1(lacustre) -3035 Archéolabs
Annecy-le-Vieux (73) Le Petit Port (lacustre) -3041 à -3026 Archéolabs
Charavines (38) Les Baigneurs (lacustre) -2670 à -2580 Archéolabs
Conjux (73) La Châtière (lacustre) -2548 Archéolabs
Conjux (73) La Châtière (lacustre) -2440 Archéolabs
Talloires (74) Angon (lacustre) -2435 Archéolabs
Dates Radiocarbone
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 3367 cal. BC (3991-2507); Lyon 1659= 4630+/- 290 BP
Conjux (73) La Châtière (lacustre) 2884 cal. BC (3029-2614); Gif 6771= 4250 +/- 75 BP
Aviernoz (74) Gr. La Tanière 2876, 2792, 2787 cal. BC (2919-2588); CRG 610= 4215 +/-65 BP
St-Alban (73) Petite Ile (lacustre) 2859, 2693, 2670 cal. BC (3306-2149); Lyon 20= 4150 +/6 180 BP
Lépin (73) Beau Phare (lacustre) 2862, 2741, 2697 cal. BC (2889-2506); Gif 8339= 4160 +/- 55 BP
Chanaz (73) Portout (lacustre) 2553, 2543, 2493 cal. BC (2862-2314); Gif 7338= 4010 +/- 75 BP
Brison-Saint-Innocent (73) Meimart (lacustre) 2577 cal. BC (2910-2205); Lyon 190= 4060 +/- 120 BP
Novalaise (73) Le Gogeat (lacustre) 2558, 2530, 2497 cal. BC (2854-2403); Gif 8338= 4020 +/- 56 BP
Conjux (73) La Châtière (lacustre) 2466 cal. BC (2885-2036); Lyon 1323 et 1324= 3970 +/- 140 BP
Talloires (74) Angons (lacustre) 2452, 2423, 2305 cal. BC (2560-2199); Gif 8145= 3910 +/- 55 BP
Conjux (73) La Châtière (lacustre) 2277, 2225, 2207 cal. BC (2617-1828); Lyon 1325= 3820 +/- 140 BP
Conjux (73) La Châtière (lacustre) 2178, 2166, 2143 cal. BC (2398-1971); Gif 6770= 3760 +/- 65 BP
Brison-Saint-Innocent (73) Meimart (lacustre) 2137 cal. BC (2551-1749); Lyon 2305= 3740 +/- 130 BP
NEOLITHIQUE FINAL MERIDIONAL
Fourchette admise: 3000 à 1800 av. J.C
Sollières-Sardières(73) Les Balmes 2884 cal. BC (3084-2578); CRG 616= 4250 +/- 90 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Le Fournet 2881 cal. BC (3344-2407); Lyon 2432= 4240 +/-160 BP
Le Lauzet (04) Le Villard (Dolmen) 2513 BC (2845-2141); Lyon 3257= 3980=/-120 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Le Fournet 2856, 2818, 2736, 2695 cal. BC (3329-2141); Lyon 1178= 4140+/- 190 BP
Francillon (26) Gr. Baume Sourde 2862, 2812, 2741, 2697 cal. BC (3031-2407); Lyon 3597= 4160 +/- 120 BP
St-Nazaire-le-Désert (26) Gr. Trou Arnaud 2856, 2690, 2665, 2629 cal. BC (3035-2320); Gif 77= 4140 +/- 137 BP
St-Nazaire-le-Désert (26) Gr. Trou Arnaud 2850 2655, 2622 cal. BC (2923-2332); Gif 4140= 4120 +/- 123 BP
Montmorin (05) Col des Tourettes 2615 cal. BC (3070-2147); Lyon 3623= 4100 +/- 160 BP
Romeyer (26) Pierre Pertuise 2582 cal. BC (3440-1921); Lyon 4787= 4070 +/- 240 BP
Saou (26) Pas de l'Estang 2577 cal. BC (2895-2282); Lyon 4215= 4060 +/- 110 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Le Fournet 2577 cal. BC (2914-2198); Lyon 3913= 4060 +/- 132 BP
Boulc-en-Diois (26) Tuc de la Varaime 2572, 2513, 2508 cal. BC (2920-2138); Lyon 4527= 4050 +/-152 BP
Montmorin (05) Col des Tourettes 2468 cal. BC (2850-2290); Lyon 3624= 3950 +/- 130 BP
Choranche (38) Gr. de Coufin 2466 cal. BC (2872-2138); Lyon 2373= 3970 +/- 113 BP
St-Nazaire-le-Désert (26) Gr. Trou Arnaud 2287 cal. BC (2575-1974); Lyon 5251= 3845 +/- 105 BP
Montmorin (05) Col des Tourettes 2260 cal. BC (2470-2036); Lyon 3622= 3810 +/- 140 BP
CAMPANIFORME
Fourchette admise: 2600 à 2000 av. J.C.
Montmorin (05) Gr. des Aiguilles 2461 cal. BC (2876-2036); Lyon 3621= 3950 +/- 130 BP
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 2289 cal. BC (2613-1938); Lyon 595= 3850 +/- 123 BP
St-Paul-de-Varces (38) Les Râcles (tombe) 2184, 2163, 2144 cal. BC (2392-1981); ARC 895= 3765 +/- 56 BP
142
NEOLITHIQUE RECENT ET FINAL sans attribution culturelle précise
Balme-de-Sillingy (74) Gr. de Lesvaux 2923 cal. BC (3335-2707); CRG 141= 4366 +/- 86 BP
Billième (73) Pierre à cupules de Santourin 2917 cal. BC (3699-2142); Lyon 2288= 4340 +/- 290 BP
Montmorin (05) Col des Tourettes 2615 cal. BC (3070-2147); Lyon 3623= 4100 +/- 160 BP
Montmorin (05) Col des Tourettes 2461 cal. BC (2876-2036); Lyon 3624= 3950 +/- 130 BP
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 2450, 2446, 2401, 2372, 2365 cal. BC (2858-1982); Gif 1204= 3900 +/- 120 BP
St-Thibaud-de-Couz (73) Grotte Jean-Pierre 1 2197 cal. BC (2912-1519); Lyon 1309= 3790 +/- 260 BP
Balme de-Sillingy (74) Gr. de Lesvaux 2191, 2158, 2146 cal. BC (2461-1936); CRG 204= 3774 +/- 86 BP
Montalieu-Vercieu (38) Chamboud 2019, 2003, 1981 cal. BC (2510-1620); Lyon 4121= 3650 +/- 170 BP
BRONZE ANCIEN (2200/2000 à 1650 av. J.C.)
Dates dendrochronologiques des abattages
Sévrier (74) (lacustre) -1655 Archéolabs
Dates Radiocarbone
Sévrier (74) Les Mongets (lacustre) 1932 cal. BC (2140-1770); ARC 528= 3595 +/- 56 BP
Montmaur-en-Diois (26) Gr. Le Fournet 1926 cal. BC (2455-1535); Lyon 2433= 3590 +/- 182 BP
Sollières-Sardières (73) Les Balmes 1888 cal. BC (2129-1686); CRG 906= 3560 +/-70 BP
Billième (73) Pierre à cupules de Santourin 1884 cal. BC (2490-1410); Lyon 2287= 3550 +/- 220 BP
Bourg-Saint-Maurice (73) Le Chatelard 1884 cal. BC (2285-1540); Lyon 4591= 3550 +/- 127 BP
Claix (38) Comboire 1747 cal. BC (2010-1585); Lyon 4667=3465 +/- 84 BP
Choranche (38) Gr. de Coufin 1734, 1721, 1689 cal. BC (2025-1495); Lyon 2372= 3420 +/- 113 BP
Sassenage (38) Gr. Grande Rivoire 1617 cal. BC (2009-1320); Lyon 5184= 3337 +/- 144 BP
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 1605, 1557, 1541 cal. BC (1885-1405); Gif 1203= 3320 +/- 113 BP
BRONZE MOYEN (1650 à 1350 av. J.C.)
Injoux-Génissiat (01) Abri de Sous-Sac 1518 cal. BC (1810-1330); Lyon 233= 3260 +/- 103 BP
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 1513 cal. BC (1845-1235); Lyon 239= 3240 +/- 123 BP
Saou (26) Pas de l'Estang 1414 cal. BC (1738-1008); Lyon 4214= 3150 +/- 142 BP
BRONZE FINAL (1350 à 700 av. J.C.)
PHASE ANCIENNE DU BRONZE FINAL ALPIN (1350 à 1070 av. J.C.)
Jons (69) Les Batailles 1375, 1348, 1217 cal. BC (1438-1128); ARC 628= 3070 +/- 60 BP
Saou (26) Pas de l'Estang 1262 cal BC (1515-918); Lyon 3056= 3020 +/- 113 BP
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 1251, 1248, 1205 cal. BC (1441-903); Gif 1202= 2980 +/- 108 BP
Creys-Mépieu (38) St Alban 1251, 1248, 1205 cal. BC (1428-912); Lyon 4743= 2980 +/- 98 BP
Annecy (74) Le Port (lacustre) 1226 cal. BC (1418-1071); Gif 8144= 3035 +/- 60 BP
Sévrier (74) Crêt de Chatillon (lacustre) 1225 cal. BC (1615-836); Lyon 192= 3030+/- 150 BP
Creys-Mépieu (38) St Alban 1192, 1162, 1137 cal. BC (1386-995); Lyon 5097= 2965 +/- 60 BP
Creys-Mépieu (38) St Alban 1152, 1149, 1130 cal. BC (1382-932); Lyon 4686= 2950 +/- 65 BP
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 1125 cal. BC (1560-820); Lyon 238= 2940 +/- 172 BP
Sollières-Sardières(73) Les Balmes 1028 cal. BC (1306-832); CRG 530= 2880 +/- 84 BP
PHASE MOYENNE DU BRONZE FINAL ALPIN (1070 à 940/930 av. J.C.)
Dates dendrochronologiques des abattages
Chens-sur-Léman (74) Beauregard 2(lacustre) postérieur à -1085 Archéolabs
Nernier (74) La Tire (lacustre) postérieur à -1085 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Tougues (lacustre) postérieur à -1078 à - 943 Archéolabs
Sévrier (74) Crêt de Chatillon (lacustre) -1066 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Sous le Moulin (lacustre) postérieur à -1050 à -965 Archéolabs
Duingt (74) Le Roselet (lacustre) -1058 à -1033 Archéolabs
Conjux (73) La Châtière (lacustre) -1054 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Fabrique-Nord (lacustre) -1050 Archéolabs
143
Annecy (74) Le Port (lacustre) -1045 Archéolabs
Thonon (74) Rives 2 (lacustre) postérieur à -999 Archéolabs
Messery (74) Parteyi (lacustre) postérieur à -995 à 955 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Vorze Ouest (lacustre) postérieur à -975 Archéolabs
Veyrier-du-Lac (74) Vieugy-Nord (lacustre) -963 Archéolabs
Dates Radiocarbone
Chindrieux (73) Chatillon (lacustre) 1312 cal. BC (1520-1000); Lyon 9= 3060 +/- 103 BPCulture ph. moy./réc
St-Alban (73) Petite Ile (lacustre) 1294, 1284, 1268 cal. BC (1610-899); Lyon 19 = 3040 +/- 142 BPCulture ph. moy./ réc
Conjux (73) La Châtière (lacustre) 1009 cal. BC (1417-794); Lyon 1326= 2870 +/- 142 BP Culture ph.moy./réc
Saou (26) Pas de l'Estang 1009 cal. BC (1194-907); ARC 1158= 2869 +/- 47 BP
PHASE RECENTE DU BRONZE FINAL ALPIN (940/930 à 700 av.J.C.)
Dates dendrochronologiques des abattages
Veyrier-du-Lac (74) Vieugy (lacustre) -937 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Vorze Ouest (lacustre) postérieur à -930 à -905 Archéolabs
Thonon (74) Rives 2 (lacustre) postérieur à -919 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Beauregard 2 (lacustre) postérieur à -911 Archéolabs
Chindrieux (73) Chatillon (lacustre) -906 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Tougues (lacustre) -905 à -859 Archéolabs
Brison-Saint-Innocent (73) Grésine (lacustre) -904 Archéolabs
Duingt (74) Ruphy (lacustre) -902 à -860 Archéolabs
Chens-sur-Léman (74) Fabrique-Nord (lacustre) -901 Archéolabs
Sévrier (74) Crêt de Chatillon (lacustre) -900 Archéolabs
Duingt (74) Le Roselet (lacustre) -880 Archéolabs
Messery (74) Parteyi (lacustre) postérieur à -877 à -867 Archéolabs
Annecy (74) Le Port (lacustre) -874 à -868 Archéolabs
Messery (74) Grand Bois (lacustre) postérieur à -834 Archéolabs
St Ferréol-Trente-Pas (26) Les Gandus postérieur à -880 Archéolabs
Chindrieux (73) Chatillon (lacustre) -814 Archéolabs
La Côte-Saint-André (38) Char du Rival postérieur à -765 (de 10 à 20 ans) Archéolabs
Dates Radiocarbone
Sévrier (74) Crêt de Chatillon (lacustre) 902 cal. BC (1373-522); Lyon 191= 2760 +/- 152 BP
Creys-Mépieu (38) St Alban 902 cal. BC (1036-803); Lyon 4684= 2760 +/- 65 BP
Saou (26) Pas de l'Estang 893, 882, 848 cal. BC (1001-802); ARC 642= 2740 +/- 56 BP
Saou (26) Pas de l'Estang 843 cal. BC (1202-543); Lyon 3729= 2730 +/- 123 BP
Creys-Mépieu (38) St Alban 840 cal. BC (1002-795); Lyon 4742= 2725 +/- 65 BP
Creys-Mépieu (38) St Alban 837 cal. BC (1005-792); Lyon 4685= 2720 +/- 70 BP
Balme-de-Thuy (74) Vieille Eglise 832 cal. BC (996-791); CRG 289= 2710 +/- 67 BP
Sévrier (74) Crêt de Chatillon (lacustre) 827 cal. BC (1252-410); Lyon 1951= 2700 +/- 142 BP
Creys-Mépieu (38) St Alban 822 cal. BC (1627-7); Lyon 4449= 2660 +/- 331 BP
St-Ferréol-Trente-Pas (26) Les Gandus 807 cal. BC (922-560); Gif 5448= 2650 +/- 74 BP
Aiguebelette-le-Lac (73) (lacustre) 755, 686, 540 cal. BC (913-194); Gif 222= 2480 +/- 152 BP Culture Bronze final
Thonon (74) Le Port (lacustre) 511, 435, 428 cal. BC (924-55); SA 228= 2440 +/- 182 BP Culture Bronze final
Creys-Mépieu (38) Gr. de Malville 511, 435, 428 cal. BC (895-169); Lyon 3443= 2440 +/- 152 BP Culture Bronze final
Sassenage (38) Gr. Grande Rivoire 407 cal. BC (899-39); Lyon 5098= 2400 +/- 177 BP Culture Bronze final
Chindrieux (73) Chatillon (lacustre) 403 cal. BC (794-193); Lyon 275= 2380= +/- 103 BP Culture Bronze final
PREMIER AGE DU FER (700 à 450 av. J.C.)
Seyssinet-Pariset (38) Gr. des Sarrasins 760, 632, 560 cal. BC (836-378); Gif 1201= 2500 +/- 108 BP
Sollières-Sardières (73) Les Balmes 519 cal. BC (817-209); Lyon 880= 2450 +/- 113 BP
DEUXIEME AGE DU FER (450 à 50 av. J.C.)
Saou (26) Pas de l'Estang 377 cal. BC (767-33); Lyon 3728= 2280 +/- 123 BP
Billième (73) Pierre à cupules de Santourin 351, 282, 257 cal. BC (903- AD343); Lyon 1604 = 2240 +/- 260 BP