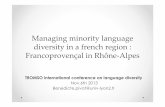Téléphonie et mobilité au Mali - Scholarly Publications Leiden ...
Indices de mobilité au Premier Age du fer, au sud et au nord des Alpes
Transcript of Indices de mobilité au Premier Age du fer, au sud et au nord des Alpes
INDICES DE MOBILITÉ AU PREMIER ÂGE DU FER ENTRE LE SUD ET LE NORD DES ALPES*
Stefania Casini (1), Bruno Chaume (2)
Riassunto. La distribuzione degli oggetti della cultura di Golasecca al di fuori del territorio d’origine si è modificata nel corso del tempo sia da un punto di vista geografico, sia in termini d’intensità. Nell’VIII e VII secolo a.C. la diffusione delle fibule a grandi coste si concentra nell’Italia nord-orientale, verso Bologna, il principale nodo di traffici, nel Veneto e lungo la valle dell’Adige, importante via di comunicazione verso l’Europa centrale. Gli ornamenti femminili sono strettamente connessi alle relazioni di scambio commer-ciale ed è possibile ritenere che la loro presenza sia legata a pratiche esogamiche. A partire dalla fine del VI secolo a.C. e durante tutto il V secolo a.C., la cultura di Golasecca assume un ruolo di intermediario tra i Celti nord-alpini e gli Etruschi della pianura padana. Durante questo periodo gli oggetti golasecchiani conoscono la loro massima diffusione sia in Italia settentrionale, sia a nord delle Alpi. Aumenta la varietà degli ornamenti, così come anche la quantità. Agli ornamenti femminili, fino a quel momento prevalenti al di fuori del territorio golasecchiano, si aggiungono quelli riferibili a soggetti maschili, la cui mobilità è legata a scopi commerciali. Questo quadro si modifica all’inizio del IV secolo a.C. e durante il LT B1, in seguito alle invasioni galliche dell’Italia settentrionale : si riducono, infatti, i territori nord-alpini interessati dalla diffusione degli ornamenti golasecchiani, che ricompaiono, invece, di pre-ferenza lungo la valle dell’Adige.Nel momento di massima diffusione degli oggetti di ornamento golasecchiani nei territori a nord delle Alpi, ossia tra la fine del VI e nel corso del V secolo a.C., si osserva in modo analogo la comparsa di ornamenti hallstattiani nell’Italia settentrionale, soprattutto fibule. Sia che questa mobilità possa avere avuto origine dalle pratiche esogamiche o più semplicemente da motivi commerciali in senso lato, gli oggetti hallstattiani che hanno raggiunto le Alpi restano molto rari e non permettono di documentare una presenza massiccia di popolazione di origine hallstattiana in Italia settentrionale.
Résumé. La répartition des objets de la culture de Golasecca en dehors de leur territoire d’origine a évolué au fil du temps, tant du point de vue géographique qu’en terme d’intensité des flux. Aux VIII e et VIIe siècles av. J.-C., la diffusion des fibules à grandes côtes se concentre à l’est, vers Bologne, un carrefour commercial, en Vénétie et le long de la vallée de l’Adige, importante voie conduisant vers le centre de l’Europe. Les parures féménines sont fortement impliquées dans le système des échanges de sorte qu’on peut inférer de leur présence des pratiques exogamiques. À partir de la deuxième moitié du VIe et pendant tout le Ve siècle av. J.-C., la culture de Golasecca assume le rôle d’intermédiaire entre les Celtes nord-alpins et les Étrusques de la vallée du Pô. Pendant cette période les objets golasecciens connaissent leur diffusion maximale aussi bien en Italie du Nord qu’au nord des Alpes. La gamme des objets augmente tout en se diversifiant : aux objets féminins qui jusque-là représentaient l’essentiel du flux des échanges, viennent s’ajouter des objets masculins révélant une mobilité des hommes sans doute à but économique. Ce cadre se modifie au début du IVe siècle av. J.-C et durant le LT B1 à la suite des invasions gauloises de l’Italie du Nord ; non seulement il se restreint en ce qui concerne les territoires nord-alpins, mais il se déplace du fait d’une remontée en puissance des territoires de l’est du cours de l’Adige.Au moment où le flux des objets golasecciens vers les territoires hallstattiens nord-alpins atteint son maximum d’intensité, c’est-à-dire dans la deuxième moitié du VI e et au cours du Ve siècle av. J.-C., on constate également, dans le sens nord-sud, une intensification des échanges marquée par l’apparition en milieu nord-italique d’objets hallstattiens, pour l’essentiel des fibules. Que cette mobilité ait pour origine des pratiques exogamiques ou plus simplement des motifs commerciaux au sens large du terme, les objets hallstattiens ayant franchi les Alpes demeurent très rares et ne permettent pas d’attester une présence massive de populations hallstattiennes en Italie du Nord.
(1) Directeur du musée de Bergame, Civico Museo Archeologico, Piazza Cittadella 9 - I - 24129 Bergamo - [email protected](2) Chargé de Recherche au CNRS, Directeur du programme international « Vix et son Environnement », UMR 6298, ARTeHIS, Dijon, Faculté des Sciences, 6 boulevard Gabriel - F - 21000 Dijon - [email protected]
* Depuis la rédaction de cet article deux travaux importants traitant de la culture de Golasecca sont parus. Il s’agit des ouvrages de P. Nagy et de M.A. Sormani.- Nagy P., 2012, Castaneda GR. Die Eisenzeit im Misox, mit Beiträgen von Bruno Kaufmann, Elisabeth Langenegger, Peter Northover, Antoinette Rast-Eicher. 2 Bände. Bonn, Dr. R. Habelt, 934 p., 259 pl. (Universitätsforschung zur prähistorischen Archäologie, Band 218).- SormaNi m. a., 2011-2012, « La necropoli protostorica di Gudo - Canton Ticino: dall’epoca del Bronzo alla secona età del Ferro », Rivista archeolo-gica dell’antica provincia et diocesi di Como, 193-194, p. 5-159.
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 231p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Stefania Casini, Bruno Chaume
232 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
La mobilité des individus durant le Premier Âge du fer peut être perçue à travers la circulation des objets à caractère personnel comme les fibules. Ces éléments de parure ne jouent pas de rôle économique dans les échanges, étant de peu de valeur, mais ils se caractérisent, en revanche, par une forte identité régionale. Si de tels objets sont trouvés au-delà des limites d’une aire culturelle déterminée, il est permis de penser que leur déplacement s’est accompagné de celui des personnes. Les raisons de la mobilité à l’Âge du fer sont liées à des facteurs écono-miques (commerçants), artisanaux, militaires (mercena-riat) et pour ce qui concerne les femmes, à la pratique du mariage exogamique (Pauli, 1978b ; Kristiansen, 1981, p. 254-255 ; Kristiansen, 1998, p. 90-94, 162-163, 394-399).
De nombreux chercheurs se sont interrogés sur la pré-sence d’objets golasecciens en dehors de leurs zones d’ori-gine et l’ont justifiée par quelques conjectures (Bocquet, 1991, p. 139-141 ; Dunning, 1991, p. 375 ; Schmid-Sikimić, 1991, p. 393-398). Richard Adam (Adam, 1992, p. 183-184) propose de considérer les fibules nord-ita-liques comme un genre de « passeport-laisser-passer » pour l’identification de ceux qui transitaient souvent d’un versant à l’autre des Alpes à des fins commerciales. Martin Schindler se demande s’il est possible d’envisager le groupe défini par la céramique de Tamins et du Haut-Valais comme deux « faces » de la culture de Golasecca du fait de la présence d’objets en bronze golasecciens (Schindler, 1998, p. 262-263).
Gilbert Kaenel (Kaenel, 1990, p. 289-290), quant à lui, avance l’hypothèse que quelques-uns des objets gola-secciens retrouvés en Suisse occidentale révèlent la pré-sence de femmes de Golasecca. Ce fait serait lié à la pratique des mariages exogamiques, ce que sembleraient confirmer deux cas uniques d’incinération (Chêne-Bougeries et Saint-Sulpice t. 26 bis)1.
L’explication de G. Kaenel a été reprise en 2000 (Casini, 2000) à la suite d’un recensement de tous les matériaux de Golasecca des VIe et Ve siècles av. J.-C. connus jusqu’alors soit au nord des Alpes, soit en Italie du Nord, dans les limites des territoires contrôlés par les Étrusques et par les populations d’origine rhétique. La recherche a été ensuite élargie au cours de l’année 2011 pour ce qui concerne la période du IXe au VIe siècle av. J.-C. (Casini, 2011).
Les premiers indices de mobiLité : ixe - viiie siècLe av. j.-c.
Par rapport à la recherche effectuée en 2000, le cadre s’est précisé grâce à de nouvelles découvertes et nous avons mis au premier plan le problème des imitations des
1. Sur le même sujet, à propos des territoires de l’Étrurie padane se référer à Macellari, 1994, p. 100-103 et Vitali, 1998, p. 257-259.
productions de Golasecca2. Une fibule de type tardo-alpin en plomb a été découverte à Gênes (Melli, 2004, p. 330, V.2.47). Elle atteste que des modèles d’objets golasecciens circulaient. Nous ne pouvons pas exclure d’autre part que des artisans de Golasecca se soient déplacés en d’autres lieux, reproduisant fidèlement des objets de leur tradition. Il est évident que ces éléments doivent être pris en consi-dération pour évaluer les circuits liés à la mobilité des personnes.
Le cadre, tel qu’il apparaît aujourd’hui, reflète une réalité beaucoup plus complexe et différenciée qui néces-sitera des approfondissements ultérieurs et des vérifica-tions. Dans cette contribution nous nous bornerons à circonscrire le plus précisément possible le cadre chrono-logique.
Les premiers objets de Golasecca qui apparaissent hors les limites de cette culture sont les fibules à côtes (de Marinis, 1995, 2002, Casini, 2011) dont l’origine peut être rapportée au type à disques du IXe siècle av. J.-C. (G. I A1). Ces dernières sont attestées, pour le moment, seule-ment dans la nécropole de la Ca’ Morta (CO) et à Ponte San Pietro (BG)3. En revanche, à partir du VIIIe siècle av. J.-C., les fibules à grandes côtes de type Mörigen (G.I A2, première moitié du VIIIe siècle av. J.-C. environ) (fig. 1) sont diffusées pour la première fois au-delà des limites du territoire golaseccien ; elles sont suivies des types de Castelletto Ticino (G. I B, milieu du VIIIe-début du VIIe siècle av. J.-C. environ) et Ca’ Morta (G.I C, VIIe siècle av. J.-C. environ) (fig. 2) (Casini, 2011).
Que les fibules à côtes appartiennent exclusivement au costume féminin, de nombreux ensembles clos de la culture de Golasecca en témoignent : par exemple, la tombe 289 de la Ca’ Morta (de Marinis, 1995, p. 94 et 97, fig. 3-4) avec des fibules à arc grossi et des pendentifs à bulle, un collier de perles d’os et de verre bleu, azur et rouge et des séparateurs en os4 ; la tombe 102 de la Ca’ Morta qui contenait des éléments de collier à petits pen-dentifs de corail figurant parmi les divers objets (de Marinis 2000, fig. 2) ; la tombe III/1921 de la Ca’ Morta avec des perles en pâte de verre (de Marinis, Premoli Silva, 1968-69, tavv. XIII : 3-4). La confirmation d’une appartenance de ces objets au trousseau féminin est appor-tée par des contextes extérieurs à la culture de Golasecca comme la tombe 27 de Villanova-Le Roveri (Gambari,
2. Dans beaucoup de cas, seul l’examen direct des objets permet d’éta-blir s’il s’agit d’imitations de modèles golasecciens ou de productions originales. 3. Au IXe siècle av. J.-C., le type à petites côtes est en revanche répandu hors des frontières de la zone de Golasecca, même si c’est de manière sporadique (Casini, 2011, fig. 4). Cependant, le peu de témoignages connus ne permet pas de comprendre s’il s’agit de productions locales ou d’objets que l’on peut effectivement rattacher à la culture de Gola-secca. Il est donc préférable pour le moment de ne pas prendre position en attendant de nouvelles données. 4. Il s’agit probablement d’une sépulture double à cause de la présence de fragments d’épingles caractéristiques du vêtement masculin, mais la majorité des ornements se rattache à la sphère féminine.
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 233p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 1. Carte de répartition des fibules de type Mörigen hors de la zone de la culture de Golasecca : 1. Mörigen (canton de Berne, CH) ; 2. Egg-Stirzental (canton de Zurich, CH) ; 3. Valfontana (Sondrio, I) ; 4. Sanzeno (Trento, I) ;
5. Dercolo (Trento, I) ; 6. Zambana (Trento, I) ; 7. Ravina (Trento, I) ; 8. Solteri (Trento, I) ; 9. Romagnano (Trento, I) ; 10. Nomi, Olmi (Trento, I) ; 11. Garda (Verona, I) ; 12. Oppeano (Verona, I) ; 13. Cologna Veneta, Baldaria (Verona, I) ;
14. Montagnana (Padova, I) ; 15. Bologna (I) ; 16. Villanova (Bologna, I).
Fig. 2. Carte de répartition des fibules de type Castelletto Ticino (rouge) et Ca’ Morta (noir) : 1. Saint-Julien-Mont-Denis, Cré du Saut (Savoie, F) ; 2. Wörgl-Kirchbichl, Kufstein (A) ; 3. Rogno (Bergamo, I) ;
4. Zambana (Trento, I) ; 5. S. Giacomo di Riva (Trento, I) ; 6. Gazzo Veronese, Colombara (Verona, I) ; 7. Este (Padova, I).
Stefania Casini, Bruno Chaume
234 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
1979, p. 66, fig. 41), les deux tombes de San Vitale 777 et 778 Pincelli, Morigi Govi, 1975, p. 479-48, tavv. 322 : 8-9 et p. 483-484, tav. 325 : 18) ou la tombe d’Este Candeo 301 (Chieco Bianchi et alii, 1976, tavv. 3:3) avec six fusaïoles parmi d’autres objets de parure. La répartition de tous les types de fibules à grandes côtes (fig. 1-2) indique des contacts privilégiés avec : à l’est Bologne et au nord-est les principaux sites paléo-venètes de la plaine padane (Este, Oppeano, Cologna Veneta, Montagnana) ainsi que la vallée de l’Adige (Nomi, Romagnano, Ravina, Solteri, Zambana) qui constituait un axe de contacts essen-tiel avec les territoires situés au nord des Alpes. La cho-rologie des fibules suisses du type Mörigen, d’Egg-Stirzental et celle plus méridionale de Saint-Julien-Mont-Denis, constitue une exception à ce schéma. Elles annoncent des voies de contact plus occidentales qui seront principalement exploitées à partir du VIe siècle av. J.-C.5 De ce point de vue, l’un des aspects les plus inté-ressants est qu’à partir du VIIIe siècle av. J.-C., parallèle-ment à la diffusion des fibules à côtes au-delà des limites de l’aire de la culture de Golasecca, une série d’objets des productions villanoviennes ou les imitant confirme l’exis-tence de rapports constants et continus avec Bologne dont le rôle de centre de tri des produits de la péninsule a été plusieurs fois mis en évidence (de Marinis, 1986, p. 52-55 ; de Marinis, 1999a, p. 604-605, avec la bibliographie pré-cédente ; de Marinis, 2002, pp. 51-53 et de Marinis, 2009, p. 45-49). Dans le cadre de ces rapports, on doit mettre l’accent, par exemple, sur le fragment de ceinturon à losanges trouvé à Prestino (via Isonzo-La Pesa) dans l’habitat protohistorique de Côme (de Marinis 1999a, p. 605-611, fig. 1-2)6. Il est intéressant d’observer qu’en dehors de Bologne, des ceinturons du même type, quoique ces objets soient sans doute des productions locales, se retrouvent au nord du Pô : à Baldaria di Cologna Veneta (Verona), à Este (Padova) mais aussi à Wörgl (Kufstein, Austria) (Gleirscher, 1994, p. 70-71, fig. 2:1 ; de Marinis, 1999a, p. 610, fig. 3), des sites où ont été découvertes éga-lement des fibules à grandes côtes du VIIIe siècle av. J.-C. (de type Mörigen ou de type Castelletto Ticino). Le long de la vallée de l’Adige, le fragment exhumé dans la nécropole de Vadena (Bolzano) nous semble aussi très significatif.
Au cours du VIIIe siècle av. J.-C., toujours via Bologne, débute dans la culture de Golasecca, l’importation de corail provenant de la baie de Naples. Il est utilisé pour la réalisation de petits pendentifs en T (de Marinis, 2000). De nouveaux objets apparaissent aussi comme : des mors de cheval tressés, la serfouette de la tombe de Vigna di Mezzo (Como) (de Marinis, 1988, p. 178-179, de Marinis,
5. Pour la liste des sites ayant livré des fibules de type Mörigen, voir Casini, 2011, p. 267-268. 6. Nous n’excluons pas d’ailleurs que ce ceinturon appartienne à une femme originaire de Bologne, qui serait venue à Côme pour se ma-rier.
1999a, p. 610-611), ou le vase en forme de botte du groupe Bologne-Vetulonia-Veio dans une tombe de Brescia-Villa Giovio (Como) (de Marinis, 1999 a, p. 611-616, fig. 5-6), les coupes à godrons (de type Colmar) produites à Vetulonia, la hache à douille de type San Francesco et une puisette (attingitoio) en bronze avec manche en S de la tombe du Carrettino (Como) (de Marinis 1998, p. 178 ss. fig. 150-153). Un autre attingitoio de type bolognais fait partie des objets de la tombe 11 de la Ca’ Morta (associée à une fibule à grandes côtes) tandis qu’un fragment indé-terminé se trouve dans la tombe V-VI/1921 de la même nécropole (de Marinis, 1986, p. 59 avec la bibliographie précédente).
Le viie siècLe av. j.-c.
Les contacts avec la péninsule s’intensifient proba-blement au cours du G.IC, avec l’ouverture de voies plus occidentales, alternatives à Bologne, par lesquelles arrivent peut-être le bassin en bronze à fond plat de style orientalisant de la tombe de Motto Fontanile à Castelletto Ticino (Novara), une production probable de Vetulonia (Grosseto) (Gambari, 1986), la situle en bronze à attaches en demi-lune, fabriquée à Populonia et provenant d’une tombe de Golasecca (de Marinis, 1986, pp. 57-58, fig. 20), le « kyathos buccheroïde » avec des frises animalières d’une tombe de Sesto Calende, loc. San Giorgio (Varese) (de Marinis, 1975, p. 253, notes 56-57 ; M. Colonna dans Gambari, Colonna 1988, p. 155 ss., tavv. XLVI-XLVIII), un « kylix » en « bucchero » de type Rasmussen 1c, une boucle d’oreille en or travaillé à granulations de la sépul-ture de Golasecca (Varese) (de Marinis, 2002, p. 52, note 79) et pour finir un « kylix » en bucchero de type Rasmussen 3b provenant de Castelletto Ticino (Novara) (Gambari, 1993, p. 127-129), fig. 1:1). Les jambières de type grec archaïque et le char à deux roues de la tombe I du guerrier de Sesto Calende (Varese) (de Marinis, 1975, p. 214-220, tavv ; I-IV : A) participent de ce mouvement.
Des objets comme le couteau en bronze de type Arnoaldi retrouvé à Golasecca (Varese) (de Marinis, 2002, p. 51-52, fig. 9), privé de tout contexte de découverte, nous ramènent à Bologne ainsi d’ailleurs que la boucle de ceinture à quatre anneaux de bronze découverte à Grandate (Como) et produite dans le Picenum mais attestée aussi à Bologne (de Marinis, Premoli Silva, 1968-69, tav. XIV:3 ; de Marinis, 1988, p. 195). À ces objets, il convient d’ajou-ter deux perles en pâte de verre à motifs oculiformes et à zigzags jaunes connues à Bologne dans le Villanovien IV B1 et deux perles cylindriques à côtes longitudinales en pâte de verre azur avec des bandes ondulées blanches, fréquentes dans le style orientalisant étrusque. Ces objets font partie du mobilier de la t. III/1921 de la Ca’ Morta (Como) où ils se trouvent, entre autres, associés à des fibules à grandes côtes de type Ca’ Morta (de Marinis,
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 235p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Premoli Silva, 1968-69, tavv. XIII:13, 14, 15, 3-4 ; de Marinis, 1988, p. 209).
Les échanges entre la culture de Golasecca et Este sont eux aussi bien documentés : trois petites fibules à arc surbaissé du VIIIe siècle av. J.-C. retrouvées, l’une à Santa Maria di Vergosa (CO) et les deux autres à Ponte San Pietro (Bergamo), sans contexte d’association (de Marinis, 1970, tav. VIII:9 ; de Marinis, 1971-72, p. 81-86, tav. XIII: 4-5, p. 93), nous renvoient au monde paléo-venète. Elles trouvent leurs équivalents à Este (Padova) dans la tombe de Ricovero 143 et 236 (von Eles Masi, 1986, n° 575 et 567) et à Bologne dans la nécropole de San Vitale, tombes 774, 655, 661, 749 (Pincelli, Morigi Govi, 1976, respectivement tavv. 312:4, 265:10, 269:7-8, 299:4). D’Este, provient enfin le couvercle à décor travaillé en creux et en relief utilisé comme couvercle d’urne cinéraire en bronze de la tombe I/1885 de Grandate (Como) datée de la dernière moitié du VIIe siècle av. J.-C. (de Marinis, Premoli Silva, 1969, p. 117-120).
La présence des fibules à côtes en dehors du territoire de la culture de Golasecca s’insère donc dans ce cadre de relations axées sur une intense activité d’échanges et per-met de conjecturer que, selon toute probabilité, des alliances étaient contractées aux frontières grâce à des mariages exogamiques qui supposent le déplacement de femmes vers d’autres cercles culturels (Casini, 2011).
Une telle hypothèse semble corroborée par la décou-verte de ces objets dans les centres névralgiques des échanges de Bologne ou Este, situés le long des princi-paux axes de communication comme la vallée de l’Adige ou dans les lieux d’arrivée ou de tri des produits méditer-ranéens au-delà des Alpes (par exemple Wörgl en Autriche).
Ils témoignent des premières tentatives des Golasecciens pour s’insérer dans le réseau des rapports commerciaux tissés à partir de Bologne avec les zones nord-alpines. Il semble, en outre, assez évident que ces pratiques concernaient les classes sociales élevées comme tendent à le montrer les mobiliers avec fibules à côtes soit dans la culture de Golasecca soit dans des cercles exté-rieurs qui apparaissent habituellement riches. La preuve ultime réside peut-être dans la découverte des cippes funé-raires de Rubiera (Reggio Emilia). L’un d’eux rappelle le souvenir de Kuvei Pulesnai, une femme dont le nom, Kuvei, renvoie au domaine celtique, probablement de Golasecca, et qui vers la fin du VIIe siècle av. J.-C. avait épousé un chef militaire, le « zilath » de Rubiera dont la sépulture était signalée par le second cippe funéraire (Vitali, 1998, p. 257).
Ces fibules étaient donc l’apanage de sujets féminins, socialement élevés, dont on peut suivre les déplacements sur plusieurs générations étant donné que des types d’ob-jets, à la chronologie différente, apparaissent dans les mêmes localités. À Este, toutes les formes sont présentes ;
à Baldaria, ce sont les types Mörigen et Castelletto Ticino, à Gazzo (Verona) et à Wörgl, le type Castelletto Ticino ou le type Ca’ Morta qui sont attestés.
La présence sporadique au cours des VIIIe-VIIe siècles av. J.-C. de fibules à grandes côtes dans la zone alpine occidentale pourrait signifier la recherche de contacts de la part des Golasecciens. En effet, c’est dans cette direction que circulent la majeure partie des objets de parure féminins à partir du VIe siècle et durant tout le Ve siècle av. J.-C. quand les trajets commerciaux prove-nant de la péninsule privilégiaient les contacts avec les territoires transalpins plus occidentaux et empruntaient pour cela les axes du Rhône et du Rhin comme voies de transit.
Les sites d’habitat de Gamsen (Brig) (Benkert et alii, 2010) et Tamins (Canton des Grisons) (Conradin, 1978 ; Schmid-Sikimić, 1991, fig. 10-11) avec la présence de céramiques de Golasecca dès le VIIe siècle av. J.-C. et de parures aussi bien féminines que masculines de la même origine, confirment ces nouvelles orientations commer-ciales.
La présence de la céramique apparaît comme particu-lièrement significative car elle peut être mise en relation avec des formes de résidences durables pour des per-sonnes ou des noyaux familiaux provenant de Golasecca qui pour des motifs économiques s’installent le long des principaux axes par lesquels transitent les biens destinés aux Celtes transalpins (fig. 3). A partir du VIe siècle les lieux où l’on trouve de la céramique de Golasecca se mul-tiplient, surtout vers le sud-est (Valdieri, Tortona, Gremiasco) ; puis, au Ve siècle av. J.-C., cette céramique se retrouve en grande quantité à Forcello di Bagnolo San Vito (Mantova) (fig. 4) et de façon significative à Bragny-sur-Saône, c’est-à-dire aux deux pôles extrêmes du réseau commercial.
Du vie Siècle av. j.-c. aux iNvaSioNS gauloiSeS
Si dans la première moitié du VIe siècle av. J.-C., la dif-fusion des objets golasecciens apparaît encore ténue en dehors de la zone d’origine (fig. 5), on assiste, dans la seconde moitié du VIe et au Ve siècle av. J.-C., à une véri-table explosion (fig. 6-9) liée à une diversification des causes engendrant la mobilité, au-delà du seul motif des mariages exogamiques. Ce phénomène coïncide aussi avec la diffusion extraterritoriale d’une plus vaste gamme d’objets7 qui ne concerne plus seulement la sphère fémi-nine, bien qu’elle reste dominante, mais également la sphère masculine. Les comptages des objets (fig. 9) démontrent que les fibules masculines atteignent 10,8 % du total tandis que le pourcentage de féminines passe à
7. Outre les fibules a sanguisuga, des boucles de ceinture en bronze, des anneaux, des colliers d’ambre, des objets de toilette, des penden-tifs de différents types.
Stefania Casini, Bruno Chaume
236 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 3. Carte de répartition de la céramique de Golasecca entre le VIIe et le Ve siècle av. J.-C. : 1. Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire, F) ; 2. Gamsen (canton du Valais, CH) ; 3.Tamins (canton des Grisons, CH) ;
4. Savogn (canton des Grisons, CH) ; 5. Valdieri (Cuneo, I) ; 6. Tortona (Alessandria, I) ; 7. Gremiasco (Alessandria, I) ; 8. Brescia (I) ; 9, Forcello (Bagnolo San Vito, Mantoue, I) ; 10. Bologne (I).
Fig. 4. Fragments de céramique de la culture de Golasecca découverts dans l’habitat de Forcello (Mantoue, I) G. III A, Ve siècle av. J.-C. (dessins : S. Casini, R. C. de Marinis).
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 237p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
20,5 %. Aux fibules, il faut ajouter d’autres objets, indu-bitablement féminins, comme les armilles, les boucles d’oreille, les ceintures, les colliers qui représentent 12,3 %, et les pendeloques en forme de panier qui con-stituent la part la plus importante de l’ensemble avec 40,7 %.
Parmi les objets considérés habituellement comme féminins (Casini, 1998, p. 135-138), les pendeloques en forme de panier sont particulièrement diffusées (de Marinis, 1981, p. 229-232, fig. 5) ; ils atteignent parfois des territoires lointains comme l’Allemagne du Nord (Bernhöved, au sud de Kiel, ou Menz au nord de Berlin) et la Pologne (sites de Komratovo, Marcinkowo, Mieleszin et Miniszewo) (Teßmann, 2007) (fig. 6). À partir de leur diffusion se dessine une voie de l’ambre, un matériau fré-quemment utilisé pour les colliers, surtout dans la zone lépontique de la culture de Golasecca. Durant la première moitié du Ve siècle av. J.-C., ils circulent dans la partie septentrionale des Balkans avec une concentration parti-culière sur les sites slovènes et croates (Teßmann, 2007) (fig. 7) et parviennent même jusque dans la péninsule
ibérique8 dans la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C. (fig. 8). Il est possible, parce qu’ils avaient sans doute une valeur apotropaïque, qu’ils soient passés de main en main, ce qui n’est pas toujours significatif d’une mobilité individuelle. L’aire de diffusion s’amplifie aussi et concerne toute l’Étrurie padane dont Forcello di Bagnolo San Vito (MN) marquait le centre, la Ligurie et l’emporion de Gênes puis vers le nord, au-delà du Valais, vers les territoires situés le long du Rhône et les vastes zones de la France centrale jusqu’à la Marne. De nombreuses découvertes con-cernent aussi les territoires de Suisse septentrionale, traver-sés par le cours du Rhin, jusqu’au lac de Constance.
Pour le VIe siècle av. J.-C., les découvertes faites dans les contextes funéraires de Sankt Niklaus (Valais) (Schmid-Sikimič, 1996) apparaissent significatives. Dans
8. Bokhow, Prähistorische Zeitschrift, XLI, 1963, Abb. 30b. Altranft : un collier avec 10 “ pendeloques à petits seaux ” à fonds arrondis, var. B : voir Beilke Voigt, 1998, fig. 74a, p. 61. Les pendeloques décou-vertes à Numancia sont en réalité des copies de modèles golasecciens ; cela démontre bien que les modèles circulaient (Lorrio, 1997, fig. 96 / A8-10).
Fig. 5. Carte de répartition des objets golasecciens datés de la première moitié du VIe siècle av. J.-C. (G. II A-II A/B) : 1. Nainhof-Hohenfels (D), 2. Courtesoult (Haute-Saône, F) ; 3. Salins-les-Bains, Camp-du-Château (Jura, F) ;
4. Effretikon-Illnau (canton de Zurich, CH), 5. Tamins Unterm Dorf (canton des Grisons, CH) ; 6. Gamsen (canton du Valais, CH) ; 7. St. Niklaus (canton du Valais, CH) ; 8. Valdieri (Cuneo, I) ; 9. Bologna, Giardini Margherita (I) ; 10. Este (Padova, I) ;
11. Padova, vicolo Ognissanti (I), références in : Casini, 2000).
Stefania Casini, Bruno Chaume
238 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 6. Carte de répartition des objects golasecciens (noir) ou de pendeloques à petit seau (rouge) de la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. (G. II B):
1. Komratowo (PL); 2. Marcinkowo Górne (PL); 3. Mieleszin t. 17 (PL); 4. Miniszewo t. I e II (PL); 5. Mrowino (PL); 6. Bojanowo stare (PL); 7. Bernhöved (D); 8. Menz (D); 9. Altranft (Bad Freienwalde, D); 10. Sietzing (D); 11. Wellmitz (D);
12. Bochow (Potsdam, D); 13. Podborany, Zatec (CZ); 14. St. Etienne au Temple (Marne, F); 15. Heilz-l’Évêque, Charvais (Marne, F); 16. Luyères (Aube, F); 17. Vix, Mont Lassoy (F); 18. Bourguignon-les-Morey (Haute-Saône, F);
19. Chassey, la Redonte (Saône-et-Loire, F); 20. Salins-les-Bains (Jura, F); 21. Chilly, Les Moidons Papillard (Jura, F); 22. La Rivère-Drugeon (Jura, F);
23. Baulmes, Orbe (canton de Vaud, CH); 24. Bussy, Pré de Fond (Fribourg, CH); 25. Conthey, Sensine (canton du Valais, CH); 26. Brig-Glis Waldmatte/Gamsen (canton du Valais); 27. Wohlen, Hochbühl (canton d’Argovie, CH);
28. Trun, Grepault (canton des Grisons, CH); 29. Sagogn, Schiedberg (canton des Grisons, CH); 30. Tamins Unterm Dorf (canton des Grisons, CH); 31. Chur, Mittenberg (canton des Grisons, CH); 32. Eschen, Malanser (FL);
33. Oberriet, Montlingerberg (canton de Saint-Gall, CH); 34. Singen (Konstanz, D); 35. Hundersingen, Heuneburg (D); 36. Eberdingen-Hochdorf (D); 37. Nainhof-Hohenfels (D); 38. Lamprechtskogel, Weisenberg (A); 39. Prozor, Otočac, t. 61 (HR); 40. Kompolje t. 154 (HR); 41. Vače, Litija (SLO); 42. Bitnje tt. 2 e 3 (SLO); 43. S. Lucia, Most na Soci, tombes diverses (SLO);
44. Obervintl/Vandoies di Sopra (Bolzano, I); 45. San Lorenzo (Bolzano, I); 46. Monteleale Valcellina, casa dei Dolii (Padova, I); 47. Altino, Fornasotti (Venezia, I); 48. Padova, Ognissanti (I); 49. Montebello Vicentino (Vicenza, I); 50. Este (Padova, I);
51. Ospedaletto (Padova, I); 52. Oppeano, Ca’ del Ferro (Verona, I); 53. Rivoltella (Brescia, I); 54. S. Ilario (Reggio Emilia, I); 55. Ceresola Nova (Reggio Emilia, I); 56. Baragalla (Reggio Emilia, I); 57. San Polo, Servirola (Reggio Emilia, I);
58. Bismantova (Reggio Emilia, I); 59. Bologna, Certosa (I); 60. Verucchio, Pian del Monte (Forlì, I); 61. Sirolo. area Quagliotti (Ancona, I); 62. Orvieto, Crocifisso del Tufo (I); 63. Valbrevenna (Genova, I); 64. Casteggio (Pavia, I);
65. Verretto (Pavia, I) (références bibliographiques in Casini, 2000 et Teßmann, 2007).
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 239p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 7. Carte de répartition des objects golasecciens (noir) ou de pendeloques à petit seau (rouge) de la première moitié du Ve siècle av. J.-C. (G. III A1):
1. Cedyna t. 25 (PL); 2. Menz (D); 3. Düpow (D); 4. Halle, Röderberg (D); 5. Rochefort, Hans-sur-Lesse (B); 6. Hauviné La Motelle (Ardennes, F); 7. Messein, Cité d’Afrique (Meurt-Moselle, F); 8. Vix, Mont Lassois (Côte d’Or, F);
9. Bragny-sur-Saône (F); 10. Chassy, la Redonte (Saône et Loire, F); 11. Aubonne (canton de Vaud, CH); 12. Brig-Glis Waldmatte/Gamsen (canton du Valais, CH); 13. Ritzingen (canton du Valais, CH); 14. Jaberg, Kirchdorf (Bern, CH);
15. Thunstetten, Tannwäldli (Bern, CH); 16. Allschwil, Ziegelei (Basel, CH); 17. Kaisten (canton d’Argovie, CH); 18. Mels Gässli e Castels (canton de Saint-Gall, CH); 19. Tamins Unterm Dorf (canton des Grisons, CH);
20. Surcasti, Kirchenhügel (canton des Grisons, CH); 21. Vaz/Obervaz (canton des Grisons, CH); 22. Lenz, Bot da Loz (canton des Grisons, CH); 23. Susch Padnal (canton des Grisons, CH); 24. Domat/Ems (canton des Grisons, CH);
25. Chur (canton des Grisons, CH); 26. Oberriet, Montlingerberg (canton de Saint-Gall, CH); 27. Heidenheim, Mergelstetten (D); 28. Vellberg-Grossaltdorf (Scwäbisch Hall, D); 29. Chotín t. 2 (SK); 30. Dürrnberg bei Hallein (A); 31. Bergisel, Innsbruck (A); 32. Obervintl (Bolzano, I); 33. Bressanone, Stufels (Bolzano, I); 34. Meluno (Bolzano, I); 35. Rungger Egg, Sciliar (Bolzano, I);
36. Sanzeno (Trento, I); 37. Mechel (Trento, I); 38. Dercolo (Trento, I); 39. Breonio, Campo Paraiso (Verona, I); 40. Archi di Castelrotto, S. Pietro in Cariano (Verona, I); 41. Gazzo Veronese (Verona, I); 42. Este (Padova, I);
43. Montebello Vicentino (Vicenza, I); 44. Belluno, Safforze e Chies d’Alpago (I); 45. San Pietro al Natisone (Udine, I); 46. San Servolo, Trieste (I); 47. S. Lucia Most na Soci tombe varie (SLO); 48. Bitnje t. 3 (SLO); 49. Magdalenska Gora (SLO); 50. Martinov (SLO); 51. Metlika Hrib tum. 1/18(SLO); 52. Libna (SLO); 53. Smarjeta (SLO); 54. Novo Mesto tum. II/8 (SLO);
55. Doleniske Toplice tum. 11/8 (SLO); 56. Kaštelir (HR); 57. Osor (HR); 58. Kompolje tt. II-62 e dalla necropoli (HR); 59. Prozor tt. 3 e 56 (HR) 60. Nin t. 18 (HR); 61. Solin (HR); 62. Viča Luka tt. 3 e 4 (HR); 63. Jezerine tt. 1660, 477A (BIH);
64. Golubić tt. 15, 26 (BIH); 65. Perugia (I); 66. Verucchio Pian del Monte (Forlì, I); 67. Bologna, Certosa (I); 68. Marzabotto (Bologna, I); 69. Savignano (Bologna, I); 70. Bismantova (Reggio Emilia, I); 71. San Polo, Servirola (Reggio Emilia, I); 72. Canali (Reggio Emilia, I); 73. Virgilio, Forcello e Castellazzo della Garolda (Mantova, I); 74. Rivalta di Collefiorito (Mantova, I);
75. Brescia (I); 76. Remedello Sotto (Brescia, I); 77. Calvatone (Cremona, I); 78. Bobbio (Piacenza, I); 79. Pianello val Tidone (Piacenza, I); 80. Casteggio (Pavia, I); 81. Castelnuovo Scrivia, via Matteotti (Alessandria, I);
82. Gremiasco, Guardamonte (Alessandria, I); 83. Sestri Ponente, Bric Castellar (Genova, I); 84. Genova, San Silvestro (I); 85. Cafaggio, dal Magra (La Spezia, I); 86. San Romano di Garfagnana (Lucca, I);
87. Populonia (Livorno, I) (références bibliographiques in Casini, 2000 et Teßmann, 2007).
Stefania Casini, Bruno Chaume
240 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 8. Carte de répartition des objets golasecciens (noir), de pendeloques à petit seau (rouge) de la deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C. (G.III A2) :
1. Bourges, la Route des Duns (Cher, F) ; 2. Bragny-sur-Saône (F) ; 3. Chilly-sur-Salins, Les Moidons-Papillard (Jura, F) ; 4. Chabestan (Hautes-Alpes, F) ; 5. Guillestre (Hautes-Alpes, F) ; 6. Zeneggen, Heidenegg (canton du Valais, CH) ;
7. Brig Glis Waldmatte/Gamsen (canton du Valais, CH) ; 8. Raron. Heidnischbühl (canton du Valais, CH) ; 9. Münsingen Rain (canton de Berne, CH) ; 10. Aarwangen, Zopfen (canton de Berne, CH) ;
11. Unterlunkhofen, Bärau (canton d’Argovie, CH) ; 12. Trun, Grepault (canton des Grisons, CH) ; 13. Oberriet, Montlingerberg (canton de Saint-Gall, CH) ; 14. Seittens, Horwa (A) ;
15. Chur, Areal Ackermann (canton des Grisons, CH) ; 16. Müstair, Kloster St. Johann (canton des Grisons, CH) ; 17. Meluno (Bolzano, I) ; 18. Rasun di Sotto (Bolzano, I) ;
19. Libna (SLO) ; 20. S. Servolo (Trieste, I) ; 21. Este (Padova, I) ; 22. Montebello Vicentino (Vicenza, I) ; 23. Breonio, Campo Paraiso (Verona, I) ; 24. Archi di Castelrotto, San Pietro in Cariano (Verona, I) ; 25. Gazzo Veronese (Verona, I) ;
26. Forcello (Mantova, I) ; 27. Breno, t. 4 (Brescia, I) ; 28. Remedello, Ca’ di Marco (Brescia, I) ; 29. Gottolengo, Castellaro (Brescia, I) ; 30. Fraore, Parma (I) ; 31. S. Polo, Servirola (Reggio Emilia, I) ;
32. Bismantova (Reggio Emilia, I) ; 33. Bologna Certosa (I) ; 34. Verucchio, Pian del Monte (Forlì, I) ; 35. Villa Collemandina (Lucca, I) ; 36. Velleia (Piacenza, I) ; 37. Casei Gerola (Pavia, I) ; 38. Genova S. Andrea e S. Silvestro (I) ;
39. Molina de Aragón, Guadalajara (E) ; 40. Kirin (HR) (références bibliographiques in : Casini, 2000 et Teßmann, 2007).
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 241p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
ces tombes ont été trouvées : deux fibules a navicella à grands disques datées de la première moitié du VIe siècle et une fibule à arc composite avec un élément d’ambre ainsi que deux « armilles » à bouts superposés et à extré-mités à double globe de la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. Ce sont des parures typiquement golasecciennes qui révèlent la présence de femmes originaires du sud des Alpes. Le mélange d’objets golasecciens et d’origine locale (surtout les bracelets) rappelle ce qu’affirmait L. Pauli, sur la base des parures de tête de la défunte de la sépulture 44 de Jenišův Újezd (Bohême, Pauli, 1978a, p. 93-102), à savoir qu’il s’agissait probablement d’une femme originaire d’Allemagne centrale. L. Pauli soutenait que la disposition des tombes de personnages étrangers, dans ce cas des femmes9, à l’intérieur de la nécropole et la présence dans les assemblages mobiliers d’objets d’ori-gine locale, permettent de penser que ces femmes étaient pleinement intégrées dans la communauté dont elles avaient adopté le costume en conservant toutefois quelques objets qui rappelaient leur origine. L. Pauli considérait, en outre, que la découverte d’objets étrangers dans l’habitat et pas seulement dans les sépultures, consti-tuait la meilleure preuve de la complète assimilation des femmes étrangères dans leurs nouvelles communautés. Au nombre des sépultures actuellement identifiées comme celles de femmes golasecciennes figurent : la t. 13 de Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) (Sant’Ilario d’Enza, 1989, tavv. XXXIV) de la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. où apparaissent une ceinture décorée de cabo-chons de bronze qui trouve un équivalent dans la parure de la tombe de Sesto Calende (de Marinis, 1999b) et une boucle de type Golasecca var. B (Casini, 1998, fig. 15:3) ; dans la tombe 10 du tumulus I de Wohlen-Hochbühl (Canton d’Argovie) (Koller, 1998, p. 143, pl. 10 : C) avec une importante série de pendentifs à petits seaux (penda-gli a secchielli) à fond arrondi, var. B toujours datés de la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. ; la tombe 30 de Este-Capodaglio (Padova) (Teržan, 1977, p. 364, fig. 312:4) de la deuxième moitié du Ve siècle (G.III A2) avec une fibule « a sanguisuga » de type alpin tardif var. B.
La tombe 57 de la Certosa à Bologne, datée du Ve siècle av. J.-C. (G.III A 1-2) avec un verre à saillie médiane du type C1, est attribuable à un enfant, probablement d’origine golaseccienne (Sassatelli, 1989, p. 64, fig. 16). Certaines sépultures sont particulièrement riches comme la tombe 30 de Gênes (Melli, 2004, p. 288 et 342-344) avec un
9. Il donne comme exemple de cas probables d’exogamie : la tombe 1 de Losheim datée de LT B2 dans laquelle était enterrée une femme provenant des territoires du Rhin moyen (Groß, Haffner, 1969, p. 96) ; l’auteur estime que les objets étrangers à la culture locale, un bol et un anneau, ne sont pas arrivés par la voie commerciale mais portés par cette femme dont ils constituaient le trousseau - une tombe de Bourges avec une femme originaire de la Marne (U. Schaaff, Fibeln- und Ringschmuck im westlichen Frühlatène-Kreis, Versuch einer Gruppen-gliederung, Ungedr. Diss. Marburg, cité dans Pauli, 1978, p. 98) - et la tombe 5 d’Andelfingen avec une femme provenant de l’Allemagne sud-occidentale (Schaaff, 1972, p. 155).
mobilier de « toilette » type Rebbio en argent et or, une fibule « a sanguisuga » de type alpin tardif var. B et un collier d’ambre avec un pendentif en botte de même matière, daté de la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C. (G. III A2) et ayant appartenu à une « princesse » de Golasecca ; enfin signalons la tombe de la route des Duns à Bourges avec trois pendeloques en forme de panier à fond profilé var. B et un anneau décoratif, associé à une situle stamnoïde et une « Schnabelkanne », toutes deux des importations, qui date de la même époque (Willaume, 1985, n° 77-79 et 82 ; Chaume, 2001, 573, pl. 85).
La tombe 48 de Saint-Sulpice (canton de Vaud) datée des premières décennies du IVe siècle av. J.-C. (G.III A3) se distingue par ses précieuses fibules recouvertes de feuilles d’or et ornées de perles de corail ; elle compte une pendeloque en forme de panier à fond profilé var. C et un collier de perles d’ambre et de verre qui rendent probable l’attribution de la sépulture à une jeune femme de Golasecca de haut rang.
Quelques tombes, déposées à l’intérieur de tumulus, peuvent confirmer la complète intégration de ces femmes dans les différents cercles familiaux des nouvelles com-munautés qui les accueillent : Lanslevillard (Savoie) (Willigens, 1991, p. 171, pl. X:141), La Rivière-Drugeon, tumulus des Gentianes (Jura) (Bichet, Millotte, 1992, p. 862, fig. 44:9), la tombe 10 du tumulus I de Wohlen (canton d’Argovie) déjà citée et Thunstetten (Berne) (Hennig, 1992, p. 26-30).
Quant aux dépositions masculines, on peut en donner pour exemples : les tombes Alfonsi 1 de Este (Chieco Bianchi et alii, 1985, p. 374-375, tav. 252,9) de la deu-xième moitié du VIe siècle av. J.-C. (Este III antico) avec une fibule à arc serpentiforme de type Giaccio, la Rebato 208 de la première moitié du Ve siècle av. J.-C. (Este III) et une fibule a drago de type Cerinasca d’Arbedo (von Eles Masi, 1986, n° 2475), la tombe 18 de Sirolo, aire Quagliotti (Ancona) de la fin du VIe/début du Ve siècle av. J.-C. avec une fibule a drago pre-Cerinasca d’Arbedo (La Romagna, 1985, p. 337, fig. 15:4), la tombe 358 de la Certosa à Bologne (Zannoni, 1876, tav. CXX:3) qui conte-nait une fibule à arc serpentiforme de type Benvenuti 111, de la première moitié du Ve siècle av. J.-C. La tombe à inhumation de Carossina à Bagnolo San Vito (Mantova) avec une fibule à arc serpentiforme de type Benvenuti 111 (Menotti, 2011, p. 10) date de la même époque. On peut citer aussi, pour les territoires au nord des Alpes, la tombe 28 de Münsingen Rain (canton de Berne) (Hodson, 1968, Taf. 13, 708) avec une fibule de type Certosa variante tessinoise (Xn de B. Teržan).
La distribution des objets entre la seconde moitié du VIe et la fin du IVe siècle av. J.-C. (G. II B LT B1) n’est pas constante, elle subit des variations quantitatives et géographiques influencées par les événements historiques qui se déroulent dans les territoires celtiques vers le milieu
Stefania Casini, Bruno Chaume
242 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
du Ve siècle av. J.-C., c’est-à-dire au passage à La Tène A. La deuxième moitié du VIe siècle av. J.-C. (fig. 6) consti-tue la période de diffusion majeure avec la première moi-tié du Ve siècle (G.III A1, fig. 7 puis G.III A2, fig. 8) ; ensuite, on assiste à une diminution progressive jusqu’au début du IVe siècle av. J.-C. (G.III A3, fig. 10), c’est-à-dire avant les invasions gauloises de 388 av. J.-C. quand les contacts semblent se limiter aux territoires émiliens occi-dentaux, au Valais et dans la partie occidentale des Grisons.
Le cadre semble se modifier radicalement après les invasions celtiques (LT B1, fig. 11). La descente des tribus gauloises en Italie du Nord marque la rupture des équi-libres politico-économiques des périodes précédentes. Les flux commerciaux, les alliances et par conséquent la mobi-lité des personnes et des biens en sont affectés. Si on exclut Gênes, il semble que l’attention se déplace à l’est vers la Vénétie et la Vallée de l’Adige.
leS échaNgeS NorD-SuD : le caS DeS fibuleS hallStattieNNeS
Au moment où le flux des objets golasecciens vers les territoires hallstattiens nord-alpins atteint son maximum d’intensité, c’est-à-dire dans la deuxième moitié du VIe et au Ve siècle av. J.-C., on constate également, dans le sens nord-sud, une intensification des échanges marqués par l’apparition en milieu nord-italique d’objets hallstattiens, pour l’essentiel des fibules. Ces mouvements transalpins qui sont concomitants n’ont pas la même intensité, du moins si on les juge à l’aune de la répartition des objets situés de part et d’autre de la partie occidentale de l’arc alpin. Les artefacts provenant d’Italie sont plus nombreux au nord des Alpes que leurs homologues hallstattiens découverts au sud.
La question de la présence d’objets hallstattiens en Italie du Nord a plusieurs fois été traitée (Pauli, 1971 ; Frey, 1971, 1988 ; Parzinger, 1988 ; Pare, 1989 ; Adam, 1992, 1996). Nous nous efforcerons ici de préciser les typologies, de mieux sérier les groupes et spécifier les inventaires, pour reconsidérer, sous ce nouvel éclairage, les problématiques historiques. En effet, plus les typolo-gies des objets impliqués dans les réseaux d’échanges à longues distances, les fibules notamment, s’affinent, et plus la complexité des problèmes qu’ils soulèvent se révèle, ce qui en soi n’a rien de très surprenant. Sans trop entrer dans les détails, l’historiographie du sujet, que nous évoquons ici rapidement, conduit à ce constat : dans un premier temps de la recherche, l’hypothèse d’une présence hallstattienne en Italie du Nord a pris peu à peu corps. Elle s’appuyait essentiellement sur l’étude de la réparti-tion des objets hallstattiens ou pseudo-hallstattiens. L’article fondateur d’Otto-Herman Frey, paru en 1971, marquait le point culminant de cette première étape de la réflexion (Frey, 1971). On s’est trop focalisé sur son titre
évocateur (nous le traduisons, ainsi que les quelques cita-tions qui suivent) : « Des fibules de type hallstattien occi-dental de la région située au sud des Alpes : le problème des migrations celtiques », pour finalement ne retenir que l’intitulé aux dépens de la conclusion, pourtant très mesu-rée, qui contrastait fortement avec l’effet d’annonce du titre de l’article10. Dans son étude, O.-H. Frey nous dit, en substance, que les fibules hallstattiennes sont trop rares en Italie du Nord pour appuyer l’hypothèse de migrations celtiques à la fin du VIe et dans la première moitié du Ve siècle av. J.-C. Leur présence atteste simplement « d’échanges réciproques entre le nord et le sud des Alpes » (Frey, 1971, p. 375). Dans cet article, O.-H. Frey a pris le risque de lier l’existence des objets hallstattiens d’Italie du Nord aux migrations celtiques, rappelant au passage les fameux textes de Tite-Live (Ab Urbe condita) et de Polybe dont certains passages ont été interprétés comme témoignant de la réalité d’une présence hallstat-tienne en Italie du Nord à la fin du VIe et au début Ve siècle av. J.-C. O.-H. Frey notait toutefois que la première vague d’ “ immigrants ” ne pouvait pas être antérieure aux désordres sociaux constatés en Italie du Nord dans la deu-xième moitié du Ve siècle av. J.-C. (Frey, 1971).
C. Peyre, dans un très solide argumentaire, publié dans les actes du colloque AFEAF de Clermont-Ferrand, opère une mise au point, décisive selon nous, sur cette question des prétendues migrations hallstattiennes de la fin du VIe-début Ve siècle av. J.-C. (Peyre, 2007). Il revient sur la tra-duction et l’interprétation du texte de Tite-Live pour nous livrer son exégèse qu’il met toujours en regard des données archéologiques. Pour C. Peyre il n’est pas de preuve tangible attestant des migrations importantes en Italie du Nord au tournant des VIe et Ve siècle av. J.-C. Des incursions spora-diques ont sans doute été possibles (Peyre, 2007) voire pro-bables mais, en l’état des connaissances, pas plus les textes que les données archéologiques ne justifient l’idée d’une présence massive hallstattienne en Italie septentrionale à la fin du VIe et dans le courant du Ve siècle av. J.-C.
Les objets concernés par les échanges transalpins sont en général des éléments de parure, par excellence des fibules. Les études typochronologiques des fibules hall-stattiennes d’Italie du Nord, poursuivies depuis les travaux d’O.-H. Frey par H. Parzinger, C.F.E. Pare, P. Gleirscher et l’un d’entre nous (Chaume, 2001, p. 107, fig. 89), n’ont cessé de démontrer qu’en fait, rares sont les exemplaires hallstattiens qui ont franchi les Alpes et sont parvenus en Italie du Nord.
Une fois les typologies affinées, la plupart des groupes de fibules étudiés se scindent sans trop de difficultés en deux variantes qui se répartissent l’une au nord et l’autre
10. On prête aux titres d’article ou d’ouvrage un effet condensateur, souvent casuistique. Celui d’O-H. Frey n’échappe pas à la règle, car annoncer qu’on traitera du problème des migrations celtiques ne préjuge pas de la solution qu’on y apportera.
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 243p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
au sud des Alpes. C’est le cas notamment pour les fibules à arc rubané et celles à bec de canard. Les fibules à arc rubané (Bandfibeln) appartiennent au type S1 de Mansfeld. H. Parzinger (Parzinger, 1988, p. 324, pl. 144, 1) a distin-gué deux variantes, sud et nord-alpines. Bouleté pour la variante sud-alpine, le pied prend la forme d’une tête de pavot sur les exemplaires nord-alpins. Les deux groupes diffèrent également par leur arc : il est foliacé au sud des Alpes, rubané et décoré de stries parallèles sur les fibules de la variante nord-alpine. Les choix typologiques d’H. Parzinger nous paraissent pertinents, ce qui nous amène à modifier sensiblement les conclusions de C. F. E. Pare (Pare, 1989, p. 456, fig. 22) sur la répartition du type. Comme nous n’avons plus affaire à un groupe de fibules homogène ainsi que le pensait C. F. E. Pare mais à deux types parfaitement distincts, l’hypothèse d’une exporta-tion des fibules sud-alpines au nord des Alpes ne tient
Fig. 10. Carte de répartition des objets golasecciens (noir), de pendeloques à petit seau (rouge) datés des premières décennies du IVe siècle av. J.-C. (G.III A3) :
1. Lanslevillard, mur des Sarrasins (Savoie, F) ; 2. Corsier (canton de Genève, CH) ; 3. Saint-Sulpice, En Pétoleyres (canton de Vaud, CH) ; 4. Leukerbad (canton du Valais, CH) ; 5. Zeneggen (canton du Valais, CH) ;
6. Reckingen (canton du Valais, CH) ; 7. Chur, Markthallenplatz (canton des Grisons, CH) ; 8. Gamprin an der Halde (FL) ; 9. Dürrnberg bei Hallein (A) ; 10. Breno, t. 5 (Brescia, I) ; 11. Brescia, palazzo Martinengo (I) 12. Gardumo (Trento, I) ;
13. Este, Meggiaro (Padova, I) ; 14. Forcello (Mantova, I) ; 15. Sabbioneta, Villa Pasquali (Mantova, I) ; 16. Carpineti, Monte Fosola (Reggio Emilia, I) ; 17. Bismantova (Reggio Emilia, I) ; 18. Bologna, De Lucca 99 (Bologna, I) ;
19. Verucchio, pian del Monte (Forlì, I) ; 20. Populonia (Livorno, I) ; 21. Villa Collemandina (Lucca, I) ; 22. Pontecosi, Piazza al Serchio (Lugano, I) ; 23. Ameglia (La Spezia, I) ; 24. Genova, via Giulia (I).
Fig. 9. Répartition en pourcentage et par catégorie d’objets golasecciens découverts hors de leur territoire d’origine.
Stefania Casini, Bruno Chaume
244 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
plus. Les deux groupes paraissent d’ailleurs fonctionner de façon autonome ce qui n’exclut pas l’hypothèse d’in-fluences réciproques, toutefois difficiles à évaluer en l’état des données.
Les fibules à bec de canard ont d’abord été identifiées comme hallstattiennes et formant un ensemble relative-ment homogène (Vogelkopffibel) (Mansfeld, 1973, p. 90-91, p. 254-255) pour ensuite être réparties par O.-H. Frey (Frey, 1988, p. 37, p. 38, fig. 4) en des variantes, l’une nord-alpine (modèle à bec fermé), l’autre sud-alpine (modèle à bec ouvert).
Démonstration a été faite pour le type DP4 de Mansfeld que la quasi-totalité des exemplaires sud-alpins étaient d’origine locale (Chaume, 2001, p. 107, fig. 89). Nous avons aussi individualisé dans la vallée de l’Adige un type Mechel (fig. 12) qui n’a que très peu à voir avec les modèles hallstattiens desquels A.-M. Adam a voulu le rapprocher (Adam 1996).
Pour les fibules dP4 et F4 sud-alpins, le critère discri-minant est le renforcement du pied au niveau du porte-
ardillon (fig. 13), caractéristique que ne possède aucune fibule de type dP4 ou F4 au nord des Alpes. Parmi la série de fibules dP4 (à double timbale) d’Italie du Nord, seuls les exemplaires de la nécropole de la Certosa à Bologne se démarquent du groupe (Frey, 1971, p. 357, pl. 1, 5-6, p. 359, fig. 2, 10-13) ; leur porte-ardillon est tout à fait sem-blable aux exemplaires bourguignons ou franc-comtois.
Le détail technique sur le renforcement du pied suffit, selon nous, à démontrer que les fibules qui possèdent cette caractéristique typologique ont été produites au sud des Alpes. On comprendrait mal pourquoi les artisans des régions nord-alpines ne l’auraient pas mis en œuvre, s’ils en avaient eu connaissance, alors même qu’il est de nature à prolonger l’utilisation de la fibule en la rendant plus solide.
Ainsi la norme qui semble s’imposer actuellement va plutôt vers une bipartition des séries de fibules entre modèles nord et sud-alpins ; toutefois et néanmoins, cette règle souffre quelques exceptions. Certaines fibules découvertes en Italie du Nord sont indubitablement hallstattiennes et ont
Fig. 11. Carte de répartition des objets golasecciens (noir), des pendeloques à petit seau (rouge) datés de LT B1 : 1. Lamprechtskogel, Weisenberg (A) ; 2. Hausen am Tann, Lochenstein (D) ; 3. Münsinger Rain (canton de Berne) ;
4. Jona, Kempraten (canton de Saint-Gall, CH) ; 5. Schiers (canton des Grisons, CH) ; 6. Vadena (Bolzano, I) ; 7. Cles (Trento, I) ; 8. Serravalle all’Adige (Trento, I) ; 9. Vobarno, via Goisis (Brescia, I) ; 10. Archi di Castelrotto (Verona, I) ;
11. Montebello Vicentino (Vicenza, I) ; 12. Castellazzo della Garolda (Mantova, I) ; 13. Pianello Valtidone (Piacenza, I) ; 14. Genova, via Giulia, S. Silvestro (Genova, I).
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 245p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
franchi les Alpes dans le sens nord-sud à la fin du VIe et dans la première moitié du Ve siècle av. J.-C. Leur nombre se réduit à quelques unités.
Il en est ainsi des fibules du type de Vix (Chaume, 2001, p. 122, fig. 99) (fig. 14) et de certaines fibules de type dP4 (fibules à double timbale) (Chaume, 2001, p. 106, fig. 88). Dans ces deux cas nous avons clairement affaire à des exemplaires hallstattiens qui sont parvenus en Italie du Nord, probablement par la vallée du Tessin et
via les cols du Saint-Bernard et/ou du Simplon, si on en juge par les quelques jalons (Gamsen, Arbedo, Gudo) connus qui s’égrènent sur le parcours menant en Italie septentrionale depuis la zone hallstattienne.
Parmi le groupe de fibules du type F1 C de la classi-fication de G. Mansfeld (Mansfeld 1973 : 143, 238-239), nous avons individualisé un modèle particulier que nous nommons type Heuneburg (Chaume, Ney à paraître) (fig. 15). Deux fibules de ce type sont présentes dans la tombe 311 de la Certosa à Bologne (Frey, 1971, p. 357, pl. 1, p. 359, fig. 2, nos 14-15, p. 376 ; Vitali, 1992, p. 99-100, tav. 2, p. 420) ; en revanche, nous considérons les exemplaires de Gamsen (Curdy et alii, 1993, p. 148, fig. 22, 4, Benkert et alii, 2010, p. 94, fig. 13, 7) et de Forcello (de Marinis, 1987, p. 92, fig. 4, d) comme des imitations du type éponyme.
Si on élargit un peu la sphère d’étude vers l’est, des situations similaires s’observent mais cette fois-ci dans le sens sud-nord avec comme point de départ l’actuelle Slovénie. Biba Teržan a montré pour les fibules du type Certosa, l’extrême complexité des situations avec l’exis-tence de nombreuses variantes locales. Le type X de sa
Fig. 12. Carte de répartition des fibules de type Mechel et autres variantes sud-alpines. 1, Mechel Valemporga (Trento, I) ; 2, Mechel Vallemporga (Trento, I) ; 3, Dercolo (I) ; 4, Sanzeno (I) ; 5, Borgo Valsugana (Trento, I) ; 6, Merano Hochbühel (I) ; 7, Molinazzo (Canton du Tessin, CH) ; 8, Vandoies-di-Sopra (Bolzano, I) ; 9, Gazzo Veronese (Verona, I) ;
10, Magdalenska gora (SLO) ; 11, Hallstatt (A).
Fig. 13. Exemples de renforcement du porte-ardillon sur des fibules provenant de Trente (dessins originaux empruntés à
A.M. Adam, 1996, p. 282, pl, 1, 10-11).
Stefania Casini, Bruno Chaume
246 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 14. Carte de répartition des fibules de type Vix. 1, Vix/le mont Lassois (Côte-d’Or, F) ; 2, Talant, La Peute-Combe, (Côte-d’Or, F) ; 3, Ivory (Jura, F) ; 4, Haguenau (Bas-Rhin, F.) ;
5, Schirrhein (Bas-Rhin, F) ; 6, Ihringen (D) ; 7, Krozingen (D) ; 8, Pfinztal (D) ; 9, Langenlonsheim (D) ; 10, Römhild (D) ; 11, Wohlen (canton d’Argovie, CH) ; 12, Gamsen (canton du Valais, CH) ; 13, Arbedo (canton du Tessin, CH) ;
14, Forcello (Bagnolo San Vito, Mantoue, I).
Fig. 15. Fibules du type Heuneburg provenant du site éponyme (dessins originaux dans G. Mansfeld 1973, 1-2, 4, pl. 10, 80-82 ; 3, pl. 20, 770).
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 247p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
classification, par exemple, a une aire de répartition qui est centrée sur le domaine golaseccien et le Tessin (Teržan, 1976, p. 363) mais il a été largement diffusé en secteur nord-alpin, en Suisse principalement.
Si la chorologie des fibules offre souvent une vision globale, elle ne permet pas toujours de préciser le sens de circulation des objets. Tel est le cas pour les fibules de type Grattenbergl (Gleirscher, 1986, p. 322, fig. 6). Celles-ci se distribuent grosso modo selon un axe reliant la Slovénie à la Champagne, avec un groupe oriental (Slovénie-Autriche) et un bloc occidental (Jura, Champagne). Cette diffusion bipolaire présente un grand vide sur les zones où sont censés transiter les objets concernés par les échanges transalpins (Italie du Nord et Suisse) si bien qu’il est impossible de tirer des enseignements sur l’origine du type et sa diffusion.
coNcluSioN
Au terme de notre analyse, force est de constater que la conclusion à laquelle était parvenue O.-H. Frey en 1971 est toujours valide. Les quelques faits nouveaux recueillis depuis ne remettent pas en cause le constat initial. Même si le port des fibules dans le domaine hallstattien n’était pas l’apanage exclusif des femmes, les hommes les arbo-raient également, les données que nous avons rassemblées ici sont compatibles avec l’hypothèse émise dans le pré-
ambule de cet article sur la mobilité des personnes, des femmes en particulier, dans le cadre des échanges transal-pins. Que cette mobilité ait pour origine des pratiques exogamiques ou plus simplement des motifs commerciaux au sens large du terme, les fibules hallstattiennes ayant franchi les Alpes demeurent très rares.
Durant le VIe siècle av. J.-C., les échanges axés sur le système des « gift trade » laissent graduellement la place à des formes plus diversifiées et surtout mises en œuvre avec une plus grande fréquence, dans le cadre de l’écono-mie-monde (Brun, 1991, p. 325-329 ; Brun, 1992, p. 189-192 et p. 196-201) qui présuppose l’existence de « centres-moteurs » cherchant à obtenir des produits non disponibles localement, et de centres intermédiaires assu-rant le transfert de ces produits sur de longues distances, même sans monnaie. Dans ce réseau complexe de rela-tions à longue distance entre la Méditerranée et l’Europe centrale, la culture de Golasecca a eu un rôle d’intermé-diaire comme le montrent les nombreuses importations de la zone méditerranéenne – la vaisselle étrusque de bronze (Schnabelkannen, situles stamnoïdes, stamnoi, kyathoi, cistes, passoires…), la céramique attique, le corail, l’en-cens arabique et beaucoup d’autres (de Marinis, 1986, 1988, 2008 ; Casini, 1986, 2007). Il semble indubitable qu’une telle dynamique modifia les stratégies d’alliance et les pouvoirs territoriaux qui avaient cours aux siècles précédents.
aDam a.-m., 1992, « Signification et fonction des fibules dans le cadre des relations transalpines du VIIIe au Ve siècle avant notre ère », in : aigNer foreSti l.a. dir., Etrusker nördlich von Etrurien, Etruskische Präsenz in Norditalien und nördlich der Alpen sowie ihre Einflüsse auf die einhei-mischen Kulturen, Symposium, château de Neuwaldegg, Vienne, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist., p. 389-409 (Klasse, Sitzungsberichte, 589).
aDam a.-m., 1996, Le fibule di tipo celtico nel Trentino. Trente, Provincia autonoma di Trento, 312 p., 25 pl. (Patrimonio storico artistico del Trentino, 19).
aDam r., 1992, « L’apport d’objets italiques dans le Jura : voie unique ou voies alternatives ? », in : KaeNel g., curDy P. dir., L’âge du fer dans le Jura, actes du 15e colloque de l’A.F.E.A.F., Pontarlier, 9-12 mai 1991, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, p. 181-187 (Cahiers d’Archéologie Romande, 57).
beilKe voigt i., 1998, Frühgeschichtliche Miniaturobjecte mit Amulettcharakter zwischen Britischen Inseln und Schwarzem Meer, Bonn, Dr Rudolf Habelt, 342 p., 104 Abb., 42 Taf., 18 Ktn, 1 Faltkte (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, 51).
beNKert a., curDy P., ePiNey-NicouD c., KaeNel g., mac cullough f., mauvilly m., ruffieux m., 2010, « Ze ra-lisierungsprozess und Siedlungsdynamik in der Schweiz
(8.–4. Jh. v. Chr.) », in : KrauSSe D. dir., « Fürstensitze » und Zentralorte der frühen Kelten, Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 (Stuttgart 12-15 Oktober 2009), Stuttgart, 2010, p. 79-118.
bichet P., millotte j.-P., 1992, « L’âge du Fer dans le haut Jura : les tumulus de la région de Pontarlier (Doubs) », Paris, éd. de la Maison des sciences de l’Homme, 154 p., ill., tab., cartes (Documents d’archéologie française, 34).
bocquet a., 1991, « L’archéologie de l’âge du Fer dans les Alpes occidentales française » in : Duval a. dir., Les Alpes à l’âge du Fer, actes du Xème colloque de l’A.F.E.A.F., Yenne-Chambéry, 1986, Paris, éd. C.N.R.S., p. 91-155 (Revue archéologique de Narbonnaise, suppl. 22).
bruN P., 1991, « Systèmes économiques et organisations sociales au premier âge du Fer dans la zone nord-alpine », in : Duval a. dir., Les Alpes à l’âge du Fer, actes du Xème colloque de l’A.F.E.A.F., Yenne-Chambéry, 1986, Paris, éd. C.N.R.S., p. 325-329 (Revue archéologique de Narbonnaise, suppl. 22).
bruN P., 1992, « La place du Jura franco-suisse dans l’écono-mie-monde méditerranéenne au Premier âge du Fer : essai de modélisation », in : KaeNel g., curDy P. dir., L’âge du fer dans le Jura, actes du 15e colloque de l’A.F.E.A.F., Pontarlier, 9-12 mai 1991, Lausanne, Bibliothèque histo-rique vaudoise, p. 189-192 et 196-201 (Cahiers d’Archéo-logie Romande, 57).
BIBLIOGRAPHIE
Stefania Casini, Bruno Chaume
248 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
caSiNi S., 1986, « Le importazioni di V sec. a. C. nella cultura di Golasecca », in : De mariNiS r.c. dir., Gli Etruschi a nord del Po, II, Catalogo della Mostra, Mantova, p. 31-36.
caSiNi S., 1998, « Ritrovamenti ottocenteschi di tombe della cultura di Golasecca nel territorio bergamasco », Notizie Archeologiche Bergomensi, 6, p. 11-27.
caSiNi S., 2000, « Il ruolo delle donne golasecchiane nei com-merci del VI-V sec. a.C. », in : De mariNiS r.c., biaggio SimoNa S. dir., I Leponti tra mito e realtà, 2, Locarno, Dadò Editore, p. 75-100.
caSiNi S., 2007, « L’area di Golasecca e i passi alpini : conside-razioni sulla presenza di manufatti greci », in : tarDiti c. dir., Dalla Grecia all’Europa. La circolazione di beni di lusso e di modelli culturali nel VI e V sec. a.C., Atti della giornata di Studi, Brescia, 3 marzo 2006, Milano, p. 97-176.
caSiNi S., 2011, « Le fibule a coste rinvenute a Bologna. Nuovi spunti di riflessione », Notizie Archeologiche Bergomensi, 19, p. 257-270.
chaume b., 2001, Vix et son territoire à l’âge du Fer. Fouilles du mont Lassois et environnement du site princier, Montagnac, Librairie archéologique, 643 p., 238 ill., 155 pl. (Collection Protohistoire européenne, 6).
chaume b., Ney W. à paraître, « Les fibules de type Heuneburg », Archäologisches Korrespondenzblatt.
chieco biaNchi a.m., calzavara l., De miN M., tombolaNi M., 1976, Proposta per una tipologia delle fibule di Este, Firenze, Leo S. Olski ed., 70 p., Biblioteca di Studi Etruschi, 9.
coNraDiN e., 1978, « Das späthallstättische Urnengräberfeld Tamins-Unterm Dorf in Graubünden », Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 61, 1978, p. 65-155.
curDy P., mottet m., NicouD c., bauDaiS D., luNDStröm-bauDaiS K., mouliN b. 1993,, « Brig-Glis/Waldmatte, un habitat alpin de l’âge du Fer. Fouilles archéologiques N9 en Valais », Archéologie suisse, 16, 1993, 4, p. 138-151.
De mariNiS r.c., 1970, « Note relative alla cronologia della Cultura di Golasecca », Rassegna Gallaratese di Storia e Arte, XXIX, p. 110-111/2-3.
De mariNiS r.c., 1971-72, « Ritrovamenti dell’età del Bronzo Finale in Lombardia, Contributo alla suddivisione in periodi del Protogolasecca », Sibrium, XI, p. 53-98.
De mariNiS r.c., 1975, « Le tombe di guerriero di Sesto Calende e le spade e i pugnali hallstattiani scoperti nell’Ita-lia nordoccidentale », in : Archaeologica, Scritti in onore di A. Neppi Modona, Olschki, Firenze, p. 213-269.
De mariNiS r.c., 1981, « Il periodo Golasecca III A in Lombardia », in : Studi Archeologici, I, Bergamo, p. 41-303.
De mariNiS r.c., 1986, « I commerci dell’Etruria con i paesi a nord del Po dal IX al VI sec. a.C. », in : De mariNiS r.c. dir., Gli Etruschi a nord del Po, I, Mantova, Comune di Mantova, p. 52-89.
De mariNiS r.c., 1987, « Fibule tardohallstattiane occidentali dell’abitato etrusco del Forcello (Bagnolo S. Vito) » in : vitali D. dir., Celti ed Etruschi nell’Italia centro-setten-trionale dal V secolo a. C. alla romanizzazione, Actes du colloque international, Bologne 1985, Imola, Santerno Edizioni, p. 89-99.
De mariNiS r.c., 1988, « Liguri e Celto-Liguri », in : PuglieSe carratelli g. dir., Italia Omnium Terrarum Alumna, Antica Madre, Collana di Studi sull’Italia antica, Milano, p. 159-259.
De mariNiS r.c., 1995, « La tomba 289 della Ca’ Morta e l’ini-zio dell’Età del Ferro nelle necropoli dei dintorni di Como », in : Trans Europam : Beiträge zur Bronze- und Eisenzeit zwischen Atlantik und Altai, Festschrift für Margarita Primas, Bonn, R. Habelt, p. 93-102.
De mariNiS r.c., 1999a, « Rapporti culturali tra Reti, Etruria padana e Celti golasecchiani », in : I Reti, Trento, Arge Alp, p. 603-649 (Archeologia delle Alpi, 5).
De mariNiS r.c., 1999b, « La tomba del tripode di Sesto Calende », in : Riti e culti nell’età del Ferro, Sesto Calende, p. 17-28.
De mariNiS r.c., 2000, « Il corallo nella cultura di Golasecca », in : morel j.-P., roNDi coStaNzo c., ugoliNi D. dir., Corallo di ieri corallo di oggi, Atti del Convegno (Ravello, Villa Ruffolo, 13-15 dicembre 1996), Bari, Edipuglia, p. 159-175.
De mariNiS r.c., 2002, « L’età del Ferro in Lombardia : stato attuale delle conoscenze e problemi aperti », in : La Protostoria in Lombardia, Atti del 3° Convegno archeolo-gico regionale (Como 22-24 ottobre 1999), Como, Società Archeologico Comense, p. 27-76.
De mariNiS r., 2008, « Aspetti degli influssi dell’espansione etrusca in Val padana verso la civiltà di Golasecca », Annali Fondazione Faina, XV, Orvieto, p. 115-146.
De mariNiS r.c., 2009, « La culture de Golasecca : une histoire de plusieurs siècles. Signes de pouvoir et de richesse à Golasecca : du monde des morts à celui des vivants », in : Golasecca. Du commerce et des hommes à l’âge du Fer (VIIIe-Vesiècle av. J.-C.), Paris, Réunion des Musées Nationaux, p. 38-55.
De mariNiS r.c., Premoli Silva D., 1969, « Revisione di vecchi scavi nella necropoli della Ca’ Morta », Rivista Archeologica dell’Antica Provincia e Diocesi di Como, p. 150-151, 1968-69, p. 99-200.
DuNNiNg c., 1991, « Parures Italiques sur le Plateau Suisse », in : Duval a. dir, Les Alpes à l’âge du Fer, actes du X ème
colloque de l’A. F. E. A. F., Yenne-Chambéry, 1986. Paris, éd. du C.N.R.S., p. 367-377 (Revue archéologique de Narbonnaise, suppl. 22).
frey o.-h., 1971, « Fibeln vom westhallstättischen Typus aus dem Gebiet südlich der Alpen, zum Problem der keltischen Wanderung », in : Oblatio. Raccolta di studi antichità ed arte in onore di Aristide Calderini. Como, società archeo-logica comense, p. 355-386.
frey o.-h., 1988, « Les fibules hallstattiennes de la fin du VIe siècle au Ve siècle en Italie du Nord », in : Les Princes celtes et la Méditerranée, Actes du colloque international du Grand Palais, Paris, La Documentation française, p. 33-43 (Rencontres de l’Ecole du Louvre).
gambari f.m., 1979, « Le Roveri », in : La necropoli villano-viana di Ca’ dell’Orbo a Villanova di Castenaso, Catalogo della mostra, Bologna, p. 63-72.
gambari f.m., 1986, « Castelletto Ticino (NO) : tomba del Bacile », in : De mariNiS r.c. (a c. di), Gli Etruschi a nord del Po, I, Catalogo della mostra, Mantova, pp. 81-84.
IndIces de mobIlIté au PremIer Âge du fer entre le sud et le nord des alPes
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 249p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
gambari f.m., 1993, « Il bucchero etrusco nei contesti piemon-tesi della prima età del Ferro », in : boNghi joviNo m. dir., Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero etrusco, Atti del Colloquio Internazionale, Milano (10-11 maggio 1990), Milano, p. 127-146.
gambari m.f., coloNNa m., 1988, « Il bicchiere con iscrizione arcaica da Castelletto Ticino e l’adozione della scrittura nell’Italia nord-occidentale », Studi Etruschi, LIV, pp. 121-164.
gleirScher P., 1986, « Eine Fußzierfibel vom Grattenbergl bein Wörgl, Tirol », Bayerische Vorgeschichtblätter, 51, p. 313-323.
gleirScher P., 1994, « Zum etruskischer Fundgut zwischen Adda, Etsch und Inn », Helvetia Archaeologica, 93/94, p. 69-105.
groSS N., haffNer a., 1969, « Ein Gräberfeld der jüngeren Hunsrück-Eifel-Kultur von Losheim, Kreis Merzig-Wadern », Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland, 16, p. 61-103.
heNNig h., 1992, Zwei hallstattzeitliche Grabhügel aus dem Berner Mittelland. Thunstetten-Tannwäldli und Urtenen-Buebeloo/Chrache. Bern, Staatlicher Lehrmittelverlag, 60 p. : 4 pl., 47 fig. (Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern).
hoDSoN f.r., 1968, The La Tène Cemetery at Münsingen-Rain. Catalogue and Relative Chronology, Berne, Verlag Stämpfli & Cie AG Bern. 168 p., 122 pl., 1 tableau (Acta Bernensia, 5).
KaeNel g., 1990, Recherches sur la période de La Tène en Suisse occidentale : analyse des sépultures. Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise. 457 p., ill., 91 pl. (Cahiers d’Archéologie romande, 50).
Koller h., 1998, « Die Gräber der Späthallstattzeit im Freiamt (Kt Aargau) », Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 81, p. 119-170.
KriStiaNSeN K., 1981, « Economic models for Bronze Age in Scandinavia : towards an integrated approach », in : SheriDaN a., bailey g. dir., Economic Archaeology : towards an integration of ecological and social approaches, Oxford, pp. 239-303, (British Archaeological Reports, Int. Series, 96).
KriStiaNSeN K., 1998, « Europe before History », Cambridge, Cambridge University Press, 440 p., 200 fig.
La Romagna, 1985, voN eleS maSi P. dir., 1985, La Romagna tra VI e V sec. a.C. La necropoli di montericco e la protos-toria romagnola, Bologna, University Press. 385 p.
Liguri, 2004, De mariNiS r.c., SPaDea g. dir., I Liguri. Un antico popolo tra Alpi e Mediterraneo, Catalogo della mos-tra, Genova, Palazzo Ducale, 23 ottobre 2004-23 gennaio 2005, Skira Ed., 655 p.
lorrio A.J., 1997, Los Celtiberos, Madrid/Alicante, Universidad Complutense de Madrid/Universidad de Alicante, 1997, 454 p. (Complutum Extra, 7).
macellari r., 1994, « Una nuova iscrizione etrusca da Bologna », Ocnus, 2, Bologna, p. 97-105.
maNSfelD g., 1973, « Die Fibeln der Heuneburg 1950-1970 : eine Beitrag zur Geschichte der Späthallstattfibel », Berlin, Walter De Gruyter & Co., 299 p., 21 pl., 13 cartes, 2 dépl. (Heuneburg-studien II, Römisch-Germanische Forschungen, 33).
melli P., 2004, « Genova. Dall’approdo del Portofranco all’em-porio dei Liguri », in : Liguri, 2004, p. 285-297.
meNotti e.m., 2011, Gli Etruschi e Mantova, Museo Archeologico Nazionale di mantova, Catalogo della mostra (14 aprile-31 marzo 2011), Mantova, 15 p.
Pare c.f.e., 1989, « Ein zweites Fürstengrab von Apremont “La Motte aux Fées” (Arr. Vesoul, Dép. Haute-Saône). Untersuchungen zur Späthallstattkultur im ostfranzösischen Raum », Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral-museums, 36, p. 411-472, pl. 34-36.
ParziNger h., 1988, Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatène-Zeit : Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save, Weinheim, VCH, Acta humaniora, 361 p., 174 pl., 1 dépl. (Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie, 4).
Pauli l., 1971, Die Golasecca-Kultur und Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Geschichte des Handels über die Alpen. Hamburg, Helmut Buske Verlag, 58 p., 7 cartes (Hamburger beiträge zur Archäologie, 1).
Pauli l., 1978a, « Fremdformen im Frauengrab 44 », in : Das keltische Gräberfeld bei Jenišův Újezd in Böhmen, Teplice, p. 93-102.
Pauli l., 1978b, « Der Dürrnberg bei Hallein III : Auswertung der Grabfunde », München, C. H. Beck’sche Verlags-buchhandlung.
Peyre c., 2007, « Les migrations celtiques vers l’Italie d’après le témoignage de Tite-Live, in : meNNeSSier-jouaNNet c., aDam a.-m., milceNt P.-y. dir., La Gaule dans son contexte européen aux IVe et IIIe s. av. n. è., actes du 27e colloque international de l’A.F.E.A.F, Clermont-Ferrand, 29 mai-1er juin 2003, Lattes, éditions de l’association pour le développement de l’archéologie en Languedoc, p. 363-375 (Monographies d’archéologie méditerranéenne, 22).
PiNcelli r., morigi govi c., 1975, La necropoli villanoviana di San Vitale, Fonti per la storia di Bologna, Bologna.
Sant’Ilario d’Enza, 1989, AmbroSetti G. dir., Sant’Ilario d’Enza. L’età della colonizzazione etrusca : strade, villagi, sepolcreti, Reggio Emilia (Archaeologica Regiensia, 3).
SaSSatelli g., 1989, « Ancora sui rapporti tra Etruria padana e Italia settentrionale : qualche esemplificazione », in : Gli Etruschi a nord del Po, Atti del Convegno di Mantova (4-5 ottobre 1986), Accademia Nazionale Virgiliana, Mantova, p. 49-81.
Schaaff u., 1965, Fibel- und Ringschmuck im westlichen Frühlatènekreis. Versuch einer Gruppengliederung. Thèse de doctorat dactylographiée sous la direction du prof. Dr W. Dehn. Marburg/Lahn, Université de Marburg, 325 p., 33 pl., 33 cartes.
Schaaff u., 1972, « Zur Tragweise keltischer Hohlbuck-elringe », Archäologisches Korrespondenzblatt, 2, 1972, p. 155-158.
SchiNDler m.P., 1998, « Der Depotfunde von Arbedo TI und die Bronzedepotfunde vom 6. bis zum Beginn des 4. Jh.v.Chr. », Bâle, Verlag Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 472 p., 81 pl. (Antiqua, 30).
Stefania Casini, Bruno Chaume
250 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 231-250 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Schmid-Sikimić B., 1991, « L’âge du Fer dans le Canton des Grisons (Suisse) », in : Duval a. dir, Les Alpes à l’âge du Fer, actes du X ème colloque de l’A. F. E. A. F., Yenne-Chambéry, 1986. Paris, éd. du C.N.R.S., p. 379-399 (Revue archéologique de Narbonnaise, suppl. 22).
Schmid-Sikimić B., 1996, Der Arm- und Beinschmuck der Hallstattzeit in der Schweiz, Stuttgart, (Prähistorische Bronzefunde, X, 5).
Teržan B., 1977, « Certoška fibula (Die Certosafibel) », Arheološki vestnik, 27, p. 317-536.
teSSmaN b., 2007, « Körbenanhänger im Süden - Göritzer Bommel im Norden. Eine vergleichende Studie zu einem späthallstattzeitlichen Anhängertyp », in : Scripta Praehis-torica in Honorem Biba Teržan, Narodni Muzej Slovenije, 2007, p. 667-694 (Situla, 44).
vitali D., 1992, Tombe e necropoli galliche di Bologna e del territorio, Imola, Comune di Bologna, Museo Civico Archeologico di Bologna, 415 p., 75 pl.
vitali D., 1998, « I Celti e Spina », in : rebecchi f. dir., Spina e il delta padano, Roma, p. 253-273.
voN eleS maSi P., 1986, Le fibule dell’Italia settentrionale, München, (Prähistorische Bronzefunde, XIV/5).
Willaume m., 1985, Le Berry à l’âge du Fer Ha C - La Tène II : précédé du catalogue des collections de l’âge du Fer du Musée de Bourges, Oxford, 293 p., 43 pl. (British Archeological Report, International Series, n° 247).
WilligeNS m.-P., 1991, « L’âge du Fer en Savoie et Haute-Savoie », in : Duval a. dir., Les Alpes à l’âge du Fer, actes du Xème colloque de l’A. F. E. A. F., Yenne-Chambéry, 1986. Paris, éd. du C.N.R.S., p. 157-226 (Revue archéologique de Narbonnaise, suppl. 22).
zaNNoNi a., 1876-94, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna, Regia Tipografia, 479 p., 56 pl.