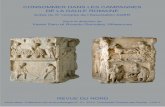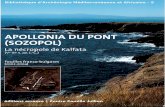Légitimité et déviance. L’annulation des votes dans les campagnes de la IIIe République
-
Upload
sciencespo-grenoble -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Légitimité et déviance. L’annulation des votes dans les campagnes de la IIIe République
Yves DéloyeOlivier Ihl
Légitimité et déviance. L'annulation des votes dans lescampagnes de la IIIe RépubliqueIn: Politix. Vol. 4, N°15. Troisième trimestre 1991. pp. 13-24.
Citer ce document / Cite this document :
Déloye Yves, Ihl Olivier. Légitimité et déviance. L'annulation des votes dans les campagnes de la IIIe République. In: Politix.Vol. 4, N°15. Troisième trimestre 1991. pp. 13-24.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_1991_num_4_15_1462
Légitimité et déviance L'annulation des votes dans les campagnes de la Ille République
INTERROGER L'UNITE DU SUFFRAGE qu'est le bulletin de vote ouvre à la réflexion un pan qui peut encore aujourd'hui passer pour anecdotique : celui des
technologies au travers desquelles l'acte de vote s'est à la fois manifesté et défini. S'il est chargé d'assurer la représentation politique des électeurs, il ne faudrait point l'oublier, le vote est aussi quelque chose de matériel : un bulletin choisi, en France depuis 1914, dans l'atmosphère feutrée d'un isoloir mais qui était auparavant confectionné par le votant lui-même à l'extérieur du bureau de vote1. Rédigés souvent à la main sur des morceaux de papier dont ni le format, ni la texture n'étaient réglementés, ces bulletins faisaient donc l'objet d'une appropriation particulièrement instructive pour saisir les conditions d'expérimentation du suffrage universel. C'est notamment le cas à la fin du siècle dernier, au moment où l'avènement de la Ille République consacre la mise en place d'un modèle nouveau de citoyenneté.
Parmi les bulletins de vote, les plus riches d'enseignement sont assurément ceux qui, accumulant les indices de suspicion, ont été annulés par les assemblées électorales2. Réputés soit "fantaisistes", soit "blancs", soit encore contraires aux règles délimitant la normalité du vote, ils paraissent a priori pleinement justifier l'usage qui les faits appeler des "voix perdues"-^. Ne s'avèrent-ils pas encombrants lors de la mise en forme, puis lors de la proclamation des résultats ? Les signes et notations, au
1. Le bulletin était remis à découvert, mais plié, au président du bureau de vote qui, après avoir vérifié s'il n'en renfermait pas d'autres, l'introduisait dans l'urne (Cf. Guerlin de Guer, Manuel électoral de l'électeur et du maire, Paris, Berger-Levrault, 1889, p. 163). Sur le contexte et les conséquences de l'apparition de l'isoloir ou de l'enveloppe, voir Garrigou (A.), "Le secret de l'isoloir", Actes de la recherche en sciences sociales, n°71-72, 1988, p. 22-45. 2. Alain Lancelot fournit des indications chiffrées pour les élections comprises entre 1877 et 1965. Leur nombre va de 36 732 (résultat le plus bas) en 1885 à 1 098 238 (résultat le plus élevé) au référendum d'avril 1962, avec une moyenne établie autour de 450 000. Il convient néanmoins d'insister sur l'extrême fragilité de ce type de données compte tenu des changements intervenus dans les opérations de vote elles- mêmes - usage de l'enveloppe, variation de la notion de "suffrage exprimé", obligation de déclaration des candidatures en 1889... (Lancelot (A.), L'abstentionnisme électoral en France, Paris, Armand Colin, 1968, p. 50). 3. Seule dissonance par rapport à cette manière de voir : celle exprimée par les tenants du vote obligatoire, pour qui les bulletins blancs, traduisant une volonté d'accomplir son devoir civique, devaient entrer en compte dans la détermination du nombre des votants. Voir, par exemple, la proposition de loi Bardoux {Journal Officiel, Chambre des députés, 13 juillet 1880, p. 10940).
nom desquels de tels votes ont pu être invalidés, en disent toutefois plus sur les modalités d'apprentissage du savoir faire électoral en cours d'institutionnalisation que l'ensemble des voix tenues pour conformes4. Dans ces traces qui forment comme les symptômes d'une déviance électorale, se découvre, en effet, la nature des résistances rencontrées par ce jeune rite social qu'était, en ces années, le suffrage universel. Ce qui s'y observe avec force ce sont les parts du prescrit et du vécu qui sous-tendent les opérations électorales. D'un côté, se dégagent comme en négatif les critères de normalité qui ont justifié la mise à l'écart de telles voix, autrement dit l'ensemble des règles et des exigences traduisant l'idéal promu par les républicains dans les campagnes en matière de comportement électoral. Les leçons que leur consacrent les manuels de morale et d'instruction civique fournissent d'ailleurs un indicateur explicite de ce volontarisme, comme on le verra plus loin. De l'autre, se dévoilent certains des usages, certaines des attentes qui pouvaient régir localement l'emploi du bulletin de vote.
C'est évidemment au sein du monde paysan, ce lieu où se décide désormais le sort des grandes batailles politiques, que les utilisations du bulletin sont les plus réfractaires au modèle de citoyenneté républicaine. Aussi est-ce lui qui retiendra ici l'attention. Mais, plutôt que de trouver dans ces réticences la preuve d'une incompétence politique, ou d'une indifférence coupable, l'examen des bulletins annotés pousse à évoquer l'idée d'une compétence sui generis. Une compétence marquée par d'autres enjeux, et surtout inscrite dans un autre registre que celui développé par les hommes au pouvoir. Il suggère, en somme, que le thème de la politisation des campagnes au XIXe siècle doit moins être compris comme l'éveil d'un intérêt jusque là inédit pour les questions politiques que comme la substitution d'un autre répertoire politique à un ensemble de pratiques rendues brusquement illégitimes par l'imposition de nouvelles règles du jeu^.
4. La loi imposant aux présidents des bureaux de vote d'annexer à leur compte rendu les bulletins "douteux ou nuls", il est possible d'étudier de près leur contenu. C'est ce qui a été réalisé, dans le cadre de cette enquête, pour les élections législatives des 21 août et 4 septembre 1881, à partir des procès-verbaux de quelque trente-cinq départements. Ce sont les résultats de ces dépouillements qui servent à étayer nos hypothèses. Pour une présentation d'ensemble de ce travail, voir notre article : Deloye (Y.), Ihl (O.), "Des voix pas comme les autres. Votes blancs et votes nuls aux élections législatives de 1881", Revue française de science politique, n°2, 1991. 5. Dans son pamphlet La lutte électorale de 1863, J. Ferry opposait la France politisée des élites urbaines à la France des paysans, une France "locale, étroite, intéressée, timide" dans
Politix, n°15, 1991 13
Yves Deloye, Olivier Ihl
Querelles de légitimité : autour du "bon" usage
du bulletin de vote
A la fin du XIXe siècle, la société rurale française affronte une situation de crise multiforme1. Au centre de ce bouleversement se trouve la volonté de promouvoir de façon durable la forme républicaine en France. Eclairés par l'expérience cruelle de 1848, les républicains savent qu'ils ne peuvent réussir cette entreprise qu'en gagnant les voix des campagnes. Ils doivent impérativement métamorphoser les paysans en citoyens et ce faisant, leur inculquer une image socialement convenable de leurs devoirs d'électeurs. Le paysan devra, en particulier, apprendre à respecter le caractère sacré qu'acquiert, à l'époque, le bulletin de vote et en user en conséquence : "Citoyens! les élections sont proches, l'avenir de la République en dépend. Montrons- nous dignes fils des géants de 89, en défendant à coups de bulletin de vote, les précieuses conquêtes qu'ils nous ont léguées, au prix de tant d'abnégation et de sang!"2.
Disons-le sans attendre : la modification du comportement politique qui est visée à travers la diffusion de ce type de formule ne sera pas immédiate. Avant de devenir un comportement s'imposant à tous, de nombreuses conceptions et pratiques de l'acte de vote s'opposeront. L'école républicaine occupe une place centrale dans cette entreprise d'acculturation. Eparpillées, disséminées à travers la campagne française qu'elles structurent, ces écoles constituent, aux yeux des républicains, autant de lieux différenciés et pourtant uniformes d'affirmation des valeurs républicaines et d'intégration à la communauté nationale ; chacune a sa zone d'influence, son territoire géographique, son champ d'action3.
laquelle les questions politiques ne suscitent qu'une "douce apathie" (Ferry (J.), La lutte électorale de 1863, Paris, 1863, p.
10 et 43). Ce préjugé, alors largement partagé, continue d'être vivace. Ainsi, l'histoire des bulletins nuls a pu être présentée comme celle d'une "politisation" progressive de leur message, au lendemain du référendum d'avril 1972. Aux votes annulés aujourd'hui, à forte teneur idéologique, s'opposeraient les bulletins "d'autrefois" qui ne contenaient que "des doutes sur la virilité du maire, la vertu de la femme du chef de gare ou l'honnêteté du boulanger" {Le Monde, 27 avril 1972, p. 7). 1. Sur les différents aspects de cette crise, voir Moulin (A.), Les paysans dans la société française. De la révolution à nos jours, Paris, Seuil, 1988, p. 118 et s. 2. Martin (G.), Du suffrage universel considéré dans ses erreurs et leurs conséquences, Paris, "Se trouve chez le citoyen Zion", 1885, p. 31. 3. Cette politique d'expansion scolaire ne sera pas sans provoquer certaines oppositions de la part de notables ruraux. En atteste cette profession de foi : "Ce n'est pas l'école que nous refusons d'accepter ; c'est l'enseignement qu'on y donne ; ce n'est pas l'instituteur que nous repoussons ; c'est l'agent du gouvernement"(cité dans La politique au village à l'approche des élections, 1ère livraison, Paris, 1889, p. 15).
Une lecture attentive des manuels de morale et d'instruction civique permet de préciser les principales qualités qui feront des ruraux de "bons citoyens". Parce qu'ils se donnent pour objet de transmettre un nouveau savoir civique et, par la même, de procéder à une inculcation morale et politique explicite, ces manuels soulignent le caractère valorisant de la participation au scrutin et dénoncent parallèlement les pratiques déviantes comme l'abstention4. Les manuels ne se contentent pas de recourir à des injonctions, ils dessinent également les contours de la normalité en matière de comportement électoral.
Alfred Mézière introduit son chapitre consacré au vote de la manière suivante : "II doit être libre, consciencieux, éclairé, désintéressé"5. Les quatres adjectifs traduisent, pour les républicains, les principaux traits sans lesquels la citoyenneté ne pourrait s'accomplir. L'accent est, tout d'abord, porté sur l'indépendance de l'électeur. Le soutien massif que les paysans ont apporté au Second Empire suscite craintes et soupçons. Aussi, les campagnes sont- elles alors décrites comme solidement tenues par un système d'encadrement qui contrôle sans relâche les votes ruraux. Pour briser ce système, les républicains tentent de promouvoir en chacun des paysans l'idée d'une conscience libre, dénouée des loyautés primaires qui enfermaient jusqu'alors le jugement. Ils proposent l'image d'un individu apte à choisir de façon indépendante et raisonnée son candidat. Lorsque "le paysan", déclare Léon Gambetta dans son célèbre discours de Belleville, "sentira lui-même, de son "tout seul", comme il dit familièrement, qu'il est maître en sa cabane et qu'il faut qu'il le soit en sa commune car il nourrit, travaille, peine et se fait tuer pour la France, quand (il) (...) sera arrivé à la véritable conception de sa souveraineté, ce jour-là la République sera indestructiblement fondée"6.
Pour ce faire, l'électeur doit prendre conscience de sa dignité et ne céder à aucune tentative d'intimidation ou de corruption. C'est la seconde exigence. Les manuels ne cessent de dénoncer les pratiques issues du clientélisme et qui maintenaient prisonnière la souveraineté des campagnes : "Vendre sa voix dans une élection, c'est pire encore que vendre son honneur, car, en définitive, celui qui vend son honneur ne fait tort qu'à lui-même; celui qui vend sa voix
4. Le manuel rédigé par H. Marion stigmatise ainsi les abstentionnistes : "S'abstenir faute d'avoir un avis ou faute d'oser l'exprimer, cela n'est pas digne d'un citoyen. Si les honnêtes gens ne se donnent pas la peine de voir clair dans les affaires publiques et d'en prendre la direction, elles seront abandonnées aux intrigants sans scrupules ! Quoi de plus funeste pour le pays ?" (Marion (H.), Devoirs et droits de l'homme, Paris, Librairie d'Education de la Jeunesse, 1883, p. 73-74). 5. Mézière (A.), Education morale et instruction civique, Paris, Librairie C. Delagrave, 1883, p. 129. 6. Gambetta (L.), Discours sur les lois constitutionnelles prononcé le 23 avril 1875, reproduit in Reinach (J.), dir., Discours et plaidoyers de M. Gambetta, Paris, G. Charpentier, 1881, tome IV, p. 329.
14
Légitimité et déviance
fait tort à tous ses concitoyens, puisque son vote peut avoir pour résultat de confier les intérêts publics à des gens indignes de les avoir en main"1. Pour voter en conscience, l'électeur doit ne pas se laisser duper par les flatteries et les belles promesses de certains candidats : "Sachez discerner l'ambitieux qui promet tout, qui flatte le peuple pour avoir ses suffrages, de l'honnête homme plus soucieux du bien public que de sa popularité, et votez toujours pour le candidat le plus éclairé, le plus ferme dans ses idées, le plus désintéressé, le plus dévoué au bien public"2. Les manuels favorisent de la sorte la séparation entre l'appartenance à la communauté d'existence ou de travail et l'appartenance citoyenne. Ils tendent à élargir l'horizon du paysan en l'obligeant à penser en terme universel.
Troisième nécessité, l'électeur doit être capable de se mettre à la place de ses concitoyens, afin de saisir leurs intérêts et leurs préoccupations ; il doit apprendre à subordonner son bonheur privé à l'intérêt général. De cette exigence nouvelle, naît l'incompatibilité posée par les manuels entre l'expression de l'égoïsme individuel et la participation à une communauté de destin : "Qu'est-ce qu'un électeur honnête ? C'est celui qui, un jour d'élection, n'est préoccupé que de l'intérêt général : des intérêts de la commune s'il s'agit d'élire des conseillers municipaux ; des intérêts du département s'il s'agit d'élire un conseiller général ; des intérêts du pays s'il s'agit d'élire un député (...). Si, ayant à nommer un conseiller d'arrondissement, un conseiller général, un député, tu votes pour celui-ci, que tu sais le moins méritant, parce qu'il est ton parent, ou ton ami, parce qu'il est proche et influent, parce que tu espères de lui une protection pour toi ou pour quelqu'un des tiens, ne comprends-tu pas encore que tu es un malhonnête homme, qui vole la communauté, qui par un misérable égoïsme sacrifie la communauté à lui-même ?"3.
Enfin, le votant doit produire un suffrage réfléchi et éclairé. Pareille conception suppose non seulement l'existence d'une compétence politique également distribuée sur le territoire national, mais plus encore une volonté, de la part des électeurs, d'accéder à l'information politique comme une capacité à évaluer les divers programmes en concurrence. Les républicains voient dans l'instruction la meilleure garantie de réalisation de ces présupposés démocratiques. Les manuels sont donc censés inciter les électeurs à participer aux réunions électorales et les encourager à lire la presse^ afin que le choix effectué se fasse en connaissance
1. Liard (L.), Morale et enseignement civique, Paris, Librairie Leopold Cerf, 1883, p. 118. 2. Idt., p. 119 ; voir également, Bigot (C), Le Petit Français, Paris, E. Weil et G. Maurice, 1884, p. 111. 3. Bigot (C), Le Petit Français, op. cit. , p. 110-111. 4. Les républicains seront ainsi particulièrement attentifs au développement d'une presse régionale pouvant atteindre facilement le monde rural. En témoigne, cette correspondance entre J. Steeg et E. Quinet : "Je suis très douloureusement frappé de l'abîme qui se creuse toujours plus entre la population des
de cause : "Mais comment bien voter ? diras-tu. Il n'y a pour cela qu'un moyen ; c'est que tu te fasses une opinion sur les affaires de ta commune, de ton arrondissement, de ton département, de ton pays, de façon à voter toujours en connaissance de cause (...). Ici tu n'as que deux moyens de te renseigner. Voici le premier. C'est de lire les journaux qui agitent ces grandes questions. C'est là que tu t'instruiras surtout (...). Un second moyen de te renseigner, le voici. Avant les élections, il y a des réunions diverses, tantôt privées, tantôt publiques, où les candidats exposent leur programme, où ils se combattent les uns les autres, où ils rencontrent dans l'assistance des contradicteurs. Ces réunions-là, qu'on nomme réunions électorales, il est de ton devoir d'y assister"^.
Au-delà de cette définition normative, la citoyenneté que les républicains tentent de favoriser dans les campagnes constitue donc un ensemble de rôles sociaux spécifiques, distincts des rôles professionnels ou privées par lesquels chaque paysan, quelle que soit sa place dans la structure sociale, se considère comme apte à opérer des choix concernant la Nation. De tels rôles supposent, bien entendu, une certaine compétence politique et certaines dispositions culturelles rendant déjà ce mode de division du travail politique intelligible. Ne partageant pas cette a priori, nombre de notables ruraux, menacés par le suffrage universel, y dénonceront une absurde "souveraineté du nombre" : "Pourquoi donner à tout le monde, aux ignorants comme aux autres, le droit de nommer les représentants de la nation ? Le vote est chose grave ; c'est un acte important au premier chef, puisque du choix des députés, par exemple, dépend la ruine ou la prospérité du pays (...). Est-ce qu'il n'est pas absurde, par exemple, que le vote des membres de l'Institut n'ait pas plus de valeur que celui des décrotteurs de Brive-la-Gaillarde ou de Landernau ?"6.
Les manuels de morale et d'instruction civique en usage dans les écoles catholiques rendent compte tout autant de
campagnes et celle des villes : le pouvoir y a poussé de toutes ses forces, excité l'une contre l'autre ces deux parties du peuple et, à la défiance réciproque, pourrait bientôt succéder la haine. A ce mal profond, il n'y a qu'un remède : éclairer les campagnes, les intéresser à la vie publique, leur parler régulièrement par la presse. Mais les journaux sont chers, trop longs, trop fréquents, trop lointains. Il importe donc de créer partout une presse locale, des journaux à bon marché" (Lettre de Jules Steeg à Edgar Quinet, 11 juin 1870, Bibliothèque nationale, N.a.fr. 20798). 5. Bigot (C), Le Petit Français, op. cit., p. 107-109. Voir également Bert (P.), L'instruction civique à l'école, Paris, Librairie Picard-Berheim et Cie, 1882, p. 69 et s. 6. Anonyme, L'Instruction civique à l'école laïque des sans-Dieu expliquée par un homme de bon sens, Paris, Tolra, 1883, p. 42. Ce thème sera très largement repris lors des assemblées provinciales organisées en 1889 pour la contre- commémoration de 1789. Cf. Burger (A.), Le suffrage universel coordonné, vote plural, réponses d'un consulté sur la question "gouvernement" aux promoteurs du Centenaire de 1789, Paris/Meaux, 1893.
15
Yves Deloye, Olivier Ihl
cette crainte. Sans remettre ouvertement en cause le modèle développé par l'école publique, ils se font les porte-parole d'une autre définition du comportement électoral plus en adéquation avec la situation du paysan français. Favorables à un vote communautaire devenu inavouable, ces manuels nuancent d'abord fortement l'image d'un électeur autonome et rationnel. Pour eux, si le vote doit être éclairé, ce n'est pas tant par la lecture individuelle des journaux1, encore moins par la participation aux réunions électorales, que par l'écoute des conseils des personnes instruites appartenant à la communauté même : "Le véritable moyen de remplir ses devoirs comme électeur, est de procurer à la France des députés à la fois intelligents et honnêtes, et pour cela de prendre conseil de quelque personne capables de nous renseigner. Au lieu de perdre son temps et sa peine à des questions d'économie politique, de finances, d'administration, de diplomatie, de législation, auxquelles on n'a pas été préparé par les études de sa jeunesse et dont on ne sait pas le premier mot, il est bien plus simple et bien plus efficace de consulter quelque personne instruite, honnête et désintéressée. Il ne manque pas, grâce à Dieu, dans le monde, de personnes intelligentes, et bienveillantes qui sont toutes disposées à nous faire part de leurs lumières. Ces personnes qui ont plus de loisir et plus de connaissances que nous-mêmes sont plus à même de juger les opinions et la vie des candidats ; elles peuvent se faire une idée exacte de leur capacité"2.
De fait, ces manuels pérennisent la dépossession de l'électeur-paysan au profit des notables ruraux (propriétaires, curés de campagne, etc.) qui se trouvent ainsi justifiés dans leur mission de contrôle sur les campagnes. Plus généralement, ils revendiquent la perpétuation d'une représentation communautaire de l'acte de vote encore très largement présente dans la société rurale. C'est toute une conception du paysan-électeur qui se voit ainsi réclamée. Elle n'est pas celle d'un être abstrait, semblable à tous les autres quelle que soit son activité sociale, mais celle d'un individu naturellement situé dans un réseau de relations sociales qui le particularise et interdit de le confondre avec un autre. En défendant une telle représentation, les notables ruraux tentent, bien entendu, de préserver leur pouvoir : ils infléchissent également l'usage du bulletin de vote. Car ils favorisent, à terme, l'émergence d'une norme de résistance au modèle idéalisé du citoyen défendu par les républicains. Modèle qui se traduira par l'annulation de nombreux bulletins émis par ces citoyens "pas comme les autres" que
1. Lecture ainsi dénoncée : "Pour bien voter, mes enfants, pour voter en conscience, vous n'aurez pas égard à ce qui se dit dans les journaux ou au cabaret, car on y trompe le plus souvent les électeurs" (cité par Loth (A.), Le petit livre du jeune français. Leçons populaires d'instruction civique, Paris, Société Générale de Librairie Catholique, 1884, p. 49). 2. Rondelet (A.), Manuel chrétien d'instruction civique, Paris, L. Vives, 1882, p. 172-173. Voir également Bailleux (Abbé L.), Martin (Abbé V.), Nouveau manuel d enseignement moral et d'enseignement civique, Nantes, Mazeau, 1882, p. 172.
continuent d'incarner les paysans des débuts de la Hle République.
Résistances rurales : les votes annulées face au
modèle républicain
II serait erroné d'assimiler l'ensemble de ces votes annulés à une forme d'abstention : singulièrement motivés, ces bulletins se révèlent, en réalité, bien plus éloquents sur la nature de l'acte de vote que la plupart des commentaires de lendemain d'élections^. Mais que recouvre exactement cette catégorie de votes ? Force est de constater qu'essentiellement utilitaire, la classification appliquée par les assemblées électorales se révèle peu commode pour répondre à cette question. Ne tente-t-elle pas surtout d'assurer la protection de l'anonymat, de la sincérité et de l'obligation du choix électoral, soit l'ensemble des principes chers aux nouveaux cours d'instruction civique4 ? L'idée centrale sur laquelle elle repose est claire : le droit électoral niant toute forme d'objection de conscience en matière de scrutin, l'électeur doit impérativement accorder sa faveur à un candidat et endosser la responsabilité d'un programme, cela même si la structure de l'offre électorale s'y oppose dans les faits. Rien de surprenant, ce faisant, à ce que les règles de l'arithmétique électorale reproduisent un pareil présupposé démocratique. Ni d'ailleurs, dans la mesure où l'abstention est autorisée, à ce qu'une partie des votes nuls et blancs soient exclus du décompte des voix exprimées pour être renvoyés au néant de votes sans conséquences. Lorsque l'on dépasse la grille de lecture administrative pour envisager la nature réelle de tels votes, six types de bulletins apparaissent, dont le poids respectif varie considérablement suivant les situations locales^.
3. Pour une approche théorique de ces questions, cf. Kelley (S.), Mirer (T.), "The simple act of voting", American political science review, vol. 68, 1974, p. 572-591. 4. Cette classification oppose les bulletins n'entrant pas en compte dans le calcul de la majorité (blancs, incomplets ou non anonymes) à ceux qui sont intégrés à ce calcul (bulletins de couleur, portant des "signes extérieurs" ou "annulés pour d'autres motifs") ; cf. sur ce point, Bidault (E.), Code électoral. Guide pratique pour les élections au Sénat, à la Chambre des Députés, aux conseils généraux et d'arrondissement et aux conseils municipaux, Paris, Paul Dupont, 1884, p. 198 et s. 5. La structure générale de ces votes peut-être cependant précisée en dressant la moyenne pondérée de chaque type de bulletins, et ceci à partir des données d'un certain nombre de circonscriptions constituées en échantillon opératoire. Le principe de constitution de cet échantillon est un taux de représentativité (pourcentage de bulletins empiriquement vérifiables par rapport au total des bulletins annulés par circonscription) supérieur à 75%. Lors des élections législatives du 21 août et du 4 septembre 1881, la composition des bulletins annulés se distribue de la façon suivante : bulletins vierges : 12,77 % ; bulletins barrés et découpés : 55,24 % ; bulletins annotés : 10,11 % ; bulletins barrés portant le nom d'un autre candidat : 7,99 % ; bulletins avec le nom d'un candidat non autorisé : 6,09 % ; plusieurs bulletins pour un même électeur : 4,31 % ; autres : 3,5 %. Cette distribution
16
Légitimité et déviance
Les bulletins vierges de toute annotation
Ils représentent environ 13% du total des annulés, dans l'échantillon retenu pour les besoins de notre enquête, et correspondent à ce qu'on appelle communément les "bulletins blancs"1.
Première observation : ces votes ne sont souvent blancs qu'au sens figuré. De tels bulletins étant particulièrement vulnérables à la fraude^, certains électeurs mettre noir sur blanc leur intention de voter "blanc". Aussi trouve-t-on les mentions «Pour billet blanc» sur plusieurs bulletins dans l'arrondissement de Draguignan, ou «Je vote en blanc» dans la deuxième circonscription de Cambrai, ou encore «Pour blanc» dans le canton de Granges d'Ans (Dordogne). Les assemblées électorales peuvent, il est vrai, se montrer très partiales, en interprétant à leur gré les votes incomplets : à Saint Sulpice Laurière (Haute- Vienne), un bulletin portant la mention «bulletin blanc» écrite au crayon, "mais où le nom de M. Pénicaud n'était pas effacé" a été considéré comme valable par le bureau et comptabilisé en faveur du dit candidat3. Le caractère artisanal des modes de confection du bulletin aboutit, au demeurant, à faire considérer comme "blancs" des papiers vergés, réglés, timbrés ou quadrillés, des billets de couleur ou tachés d'encre, de graisse, de boue ou encore portant des découpures intérieures'*.
représente la structure des moyennes pondérées de 3204 bulletins provenant des bureaux de vote de 30 circonscriptions: Roanne 1 et 2 (42), Laval 1 et Chateau Gontier (53), Lorient 1 et 2 (56), Lure et Vesoul (70), Mamers 1 et 2, Mans 1 et 2 (72), Chambery 2 (73), La Roche sur Yon 2, les Sables d'OIonnes 1 et Fontenay 1 (85), Die (26), Brest 1 et Quimperlé (29), Poitiers 2, Civray et Loudain (86), Montauban (82), Briey (54), Lodève et Béziers 2 (34), Digne et Sisteron, Hazebrouck 1 et 2 (59). Le critère de sélection de ces circonscriptions ou "arrondissements" est un taux de vérification (nombre de bulletins présents et donc contrôlés / nombre de bulletins déclarés annulés dans les procès verbaux) supérieur à 75 %. La source qui a permis d'établir ces données est la série des cartons cotés C 3970 à 4077 des archives de la Chambre des députés conservés au CAR AN. 1. A l'époque aucune valeur spécifique n'est attachée à la couleur blanche. C'est ainsi que les députés utilisent le blanc dans les votes parlementaires pour traduire une réponse favorable, le bleu étant réservé au "non". Depuis lors, une curieuse métonymie politique a fait correspondre à cette couleur "l'ensemble des votes qui n'expriment pas une volonté positive" (Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, vol. 2, 1982, p. 1573). 2. Ces craintes sont en partie justifiées : à Saint-Mars, dans l'Orne, plusieurs propriétaires et artisans protestent auprès du sous-préfet : au lieu des 49 bulletins annoncés "blancs ou nuls" lors de la proclamation des résultats (sur 347 votants), le procès-verbal ne faisait plus apparaître, le lendemain, que 26 bulletins de cette nature, 23 ayant été attribués frauduleusement à l'un des candidats pendant la nuit (Archives nationales, C 3510 - Orne). 3. Archives nationales C 4073 - Haute-Vienne. 4. Sur l'interprétation juridique de ces signes qui "noircissent" les bulletins blancs, voir Uzé (C), De la nullité en matière d'élection, Paris, 1896, p. 423 et s.
De manière générale, les bulletins blancs expriment soit une opposition au(x) candidat(s) en présence, soit l'incapacité de certains électeurs à se déterminer par rapport à des sollicitations contradictoires. Il ne faudrait pas en conclure, pour autant, qu'ils correspondent nécessairement à des attitudes apolitiques. Voter "à la blanche"5 n'équivaut pas forcément à se désintéresser des questions politiques. Au contraire, cette prise de position peut manifester une exigence, un sens de la responsabilité et des nuances partisanes très prononcés : "Monsieur Paulon et Monsieur Bontoux n'ayant ni l'un ni l'autre ma confiance, je vote en blanc" (signé "un partisan de la liberté")6 ; "Je ne vote aujourd'hui ni pour la république parce qu'elle ne suit pas le droit chemin ni contre la République parce que je suis républicain "7.
Les bulletins rayés ou découpés
Globalement, ils composent la moitié des votes annulés de notre échantillon8. On pourrait s'attendre à ce que leur nombre soit, comme pour les bulletins précédents, proportionné au caractère concurrentiel du scrutin. Très élevé dans les situations de monopole électoral, il s'avérerait plus faible lorsque la compétition électorale se fait plus disputée. Plusieurs scrutins d'arrondissement semblent d'ailleurs témoigner en ce sens^. L'hypothèse n'a cependant aucun fondement statistique si l'on se fie au résultat des trente-cinq circonscriptions étudiées : aucune relation probante de cette nature ne se dégage, dans un sens ou dans l'autre. La variable apparaît donc indépendante de l'intensité de la compétition.
5. L'expression désigne le vote blanc dans certains cantons des Alpes. Un exemple d'utilisation rimée de cette formule, cet électeur qui note : "Election sur la planche. L'un est sur. L'autre le pince. Pour moi je vote à la blanche" puis confie "celui qui la fait n'en veut ni l'un ni l'autre", in Archives nationales, C 3975 - Basses-Alpes. 6. Archives nationales, C 3975 - Basses-Alpes, commune de Belief faire. 7. Archives nationales, C 4069 - Tarn et Garonne, arrondissement de Moissac. 8. Ces élections, il faut le rappeler, furent marquées par de nombreux désistements dans le camp des conservateurs. Au point que dans la moitié des circonscriptions, ils étaient totalement absents de la compétition. Les difficultés pour "choisir" son candidat ne pouvaient qu'en sortir renforcées. Pour de plus amples aperçus sur les enjeux et le déroulement de ces élections de 1881, voir Rudelle (O.), La République absolue 1870-1889, Paris, Publications de la Sorbonne, 1982, p. 81 et Charnay (J.-P.), Les scrutins politiques en France de 1815 à 1962, Paris, Armand Colin, 1964, p. 88-90. 9. Dans la deuxième circonscription de Beaune où le député sortant, Sadi Carnot, se présente sans rival, sur les 369 votes vérifiés, 237 sont des bulletins rayés ou découpés qui portaient son nom, soit à peu près 64% (Archives nationales, C 3994 - Côte d'Or). En revanche, dans la première circonscription de Bergerac où trois candidats très différents (un républicain, un bonapartiste et un monarchiste) s'affrontent, seuls 20% des bulletins annulés et vérifiés appartiennent à cette catégorie (Archives nationales, C 3999 - Dordogne).
17
Yves Deloye, Olivier Ihl
Elle renvoie, en fait, à des réalités plus complexes, notamment aux pratiques de diffusion des bulletins et, donc, d'encadrement du vote. A une époque où les sujétions à l'égard des autorités notabiliaires (qu'elles soient républicaines ou conservatrices) influent lourdement sur l'orientation du vote, la distribution du "bon" bulletin constitue l'une des formes de pression les plus usitées. Une pression, d'abord, qui continue d'être vécue, dans plusieurs régions de France, comme l'exercice d'une ascendance bienveillante à laquelle la coutume a conféré toute sa légitimité1. Une pression ensuite, qui, compte-tenu des conditions de déroulement du vote (à la fois secret et public) ne laisse pas d'autre échappatoire que l'apposition d'un discret trait d'encre sur le nom du candidat2. Plus que d'autres, ces bulletins rayés tirent ainsi leur origine de l'environnement concret du vote, plus précisément de l'interférence dans la salle de vote entre une volonté d'obéissance et une tentation de la sincérité.
Les bulletins en double exemplaire ou associant deux candidats différents
Le poids des bulletins plies ensemble est assez limité (à peine plus de 4%). Leur signification recouvre des attitudes très différenciées. Dans le premier cas, celui où deux bulletins identiques ont été déposés dans l'urne3, la tentative de fraude semble l'explication la plus patente : l'électeur aurait voulu par ce geste peser plus fortement sur le scrutin. La volonté de donner sa voie en exemple est un désir compréhensible dans un milieu où le principe d'égalité des
1. H. Taine décrit de façon saisissante ce contrôle social : "Grande influence cléricale ici ; sur les riches d'abord : «Sans religion où irions-nous ?». En effet, c'est une gendarmerie intellectuelle. Puis sur le peuple : le curé va chez les paysans pendant que le mari est à l'ouvrage : «Eh bien, ma bonne femme, vous voulez donc la destruction de notre sainte religion et la ruine de notre Saint père le Pape ? - Oh, monsieur le doyen! - Alors, pourquoi votez-vous pour un tel ? - Dame, c'est que le maire nous a donné un billet. - C'est un mauvais billet. - Ah bien, si c'est cela, le voilà ; donnez-nous-en vite un autre. Je ne veux pas la destruction de notre sainte religion, et j'obligerai bien mon mari à voter avec votre bon billet» - Et le mari vote !" (Taine (H.), Notes sur la province, 1863-1865, Paris, Hachette, 1897, p. 8-9). 2. De telles pratiques avaient pour elles la méfiance partagée par nombre de campagnards pour l'imprimé. Fin observateur, H. Taine le note dans son étude sur le suffrage universel : "A leurs yeux [des paysans], les écritures, gazettes, proclamations, prospectus, sont des «mécaniques d'enjôleurs» tout comme le papier timbré de l'huissier ou l'avertissement du percepteur, arrangées pour extraire l'argent des poches. Ils sont sur leurs gardes ; ils ont été tant de fois trompés!" (Taine (H.), Du suffrage universel et de la manière de voler, Paris, Hachette, 1872, p. 26-27). 3. Selon la réglementation électorale, dans cette situation, l'un d'entre les deux bulletins est tenu pour valable. En revanche, lorsque les deux bulletins sont différents, aucune attribution n'est effectuée. La disposition est surtout théorique car chaque assemblée électorale interprète ces votes en toute liberté.
voix se heurte au démenti quotidien d'une hiérarchie et d'inégalités omniprésentes4.
C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un vote minoritaire, voué par avance à la disparition du résultat comptable : «Je voudrais que ce bulletin compte pour 2000. Vive de Roux. Vive la religion. A bas la République» est-il inscrit sur le bulletin imprimé en faveur du candidat E. De Roux Larcy, soutenu par le Comité Catholique Conservateur5 . A l'inverse, des électeurs avouent dans certaines circonstances ne pas pouvoir se décider entre deux candidats : «Je les aime autant l'un que l'autre», par exemple, dans l'arrondissement de Vassy (Haute-Marne)6. Cet embarras du choix, pour marginal qu'il soit, a pu également motiver certains votes doubles du second type.
Les bulletins portant un nom de "non-candidat" ou qui, recouvert du nom imprimé d'un candidat, ont été rayés au profit d'un concurrent
Pour ce qui est de la première catégorie, elle souligne, avant tout, l'état lacunaire du droit électoral. En l'absence de réglementation précise à propos de la déclaration de candidature, chaque citoyen était susceptible de se présenter à l'investiture des suffrageants. En ces années de consolidation de la République, l'argument tenait une place cruciale dans les discours et écrits de propagande adressés aux paysans. Non seulement le nouveau régime accordait à tous le droit d'élire l'homme de leur choix, mais chacun pouvait désormais prétendre à un mandat politique7. Les bulletins au nom de figures locales influentes ou appréciées (l'instituteur, le curé, le président d'un comice agricole, les "vétérans de la Démocratie" comme les républicains de
4. Ce genre d'idée est moins original qu'on ne le pense : comme l'écrit le marquis de Castellane, il est difficile "d'admettre sans appréhension que le citoyen inintelligent, dépourvu d'instruction, dont les vues souvent ne s'étendent pas au-delà du cabaret, ait la même influence sur la marche des affaires que l'homme instruit, que le savant qui a fait des questions politiques l'étude de toute sa vie" (Essai sur l'organisation du suffrage universel en France, Paris, E. Lachaud, 1872, p. 11). Une vue défendue également, à l'époque, par des républicains de la notoriété de E. Quinet, E. Renan, etc. 5. Archives nationales C 4006 - Gard, commune de La Grande Combe. 6. Archives nationales C 4033 - Haute-Marne, arrondissement de Vassy. 7. Dans les brochures électorales des républicains, ces vertus du suffrage universel sont sans cesse brandies. Dans sa Lettre aux paysans, le dénommé Jacquillou, "petit fils de paysan, fils de paysan, paysan (lui) même" le déclare sans ambages : "Aujourd'hui, tout le monde est électeur et tout le monde peut être élu". La formule frappe les imaginations : "Nommer un paysan député ! Sénateur ! pourquoi pas Président de la République ?!!". Cette meritocratic électorale puise largement dans la mythologie américaine : "Allez donc voir en Amérique dans cette république des Etats-Unis qui est la première nation du monde si on n'y nomme pas des paysans présidents de la République". Et de citer le cas de l'ancien "gardien de troupeaux" Abraham Lincoln (Jacquillou, Lettre aux paysans, Paris, 1881, p. 23).
18
Légitimité et déviance
1848, etc.) s'en trouvaient évidemment favorisés : dans la deuxième circonscription de Béziers, le nom d'Emile Granier dit "Barraque", victime du coup d'Etat de 1852, revient à plusieurs reprises, témoignant du prestige attaché dans ces localités aux luttes politiques du passé1. A moins qu'ils ne servent de prétexte pour ironiser sur les compromissions de notables bien connus, comme sur ce bulletin pour «Ribardière, métayer au Château, ex-maire»2. Les affinités électives, en ce domaine, n'obéissent pas toujours à des règles simples, elles peuvent suivre des voies parfois très personnelles : à Châteauponsac, le billet porte «J'ai voté pour Mlle Ana Courcelle, couturière et sous maîtresse chez M. Gaudeau»-*. Une remarque au sujet des bulletins rayés au profit d'un rival : la procédure du vote ne permettant pas forcément, comme on l'a vu, de dissimuler le contenu du billet pour le soustraire à la surveillance de l'entourage, les votes de cette nature offraient a priori un double avantage. Celui de pouvoir tromper le contrôle du président du bureau de vote, lors de l'introduction dans l'urne, puisque le format comme la texture du bulletin le rassuraient sur sa qualité. Celui également de déjouer les pressions exercées par d'éventuels agents électoraux, en acceptant de prendre leur bulletin imprimé (sous la menace ou en échange d'une rétribution quelconque), tout en s'aménageant la possibilité de voter "en conscience". L'efficacité du subterfuge expliquerait le pourcentage non négligeable de ces bulletins dans notre échantillon (8%). La parade existe cependant : remettre au votant un bulletin déjà rayé de la sorte4.
Les papiers divers : prospectus, dessins, bulletins d'anciennes élections, cartes électorales...
A l'instar des bulletins renfermant des apostrophes humoristiques ou sarcastiques, une partie de ces papiers peut être analysée comme un mode de contournement du sérieux affiché par le rituel du scrutin. La sollicitation périodique du suffrage est utilisée comme une occasion pour donner libre
1. Archives nationales, C 4012 - Hérault, deuxième circonscription de Béziers. 2. Archives nationales, C 4072 - Vienne, canton d'Availles. Ou encore sur ce billet, initialement pour l'ancien député Pétiet : "Parler peu et parler bien, voilà des titres. Jean Faucher, ancien conseiller municipal. Illustre orateur ! Franc aristocrate. Coursier intrépide aux approches des élections, un peu boiteux mais cela passe. Bon pour un député" (Archives nationales C 4064 - Deux-Sèvres, deuxième circonscription de Niort). 3. Archives nationales, C 4073 - Haute-Vienne, commune de Châteauponsac. 4. A Bordes, dans les Hautes-Pyrénées, le chiffonnier de la commune, Joseph Combret a, par exemple, offert à un électeur un bulletin "où le nom de M. Fourcade était biffé, et remplacé par celui de Me Cazaux, en lui disant : «Je vous donne deux francs si vous portez ce bulletin dans l'urne». Au cabaret d'un nommé Barbazan, les partisans de Cazaux se livraient eux aussi à l'opération en offrant à boire à volonté aux électeurs consentants". Aussi, une trentaine de ces billets seront-ils retrouvés dans l'urne au moment du dépouillement (Archives nationales, C 4048, dossier Hautes-Pyrénées).
cours aux plaisanteries, plus ou moins licencieuses, sur la qualité des candidats et le sens des campagnes électorales. Profitant du relatif anonymat accordé par la procédure du vote, ces électeurs s'emploient à narguer délibérément la solennité d'une opération productrice de frustrations. L'outrance, le grotesque, le burlesque constituent alors des voies latérales pour dissimuler la réalité d'une dépossession. En s'attachant à dévaloriser sciemment la représentation tacite des candidats qui fait d'eux des "serviteurs éclairés et dévoués", ces bulletins offrent le moyen de se réapproprier une identité. Grâce à eux, l'électeur a le sentiment de reprendre l'initiative en déjouant les attentes placées dans la pratique ritualisée du suffrage. La distance critique permise par l'attitude parodique^ inverse donc la relation de pouvoir entre le mandant et le mandataire au profit d'un électeur désormais en position de dominant.
Par son fonctionnement pacifié et policé, l'élection invalide de fait sinon de droit, tout un ensemble d'attitudes charivariques, de violences verbales, de charges polémiques particulièrement à l'honneur dans la "politique de la rue". Imposant une censure sur ces modes d'énonciation de l'opinion, elle contraint, dès lors, à une impuissance dédaigneuse, voire teintée d'agressivité : à Nantiat (Haute- Vienne), l'électeur a entouré le bulletin du candidat conservateur De Montvallier d'un crêpe noir, en signe de deuil, tandis qu'à Folles, dans le canton voisin de Bessines sur Gartempe, c'est une facture d'un pesage de cochon de 129 kg. qui a été trouvée dans l'urne^. La distraction, l'insuffisance dans l'apprentissage des règles du vote tiennent, elles aussi, une place dans la présence de cette déroutante littérature électorale^.
Les bulletins contenant des commentaires
Leur valeur, on s'en doute, est sans commune mesure avec leur importance numérique, relativement modeste (près de 10% de l'ensemble des bulletins vérifiés). Renfermant, dans la plupart des cas, une véritable "explication" du vote, ces billets justifient une analyse circonstanciée. D'autant que le suffrage universel, en impliquant une "citoyenneté passive"8, c'est-à-dire dépourvue de toute considération d'intensité ou de qualité, ainsi que de toute justification du vote, passe facilement pour une sorte de "chambre obscure",
5. Pour une réflexion générale sur la parodie, voir Labounoux (G.), "La parodie instrument de pouvoir symbolique", Cahiers internationaux de Sociologie, voLLXXIII, 1982, p. 233-250. 6. Archives nationales, C 4073 - Haute- Vienne. 7. A Thouron, un journalier a utilisé sa carte électorale "en guise de bulletin" (Archives nationales, C 4073 - Haute- Vienne) alors qu'à Ensigné (Archives nationales, Deux-Sèvres), c'est l'inadvertance d'un assesseur ayant confondu la carte et le bulletin de l'électeur Jean Travers, qui est responsable de l'annulation du vote. 8. Sur cette notion, cf. Campell (A.), "The passive citizen", Acta Sociologica, vol.6, 1962, p. 9-21.
19
Yves Deloye, Olivier Ihl
que les plus critiques dénoncent comme le règne d'une opinion collective asociale1.
Une citoyenneté bruyante et revendicative : les votes annotés
Les milieux positivistes sont les premiers à s'efforcer de rompre avec la vision idéaliste de l'acte de vote. Le bulletin glissé dans l'urne traduit moins, selon eux, l'expression d'une délibération rationnelle que la réaction sentimentale à des injonctions qui prennent, particulièrement dans les campagnes, la forme de dilemmes manichéens. Prenant à contre-pied le credo démocratique, ils contestent avec force la transparence proclamée du mécanisme de la représentation politique : "Quel que soit le mode de votation, observe G. Wyrouboff, le peuple ne peut exprimer des opinions politiques qu'il n'a pas, c'est tout au plus s'il indique les sentiments qui l'agitent et les vagues espérances qu'il nourrit"2.
Cette manière de voir recèle cependant une ambiguïté. Peut- on inférer du constat d'une infériorité culturelle, traduite au sein du plus grand nombre par un fort taux d'analphabétisme et l'absence d'instruction civique, l'idée d'une "incompétence politique" du monde paysan ? Autrement dit, faut-il opposer au théâtre politique urbain le thème d'une indifférence généralisée du monde des campagnes, prisonnier des formes "archaïques" d'énonciation du politique que sont le localisme et la personnalisation des débats politiques ?
Pourtant, aucune différence notable entre villes et campagnes sur le plan de la participation électorale ne vient soutenir une pareille hypothèse3. Au contraire, les études actuelles sur l'abstentionnisme aboutissent à démontrer que celui-ci "est plus fort dans les grandes agglomérations que dans les campagnes"4. Une approche qualitative de
1. Voir, entre autres, Benoist (C), De l'organisation du suffrage universel, Paris, Firmin Didot, 1895, p. 129 et s. ; et Laffitte (P.), Le suffrage universel et le régime parlementaire, Paris, Hachette, 1888, p. 230. 2. L'auteur en concluait que "les mots république et empire, entendus comme les entendent les masses ne constituent pas des régimes politiques déterminés ; [...] ce sont là de simples enseignes qui effrayent ou attirent sans qu'on ait la moindre notion de ce que ces enseignes représentent" (Wyrouboff (G.), "Les élections nouvelles et la vieille politique", extrait de la Philosophie positiviste, septembre-octobre 1881, Versailles, Cerf et fils, p. 10 et 12). H. Taine ne disait pas autre chose lorsqu'il écrivait, quelques années auparavant : "L'électeur, même peu éclairé, a plus forte raison ignorant, est vis à vis de son mandataire comme vis à vis de son médecin ou de son avoué. Tout son office est de décider en quel homme spécial, il a le plus confiance" (Du suffrage..., op. cit., p. 23). 3. Voir, par exemple, Les cahiers électoraux de 1881, Paris, P. Gourmain-Cornille et R. Martin, 1882. 4. Subileau (F.), Toinet (M. -F.), "L'abstentionnisme en France et aux Etats-Unis", in Gaxie (D.), dir., Explication du vote. Un bilan des études électorales en France, Paris, Presses de la FNSP, 1985, p. 187. Voir aussi Lancelot (A.), L'abstentionnisme en France, Paris, Armand Colin, 1968.
l'électorat des campagnes s'impose donc si l'on veut dissiper de tels malentendus.
Certes, pour chaque électeur rural, la participation au scrutin ne va pas de soi, en ces années d'affirmation d'une compétition politique réglée et concurrentielle. Mais, l'entreprise de conquête des voix paysannes a eu rapidement des répercussions sur leurs façons d'envisager la valeur du scrutin. La sollicitation à laquelle ils étaient soumis avait, il est vrai, de quoi flatter leur orgueil et leur susceptibilité5. Fiers d'être appelés pour la désignation de ceux dont ils subissent habituellement l'autorité, ils se sont, dès lors, plutôt acquittés de leur tâche avec scrupule. L'encadrement du vote, réalité massive dans les univers sociaux encore très cloisonnés, ne rend compte que d'une partie des comportements électoraux. Toutes les communautés villageoises sont loin de marcher encore chacune comme un chœur antique mené par son coryphée : une part croissante d'électeurs se montre désormais jalouse de son honneur et de son indépendance électorale. La prégnance de ce sentiment du devoir civique n'est jamais plus visible que lorsque ceux- ci ne parviennent pas à se décider car leur aveu d'impuissance s'avère éloquent : "Je ne veux point voter car je ne s'est pas ci je ferais bien ou mal"6 ; "Je vote pour personne crainte de me tromper"^. La fuite dans le vote blanc se fonde alors sur la crainte de mal faire, de ne pas être à la hauteur de l'identité gratifiante de citoyen8.
Si la légitimité du suffrage universel comme procédure de désignation n'est pas remise en question dans les bulletins annotés, en revanche, le mécanisme de la représentation suscite plus de méfiance. Le reproche principal fait à son encontre est de condamner le mandant à une position passive : d'une part, en l'obligeant à se déterminer d'après une offre politique sur laquelle il n'a aucun moyen d'intervention, d'autre part, en lui donnant moins le pouvoir "d'élire" un programme que celui d'accréditer un individu. L'attente d'un mandat impératif perce dans de nombreux commentaires : "Inutile de voter pour qui que se soit lorsqu'il font la propagande, promettent beaucoup de sauce s'ils parviennent au pouvoir ils pensent à eux non pas à moi" confie, de façon significative, cet électeur de la Grande Freinet, dans le Var9 ; "Tu m'as trompé au vote sénatorial
5. Sur ce point, voir les exemples, tirés notamment de rapports de procureurs généraux, cités par Weber (E.), "La formation de l'hexagone français", in Furet (F.), dir., Jules Ferry «fondateur de la République», Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1985, p. 231. 6. Archives nationales, C 4064 - Deux-Sèvres, commune de Parthenay. 7. Archives nationales, C 4064 - Deux-Sèvres, commune d'Aubigné. 8. Manière aussi de voir que le sentiment de compétence ne recoupe pas complètement la motivation à voter puisque, sommé de produire une opinion électorale, l'électeur peut s'avouer embarrassé sans renoncer pour autant à son droit de suffrage. 9. Archives nationales, C 4069 - Var, commune de la Garde Freinet.
20
Légitimité et déviance
du 5 janvier. Non tu n'auras pas ma voix", lit-on également sur un bulletin en faveur du candidat républicain sans opposant d'une circonscription du Gard1. En somme, ces bulletins marquent avant tout le refus d'une prise de position abstraite et "silencieuse".
Le caractère mutilant de la procédure du suffrage universel fait même, à cette époque, la joie des chansonniers de rue. Dans ses Aubades à Marianne, Fernand Boussenot raille, par exemple, son extrême docilité sur l'air des "Petits Mousquetaires" :
"Premier électeur : Vous allez parler aujourd'hui ! Le suffrage universel : Oui ! Oui !
Le deuxième électeur : Et surtout pas de trahison ! Le suffrage universel : Non ! Non!
Troisième électeur : Vous changer fort de favori ? Le suffrage universel : Oui ! Oui !
Quatrième électeur : Mais en savez vous la raison ? Le suffrage universel : Non ! Non !
Ensemble : C'est ça qui gouverne la France
Et qui nous mène à sa façon Voilà toute son éloquence : Oui, non !"2
Plus généralement, les critiques développées sur ces billets prouvent l'existence d'opinions personnelles, qui pour distinctes qu'elles soient des formes légitimes des échanges politiques, n'en sont pas moins politiquement construites : "Mes bons amis il faut que nous naumion in dé puté dan notre arondissement san doute nous annavons besoin mais nous ne de vons pas être en y griar des deux partie quel est L'Homme qu'il nous faut Tancau partie républicaine il nous faut pas M Jouffrant (candidat républicain, présent dans la circonscription de Bressuire, battu par le candidat monarchiste) Je ne veux pas dire du mal de lui mais sont partie neme plais pas on nous dit que la république demande la justice et la liberté je vois que s'est faut car il y a quatre ans a pareil époque Mr le marquis {de la Rochejacquelin, représentant du parti monarchiste) s'est présenté comme cette foi ci et il a ut la majotité des vois par trois foi diférante et on a in validé Mr le marquis vois la bien la justice de la République et en corditan quil faut pour M Jouffrant non il nait pas capable de faire in discoure il faut que sa sois s'est confrère qui lui diet pour quil prène par
ceure sa nest pas surprenant il na pas fait toute sest classe il a promie de les faire"3.
Dans un registre semblable, il est clair que plus l'enjeu se prête à une interprétation éthique, plus le votant est à même d'intervenir, autrement dit, de passer outre son sentiment éventuel d'incompétence pour donner un avis motivé. L'indignation morale s'apparente, de ce point de vue, à un stimulant particulièrement efficace de la participation électorale :
"Retiré vous bonapartistes malfaisant Votre parti est mort honteusement
En livrant la France à Sedan Moi je vote les honnêtes républicains
Qui ne prête pas leur argent aux italiens"4.
Les réactions de ces votants expriment, la plupart du temps, un vigoureux antiparlementarisme, fondé sur le sentiment d'une dépossession, sinon d'une trahison. Percevant leur voix comme une parcelle de pouvoir, ils font preuve d'un fatalisme agressif quand ils ont l'impression qu'elle leur est volée par la logique de la représentation : "Que l'on supprime la paye aux députés et vous verrez qu'ils ne sont pas si bavards sur leurs professions de foi. Depuis 10 ans ils promettes des alouettes rôties ! Allez donc ceux sont eux qui les mangent"5 ; "Votez pour Bizot de Fonteny nous n'aurons pas de dégrèvement on nous dit blanc on nous fait noir voter Dubreuil c'est nous ramener avant 1789 Pris par l'un ou l'autre pauvre contribuable c'est toujours nous qui payons pour les autres"6.
Les plus mobilisés des votants exposent parfois de véritables "explications" de leur comportement. On devine bien sûr dans le goût de la nuance, la facilité à manipuler le langage écrit, l'assurance également avec laquelle sont soupesées les idées de chaque candidat, la main d'un homme instruit, lecteur de journaux, probablement fonctionnaire, en tout cas habitué aux joutes oratoires du débat politique (instituteur, juge de paix, curé, ou ancien officier à la retraite...) : "S'il s'était présenté un homme raisonnable il aurait eu ma voix je m'abstiens de voter pour un homme qui a contribué à chasser les honnêtes gens par une porte et faire rentrer les communards par l'autre car il n'est plus dans mon estime que ces derniers. Je prie M. Beriet de croire que s'il a pu plaire à un petit nombre, il a déplu à un bien plus grand car je suis persuadé que dans notre chère patrie (comme on a l'habitude de dire sans en avoir les vrais sentiments) le nombre des honnêtes gens dépasse encore
1. Archives nationales, C 4006 - Gard, deuxième circonscription de Nîmes. 2. Boussenot (F.), Aubades à Marianne. Crécelle de Fernand Boussenot, Paris, L. Sauvaitre, 1889, p. 19.
3. Archives nationales, C 4069 - Deux-Sèvres, commune de St Martin de Sanzay. 4. Archives nationales, C 4072 - Vienne, commune de Chalais. 5. Archives nationales, C 4033 - Haute-Marne, commune de Bourbonne les Bains. 6. Archives nationales, C 4033 - Haute-Marne, commune de Serqueux.
21
Yves Deloye, Olivier Ihl
celui de la canaille Puissent ces quelques mots lancés par un pauvre paysan être entendus et compris de tous ceux qui devront nous représenter à l'avenir s'ils ne veulent pas encourir davantage notre malédiction. Et les agriculteurs on ne songe à eux que pour leur tirer leurs impôts et venir quêter leurs suffrages"1.
Mais, d'autres recourent à des arguments plus abrupts, dans un français mâtiné d'expressions familières et rédigés d'une main hésitante. La volonté sous-jacente, elle, demeure identique : rendre compte d'une décision qui engage profondément le votant et dont la manifestation s'accorde mal avec une technologie électorale réductrice et impassible: "Je ne vote pour M. Laumond qui nous a ôté nos frères ni non plus pour M. Pépinières car touts les républicains ensembles nous criblent d'impôts y aurait bien autre chose à vous dire"2; "Je vote en blanc ne voulant pas voter pour un homme qui dans ses affiches dit des mensonges surtout pour l'agriculture"3 ; "Je vote pour Lacaud-Alotte que je crois bon et sincère républicain mais s'il faisait comme Cousseau (membre du conseil municipal) jamais je ne recommencerai à voter pour lui"4.
De telles prises de parole s'effectuent, dans certains cas, dans la langue vernaculaire. Dans la commune de La Cluse (Hau tes- Alpes), qui comptait 51 votants, les deux seuls bulletins annulés étaient écrits en patois. Voici ce que dit l'un deux : "Iou pou pas voutar per a queou que me voul enlevar l'air que respirou à pies poupious"5. A Roques, dans le Var, le ton est tout aussi virulent : "Elections dé la Lessivos, per que vous vouagounpas maou ! ! Lou mies es dé routa per pegiin, et foutre cadiin n'en mai vaou saoupé que Lou védin"6.
Mais, il semble plus que ce soit en raison du fond, et non de la forme, que ces votes aient été sanctionnés. Autre trait frappant : la figure des candidats incarne dans les représentations paysannes des scénarios dramatisés à l'extrême, des options idéologiques caricaturales. Servant en quelque sorte de repère, elle semble faciliter la retraduction dans une question de confiance personnelle d'enjeux souvent "difficiles"7 : "Parchis Ludovic au bourg ferait un bon député il a le nez long il prévoiras tous les coup a l'avance et il ne tarderas pas à faire un projet de loi il inventerai la
1. Archives nationales, C 4035 - Meurthe et Moselle, commune de Thèzey St Martin. 2. Archives nationales, C 3993 - Corrèze, commune d'Ussel. 3. Archives nationales, C 4035 - Meurthe et Moselle, commune de Briey. 4. Archives nationales, C 4072 - Vienne, canton des Trois Moutiers. 5. Archives nationales, C 3976 - Hautes- Alpes, commune de La Cluze. 6. Archives nationales, C 4069 - Var, commune de Roques. 7. Notion reprise des travaux d'Edward Carmines et James Stimson qui proposent de différencier "enjeux aisés" {easy issues) et "enjeux difficiles" (hard issues) (Carmines (P.E.), Stimson (J. A.), "The two faces of issues voting", American political science review, vol.74, n°l, mars 1980, p. 78-91.
gillotine la noyada il ferê pendre les legitimes dans leur lit la lui et conduire a Nantes tous passèrent sous le fatal niveau de la guillotine"8.
La question religieuse est de celle qui se prête le mieux à ce travail d'appropriation et de classification politique. Ne constitue-t-elle pas une donnée sensible dans chaque communauté rurale en ces années de résurgence de l'anticléricalisme ? Par elles, les polémiques nationales qui divisent la presse comme la Chambre trouvent un écho local, s'incarnant dans des personnages aussi réels que l'instituteur et le curé^ : "La religion est semblable à une épée dont le manche est à Rome et la pointe partout, paroles prononcées par ce candidat à Pont St Vincent lors des dernières élections" (sur un bulletin rayé au nom de Duveaux)10 ; "Pas de deputation pour Monsieur Gassier qui a été hostile à la religion par ses votes quoi qu'il en dise"11; "Nous ne votons pas pour des jésuites mais pour de bons républicains"12.
Contrairement à l'idée de Taine, la personnalisation des problèmes, qu'ils soient locaux ou nationaux, s'accomode sans peine de la compétence politique. A vrai dire, ces deux variables ne s'opposent pas car l'une et l'autre sont relativement indépendantes. Les deux bulletins suivants l'illustrent, chacun à leur manière, de façon convaincante : "Loustalot, Grand farceur !!! tu nous cajoles, tu nous trompes, tu nous bernes... Voyons, sois franc ; crois tu un seul mot de ta circulaire ? Où est la liberté ? Hein !!! Où est l'amélioration dans la vie de l'ouvrier, du commerçant, de l'agriculteur ? Je cherche, je ne trouve rien. Tu parles d'un dégrèvement d'impôt de 300 millions, Grand hâbleur ! grand m... !!! Pourquoi caches-tu que notre dette publique, réduction faite de la guerre de 1870, a augmenté de 2 milliards 88 millions ? J'aime les républicains honnêtes... Aux gémonies !!!"13 ; "Vive la France a bat Antonin Proust ehe lege endarm grand voleur et dicipatou de noutre caise publiques gay noume granbeta chelle varmine do pouple français on demende un reprezantand pezible louyal ounaite vartueus i ne vêlent pas dantonin proust"14.
L'exigence de proximité revient dans beaucoup de ces apostrophes. Elle tourne même en une revendication particulariste. "Je voteré pour le candidat de mon paiy": ces mots reviennent plusieurs fois dans l'arrondissement de
8. Archives nationales, C 4023 - Loire Inférieure, deuxième circonscription de Nantes. 9. Cf. Ozouf (M.), L'Ecole, L'Eglise et la République 1871- 1914, Paris, Armand Colin, 1963, p. 157 s. 10. Archives nationales, C 4035 - Meurthe et Moselle, première circonscription de Nancy. 11. Archives nationales, C 3975 - Basses-Alpes, commune de Barcelonnette. 12. Archives nationales, C 3976 - Hautes- Alpes, commune de Mévaches. 13. Archives nationales, C 4019 - Landes, commune de St Paul les Dax. 14. Archives nationales, C 4064 - Deux-Sèvres, première circonscription de Niort.
22
Légitimité et déviance
Draguignan. De façon concomitante, la mémoire du lieu assure comme un prisme pour l'évaluation de la valeur des candidats : "Vive Garrigat a bat La parrouse souvenez vous que son grand père a vidé la caisse"1. Ou sur ce bulletin en faveur de Gustave Roch : "II ne faut pas donner sa voix à Mathurin le Biliais car en 1870 il conduisait une bande de voleurs"2.
Autre appel lancé par ces électeurs : la prise en compte d'intérêts qui les touchent directement. Le bulletin fait alors office de support pour formuler un besoin précis. On ne sera pas surpris que la chasse soit au premier rang d'entre eux. Une seule illustration : dans la petite commune de Seilhac où votent 377 personnes, la mobilisation pour la préservation du droit de chasse est très vive : "Nous demandons à payer l'impôt du fusil et d'avoir droit à chasser Vive la République" (sur un billet en faveur de Léon Vacher signé "les bons républicains") ; "L'électeur demande la liberté de la chasse et l'impôt sur les fusils" (sur un papier libre)3.
Ce sont, en fait, cinq bulletins sur les 18 annulés qui portent ce type de revendication. Bien d'autres pourraient être cités se rapportant aux dégrèvements fonciers, à l'impôt sur les sucres, les vins et les cidres, à la suppression de la surtaxe de deux centimes et demi sur le sel, à la lutte contre le phylloxera... Considérée sous cet angle, l'inégale compétence du corps électoral, derrière laquelle se retranchent les républicains eux-mêmes pour justifier le volontarisme en matière d'instruction civique, devient moins un problème quantitatif (être plus ou moins bien situé sur l'échelle d'une politisation univoque) qu'une question qualitative, qui met en jeu une pluralité de savoir- faire. Et, il faut en convenir, ce n'est qu'à la faveur de la promotion dans les campagnes d'une définition restrictive de la citoyenneté électorale que cette diversité a du s'effacer.
Enfin, dernier enseignement issu de la lecture de ces votes si riches de sens : le rôle mobilisateur des pressions électorales. L'encadrement du vote transparaît très nettement dans ces billets. Pratique empruntant des voies nombreuses et subtiles4, il est en partie sanctionné lors du dépouillement de l'urne, soit parce que la violation du secret électoral est à ce point flagrante que l'annulation de certaines voix s'en trouve justifiée, soit parce que l'électeur en avait profité pour dénoncer la pression exercée sur lui. A Trémolat, en Dordogne, le bulletin en faveur de "Garriga"
1. Archives nationales, C 3999 - Dordogne, canton de Bergerac. 2. Archives nationales, C 4023 - Loire Inférieure, troisième circonscription de Nantes. 3. Archives nationales, C 3993 - Corrèze, commune de Seilhac. 4. Sur de tels comportements, voir Huard (R.)» "Comment apprivoiser le suffrage universel ?", in Gaxie (D.), dir., Explication du vote, op. cit. ; ou Rivet (A.), La vie politique dans le département de la Haute-Loire, Le Puy, Edition des Cahiers de la Haute-Loire, 1979 (chapitre VI).
était "d'une nuance différente des autres", de couleur blanc cassé, facilitant le contrôle des membres du bureau ou de "surveillants" présents dans la salle. De même à Moussac- sur- Vienne (Vienne), un vote a été invalidé pour la raison qu'il était "plié de façon à faire apercevoir le nom du candidat Demarçay"5. Illustration des votes de dénonciation: à Chérigné (Deux-Sèvres), le maire est interpelé par le sous- préfet au sujet de quatre bulletins qui portaient les noms de courtiers électoraux très actifs dans la région. Très embarrassé, l'édile local doit avouer que les pièces à conviction ont été brûlées par le bureau électoral : "Ces deux honorables citoyens de la commune qui s'étaient faits remarquer par leur dévouement à la candidature de Monsieur Giraud" auraient vu comme une "injure" de voir "figurer leurs noms sur le tableau des candidats"6.
Au regard des résultats de cette enquête, trois critères essentiels interviennent dans la définition de l'acte de vote : l'aptitude, tout d'abord, à décliner sa préférence politique dans les termes reconnus par le droit électoral et appliqués au sein des assemblées (les obligations d'anonymat, de désignation suffisante, d'absence de signes extérieurs...). C'est la définition d'une qualification électorale. Son absence renvoie surtout au non apprentissage des règles légales d'utilisation du suffrage7. Ensuite, la capacité culturelle à répondre aux exigences impliquées par l'usage du bulletin : exprimer son avis de manière décente et sérieuse, disposer des moyens de signifier son choix - lire et écrire8. Enfin la motivation à participer au jeu de l'élection: si par définition tous les bulletins annulés sont le fait d'électeurs motivés à voter (volontairement ou non), tous
5. Successivement Archives nationales, C 3999 - Dordogne et Archives nationales, C 4072 - Vienne. 6. Archives nationales, C 4064 - Deux-Sèvres. Autre cas significatif, à Meymac : "Vive le châtelain Bordas. Je vote pour Bordas, un homme incomparable que son vin généreux fait seigneur aimable purificateur du pays son nom dans tous les cœurs restent à jamais gravé pour ses douces liqueurs" (Archives nationales, C 3993 - Corrèze). 7. Exemple de ce type de disposition juridique : l'usage du crayon est rigoureusement interdit. La méconnaissance de cette règle est punie de sanction : à Foyartin dans les Landes, 31 bulletins rayés au crayon seront finalement attribués par le bureau au candidat Loustalot "pour la raison que le crayon n'est point admis en matière de vote" (Archives nationales, C 4019 - Landes, canton de Monfort). 8. L'accès à l'écriture favorise évidemment l'indépendance de l'électeur. L'argument est cher aux républicains de la fin du XIXe siècle, mais l'idée n'a pas qu'une valeur polémique : à Villeneuve-sur- Yonne, pendant toute la durée du Second Empire, le maire intervenait directement pour remettre aux votants les bulletins au nom du candidat officiel. Surtout, il faisait placer, à l'Hôtel de Ville, dans la salle qui précède celle où les électeurs déposent leur vote, une table, des plumes, de l'encre, des carrés de papier blanc et des bulletins imprimés au nom du député sortant. Au-dessus de cette table étaient affichés les noms "écrits en gros caractères" des candidats ayant prêté le serment impérial (Archives départementales de l'Yonne, 2 Ml 164).
23
Yves Deloye, Olivier Ihl
n'expriment pas une motivation à choisir. La structure de l'offre électorale constitue l'élément principal de pondération en la matière. Ces différentes variables, trop souvent confondues, obéissent à des logiques relativement autonomes. En tout cas, force est de constater qu'elles ne se recouvrent pas parfaitement. Les bulletins annulés constituent, d'ailleurs, la preuve patente de l'existence d'une autonomie relative de chacune de ces déterminations de l'acte de vote.
Par ailleurs, la diffusion d'une représentation gratifiante du suffrage ne suffit à indiquer ce qu'elle est effectivement pour ses utilisateurs. Il faut encore analyser sa manipulation par les populations concernées, en l'occurrence, les paysans- électeurs. Notre recherche se situe justement dans cet écart entre la définition normative de l'acte de vote et la pratique effective. Si elle a permis de confirmer la permanence de pressions et de pratiques d'encadrement du suffrage1, elle oblige aussi à nuancer ces réalités. Loin d'être voués à la passivité ou à la discipline, certains paysans, particulièrement rusés ou attachés à l'honneur de leur vote, parviennent à s'émanciper de ces tutelles pour produire un suffrage dénoué de toute allégeance. La créativité dont ils font preuve se manifeste dans leurs diverses manières d'user du bulletin de vote. De telles pratiques (pliage, collage...) leur permettent de se réapproprier une formule politique inventée ailleurs. C'est dire qu'il existe dans les campagnes un répertoire largement ignoré de savoir-faire politiques grâce auquel ont pu s'instituer les formes les plus élémentaires d'une conscience civique. Il y aurait danger à le négliger car c'est dans ce même répertoire que les paysans ont puisé pour contester un mode d'énonciation du politique - la citoyenneté républicaine - coupable d'éradiquer, à leurs yeux, des traditions et des appartenances dont tous n'étaient pas prêts à se laisser déposséder^.
Yves Déloye CRP-Sorbonne, Université Paris I
Olivier Ihl EHESS
1. L'ingéniosité déployée dans le domaine des fraudes électorales mériterait à elle seule une étude spécifique. Cela faciliterait notamment la compréhension des usages, multiples et circonstanciés, de la règle de droit dans la compétition politique, règle qui si elle ne peut être prise comme argent comptant n'en exerce pas moins des effets politiques indéniables. Ainsi, la procédure de vérification extra-locale des bulletins "réservés" (par une commission départementale présidée par le préfet) a poussé un imprimeur de l'arrondissement de Montauban à mettre au point, pour le candidat bonapartiste, un papier de vote spécial. De couleur légèrement verte, ce bulletin redevenait complètement blanc, et donc indétectable passées 48 heures (Archives départementales du Tarn et Garonne, 17M1 84, procès-verbal du 21 août 1881). 2. Cet article s'intègre dans une problématique plus large développée dans le cadre d'un groupe de travail (L'acte de vote) interne au C.R.P. Sorbonne.
24