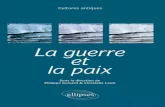La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier avant notre ère
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier avant notre ère
La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C.
Yann DEBERGE, Lionel ORENGO, Matthew LOUGHTON, Guillaume VERRIER*
* YD et ML: ARAFA, Mirefleurs ; LO: Archeodunum SAS ; GV : Inrap Grand-Est-Nord.
INTRODUCTION
Nous disposons, en Limagne d’Auvergne, d’un nombre important d’ensembles pourvus de mobiliers abondants et diversifiés pour les trois derniers siècles avant notre ère. Nous proposons de synthétiser les observations faites sur ces différents ensembles, en présentant pour chaque grande catégorie de mobilier (céramique indigène, vaisselle d’importation, amphore et petit mobilier), les évolutions et les spécificités de la culture matérielle de cette zone située au cœur du territoire arverne, tant du point de vue géographique que politique et économique. Le corpus retenu comprend majoritairement des ensembles issus d’habitats qui ont été étudiés, dans le cadre du PCR «Chrono-typologie des mobiliers du second Age du fer en Auvergne» (Mennessier-Jouannet 1999, 2000, 2001, 2002), par plusieurs collaborateurs (fig. 1). Citons notamment V. Guichard, qui a largement contribué à l’étude des ensembles de La Tène moyenne et finale et, dans une moindre mesure, A. Wittmann. Ponctuellement, il a été fait appel à d’autres ensembles (funéraires notamment : nécropoles de «Gandaillat» à Clermont-Ferrand - Vermeulen 2002 -, de «Sarliève» à Cournon - Deberge 2002d - et de «Rochefort» à Gerzat - Alfonso 2001) pour illustrer certains aspects particuliers tels que les cas d’association de mobiliers. La partie sur le mobilier amphorique synthétise les découvertes faites depuis ces vingt dernières années dans le département du Puy-de-Dôme.
À la fin de cet article, nous détaillerons la périodisation établie sur la base des travaux du PCR qui sert de cadre à notre présentation (voir en fin d’article la fig. 16). Précisons tout de suite qu’elle revêt un caractère provisoire et qu’elle fera l’objet, notamment pour ce qui concerne les propositions de rattache-ment en chronologie absolue, de réajustements ultérieurs. De même, certaines étapes restent très mal documentées (c’est
notamment le cas pour l’ensemble du Ier s. av. J.-C.), ce qui limite la validité de nos observations. Gageons que les fouilles réengagées depuis peu sur les oppida arvernes permettront de préciser, d’ici peu, nos données.
1. LA CÉRAMIQUE INDIGÈNE (YD)
La céramique indigène est un mobilier abondant et forte-ment soumis aux phénomènes de mode. Elle constitue donc un matériel de choix pour l’établissement d’une périodisation. Nous proposons, dans un premier temps, de traiter des prin-cipaux changements technologiques liés à la production de la vaisselle céramique. Ensuite nous retracerons à grands traits l’évolution du répertoire morphologique des grandes catégories céramiques (grossière, fine et peinte) en faisant une large place aux types attestés en nombre.
Cette contribution synthétise une étude qui repose sur un corpus d’environ 37000 restes équivalents à un peu plus de 4400 vases (NMI-bords) provenant de 21 ensembles, essentiel-lement domestiques, étudiés dans le cadre du PCR mentionné plus haut. Il est à souligner que les effectifs disponibles sont très inégaux sur l’ensemble de la période considérée. Deux ho-rizons sont assez mal documentés : le début du IIe s. av. J.-C. et surtout la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. (fig. 2a).
1.1. Evolutions technologiques
Les innovations technologiques dans le domaine de la pro-duction céramique portent sur trois aspects : le choix des argi-les, l’évolution du mode de façonnage et du mode de cuisson.
1.1.1. Le choix des argiles
En l’absence d’une étude détaillée et systématique de la
Yann DEBERGE et alii168 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 169
����������� ���������������
����������� ������������ ����������������
�����������������
���������
��������������
������������������������
���������������������������������
��������� ��������� ��������������������
�������� ����� ��� �� ������� �������������������������
���������������������������������
��������� ��������� ��������������������
����������� ����� ��� �� ������� �������������������������
���������������������������������
��������� ��������� ��������������������
�������� ��� �� � ������� ��������������������������
���������������������������������
��������� ��������� ��������������������
��������� ��� ��� � ������� ������������������������
���������������������������
���� ����������� ����������������������
�������� ����� �� � ������� ����������������������������
���������������������������������
��������� ��������� ��������������������
��������� ��� �� � ������� ������������������������
�������������������������������
���� ��������� ��������������������
��������� ��� �� � ������� �������������
�������������������������������
���� ��������� ��������������������
��������� ����� ��� � ������� �������������
�������������������������
��������� ��������������������
������������������
���������� ����� ��� �� ������� �������������������
���������������������������
���� ��������� ��������������� ������� ��� �� � ��������� �������������������������������
�������������������������
��������� ��������������������
������������������
���������� ����� ��� �� ������� ������������������
���������������������������������
��������� ��������� ��������������������
�������� ����� ��� �� ������� ��������������������������
�����������������������������
���� ��������� ��������������������
������� ����� �� � ������� ��������������������������
���������������������������
���� ��������� ��������������� �������� ����� �� � ������� �������������
������������������������������
���� ����������� ����������������������
�������������������
����� �� � ������ �������������
�����������������������������
���� ����������� ������� �������� ����� ��� ��� ������ �������������
������������������
���� ����������� ��������� ����������������� ��� �� � ����� ���������������������
������������������ ���� ��������� ������� ��������������� ����� ��� � ����� �����������������������������������������
���� ������� ������� ������������ ����� �� �� ����� �����������������������
������������������
���� �������������������
������� �����������������
��� ��� � ����� ��������������
��������������������������
�����������
�����������������������
������� ������������� ��� �� � ����� ��������������
����������������������������
��� ������� ������� ������������ ��� �� �� ����� �����������������������
������������������
���� ����������� ��������� ���������������������
��� �� � ����� ���������������������
������������������ ���� ��������� ������� ��������������� ����� ��� � ����� �����������������������������
���������������������
�����������������������
������� ������� ��� �� �� ����� ��������������
������������������
���� ����������� ��������� ����������������� ����� �� � ����� ���������������������
������������������
���� ����������� ��������� ���������������� ��� �� � ����� ���������������������
������ ����� ���
Fig. 1 : Liste des principaux ensembles retenus pour cette étude. Les effectifs céramiques comprennent également la vaisselle d’importation et les amphores. Les propositions de rattachement en chronologie absolue sont celles figurant dans les
différents volumes du rapport PCR «Chrono-typologie des mobiliers du second Age du fer en Auvergne»
Yann DEBERGE et alii168 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 169
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
finegrossière
0100
200300
400500
600700
800900
10001100
a : effectifs céramiques par étape (en NMI-bord)
b : rapport céramique fine / céramique grossière
0%
50%
100%
tournéemodelée
c : mode de façonnagepour la céramique fine
0%
50%
100%
tournéemodelée
d - mode de façonnagepour la céramique grossière
0%
50%
100%
pâte clairemode Bmode A
e : modes de cuissonemployés pour la céramique fine
582
813
209 216
977
575 556
323
13533
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ����� ����� ����
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ����� ����� ����
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
��
����
�
����
�
����
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
��
����
�
����
�
����
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
��
����
�
����
�
Fig. 2 : Données statistiques concernant la céramique indigène des IIIe, IIe et Ier s. av. J.-C. en Basse-Auvergne. a : effectifs céramiques dispo-nibles pour illustrer chacun des horizons chronologiques ; b : fréquence relative entre céramique à pâte grossière et céramique à pâte fine ; c : évolution du mode de façonnage utilisé pour la confection de la céramique fine ; d : évolution du mode de façonnage utilisé pour la confection
de la céramique grossière ; e : évolution des modes de cuisson employés pour la céramique fine.
Yann DEBERGE et alii170 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 171
nature des pâtes des récipients, il nous est évidemment im-possible d’être précis pour ce qui concerne le choix des argiles employées pour la confection des céramiques. Ce chapitre, volontairement généralisant, permet toutefois de retracer, à grands traits, les principales évolutions que l’on peut observer pour cet aspect de la production céramique.
Le premier phénomène marquant est, au tournant des IIIe et IIe s. av. J.-C., l’apparition d’une différenciation nette du vaisselier entre éléments dédiés au service de table (à pâte fine) et vaisselle culinaire (à pâte grossière). Au début du IIIe s. av. J.-C., la distinction entre ces deux grandes catégories fonctionnelles ne peut être établie en utilisant le seul critère du degré d’épuration de la pâte et en on retrouve fréquemment des éléments liés à la préparation culinaire (pots à cuire par exemple) traités en céramique fine ou mi-fine. Dès la fin du IIIe s., on observe une «rationalisation» dans le choix des argiles qui dépend alors plus nettement de l’utilisation projetée du ré-cipient. Les pâtes riches en constituants grossiers sont de plus en plus fréquemment utilisées pour la confection de la vaisselle culinaire, très vraisemblablement en raison de leur plus grande aptitude à résister aux contraintes mécaniques et thermiques. Ce phénomène précède de peu une standardisation poussée, que l’on observe pour le IIe s. av. J.-C., dans la nature des cons-tituants employés pour la confection des récipients à cuire et de stockage : argile abondamment dégraissée à l’aide d’un sable granitique contenant quelques éléments volcaniques. Jusqu’à la fin de ce siècle, la nature de la pâte associée à cette catégorie de récipients change très peu. Ces constatations alliées à la très forte standardisation morphologique que l’on observe pour ces récipients sont les indices probables de l’existence d’une pro-duction centralisée pour ce secteur du territoire arverne (une même pâte pour un même récipient = un même centre de pro-duction ?). Les changements que l’on observe, au début du siè-cle suivant, dans la nature de la pâte utilisée (qui devient alors très riche en micas) témoignent de nouveaux changements dans l’organisation de la production de la vaisselle culinaire (déplacement du centre de production ou utilisation d’autres sources de matières premières ?).
L’une des conséquences marginales de la généralisation de l’emploi des pâtes riches en constituants grossiers, à partir de la fin du IIIe, est l’augmentation de la place occupée par les céramiques dites «à pâte grossière» sans que cela traduise vé-ritablement un changement dans les modes de consommation de la céramique. En d’autres termes, on ne consomme pas plus de vaisselle culinaire mais on change la façon de la produire en utilisant une pâte moins épurée (fig. 2b).
Pour la céramique fine, peu de changements sont percep-tibles pour ce qui concerne le choix des argiles. Ceci est en grande partie dû à l’absence de dégraissants visibles à l’œil nu dans ces pâtes souvent assez fortement épurées. On note toutefois que les productions de la fin du IIIe et du début du IIe s. av. J.-C. (soit La Tène C) sont fréquemment caractérisées par des pâtes soyeuses de couleur rose orangée à dégraissant
volcanique de très petite dimension. Pour le reste, sauf à cons-tater que la pâte contient des paillettes de micas, il n’est que très rarement possible de relever des éléments distinctifs entre les différents récipients (dans quelques cas on note la présence d’inclusions de grains de quartz, de chamotte ou de calcaire). La principale innovation consiste en l’utilisation, à partir du dernier quart du IIe s. av. J.-C., d’une argile kaolinique pour la confection des imitations régionales des cruches à col cylindri-que d’importation. Ce matériau est déjà utilisé en Bourbonnais depuis au moins le milieu du IIe s. av. J.-C. pour la confection de récipients appartenant pleinement au répertoire indigène (information orale D. Lallemand). En Limagne, l’utilisation de cette argile se développe tout au long de la période en se limitant, à quelques exceptions près (forme indigène à panse élevée, jattes carénées, et à la toute fin du Ier s. av. J.-C., terra nigra) au répertoire des cruches.
1.1.2. Le façonnage
D’une manière générale, on note une progression sur l’en-semble de la période considérée du façonnage au tour (rapide ou lent - tournette). Son utilisation concerne principalement la céramique fine (fig. 2c) : apparition de l’usage du tour dans le courant du IIIe s. av. J.-C., généralisation progressive dès le début du IIe s. puis disparition quasi totale du recours au modelage à la fin de ce siècle. L’usage du tour pour les céra-miques grossières est également connu dès le début du IIe s. mais reste limité à un groupe de production (pots à cuire tournés) qui est représenté de façon marginale (2 à 3 % du NMI selon les ensembles) tout au long de la période (fig. 2d). L’utilisation du tour pour le façonnage des récipients en céra-mique grossière (pots de stockage, pots à cuire, formes bas-ses) ne progresse de façon significative que dans la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.
1.1.3. Les modes de cuisson
Sur l’ensemble des trois siècles, la cuisson majoritairement employée pour la céramique grossière est celle faite en mode dit primitif (B’) qui confère aux pâtes une teinte hétérogène allant du beige au noir en passant par toutes les gammes du rouge. Quelques éléments témoignent cependant assez précocement (dès le IIe s. av. J.-C.) d’une cuisson en mode réducteur-oxydant (mode A). L’emploi de ce mode de cuisson est néanmoins ré-servé qu’à un seul type morphologique (pots de stockage) et ne concerne qu’une part limitée de ces récipients (rarement plus de 7 % du NMI des ensembles céramiques).
Les changements importants concernent la céramique fine (fig. 2e). Celle-ci, est majoritairement cuite en mode A (mode réducteur-oxydant) avec un enfumage de surface quasi systé-matique du IIIe s. à la fin du IIe s. av. J.-C. Ces productions di-tes «lissées fumigées» semblent avoir fait, la plupart du temps, l’objet d’un engobage de surface avant le lissage et la fumigation
Yann DEBERGE et alii170 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 171
définitive (Andrews 1997). Dans les dernières décennies du IIe s., apparaissent les premiers éléments cuits en mode réducteur total (mode B). L’emploi de ce mode de cuisson progresse très rapidement au Ier s. av. J.-C. pour concerner la grande majorité des éléments fins à la fin du siècle.
1.2. Evolutions morphologiques
L’intérêt des séries arvernes est de présenter de façon précoce, au moins dès le IIIe s. av. J.-C., une partition assez nette entre un service dédié uniquement au stockage et à la préparation culinaire (céramique grossière) et un autre destiné principalement au service de la table (céramique fine). La mise en évidence de ces grands groupes morpho-fonctionnels repose sur le croisement des données technologiques (pâte, cuisson, finition…), morphologiques (forme, épaisseur des parois, volume utile…) et de celles concernant l’utilisation des récipients (traces d’usures, de passage au feu, résidus alimentaires…). Nous n’avons pas ici la place de développer l’argumentaire qui conduit à l’établissement de cet «ordonnancement» du vaisselier laténien (pour un exemple voir Deberge dans ce volume : fig. 11). C’est au travers d’une telle démarche que l’on peut, à l’image de ce qui a été développé dans plusieurs articles du XXVe colloque de l’AFEAF (voir par exemple Meunier 2002, Barral 2002, Malrain 2002, Saurel 2002…), suivre de façon signifiante l’évolution typologique des grandes classes de récipients.
Si le service culinaire témoigne d’un certain conservatisme qui se caractérise par une pérennité des grandes classes mor-phologiques sur toute la période, la céramique fine (de table dans la majorité des cas) montre un renouvellement fréquent qui témoigne du dynamisme de cette production.
1.2.1. La céramique grossière (fig. 3)
Dès le IIIe s. av. J.-C. trois grands groupes morpho-fonction-nels peuvent être individualisés : les pots de stockage, les pots à cuire et les formes basses. Les deux premiers témoignent sur l’ensemble de la période d’une grande homogénéité de forme et de mode de finition même si sur le long terme des modifica-tions sont perceptibles.
Les pots de stockage (contenance de 30 à 40 litres), mis à part quelques rares exemplaires sub-ovoïdes du IIIe s. av. J.-C., sont tous par la suite de forme ovoïde ou globulaire. Le bord, probablement repris au tour, est systématiquement lissé et un décor incisé/estampé est toujours présent à la liaison col/panse. L’évolution de ces récipients tient surtout en une modification du profil de la lèvre qui, de simplement vertical au début du IIe s. av. J.-C., va en complexifiant (profils à méplat au Ier s. av. J.-C.), au changement du mode de décoration (évolution du motif incisé) et de la finition employée (abandon du raclage utilisé au IIIe s. av. J.-C. au profit du balayage de surface qui se généralise dans la seconde moitié du IIe s.).
Pour les pots à cuire (contenance de quelques litres), les changements morphologiques sont plus nets puisque l’on passe progressivement de la forme sub-ovoïde (IIIe s. av. J.-C.), à la forme ovoïde (fin IIIe/début IIe s. av. J.-C.), puis à la forme globulaire (seconde moitié IIe s. av. J.-C.), pour revenir finale-ment à une forme plus ovoïde (début Ier s. av. J-.C.). Chacune de ces formes est représentée sur une durée comprise entre 50 et 75 ans avec des chevauchements parfois assez importants (fig. 3a). Ces récipients témoignent d’une homogénéité de leur mode de finition (lissage systématique du col) et de décoration (incisions à la liaison col/panse) même si quelques modifica-tions sont perceptibles au cours de la période (évolution dans la finition comparable à celle des pots de stockage, modification du décor incisé).
Pour chacune des étapes individualisées, ces formes hautes présentent une grande homogénéité morphologique, technolo-gique et décorative qui témoigne d’une standardisation poussée peut-être révélatrice de l’existence d’un nombre très limité de centres de production.
Pour les formes basses (essentiellement des jattes à bord rentrant), la situation est plus contrastée puisque l’on observe une grande variabilité de profil, de finition et de décoration quelque soit l’horizon chronologique concerné. La faible standardisation morphologique de ces récipients témoigne probablement d’une production relativement éclatée. Les grandes tendances concernant le mode de finition observée sur les formes hautes sont néanmoins perceptibles pour les formes basses (abandon du raclage et généralisation du balayage de surface dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.) même si la plupart des récipients font, tout au long de la période, assez fréquemment l’objet d’une finition par égalisation ou lissage de surface. La principale nouveauté consiste en la large diffusion, peu avant le milieu du IIe s. av. J.-C., d’une jatte à anse horizon-tale destinée à la cuisson (jatte d’Aulnat) et d’une jatte à bord moulurée parfois pourvue d’un bec verseur. Si la jatte à bord mouluré entre directement en concurrence avec la tradition-nelle jatte à bord rentrant (fig. 3b) ce n’est pas le cas de la jatte d’Aulnat qui, bien que très fortement représentée pour la se-conde moitié du IIe s. (jusqu’à près de 20 % du NMI total), n’en-traîne pas une diminution de la fréquence des autres formes basses. Ces éléments «nouveaux» présentent une très grande homogénéité morphologique, technologique et décorative qui laisse supposer l’existence d’un nombre très limité de centres de production. Si la durée de vie de la jatte d’Aulnat ne semble pas dépasser la fin du IIe s. av. J.-C., les jattes à bord mouluré ou bord rentrant connaissent une évolution semblable avec un lent déclin suivi d’une disparition dans les dernières décennies du Ier s. av. J.-C.
1.2.2. La céramique fine (fig. 4 et 5)
Comme pour la céramique grossière, trois grandes catégo-ries morpho-fonctionnelles peuvent être individualisées : les
Yann DEBERGE et alii172 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 173
��� ��� ��� ��� ��� �� �
��
��
��
��
�
�
�
��
���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �
������
����������
�����������
���������� ������
���
���
� � ��������� �� �� ��������� ��� ���� � �����
��
��
��
�
�
���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �
���� ��������
���
���
����� ��������
���� �������
� � ��������� �� �� ��������� ��� ������ ������
���� �� ��������
����������
������
����������
������
����� � ������������
�������������
����� � �����������
���� � �����
������ ������
Fig. 3 : Evolution du répertoire de la céramique modelée à pâte grossière (éch. 1/20e).
Yann DEBERGE et alii172 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 173
formes hautes de grande contenance (jusqu’à 20 litres), les for-mes hautes de faible et moyenne contenance (de 0,5 à 5 litres) et les formes basses (moins de 3 litres). Pour la grande majorité de ces récipients, les volumes utiles excluent une utilisation autre que le stockage de petites quantités de denrées, le service et la consommation des aliments.
Contrairement à ce qui a été vu pour la céramique gros-sière, les formes hautes fines (fig. 4) présentent une assez grande diversité morphologique et on note souvent la présence conjointe, pour une même étape, de plusieurs types différents (souvent 4 ou 5). Cette diversité morphologique couplée à une grande variabilité dans le degré d’épuration de la pâte ou dans la qualité de la cuisson employée (mode A plus ou moins réduc-teur ou oxydant) rend difficile l’individualisation de groupes de production homogènes.
L’évolution de la morphologie des formes hautes témoigne d’un renouvellement partiel du répertoire tous les 50 à 75 ans. Globalement, sur les trois premiers quarts du IIe s., le corpus relève d’une même ambiance culturelle héritée en grande partie de la seconde moitié du IIIe s. (grandes formes hautes souvent pourvues d’un épaulement et comportant des déco-rations faites au lissoir). Dans les dernières décennies du IIe s. av. J.-C., on assiste à l’apparition des premières imitations locales des cruches à col cylindrique à pâte claire et des pichets à col tronconique d’importation. Au Ier s. av. J.-C., ces formes exogènes connaissent la faveur des potiers et consommateurs locaux même si parallèlement le fond d’inspiration indigène se renouvelle. Ce renouveau morphologique s’accompagne de la diffusion des nouveaux modes de décoration (décor au peigne et à la molette) et des innovations technologiques (utilisation de pâte kaolinique, cuisson en mode B) de la fin du IIe s. av. J.-C. Dans la seconde moitié du Ier s., le répertoire des cruches à pâte claire se diversifie de façon significative (fig. 4a). C’est éga-lement à cette période qu’apparaissent les premières imitations des gobelets à paroi fine d’importation.
Pour les formes basses, le processus d’évolution morpholo-gique peut être scindé en deux étapes (fig. 5). Du début du IIIe au milieu du IIe s. av. J.-C. le répertoire évolue peu. Il comprend les jattes à profil en «S», en voie de disparition, et les jattes à bord rentrant, alors majoritaires. Les modifications observées sont alors de l’ordre du détail et concerne le profil de ces deux formes. Peu avant le milieu du IIe s., apparaissent des éléments qui reproduisent, dès le départ en les adaptant aux goûts locaux, des formes issues du répertoire de la vaisselle d’importation. Ces éléments sont représentés de façon sans cesse croissante jusqu’à dépasser quantitativement la jatte à bord rentrant au début du Ier s. av. J.-C. Les formes imitées suivent avec un léger décalage le rythme des importations. Il s’agit d’abord de formes empruntées au répertoire de la campanienne A (coupes Lamb. 27 – à partir de 160 av. J.-C. -, bols dérivées des Lamb. 31/33 - à partir de 140 av. J.-C. et jusqu’au changement d’ère : cette forme dominera le corpus des imitations -, coupes ou assiettes à marli Lamb. 6/36 – surtout à partir de 130 av. J.-C.) puis de la
campanienne B (assiettes Lamb. 5 - à partir de 110 av. J.-C. - et plus ponctuellement coupes Lamb. 1 et Lamb. 2 - à partir de 80 av. J.-C.). Il est à noter que les potiers arvernes ont reproduit en masse la forme qui faisait apparemment le plus défaut dans le corpus des importations (à savoir les bols Lamb. 31/33) alors que les formes ansées ou les coupes Lamb. 27, pourtant bien attestées, n’ont pas ou peu été reproduites. La seconde moitié du Ier s. av. J.-C. voit l’apparition des imitations de plat à cuire italique (d’abord en céramique fine enfumée puis en céramique claire engobée) et, à la toute fin de la séquence, les premiers emprunts au répertoire de la sigillée italique.
La période du Ier s. av. J.-C. constitue toutefois une période de renouveau de la créativité des potiers gaulois qui se traduit par une modification substantielle de la morphologie des jattes à bord rentrant qui présentent désormais un profil évolué par comparaison avec les séries du IIe s. av. J.-C. (panse tendue, lèvre rectiligne rainurée, pied annulaire) et par l’apparition d’une nouvelle forme (la jatte carénée), d’abord traitée en pâte claire ou en céramique peinte, puis en céramique fine cuite en mode B. Elle domine le corpus des formes basses à partir du milieu du siècle.
Pour résumer, à une phase de production où dominent les formes d’inspiration indigène héritées du IIIe s. av. J.-C., succède une période pendant laquelle les modèles originaires d’Italie sont privilégiés. Ce phénomène qui conduit au bascule-ment en faveur des seconds au tournant des IIe et Ier s. av. J.-C. a une origine ancienne puisque les premiers emprunts faits à ce répertoire semblent antérieurs au milieu du IIe s. av. J.-C. La reproduction de ces formes exogènes a débuté avec les formes basses et il faut attendre la seconde moitié du IIe s. pour que les premières copies de formes hautes fassent leur apparition.
1.2.3. La céramique peinte
Cette catégorie spécifique de céramique a déjà fait l’objet de plusieurs présentations détaillées concernant son mode d’ornementation (Guichard 1987, 1994 et 2002). Nous nous contenterons ici, à partir d’un corpus de 149 individus, de replacer à grands traits ces phénomènes dans une perspective chronologique (fig. 4b).
Tout d’abord, il est à noter que la représentation de ce type de récipient connaît une évolution centrée sur le IIe s. av. J.-C. Quasiment absente des contextes du IIIe s., la céramique peinte est particulièrement bien représentée dans les ensembles de la première moitié et, de façon moindre, de la seconde moitié du IIe s. Le passage avec le Ier s. av. J.-C. marque un tournant et la céramique peinte semble absente des contextes postérieurs à la Conquête.
Au IIIe s. av. J.-C. les rares exemplaires dénombrés adop-tent un profil à épaulement également attesté dans le réper-toire de la céramique fine. Au IIe s. se développe un répertoire morphologique distinct de ce dernier. L’évolution du mode de décoration (géométrique, curviligne et zoomorphe) est syn-
Yann DEBERGE et alii174 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 175
300
200
150
200
150
100
100
500
a - p
âtes
cla
ires
régi
onal
es
100
500
12 810 2 0 300
250
200
175
150
125
100
7550
250
% du NMI 46
form
es b
asse
s
12 810 2 0 300
250
200
175
150
125
100
7550
250
% du NMI
4616 14
b - p
eint
es
Fig.
4 :
Evo
lutio
n du
rép
erto
ire
des
form
es h
aute
s en
cér
amiq
ue fi
ne (é
ch. 1
/20e ).
Yann DEBERGE et alii174 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 175
chrone avec celle de la morphologie du support. Au début du IIe s. av. J.-C. les formes sont ovoïdes et comportent un décor géométrique. Quelques rares éléments en forme de tonnelets à décor curviligne sont également présents. Peu avant le milieu de siècle apparaissent des formes hautes à panse fuselée, petit col droit et pied cintré qui servent de support à un décor géo-métrique (damier) ou curviligne parfois à caractère zoomorphe (décor animalier de style 1 - sur fond de résille -, de style 2 - dis-posé en métope - ou de style 4 - surchargé ou «baroque»). Ces formes et modes de décoration évoluent apparemment assez peu jusqu’au dernier quart du IIe s. av. J.-C. La fin du IIe s. et le début du siècle suivant marquent le déclin de la céramique peinte à figuration zoomorphe. Les formes fuselées comportent alors un décor géométrique fréquemment constitué de bandes ondées disposées verticalement. C’est également au cours de cette phase qu’apparaît une nouvelle variante morphologique, à pied très cintré et ouverture large, intégralement peinte en blanc et qui est également reproduite en céramique fine.
Pour les formes basses, le répertoire morphologique est identique à celui de la céramique fine. Il suit la même évolu-tion : jatte à profil en «S» (vers 250-160 av. J.-C.), jatte à bord rentrant (tout le IIe s. av. J.-C. avec un exemplaire à décor animalier), imitation de campanienne (Lamb. 31/33, Lamb. 36, Lamb. 6 et Lamb. 5 ; vers 150-75 av. J.-C.) et jatte carénée (vers 75-50 av. J.-C. dont un exemplaire à figuration zoomorphe).
1.3. Synthèse
Au cours du IIIe s. av. J.-C. (la fin de La Tène B2 et La Tène C1), et surtout dans la seconde moitié du siècle, on assiste à la mise en place d’un nouveau répertoire pour la céramique fine et grossière. Celui-ci, qui est en partie hérité des phases anciennes de La Tène (jatte à paroi incurvée ayant évolué vers des exem-plaires à bord rentrant, jatte à profil en «S», pot à cuire sub-cylindrique évoluant vers des formes plus ovoïdes), comprend une part de nouveautés sur le plan morphologique (formes hautes à épaulement, vases ovoïdes, pots de stockage) et déco-ratif (généralisation des décors faits de bandes lissés). Le réper-toire de la céramique fine se développe dans la première moitié du IIe s. parallèlement à la diffusion de l’usage du tour, tout en respectant les canons stylistiques établis précédemment : pro-fils complexes avec la présence d’épaulements, de pincements et de pieds creux plus ou moins hauts. Celui de la céramique grossière évolue de façon moins marquée témoignant ainsi du conservatisme des potiers ou des consommateurs dans le domaine de la vaisselle culinaire. La standardisation observée tant sur le plan morphologique que technologique, de même que la présence de groupes de production homogène, témoi-gnent de l’existence précoce, dès la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C., d’ateliers spécialisés qui restent toutefois à localiser.
La seconde moitié du IIe s. av. J.-C. constitue une nouvelle étape dans l’évolution des répertoires céramiques avec d’une part l’ouverture de celui de la céramique fine aux influences
méditerranéennes (d’abord les formes basses puis les formes hautes) et d’autre part avec l’apparition d’un véritable service culinaire très standardisé (service de la jatte d’Aulnat). D’une manière générale, les formes héritées du répertoire de la pre-mière moitié du siècle tendent à être délaissées de même que les modes de finition et de décoration alors en usage. La fin de cette période est également marquée par des innovations tech-nologiques (pâte kaolinique, cuisson en mode B) et décoratives (molette) majeures.
Le Ier s. av. J.-C. correspond à une phase de développement de ces nouveaux acquis tant sur le plan technologique (géné-ralisation du mode de cuisson réducteur, augmentation de la place occupée par les éléments à pâte claire), décoratif (géné-ralisation des décors moletés ou peignés) que morphologique (poursuite du processus d’imitation, évolution des formes déjà présentes). Quelques créations nouvelles (des recréations ?) sont néanmoins faites peu avant le milieu du siècle avec notam-ment celle de la jatte carénée. La seconde moitié du siècle voit l’apparition de nouvelles solutions décoratives probablement inspirées du répertoire de la céramique d’importation mais qui ne sont pas inconnues des potiers gaulois : engobage de surface blanc ou rouge qui rappelle, au moins par l’aspect, la cérami-que peinte du IIe s.
Pour résumer, au IIIe s. av. J.-C. on assiste à la mise en place du corpus que l’on retrouve tout au long du IIe s. av. J.-C. C’est également à cette période que les premiers indices de l’existence précoce d’ateliers spécialisés sont perceptibles et ce pas uniquement pour des productions spécifiques telles la céramique peinte. Dans le courant du IIe s., on assiste au développement des emprunts faits au domaine de la céramique d’importation. Le début du Ier s. av. J.-C. témoigne de change-ments importants, déjà engagés à la fin du siècle suivant, tant sur le plan morphologique que technologique et décoratif. Il est possible que les changements socio-économiques que connaît alors la Limagne, avec le déplacement du chef lieu de cité et l’abandon d’un grand nombre de sites de plaine, ont influencé le domaine de la production céramique. Pour le reste du siècle, les modifications sont minimes et le passage vers la «romanisa-tion» est à peine perceptible.
Pour finir, le mobilier céramique examiné présente des spécificités propres qui attestent l’existence d’un faciès micro-régional centré sur la Limagne. Si on élargit notre aire d’étude, certains types pourtant très bien représentés dans le sud de la Grande Limagne (tels la jatte d’Aulnat et le service associé), sont absents dès que l’on s’éloigne de ce secteur (au-delà d’une ving-taine de kilomètres). De même, les pots à cuire et de stockage dit de «Besançon» bien représentés dans l’Allier (par exemple à Varennes-sur-Allier ; Lallemand dans ce volume) sont quasi-ment absents des ensembles sud-limagnais (3 mentions sur plus de 4 000 vases identifiés). Il faut cependant noter que pour le reste les affinités entre le mobilier céramique du Bourbonnais et celui de la Limagne sont très fortes même si ces observations montrent qu’il existe des faciès micro-régionaux qui sont proba-
Yann DEBERGE et alii176 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 177
�
���
���
���
���
���
� �
� �
�� ���� �� � ���
���
���
���
���
���
���
����
���
��������
���
������
�����������
�����
����
����
�����
����
����
����
����
��������
����������
����
��������
������
��
�� �� � � � ���
���
���
���
���
���
���
����
���
�������
������
�������
���
������
�����������
�����
����
����
�����������
�������
����
��
�������
������
�����
��������
���
�����
���
� ���������
�������
�����
���
�������
�������
�������
������
�������
����
���� ���
����
���
�����
������
�
������� �
������
�����
Fig.
5 :
Evo
lutio
n du
rép
erto
ire
des
form
es b
asse
s en
cér
amiq
ue fi
ne (é
ch. 1
/20e ).
Yann DEBERGE et alii176 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 177
blement révélateurs de découpages sinon politiques du moins culturels et probablement économiques au sein même du terri-toire arverne. Le site d’Aigueperse situé à une vingtaine de kilo-mètres du bassin clermontois semble correspondre à une zone de contact entre deux de ces entités puisque l’on y rencontre en proportion sensiblement équivalente des jattes d’Aulnat et des vases de types Besançon (Featherby étude inédite).
D’une manière plus générale, si les différences avec les ensembles micro-régionaux voisins sont importantes, elles le sont encore plus avec les grands ensembles régionaux limitrophes. Pour exemple, le faciès limagnais apparaît, au moins pour le IIe et le Ier s. av. J.-C., très éloigné de celui connu à Levroux (Buchsenschutz 1994 ; Levéry 2000 : fig. 17). Outre les différences importantes observées dans la morphologie des récipients (à l’exception des jattes à bord rentrant), deux phénomènes apparaissent comme marquant : la rareté au IIe s. de la céramique peinte (et particulièrement celle à figuration zoomorphe) et la quasi absence des emprunts faits à la céramique italique avant le plein Ier s. av. J.-C. A l’opposé, les Arvernes partagent avec leurs voisins ségusiaves et éduens, plusieurs points communs dont un goût prononcé pour la céramique peinte à décoration élaborée et la reproduction précoce (dès la seconde moitié du IIe s.) et massive de la vaisselle d’importation, qui plus est en adoptant un répertoire proche (Barral 1999 et 2002, Vaginay 1988, Genin 1992, Lavendhomme 1997). Toutefois, les différences observées notamment dans le domaine de la céramique culinaire (présence de la vaisselle dite de Besançon) mais aussi, et à quelques exceptions près (dont la jatte à bord rentrant et les imitations de campanienne), pour la céramique fine sont notables. Elles témoignent, au-delà de l’appartenance à une même entité culturelle du Centre Est de la Gaule, de l’existence de variations dans les vaisseliers céramiques entre ces différentes cités. Pour ce qui concerne le sud et l’ouest, nous manquons d’éléments de comparaison. A noter toutefois, les parentés que l’on peut observer avec plusieurs ensembles issus des territoires vellaves (oppidum de La Roche Lambert - Izac-Imbert 2001 - et Bas-en-Basset - Simonet 1983) et mêmes rutènes (site de la «Caserne Rauch» à Rodez - Gruat 1991). On y retrouve parfois des éléments céramiques typiquement limagnais tels que la jatte d’Aulnat (à Bas-en Basset et à Rodez).
2. LA VAISSELLE D’IMPORTATION (GV)
En ce qui concerne les importations de céramique fine, le problème principal tient à la faiblesse du corpus, comme sur l’ensemble des sites de la fin de La Tène situés au nord du Massif central.
Pourtant, la rareté des importations en plaine de Grande Limagne est toute relative puisque les sites de cette région sont parmi les plus fournis de Gaule interne. Ainsi pour avoir un ordre d’idée, on compte 506 tessons de céramique importée sur
le sites de Clermont Ferrand «La Grande Borne/Gandaillat/Rue Reclus» (133 vases ; effectif au mois de juin 2003 sans prendre en compte les découvertes de R. Périchon) et 213 NR (59 NMI) sur le site de Clermont-Ferrand «Pâtural», tous deux occupés aux IIIe et IIe s. av. J.-C. A titre de comparaison, on en dénom-bre environ 190 récipients à Roanne qui est considéré actuel-lement comme l’un des plus gros gisements de Gaule interne pour les IIe-Ier s. av. J.-C. (Lavendhomme 1997) ou encore 685 NR (pour 152 NMI) à Verdun-sur-Le Doubs «Le Petit Chau-vort» (Saône-et-Loire) (Verrier 2001).
Si pour le IIe s. av. J.-C., et dans une moindre mesure le IIIe s. av. J.-C., nous possédons d’ensembles conséquents, et à notre avis suffisamment représentatifs de ce phénomène d’échange, nous constatons certaines distorsions pour le Ier s. av. J.-C. avec des ensembles numériquement faibles ou issus de contextes particuliers, tels que des dépôts dans des ensembles funéraires. Ceci ne va pas, bien entendu, sans nous poser quel-ques problèmes pour cerner l’évolution des importations de vaisselle céramique au cours du dernier siècle avant notre ère.
2.1. Les différents types d’importation (1)
2.1.1. Les importations de céramiques à vernis noir (fig. 6, 7a et 7b)
On notera pour la fin du IVe ou le début du IIIe s. av. J.-C., la présence d’un fragment de céramique à vernis noir dans les niveaux inférieurs du chemin 8 du site de «La Grande Borne». Pour l’instant, nous n’avons pas pu en déterminer l’origine. Il semblerait qu’il s’agisse d’une anse horizontale de cratère.
Les premières importations de céramique à vernis noir de type campanienne A apparaissent au cours de la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C. sur les sites de «La Grande Borne» et du «Pâ-tural». Aucune forme n’a pu être identifiée mais elles semblent appartenir dans leur majorité à de petits bols de type Lamb27ab. A la fin de ce siècle, le répertoire se diversifie (apparition des formes Lamb. 68bc, Lamb. 42Bc, Lamb. 27B, Lamb. 28, Lamb. 27ab et Lamb. 36).
Comme à l’accoutumé en Gaule interne pour les deux der-niers siècles avant notre ère, les céramiques campaniennes A et B-oïde sont les mieux représentées. Les campaniennes à pâte grise restent très marginales et n’apparaissent que dans le cou-rant du Ier s. av. J.-C.
Pour ce qui est de la forme des campaniennes (fig. 6), on constate dans les deux derniers tiers du IIe s. av. J.-C., l’écrasante majorité des coupes Lamb. 27B, suivies de loin par quelques assiettes Lamb. 36. Pour le Ier siècle, les formes Lamb. 5 puis Lamb. 1 en campanienne B-oïde deviennent majoritaires.
L’inversion de la proportion campanienne A / campanienne B-oïde se situe dans la plaine de Grande Limagne autour de 100 avant J.-C. (fig. 7a et 7b). Ce phénomène semble être général aux différentes régions de Gaule interne (Morel 1985). Pourtant, il est intéressant de constater que le type B-oïde au Ier s. av. J.-C.
Yann DEBERGE et alii178 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 179
������������������������
��
��
��
��
���
����
�
��
��
��
���
���
����� ���������
�����
�����
����
�����
�����
��
����
��
�
�
�
Fig. 6 : Répertoire morphologique de la céramique à vernis noir des IIIe, IIe et Ier s. av. J.-C. en Basse Auvergne(ont été exclus les ensembles funéraires). La numérotation renvoie à la typologie élaborée par N. Lamboglia (Lamboglia 1952).
Un point correspond à un individu, les diamètres sont ensuite proportionnels.
Yann DEBERGE et alii178 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 179
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Verdun-sur-Le Doubs /Le Petit Chauvort
Lyon / Rue duSouvenir - Rue
Marietton
Clermont-Ferrand / LePatural 3
Clermont-Ferrand / LaGrande Borne
PCCamp A
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Verdun-sur-LeDoubs/Le Petit Chauvort
Lyon / Rue duSouvenir - Rue
Marietton
Clermont-Ferrand / LePatural 3
Clermont-Ferrand / LaGrande Borne
CoupeAssiette
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4% NR / Total (sauf amphores)
% NMI / Total (sauf amphores)
a : évolution de la fréquence des campaniennes A et B au sein des ensemblescéramiques (en % du NR total hors amphores)
b : évolution de la fréquence des campaniennes A et B au sein des ensemblescéramiques (en % du NMI total hors amphores)
c : évolution de la fréquence des pâtes claires importées au sein des ensembles céramiques (en % du NR total et du NMI total hors amphores)
d : rapport entre pâtes claires importées et campanienne A sur plusieurssites de Gaule du Centre Est dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.
e : rapport assiettes / coupes sur plusieurs sites de Gaule du Centre Estdans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.
�������
�������
�������
�������
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ����� ����� ���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ����� ����� ����
������� ������� ������� ������� ������� �������
Fig. 7 : Données statistiques concernant la céramique d’importation des IIIe, IIe et Ier s. av. J.-C. en Basse Auvergne.
Yann DEBERGE et alii180 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 181
n’atteindra jamais les taux de la campanienne A du siècle précé-dent (il est vrai que le tout reste assez faible, entre 1,5 % et un peu plus de 2 % des NMI de l’ensemble des céramiques pour ces deux siècles).
2.1.2. Les importations de céramiques à pâtes claires (fig. 7c)
Nous avons pu recenser quelques importations dès la fin du IVe s. av. J.-C. et durant la première moitié du siècle suivant. Il s’agit de vaisselle à pâte claire, de type massaliote (cruche de type CL-MAS 525 et 546, mortier de type CL-MAS 633 ou coupe à anse de type CL-MAS 410 ou 433), encore peu représentée il est vrai (moins de 0,4 % en NMI du total des céramiques).
Dans la deuxième moitié du IIIe s. av. J.-C., leur taux est un peu plus élevé (1 % en NMI du total des céramiques).
Pour le siècle suivant, leur présence évolue peu à peu, pas-sant de 1 % à la fin du IIIe s. av. J.-C. jusqu’à un peu plus de 2 % vers la fin du IIe s. av. J.-C. Nous ne possédons pas pour l’instant toutes les données pour le Ier s. av. J.-C., n’ayant pas encore achevé de séparer, pour les ensembles de ce siècle, les véritables importations des imitations locales (qui commencent à être produites dès le dernier quart du IIe s. av. J.-C.). Il ne sem-ble pas toutefois que la fréquence des céramiques à pâte claire d’importation ait dépassé, pour le Ier s., les 2 % du nombre total de céramique (en NMI).
Les formes les plus représentées au IIe s. av. J.-C. sont les cruches suivies de loin par les mortiers (CL-MAS 633). Les pre-mières évoluent vers le modèle dit «républicain» (CL-REC 1), courant à la fin de La Tène en Gaule interne (cruche à bord en bourrelet).
2.1.3. Les autres types de céramiques importées
Il convient de noter tout d’abord la présence d’un pot en céramique commune de provenance méditerranéenne, dans un ensemble clairement daté de la première moitié du IIIe s. av. J.-C. (Clermont Ferrand «La Grande Borne» chemin 8).
Pour les autres types d’importations, très peu représentés, on peut se borner à constater la présence sporadique de céramique grise de la côte catalane dès la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C. (Clermont Ferrand «Le Pâtural» fosse 309). Il ne s’agit jamais de plus d’un ou deux exemplaires par ensemble et l’on retrouve cette présence assez lâche jusque dans la première moitié du Ier s.
Dès la fin du IIe s., on remarque la présence de quelques balsamaires, de gobelets à paroi fine et de céramique culinaire italique (plat à cuire, caccabae et couvercle). Le tout se retrouve de façon sporadique et totalement marginale tout au long du Ier s. av. J.-C.
2.2. Un faciès régional
Globalement, le faciès de la plaine de Grande Limagne ne
semble pas dénoter par rapport aux autres régions de Gaule du Centre Est. Pourtant, dans le détail, certaines particularités ressortent.
Ainsi, pour la seconde moitié du IIe s. av. J.-C., des différen-ces de faciès apparaissent dans les importations de céramique fine, différences qui ne nous semblent pas fortuites.
Au niveau des catégories de céramiques importées, nous avons constaté de fortes disparités entre le faciès de la plaine de Grande Limagne et celui de la vallée de la Saône. Si, sur les sites de cette région, les importations de campanienne A et de pâte claire se font à des taux équivalents, il n’en est pas de même autour de Clermont Ferrand. Là, les importations de pâtes claires sont clairement minoritaires par rapport aux céra-miques campaniennes A (fig. 7d). La cause ou la conséquence de ce phénomène est peut-être l’existence d’une production précoce (dès la fin du IIe s.) d’imitations de cruches à pâte claire républicaines d’importation.
De même, si l’on prend simplement les formes de cérami-que campanienne A pour cette même période, la différence reste sensible entre les sites de La Tène D1a des deux régions. Les assiettes semblent ainsi mieux représentées dans la vallée de la Saône par rapport aux coupes, la proportion s’inversant dans le bassin clermontois (fig. 7e).
Il y a donc tout lieu de penser que les deux régions sont irri-guées d’une manière différente en céramiques importées. Pour l’instant, nous ne pouvons dire s’il s’agit d’un problème d’offre ou de demande.
2.3. Synthèse
Pour conclure ce court (et encore très incomplet) aperçu des importations de vaisselle céramique dans la plaine de Grande Limagne, nous voudrions insister sur le fait que les régions de Gaule interne doivent faire l’objet d’une étude plus approfondie (2). En effet, des différences sensibles semblent apparaîtrent au niveau des faciès d’importation. Ces différences semblent rejoindre les dernières conclusions des études sur les amphores sur des diffusions privilégiées de certains vignobles vers des zones particulières de Gaule interne (3) même si ici, l’origine de ces différences ne peut pas encore être clairement établie.
3. LES AMPHORES (ML) Pour le département du Puy-de-Dôme nous disposons de
près de 100 points de découvertes relatifs aux amphores répu-blicaines (fig. 8 ; Loughton, Jones 2000). Au total, notre corpus compte 80 000 tessons d’amphores (plus de 9 tonnes) équivalents à 2 400 récipients qui proviennent de sites ruraux, d’aggloméra-tions, de lieux de cultes, de structures funéraires et d’oppida. Les sites de Corent et de «Gandaillat/La Grande Borne» livrent les plus gros effectifs avec respectivement plus d’un millier et plu-sieurs centaines de récipients chacun. Les quantités d’ampho-res présentes sur ces sites restent toutefois très variable d’une
Yann DEBERGE et alii180 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 181
����������������
������
�������
����������
������
�����
����
����
����
����
���
��������������
���������
����������
�����������
������������������������
� ������������
Fig. 8 : Carte de distribution des découvertes d’amphores républicaines dans le département du Puy-de-Dôme (d’après Loughton et Jones 2000).
structure à l’autre. Certaines fosses sont remplies de fragments d’amphores alors que d’autres en sont quasiment exemptes sans que cela soit toujours lié à la chronologie. Il est donc délicat de résonner en terme de fréquence pour cette catégorie de récipient tant la présence d’amphores au sein des structures semble aléatoire.
3.1. Morphologie
La présentation qui suit sur la typologie et la datation des amphores républicaines sera évidemment brève. Nous invitons le lecteur à se reporter à un article paru récemment (Loughton
2000) en attendant la publication exhaustive des résultats de notre enquête sur les amphores républicaines d’Auvergne (Lou-ghton à paraître).
Les contextes anciens ayant livré des amphores républicai-nes sont relativement rares : une amphore gréco-italique dans une fosse datée du début du IIe s. av. J.-C. à Varennes-sur-Allier dans le département de l’Allier, deux fosses du milieu du IIe s. av. J.-C. sur le site d’Aigueperse «Le Clos Clidor» (fosses 61 et 68) et un fossé de la même période sur le site de Malintrat «Villevaud» (fig. 9).
Quelques amphores ont également été collectées dans des ensembles légèrement plus récents mais toujours en pe-
Yann DEBERGE et alii182 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 183Malintrat/VillevaudAigueperse St. 68
Le Pâtural 3231
Le Brézet Puits 15
L.2Pâte : Cosan
Gandaillat Puits 715
Pâte : La Parina
3
4
5
6
7
8
0 cm 15
9-10
Dr. 7-11 H. 70 L. 2 Dr. 2-4
Corent, Le Bay
Sarliève, Gondole, Chaniat
Gergovie, Chaniat
Gergovie, Chaniat
�������
�������
�������
�������
������
�����
�����
����
Fig. 9 : Répartition de quelques éléments morphologiquement identifiables en fonction de leur appartenance chronologique.
Yann DEBERGE et alii182 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 183
10%
0
20%
30%
40%
50%
60%a - % de gréco-italiques (méthode Hesnard)
b - évolution de la morphologie des lèvres perçue au travers de la méthode des classes (méthode Guichard)
10%
0
clas
se1
20%
30%
40%50%
60%
70%
clas
se1
ou2
clas
se2
clas
se2
ou3
clas
se3 ?
clas
se1
clas
se1
ou2
clas
se2
clas
se2
ou3
clas
se3 ?
clas
se1
clas
se1
ou2
clas
se2
clas
se2
ou3
clas
se3 ?
clas
se1
clas
se1
ou2
clas
se2
clas
se2
ou3
clas
se3 ?
clas
se1
clas
se1
ou2
clas
se2
clas
se2
ou3
clas
se3 ?
clas
se1
clas
se1
ou2
clas
se2
clas
se2
ou3
clas
se3 ?
c - évolution de la hauteur des lèvres
5%
0
10%
15%
20%
25%
30%
35%
20 30 40 50 60 70hauteur (mm)
20 30 40 50 60 70hauteur (mm)
20 30 40 50 60 70hauteur (mm)
20 30 40 50 60 70hauteur (mm)
20 30 40 50 60 70hauteur (mm)
20 30 40 50 60 70hauteur (mm)
������� ������� ������ ��������������
�������
������ ��� ��� ��� �� �� �� �
������� ������ ��������������
Fig. 10 : Statistiques concernant la morphologie des lèvres d’amphores républicaines. a : ratio hauteur/largeur (méthode Hesnard) ; b : répartition en classe pour chaque horizon chronologique (ratio hauteur/inclinaison ; méthode Guichard) ; c : évolution de la hauteur des lèvres d’amphores.
tite quantité (sites du «Pâtural» et de la «Rue E. Reclus» à Clermont-Ferrand). Ces ensembles sont dominés par des exem-plaires à lèvres courtes avec une faible inclinaison (fig. 9 et 10e) qui se rattachent aux classes 1 et 1/2 de V. Guichard (1997a ; fig. 10b). En utilisant la méthode d’identification développée par A. Hesnard (Hesnard 1981) on s’aperçoit que la plupart de ces exemplaires appartiennent au type gréco-italique (fig. 10a). La morphologie de leur pied (haut et gracile) et la largeur im-portante de l’épaulement sont autant de caractéristiques qui confirment cette attribution typologique (fig. 9). L’examen des pâtes nous révèle que ces éléments sont originaires du Latium et de Campanie et non pas d’Etrurie (Loughton à paraître).
Les ensembles attribués à la fin du IIe s. av. J.-C. (La Tène D1a) sont nettement plus fournis en amphores. Le spectre morphologique des lèvres est relativement proche de celui mis en évidence pour l’horizon précédent (fig. 10b et c, fig. 11) et indique, selon les méthodes de classification de Guichard et de Hesnard, la présence toujours importante de gréco-italiques (sites du «Brézet» et de «Pontcharaud» à Clermont-Ferrand ; fig. 9 et 10a). Toutefois, on s’aperçoit que la morphologie des pieds et des épaulements diffère notablement de celle des exemplaires classiques des gréco-italiques décrits plus haut. Exception faite de la forme des lèvres, les amphores présentes dans les ensembles de cette étape se rattachent plutôt au type
Yann DEBERGE et alii184 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 185
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Hauteur(mm)
A
A
AAA
AA A
A
A
A
A
AA
A
AA
A AA A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
AA
A
AAAA
A
A
A
A
AA
A A
AA
A
AAA
A AA A
AAAAA AAA A AAAA AA A A
AAAAAAA AA AAA AAA A AA A
AA AA
A
A
A
A
A
A
AA
AA AAAA
A AA
AA
AA AAA A A
A
A AA
A
AAA
AA
A
A A
AA A A
A
A AA AAA
AAA
A AAAAAAAA AA
AAA AAA
AA
AA
A
AA A A
A
A
AA
AA
AA
AA
A AAA
A
A
A
AA
A
A
A
AA
AA A
AAA
A
A
AAAA
A
A
A
A AAA
A
AAA
AA A
A
AA
A
AAA
A
A
A AA A
A A
AA
A
A
AA
AA
A
AA
A
AA
A
AA
A
A
A
AAAA
AA
A
AA
AA
A
AA A
A
A
A
A AAAAA A
A
A
A
AAA
A
A A
AA
AA
AAA A
AAAA A
A
AA
AA
AA
AAA
AA
AA
AA
A
A AAA
AA
A AAA
A
A
AA
AAA
A
AA
A
A
A
A
A A
A
A
AAA
A
AAA A
A
A
A
AA AA
A
A
A
AA
AA
A
A
A
AAA
A
AAA
A
A AAA
A
AA
A
AA
A
A
A
A
AAAA
A A
AA A
A
A
AA
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110Inclinaison(°)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Hauteur(mm)
A
AA
A
A
AA AA
A AA AA A AA AA A AA AA AA AA AAA AA AA AAAAAAAAA
AA A
AA A AA
A
AA A
AAA
A
A
A
A
A
A
A
A A
A
A
A
AA
A A
A
A
AA
AA A
A
A
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110Inclinaison(°)
A
A
A
A
AAA AA
AA
AA
A
AA AA
AA
A
AA
A
AA
A AA
A
A
A
AA
A
AAA A A
A
A AA A A
AA
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
AA
AA AA
A AA
A
A
AAA
AA
A
A
A
AA
A
A A
AAA
A
AA
A
A
A
AAA
A
AA
A
A
A
A
A
AA A
A
AA
A
A
AA
AAAA
AA
A
AA
AA
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
AAA
A
A
A
A
A
AAA
A
A AAA
A
A
A
AAA
A
AA AAAAA
A
A
A
A
A
A
A AA A
AA
A
A
AA
A
AA
A
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110Inclinaison(°)
AA
A
������� ������� ������
��������������
Fig. 11 : Répartition pour le IIe-Ier s. av. J.-C. des lèvres en fonction de leur hauteur et inclinaison.
Dressel 1A. Cette convergence morphologique est renforcée par les données de l’archéologie sous-marine. En effet, les épaves de Méditerranée indiquent que la grande période d’exportation à vaste échelle des gréco-italiques n’a pas dépassé les années 140-130 av. J.-C.
Ces informations nous conduisent à remettre en cause l’attribution typologique habituelle des amphores découvertes dans les ensembles limagnais de cette étape qui est faite à partir du seul examen des lèvres, en l’absence d’autres éléments mor-phologiques. Il faut envisager l’existence d’une forme hybride pourvue d’une lèvre courte et triangulaire mais présentant tou-tes les autres caractéristiques morphologiques d’une Dressel 1A (fig. 12 ; pour un argumentaire plus détaillé sur cette «Dressel 1G», voir Loughton 2003).
Les exemplaires identifiables à des Dressel 1B sont en tout cas absents des ensembles appartenant à la fin du IIe s. av. J.-C. (4). Quelques lèvres présentent des hauteurs égales ou supé-rieures à 45 mm, ce qui dénote des exemplaires de morphologie évoluée, mais aucune ne dépasse la valeur des 55 mm généra-lement retenue pour identifier les Dressel 1B (fig. 10c). Tradui-
tes en adoptant la classification proposée par V. Guichard, la grande majorité des lèvres appartient aux classes 1, 1 ou 2 et 2, quelques récipients appartiennent à la classe 2 ou 3 et aucun n’appartient à la classe 3 (fig. 10b). De même, aucun autre élément morphologique caractéristique des Dressel 1B (pieds hauts et massifs, épaule anguleuse) n’est présent dans ces en-sembles. Quelques assemblages livrent toutefois des amphores de type Lamboglia 2 et Dressel 1C. La rareté de Dressel 1A tardives et l’absence de Dressel 1B montrent que l’importation d’amphores républicaines a cessé sur les sites de plaine à la fin du IIe s. av. J.-C. Cette datation coïncide avec celle proposée, à partir de l’examen des autres types de mobilier, pour l’abandon d’une grande partie de l’occupation des sites de plaine. La mor-phologie des éléments présents pour cette étape se rapproche de celle observée sur les camps romains de Numance (terminus ante quem à 133 av. J.-C.), sur les sites de Roanne horizon 2 (vers 130-120 av. J.-C.), des «Arènes» à Levroux et de la «Rue du Souvenir» à Lyon-Vaise (Loughton à paraître) et permet de proposer un rattachement en chronologie absolue qui corres-pond globalement au dernier tiers du IIe s. av. J.-C. Comme pré-
Yann DEBERGE et alii184 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 185
� �����
�������
���
��������������������
��������
�����
������
������
�������
�����
���������������
������������������
������������������
���������������
��������������
����������������������
������������������������������� ������������������������������
���������������������������
��������������������������������
���������������������������
����������������������
���������������������������
�����������������������
Fig. 12 : Proposition de schéma évolutif concernant la classification des amphores républicaines.
cédemment, les amphores provenant des centres de production étrusques (Albinia, Cosa, Feniglia) sont rares et n’apparaissent que dans les structures les plus tardives (puit 715 du site de «Gandaillat» à Clermont-Ferrand ; fig. 9).
L’étape suivante (vers 110-80 av. J.-C.) est représentée par quelques sites (oppidum de Corent et le site voisin du «Bay» aux Martres-de-Veyre) qui livrent cependant des quantités très éle-vées d’amphores. La présence de quelques lèvres se rattachant, selon les méthodes de Guichard et de Hesnard (fig. 10a), aux gréco-italiques dans ces contextes tardifs qui ne livrent aucun autre élément morphologique appartenant à cette catégorie renforce notre proposition quant à l’existence des Dressel 1G. Dans ces ensembles les lèvres appartiennent majoritairement à des Dressel 1A (classe 2) avec quelques éléments de morpho-logie plus évoluée (classe 2 ou 3 ; fig. 10b) dont les premiers exemples de Dressel 1B (fig. 10b et c). Les Dressel 1C semblent
également représentées de façon plus significative. La morpho-logie des pieds a également évolué et ceux-ci sont désormais assez hauts sans toutefois présenter les mensurations typiques des Dressel 1B (fig. 9). En se conformant à l’analyse des lèvres d’amphores, les ensembles illustrant cette étape présentent de fortes similitudes avec ceux des sites de Condé-sur-Suippe (120/110-80/70 av. J.-C.) et de Roanne horizon 3 (vers 110-100 av. J.-C.). A partir de cette période, les amphores proviennent en grande partie d’Etrurie, principalement de Cosa (quelques lèvres portant le timbre de Sestius) et d’Albinia.
Pour l’étape suivante (vers 80-50 av. J.-C.), les ensembles amphoriques, qui sont nettement moins nombreux, présentent des différences significatives avec ceux de l’étape précédente (Malintrat «Chaniat» sép. 5516, Cournon «Sarliève» puits 2474/2485, Le Cendre «Gondole»). La majorité des lèvres pré-sente un profil évolué (classes 2 ou 3 et 3 ; fig. 10b), la plupart
Yann DEBERGE et alii186 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 187
d’entres elles ayant une hauteur supérieure à 45 mm, plusieurs exemplaires excédant 55 mm (fig. 10c et fig. 11). Ces lèvres appartiennent à des exemplaires de transition entre Dressel 1A et 1B (lèvres verticales mais avec des hauteurs comprises entre 40 et 54 mm comme celles présentes dans l’épave de Spargi) et à des Dressel 1B (fig. 12). Les autres éléments morphologiques disponibles (pieds hauts et massifs) accréditent également une identification à des exemplaires évolués. Les ensembles attri-bués à cette étape sont à mettre en regard de ceux provenant de Villeneuve-Saint-Germain (80-30 av. J.-C.) et de la tombe de Clémency (80-60 av. J.-C.).
La Grande Limagne d’Auvergne livre peu d’indices pour soutenir la proposition faite par A. Desbat (Desbat 1998) concernant le déclin rapide des importations de Dressel 1 au cours de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. Les amphores républicaines continuent d’être importées comme le montrent les exemplaires présents dans l’ensemble funéraire fouillé sur le site de «Chaniat» à Malintrat (vers 50-1 av. J.-C.). Certaines structures fouillées sur l’oppidum de Gergovie et sur le site de «Sarliève» (Cournon-d’Auvergne «La Grande Halle») suggèrent même un approvisionnement toujours important avec notam-ment un accroissement de la place occupée par les amphores en provenance de l’Adriatique (Lamboglia 2).
Concernant les importations en provenance d’Espagne, il est à noter qu’elles sont extrêmement rares avant la Conquête : un seul exemplaire identifié dans une structure attribuée au deuxième quart du Ier s. av. J.-C. Encore s’agit-il d’un type relativement atypique dont la datation et la morphologie restent à préciser («type 4» ou «Léétanienne 2» dans Long 1998 ?). Les autres amphores hispaniques (Pascual 1, Haltern 70) ne sont pas attestées de façon certaine avant le dernier quart du Ier s. av. J.-C. (fig. 9). Il faut cependant souligner que les ensembles amphoriques bien documentés sont rares pour cette période.
3.2. Spécificités régionales
La présence récurrente, mais en petite quantité, d’amphores gréco-italiques en Auvergne n’est pas surprenante ; elle est confirmée par d’autres études qui révèlent aussi l’existence d’une période d’importation de vin en Gaule non Méditerranéenne dès la première moitié du IIe s. av. J.-C. (Loughton 2003a : 194, 201; Maza 1998). On enregistre cependant des variations régionales quantitatives. En effet, on constate que cette première phase d’importation est bien mieux attestée dans la proche région du Berry comme le suggère le nombre considérable d’amphores gréco-italiques récoltées dans les ensembles de la première moitié du IIe s. av. J.-C. à Levroux (Buchsenshutz 2000). Le corpus des amphores gréco-italiques de Basse Auvergne se signale par un trait spécifique qui tient dans l’aspect incontestablement archaïque de certains exemplaires du «Pâtural» (épandage 3231) et de Malintrat «Villevaud» qui ne trouvent pas de parallèles, en-dehors du littoral méditerranéen. La présence de lèvres de «Dressel 1G»
dans des contextes datés de La Tène D1 (vers 140-80 av. J.-C.) n’est pas sans rappeler des découvertes effectuées dans les régions voisines à Arnac-la-Poste, en Limousin, Rodez, «La Pâture du Couvent» au Mont Beuvray et dans les fossés de la «rue du Souvenir» et du «Verbe Incarné» à Lyon (Loughton 2003a). De telles lèvres sont aussi présentes sur le site de Chassenard «La Génerie», dans l’Allier (Lavendhomme 1999). Il est par contre surprenant de constater leur quasi-absence sur les sites voisins du Forez et du Roannais, de même que la faible fréquence des gréco-italiques (Guichard 1997 ; Aulas 1988).
Ces dernières années, les discussions des chercheurs ont porté sur le remplacement des Dressel 1A par les Dressel 1B ; des dates très différentes ont été proposées par les spécialistes pour dater ce phénomène. Pour la Basse Auvergne, la rupture typologique des assemblages d’amphores est facilement discer-nable et s’effectue en un court laps de temps. Les assemblages datés entre 80 et 50 av. J.-C. sont encore dominés par les am-phores de transition Dressel 1A/B et il faut attendre le milieu du siècle pour que le basculement se produise. Dès lors, les assemblages sont nettement dominés par les Dressel 1B. Le même constat a d’ailleurs été effectué pour d’autres régions : la vallée de l’Aisne (Hénon 1995) et Lyon (Maza 1998). À Roanne il n’en va pas de même puisque les assemblages de l’horizon 4 (80-70 av. J.-C.) témoignent plutôt d’un mélange des différents types d’amphores tandis que l’on note, par ailleurs, une faible fréquence des amphores pour la période suivante calée en chronologie absolue entre 40-30 av. J.-C. (Lavendhomme 1997). Toutefois, on observe que les lèvres de transition Dressel 1A/B dominent l’assemblage du site forezien de Chézieux, distant de Roanne de 50 km (Mathevot 1998). En Limagne, l’oppidum de Gondole livre un faciès comparable.
Pour la Bourgogne, Fabienne Olmer avance qu’il n’est pas possible de distinguer une rupture typologique aussi nette en-tre les amphores Dressel 1A et 1B (Olmer 1997 : 151-152, 288). Cette dernière renforce son propos en comparant la situation bourguignonne avec celle connue à Lattes où les Dressel 1A dominent encore les assemblages de la seconde moitié du Ier s. av. J-C. (Py 2001 : 98-99, fig. 11). L’absence d’épave datée de la fin du Ier s. av. J.-C. qui recèlerait une cargaison de Dressel 1A limite toutefois la portée des arguments des chercheurs en faveur d’un remplacement tardif des Dressel 1A par les Dressel 1B à moins qu’il faille reconsidérer la validité des datations des cargaisons de référence et des naufrages documentés par l’ar-chéologie sous-marine.
Pour Fabienne Olmer, les timbres d’amphores républicaines en provenance d’Etrurie se concentreraient dans le Centre-Est de la France, ce qui attesterait l’existence de relations commer-ciales spécifiques entre l’ager Cosanus et cette zone géographi-que bien que certaines estampilles, les SESTIUS, soient pré-sentes dans toute la France. Elle suggère aussi l’existence d’une zone de diffusion spécifique à l’Ouest de la France pour les amphores portant certaines estampilles tels que RODO/GALLI, ALEX, et PARNA… (Olmer 2003 : 213, fig. 58, 221, fig. 61). Ces
Yann DEBERGE et alii186 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 187
arguments souffrent, de notre point de vue, de plusieurs limites. Tout d’abord, seule une minorité d’amphores républicaines était estampillée (4 à 6% tout au plus). Il paraît difficile de tirer des conclusions quant aux réseaux d’approvisionnement en vin ita-lien à partir de l’analyse de la répartition des seuls exemplaires estampés découverts en Gaule. Seule la mise en évidence de groupes de pâtes spécifiques à des centres de production, et l’étude de leur répartition, est à même de répondre à la question de la provenance des contenants et, probablement aussi, de leur contenu. De même, de nombreux timbres découverts dans l’Ouest de la France ne sont toujours pas attribués de façon certaine à des centres de production. Enfin, on note la présence sur l’oppidum arverne de Corent de nombreuses amphores qui portent des timbres considérés par Fabienne Olmer comme appartenant à la zone de diffusion spécifique à l’Ouest de la France : ALEXA et PARNA (Loughton à paraître).
Pour résumer, on constate en Auvergne l’existence de trois grandes étapes dans la diffusion pour des amphores républi-caines (fig. 10 b). Les ensembles du IIe s. av. J.-C. (vers 140-110 av. J.-C.) livrent un faciès peu différencié où dominent les amphores de classe 1, 1/2 et 2 qui peuvent être identifiés à des gréco-italiques et surtout, Dressel 1A et 1G. L’étape suivante (vers 110-50 av. J.-C.) livre surtout des amphores de morpholo-gie plus évoluée correspondant à des Dresse 1A puis des exem-plaires de transition avec les Dressel 1B, avec un nombre très limité de Dressel 1B. La dernière étape individualisée (vers 50-1 av. J.-C.) témoigne d’une nette domination des Dressel 1B.
4. LE PETIT MOBILIER (LO)
Le corpus des objets retenus comprend pour l’essentiel des éléments de parure (fibules, anneaux de ceintures, torque, bracelets, des colliers associant ou non des perles et divers pendentifs) confectionnés avec des matériaux divers (matière organique fossilisée, verre, ambre, corail, fer, alliage à base de cuivre, argent) et des armes. Il paraît opportun d’ajouter ici des objets supplémentaires, pour la plupart inédits, qui permettent de compléter les séries issues des ensembles préalablement sé-lectionnées. Ceci permet d’offrir un panorama synthétique de la culture matérielle locale plus achevé, notamment dans le do-maine de la parure, des trois derniers siècles avant notre ère.
On note une disparité dans la répartition chronologique du petit mobilier étudié : la plupart des éléments appartiennent aux IIIe et IIe s. av. J.-C. ; le dernier siècle avant notre ère est mal représenté. On note aussi une inégalité dans la représentation des différentes catégories de petit mobilier : la parure domine très nettement au dépens de l’armement qui n’est représenté que par quelques pièces, souvent très fragmentées. Les autres catégories de petit mobilier, comme l’outillage par exemple, sont insuffisamment nombreuses pour pouvoir se prêter à ce type d’analyse. Les éléments de petit mobilier présentés ici pro-viennent de contextes de rejets domestiques d’habitat (fosses et fossés) mais aussi de sépultures ou bien encore de dépôts en
sanctuaire (Corent) et en contexte d’habitat, comme dans le cas du fossé de «La Grande Borne» (5).
4.1. Les fibules
Les observations portées sur les fibules ont déjà été consi-gnées dans une monographie (Orengo 2003). Il faut toutefois rappeler les grands traits du corpus à notre disposition.
4.1.1. Le IIIe s. : à pied libre et schéma «La Tène II»
Le chemin 8 de «La Grande Borne» constitue l’ensemble de référence qui permet de caractériser les fibules en circulation dans le courant de la première moitié du IIIe s. av. J.-C. Ces dernières sont pour la plupart filiformes et toutes, sans exception, de schéma à pied libre et de petite taille (fig. 13, n° 43-50). Leur ressort, lorsqu’il est conservé, est à corde externe, bilatéral à 4 ou 6 spires. Les exemplaires les plus caractéristiques portent sur l’extrémité du pied, qui est long et touche le sommet de l’arc, une série de nodosités et sont à rapprocher des fibules dérivées du modèle tardif de Duchcov (Rouallet 1993 : 58-59). On note l’absence des fibules classiques de Duchcov et des fibules de Münsingen, si ce n’est la présence d’un petit fragment de corail en forme de segment de tore, orné d’incisions et percé pour permettre le passage d’un rivet, qui pourrait appartenir au pied d’une fibule (fig. 13, n° 42). La datation de l’assemblage des fibules du chemin 8 (La Tène B2) est discutée plus en détail dans le cadre du thème spécialisé (Augier thème spécialisé). Le fossé 11 du même site livre un cas unique en Limagne d’association de fibules de schéma à pied libre et d’une grande fibule de schéma «La Tène II» à pied attaché au sommet de l’arc (fig. 13, n° 62-65). Cette dernière porte sur son pied deux petites nodosités. Cette association définie le début de l’horizon de La Tène C1 en Limagne.
À compter du milieu du IIIe s. av. J.-C., les ensembles ne livrent plus que des fibules filiformes de schéma «La Tène II», presque toutes en fer. Ces dernières ont été diffusées durant toute la deuxième moitié du IIIe s. av. J.-C. et jusque dans le courant de la deuxième moitié du siècle suivant. Le pied est fixé à l’arc à l’aide d’une pincette formée dans la masse du métal ou à l’aide une bague. Il en existe plusieurs variantes, toujours à corde externe. Dans le courant de la deuxième moitié du IIIe s. av. J.-C., ces fibules sont parfois de grande dimension, comme l’illustre la tombe 366 de «Gandaillat» qui en contient un exem-plaire complet (fig. 13, n° 68).
4.1.2. Le IIe s. : schéma «La Tène II» et Nauheim
Les fibules les plus caractéristiques des premières décen-nies du IIe s. av. J.-C. sont de grande dimension, à petit ressort bilatéral à 4 spires (fig. 14, n° 9-10 et 18). Elles portent sur le pied une ou deux perles confectionnées dans la masse même du métal ou rapportées comme pour l’exemplaire de la fosse 307
Yann DEBERGE et alii188 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 189
0 10
1
12
24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
44
37 38
39 40
4142
43 45
46 47 48
4950
51 52 53 54 55 56
57
58
sep 366
35
36
59
60 61
62 63 64
65
66 67
68
69 70 71 72 73
74 75 76 77 78
79 80 81 82
83 84 85 86
87
88
8990 91 92 93 94 95
96
9798
99
100
101
102
103
� � �� � � �
104105 106 107 108
���� ������ �� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ���
������ �� �� ������ �� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ����� �� �� ���� ���
Clermont-Ferrand, La Grande Borne -Chemin 8
Clermont-Ferrand, La Grande Borne -Fossé 12/13
Clermont-Ferrand, Le Pâtural
Fossé 63005 Fossé 3474
Clermont-Ferrand, La Grande Borne
Clermont-Ferrand, Gandaillat
Cournon, La Grande Halle
cm
Fig. 13 : Petits mobiliers du IIIe s. av. J.-C. Matière organique fossilisée : 1-34, 60, 61, 78-88 ; verre : 69, 71 (incolore), 23, 24 (incolore avec feuille jaune), 37, 38, 57, 66, 67, 70, 72-77, 89, 93, 94 (bleu), 90 (brun) ; ambre : 36, 95, corail : 39, 40, 42 ; alliage cuivreux : 35, 41, 43-45, 97 ; fer : 46-
56, 58, 59, 62-65, 68, 96, 98-108 (éch. 1/4).
Yann DEBERGE et alii188 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 189
0 10
fosse 61
fossé 43905
.
Sep 561Sep 499
sep 3172fosse 38
fosse 68
fosse 307
sep 317 puits 41 (1er comblement)
puits 41 (2 ème comblement)
sep 474
fosse 46
sep 17
ruisseau 5557 (2e comblement)
fossé 34
sep 43901
0 10cm
ruisseau 5557 (1er comblement)
HS ? sep 2247
98 99
1234
5
67
8 9 10
11
12 1314
15
1618
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28
29
3031
40
41
42
43 44 45 46 47
48
49
50
51
52
53 54 55
56 57 58
59 60 6162
63 64
65
66
67
68 69 70 7172
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
8687
88 89 90
91 92
93
94
95
17
32
33 34
35
36
37 38
39
96 97
������� ����� �� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����
������ �� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ����� �� �� ���� ����
����� �� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���Clermont-Ferrand, La Grande Borne Clermont-Ferrand, Le Pâtural Gerzat, Rochefort
Clermont-Ferrand, Gandaillat
Clermont-Ferrand, Le Pâtural
Aigueperse, Le Clos Clidor
Clermont-Ferrand, Gandaillat Clermont-Ferrand, La Grande Borne Aigueperse, Le Clos Clidor Clermont-Ferrand, Gandaillat
Clermont-Ferrand, La Grande Borne
Clermont-Ferrand, Le Pâtural
Clermont-Ferrand, Le Pâtural
Clermont-Ferrand,Le Pâtural
Cournon LGH
Clermont-Ferrand, Le Pâtural
Clermont-Ferrand, Gandaillat
cm
Clermont-Ferrand, La Grande Borne
Fig. 14 : Petits mobiliers du IIe s. av. J.-C. Matière organique fossilisée : 2-4, 22-26, 42, 43, 57, 61, 73 ; verre : 1, 6, 35, 44-46, 53, 55, 56, 76 (bleu), 26 (brun), 40, 41, 54, 74, 75, 77, 89, 91 (pourpre), 29, 65-67, 88, 92 (translucide incolore), 11, 47 (avec feuille jaune interne) ; os : 96-99 ; alliage
cuivreux : 5, 7, 16, 17, 20, 62, 68-70, 72, 78-87, 93, 94 ; fer : 8, 9, 12-15, 18, 19, 21, 30-34, 36-39, 48-52, 64, 71, 95 ; fer et alliage cuivreux : 10(éch. 1/4 et 1/8).
Yann DEBERGE et alii190 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 191
du «Pâtural» (6). La fosse à incinération 3172 du site de Gerzat «Rochefort», a livré deux exemplaires de ce modèle, dont un de très petite taille (moins de 30 mm de longueur ; fig. 14, n° 8). Ces fibules peuvent constituer des variantes occidentales en fer des célèbres fibules de Mötschwill, fossiles par excellence de La Tène C2 sur le plateau Suisse. Toutefois leur arc, incomplet, ne semble pas être aussi surbaissé que celui des exemplaires canoniques, en alliages cuivreux.
Une seconde variante est facilement reconnaissable à son ressort long et étroit à 10 ou 12 spires, voire plus, enroulées le plus souvent autour d’un petit axe en fer. On trouve ces fibules dans les ensembles du milieu du IIe s. av. J.-C. comme dans la tombe de guerrier 474 ou bien la fosse 46 de «Gandaillat» (fig. 14, n° 19 et 33-34). ). La tombe 474 constitue un ensemble clef pour la définition du faciès du petit mobilier limagnais dans le courant du milieu du IIe s., en l’occurrence entre la fin de La Tène C2 et le début de La Tène D1.
Il est plus difficile de déceler l’existence de variantes spéci-fiques à la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. On note cependant que la dimension des fibules est en général réduite, tout au moins inférieure à 100 mm. Néanmoins, rares sont les exem-plaires complets dans la documentation disponible en Lima-gne. De ce fait, on ne peut utiliser le seul critère de taille comme un argument discriminant.
La présence des fibules de schéma «La Tène II» dans les ensembles de la fin du IIe s. av. J.-C. demeure exceptionnelle. Elle est cependant attestée dans deux des trente-trois sépul-tures de Cournon «La Grande Halle». Ce schéma technique semble avoir rapidement cédé la place à celui des fibules de Nauheim. La particularité technique de ces dernières, con-fectionnées pour la plupart en alliage cuivreux, réside dans la forme de leur pied qui est formé dans le prolongement de l’arc, ce dernier étant en général plat, de forme plus ou moins triangulaire. Les associations de fibules de schéma «La Tène II» et de fibules de Nauheim sont suffisamment rares pour être citées ici, comme dans le cas de la sépulture 17 de «Gandaillat» (fig. 14, n° 93 et 95). On connaît une fibule en alliage cuivreux dont la morphologie est un compromis entre le modèle de «schéma La Tène II» et le modèle de Nauheim qui n’est pas sans rappeler un exemplaire de Levroux daté de La Tène D1 (fig. 14, n° 63).
Les fibules à arc filiforme tendu et à pied ajouré dans le prolongement de l’arc à grand ressort à corde externe (type 25c de Gebhard ou type 4 à Acy-Romance) ne sont attestées que par un exemplaire unique, bien daté de la fin du IIe s. av. J.-C. et associé à une fibule de schéma La Tène II dans le tombe 2247 à Cournon «Sarliève» (fig. 14, n° 64). Les fibules de ce type sem-blent avoir été peu diffusées en Basse Auvergne, à la différence des régions plus septentrionales comme la vallée de l’Aisne. On note aussi la rareté, dans le corpus limagnais, des fibules à tête couvrante (un seul exemplaire connu à ce jour), pourtant pré-sentes chez les voisins ségusiaves, dans les ensembles clos datés des 30 dernières années du IIe s. av. J.-C.
4.1.3. Le Ier s. : Nauheim et nouveaux types
Alors que les fibules de schéma «La Tène II» ont circulé presque exclusivement pendant près de 100 ans, les fibules de Nauheim ont été rapidement concurrencées, au début du Ier s. av. J.-C., par de nouveaux modèles au schéma de construc-tion proche puis semblent avoir disparues dans le courant du deuxième quart du siècle comme le suggère la fouille du fossé d’un petit enclos laténien à Corent (Poux 2002). Toujours à Corent, les niveaux d’occupation du premier tiers de ce siècle, fouillés en 1992, ont livré, outre les fibules de Nauheim «clas-siques» et ses dérivées (presque toutes en alliage cuivreux), des fibules en fer qui se caractérisent par leur ressort bilatéral à 4 spires à corde externe et par leur arc, filiforme ou plat, de sec-tion plus ou moins ovale ou losangique (fig. 15, n° 23-27). Leur typologie générale les rapproche des variantes à corde externe des fibules du type 2a de Feugère (Feugère 1985 : 188-189).
La fréquence de ces fibules semble augmenter dans les ensem-bles datés entre 80 et 30 av. J.-C. Une évolution est sensible dans la nature du métal employé. Les fibules les plus anciennes sont en fer ; puis elles sont remplacées (à une date encore inconnue, probablement le milieu du siècle) par des exemplaires en alliage cuivreux, comme dans les ensembles de Gergovie (elles compor-tent un porte-ardillon à fenêtres multiples lorsque ce dernier est conservé) ou bien encore dans l’épandage 2828 du petit ensemble funéraire du site de «Chaniat» à Malintrat (fig. 15, n° 46-53 et 55). Le corpus limagnais est marqué par la rareté des fibules d’Alésia (au moins un exemplaire à Gergovie) et des fibules à coquille (un exemplaire non stratifié à Corent). Il faut chercher l’explication de cette rareté dans la faiblesse de la documentation régionale relative, d’une manière générale, au Ier s. av. J.-C.
On doit également citer l’existence de deux fibules de Jezerine en alliage cuivreux découvertes fortuitement à La Roche Blanche et au Cendre, à l’emplacement de l’oppidum de Gondole (pour une illustration de l’exemplaire découvert à Gondole, voir Collis dans ce volume : fig. 13). Un dernier exem-plaire, conservé au musée Bargoin, est de provenance inconnue (Fauduet 1982a : 15, pl. 3 n° 34). Le schéma de construction de ces fibules est assez proche de celui des fibules de La Tène D et notamment, à quelques détails près (la forme du pied et de l’arc), des exemplaires du type Nauheim : arc rectangulaire plat, décoré de lignes longitudinales incisées, ressort à 4 spires à corde interne, porte-ardillon percé d’un trou séparé de l’arc par une bague cannelée et terminé par un bouton. Ces deux fibules sont classées dans le type 12 de Feugère. Ce chercheur date la diffusion en Gaule des fibules de ce modèle dans une fourchette chronologique tardive, 20 av. / 20 ap. J.-C., tandis que pour l’ex-Yougoslavie Mitja Guštin les classe parmi les fibules de La Tène finale et propose une datation un peu plus ancienne, en l’occurrence dans le dernier tiers du I er s. av. J.-C. (Feugère 1985, p.351 et fig.24 ; Guštin 1987, p.53). Ces deux chercheurs mentionnent les travaux de Sabine Rieckhoff, qui date ce modèle de fibule de La Tène D2 (Rieckhoff 1975). La
Yann DEBERGE et alii190 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 191
0 10
0 centimËtres 20
0 10
Corent. niveaux d'occupation sous l'empierrement (fouille 1992)
deuxième et troisième quarts du Ier s. av. J.-C. (La Tène D2)
1
12
24
2
3
4 5
6 7
8 9 10
11
13
14
15 16 17 1819
20
21
22 23 25 26
2728
47
4849
50
51
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43
44
45 46
52
53
54 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
65
changement d'Ère (10 av./10 ap. J.-C.)
Gergovie-plateau fosses du chemin de la Croix
dernier quart du Ier s. av. J.-C.
68
��� ��� � ����� �� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����
cm
Malintrat Chaniat dépôt d'incinération 5902
Malintrat Chaniatdépôt d'incinération 5903
Malintrat Chaniat fosse 5889
Gergovie-Rempart (us 10013) Malintrat Chaniat Epandage 2828
Gergovie-plateau fosses du Chemin de la Croix
cm
Fig. 15 : Petits mobiliers du Ier s. av. J.-C. Matière organique fossilisée : 1-3 ; verre 5, 6, 8 (bleu), 7 (brun), 4 (pourpre) ; ambre : 9, argent : 10, alliage cuivreux : 10-13, 17-22, 28-40, 46-53, 55-65 ; alliage cuivreux et roche : 14 ; alliage cuivreux et fer : 67 ; fer : 15, 16, 23-27, 41-45, 54, 66, 68 (éch. 1/4 et 1/8).
Yann DEBERGE et alii192 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 193
diffusion de ces fibules concerne essentiellement le Languedoc, l’Italie centrale et le territoire de l’ex-Yougoslavie. Il est donc intéressant de mettre en lumière la présence en Limagne de ce modèle.
Enfin, de nouveaux types à ressort munis de crochet fixe-corde sont diffusés au plus tard dès le début de l’époque augus-téenne (fig. 15, n° 56-64). C’est le cas de la fibule à arc plat et étroit à 4 spires du dépôt d’incinération 5903 de «Chaniat» (à mi-chemin entre les variantes 9a et le type 14a de Feugère) et des fibules à 6 ou 8 spires et à arc large et plat de Gergovie «Chemin de la Croix» (Feugère 9b/Almgren 241). Concernant ce dernier site, on sait, par les comptes-rendus des fouilles de Jean-Jacques Hatt, et le catalogue du musée Bargoin de Clermont-Ferrand, qu’au moins cinq types supplémentaires de fibules en alliage cuivreux sont à ajouter à ceux documentés dans le cadre du PCR pour illustrer les modèles en circulation dans la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. (Hatt 1943 : 115, fig. 15 ; Hatt 1947 : fig. 8 n° 13 ; Fauduet 1982) :
- fibule à arc mouluré (Feugère 8b Ettlinger type 8) caracté-ristique de La Tène D2a dans la nécropole de Wederath (Miron 1989) ;
- fibule à collerette et à ressort protégé par une plaquette muni d’un crochet fixe-corde ou Kragenfibeln (Feugère 10a) ;
- fibule à disque médian à ressort protégé par une plaquette muni d’un crochet fixe-corde (Feugère 15a) ;
- fibule à couvre-ressort à arc non interrompu de forme quadrangulaire (Feugère 14b1)
- fibule à ressort protégé à queue de paon de petite taille (Feugère 16a) diffusée dès l’époque augustéenne.
Ce dernier type de fibule est attesté par un exemplaire dé-couvert dans le dépôt d’incinération 5902 de «Chaniat» daté autour du changement d’ère (fig. 15, n° 65).
4.2. Les parures annulaires
4.2.1. Le IIIe s. : bracelets en MOF et premiers éléments en verre
Le chemin 8 de «La Grande Borne» livre une trentaine de bracelets en matière organique fossilisée (lignite ou sapropé-lite) dont la section varie peu, d’un exemplaire à l’autre, du «D» à l’ovale (fig. 13, n° 1-34). Cet ensemble de la première moitié du IIIe s. av. J.-C. ne livre aucune parure en verre, à l’exception de deux petites perles en verre bleu probablement montées en collier (fig. 13, n° 37-38). Il faut leur ajouter une perle en ambre (fig. 13, n° 36). Deux petits fragments de corail brut de couleur rouge ont pu être portés en collier (fig. 13, n° 39-40), malgré l’absence de trou de suspension, comme l’attestent les découvertes de La Tène ancienne au «Trou de l’Ambre» (Ca-hen-Delhaye 1998). Cette structure a également livré une petite pendeloque en alliage cuivreux (fig. 13, n° 41). Ce type d’orne-ment appartient à des chaînes de ceinture féminine de La Tène C. Enfin, cet ensemble a livré un fragment de torque filiforme
en alliage à base de cuivre qui se signale par une morphologie inhabituelle pour la Gaule centrale (fig. 13, n° 35). En effet, l’extrémité conservée forme un enroulement décoratif qui n’est pas sans rappeler les exemplaires connus dans le Picenum à La Tène B (Szabó 1982).
Les premiers bracelets en verre font leur apparition dans le courant de la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C. comme l’at-testent les exemplaires découverts dans le fossé 12/13 de «La Grande Borne» (fig. 13, n° 69-77). Parmi les types diffusés en Limagne, on note la présence d’un spécimen transparent inco-lore à section en «D» orné d’un décor de filets croisés bleu opa-que de la série 33 de Gebhard (fig. 13, n° 69). Cet exemplaire appartient au plus ancien groupe de bracelets en verre, diffusé en Bavière et en Suisse à partir de La Tène C1a (Gebhard 1989). La plupart des autres bracelets sont de couleur bleu cobalt et sont parfois agrémentés de filets décoratifs (séries 1, 11a, 12, 14 et 19). Ces bracelets sont datés de La Tène C1. Le site du «Pâtural» a aussi livré des bracelets en verre bleu cobalt déco-rés de rangs de petites boules de la série 1 de Gebhard (fig. 13, n° 66-67).
L’intérêt accordé aux matières organiques fossilisées a con-sidérablement décru par rapport à l’horizon précédent. Hormis les exemplaires classiques de section ovale ou en «D», on cons-tate la présence de bracelets dont la section à côtes multiples n’est pas sans rappeler celle des bracelets en verre. La section de l’un d’entre eux (fig. 13, n° 87) est l’exacte réplique de celle des bracelets en verre à côte centrale de la série 11a de Geb-hard. Les perles restent rares. À côté des grains de collier en ambre ou en verre de couleur bleue que l’on trouve à diverses époques, on observe la présence d’autres perles en verre brun ou bien incolore avec une feuille jaune interne connues à La Tène C2 ainsi qu’un exemplaire à décor occulé spiralé non pro-tubérant du groupe IV.1.1. de Zepezauer.
4.2.2. Le IIe s. : bracelets en verre et métalliques, perles et pendentifs
Quelques ensembles, comme la tombe 499 de «Gandaillat», livrent des bracelets en verre incolore à feuille jaune interne à 5 côtes de la série 27, caractéristiques de La Tène C2 (fig. 14, n° 11). Des bracelets à 4 côtes, de couleur bleue, ornés de filets jaunes, comme l’exemplaire du fossé 43905 du «Pâtural», appartiennent aussi à cette phase (fig. 14, n° 6). Les bracelets en matière or-ganique fossilisée restent présents dans les mêmes proportions qu’à la période précédente et les types ne se diversifient pas. La fosse 38 de «La Grande Borne» en livre 3 exemplaires ainsi qu’un fragment de bracelet en verre bleu cobalt de section en «D» de la série 38e de Gebhard (fig. 14, n° 1). Ce dernier est tenu pour typique La Tène D1 et on a coutume de dater son apparition dans les dernières décennies du IIe s. av. J.-C. Toutefois, d’autres découvertes attestent une apparition plus ancienne, au plus tard dès le milieu du IIe s. av. J.-C. (Guichard 1997a : 156, 165).
Les perles en verre restent peu fréquentes dans les ensem-
Yann DEBERGE et alii192 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 193
bles des premières décennies du IIe s. avant J.-C. Un modèle un peu particulier de bracelet métallique sem-
ble être apparu au début de ce siècle. Il s’agit d’un brassard constitué d’un fil métallique en fer ou en alliage cuivreux de 5 mm d’épaisseur environ enroulé autour du bras, illustré par un exemplaire dans la tombe 561 de «Gandaillat» (fig. 14, n° 15). Ces brassards sont parfois agrémentés d’un petit anneau métal-lique. Dans cette sépulture, le défunt portait un collier orné de deux petites pendeloques en alliages cuivreux, l’une représen-tant une hache (fig. 14, n° 16-17). Le port de ce type de penden-tif est aussi représenté, en contexte funéraire, dans la fosse à incinération 3172 de Gerzat «Rochefort» par un petit couteau (lime ?) en alliage à base de cuivre (fig. 14, n° 7).
Les ensembles clos dont la datation est située au milieu du IIe s. av. J.-C. livrent peu d’éléments de parures annulaires. On constate la persistance, toutefois décroissante, des bracelets en matière organique fossilisée Certains d’entre eux sont l’exacte réplique d’exemplaires en verre. La fosse 61 du «Clos Clidor» à Aigueperse livre un bracelet en verre à rainure centrale de couleur brune de la série 35a de Gebhard accompagné d’un bracelet en matière organique fossilisée de même morphologie (fig. 14, n° 25-26). Le port des brassards métalliques semble persister comme l’attestent quelques sépultures de «Gan-daillat». C’est vers le milieu du IIe s. que semblent apparaître les premiers petits bracelets en alliage cuivreux, filiformes à jonc ouvert dont les extrémités, plus épaisses que la section du fil, ont l’aspect de petites boules (fig. 14, n° 20). Enfin, quelques ensembles légèrement plus tardifs livrent les premières perles toriques en verre. La fréquence de ces dernières augmente sen-siblement par la suite. Dans l’épandage 3231 du «Pâtural», les perles toriques (on constate la présence des premiers exemplai-res à décor spiralé) sont associées aux premiers bracelets en verre de couleur pourpre à section en «D» et triangulaire (séries 36 et 37 de Gebhard) diffusés en Limagne.
Cette association avec les bracelets tubulaires en tôle d’alliage cuivreux est celle de la phase de La Tène D1 (vers 140-80 av. J.-C.). Son étape initiale (globalement le dernier tiers du IIe s) est celle de La Tène D1a (à la différence de Miron qui la fait correspondre avec une phase pré Nauheim en pays Trévire) qui est bien documentée pour les habitats de la plaine (fossé 34 de «La Grande Borne» et comblement sommital du ruisseau 5557 du «Pâtural») avec les premières fibules de Nauheim. Hormis la présence récurrente des bracelets en ma-tière organique fossilisée, on assiste à l’apparition des premiers bracelets en verre de section triangulaire, de couleur pourpre pour la plupart de la série 37 de Gebhard (fig. 14, n° 54-77) au cours de cette phase. La couleur pourpre tend à se généraliser, au cours de cette phase, pour les bracelets mais aussi pour les perles toriques.
Enfin, il faut citer aussi la présence, dans le fossé 34 de «La Grande Borne», de petits anneaux en os. Ces derniers sont peu fréquents alors que l’on a reconnu, en plusieurs endroits, les déchets de leur fabrication sous la forme de petites plaquettes
d’os (7). Même si leur destination exacte reste obscure, on peut soulever l’hypothèse de leur emploi comme éléments de parure portés en collier, au même titre que les perles en verre et cer-tains anneaux métalliques. Les alliages cuivreux semblent être plus employés qu’aux phases précédentes pour la confection de bracelets. Les petits bracelets ouverts bouletés continuent à être diffusés (fig. 14, n° 82) en compagnie de nouveaux mo-dèles, comme les bracelets tubulaires en tôle et les bracelets à épissures (fig. 14, n° 62, 78-80, 72).
4.2.3. Le Ier s. : perles en verre et bracelets métalliques
Les bracelets tubulaires en tôle d’alliage cuivreux et les bracelets ouverts bouletés continuent à être diffusés au cours des premières décennies du Ier s. av. J.-C. On note une forte raréfaction des bracelets en verre tandis que la fréquence des exemplaires en matière organique fossilisée se maintient. Nu-mériquement, la part des perles toriques en verre est quatre à cinq fois plus importante que celle des bracelets. Les parures munies de perles toriques en verre (bracelets et/ou colliers) semblent avoir été très en vogue au cours de cette phase. Les niveaux d’occupation des premières décennies du Ier s. de Co-rent ont livré de nombreux petits anneaux en alliage à base de cuivre (fig. 15, n° 29-40). La destination de ces derniers n’est pas toujours facile à établir. Toutefois on sait, qu’à la période immédiatement antérieure, de tels anneaux étaient portés en collier en compagnie de perles toriques et parfois de pende-loques métalliques. Ces dernières sont représentées à Corent dans ces mêmes niveaux d’occupation par une pièce unique en Limagne (Faye 1995: pl. 33, n° 342). Il s’agit d’un pendentif en forme de cage confectionnée en alliage cuivreux enserrant une pierre (fig. 15, n° 14). Une pendeloque similaire est docu-mentée dans une sépulture du début de l’époque augustéenne située sous le sol de la cella d’un temple du sanctuaire nord d’Avenches, en Suisse (Castella 1990 : fig. 5, n° 25). Il faut souli-gner la présence de ces objets (s’agit-il d’amulettes ?) dans deux sanctuaires, que 50 ans et plusieurs centaines de kilomètres séparent (8).
Les données sont trop insuffisantes pour suivre l’évolution de la parure annulaire après le premier tiers du Ier s. av. n. è.
4.3. Les armes
On constate en Limagne la présence assez fréquente de petits débris d’armes dans les rejets des habitats des IIIe et IIe s. av. J.-C. Ces armes, peu nombreuses, sont souvent très mal conservées et leur étude en est d’autant plus limitée (Orengo 2003). Les sépultures livrant des armes sont rares ; deux tombes, fouillées récemment, ont toutefois été intégrées dans cette contribution (Deberge dans ce volume a). Nous ne présentons ici qu’une partie seulement de l’armement laténien connu actuellement dans le secteur limagnais.
Le chemin 8 de «La Grande Borne» livre, outre quelques
Yann DEBERGE et alii194 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 195
fragments de fourreau et un tronçon de lame d’épée, plusieurs portions d’orles de bouclier de section en forme de «U» (fig. 13, n° 51-56). Des fragments similaires d’orles sont documentés dans le fossé 12/13 du même site (fig. 13, n° 104-108). La pré-sence de ces éléments dans des ensembles du IIIe s. av. J.-C. est en accord avec les données disponibles pour le bassin parisien (Brunaux 1988, Baray 1991). Le fossé 12/13 livre en plus, la moitié d’un umbo à ailettes rectangulaires hautes, associé à un rivet à tête hémisphérique creuse (fig. 13, n° 103). Un fragment d’anneau plat en alliage à base de cuivre et deux crochets de ceinturon en fer appartiennent à un système de suspension de fourreau connu à La Tène C2 (fig. 13, n° 97-99). Ils sont asso-ciés à un second système de suspension, un peu plus ancien (fin de La Tène C1), illustré par un fragment de chaîne en fer à double torsade (fig. 13, n° 96). Le fossé 12/13 contient aussi plusieurs fragments de fourreaux d’épée dont on présente ici deux éléments de bouterolle : une extrémité accompagnée de plusieurs tronçons du corps et de l’entrée (fig. 13, n° 100-101). L’ensemble appartient à un modèle de bouterolle à extrémité fine à faibles ajours caractéristique de la fin de La Tène C1. Un fer de lance accompagne ces éléments. Il faut noter que deux autres phases de remplissage de ce fossé ont aussi livré plu-sieurs éléments de fourreau d’épée et des pointes de lances de La Tène C («fossé» 10 et 11).
La tombe 474 fouillée sur le site de «Gandaillat» a livré la panoplie complète d’un guerrier gaulois (épée, lance et bouclier). L’épée, grande et à pointe arrondie, est conservée dans son fourreau (fig. 14, n° 48) dont la bouterolle est malheureusement mal conservée (elle est vraisemblablement plus longue). La datation de fourreaux similaires (Lejars 1997 : 156-158) confirme l’attribution du mobilier de la tombe à un horizon situé à la charnière de La Tène C2 et de La Tène D1, soit autour du milieu du IIe s. av. J.-C. Le système de suspension, représenté par trois anneaux en fer associés à un crochet en fer, correspond bien à celui des armes de cette période (fig. 14, n° 49). On peut citer la découverte à la fin du XIXe s. dans la nécropole des Martres-de-Veyre d’un casque en tôle d’alliage cuivreux de type étrusco-italique à bouton sommital et à décor de «S» sur le couvre-nuque (Déchelette 1914 : 1162, fig. 489). Ce casque est très proche des exemplaires diffusés en Europe dans le courant du IIIe et du IIes s av. J.-C. et jusqu’au début du siècle suivant (Feugère 1994 : 39-41).
Les armes du Ier s. av. J.-C. sont représentées par deux ensembles. À Corent, les niveaux d’occupation des premières décennies du siècle ont livré trois umbos de bouclier, dont deux sont assez bien conservés et un orle presque complet, déposé après avoir été ployé (fig. 15, n° 41-44). Ce dernier est d’un type peu fréquent, documenté à Larina (Perrin 1990 : 102) ; il est muni de pattes de fixation, espacées à intervalle régulier de 80 mm. La fosse 5889 de l’ensemble funéraire de «Chaniat» a livré une longue épée étroite conservée dans son fourreau et une lance (fig. 15, n° 66-68). La morphologie du fourreau (longue bouterolle en échelle à extrémité en anse de
panier) permet de dater ce dernier de La Tène D2. Le système de suspension est représenté par deux anneaux en fer, associés à une boucle de ceinturon d’origine méditerranéenne (Riquier à paraître). Le même ensemble funéraire a aussi livré le fragment d’un probable protège joue de casque en fer dans un dépôt d’incinération daté de l’époque augustéenne, autour du changement d’ère (Guichard 1999 : 118, fig. 27 n° 4).
4.5. Synthèse
On note des évolutions dans le domaine de la parure au cours des trois derniers siècles avant J.-C. C’est notamment le cas des fibules et du choix des métaux employés pour leur con-fection. Globalement dans la première moitié du IIIe s. av. J.-C., la proportion des fibules à pied libre en fer est supérieure à celle des exemplaires en alliage à base de cuivre : le rapport est de deux tiers / un tiers en faveur des fibules en fer. A partir du milieu du siècle, les fibules, alors de «schéma La Tène II», sont presque toutes en fer. La prédominance de ce métal se poursuit jusque dans la deuxième moitié du IIe s. av. J.-C. Ce phénomène a déjà été constaté ailleurs (Duval 1976 : 482-483). A partir du dernier tiers du IIe s., les fibules sont presque toutes en alliage cuivreux, l’emploi du fer étant marginal pour la confection des fibules de Nauheim. Ces dernières restent majoritairement en alliage cuivreux, au début du Ier s. av. J.-C., mais le recours au fer réapparaît pour quelques fibules dérivées du modèle classique. On assiste à un bref retour du fer, dans le courant du deuxième quart du siècle, avec les variantes à corde externe du type 9a de Feugère (fibules à ressort bilatéral à 4 spires à corde externe à arc filiforme, plat ou losangique). Enfin, la seconde moitié du Ier s. voit un nouveau retour des alliages à base de cuivre employés quasi-exclusivement pour tous les types de fibules alors en circulation.
L’examen des différents types de fibules en circulation sur les trois siècles considérés met aussi en lumière l’existence de rythmes de diffusion d’inégale durée. Cela est illustré par les fibules de «schéma La Tène II» diffusées durant près de 100 ans à l’exclusion de tout autre type alors que le Ier s. av. J.-C. est marqué par une accélération du renouvellement des types avec au moins six modèles de fibule. Ces derniers, pour la plupart, ont une durée de diffusion relativement courte, de vingt à trente ans ; chaque type étant rapidement remplacé par un nouveau.
On peut rechercher les causes de ces changements dans une évolution des goûts, cause ou conséquence de la succession de modes vestimentaires (les alliages cuivreux varient du jaune au rouge, le fer du bleu foncé au gris). Il est fort probable aussi que le recours quasi-exclusif aux alliages cuivreux dans la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. soit une réponse à la complexification technique des modèles de fibules alors en circulation, nécessi-tant notamment un stade d’ébauchage en moule, préalable au forgeage (Guillaumet 1993).
Pour les parures annulaires, on note que les bracelets en verre ne se substituent pas totalement aux bracelets en matière
Yann DEBERGE et alii194 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 195
organique fossilisée, quand bien même les premiers supplan-tent les seconds après le milieu du IIIe s. av. J.-C. Tout au plus, on enregistre une baisse constante de l’emploi des matières organiques fossilisées jusqu’au début du Ier s. av. J.-C. On constate également une nette augmentation de la fréquence des perles toriques en verre à partir du dernier tiers du IIe s. av. J.-C. Cette évolution semble être linéaire et aboutit, dans les premières décennies du Ier s. av. J.-C., à une sur-représentation des parures à perles toriques, plus vraisemblablement portées en collier, aux dépens des bracelets en verre.
Globalement, les parures limagnaises ne dénotent pas ou peu de celles connues dans les régions voisines ; le faciès du petit mobilier en Limagne reste profondément attaché à la culture matérielle laténienne, que l’on retrouve de la Bohême à l’Armorique. Si l’on considère uniquement le petit mobilier (et plus particulièrement les parures sur lesquelles sont fondées les grands systèmes chronologiques en vigueur dans les différentes régions voisines) on perçoit en Limagne deux grands horizons pour le IIIe s. Le premier, est celui de la Tène B2 auquel suc-cède l’horizon de La Tène C1 (dans le courant du deuxième quart ou au milieu du siècle ?). Le IIe s. est assez clairement divisé en trois horizons ; La Tène C2 (globalement centrée sur la première moitié du siècle) et La Tène D1a (dans les 30 der-nières années du siècle). Ces deux horizons sont intercalés par un horizon de transition qui est placé vers le milieu du siècle. Le Ier s. est aussi divisé en trois horizons ; La Tène D1b (vers 110-80 av. J.-C.) et à l’opposé (dernier tiers du siècle), un ho-rizon augustéen que l’on peut qualifier de précoce. Entre eux deux, s’intercale assez bien l’horizon de La Tène D2.
5. SYNTHÈSE GÉNÉRALE
5.1. La culture matérielle, base d’une chronologie des mobiliers de Basse Auvergne
Les travaux effectués sur la chronologie des mobiliers de Basse-Auvergne sont à la fois basés sur une analyse comparative des ensembles et sur le rattachement, à partir des fossiles directeurs que sont certaines catégories de petit mobilier, au premier rang desquels on placera les fibules, aux systèmes chronologiques actuellement en vigueur (fig. 16). La prise en compte de tous les indices mobiliers (céramique indigène, vaisselle d’importation, amphore et petit mobilier) permet de proposer une périodisation pour la Basse Auvergne, du IIIe au Ier s. av. J.-C.
L’emploi privilégié de la céramique indigène, qui est la catégorie de mobilier la plus abondamment représentée et la plus sujette aux phénomènes d’évolutions, permet d’individualiser plusieurs étapes que l’on ne distingue pas forcement à l’examen des seuls autres mobiliers. Ainsi, la période du IIe s. av. J.-C. peut être scindée en quatre étapes. Il en va de même pour le siècle suivant qui comporte toutefois une étape supplémentaire correspondant au changement d’ère.
Le IIIe s. av. J.-C. ne peut être, compte tenu de la documentation disponible, que divisé en deux grandes étapes.
Nous rappelons au lecteur que ces propositions témoignent d’un état d’avancement de la recherche et pourront faire l’objet de réajustements ultérieurs en fonction de nouveaux apports. De même, les propositions de rattachement en chronologie absolue sont encore largement hypothétiques en l’absence de datation objective de nos ensembles. A noter toutefois, qu’une date obtenue à partir de l’étude d’un bois provenant d’une structure bâtie (TPQ aux années 154 ou 130 avant J.-C. ; Lambert 1996) s’accorde avec la proposition de rattachement chronologique faite à partir de l’examen du mobilier, bien que peu abondant, associé (La Tène D1a).
Dans l’ensemble, nos propositions sont cohérentes avec celles faites pour les sites du pays ségusiave (Vaginay 1988, Lavendhomme 1997), de la vallée de l’Aisne (Pion 1996) ou encore de la région de Trèves (Metzler 1996). La sériation établie pour le site de Levroux en territoire biturige, conduit également à des propositions voisines : découpage du IIe s. en quatre phases, de La Tène C2 au milieu de La Tène D1b (Buchsenschutz 2000 : 167-172). La sériation des mobiliers qui est à la base de la périodisation proposée pour la Grande Limagne d’Auvergne trouve également une bonne corrélation avec les différentes phases reconnues pour l’évolution du faciès monétaire arverne des deux derniers siècles av. J.-C. (Guichard 1993 : 34).
5.2. Périodisation (fig. 16)
Etape initiale (vers 300-250 av. J.-C. ; La Tène B2récente ou transition La Tène B2/C1 )
On envisage l’étude des ensembles de cette première moi-tié du IIIe s. av. J.-C. et notamment le thème de la «transition La Tène B2/C1» dans le thème spécialisé (Augier dans thème spécialisé).
Céramique indigène : renouvellement partiel du répertoire par comparaison avec les ensembles de la seconde moitié du IVe s. av. J.-C. ; apparition de la jatte à bord rentrant ; évo-lution des jattes à profil en «S» ; apparition des pots à cuire sub-ovoïdes ; apparition des formes hautes à épaulement et des vases ovoïdes en céramique fine ; apparition du façonnage au tour.
Vaisselle d’importation : premières importations d’éléments à pâte claire de type massaliote (cruche, mortier et coupe à anse) et de céramique à vernis noir (anse horizontale de cra-tère ?).
Parure : Présence exclusive des petites fibules à pied libre (pour la plupart des exemplaires dérivés du modèle tardif de Duchcov, absence d’exemplaires de Münsingen). Forte propor-tion des bracelets en matière organique fossilisée absence des bracelets en verre et présence de pendentif en corail.
Monnaie : absence.
Yann DEBERGE et alii196 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 197
Manching Gaule Vallée de Feurs Roanne Basseinterne l'Aisne Auvergne
Vaginay LavendhommeReinecke Polenz Gebhard Miron Colin Pion Guichard Guichard PCR
1902 1982 1991 1992 1998 1996 1988 1997250245240235230225 LTC1 Feurs 0 ? Roanne 0 étape 1220215 LTC1210205200 LTC LTC1195190185
étape 2180175170 LTC2165 LTC2 Aisne 1160
étape 3155150 Roanne 1145 LTC2140135 LTC2/D1a LTD1a Aisne 2 Feurs 1 étape 4130125 LTF1 Roanne 2120 ph 1115 Feurs 2110 LTD1a
étape 5
105 Aisne 3 Roanne 3100 LTD1b9590 ph 2 LTF285 LTD1 LTD1 Feurs 3
étape 6
80 LTD1b75 Aisne 4 Roanne 470
avant n.è. 65 LTD2a60 ph 3 étape 7
5550 Feurs 445 Aisne 5 LTF340 LTD2b35 LTD2 LTD2 ph 4 Roanne 5 étape 830252015 LTD3 Aisne 6 Roanne 6 étape 9
10 ph 5a55 étape 10
10après n.è. 15 ph 5b
2025
LTD1a
LTD1b
LTD2a
LTD2b
GR 1
GR 2
1999-2003Metzler1996
région de Trèves
Fig. 16 : Chronologie comparée et périodisation de la sériation des mobiliers pour la Basse Auvergne. La terminologie employée (étapes 1 à 10) est provisoire.
Yann DEBERGE et alii196 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 197
Etape 1 (vers 250-200 av. J.-C. ; La Tène C1)
Céramique indigène : évolution des modèles apparus précé-demment ; développement du répertoire de la céramique fine (jattes à bord rentrant, évolution de la morphologie des jattes à profil en «S», diversification du répertoire des formes hautes tournées avec quelques rares exemplaires peints) ; renouvelle-ment partiel du répertoire de la céramique grossière (appari-tion des pots à cuire et de stockage ovoïdes qui concurrencent les exemplaires sub-ovoïdes) ; usage du tour en progression pour la céramique fine.
Vaisselle d’importation : céramique à pâte claire (cruche) ; premiers éléments de campanienne A (à la fin de la période, Lamb. 68bc, Lamb. 42Bc, Lamb. 27B, Lamb. 28, Lamb. 27ab et Lamb. 36) ; quelques pichets en provenance de la côte cata-lane.
Parure : exclusivement des fibules filiformes à pied attaché sur l’arc («schéma La Tène II»). Premiers bracelets en verre de couleur bleu cobalt pour la plupart (dominés par les exem-plaires des séries 1, 11a, 12, 14 et 19 de Gebhard) et fréquence toujours élevée des bracelets en matière organique fossilisée.
Monnaie : 1 quart de statère (imitation gauloise de première génération des statères de Philippe II de Macédoine).
Etape 2 (vers 200-160 av. J.-C. ; La Tène C2 ou C2a)
Céramique indigène : disparition des pots à cuire sub-ovoïdes ; apparition des premiers éléments grossiers tournés (pots à cuire) ; généralisation du tour pour la céramique fine ; diversification du répertoire des formes hautes fines (vase à panse pincée) ; évolution minime pour les formes basses avec néanmoins une tendance nette à l’abaissement des récipients ; présence significative de la céramique peinte qui comporte, pour le moment, uniquement des décors géométriques.
Vaisselle d’importation : répertoire inchangé ; céramique à pâte claire (cruches et mortiers) et campanienne A (Lamb. 68bc, Lamb. 42Bc, Lamb. 27B, Lamb. 28, Lamb. 27ab et Lamb. 36).
Parure : fibules de «schéma La Tène II» dont plusieurs exemplaires de plus de 100 mm de long (variante occiden-tale des fibules de Mötschwil ?). Bracelets en verre incolore à feuille jaune interne à 5 côtes (série 7a de Gebhard), début de la diffusion des bracelets en verre bleu cobalt de section en «D» (Gebhard 38) ? Fréquence toujours élevée des bracelets en matière organique fossilisée. Brassards métalliques (fer ou alliages cuivreux).
Monnaie : absence.
Etape 3 (vers 160-140 av. J.-C. ; La Tène C2/D1 ou C2b)
Céramique indigène : renouvellement partiel du répertoire qui reste néanmoins ancré dans celui de La Tène C2 (forme haute à panse pincée, rares jattes à profil en «S», pot à cuire
ovoïde seul) ; augmentation de la place occupée par les jattes d’Aulnat ; apparition des premières jattes à bord mouluré ; apparition de la première génération d’imitation de campa-nienne (Lamb. 27) et de la céramique peinte à décor zoomor-phe.
Vaisselle d’importation : répertoire inchangé (mortier et cruche à pâte claire, campanienne A (principalement Lamb. 27B).
Amphore : apparition des tous premiers éléments qui restent rares et sont de morphologie ancienne (gréco-itali-ques ?).
Parure : fibules «de schéma La Tène II» ; apparition des variantes à long ressort en arbalète enroulé autour d’un petit axe ? Fréquence toujours élevée des bracelets en matière orga-nique fossilisée. La faible fréquence des bracelets en verre ne peut pas être tenue pour significative de quoique ce soit (les ensembles étudiés livrent peu de petit mobilier). On constate toutefois la présence d’un bracelet à rainure centrale de cou-leur brune (série 35a de Gebhard). Les brassards métalliques semblent se maintenir. Apparition des premiers bracelets filiformes en alliage cuivreux à jonc ouvert à extrémités «bou-letées» ? Premières perles toriques.
Monnaies : apparition des premiers potins dans le nord de la Limagne. 2 potins Nash 588-593 «à tête diabolique» dans la fosse 61 du «Clos Clidor» à Aigueperse (Guichard 1999a).
Etape 4 (vers 140-130 av. J.-C. ; La Tène D1a ancienne)
Céramique indigène : disparition progressive du fond de La Tène C2 (formes hautes à épaulement, vases à panse pincée…) et apparition de nouvelles formes en céramique fine (forme haute à panse élevée, deuxième génération d’imitations de campaniennes - bols Lamb. 31/33 -) ; vaisselle culinaire domi-née par le service de la jatte d’Aulnat (jatte à bord mouluré, jatte d’Aulnat et pot à cuire globulaire) ; céramique peinte à décor zoomorphe.
Vaisselle d’importation : apparition à côté des éléments déjà présents (cruches et mortiers à pâte claire ; gobelets et pichets catalans ; campanienne A) de balsamaires.
Amphores : augmentation de la fréquence des amphores ; exemplaires de morphologie ancienne (gréco-italiques et Dressel 1A précoces).
Parure : fibules «de schéma La Tène II», le plus souvent de petite dimension et variantes à long ressort en arbalète en-roulé autour d’un petit axe. Premiers bracelets en verre pour-pre (séries 36 et 37 de Gebhard) aux côtés des exemplaires de couleur bleue (série 38). Présence décroissante des bracelets en matière organique fossilisée. La présence des bracelets filiformes en alliage cuivreux à jonc ouvert à extrémités «bou-letées» se maintient. Premières perles toriques en verre.
Monnaies : apparition, fugace, des premiers potins dans le bassin clermontois (3 exemplaires dont 1 appartenant à la série Nash 594 «au long cou»).
Yann DEBERGE et alii198 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 199
Etape 5 (vers 130-110 av. J.-C. ; La Tène D1a récente)
Céramique indigène : peu d’évolution concernant la cérami-que grossière si ce n’est un fléchissement significatif des jattes d’Aulnat ; évolution marquée du répertoire de la céramique fine avec notamment l’apparition de nouvelles formes empruntant largement au répertoire de la céramique méditerranéenne (imitation de cruche à pâte claire, de pichets à col tronconique et troisième génération d’imitations de campanienne - Lamb. 6) ; apparition de nouvelles solutions décoratives (molettes) et technologiques (pâte kaolinique et cuisson en mode B) ; cé-ramique peinte à décor zoomorphe (en recul ?) accompagnée d’exemplaires nouveaux intégralement peints en blanc ou à décor géométrique.
Vaisselle d’importation : répertoire en grande partie inchan-gé (pâte claire, campanienne A, grise catalane) si ce n’est l’ap-parition des tous premiers éléments en campanienne B encore très peu représentés (Lamb. 1 et surtout 5).
Amphores : fréquence en forte augmentation ; corpus do-miné par les Dressel 1A «classiques» et les Dressel 1G.
Parure : recul des fibules de «schéma La Tène II» et appari-tion des premières fibules de Nauheim. Les bracelets en verre, pourpre et bleu, de section en «D» ou triangulaire se maintien-nent aux côtés des bracelets en matière organique fossilisée et des bracelets filiformes en alliage cuivreux à jonc ouvert à ex-trémités «bouletées». Diffusion des bracelets tubulaires en tôle métallique et des bracelets à épissures. La fréquence des perles toriques en verre s’accroît.
Monnaies : accroissement de la fréquence du monnayage ; présence seule ou très majoritaire des espèces de bronzes cou-lés. Phase 1 du faciès monétaire arverne (Guichard 1993 : 34).
Etape 6 (vers 110-80 av. J.-C ; La Tène D1b)
Céramique indigène : évolution significative avec notam-ment la disparition du service d’Aulnat (modification de la morphologie des pots à cuire, disparition de la jatte d’Aulnat) à l’exception toutefois de la jatte à bord mouluré ; pour la cé-ramique fine développement des innovations faites à l’étape précédente tant sur le plan technologique (pâte claire, cuisson en mode B) que morphologique (augmentation de la fréquence des imitations de céramique méditerranéenne) et décorative (décor à la molette, ondé au peigne) ; apparition des imitations de campanienne de quatrième génération (première imitation de Lamb. 5) ; quasi disparition de la vaisselle peinte (?).
Vaisselle d’importation : diversification des importations (céramique culinaire italique), coexistence des campaniennes A et B (en progression).
Amphores : très forte représentation du mobilier amphori-que ; corpus dominé par les Dressel 1A «canoniques» et Dressel 1G, alors que les exemplaires plus évolués font leur apparition (Dressel 1A/1B et 1B).
Parure : aux côtés des fibules de Nauheim (très nombreu-
ses) et de leurs dérivés, apparaissent les fibules en fer, à ressort bilatéral à 4 spires à corde externe et à arc filiforme ou plat, de section plus ou moins ovale ou losangique (variante 2a de Feu-gère). Les bracelets en verre (séries 36, 37 et 38 de Gebhard) se raréfient alors que la fréquence des bracelets en matière orga-nique fossilisée se maintient. Les perles toriques en verre sont très nombreuses et dépassent de loin le nombre des bracelets en verre. Les bracelets filiformes en alliage cuivreux à jonc ouvert à extrémités «bouletées» et les bracelets tubulaires en tôle métallique sont toujours diffusés.
Monnaies : les espèces de bronzes frappés dominent au détriment des potins, consécutivement à un basculement du faciès monétaire survenu au début du siècle. Phase 2 du faciès monétaire arverne. Quelques bronzes coulés (Nash 594 «au long cou»), nombreux bronzes frappés de la 1ere série (BN 3966-3969 «au renard», BN 3982-3989 «cheval/cheval», LT XII/3994 «MOTVIDIACA», LT XII/3868 «ADCANAVNOS»), argents anépigraphes (ibid.).
Etape 7 (vers 80-50 av. J.-C. ; La Tène D2a)
Céramique indigène : évolution peu significative du réper-toire de la céramique grossière (légère modification du profil des pots cuire et de stockage) avec toutefois la régression des jattes à bord rentrant ; pour la céramique fine développement des innovations faites à l’étape 5 ; les formes dérivées du réper-toire de la céramique d’importation présentent un profil plus évolué (cruche à col tronconique haut, imitation de Lamb. 5 et 6) ; apparition de nouvelles imitations de campanienne (Lamb. 1 et 2) et nouvelles formes d’inspiration indigène (forme à ca-rène haute, jatte carénée à pâte claire).
Vaisselle d’importation : répertoire de la campanienne dominé par la Boïde ; apparition des parois fines pré-augus-téennes.
Amphores : baisse de la fréquence du mobilier amphorique ; corpus dominé par les exemplaires tardifs (Dressel 1A/1B et 1B) à côté des Dressel 1A «canoniques» en forte diminution.
Parure : la documentation disponible pour cette étape dans le Bassin clermontois est malheureusement très lacunaire. Les fibules de Nauheim semblent disparaître avant le milieu du siècle. Les fibules en fer, à ressort bilatéral à 4 spires à corde externe et à arc filiforme ou plat, de section plus ou moins ovale ou losangique (variante 2a de Feugère) semblent se maintenir. On note l’apparition d’exemplaires similaires en alliage cui-vreux. Les contextes archéologiques fiables manquent pour suivre l’évolution, en Limagne, des fibules pour cette étape (1 seule fibule à coquille, non stratifiée, et 1 fibule à arc mouluré). Il en va de même pour les éléments de parure annulaire : 1 bracelet en verre bleu (série 38 de Gebhard) et 3 perles toriques en verre.
Monnaies : quelques bronzes coulés, maintient de la prédo-minance des bronzes frappés de la 1ere série (BN 3966-3969 «au renard», LT XII/3952 «EPOS», LT XII/3921 «DONNADV»,
Yann DEBERGE et alii198 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 199
LT XII/3868 «ADCANAVNOS») à laquelle s’ajoute ceux de la 2e série (LT XII/3894 «EPAD/CICECV.BRI»). Phase 3 du faciès monétaire arverne (ibid.)
Etape 8 (vers 50-30 av. J.-C. ; La Tène D2b)
Céramique indigène : complexification du profil des réci-pients en céramique grossière ; diminution de la place occupée par ces productions (?) ; pour la céramique fine, formes évo-luées par rapport à l’étape précédente (jatte à bord rentrant et imitation de Lamb. 1, 2 et 7) ; apparition des jattes carénées à bord en gouttière, des imitations de gobelets à parois fines et des imitations de plats à cuire italiques ; développement du répertoire des cruches à pâte claire qui va de paire avec l’appa-rition de l’engobage de surface.
Vaisselle d’importation : parois fines pré-augustéennes, go-belets d’ACO, campanienne B seule.
Amphores : exemplaires tardifs (Dressel 1A/1B et 1B) repré-sentés seuls.
Parure : diffusion des variantes 2a de Feugère en alliage cuivreux. Pour le reste, on note les mêmes problèmes que pour l’étape précédente. Toutefois, les fouilles anciennes de Jean-Jacques Hatt sur l’oppidum de Gergovie attestent la diffusion des kragenfibeln et des fibules d’Alésia.
Monnaies : quelques bronzes coulés résiduels (Nash 594 «au long cou»), maintient de la prédominance des bronzes frappés des 1ere et 2eme séries, apparition des premières espèces de la 3eme série (LT XII/3900 «EPAD au guerrier»), argent anépigra-phe (résiduel ?). Phase 4 du faciès monétaire arverne (ibid.).
Etape 9 (vers 30-10 av. J.-C. ; Augustéen ancien)
Céramique indigène : diminution de la place occupée par les productions grossières modelées (?) ; pour la céramique fine,
quasi disparition des formes typiquement indigènes (formes hautes évoluées par rapport à l’étape précédente, jatte à bord rentrant notamment) au profit des formes d’inspiration médi-terranéennes (imitations de parois fines, cruches à col tronco-nique et cruches en pâte claire engobée blanc, imitation Lamb. 7 et assiettes VRP).
Vaisselle d’importation : gobelets à parois fines augustéens, disparition de la campanienne et apparition de la sigillée itali-que.
Amphores : présence en petit nombre des Dressel 1B seules ; apparition des amphores hispaniques (Pascual 1).
Parure : fibule en alliage cuivreux, à mi-chemin entre les variantes 2a et le type 14a de Feugère et diffusion des fibules à 6 ou 8 spires et à arc large et plat (Feugère 9b/Almgren 241) ; ces dernières sont toutefois non stratifiées. Les fibules à disque médian proche du type Feugère 15a sont documentées dans les fouilles de Jean-Jacques Hatt à Gergovie.
Monnaies : absence totale des potins, bronzes frappés de la 3eme série (LT XII/3943 «VERCA» et LT XII/4353 «SEX F/T POM»), argent (néant). Phase 4 du faciès monétaire arverne (ibid.).
Etape 10 (vers 10 av./15 après J.-C. ; Augustéen récent)
Céramique indigène : pas d’évolution significative si ce n’est l’apparition de formes dérivées du répertoire de la sigillée itali-que et le recours à de nouvelles solutions décoratives (engobage rouge, glaçure plombifère) ; première sigillées gauloises.
Vaisselle d’importation : sigillée italique.Amphores : amphores hispaniques seules (Pascual 1, Hal-
tern 70).Parure : diffusion des premières fibules à queue de Paon ;
idem pour les fibules à ressort protégé de type Langton Down (Feugère 14b1) ?
NOTES
(1) En ce qui concerne la typologie, nous nous réfèrerons pour les pâtes claires à Py 2001 (623 à 826) selon qu’il s’agit de «céramiques à pâte claire massaliète» ou de «céramiques à pâte claire récente», et pour les céramiques à vernis noir à Lamboglia 1952.
(2) Ce travail est en cours de réalisation dans le cadre d’une thèse de doctorat portant sur «Les importations de vaisselle céramique en Gaule du Centre Est du IIIe au Ier s. av. J.-C.» préparée à l’Université de Bourgogne, sous la direction de M. Gilles Sauron.
(3) Voir notamment la contribution de M. Loughton dans cet arti-cle mais aussi Olmer 2003.
(4) Il y a quelques exemplaires de lèvres, d’épaules et de pieds appartenant à des Dressel 1B sur le site du «Pâtural» à Clermont-Ferrand. Ceux-ci ne proviennent pas des contextes laténiens mais
d’un chenal comblé en grande partie à la période augustéenne, au moment où le site accueille une petite nécropole à incinération (Loughton à paraître).
(5) Les sites laténiens de «La Grande Borne» (fouillé par Robert Périchon et John Collis dans les années 1960-1970) et de «Gandaillat» (fouillé par Christine Vermeulen en 2000, 2001 et 2003) sont en réalité deux secteurs d’un seul et même site, éloignés de quelques centaines de mètres (Deberge dans ce volume b). Ce site, connu internationalement sous l’appellation d’Aulnat est en réalité situé à l’extrémité orientale du territoire actuel de la commune de Clermont-Ferrand.
(6) Le site laténien du «Pâtural» est situé sur la commune de Clermont-Ferrand, 3 km au nord du site «d’Aulnat» («Gandaillat/La Grande Borne»).
Yann DEBERGE et alii200 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 201
BIBLIOGRAPHIE
Alfonso 2001 : G. Alfonso, V. Bel, C. Jouannet, R. Lisfranc, I. Rodet-Bélarbi, A. Wittmann, Gerzat «Rochefort», occupation rurale laténienne et gallo-romaine, DFS, Clermont-Ferrand, Service Régional de l’Archéologie, 2001.
Andrews 1997 : K. Andrews, From ceramic finishes to modes of production, Iron Age finewares from Central France, dans C.-G. Cumberpatch, P.-W. Blonkhorn (eds.), Not so much a pot, more a way of life, Oxford, Oxbow Books, 1997, p. 57-75.
Aulas 1988 : C. Aulas, Les amphores, dans M. Vaginay et V. Guichard (dir.), L’habitat Gaulois de Feurs (Loire), fouilles récentes (1978–1981), Documents d’archéologie française, 14, Paris, Éditions Maison des Sciences de l’Homme, 1988, p. 87-91.
Augier thème spécialisé : L. Augier, C. Mennessier-Jouannet, P.-Y. Milcent, S. Riquier, P. Pion, L. Orengo, Les IVe-IIIe s. av. n.è. en France centrale, dans thème spécialisé.
Barral 1999 : P. Barral, Place des influences méditerranéennes dans l’évolution de la céramique indigène en pays éduen aux IIe-Ier s. av. n.è., dans M. Tuffreau-Libre, A. Jacques, La céramique précoce en Gaule Belgique et dans les régions voisines, de la poterie gauloise à la céramique gallo-romaine (actes de la table-ronde d’Arras, 1996), Nord-Ouest Archéologie, 9, 1999, p. 367-384.
Barral 2002 : P. Barral, Quelques traits remarquables de la com-position et de l’évolution du vaisselier céramique à La Tène finale en pays éduen, dans P. Méniel, B. Lambot (éd.), Repas des vivants et nourriture pour les morts en Gaule (actes du XXVe colloque de l’AFEAF, Charleville-Mézières, 2001), Mémoire de la Société Archéologique Champenoise, 16, Reims, 2002, p. 157-166.
Baray 1991 : L. Baray, Le Sénonais dans son contexte du Bassin parisien du IVè et du IIIè siècle avant J.-C., dans Revue archéologique de l’Est, 42, 1991, p. 203-270.
Buchsenschutz 1994 : O. Büchsenschütz, A. Colin, S. Krausz, M. Levery et Cl. Soyer (dir.), Le village Celtique des Arènes à Levroux, description du mobilier (Levroux 3), Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 10, Tours, ADEL, 1994.
Buchsenschutz 2000 : O. Büchsenschütz, A. Colin, S. Krausz, M. Levery et C. Soyer (dir.), Le village Celtique des Arènes à Levrou, synthèses (Levroux 5), Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 19, Tours, ADEL, 2000.
Brunaux 1988 : J.-L. Brunaux et A. Rapin, Gournay II, Boucliers et lances, dépôts et trophées, Revue Archéologique de Picardie, Paris, Errance, 1988, 245p.
Castella 1990 : D. Castella et L. Flutsch, Sanctuaires et monuments funéraires à Avenches en Chaplix VD, dans Archéologie Suisse, 13, 1990, p. 2-30
Cahen-Delhaye 1998 : A. Cahen-Delhaye, Vers une nouvelle interprétation des vestiges du «Trou de l’Ambre» à Eprave (Namur), dans G. Leman-Delerive (dir), Les Celtes, rites funéraires en Gaule du Nord entre le VIè et le Ier siècle avant Jésus-Christ. Recherches récentes en Wallonie, Etudes et Documents série Fouilles, 4, Namur 1998, p. 103-105.
Colin 1998 : A. Colin, Chronologie des oppida de la Gaule non méditerranéenne, Documents d’archéologie française, 71, Paris, Éditions Maison des Sciences de l’Homme, 1998.
Collis 1983 : J.-R. Collis, La stratigraphie du chantier sud d’Aul-nat, dans J. Collis, A. Duval, R. Périchon, Le Deuxième âge du Fer en Auvergne et en Forez et ses relations avec les régions voisines (Actes du IVe colloque de l’AFEAF, Clermont-Ferrand , 1980), Sheffield, Université de Sheffield et Centre d’étude foréziennes, 1983, p. 48-56.
Collis dans ce volume : J.-R. Collis, Du IVe colloque de l’AFEAF à l’ARAFA et au XXVIIe colloque, L’archéologie de l’Age du Fer en Auvergne (1973-2003), dans ce volume.
Deberge 1999 : Y. Deberge, Un puits de la Tène finale au «Brézet», Clermont-Ferand, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typolo-gie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermé-diaire du PCR, Mirefleurs, 1999, p. 104-113.
Deberge 2000 : Y. Deberge, V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, La structure 5557 sur le site du «Pâtural» à Clermont-Ferrand, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2000, p. 152-187.
Deberge 2000a : Y. Deberge, Un puits à cuvelage en bois de La Tène finale au Brézet (Clermont-Ferrand), dans Revue Archéologique du Centre de la France, 39, 2000, p. 43-62.
Deberge 2001 : Y. Deberge, V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, Clermont-Ferrand, «La Grande Borne», puits 41, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2001, p. 69-90.
Deberge 2001a : Y. Deberge, V. Guichard, M. Loughton, Clermont-Ferrand, «Rue Elisée Reclus», puits 78, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2001, p. 91-115.
Deberge 2001b : Y. Deberge, S. Faye, V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, D. Pasquier, Veyre-Monton, oppidum de Corent, niveaux d’occupation, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2001, p. 130-173.
Deberge 2002 : Y. Deberge, J. Collis, J. Dunkley (dir.), Le site du «Pâtural» à Clermont-Ferrand : évolution d’un établissement agricole
(7) Ces déchets de fabrication sont présents dans des ensembles datés de La Tène D1 à «La Grande Borne», mais aussi à Cournon «La Grande Halle/Sarliève», ainsi que sur le site de Corent. Ils font d’ailleurs l’objet d’une thèse de Doctorat (Minni en préparation).
(8) L’existence du sanctuaire de Corent ne se limite pas à la fin de l’âge du Fer puisque l’on sait que ce dernier a fait l’objet de plusieurs phases d’aménagements et qu’il fût fréquenté jusque dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. (Poux 2002).
Yann DEBERGE et alii200 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 201
gaulois (IIIe-IIe s. av. J.-C.) en Limagne d’Auvergne, DFS, Clermont-Ferrand, SRA/AFAN/ARAFA, 2002 (multigraphié, 4 volumes).
Deberge 2002a : Y. Deberge, C. Mennessier-Jouannet, M. Lou-ghton, Clermont-Ferrand, «Le Brézet», puits 15, dans C. Mennes-sier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2002, p. 120-135.
Deberge 2002b : Y. Deberge, M. Loughton, Cournon, «Sarliève, puits 2474/2485, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2002, p. 136-155.
Deberge 2002c : Y. Deberge, M. Poux, D. Pasquier, M. Garcia, F. Malacher, Oppidum de Corent, enclos 10325, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2002, p. 156-178.
Deberge 2002d : Y. Deberge, L. Oregno, La nécropole de «Sarliè-ve» à Cournon, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2002, p. 99-119.
Deberge dans ce volume : Y. Deberge, Les établissements ruraux fossoyés en Basse-Auvergne du IIIe au IIe s. av. n.è., dans ce volume.
Deberge dans ce volume a : Y. Deberge et L. Orengo, Les mobiliers funéraires en Basse Auvergne du IIIe au Ier s. av. n.è., dans ce volume.
Deberge dans ce volume b : Y. Deberge, C. Vermeulen, J. Collis, Le complexe de «Gandaillat / La Grande Borne : un état de la question», dans ce volume.
Déchelette 1914 : J. Déchelette, Manuel d’Archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine II, Archéologie celtique ou protohistorique. Troisième partie. Second âge du Fer ou époque de La Tène, Paris, Auguste Picard, 1914, p. 912-1692
Desbat 1998 : A. Desbat, L’arrêt des importations de Dressel 1 en Gaule, dans Actes du Congrès d’Istres de la SFECAG, 1998, p.31-36.
Duval 1976 : A. Duval, Aspects de La Tène moyenne dans le Bas-sin parisien, dans Bulletin de la Société Préhistorique Française, 73, 1976, p. 457-484.
Fauduet 1982 : I. Fauduet, Les fibules des oppida du centre de la Gaule, un aperçu, dans J. Collis, A. Duval, R. Périchon, Le Deuxième âge du Fer en Auvergne et en Forez et ses relations avec les régions voisi-nes (IVe colloque de l’AFEAF, Clermont-Ferrand , 1980), Sheffield, Uni-versité de Sheffield et Centre d’étude foréziennes, 1983, p. 255-270.
Fauduet 1982a : I. Fauduet, Les fibules des collections archéologi-ques du Musée Bargoin, Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, 1982, 66 p.
Faye 1995 : S. Faye, Les objets de parure et de toilette de l’oppidum de Corent, Mémoire de Maîtrise, Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II, 1994-1995, 102 p., 34 pl.
Feugère 1985 : M. Feugère, Les fibules en Gaule méridionale, de la conquête au Vè S. ap. J.-C., Supplément à la Revue Archéologique de Narbonnaise, 12, Paris, CNRS, 1985, 509 p.
Feugère 1994 : M. Feugère, Les casques antiques, Visages de la guerre de Mycènes à l’Antiquité tardive, Paris , Errance, 1994, 173 p.
Gebhard 1989 : R. Gebhard, Pour une nouvelle typologie des bracelets celtiques en verre, dans M. Feugère (dir), Le verre préromain
en Europe occidentale (journée d’étude de Lyon, 8 novembre 1986), Ed. M. Mergoil, 1989, p. 73-83.
Gebhard 1991 : R. Gebhard, Die fibeln aus Oppidum von Manching, (Die Ausgrabungen in Manching 14), Römisch-Germanische-Kommission, Stuttgart, 1991, 224 p., 86 pl.
Genin 1992 : M. Genin, M.-O. Lavendhomme, V. Guichard, Les influences méditerranéennes dans le répertoire des céramiques grises de Roanne (Loire) au Ier s. av. J.-C. et au Ier s. ap. J.-C., dans G. Kaenel, P. Curdy, Les Celtes dans le Jura (XVe colloque de l’AFEAF, Pontarlier-Yverdon ,1991), Cahiers d’Archéologie Romande, 57, 1992, p. 239-261.
Gruat 1991 : P. Gruat, J. Maniscalo, H. Marin, E. Crubezy, Aux origines de Rodez (Aveyron), les fouilles de la caserne Rauch, dans Aquitania, 9, Bordeaux, édition FA, 1991, p. 61-104.
Guichard 1987 : V. Guichard, La céramique peinte à décor zoo-morphe des IIe et Ier s. avant J.-C. en territoire ségusiave, dans Etudes celtiques, 24, 1987, p. 103-143.
Guichard 1993 : V. Guichard, P. Pion, F. Malacher, J. Collis, A propos de la circulation monétaire en Gaule Chevelue aux IIème et Ier siècles av. J.-C., dans Revue Archéologique du Centre de la France, 32, 1993, p. 25-55.
Guichard 1994 : V. Guichard, La céramique peinte des IIe et Ier s. av. J.-C. dans le nord du Massif Central, nouvelles données, dans Etudes celtiques, 30, 1994, p. 81-114.
Guichard 1997 : V. Guichard, Les amphores, dans M.-O. Lavendhomme et V. Guichard (dir.), Rodumna (Roanne, Loire), le village Gaulois, Documents d’archéologie française, 62, Paris, Éditions Maison des Sciences de l’Homme, 1997, p. 133-141.
Guichard 1997a : V. Guichard, L’instrumentum, dans M.-O. Lavendhomme et V. Guichard (dir.), Rodumna (Roanne, Loire), le village Gaulois, Documents d’archéologie française, 62, Paris, Éditions Maison des Sciences de l’Homme), 1997, p. 156-167.
Guichard 1999 : V. Guichard, L. Orengo, Le fossé 12/13 du site de «La Grande Borne» à Clermont-Ferrand, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 1999, p. 67-91.
Guichard 1999a : V. Guichard, C. Mennessier-Jouannet, M. Loughton, L. Orengo, La fossé 61 du «Clos Clidor» à Aigueperse, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 1999, p. 92-103.
Guichard 1999b : V. Guichard (dir.), Archéologie en Grande Lima-gne d’Auvergne sur le tracé de l’autoroute A710, Contribution à l’histoire de l’exploitation d’un milieu palustre, DFS, Clermont-Ferrand, SRA/AFAN/ARAFA, 1999-2000 (multigraphié, 5 volumes).
Guichard 1999c : V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, Ensem-bles funéraires du Ier s. avant J.-C. à «Chaniat», Malintrat, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 1999, p. 113-148.
Guichard 2000 : V. Guichard, L. Orengo, Clermont-Ferrand, «La Grande Borne», Chemin8, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne,
Yann DEBERGE et alii202 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 203
rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2000, p. 87-109.Guichard 2000a : V. Guichard, L. Orengo, Clermont-Ferrand, «La
Grande Borne», fosse 38, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2000, p. 110-123.
Guichard 2000b : V. Guichard, L. Orengo, M. Loughton, Clermont-Ferrand, «La Grande Borne», fosse 34, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2000, p. 188-205.
Guichard 2000c : V. Guichard, M. Loughton, Clermont-Ferrand, «Pontcharaud», fosse 5, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2000, p. 206-229.
Guichard 2000d : V. Guichard, M. Loughton, Le Cendre, oppidum Gondole, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2000, p. 230-241.
Guichard 2001 : V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, Deux ensembles de La Tène finale au «Bay», dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2001, p. 116-129.
Guichard 2001a : V. Guichard, D. Leguet, D. Tourlonias, La Roche Blanche, oppidum de Gergovie, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2001, p. 193-208.
Guichard 2002 : V. Guichard, Un dernier moment de folie créatrice : le répertoire ornemental de la céramique dans le nord-est du Massif Central au IIe s. avant J.-C., dans O. Buchsenschutz, A ; Bulard, M.-B. Chardenoux, N. Ginoux (dir.), Décors, images et signes de l’âge du Fer européen (Actes du XXVIe colloque de l’AFEAF), Paris et Saint-Denis, 2002, p. 91 à 112.
Guillaumet 1993 : J.-P. Guillaumet, Les fibules de Bibracte, techni-que et typologie, Publications du Centre de Recherche sur les Techni-ques Gallo-romaines (C.R.T.G.R), 14, Université de Bourgogne, 1993.
Guštin 1987 : M. Guštin, La Tène fibulae from Istria, dans Archaeologia Iugoslavica, 24, 1987, p. 43-57.
Hatt 1943 : J.-J. Hatt, Les fouilles de Gergovie, La campagne de 1942, dans Gallia, II, 1943, p. 97-123
Hatt 1947 : J.-J Hatt, Les fouilles de Gergovie, Campagnes de 1943 et de 1944, dans Gallia, V, fasc.II, 1947, p. 272-300.
Hénon 1995 : B. Hénon, Les amphores de la vallée de l’Ainse à La Tène finale, dans Revue Aréchéologique de Picardie, 1995, p. 149-186.
Hesnard 1981 : A. Hesnard et C. Lemoine, Les amphores du Cécube et du Falerne, prospections, typologie analyses, dans Mélanges de l’École Française de Rome, 93, 1981, p.243-295.
Izac-Imbert 2001 : L. Izac-Imbert, V. Guichard, A. Quinqueton, L. Orengo, Un habitt excavé de l’oppidum de La Roche-Lambert à Marcilhac, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2001, p. 174-192.
Lallemand dans ce volume : D. Lallemand et L. Orengo, Les ensembles de mobilier de La Tène moyenne de l’habitat groupé de Varennes-sur-Allier (Allier, Bourbonnais), premières analyses, dans
ce volume. Lambert 1996 : G. Lambert, C. Lavier, Etude dendrochronologique
de bois provenant de la fouille de l’A710 à Gerzat (63), Besançon, Université de Franche-Comté, 1996 (multigraphié).
Lamboglia 1952 : N. Lamboglia, Per una classificazione preliminare della ceramica campana (Atti del Congresso di Studi Liguri), Bordighera, 1950.
Lambot 1996 : B. Lambot, M. Friboulet, Essai de chronologie du site de La Tène finale d’Acy-Romance (Ardennes), dans La Chro-nologie du second âge du Fer en Gaule du Nord (actes de la table-ronde de Ribemont-sur-Ancre, 21-22 octobre 1994), Revue Archéologique de Picardie, 3/4, Amiens, 1996, p. 123-151.
Lavendhomme1997 : M-O. Lavendhomme et V. Guichard, Ro-dumna (Roanne, Loire), le village gaulois, Documents d’archéologie française, 62, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1997, 369 p.
Lavendhomme 1999 : M.-O. Lavendhomme, Etude du mobilier amphorique, dans C. Vermeulen, Chassenard La Génerie, DFS, Service Régional de l’Archéologie, 1999, p. 42-43.
Leguet 1999 : D Leguet et D. Toulonias, Les fosses près du chemin de la Croix, dans Bulletin de l’Association du Site de Gergovie, 17, 1999, p. 23-34
Lejars 1994 : T. Lejars, Gournay III les fourreaux d’épées, Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde et l’armement des Celtes de La Tène moyenne, Archéologie Aujourd’hui, Paris, Errance, 1994.
Levéry 2000 : M. Levéry, La céramique gauloise du terrain Rogier, Esquisse d’une typologie et d’une chronologie, dans O. Büchsens-chütz, A. Colin, S. Krausz, M. Levery et C. Soyer (dir.), Le village Celtique des Arènes à Levroux, synthèses (Levroux 5), Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 19, Tours, ADEL, 2000, p. 53-82.
Loison 1991 : G. Loison, J. Collis, V. Guichard, Les pratiques fu-néraires en Auvergne à la fin du second âge du Fer, nouvelles données, dans Revue Archéologique du Centre de la France, 30, 1991, p. 97-111.
Long 1998 : L. Long, Lucius Volteilius et l’amphore du 4e type, dé-couverte d’une amphore atypique dans une épave en baie de Marseille, dans El Vi a l’Antiguitat, Economia, produccio i comerç al Mediterrani Occidental (Actes du colloque de Badalona), Monografies Badalonines, 14, Badalona, 1998, p. 341-349.
Loughton 2000 : M.-E. Loughton, La morphologie des ampho-res républicaines en Auvergne, dans Société Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule, Actes du Congrès de Libourne, 2000, p. 243-256.
Loughton 2003 : M.-E. Loughton, The Dressel 1G: a new type of Republican amphora, dans Archäologisches Korrespondenzblatt, 33/4, 2003, p. 561-575.
Loughton 2003a : M.-E. Loughton, The distribution of Republi-can amphorae in France, dans Oxford Journal of Archaeology 22 (2), 2003, p. 177-207.
Loughton à paraître : M.-E. Loughton, Republican amphorae from Iron age sites in the Auvergne, central France, morphology, chro-nology, fabrics and stamps, Oxford, British Archaeological Reports International Series, en préparation.
Loughton 2000 : M. E. Loughton et S. Jones, Les amphores
Yann DEBERGE et alii202 La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du IIIe au Ier s. av. J.-C. 203
républicaines en Auvergne (Puy-de-Dôme), importation et diffusion avant la Conquête, dans Revue Archéologique du Centre de la France, 39, 2000, p. 63-81.
Malrain 2002 : F. Malrain, E. Pinard, S. Gaudefroy, La vaissellerie de la moyenne vallée de l’Oise, de la typologie morpho-fonctionnelle aux statuts sociaux, dans P. Méniel, B. Lambot (éd.), Repas des vi-vants et nourriture pour les morts en Gaule (actes du XXVe colloque de l’AFEAF, Charleville-Mézières, 2001), Mémoire de la Société Archéolo-gique Champenoise, 16, Reims, 2002, p. 167-180.
Mathevot 1998 : C. Mathevot, Etude preliminaire des importa-tions d’amphores Italiques sur le site de Chézieux (Loire), dans R. Périchon (dir.), Ceramiques,6, Saint-Etienne, Opus, 1998, p. 23-57.
Maza 1998 : G. Maza, Recherche méthodologique sur les am-phores Gréco-Italiques et Dressel 1 découvertes à Lyon IIe-Ier siècles avant J.-C., dans Actes de la SFECAG.(Congrès d’Istres), 1998, p.11-29.
Mennessier-Jouannet 1996 : C. Mennessier-Jouannet, J. Dunkley, Le site laténien d’Aigueperse «Le Clos Clidort», DFS de sauvetage, Clermont-Ferrand, SRA Auvergne, 1996 (multigraphié).
Mennessier-Jouannet dir. 1999 : C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rap-port intermédiaire du PCR 1999, 155 p. (multigraphié).
Mennessier-Jouannet dir. 2000 : C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rap-port intermédiaire du PCR 2000, 248 p. (multigraphié).
Mennessier-Jouannet dir. 2001 : C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rap-port intermédiaire du PCR 2001, 221 p. (multigraphié).
Mennessier-Jouannet dir. 2002 : C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rap-port intermédiaire du PCR 2002, 253 p. (multigraphié).
Metzler 1996 : J. Metzler, La chronologie de la fin de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine en pays trévire, dans La Chro-nologie du second âge du Fer en Gaule du Nord (actes de la table-ronde de Ribemont-sur-Ancre, 21-22 octobre 1994), Revue Archéologique de Picardie, 3/4, Amiens, 1996, p. 153-163.
Meunier 2002 : N. Meunier, Analyse fonctionnelle de la céramique de la nécropole de Bucy-le-Long «Le Fond du Petit Marais», La Tène C1-D1, dans P. Méniel, B. Lambot (éd.), Repas des vivants et nourriture pour les morts en Gaule (actes du XXVe colloque de l’AFEAF, Charleville-Mézières, 2001), mémoire de la Société Archéologique Champenoise, 16, Reims, 2002, p. 81-94.
Minni en préparation : D. Minni, L’artisanat des matières dures animales à l’Age du Fer en Europe, Doctorat sous la direction de Anne-Marie Adam, Université Marc Bloch de Strasbourg, en préparation.
Miron 1986 : A. Miron, Das Gräberfeld von Horath, Untersuchungen zur Mittel-und Spätlatènezeit im Saar-Mosel-Raum, dans Trierer Zeitschrift, 49, 1986, p. 7-198, 1986.
Miron 1989 : A. Miron, Zur Chronologischen Gliederung der Stufe Latène D2, dans A. Haffner (ed), Gräber, Spiegel des lebens, Mainz am Rhein, Rheinisches-Landesmuseum Trier, P. von Zabern, 1989, p. 215-225.
Miron 1992 : A. Miron, Grafunde der Mittel-und-Spälatenzeit im Kreis Bernkasetl-Wittlich, dans Trierer Zeitschrift, 55, 1992, p. 129-191
Morel 1981 : J.-P. Morel, Céramiques campaniennes, les formes, BEFAR, 244, Paris, 1981, 2 vol.
Olmer 1997 : F. Olmer, Les amphores Romaines en Bourgogne, Contribution à l’histoire économique de la région dans l’Antiquite depuis La Tène finale jusqu’au haut-Empire , Thèse de doctorat de l’Université de Dijon, Dijon, 1997.
Olmer 2003 : F. Olmer, Les amphores de Bibracte–2, Le commerce du vin chez les Éduens d’après les timbres d’amphores, Bibracte, 7, Glux-en-Glenne, Centre Archéologique Européen du Mont-Beuvray, 2003.
Orengo 2003 : L. Orengo, Forges et forgerons dans les habitats la-téniens de la Grande Limagne d’Auvergne, Fabrication et consommation de produits manufacturés en fer en Gaule à l’âge du Fer, Monographie Instrumentum, 26, 326 p., 60 fig., 15 tabl., 63 pl.
Perrin 1990 : F. Perrin, Un dépôt d’objet gaulois à Larina (Hières-sur-Amby, Isère), DARA, 4, Lyon, 1990, 175 p.
Pion 1996 : P. Pion, Les habitats laténiens tardifs de la vallée de l’Aisne : contribution à la périodisation de la fin du second Age du Fer en Gaule nord-orientale, dans M. Tuffreau-Libre, A. Jacques, La cérami-que précoce en Gaule Belgique et dans les régions voisines, de la poterie gauloise à la céramique gallo-romaine (actes de la table-ronde d’Arras, 1996), Nord-Ouest Archéologie, 9, 1999, p.
Polenz 1982 : H. Polenz, Münzen in Latènezeitlichen Gräbern Mitteleuropas aus der Zeit zwischen 300 und 50 v. Chr. Geburt, dans Bayerische Vorgenschichtsblätter, 47, 1982, p.27-222
Poux 2002 : M. Poux, Y. Deberge, S. Foucras, J. Gasc et D. Pasquier (avec la collaboration de V. Guichard et F. Malacher), L’enclos cultuel de Corent (Puy-de-Dôme), festins et rites collectifs, dans Revue Archéologique du Centre de la France, 41, 2002.
Py 2001 : M. Py, M. Andrès, A. Auroux, C. Uroux et C. Sanchez, Dicocer², corpus des céramiques de l’âge du Fer de Lattes (fouilles 1963-1999), Lattara, 14, Lattes, CNRS, 2001, 2 vol.
Reinecke 1902 : P. Reinecke, Zur Kenntis der La Tène denkmaler der zone Nord wärts der Alpen, dans Festschrift zur Feier des 50 jährigen Bestehens des Römisch-Germanischen Zentral Museums, Mainz, p. 53-109
Rieckhoff 1975 : S. Rieckhoff, Münzen und fibeln aus dem Vicus des Kastells Hüffingen (Schwartzwald-Baar-Kreis), Saalburg Jahrbuch, 32, 1975.
Riquier à paraître : S. Riquier, L’armement césarien dans les tombes de Gaule Centrale, à paraître dans M. Poux (dir) Militaria cé-sariens en contexte gaulois (actes de la table ronde du 17 octobre 2002), Bibracte, 8, à paraître.
Roualet 1993 : P. Roualet, Quelques observations sur les fibules de Duchov trouvées en Champagne, Mélanges offerts à Jean-Jacques Hatt, dans Cahiers Alsaciens d’Archéologie d’Art et d’Histoire, XXXVI, Strasbourg, 1993, p. 55-76.
Saurel 2002 : M. Saurel, Boire et manger, question de pots à Acy-Romance (Ardennes) , dans P. Méniel, B. Lambot (éd.), Repas des vivants et nourriture pour les morts en Gaule (actes du XXVe colloque de l’AFEAF, Charleville-Mézières, 2001), mémoire de la Société Archéolo-gique Champenoise, 16, Reims, 2002, p. 247-264.
Simonnet 1983 : L. Simonnet, Le deuxième âge du Fer en Haute-Loire, dans J. Collis, A. Duval, R. Périchon, Le Deuxième âge du Fer en
Yann DEBERGE et alii204
Auvergne et en Forez et ses relations avec les régions voisines, (4e col-loque de l’AFEAF, Clermont-Ferrand , 1980), Université de Sheffield, Sheffield et Centre d’étude foréziennes, 1983, p. 271-288.
Szabó 1982 : M. Szabo, Rapports entre le Picenum et l’Europe ex-tra-méditérranéenne à l’âge du Fer, dans Savaria, 16, 1982, p. 223-241.
Vaginay 1988 : M. Vaginay et V. Guichard, L’habitat gaulois de Feurs (Loire), Fouilles récentes (1978-1981), Documents d’archéologie française, 14, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1988.
Vermeulen 1999 : C. Vermeulen, C., Chassenard La Génerie, Rap-port de l’opération préventive de fouille, Clermont-Ferrnad, SRA, 1999.
Vermeulen 2002 : C. Vermeulen, F. Blaizot, V. Forest, V. Gui-chard, M. Loughton, C. Mennessier-Jouannet, L. Orengo, Clermont-
Ferrand «Gandaillat» (Puy-de-Dôme), DFS, Clermont-Ferrand, SRA Auvergne, 2002, 2 vols (multigraphié).
Vernet 1997 : G. Vernet, Rapport d’opération préventive de fouille d’évaluation archéologique, zone industrielle du Brézet Est, rapport in-termédiaire 1, Document final de synthèse, SRA, Clermont-Ferrand, 1997.
Verrier 2001 : G. Verrier, G. Videau, Les importations du village gaulois du Petit Chauvort (Verdun sur Le Doubs, Saône et Loire), dans Bulletin de l’AFEAF, 2001.
Wittmann 2002 : A. Wittmann, Cournon, Sarliève, Puits 2249/2487, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobi-liers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2002, p. 210-229.