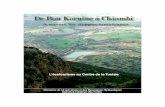Le triomphe à Rome sous la République Un rite monarchique dans une cité aristocratique (IVe –...
-
Upload
univ-reims -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le triomphe à Rome sous la République Un rite monarchique dans une cité aristocratique (IVe –...
Sommaire
Préludepar Cécile Nail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I La guerre et la paix en mots et en actes 37Guerre et Paix dans les vocabulaires grec et latin
par Michel Casevitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Guerre et paix dans le monde grec
par Jean-Nicolas Corvisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55La guerre dans le monde grec antique
par Jean-Nicolas Corvisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Tactique et stratégie de Rome
par Yann Le Bohec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95La guerre à Rome : un acte religieux
par Danielle Porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
II La guerre et la paix en personnes 133La figure du héros guerrier dans l’Antiquité gréco-latine
par Christine Kossaifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135L’Achilléide de Stace ou l’épopée travestie
par Michel Desroches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Le bon général pour Xénophon : une lecture de la Cyropédie
par Hélène Olivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Marcus s’en va-t-en guerre
par Yasmina Benferhat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
iv Sommaire
La valorisation du hérospar Florence Garambois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Les populations civiles et la guerre dans l’Antiquitépar Benoît Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
III La guerre et la paix : enjeux 231La guerre dans la mythologie grecque : quelques éléments de réflexion
par Antoine Contensou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233La guerre comme moyen et la paix comme fin
par Charles Delattre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251La « guerre civile » des abeilles dans les Géorgiques de Virgile
par François Ripoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267La guerre civile : un sujet pour les poètes augustéens ?
par Marie Ledentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280La guerre de Troie d’après quelques auteurs tardifs
par Étienne Wolff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
IV La guerre et la paix en débats 321Aristophane, la paix et l’épopée
par Émeline Miller-Dorangeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323Marc Aurèle, la philosophie, la guerre et le couloir de Moravie
par Yves Roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Judith et Holopherne
par Aline Canellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
V La guerre et la paix en lieux littéraires 375L’Iliade ou le théâtre de la guerre
par Françoise Létoublon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377La guerre dans la tragédie
par Laurence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392Militia Amoris chez les poètes élégiaques romains
par Catherine Salles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Sommaire v
Satire de la guerre et parodie des valeurs héroïquespar Sophie Rochefort-Guillouet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Tragédie de la guerre, tragédie de la paixpar Laurence Gauthier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
VI La guerre et la paix en représentations 467La représentation des guerriers dans l’art grec
par Sophie Montel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469La gladiature, laboratoire et conservatoire des techniques de combat
par Éric Teyssier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488Le triomphe à Rome sous la République
par Jean-Luc Bastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Conclusion 527La guerre et la paix dans l’Antiquité
par Yann Le Bohec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Les auteurs 543
Le triomphe à Rome sous la République
Un rite monarchique dans une cité aristocratique
(IV
e– I
ersiècle av. notre ère)
par Jean-Luc Bastien
Le rite de victoire le plus célèbre de l’Antiquité
Le triomphe romain est le mode de célébration de la victoire le plus fameuxde l’Antiquité puisque la cité qui l’a institué, Rome, est parvenue à conquérirl’Italie, puis les pourtours de la Méditerranée avant d’y installer durablement sadomination. Le rite qu’il met en œuvre est bien connu dans l’ensemble du mondeméditerranéen dès les derniers siècles de la République. On sait par exemple queles rois de Bithynie et de Pergame, deux alliés de Rome, assistèrent à la cérémoniemenée par Paul-Émile en 167 à l’occasion de sa victoire sur le dernier roi deMacédoine, Persée 1. Le triomphe romain a même été parodié par les ennemis deRome. Après la défaite romaine de Carrhes contre les Parthes en 53, le généralSuréna met en scène, à Séleucie du Tigre, une doublure du proconsul romainCrassus, habillée en femme, dans un cortège qu’il nomme par dérision triomphe 2.
La cérémonie du triomphe possédait une force incomparable pour suggérer lesaléas du destin humain. D’une part parce que le triomphateur atteignait la distinc-tion la plus convoitée de Rome et avançait sur un char à travers la ville jusqu’autemple capitolin de Jupiter Optimus Maximus dont il revêtait l’apparence pour lacirconstance ; les Romains étaient, d’autre part, très sensibles à l’exhibition des en-nemis de Rome réduits en esclavage et souvent promis à la mort. Le spectacle desrois vaincus traînés devant le char du triomphateur renforçait encore la dimensionparoxystique des vicissitudes de la fortune humaine.
À partir de l’époque impériale, nombre de sources littéraires utilisent l’imagedu triomphe et sa puissance d’évocation pour signifier tout exploit éclatant maisaussi les déroutes et les soumissions. Ovide file ainsi la métaphore triomphale sur
1. Les dates de cet article sont avant notre ère.
2. Plutarque, Crassus, 32, 1-3.
4 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
un ton badin pour évoquer les tourments de l’amour. Une élégie entière évoque letriomphe d’Éros traînant derrière son char les victimes de ses flèches 3.
Cette utilisation métaphorique de la cérémonie triomphale est reprise au Occi-dent à partir du XIVe siècle par un autre poète de l’amour Pétrarque. Ses trionfi,largement illustrés dans les siècles suivants, figurent les victoires d’abstractionspersonnifiées. Le rite de victoire antique suscite aussi un intérêt grandissant tantchez les peintres que chez les érudits. En 1546 on découvre à Rome les fragmentsd’une longue inscription de l’époque d’Auguste qui se révèle être une liste destriomphateurs depuis Romulus (les fastes triomphaux). Le conseil de ville jugecette inscription si prestigieuse pour Rome qu’il charge Michel-Ange de concevoirla paroi dans laquelle elle sera exposée au Capitole. La réflexion de nombreuxauteurs sur les causes de la grandeur romaine donne au triomphe une large place :
« Romulus et ses successeurs furent presque toujours en guerre avec leurs voisins pouravoir des citoyens, des femmes ou des terres. Ils revenaient dans la ville avec les dépouillesdes peuples vaincus : c’étaient des gerbes de blé et des troupeaux ; cela y causait unegrande joie. Voilà l’origine des triomphes, qui furent dans la suite la principale cause desgrandeurs où cette ville parvint. »
Montesquieu, Considérations sur les causes dela grandeur des Romains et de leur décadence, 1734
Une institution millénaire aux origines complexes
L’importance du rituel tient aussi à sa longévité. Le triomphe serait apparuavec Romulus, l’année même de la fondation de la cité et s’est poursuivit tout aulong de la domination de celle-ci. Après la chute de Rome et de l’Empire d’Occi-dent, la cérémonie sera même célébrée dans la capitale d’Orient, Constantinople,l’Empereur Justinien permettant au général Bélisaire de triompher après sa recon-quête de l’Afrique en 534 de notre ère.
Le triomphe est donc bien un rite millénaire qui a toutefois connu des évolutionsne serait-ce que dans la nature des personnes autorisées à triompher : les familles del’aristocratie sous la République ou la famille impériale par la suite. Pour la période
3. « . . . alors, jeune triomphateur, tu paraîtras guidant avec adresse tes oiseaux attelés. Der-rière toi marcheront de jeunes garçons enchaînés avec autant de jeunes filles. . . », Ovide, Amores,I, 2.
Le triomphe à Rome sous la République 5
royale, la reconstitution du triomphe archaïque a fait l’objet de publications assezconvergentes à partir de la fin des années 1960 4. Si le détail en est très complexe,on peut néanmoins retenir qu’au VIe siècle avant notre ère, les rois étrusquesde Rome ont introduit un rituel annuel. Celui-ci était pratiqué en Étrurie maisses origines seraient orientales : on évoque souvent comme prototypes les fêtesde Nouvel an célébrées en Mésopotamie et notamment l’Akitu des Babyloniens.Ce type de cérémonies avait pour principale fonction la régénération du pouvoirroyal. Le souverain réalisait une entrée solennelle dans la ville, en incarnant legrand dieu de la cité et en pratiquant une hiérogamie (un mariage sacré) avec unegrande déesse dans son sanctuaire.
La cérémonie originelle introduite à Rome par les rois étrusques était doncannuelle et se serait dissociée en plusieurs rites : celui des jeux qui continuèrent àêtre célébrés tous les ans et la cérémonie du triomphe qui ne fut plus célébrée queponctuellement lors d’une victoire effective. Quoi qu’il en soit de la nature exactede la cérémonie étrusque originelle et de son processus d’évolution, on retiendraque ces explications permettent de comprendre certains aspects fondamentauxdu triomphe. Par exemple, si le triomphateur d’époque républicaine arbore lemême costume que la statue du temple de Jupiter Capitolin c’est qu’il s’agit d’unhéritage royal : le souverain jouait le rôle du Grand dieu de la cité. La cérémonie afondamentalement une dimension dynamique, bénéfique. Le triomphateur pénètredans la cité pour y ramener les protections divines dont il a bénéficié lors de savictoire. Il est un protégé de la déesse Fortuna, et sa fortune personnelle accroîtla puissance de la cité en devenant la Fortune publique 5.
Le triomphe dans la république aristocratique
(mi IV
esiècle – mi I
ersiècle avant notre ère)
Les trois derniers siècles de la république sont une période particulièrementimportante et cohérente dans l’histoire du triomphe. C’est l’époque de la conquêteromaine et les victoires sont extrêmement nombreuses : on peut évaluer le nombre
4. Voir la synthèse historiographique dans mon ouvrage sur le triomphe cité en bibliographie.La plupart des idées exposées succinctement ici y sont développées.
5. La déesse Fortuna joue un rôle important dans la cérémonie, elle dispose d’un sanctuairearchaïque à la porte triomphale, où se serait déroulée la hiérogamie à l’époque royale.
6 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
de triomphes autour de 200 soit environ 2/3 des cérémonies célébrées à Romedurant toute son histoire. Le triomphe est alors le monopole des membres d’unearistocratie : la Nobilitas, qui se constitue progressivement par l’ouverture de l’an-cienne aristocratie patricienne à des familles plébéiennes. Ces nobles se réserventl’accès au consulat, et donc aux commandements et aux triomphes. Les hommesdits « nouveaux » qui accèdent au consulat sans avoir d’ancêtres consuls sont ex-trêmement rares, c’est le cas du célèbre Caius Marius qui triomphe des Numideset du roi Jugurtha en 104, puis des Cimbres et des Teutons en 101 6.
Ces trois siècles présentent aussi une cohérence sur le plan culturel puisqu’ils’agit de la période « hellénistique », qui s’ouvre avec la conquête et la mortd’Alexandre le Grand en 323 et s’achève avec celle de Cléopâtre VII d’Égypte en 31.L’aristocratie romaine est alors fortement influencée par la culture grecque et le ri-tuel du triomphe comme ses commémorations empruntent au souvenir d’Alexandreet des rois hellénistiques qui lui succèdent. Les manifestations en sont nombreuseset variées. On pourra signaler que Cn. Pompée pratique l’imitatio alexandri : il secompare explicitement à Alexandre. À l’image de son modèle héroïque, il adopte lesurnom de Magnus (le Grand) au temps de son premier triomphe de 81 et vingt ansplus tard alors qu’il célèbre un troisième triomphe, il choisit d’arborer un manteauqui passait pour avoir appartenu au Macédonien.
Reconstituer le déroulement de la cérémonie
Les lexiques, dictionnaires ou encyclopédies sur l’Antiquité comportent en gé-néral des entrées sur le triomphe qui s’efforcent de décrire une cérémonie type.L’exercice n’est pas sans intérêt mais présente aussi des difficultés. Cela tientaussi bien à la nature de la cérémonie qu’à nos sources. En effet, pour cette pé-riode républicaine, les fastes triomphaux, déjà évoqués, et les sources littérairespermettent de restituer la liste à peu près complète des 200 cérémonies célébrées,mais ce « squelette » manque un peu de chair et nous sommes tributaires pour uneconnaissance plus approfondie du déroulement du triomphe de quelques auteursd’époque impériale comme Tite-Live, Appien ou Plutarque. Ainsi nous n’avons
6. Sur le fonctionnement de cette république aristocratique, on pourra se reporter à ElizabethDeniaux, Rome de la Cité-État à l’Empire, Hachette, 2001 et Christophe Badel, La Républiqueromaine, PUF, 2013 .
Le triomphe à Rome sous la République 7
de descriptions détaillées que pour les triomphes de Scipion l’Africain en 201, dePaul-Émile en 167, de Pompée en 61 et de César en 46 7.
Pour le reste la documentation est très disparate et parfois confuse ou contra-dictoire. Ainsi dans un récent ouvrage qui déconstruit nos connaissances supposéesacquises sur la cérémonie, M. Beard compile l’ensemble des détails fournis par lessources antiques sur la tenue et les ornements du triomphateur. Elle remarque uneaccumulation de données : toge, tunique, couronnes et amulettes variées, anneau,palme, sceptre et autres accessoires. . . et signale « des contradictions flagrantes oupour le moins un général qu’on peut suspecter d’être un peu trop habillé » 8. Deplus le cortège du triomphe a connu tout au long de son histoire des innovations.En effet si la plupart des généraux ont suivi la tradition, certains d’entre eux etnotamment les plus prestigieux ont souvent eu à coeur de singulariser leur céré-monie. Nous avons déjà évoqué Pompée arborant la chlamyde d’Alexandre en 61.À partir de 201, on a pu voir dans certains cortèges apparaître des citoyens libérésde l’esclavage par la victoire du général ; en 200 un général obtient de triomphersans troupes, ni butin, alors que d’autres triomphateurs obtiennent des jours addi-tionnels avant leur entrée effective dans la ville pour faire étalage de leur abondantbutin, etc.
C’est pourquoi je propose ici une description a minima qui pourra être com-plétée et nuancée par les remarques contenues dans cet article. Le général est surun char, couronnée de laurier, avec une tenue (tunica palmata et toga picta) quil’assimile à Jupiter capitolin, du moins à sa statue de culte ; il est précédé du bu-tin et des ennemis captifs, des animaux du sacrifice, et suivit par son armée, ouune partie de celle-ci. La procession entre dans la ville en franchissant sa limitesacrée : le pomerium qui coïncide avec la porte triomphale. Après un parcours àtravers des espaces publics, comme le forum, et des édifices de spectacles, commele circus Maximus, qui permettent aux spectateurs de contempler le cortège, letriomphateur monte au sanctuaire de Jupiter sur le Capitole pour y sacrifier. Lacérémonie se déroule le plus souvent au cours d’une seule journée et suit un itiné-raire, apparemment immuable depuis le sud du champ de Mars où se constitue lecortège jusqu’au Capitole, en réalisant un contournement du Palatin.
7. Pour Scipion, Appien, Pun., 66 ; pour Paul-Émile, Tite-Live, 45, 40 et Plutarque, Aem.30-36 ; pour Pompée, Appien, Mithr., 116-7 ; pour César, Appien, B.C., 2, 101).
8. Mary Beard, The Roman Triumph, 2007, p. 229sq. « a suspiciously overdressed general ».
8 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
L’obtention du triomphe : le rôle du sénat et du peuple
La réflexion sur les critères permettant à un général d’obtenir le triomphe àRome est ancienne. Valère-Maxime, un proche de l’empereur Tibère, y a mêmeconsacré un passage intitulé « du droit au triomphe » dans un de ses ouvrages 9.On y apprend entre autres qu’il faut un minimum de 5000 morts ennemis, quela victoire doit avoir agrandi l’Empire, qu’on ne peut triompher lors des guerresciviles, etc. Il s’agit moins d’un exposé juridique cohérent que d’une compilationde mesures et d’exemples à visée édifiante. Pour le cas où certaines exigencesn’auraient pas été respectées, plusieurs auteurs antiques attestent d’ailleurs l’octroid’une cérémonie secondaire, la célèbre ovation (ovatio). Le général devait entrer àpied dans Rome sans la tenue habituelle du triomphateur pour une victoire jugéemoins éclatante 10.
Pour pouvoir prétendre au triomphe dans la Rome républicaine la principalecondition requise du général victorieux est d’avoir exercé une magistrature supé-rieure. Le pouvoir des deux consuls, les magistrats ayant hérité des prérogativesroyales est considérable. Leur imperium, un pouvoir civil et militaire permet d’agiraussi bien à Rome avec le sénat ou le peuple, que sur le champ de bataille avecl’armée. Cet imperium est indissociable de l’auspicium, la capacité à consulter lesdieux et à obtenir leur accord pour toutes les actions à venir. Le premier jour del’année le nouveau magistrat élu qui a reçu une investiture civile monte au Capi-tole afin de réaliser une prise d’auspices fondamentale : sanctionnant son entrée encharge, elle constitue une investiture sacrée valable pour la durée de son mandat.Le magistrat romain n’est donc pas un simple dépositaire d’un pouvoir déléguépar le peuple lors d’une élection puis sanctionné par le vote d’une loi, il est aussiet surtout le détenteur d’une légitimité sacrale, c’est elle qui rend le triomphe pos-sible et tout prétendant au triomphe précise que la victoire a été réalisée sous sonimperium et ses auspices.
L’aristocratie romaine s’est efforcée de tempérer ce pouvoir démesuré en im-posant une série de garde-fous : comme la collégialité et la durée limitée des ma-gistratures et en s’efforçant de développer le contrôle du sénat : cette assemblée
9. Valère-Maxime, Faits et dits mémorables, II, 8.
10. Aulu-Gelle, Nuits Attiques, 5, 6, 21 et Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, 5, 47,3-5.
Le triomphe à Rome sous la République 9
de la République composée d’anciens magistrats incarne le contrôle aristocratiquesur la cité. Le magistrat qui aspire au triomphe sous la république doit assemblerle sénat pour présenter un compte rendu des ses actions et demander à obtenir unvote de l’assemblée en faveur de son triomphe. Dans la tradition quelques triom-phateurs seraient passés outre l’opposition du sénat pour célébrer malgré tout unecérémonie en bravant l’interdit et parfois l’opposition physique d’un tribun de laplèbe (en 294, en 223 et en 143).
Il devient néanmoins admis qu’après un refus du sénat, tout général qui lesouhaitait pouvait célébrer une cérémonie triomphale alternative : le triomphe surle mont Albain (triumphus in monte Albano). Il s’agissait d’une procession menantau sanctuaire de Jupiter Latin à une trentaine de km au sud de Rome où les consulsavaient sacrifié avant de partir en campagne. Ce triomphe ne fut pourtant célébréqu’une demi-douzaine de fois entre 231 et 172. Il n’était pas une entrée dansla ville et de toute évidence n’avait ni la signification ni le prestige du véritabletriomphe. Durant cette période de quelques décennies il y a d’ailleurs de profondesmodifications dans différents aspects du triomphe, ce qui va inciter le sénat àmettre en place un contrôle plus sévère dans l’octroi de la cérémonie. À partir dela 2e Guerre punique, par exemple, le statut de certains généraux pose problèmecar ils ont obtenu un imperium par une loi et n’ont jamais été magistrat. Ils n’ontdonc pas d’auspices valables, ce qui est la condition du triomphe. C’est pour cetteraison que le jeune Scipion n’est pas autorisé à triompher à son retour victorieuxd’Espagne en 206, cependant dans les années suivantes plusieurs généraux dans lamême situation obtiennent une ovation. Peu après ces décisions contradictoires lesénat met en place un certain nombre de règles afin d’éviter que les triomphes nese multiplient et que ses propres décisions ne soient incohérentes.
Un dernier point mérite d’être souligné c’est l’intervention du peuple. Lors dela demande du triomphe de Paul-Émile sur la Macédoine en 167, plusieurs auteursattestent un événement exceptionnel : ses soldats mécontents de n’avoir pas reçuune part suffisante de butin s’opposent à ce que leur général puisse triompherlors d’une assemblée du peuple qui doit procéder à un vote. En réalité celui-cine concerne pas l’octroi du triomphe, déjà validé par le sénat, mais celui d’unimperium spécial permettant au général de triompher. En effet, au fur et à mesurede l’extension du monde romain, l’habitude s’est prise de prolonger les pouvoirsdes magistrats au delà de leur année d’exercice. Ces magistrats prorogés qui ont
10 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
exercé une magistrature peuvent triompher en toute légalité, mais leur imperium
contrairement à ceux des magistrats en charge s’éteindrait au moment de leurentrée dans Rome. La loi votée par le peuple octroie donc au promagistrat unimperium spécifique valable aussi à l’intérieur de la cité pour le jour du triomphe.La plupart des triomphateurs se trouvent dans cette situation aux deux dernierssiècles de la République mais le vote du peuple est moins une décision qu’uneformalité juridique.
La mise en scène de la victoire
Le délai entre la victoire et la célébration du triomphe a été très fluctuantede quelques semaines à de nombreuses années. Ainsi Vercingétorix le chef gauloisvaincu à Alésia passe six ans en captivité avant d’être mené dans le triomphe deCésar sur la Gaule et exécuté en 46. Au fur et à mesure de l’expansion de la do-mination romaine, cette durée a tendance à s’allonger : les gouverneurs d’Espagnequi reviennent par dizaines triompher à Rome à partir du début du IIe siècle ontsouvent passé plusieurs années dans la péninsule. Une fois le triomphe voté letriomphateur dispose d’une certaine latitude pour fixer la date de sa cérémonie,ce qui lui permet de mieux gérer le temps de sa préparation.
En effet, le cortège n’est pas un retour spontané de l’armée dans l’ordre demarche avec le butin entassé sur des chariots de transport, c’est avant tout unemise en scène qui doit faire revivre les différents épisodes de la campagne, soulignerson importance et montrer au peuple romain la réalité de la victoire surtout encas de contestation ou de rivalité. La présence physique des rois ou des générauxvaincus parmi les captifs est par conséquent très importante. C’est le cas en 62quand Q. Caecilius Metellus Créticus s’apprête à triompher en exhibant deux chefspirates capturés durant la grande expédition de pacification de la Méditerranée parPompée. Ce dernier parvient à les récupérer afin que ce rival ne puisse s’approprierune part de sa victoire sur les pirates qu’il célèbre l’année suivante 11.
L’exemple de Lucius Caecilius Metellus, consul en 251, démontre que le souci deconstituer un cortège extraordinaire est présent dès le champ de bataille. Ce généralparvient pour la première fois à vaincre la peur qu’inspiraient aux Romains leséléphants des Carthaginois en Sicile. Il en capture plus d’une centaine et doit leur
11. Velleius Paterculus, 2, 40, 5.
Le triomphe à Rome sous la République 11
trouver des cornacs parmi les captifs, puis assurer la périlleuse traversée du détroitde Messine pour les conduire à Rome où ils sont exhibés lors d’un mémorabletriomphe.
La mise en scène des cortèges a donc été extrêmement élaborée 12, on se conten-tera de mentionner deux évolutions notables. Le contact avec le monde grec etl’Orient hellénistique conduit à la présentation d’objets singuliers dans plusieurscortèges triomphaux. Ainsi à partir du pillage des villes de Syracuse puis de Ta-rente (triomphes en 211 et 209), les œuvres d’art grecques comme la statuaireet les tableaux sont introduites à Rome lors des processions triomphales. Deuxdécennies plus tard, ce sont des objets de luxe, comme la vaisselle d’or, l’argentciselé, les lits de tables en bronze qui font leur apparition après les victoires enAsie contre le roi séleucide Antiochos III. De nombreux généraux font alors réaliserdes décors pour leur triomphe et notamment des tableaux dont la réalisation estconfiée à des artistes grecs. Ainsi en 167 Paul-Émile demande à la cité d’Athènesde lui envoyer son meilleur peintre pour embellir son triomphe 13. Parallèlement lamise en scène du cortège vise à une dramatisation, à éveiller les passions, recourtau pathos : il s’agit de faire ressentir aux spectateurs des sentiments puissants etmêlés comme la peur et la pitié. Dans le cortège du triomphe de Paul-Émile lesarmes macédoniennes sont disposées soigneusement sur des charriots, de manièreà ce que leur entrechoquement produisent un son effrayant : on ne doit pouvoir lesentendre passer sans frayeur. Le lendemain, la mise en scène du sort tragique desenfants royaux, trop jeunes pour être conscients de leur malheur, fait verser deslarmes aux spectateurs 14.
Un des aspects politiques de la cérémonie :
l’hérédité triomphale
La cérémonie du triomphe n’est pas un simple épiphénomène de la victoire, ellea une forte valeur politique au sein de l’aristocratie romaine dans sa compétitionpour l’accès aux magistratures supérieures. En effet, à raison de deux consuls par
12. Sur cette question, voir Ida Östenberg Staging the World : Spoils, Captives, and Represen-tations in the Roman Triumphal Procession, 2007. Elle y analyse la représentation du monde etde la conquête à travers l’étude des cortèges.
13. Pline, H. N., 35, 135.
14. Plutarque, Aem., 31-32.
12 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
an, il n’y a que quelques dizaines de postes par génération pour un nombre deprétendants bien plus considérable. Le principal élément de différenciation danscette quête du pouvoir était la commendatio maiorum : la recommandation par lesancêtres. Leurs exploits étaient régulièrement rappelés à l’occasion des funéraillesfamiliales qui avaient lieu sur le forum. Des acteurs portant les masques et lestenues des ancêtres du mort venaient s’installer à proximité du corps du défunt,tandis que l’héritier, en principe un fils, prononçait l’éloge funèbre rappelant leursexploits et notamment leurs magistratures et leurs triomphes 15. Pour cette raisonnombre de familles de l’aristocratie avaient tenté d’augmenter leur capital symbo-lique en falsifiant les traditions familiales pour grossir le nombre de consulats ets’approprier des victoires et des triomphes indus 16.
Le triomphe d’un ancêtre ou d’un proche constituait une distinction particuliè-rement importante pour pouvoir accéder au consulat. Cicéron l’exprime clairementà l’occasion du procès pour brigue intenté à L. Muréna, après son élection au consu-lat en 63. Il précise que le triomphe du père, en 81, en tant que préteur, auraitdû lui garantir l’accès au consulat et que l’élection de son fils était « comme unedette » dont il réclamait le paiement 17. Ce témoignage ne relève pas de la simpleargumentation rhétorique dans un procès, Tite-Live signale un cas comparable àpropos des élections consulaires de 193. P. Cornelius Scipion Nasica, soutenu parson cousin germain Scipion l’Africain, était candidat contre L. Quinctius Flami-ninus, le frère du général qui venait de triompher l’année précédente. Le peupletrancha la rivalité entre les triomphateurs qui recommandaient chacun leurs can-didats en faveur du second, notamment car « il n’avait rien demandé au peupledepuis son triomphe, rien obtenu de lui » 18.
Si tout consulat ne menait pas forcément à une victoire militaire et à untriomphe, il était acquis que chaque triomphe devait assurer l’accès au consulatdes frères ou des cousins et surtout des descendants. Plusieurs sources attestentla présence des enfants du triomphateur lors de la cérémonie. Les plus jeunes sontplacés dans le char tandis que ceux qui ont atteint l’âge adulte se tiennent sur leschevaux du quadrige ou le suivent à cheval. Cela les désigne comme ses héritiers
15. Cf. la célèbre description de Polybe, 6, 52-54.
16. C’est ce que remarquent Cicéron, Brutus 62 et Tite-Live, 8, 40, 4.
17. Cicéron, Pro Mur. 15.
18. Tite-Live, 35, 10, 7.
Le triomphe à Rome sous la République 13
et crée une véritable prédestination pour accéder aux magistratures et triompherà leur tour : il existe une transmission héréditaire des aptitudes triomphales.
Monumenta : inscrire la cérémonie dans le temps et
l’espace de la cité
Cette dimension politique du triomphe rendait sa commémoration essentielle.Il existait une grande variété de supports de mémoire, de monumenta, destinésà conserver le souvenir des cérémonies et à les évoquer pour actualiser le capitalsymbolique des familles à l’heure des élections consulaires.
Le cas des archives privées a déjà été mentionné à propos des funérailles aristo-cratiques. Il existait des éloges qui furent d’ailleurs publiés à partir de la fin du IIIe
siècle et des inscriptions figurant sous les masques des ancêtres qui étaient conser-vées dans les demeures aristocratiques ; elles servirent notamment aux historiensde Rome ce qui contribua à entériner des versions falsifiées. Les triomphateurs,ou plus souvent leurs descendants, ont également pu frapper des monnaies. Ainsiplusieurs arrière-petits fils de L. Caecilius Metellus ont émis après 130 des deniersreprésentant un éléphant pour rappeler le fameux triomphe de 250. La plupartfurent élus au consulat dans les années suivantes et triomphèrent à leur tour.
Les généraux victorieux laissaient aussi des traces matérielles de leurs exploitsdans les espaces publics : des statues équestres ou des dépouilles ennemies commedes boucliers inscrits. Le phénomène le plus important et le plus élaboré a été laconstruction d’édifices et notamment de temples permettant d’inscrire le souvenirdu triomphe dans l’espace mais aussi dans le calendrier de la cité. À partir de la findu IVe siècle, les temples votifs se multiplient à Rome. Il s’agit de la constructionet de la dédicace d’un temple à une divinité à qui le général à fait un voeu sur lechamp de bataille dans le cas où il serait victorieux. Pour les trois derniers sièclesde la république, une cinquantaine de temples ont été construits de cette façon.C’est un phénomène massif et intimement lié à la capacité de triompher, celui àqui on refuse le triomphe se voit aussi dépossédé du processus votif. Une partieimportante des édifices se trouvait localisée sur le parcours triomphal 19.
19. On pourra trouver une cartographie dans Christophe Badel, Atlas de l’Empire romain.Construction et apogée : 300 av. J.-C. – 200 apr. J.-C., éditions Autrement, 2012, p. 34-35.
14 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
Des sources variées permettent d’affirmer que ces temples pouvaient abriter desdépouilles prises à l’ennemi : armes, oeuvres d’art, etc., ainsi que des fresques, ta-bleaux et bas-reliefs représentant les combats victorieux du général et son cortègetriomphal. Ces édifices avaient un caractère familial puisque les descendants dufondateur en assumaient apparemment l’entretien et pouvaient enrichir sa décora-tion. Il s’agissait donc de sanctuaires commémorant les exploits familiaux. Le jourqui avait été choisi par le triomphateur pour réaliser la dédicace du temple étaitle jour anniversaire (dies natalis) où la divinité était célébrée. À cette occasion lesportes du temple étaient ouvertes et la décoration interne rappelant les exploitset le triomphe devenait visible aux yeux des Romains. L’inscription de ces fêtesdans les calendriers permettait ainsi de rappeler chaque année un certain nombrede victoires et de triomphes exceptionnels réalisés par les grandes familles tout encélébrant les divinités protectrices de Rome.
Vers le monopole impérial sur le triomphe
Le triomphe portait en germe l’expression d’une idéologie royale. Certainesvictoires extraordinaires permettaient d’exalter un personnage providentiel auxqualités exceptionnelles. C. Claudius Marcellus en 222 ressuscite un ancien ritueltriomphal que la tradition attribuait à Romulus, la dédicace des dépouilles dites« opimes » : celles du roi ennemi vaincu en combat singulier (spolia opima). Peud’années après Scipion l’Africain puis Flamininus obtiennent des hommages sin-guliers dans leurs cérémonies. Des citoyens libérés de l’esclavage par la victoire lessaluent comme leur patron, leur père et les considèrent comme leurs sauveurs surle modèle de ce qui se passait dans les monarchies hellénistiques. Or la Républiqueromaine reposait sur la gestion collective par l’aristocratie des affaires publiqueset ses membres ne pouvaient supporter l’émergence de telles figures. Il en coûtacher à Scipion qui finit ses jours en exil loin de Rome alors qu’il l’avait délivréed’Annibal.
Le déclenchement des guerres civiles dans le dernier siècle de la Républiqueintensifie les rivalités personnelles pour l’octroi des grands commandements, pour-voyeurs de gloire et de triomphes. La direction de la guerre contre Mithridate VIdu Pont, le principal ennemi de Rome pendant près d’un quart de siècle provoque
Le triomphe à Rome sous la République 15
des tensions considérables entre les grands imperatores
20, d’abord entre Marius etSylla puis entre Lucullus et Pompée.
La victoire de César dans la guerre civile lui permet de célébrer quatre triom-phes en 46 ce qui n’est déjà plus une pratique républicaine. Cette étape amorcéeil se produit très vite une déconstruction du triomphe par les détenteurs successifsdu pouvoir. L’année de sa mort César célèbre une curieuse cérémonie à chevalqu’il qualifie d’« ovation au retour du mont Albain », en 40 Antoine et Octavecélèbrent une « ovation » à cheval « pour avoir fait la paix l’un avec l’autre ».Victorieux d’Antoine, Octave va progressivement mener à terme cette liquidationdu triomphe républicain. Le sujet est complexe nous en signalerons les principauxaxes 21.
En 29 après sa victoire définitive dans les guerres civiles, Octave célèbre commel’avait fait son divin père César plusieurs triomphes à la suite. Mais une fois investipar le sénat en 27 du surnom d’Auguste et d’un imperium supérieur qui le rendpratiquement seul autorisé à triompher, il refusera toutes les cérémonies que ne seprive pas de lui voter le sénat. Néanmoins et c’est le premier paradoxe, il ne cesserad’utiliser l’image et les symboles du triomphe dans les nombreux monuments qu’ilérige ou sur son abondant monnayage.
La liste des triomphateurs du passé va être affichée et simultanément close,ce sont les fameux fastes triomphaux qui relatent les triomphes depuis celui deRomulus jusqu’au plus obscur L. Cornelius Balbus, dernier général extérieur à lafamille impériale autorisé à triompher en 19 22. Cette inscription est placée sur undes arcs de triomphe qu’Auguste a fait ériger sur le forum en 19, où il figure dansun quadrige triomphal. Auguste va aussi abolir la mémoire des grandes famillesconstituée notamment par les temples votifs puisque lui même ou ses héritiers res-taurent et redédicacent la quasi totalité des temples de Rome. Les noms d’Auguste
20. Le terme imperator est octroyé par une acclamation que les troupes adressent à leur généralvictorieux sur le champ de bataille, le premier général connu à en avoir bénéficié est Scipion enEspagne.
21. Voir à ce sujet l’article de Tanja Itgenshorst, « Rite de victoire ou “adoucissement” d’unerupture pénible ? Quelques réflexions sur la transgression du triomphe dès l’époque d’Auguste »,dans Rituels et transgressions de l’Antiquité à nos jours : Actes du colloque (Amiens, 23-25janvier 2008), coll. Hier, Encrage, 2009, p. 269-276.
22. Par la suite des commandants victorieux recevront des ornements triomphaux à défaut depouvoir célébrer la cérémonie.
16 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
et de ses proches figurent désormais dans les inscriptions dédicatoires des templeset les nouvelles dates anniversaires sont modifiées pour coïncider avec un calen-drier lié à la famille impériale. Ainsi, le temple d’Apollon où avait eu lieu un grandnombre de demandes de triomphes sous la République est restauré et dédicacé lejour même de l’anniversaire d’Auguste. Dans la Rome augustéenne, si l’image duprince en triomphateur devient omniprésente, elle ne renvoie plus comme sous laRépublique à une cérémonie particulière mais à une qualité inhérente.
?
Deux extraits de Tite-live sur
le phénomène triomphal à Rome
En 203, Scipion donne à Masinissa le titre royal et lui offre
les ornements du triomphe
Postero die ut a praesenti motu auerteret
animum eius, in tribunal escendit et contio-
nem aduocari iussit ibi Masinissam, primum
regem appellatum eximiisque ornatum lau-
dibus, aurea corona aurea patera sella curuli
et scipione eburneo toga picta et palmata
tunica donat. addit uerbis honorem : neque
magnificentius quicquam triumpho apud Ro-
manos neque triumphantibus ampliorem eo
ornatum esse quo unum omnium externo-
rum dignum Masinissam populus Romanus
ducat.
« Le lendemain, pour distraire l’âme duprince des émotions qui la préoccupaient,il monta sur son tribunal et fit convoquerl’assemblée. Là il donna pour la premièrefois à Masinissa le nom de roi, le comblad’éloges, et lui fit présent d’une couronne etd’une coupe d’or, d’une chaise curule, d’unbâton d’ivoire, d’une toge brodée et d’une tu-nique à palmes. Pour rehausser l’éclat de cesdons, il ajouta : “que les Romains n’avaientpoint d’honneur plus grand que le triomphe,ni les triomphateurs d’ornements plus beauxque ceux dont Masinissa seul parmi tous lesétrangers avait été jugé digne par le peupleromain”. »
Tite-Live, 30, 15, 11-12
Le triomphe à Rome sous la République 17
Une dédicace à Jupiter qui commémore un triomphe en 174
Eodem anno tabula in aede matris Matu-
tae cum indice hoc posita est : “Ti- Sem-
proni Gracchi consulis imperio auspicioque
legio exercitusque populi Romani Sardiniam
subegit. In ea prouincia hostium caesa aut
capta supra octoginta milia. Re publica feli-
cissume gesta atque liberatis <sociis>, uec-
tigalibus restitutis, exercitum saluom atque
incolumem plenissimum praeda domum re-
portauit ; iterum triumphans in urbem Ro-
mam redit. Cuius rei ergo hanc tabulam
donum Ioui dedit.” Sardiniae insulae forma
erat, atque in ea simulacra pugnarum picta.
« La même année, on posa dans le temple deMater Matuta une plaque avec cette inscrip-tion : “Sous le commandement (imperium) etles auspices du consul Ti. Sempronius Grac-chus, la légion et l’armée du peuple romainont soumis la Sardaigne. Dans cette provinceont été tués ou pris plus de quatre-vingt milleennemis. Sa mission ayant rencontré le plusgrand succès et les <alliés> ayant été libé-rés, les tributs rétablis, il a ramené dans sapatrie l’armée saine et sauve et les bras char-gés de butin. Il rentra à Rome en célébrantun second triomphe. Aussi, en commémora-tion de cet événement, a-t-il fait don de cetableau à Jupiter.” Il avait la forme de l’île deSardaigne et on y avait peint des batailles. »
Tite-Live 41, 28, 8-10
Affirmation d’une hérédité triomphale
Figure 1 – Denier de C. Fundanius
Cette monnaie datée de 101 représenterait le triomphe célébré cette mêmeannée par C. Marius sur les Cimbres et les Teutons. L’avers présente la tête casquéede la déesse Roma, tandis que le revers figure un triomphateur sur son quadrige,accompagné par un jeune fils monté sur un des chevaux de l’attelage.
18 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
Liste de triomphes significatifs (fin IV
e– fin I
ersiècle)
Année Nom de triomphateur Élément mémorable
306 Q. Marcius Tremulus Le sénat lui accorde une statue équestre,honneur pratiqué dans le monde grec.
275 M’. Curius Dentatus Triomphe sur Pyrrhus d’Épire, un princehellénistique venu aider Tarente. Le butinest exceptionnel.
260 C. Duilius Premier triomphe naval, il érige des co-lonnes rostrales.
250 L. Caecilius Metellus Une centaine d’éléphants présents dans lecortège.
231 C. Papirius Maso Premier triomphe sur le mont Albain.222 M. Claudius Marcellus Dédicace les dépouilles dites « opimes » à
Jupiter Férétrien sur le modèle de Romuluspour avoir tué de sa main le roi ennemi enduel.
211 M. Claudius Marcellus Des œuvres d’art de Syracuse sont présen-tées dans la procession. Il n’obtient qu’uneovation.
201 P. Cornelius Scipio Afri-canus (= Scipion)
Ce triomphe célèbre la victoire sur Annibalet la fin de la 2e Guerre punique. Scipionest un sauveur.
194 T. Quinctius Flamini-nus
Plus de 2000 Romains libérés de l’esclavagepar la victoire sur la Macédoine suivent sonchar à la façon d’affranchis célébrant leurpatron.
167 L. Aemilius Paullus(= Paul-Émile)
Triomphe exceptionnel sur le roi Persée deMacédoine.
143 Ap. Claudius Pulcher Triomphe en dépit du refus du sénat et del’opposition d’un tribun de la plèbe.
Le triomphe à Rome sous la République 19
Année Nom de triomphateur Élément mémorable
111 M. Caecilius Metellus etC. Caecilius Metellus
Ces deux frères triomphent ensemble le 15juillet qui est aussi à Rome le jour anni-versaire du temple de divinités fraternellesCastor et Pollux.
104 C. Marius Il tente d’assembler le sénat en costumetriomphal.
101 C. Marius Triomphe sur les Cimbres et les Teutons.Le sénat favorise le triomphe d’un autregénéral Q. Lutatius Catulus pour diminuerson prestige.
81 L. Cornelius Sylla(= Sylla)
Une fois maître de Rome, dans la guerrecivile, le dictateur triomphe sur le roi duPont Mithridate.
vers 81 Cn. Pompeius Magnus(= Pompée)
Il combat les Marianistes réfugiés enAfrique. Il triomphe sans avoir été magis-trat.
61 Cn. Pompeius Magnus(= Pompée)
Triomphe extraordinaire sur une grandepartie de l’Orient. Il fait bâtir un gigan-tesque complexe au champ de Mars qui cé-lèbre ses victoires.
46 C. Iulius Caesar(= César)
Au terme des guerres civiles, le dicta-teur réalise quatre triomphes sur la Gaule,l’Égypte, le Pont et l’Afrique.
40 Imp. Caesar Divi filiuset M. Antonius(= Octave et Antoine)
Ils entrent à cheval dans Rome pour avoirfait la paix ensemble. Cette cérémonie estappelée ovation.
29 Imp. Caesar Divi filius(= Octave)
Le fils adoptif de César célèbre troistriomphes au terme des guerres civiles.
19 L. Cornelius Balbus Dernier personnage inscrit sur la listedes triomphateurs (fastes triomphaux), quiétait placée sur un arc érigé par Auguste auforum.
20 Sixième partie – La guerre et la paix en représentations
Bibliographie succincte
– Bastien J.-L., Le triomphe romain et son utilisation politique à Rome auxtrois derniers siècles de la République, C.E.F.R. No 392, Rome, De Boccard,2007.
– Bastien J.-L., « Les temples votifs de la Rome républicaine : monumenta-lisation et célébration des cérémonies triomphales », dans Roma Illustrata.Représentations de la ville. Actes du colloque de Caen (6-8 octobre 2005),PU de Caen, 2008, p. 29-47.
– Bastien J.-L., « Les triomphes associés et le problème de la figuration desdieux à Rome à la fin de la République », dans Rituels et transgressions del’Antiquité à nos jours : Actes du colloque (Amiens, 23-25 janvier 2008),coll. Hier, Encrage, 2009, p. 259-268.
– Beard M., The Roman Triumph, Cambridge/Londres, Harvard UniversityPress, 2007.
– Coarelli F., Il Foro Boario, Rome, Quasar, 1988.
– Gagé J., « Les clientèles triomphales de la République romaine », dansRevue Historique, No 218, 1957, p. 1-31.
– Itgenshorst T., Tota Illa Pompa : Der Triumph in der römischen Repu-blik, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2005.
– Östenberg I., Staging the World : spoils, captives, and representations inthe roman triumphal procession, Oxford/New-York, Oxford University Press,2009.
– Versnel H. S, Triumphus, an inquiry into the origin, development andmeaning of the roman Triumph, Leyde, Brill, 1970.
– Voisin J.-L., « Le triomphe africain de 46 et l’idéologie césarienne », dansAntiquités Africaines, No 19, 1983, p. 7-33.