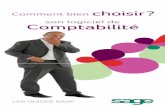La cogeneration dans le tertiaire Pourquoi ? Comment ?
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La cogeneration dans le tertiaire Pourquoi ? Comment ?
FR9900167
S e m i n a i r eCOGENERATIO N ET COLLECT1VITES TERRITORIALES
Mardi 13 fevrier 1996 APRES-ME)!
La cogeneration dans le tertiaire Pourquoi ? Comment ?
Isabelle MIGLIORE Ingenieur Reseaux de chaleur, Froid et Cogeneration
Ademe
Association Technique Energie Emironmment -47 Avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex
Intervention du 13 Fevrier 1996 Isabelle MIGLIORE
La Cogeneration: Pourquoi ? Comment ?
INTRODUCTION
LE DEVELOPPEMENT DE LA COGENERATION
Situation en Europe et dans divers pays.Situation et perspectives en France.
INTERET ET CONTRAINTES
Impact sur la maitrise de l’energie.Impact sur Fenvironnement.La satisfaction des besoins energetiques specifiques.Contraintes et risques lies a :
- F evolution fiscale et reglementaire- au cout des energies- aux tarifs de rachat de Felectricite
LES TECHNIQUES
Principes, avantages, inconvenients,applications privilegiees des trois grandes families de systeme de cogeneration.
LES APPLICATIONS
Quand ? Pourquoi ? Comment ?
Ademc - 1. MIGLIORE - 96Z24S62.docP. 1
La Cogeneration : Pourquoi ? Comment ?
La cogeneration on production combinee chaleur-force recouvre 1’ensemble des filieres techniques permettant de produire simultanement de 1’energie thermique et de l’energie mecanique, cette demiere etant generalement convertie en energie electrique par couplage a un altemateur.
Elle est relativement bien developpee dans les pays a structure decentralisee de production d’energie. Le caractere tres centralise du systeme energetique frangais, marque par de grandes structures nationales orientees vers ime seule energie, a longtemps restreint le developpement de la cogeneration dans notre pays. L’attitude de l’electricien national, longtemps hostile, a cependant change recemment, permettant a la cogeneration de prendre son essor en France.
La production combinee chaleur - force offre en effet de multiples atouts energetiques et environnementaux auxquels les utilisateurs potentiels sont sensibles, meme si le contexte reste encore incertain.
Le terme de cogeneration recouvre trois grandes families de filieres techniques : les turbines a vapeur (a contrepression, a condensation et/ou soutirage), les turbines a gaz et les moteurs thermiques.
Chaque famille technique presente des caracteristiques specifiques dont decoulent des applications privilegiees. Les utilisateurs potentiels seront alors amenes a bien definir leurs besoins propres pour determiner l’interet d’tme telle installation sur leur site.
LE DEVELOPPEMENT DE LA COGENERATION
Pour des raisons economiques, industrielles, environnementales, de nombreux pays tels que les Etats-Unis, le Japon, les Pays-Bas, l’Allemagne ont depuis longtemps fait le choix de la cogeneration : ils beneficient aujourd’hui d’une experience importante sur des installations tres diverses. Face a ce developpement, les technologies ont evolue et des equipements performants et fiables ont ete mis au point.
Le marche de la cogeneration s’est developpe au debut des annees 80, aux Etats-Unis et en Europe du Nord et, plus recemment, dans l’Europe du Sud, pour des raisons diverses qui aboutissent a des situations tres differentes.
Aux Etats-Unis, une Industrie electrique en crise, decentralisee mais soumise a un contrdle important de la part des Etats, une politique de I’Etat Federal favorisant la cogeneration et la deregulation de 1’industrie electrique se traduisent par l’installation de 2.000 a 3.000 MW chaque annee.
Ademe - 1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 2
Au Japon, le developpement de la cogeneration se caracterise par un grand nombre de machines de petite dimension: 2.500 MW foumis par 1.400 installations.
En Europe, la cogeneration represente 6 a 7 % de la production globale d’electricite. En pourcentage de la production de chaque pays, le Luxembourg et les Pays-Bas arrivent en tete avec 30 % de leur production, suivis de pres par le Danemark et la Finlande.
En Allemagne Federale, une industrie electrique decentralisee, un climat relativement froid et une forte autonomie locale se sont traduits par Vinstallation de 9.200 MW dans les reseaux de chaleur. 90 % de la chaleur produite pour les reseaux le sont par des installations de cogeneration. 200 moteurs ou turbines de 1 a 10 MW sont vendus chaque annee.
Aux Pays-Bas, en 1990, l’Etat a fixe un objectif de 6.000 MWe de capacite de cogeneration pour Fan 2000. Vu les progres du secteur, de nouveaux plans prevoient plus de 8.000 MWe, soit plus de la moitie de la capacite de production electrique.
Le Royaume Uni, en 1990, a fixe un objectif de doublement de la capacite de 2.000 MW a 4.000 MWe d’ici Fan 2000. En 1993, la capacite installee etait estimee a 2.700 MWe et le gouvemement a reevalue Fobjectif a 5.000 Mwe.
En France, moins de 2 % de l’electricite est produite en cogeneration. La majorite de la capacite se trouve dans Findustrie (3.200 MWe).
La spdcificite nationale en matiere de production d’electricite, marquee par le developpement du nucleaire, des bas couts de l’energie electrique en base et une capacite de production jusque la excedentaire, avait fortement restreint le developpement de la cogeneration.
L’attitude de l’electricien national, longtemps hostile, semble cependant avoir change recemment, permettant une acceleration du developpement de la cogeneration. Les projets actuels portent sur quelques 100 MW par an (un rythme d'equipement tout de meme plus de 20 fois inferieur a celui des Etats-Unis). Le nombre de projets de cogeneration est passe de 4 en 1991 a plus d’une trentaine en 1995, dont 20 en hopitaux.
C’est dans le tertiaire que la cogeneration connait actuellement son plus vif essor. Rhonalpenergie fixe le seuil de rentabilite dans ce secteur a 600 kW de puissance electrique. La cogdneration serait alors envisageable pour les aeroports, les hopitaux de plus de 500 Iits, les immeubles de bureaux de plus de 20.000 m2, les centres commerciaux et grande surfaces de plus de 10.000 m2, soit un potentiel de 600 MW.
Par ailleurs, la renovation de chaufferies de reseaux de chaleur et la creation de quelques 100 nouvelles usines d’incineration d’ordures menageres representent un potentiel estime a 1.000 MW contre 400 actuellement installes.
Ademe - 1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 3
In t e r e t s e t c o n t r a i n t e s
Rationaliser la production d’energie :
La cogeneration, en recuperant l’energie thermique perdue d’ordinaire lors de la production d’electricite, permet d’utiliser de fagon optimale l’energie. Les rendements d’installation de cogeneration atteignent ainsi 80 a 90 %, a comparer aux machines n’utilisant que la seule energie mecanique, dont les rendements atteignent 35 a 40 %.
Efficacite energetique et mattrise de 1’energie :
La production conjointe de chaleur et d’electricite se fait avec un rendement bien superieur a celui obtenu avec une production separee, ce qui signifie une economic d’energie. L’exemple suivant montre que pour produire la merae quantite d’energie qu’une installation de cogeneration, une production separee necessite environ 47 % d’energie en plus.
Centrale thermique
rendement 35%
Giaudiere classique
rendement 90% ■
100
100
Cogeneration
electricite
Chaleur
Production
147
Evitant le gaspillage d’energie et les pertes durant le transport, la cogeneration permet ainsi de reduire la dependance energetique et d’optimiser la distribution des energies.
La facture energetique de l’utilisateur est d’autant plus reduite que les installations fonctionnent principalement l’hiver, periode de tarifs d’electricite eleves.
Impact sur l’environnement:
II n’y a pas de reponse immediate a cette question. Les rendements energetiques de la cogeneration sont eleves. La consommation de combustible est reduite et les rejets de gaz a effets de serre et autres polluants diminues d’autant.
Mais pour en apprecier l’impact effectif, il convient de comparer l’utilisation de la cogeneration avec la solution que l’on emploierait en son absence. II faut done distinguer les modes d’utilisation de la cogeneration.
Ademe - 1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 4
En usine d’incineration d’ordures menageres, le probleme est tres specifique car l’incineration degage de toute fagon de l’energie, que Ton peut ou non valoriser.
L’incineration avec cogeneration est, sur le plan de l’environnement, plus favorable que la mise en decharge, qu’une incineration sans recuperation d’energie et qu’une incineration avec production d’electricite seule, car les rendements sont meilleurs et evitent done une production supplemental de chaleur par une chaufferie traditionnelle.
Les installations de cogeneration dans l’industrie et le tertiaire peuvent, dans certains cas, fonctionner toute l’annee. Sans cogeneration, il serait necessaire d’utiliser une chaudiere classique pour la chaleur et de faire appel au reseau pour la foumiture d’electricite. II faut done comparer l’impact environnemental de la production d’electricite centralisee plus la production de chaleur par une chaudiere classique avec 1’impact environnemental de la production d’electricite et de chaleur par l’installation de cogeneration.C’est la toute la difficulty car la comparaison depend du type de production d’electricite centralisee (nucleaire, thermique dassique).
Dans la plupart des pays europeens, ou le nucleaire est peu developpe, la cogeneration evite le fonctionnement des centrales thermiques classiques et a done un impact evidemment positif sur l’environnemenL
En France, compte tenu de l’importance du nucleaire, la reponse est plus complexe ; un kWh produit en cogeneration pollue moms Fair qu’un kWh de centrale thermique, mais plus qu’un kWh nucleaire. Tout depend des periodes d’utilisation des installations de cogeneration (leur fonctionnement en hiver permet d ’eviter Vutilisation de centrales thermiques classiques, d ’oii un impact favorable), des techniques et combustibles utilises, de l’evolution future du pare de production d’electricite centralise.
Le tableau suivant donne quelques elements de comparaison:
Emissions pour 1 kWh produit en
C 02(kg)
so2(mg)
Nox (mg eq NOz)
Centrale thermique Charbon (1% de S)
0,95 7.500 2.800
Centrale thermique Fioul (1% de S)
0,80 5.000 1.800
Centrale nucleaire 0 0 0Cogeneration * Turbine a gaz 0,22 0 35 a 1.510Cogeneration * Moteur a gaz 0,29 0 1.400Cogeneration *Turbine a vapeur (charbon) 0,57 4.400 1.170Cogeneration *Turbine a vapeur (fioul) 0,46 2.930 990* Deduction faite des emissions polluantes d'une chaudiere classique produisant la meme quantite de chaleur que Vinstallation de cogeneration.
Ademe - 1. MIGLIORE - 96/24862.docP. 5
La cogeneration pent concemer une grande variete de sites ay ant des besoins d’energie specifiques : besoins simultanes de chaleur ou de froid et d’electricite, sites disposant de ressources energetiques a valoriser,...
L’6lectricite et la chaleur produites peuvent etre consommees pour les besoins propres du site et/ou commercialisees, augmentant ainsi l’independance energetique du site et selon les cas une reduction tres importante de la facture energetique.
En complement de ces avantages techniques et financiers, un certain nombre de mesures reglementaires ont ete prises en faveur de la cogeneration:
- depuis 1993, pendant 5 ans, exoneration de la TIPP et TICGN sur les operations de cogeneration mises en service avant fin 1996 ;
- le decret du 20 decembre 1994 maintenant Fobligation d’achat par EDF uniquement pour Pelectricite issue de la cogeneration, des energies renouvelables et des dechets ;
- possibility d’effectuer un amortissement exceptionnel sur un an, permettant une exoneration de 50 % de la taxe professionnelle (poicvant etre portee a 100 % par deliberation des collectivites locales).
Cependant, malgre ces facteurs favorables, des points de blocage subsistent. Le developpement reel mais fragile de la cogeneration reste suspendu aux decisions reglementaires des pouvoirs publics (exoneration des taxes jusqu ’a fin 1996). La visibility du marche est encore reduite.
L’interet de la cogeneration depend aussi de l’ecart de prix entre Felectricite et le combustible employe. Ce risque differentiel est d’autant plus fort en France que le cout de l’electricite, a 75 % d’origine nucleaire, est un des plus faibles d’Europe. Un «pincement» inexistant chez nos voisins ou le prix de Pelectricite est aligne sur ceux des combustibles fossiles.
Enfin, les conditions de rachat de Pelectricite par EDF ne sont pas favorables a Poptimisation des installations de cogenerations. Un groupe de travail, pilote par la DIGEC et cree en Mai dernier, est charge de proposer des modifications de ces conditions.
La plus ancienne revendication conceme la suppression ou Paugmentation du seuil de puissance de 8 MVA au dela duquel EDF n’est pas tenue de racheter le courant. II s’agit ensuite de simplifier les regies d’achat. L’application d’un tarif unique, independant des periodes tarifaires, eviterait aux utilisateurs de s’assurer a un niveau eleve contre les risques de defaillance en periode EJP. Autre moyen d’attenuer les penalties : la mutualisation des risques, autorisant des groupements d’etablissements voisins a vendre au reseau, minimisant les risques de defaillances.
Le groupe de travail a rendu son rapport recemment, celui-ci devrait etre rendu public dans les prochains jours.
Le contexte de la cogeneration evolue dans un sens favorable depuis quelques annees. Des points de blocage subsistent que le Club Cogeneration, l’UNIDEN ou Cogen Europe tentent de lever.
Ademe -1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 6
L e s t e c h n i q u e s
La cogeneration permet de produire simultanement de la chaleur et de Venergie mecanique a partir d’un seul combustible. L’energie mecanique produite par un moteur thermique ou une turbine est utilisee le plus souvent pour entralner des altemateurs produisant de l’electricite. En recuperant l’energie thermique disponible a l’echappement ou au refroidissement des machines, energie perdue d’ordinaire, la cogeneration permet d’utiliser de fa?on optimale la chaleur et 1’energie mecanique. Les rendements atteignent ainsi 80 % a 90 %, bien superieurs aux 35 a 40 % des machines n’utilisant que la seule energie mecanique. La taille des systemes de cogeneration est extremement variable : de quelques dizaines de kW a plusieurs centaines de MW de puissance.
La cogeneration et ses techniques :
On peut distinguer trois grandes families d’installations :
• les turbines a vapeur utilisant n’importe quel type de combustible en chaudiere,• les turbines a combustion ou turbines a gaz dont les progres recents ont vu les rendements
dlectriques depasser les 30 % en version aeroderivative et atteindre 40 % avec injection d’eau ou de vapeur,
• les moteurs thermiques ou a combustion interne, fonctionnant au gaz ou au fioul.
Le choix de la technique depend principalement de la puissance electrique a mettre en oeuvre, de la nature des besoins thermiques (eau chaude, vapeur, ...) et du rapport des puissances thermiques et electriques foumies par V installation. En fonctionnement, ce rapport doit etre le plus ffequemment possible a son nominal pour assurer une bonne rentabilite.
1. La turbine a vapeur (TAV)
La combustion sous chaudiere d’une energie primaire (bois, charbon, fuel, gaz, dechets ...) foumit de la vapeur surchauffee moyenne ou haute pression. Celle-ci est detendue dans une turbine qui entraine un arbre de transmission ou un altemateur. La vapeur detendue est valorisee thermiquement.
L’utilisation de la vapeur en haute pression predispose une taille d’installation relativement importante (minimum 1,500 kW electriques et 5.000 kW thermiques). II est possible d’effectuer des soutirages de vapeur a divers stades de detente dans la turbine et disposer ainsi de differents niveaux de pression pour les usages thermiques.
Les domaines d’application privileges de la turbine a vapeur sont le secteur industriel et les reseaux de chaleur, notamment lors de 1’incineration des dechets. Pour les reseaux a eau surchauffee, a partir de 80 MW thermiques, les TAV ont les meilleurs temps de retour des trois filieres.
Ademe - 1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 7
La turbine a vapeur est une technique fiable et largement eprouvee.
La combustion exteme a la turbine permet un choix de combustibles large et reversible.
La turbine a vapeur possede de plus une souplesse d’utilisation selon les priorites des usages (electrique ou thermique) : elle permet de couvrir les besoins thermiques traditionnels du site independamment du fonctionnement de la turbine.
Cette technique n’est envisageable que pour les grandes installations industrielles ou de recuperation energetique du fait de la lourdeur des investissements, de la competence requise de la part du personnel et des couts de maintenance.
2. La turbine a combustion ou turbine a gaz (TAG)
Une importante quantite d’air est aspiree et comprimee jusqu’a une chambre de combustion ou a lieu une injection de combustible en continu. Les produits de combustion, lots de leur detente entrainent le compresseur et l’arbre de sortie.
La turbine fonctionne au gaz ou au fuel domestique. L’energie mecanique est soit utilisee directement en entrainement de machine toumante, soit convertie en energie electrique par un altemateur. La temperature des gaz d’echappement avoisine les 500 °C. Leurs caracteristiques autorisent un large choix de valorisation thermique.
La temperature elevee des produits de combustion permet la production de vapeur eventuellement surchauffee ou d’au chaude via une chaudiere de recuperation. La « proprete » des gaz d’echappement permet leur utilisation directe en etuve, sechoir... Leur teneur elevee en oxygene permet techniquement une post-combustion dont la validite economique est a verifier au cas par cas. Les domaines d’application privilegies de la turbine a gaz sont le secteur industriel, les reseaux de chaleur et des applications tertiaires (hopitaux, aeroports, ...). Une reserve toutefois pour le secteur hospitalier : le delai de mise en route d’une TAG ne permet pas de l’utiliser en secours en dehors des periodes de fonctionnement de la turbine.
Dans le cas des reseaux a eau chaude et des reseaux a eau surchauffee, jusqu’a 80 MW thermiques, les TAG sans postcombustion ont le meilleur temps de retour des trois filieres.
3. Le moteur thermique
Un moteur a piston et a combustion interne foumit de l’energie mecanique. Ce moteur fonctionne generalement au fuel domestique ou au gaz. L’energie mecanique disponible sur l’arbre de sortie est soit utilisee directement en entrainement de machine toumante (compresseur, soufflantes ...), soit convertie en energie electrique par un altemateur couple au reseau. Le maintien en temperature du bloc moteur et de l’huile necessite un ou plusieurs circuits de refroidissement sur lesquels s’effectue une premiere recuperation a environ 90°C. Un complement d’energie thermique est obtenu sur les gaz d’echappement.
Ademe -1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 8
Le niveau de temperature de la chaleur recuperee favorise les applications thermiques a eau chaude (chauffage, reseau d'eau surchauffee ...) au detriment de la vapeur. Le moteur thermique conserve des performances interessantes sur une plage variant de 50 a 100 % de sa charge electrique et reste tres peu sensible aux conditions climatiques exterieures. Son utilisation comme secours electrique total ou partiel peut etre raisonnablement envisage.
Le produit est generalement bien adapte aux secteurs tertiaires (hopitaux, centres administratifs, centres commerciaux ...). Ce type de machine est generalement bien adaptes aux petites et moyennes installations, on trouve des moteurs thermiques au gaz naturel de 200 a 2.500 kWe avec une predominance des puissances comprises entre 800 et 1.200 kWe.
II est possible d’en reduire les Emissions polluantes par controle de la combustion et catalyseur.
Dans le cas des reseaux a eau chaude, les moteurs thermiques ont le meilleur temps de retour des trois filieres.
Ademe - 1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 9
LES APPLICATIONS
La cogeneration conceme les sites ou une consommation d’electricite, de chaleur ou de froid est necessaire conjointement tels que les sites consommateurs d’energie thermiques ou il est recherche un secours partiel ou total, les industriels dont le process necessite des besoins thermiques, le secteur hospitalier, les centres commerciaux et administratifs, les reseaux de chaleur...
Quand etudier la possibility d’une cogeneration ?
Pour les sites concemes, differentes occasions peuvent declencher I’etude d’une telle installation:
® la creation d’une unite de consommation d’energie,* la modification des installations, que ce soit un besoin de renovation ou une modification des
besoins en puissance, temperature, debit...• une necessite de remise en conformite des installations.
L’utilisateur doit alors definir clairement ces objectifs pour orienter correctement les choix effectues Iors de l’etude. Le dimensionnement de 1’installation, le choix de la filiere peuvent, en effet, etre tres differents selon que l’on cherche a :
- assurer une continuite de 1’alimentation electrique,- diminuer sa facture energetique,- obtenir un bon rendement global,- reduire les rejets de polluants (SO* CO* No„ CO)- obtenir les avantages fiscaux (exoneration taxe professionnelle, TICGN, TIPP)
L’entreprise doit aussi se poser deux questions fondamentales avant d’entreprendre toute demarche :
- la garantie de la perennite du procede sur toute la duree d’amortissement,- les formes de demarches financieres qu’elle va pouvoir entreprendre.
Un fois le projet positionne, une etude de faisabilite devient necessaire.
L’etude de faisabilite
La premiere phase d’une telle etude doit etre de definir la situation de reference par un bilan global des besoins energetiques et de leur cout sur une annee.Le bilan doit prendre en consideration les charges electriques et thermiques du site sur une annee en decomposant par mois puis par semaine et joumee type.Les evolutions de ces charges en fonction des programmes d’extension envisages ou des travaux de maitrise de l’energie par exemple doivent etre pris en compte.Ce bilan pourra etre I’occasion d’une evaluation de la situation.
Ademe - 1. MIGLIORE - 96Z24862.docP. 10
L’etude peut alors s’orienter vers les choix des solutions possibles selon les caracteristiques de I’installation : caracteristiques du fluide caloporteur et notamment sa temperature, rapport des besoins electriques et thermiques, courbes de charge des besoins...
Un inventaire des materiels disponibles sur le marche permettra la selection de plusieurs groupes pouvant repondre au probleme, couvrant une gamme de puissance suffisamment etendue. Les contraintes techniques particulieres seront examinees pour chaque solution.Une simulation energetique sera realisee pour chaque solution en precisant notamment la consommation de combustible, les quantites d’energies thermiques et electriques produites, autoconsommees, revendues, les quantites d’energies necessaires pour completer les besoins du site, les taux de disponibilite de V installation, puissance garantie, mais aussi le rapport chaleur/electricite et le rendement global, ces deux valeurs devant repondre a l’arrete du 20.12.94.
Pour chaque cas seront examines en parallele les couts d’exploitation et de maintenance afin de calculer le gain annuel par rapport a la situation de reference.
En demiere partie des simulations, on trouvera une estimation des couts d’investissement de l’intallation, permettant de calculer un temps de retour brut pour chaque solution (investissement / gain annuel d’exploitation).Les solutions presentant un temps de retour brut manifestement trop eleve pourront etre ecartees. Les autres feront l’objet d’une etude economique en fonction des types de financement envisages.
On examinera, notamment, les modes et duree de financement, les evolutions de cout (energie, maintenance), la fiscalite (exoneration de TICGN TP...) afin de determiner la rentabilite economique des differentes solutions.
Le bureau d’etude pourra alors realiser un tableau recapitulatif de comptes d’exploitation pluri-annuel etablis au moins pour toute la duree d’amortissement permettant d’apprecier la rentabilite economique du projet, pour chacune des solutions proposees, et selon les modes de financement.
Ademe - 1. MIGLIORE - 9tiZ24862.docP. 11















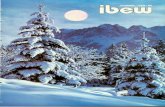














![Microscopic and macroscopic creativity [Comment]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63222cba63847156ac067f99/microscopic-and-macroscopic-creativity-comment.jpg)