Aporie visuelle. Comment photographier la mort ?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Aporie visuelle. Comment photographier la mort ?
Séminaire « Pratiques photographiques »Promotion 2008-2009 : 80-105
Un défi ou une aporie ? Face au thème qui nous a été proposé, le doute a longtemps persisté dans notre réflexion, entre défi et aporie : « Comment photographier la mort ? ». Le cheminement qui mène enfin au travail de terrain et ensuite à la prise de vue est long. Prendre une photographie est une chose. « Clic Clac, merci Kodak. » La photographie est un acte technique, physique et hasardeux. Photographier un thème en sciences sociales est une autre démarche, qui nécessite, quant à elle, une analyse détaillée. Nous permettant de justifier nos choix, cette analyse détaillée permet aussi de montrer la pertinence de l’acte photographique en sciences sociales. Entre documentaire et représentation, les questionnements divers se font face. Il nous faut sortir des livres et se confronter à nos acquis, nos théories et nos aprioris. Car, « Photographier, c’est non seulement refléter la réalité, c’est aussi la réfléchir et s’y réfléchir » (Achutti, 2004 : 34).
Le défi tient du terrain : Est-ce que nous pouvons le faire ? Comment pou-vons nous le faire ? Comment pouvons-nous nous y prendre ? L’aporie tient du thème lui-même. Et tout d’abord de la « mort ». Qu’est-ce que la mort ? Qu’est ce que j’entends par mort ? Qu’est-ce que collectivement nous entendons par « mort » ? Qui a vu la mort ? Qui peut prétendre avoir déjà vu la mort ?
APORIE VISUELLE
Comment photographier la mort ?
« Partir d’une surface blanche pour construire quelque chose qui ait une signification et qui puisse être compris et assimilé par un lecteur représente un défi. »
(Achutti, 2004 : 34).
Justine BlanckaertSHADYC - [email protected]
90 Justine Blanckaert Aporie visuelle
Après avoir délimité les contours d’une mort certaine, il nous a fallu élire la mort qui nous va le mieux. « Mort par arrêt des fonctions vitales de l’être humain. » ; « Mort à travers une commémoration collective. » ; « Mort par érosion des relations sociales. » ; etc. Soit, mais comment fixer une notion aussi abstraite que la mort (personne ne peut prétendre l’avoir VU) sur un support aussi matériel que la photographie ? Nous parlerons alors mainte-nant d’« aporie visuelle ».
Pour Philippe Ariès dire la mort aujourd’hui, c’est parler de « systèmes culturels définis comme un ensemble de discours et de pratiques, de gestes et de dits. » (Ariès, 1982 : 13) Et il ajoute : « La mort à la troisième personne est la mort en général, la mort abstraite et anonyme... un objet comme un autre qu’on décrit ou qu’on analyse médicalement, biologiquement, sociolo-giquement, démographiquement et qui représente le comble de l’objectivité atragique. » (Ariès, 1982 : 28) La mort est abstraite, mais peut être objectivée en tant qu’objet d’étude. La mort est abstraite mais peut être modélisée à travers des objets, des représentations. Ces derniers seront des médiateurs dans l’étude de la réception d’une représentation de la mort en général. En quoi la mort nous révèle-t-elle une sociologie du monde des vivants ?
Toussaint, Armistice, Commémorations. Interrogeons les notions de mémoire et de mort. Nous nous proposons, à travers ce projet, d’utiliser le concept de photoethnographie, comme Achutti 2 à la Bibliothèque Nationale Française et ensuite Spinelli avec les graffeurs à Paris et Porto Allegre, c’est-à-dire en tant que forme narrative à part entière pour faire une ethnographie, pour rendre compte d’un travail de terrain. Utilisons la photographie sous forme de récit. Le récit photoethnographique ne tient pas seulement du « nous y étions ». Préparé, étudié et méthodique, il participe à l’analyse.
« Il semble que les événements soient plus vastes que le moment où ils ont lieu et ne peuvent y tenir tout entiers. Certes, ils débordent sur l’avenir par la mémoire que nous en gardons, mais ils demandent aussi une place au temps qui les précède. Certes, on dira que nous ne les voyons pas alors tels qu’ils seront, mais dans le souvenir ne sont-ils pas aussi modifiés ? » [Proust, 1999 : 1904]. (Baussant, 2007 : 389).
Le défi est lancé : mémoire et récit photoethnographique. Dans un pre-mier temps, nous sommes allés à la cérémonie de commémoration du onze novembre à Marseille. Mais le terrain a montré ses limites. Il était trop court et le sujet trop vaste. Les photographies manquaient de pertinence. La ressemblance avec un triste reportage journalistique n’était que trop prégnante. Mais l’idée de commémoration est restée. Dans un documen-taire sur l’histoire de la photographie, la voix off parlait de la photographie comme une « connaissance immédiate et précise de la société contempo-raine » (Renault, 1992). Il y avait là la notion d’événement, car le propos était illustré par cette photographie de 1885 représentant un train qui était passé à travers la façade de la gare Montparnasse à Paris.
Nous avons alors souhaité créer un « événement ». C’est-à-dire, ici, fabriquer une situation qui lierait mort et mémoire. Cette dernière mettrait en scène une représentation matérielle qui suggérerait la mort « à la troi-sième personne », en plein centre-ville de Marseille. Cette mise en scène serait notre terrain. Comme Roland Barthes dans Mythologies parlent souvent des situations sociales qu’il décrit comme des théâtres antiques ;
91Justine Blanckaert Aporie visuelle
un peu éloignés de la scène, nous essayerons de capturer la réaction des passants face au « décor d’une pièce improvisée ». Immobiles et patients, nous avons créé le terrain, sans par la suite y participer. La démarche est interactionniste, ou plutôt provocatrice ; mais l’observation est discrète. Comment des passants réagissent-ils face à une suggestion anonyme de la mort ? Peut-on provoquer une réaction chez des passants en évoquant la mort anonymement ? La mémoire est-elle « suggérable » ? Comment suggérer la mort ? De quelle mort parle-t-on ? Mémoire, mort et événement sont les mots clefs de notre réflexion et rejoignent des questions posées par Ariès en vue d’étudier la mort aujourd’hui : « De quelle mort s’agit-il ? De quel mourant ? De la mort que l’on se donne, de celle que l’on redoute ou de celle que l’on subit ? » (Ariès, 1982 : 15) En bref partageons-nous tous les mêmes représentations de la mort « en général » ?
Créer, Expérimenter, Cadrer, MédiatiserD’après Roland Barthes, dans son ouvrage La Chambre Claire, la photographie est « Ça a été. » (Barthes, 1986 : 146). Plus que cela, « Telle est la Photo : elle ne sait dire que ce qu’elle donne à voir. » (Barthes, 1986 : 156).
L’image photographique sur la deuxième page de ce dossier est une simple illustration. Elle est de l’ordre du « nous y étions ». Elle représente pour le spectateur, le terrain. C’est autour de cet objet que vont s’articuler les diffé-rents récits photoethnographiques constitués dans ce dossier. En effet nous avons ici choisi d’articuler notre propos en deux temps distincts. D’un côté, nous avons trois récits photoethnographiques, qui comme le souligne Achutti peuvent se lire, se voir, se regarder et se comprendre indépendamment du texte. (Achutti, 2007 :114).
D’un autre côté, le but de ce travail est d’expliquer notre démarche métho-dologique et pratique et de rendre compte de notre expérience de « petit » terrain. Alors répondant à cette attente, le texte dépend des récits photoeth-nographiques. Libre, néanmoins au lecteur, de regarder les photos seules ou pendant sa lecture. Chacun utilise le dossier comme bon lui semble. Les allées et venues entre les deux supports visuels et écrits sont une façon d’appréhender ce travail. Simplement, les deux sont séparés dans la forme, pour les distinguer et construire deux discours distincts. Le discours écrit est notre discours. C’est notre démarche, notre analyse et nos conclusions, car cela part de notre point de vue, celui de l’opérator (Barthes, 1989 in Achutti, 2004 : 34). Par contre, les récits photoethnographiques, bien que résultant de choix réflectifs de notre part, sont maintenant sujet à l’œil du spectator. C’est-à-dire que, comme l’a souligné Barthes à de multiples reprises, chacun ressent (ou non) une photo-graphie différemment. On peut ici parler de sociologie de la réception. Et de ce fait, les notions de punctum et de studium définies par Barthes, dans son ouvrage La Chambre Claire, sont spécifiques à chaque individu. « Le punctum d’une photo, c’est le hasard qui en elle me point (mais aussi, me meurtrit, me poigne). » (Barthes, 1980 : 49) Et le studium est « l’application à une chose, le goût pour quelqu’un, une sorte d’investissement général, empressé, certes, mais sans acuité particulière. » (Barthes, 1980 : 48).
92 Justine Blanckaert Aporie visuelle
Créer
Créer, dans un premier temps, ce n’est pas partir de rien. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (Anaxagore de Clazomènes). En effet, le mot créer, est ici à relier à la notion d’événement, c’est-à-dire un fait synchronique et inhabituel, ainsi que ponctuel. Nous avons créé ici une situation qui n’existait pas auparavant. Mais pour créer cette situation nous avons utilisé des objets et des symboles existants.
L’idée du vélo nous a été rapportée de New York par une amie : « Un vélo tout blanc, complètement peint et attaché à un poteau. Il y avait aussi un bouquet attaché dessus. Je me suis arrêtée. C’était très subjectif. Mais j’ai trouvé cela très juste. Pour une fois que ce n’était pas du noir. » Pouvons-nous suggérer la mort, suscitant chez les passants surprises, interrogations ? Pouvons-nous provoquer l’arrêt chez les passants ? C’est l’arrêt qui nous a interpellé. Les gens vont-ils s’arrêter ? Quelle va être leur réaction ?
Le vélo, en effet, est un artefact. L’objet pour lui-même est connu de tout le monde, sa signification et ses usages sont partagés et « apprivoisés ». Dans le cadre du dispositif expérimental, c’est une production artificielle : peinture et mise en scène. C’est donc un objet fortement cognitif, car « le choix d’un modèle narratif – ou, plus exactement d’exposition – est aussi celui d’un mode de connaissance. » (Revel, 1996 : 35) La couleur blanche dont nous avons peint le vélo est plus difficile à justifier. En effet, le blanc en France est plutôt utilisé pour les mariages. Mais il est aussi lié symboliquement à la pureté et à la fragilité. C’est ici la fragilité que nous retiendrons. Pourquoi ne pas avoir pris un vélo cassé, plié ou même encore brûlé ? Nous souhaitions ici suggérer et non affirmer. Le blanc est aussi la couleur des vêtements que portent les anges dans l’iconographie chrétienne, et donc à la mythologie de l’au-delà. Quant aux fleurs, elles sont souvent en France, une monnaie d’échange symbolique. Nous offrons des fleurs pour un mariage, un anniversaire, une naissance ou même une visite. Mais nous apportons aussi des fleurs quand nous nous rendons dans un cimetière. Les fleurs sont aussi un symbole lié à la commémoration des morts. Et ceci est particulièrement visible au moment de la Toussaint. Quand à la couleur des fleurs, elle est le fruit du hasard.
Finalement créer, ça a aussi été pour nous choisir l’endroit où « poser » le vélo, « poser le décor ». Nous avons choisi la Canebière, une des rues princi-pales de Marseille, non loin du centre-ville et de ses commerces. Nous avons aussi choisi un mercredi en fin d’après-midi espérant un public diversifié.
Expérimenter
Expérimenter, c’est faire une tentative pour voir comment les choses se passent. L’expérience est un médiateur de l’observation, qui elle-même est un incontournable du travail de terrain et de la production d’une eth-nographie. Nous avons tenté de voir si nous pouvions suggérer l’idée de mort chez des passants « candides » au projet. Les résultats escomptés de l’expérience sont les réactions des gens : des gestes, des signes, des mou-vements. Ces réactions nous souhaitions les « capturer » grâce à l’appareil
93Justine Blanckaert Aporie visuelle
photographique. Sylvie Conord a défini le terrain comme des « pratiques fortement imbriquées : percevoir, mémoriser, noter [Beaud, Weber, 1998 : 14] » (Conord, 2007 : 16). Elle ajoute que « la prise de vue représente alors un moyen d’accroître la capacité de mémorisation de l’ethnologue. » (Conord, 2007 : 16) Les photographies issues du terrain sont donc un « journal de terrain visuel » (Conord, 2007 : 16). L’expérience est une façon de mettre à l’épreuve ses hypothèses. Notons que dans le cas présent, le projet est basé sur le fait que nous partageons des représentations communes de la mort.
Cadrer
Cadrer, c’est faire des choix interprétatifs. « Le photographe détermine ce qui va être montré et ce qui est hors cadre. » (Conord, 2007 : 16) En effet, le cadre dépend dans un premier tant de la place que nous, operator, nous prenons dans le dispositif expérimental, et surtout ici, dans le dispositif d’observation. Nous avons choisi un cadre pratiquement fixe tout au long des prises de vue. Nous étions face à la scène, mais aussi en dehors. Nous étions pratiquement invisibles pour les acteurs. Le décor étant posé face à un café, nous nous étions positionnés en retrait à la terrasse de ce café, quelque peu dissimulés par des chaises et des parasols. Donc le cadre est lié à un souci de discré-tion, mais aussi de continuité par rapport à l’ethnographie visuelle que nous souhaitions produire. Nous souhaitions que les plans influencent le moins possible le récit, donc que les plans soient le plus larges possible. Ceci, car en sciences sociales : « Faire varier la focale de l’objectif, ce n’est pas seulement faire grandir (ou diminuer) la taille de l’objet dans le viseur, c’est en modifier la forme et la trame ; [...] (c’est) transformer le contenu de la représentation (c’est-à-dire le choix de ce qui est représentable) ». (Revel, 1996 : 19). Et donc que la signification, du récit photoethnographique et de chaque image, vient du moment où, nous, opérateur, nous déclenchons la prise de vue. Ce court instant où nous appuyons sur le bouton ; l’obturateur s’ouvre, l’image est fixée.
Médiatiser
Médiatiser a ici des implications ou des significations différentes. En premier lieu, le vélo est le médiateur d’une représentation matérielle de la mort. En second lieu, l’appareil photographique est le médiateur de la relation entre la « scène » et l’opérator, entre l’expérience et l’observation. Nous avons d’abord effectué l’observation à « œil nu », pour percevoir, apercevoir les différentes réactions et cerner ce que nous allions « noter », c’est-à-dire photographier. Mais aussi nous avons observé à travers l’objectif de notre appareil réflexe ; l’appareil était donc médiateur entre la « scène » et l’operator. La photographie est « un instrument de recherche à part entière dans la compréhension du monde contemporain et son histoire » (Conord, 2007 : 12). De plus, « la photographie contribue à la mémorisation d’un certain nombre d’indices non perceptibles immédiatement par l’œil, sans toutefois être le reflet transparent des réalités qu’elle représente. » (Conord, 2007 : 12) La photographie est un outil de recherche très fin, néanmoins comme tout outil, il a ses limites, notamment le fait qu’elle ne
94 Justine Blanckaert Aporie visuelle
rendra jamais une copie parfaite du réel. C’est pourquoi il faut définir son cadre et expliciter le processus de prise de vue, le lecteur dispose ainsi des clefs pour comprendre la démarche et ensuite l’analyse de l’operator et de l’ethnologue. Maresca parle du recours à la photographie comme d’un outil pour faire passer la communication non verbale, « c’est-à-dire les échanges qui passent par le silence ». (Maresca, 1997 : 133)
Nous avions effectué un deuxième terrain autour du vieux port de Marseille et des traces cadavériques blanches peintes sur le sol. À notre grand désespoir, personne n’y portait la moindre attention. Peut-être à cause de l’habitude ? Ces gens qui passent devant tous les jours ne les remarquent même plus. Peut-être n’évoquent-elles rien de particulier chez les passants ? Pas de souvenirs ? Pas de liens ? Peut-être aussi ont-ils « la tête ailleurs » ? Ou sont-ils en train d’admirer le vieux port et non, le sol ?
Grammaire ou fil d’ArianeVenons-en à la grammaire de la photographie, il y a c’est vrai, « un encom-brement de l’image qu’il faut savoir déchiffrer » (Conord, 2007 : 13). Quand on fait une photographie, un ou plusieurs éléments sont en jeu. Ces éléments sont des référents. « La Photo est littéralement une émanation du référent. » (Barthes, 1980 : 129). Ici, le référent « central » est le vélo, il est le « fil d’Ariane » de ces récits photoethnographiques. Le vélo est central sur quasiment toutes les photos. Les autres référents, les passants anonymes, s’articulent autour du premier référent. Le jeu est organisé autour des positions des passants par rapport au vélo. Plus que leurs positions, leurs attitudes sont, pour reprendre l’expression de Barthes, le ou les punctums de chaque image photographique. Mais plus encore le punctum est ici comme banalisé, car les situations entières sont voulues comme poignantes. « Voulues » dans le sens où les photographies qui constituent l’ethnographie visuelle de la première partie de ce dossier sont choisies (parmi plusieurs clichés qui sont ici présentés en annexe de ce même dossier).
La distance au sujet est à quelque chose près toujours la même. « Voir suppose la distance, la décision séparatrice, le pouvoir de n’être pas en contact et d’éviter dans le contact la confusion. Voir signifie que cette séparation est devenue cependant rencontre. [Maurice Blanchot, 1955 : 25] » (Maresca, 1997 : 153). Une première série a été réalisée à deux mètres du sujet, nous étions trop proches. Les passants étaient plus attirés par l’appareil photographique que par le vélo. (Certains flairaient un piège.) Avec plus de recul, les cadrages sont plus larges, donc plus imprécis, car les référents sont éloignés et l’impact de leurs attitudes est moins fort, moins marquant. L’objet est plus difficilement cerné. Pourtant l’opérateur s’effaçant de la scène immédiate, les sujets sont moins influencés. Et l’effet escompté, c’est-à-dire l’observation des différentes attitudes par rapport à « l’élément perturbateur », est rendu possible. Ce qui pose ici la question de l’implication du chercheur dans le dispositif. Nous ne pouvons pas parler ici clairement d’observation participante. Pourtant à travers les
95Justine Blanckaert Aporie visuelle
différents médiateurs (le dispositif autour du vélo et l’appareil photogra-phique) nous participons relativement à l’action photographiée. Peut-on parler ici d’observation semi-participante ? Ou est-ce une caractéristique spécifique de l’expérience, de ce dispositif expérimental ?
L’angle de vue, frontale, est fortement représentatif de la relation entre l’observateur-opérateur et les passants. Les sièges de la terrasse du café, où s’était installé l’observateur-opérateur, apparaissent dans le champ de la plupart des photographies. Même après un recadrage, la présence de ces sièges reste apparente. Ce choix permet d’illustrer cette relation sans contact, à sens unique, de l’observateur sur les passants. Ces sièges sont une barrière, une limite ou la preuve de la discrétion volontaire de l’obser-vateur. « C’est en rendant visibles dans la photographie les conditions pratiques de sa réalisation que Puranen amorce sa réflexion en images sur la démarche documentaire et ethnologique. » (Maresca, 1997 : 220)
Nous avons laissé apparent tous les signes de l’urbain, du centre-ville, des activités urbaines et marchandes. Ceci dans le but d’inscrire les réfé-rents dans un jeu plus large. De montrer le rythme autour de la scène (les voitures, les bus, le trafic organisé par la police, les façades illuminées des magasins, etc.) Finalement, la suggestion de mort est incluse dans un paysage plus large de quotidien urbain. Ce qui permet par la suite de mettre en valeur la réaction des passants. Nous pensons ici à tous les passants (Attitudes, photos 3, 6 et 7), qui soit passent devant le vélo sans même le voir, soit se retournent brièvement tout en continuant leur chemin. Ces passants furtifs ou absents soulèvent tout un questionne-ment. Pourquoi ne l’ont-ils pas vu ? Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés ? Pourquoi ne se sont-ils pas même retournés ? (Une suite de ce travail de terrain permettrait sans doute une esquisse de réponse à ces questions. Nous pensons ici à de courts entretiens en aval de l’objet « vélo ».) Est-ce que le dispositif en lui-même n’est pas une aporie visuelle ?
La vitesse d’obturation, semblable pour tous les clichés, permet de mettre en valeur le mouvement autour du référent immobile qu’est le vélo. Surtout dans les attitudes de « retournement brusque » ou de « passage candide ».
La vitesse d’obturation met aussi en valeur le mouvement perpétuel des véhicules et des personnes en arrière-plan.
Pour la lumière, nous avons joué sur les contrastes et la luminosité à la postproduction sur presque tous les clichés. Ceci dans deux buts. Premièrement, pour toujours mettre en valeur notre « fil d’Ariane », le vélo. La blancheur du vélo est centrale dans presque tous les clichés, cela permet le récit photoethnographique grâce à l’enchaînement des images reliées par le « fil d’Ariane ». Deuxièmement, à cause de la nuit qui tom-bait, les photos sont devenues sombres. Nous les avons donc éclaircies à la postproduction dans un souci de visibilité. D’un autre côté, nous avons aussi accentué les contrastes. Ceci dans le but de garder la nuit visible. La nuit en opposition à la blancheur du vélo ce n’est pas anodin. C’est pertinent, si nous considérons la nuit comme un symbole de dramati-sation. Dramatisation qui a peut-être agi sur les réactions des passants. Mais aussi dramatisation pour les spectateurs des photographies, car la nuit sans doute rajoute à une représentation tragique de la mort « à
96 Justine Blanckaert Aporie visuelle
la troisième personne ». La blancheur du vélo dans ce contexte de nuit dramatique est comme une silhouette fantomatique. Et les fantômes sont présents dans la mythologie de la mort.
La photographie en couleurs est ici un parti pris contextuel. Tout d’abord par rapport à la blancheur du vélo et aux fleurs attachées dessus. Ces fleurs jaunes et le ruban rose foncé qui les lie au vélo sont des éléments clefs de la suggestion. L’ensemble « vélo+fleurs » permet la suggestion par représentation. Nous avons ici fait appel à des représentations col-lectives qui suggèrent la mort. De plus, la couleur est une façon de plus de mettre en valeur le contexte urbain du centre-ville (les lumières, les enseignes, etc.). Ensuite les couleurs vives des enseignes, des bus, etc. contrastent avec le blanc du vélo. Autant par sa taille que par sa couleur, le vélo représente le peu de place fait à la mort dans nos sociétés urbaines et modernes. (Baudrillard, Ariès, 1982 : 32 ; Legros et Herbé, 2006 : 12). Finalement, on peut aussi voir que la couleur rend possible l’émergence d’autres éléments que le vélo. Ces autres éléments sont importants aussi, car dans de nombreux cas, ils attirent les regards des passants (exemple : l’affiche pour le concert de Moustaki), et du même coup ces passants ignorent inconsciemment le vélo. Ou simplement, ils ne le voient pas.
« Faire, subir, regarder » : une analyse
Une photographie d’une certaine façon objective le réel en faisant des choix, notamment le choix d’appuyer sur le déclencheur à un instant T. Des choix nous en avons fait encore au moment de sélectionner certaines photographies plutôt que d’autres pour constituer trois récits photoethno-graphiques. Ces choix se présentent sous forme d’une typologie. C’est-à-dire que ces photographies posent des questions et que nous avons choisi d’y répondre sous forme d’une typologie.
Une typologie est « un effort d’abstraction autorisant des mises en ordre ou des comparaisons » (Ferréol, 2004 : 216). Est-ce que le concept de récit photoethnographique défini par Achutti n’est pas simplement une forme de « typologisation » d’une ethnographie visuelle ? « Face à la mort et au mourir les attitudes prennent la forme du pluriel. » (Ariès, 1982 : 13) Nous avons ici regroupé les photographies par « ressemblances et dissemblances, des unités autour d’un petit nombre d’entre elles, considérées comme essen-tielles. » (Ferréol, 2004 : 216) Cette « typologisation » répond aussi au fait que comme le souligne Conord, quand nous élaborons « un texte, on choisit également d’adopter une mise en forme plus ou moins sophistiquée pour exprimer une idée », c’est-à-dire que nous sélectionnons et nous arrangeons, ceci dans un souci d’esthétique et de compréhension.
Attitudes
Ces photographies n’ont pas été prises immédiatement après l’installation du vélo. Nous avons d’abord pris le temps d’observer les différentes réac-tions des passants. Ceci dans le but de pouvoir saisir les instants qui nous paraissaient répondre le mieux à nos questions. Nous avons tenté de saisir
97Justine Blanckaert Aporie visuelle
ce que nous avons appelé les attitudes. Chacune des photographies de ce premier « regroupement » représente une « attitude », une « réaction », un geste, tous ses signaux silencieux que nous observions. Attitude est un terme générique pour signifier des postures et des manières. Ces attitudes sont en réaction au dispositif expérimental. Elles se sont produites plusieurs fois avec similitudes et nous les avons en quelque sorte « essentialisées ». Nous avons par contre choisi de ne pas légender chaque photographie, seulement de donner un titre aux « regroupements ». Nous pensons que la légende influencerait le spectateur en lui ôtant toute subjectivité. Nous nous contenterons donc de titres et de l’analyse de chaque image.
La première photographie de ce premier récit photoethnographique représente une des attitudes les plus rencontrées. Des passants qui tournent la tête. Ils ne s’arrêtent pas. Ils continuent leur chemin, cependant, pen-dant un court instant, leur regard se pose sur le vélo. C’est une attitude qui est le plus souvent solitaire et pratiquée par des gens qui marchent vite. La réaction est un peu brusque.
Dans la deuxième photographie, une autre attitude est capturée. Nous avons simplement appelé cette dernière l’« arrêt ». L’arrêt, car cette atti-tude, est en deux temps. D’abord, le passant marche, il voit le vélo. Puis il s’arrête un peu plus loin et observe. L’arrêt ne dépasse pas deux ou trois minutes, cependant le passant est concentré, « pensif ». Puis il repart. Il n’y a pas ici de réaction brusque, mais plutôt comme un « long » processus : apercevoir, apprivoiser, réfléchir, puis repartir.
Sur la troisième photographie, on voit deux passants qui marchaient ensembles. L’un d’eux voit le vélo, et interpelle le second. Ce qui repré-sente des attitudes croisées, pourtant liées dans leur processus. Ainsi nous pouvons remarquer la différentiation des appareils cognitifs chez ses passants et les divergences de trajectoires qui étaient a priori similaires, ou du moins coordonnées. Nous avons choisi, celle-ci car l’enfant qui montre du doigt est très représentatif de cette situation. L’enfant de par son geste représente parfaitement cette situation. À la fois il montre le vélo du doigt, mais aussi il tire sur le bras de sa mère, et ralentit cette dernière dans sa course. Ces gestes seuls sont très significatifs. Elle tourne la tête et observe à son tour. La simplicité, ou plutôt, le côté « déjà-vu » de cette photographie participe à la réussite de la suggestion à travers le dispo-sitif expérimental. Mais aussi, cela installe dans ce récit photoethnogra-phique une confusion entre réalité et cliché. Nous avons une impression de « déjà-vu ». Ce que l’on pourrait qualifier de punctum « banalisé » dans le geste de l’enfant fait appelle à la mémoire du spectateur. L’impact de cette photographie est basé sur des connaissances antérieures, ce que nous avons qualifié de « déjà-vu ».
Nous souhaitons aussi, à cet instant du récit photoethnographique, insister sur le mouvement que permet le récit par cet enchaînement de photographies. En effet, les passants arrivent des deux côtés du vélo. Cela participe à l’ancrage de ce récit dans le réel. Cela crée un effet de mouvement. Alors que comme l’a souvent souligné Barthes, dans La Chambre Claire, la photographie est la mort, « la platitude de la mort ». Pour en revenir à l’idée de mouvement, elle est d’autant plus flagrante si les récits sont présentés sur « powerpoint » car les photographies défilent
98 Justine Blanckaert Aporie visuelle
sur l’écran. Le mouvement dépend donc aussi du support sur lequel on présente les photographies. L’interprétation et l’analyse dépendent alors autant de l’image elle-même que du support sur lequel elle est présentée.
La quatrième photographie quant à elle illustre parfaitement « la ren-contre manquée ». Le regard du passant n’a pas croisé le vélo. Le passant continue son chemin machinalement. En effet, le côté flou de la passante, ici, montre cette impression de mouvement continu, si rapide que même l’appareil n’a pas réussi à le capturer. Une idée de fuite en avant est ainsi mise en valeur. En opposition, le vélo est toujours immobile et bien net. Sur la droite, la passante est prête à sortir du cadre, le vélo a été dépassé, sans même un mouvement de tête. Il y a bien sûr, plusieurs possibilités d’interprétations. À partir d’une même photographie on peut imaginer différents récits. Néanmoins, en montant un récit photoethnographique à partir d’une série de photographies plus ou moins homogènes, nous pouvons tenter de présenter un récit intelligible, illustrant notre démarche. Ces photographies illustrent aussi l’attente de l’observateur, la nuit tom-bant petit à petit. L’observation étant passive, les résultats du dispositif expérimental sont aussi basés sur la durée, dans le temps.
À travers la cinquième photographie, la posture déséquilibrée du pas-sant illustre une surprise. Plus que de simplement tourner la tête, il est ébranlé dans sa course. À quel imaginaire notre suggestion l’a-t-il rappelé ? Qu’a-t-il vu exactement ? Sa silhouette est nette, la surprise a été lente, presque suite à un temps de réflexion.
« Tel est pris, qui croyait prendre. » est une légende possible pour la sixième photographie. Ce passant interpellé s’est arrêté pour prendre une photographie du vélo. Du même coup, la seconde passante qui l’accom-pagnait s’est arrêtée aussi. Va-t-il « faire suivre » son cliché. Et par là, communiquer cette représentation, cette suggestion morbide qu’incarne le vélo ? Pourquoi prend-on ce type d’événement, d’objet significatif, en photo ?
S’achève ici ce premier récit des attitudes plurielles rencontrées par l’observateur. La série de photographies qui constitue ce récit photoeth-nographique est, prise dans son ensemble, une illustration pure du travail de terrain. Ces photographies, prises une à une, sont des situations par-ticulières, des attitudes singulières produites de la rencontre du passant et de l’objet « vélo ». Pourtant à nouveau, prises dans leur ensemble, elles généralisent les attitudes, et un passant représente à lui seul vingt pas-sants. Le récit photoethnographique peut être vu ici comme la construc-tion d’une théorie générale. Ou plutôt, la typologie élaborée à partir de l’« essentialisation » de situations singulières, qui pourtant ne le sont pas, donne lieu à la construction d’une analyse théorique.
Les deux récits photoethnographiques suivants sont ce que nous pour-rions qualifier de cas singulier. Des trajectoires de passants prises à part de la généralisation des attitudes. La typologie est ici différente. Ces atti-tudes « modélisables » sont expressives sous forme de récit à part entière. Une seule photographie ne suffirait pas à rendre compte des processus de rencontre entre les passants et le vélo. Ce sont des processus formés d’attitudes différentes qui prennent sens à travers leur enchaînement. En effet, prises seules, ces photographies ne pourraient rendre compte des
99Justine Blanckaert Aporie visuelle
échanges cognitifs entre les passants et entre les passants et le vélo. Les mouvements des passants pris seuls et croisés ont des sens différents. Les interactions sont ici silencieusement mises en valeur. Un couple est-il un tout ou la somme des parties ?
Couples
Ce deuxième récit photoethnographique appelé « couples » retrace en fait les trajectoires de deux couples. Le premier en quatre photographies et le deuxième en trois photographies. Ils reprennent à la fois les attitudes généralisées dans le premier récit, mais aussi ils permettent une analyse en détail des trajectoires. Ces trajectoires peuvent être vues comme un enchaînement des attitudes décrites ci-dessus. Mais grâce au récit pho-toethnographique, ces trajectoires se distinguent dans leur découpage des actions. Aussi la particularité de ses trajectoires est qu’elles sont accomplies en couple. Mais les passants qui, arrivant dans un mouvement mécanique synchronisé, et d’apparence similaire et probablement dans une trajectoire commune ponctuée par une discussion commune, différent devant l’objet.
Dans le cas du premier couple, ils arrivent comme un seul bloc. Puis sur la deuxième photographie, la jeune femme se retourne la première. En traînant, sur la troisième photographie, le jeune homme qui se retourne à son tour. Enfin sur la quatrième photographie, mouvement presque imper-ceptible, très légèrement flou, le jeune homme est le premier à détourner son regard de l’objet pour reprendre sa route. Pourtant la silhouette de la jeune femme reste parfaitement immobile. Dans la série suivante, le couple s’aperçoit, prend conscience en même temps de l’objet. Et sur la deuxième photographie, malgré la poursuite de leur chemin, les deux passants restent comme un seul bloc, le regard fixé sur l’objet. Pourtant, à la troisième photographie, la jeune femme regarde droit devant elle, elle a détourné son regard de l’objet et poursuit sa route. Le jeune homme, toujours enlacé, a lui la tête détournée, le regard toujours fixé sur l’objet. Son corps même est un peu détourné de la trajectoire suivie par le couple initialement, pour permettre à son regard d’être parfaitement face à l’objet.
Dans ces deux séries, on a donc pu retrouver des attitudes générali-sées. Pourtant, les couples apportent l’avantage à l’analyse, qu’ils arrivent deux par deux, dans un mouvement commun. Nous pourrions donc supputer, qu’ils auront les mêmes attitudes face à l’objet. Et finalement non, les arrêts, les reprises de trajectoires, les temps de « fixation » ne sont pas les mêmes. Pouvons nous supposer que les effets produits par l’objet sur l’imaginaire des gens sont différents ? Imaginaire ou souvenir ? Pouvons-nous parler d’émotions différentes ? Pouvons-nous faire appel ici à l’anthropologie de l’émotion ? « L’individu contribue à la définition de la situation, il ne la subit pas. Il l’interprète d’emblée ou avec du recul à travers son système de valeurs, et l’affectivité déployée en est la conséquence. » (Le Breton, 2004 : 140). Ne peut-on pas aussi expliquer ses divergences par des causes « attentionnelles » et cognitives ? C’est-à-dire qui renvoient aux capacités du chercheur à influer sur les choses, en d’autres termes quel est l’impact d’une innovation sur la trajectoire mécanique des passants ? « Il faut toutefois rester vigilant et prendre
100 Justine Blanckaert Aporie visuelle
garde au réductionnisme sociologique qu’elle peut générer. En effet, à force d’insister sur la foule d’acteurs impliqués et sur la complexité des mécanismes collectifs à l’œuvre, en situation d’interaction, dans de tels processus, nous courrons le risque, à terme, d’une grande distanciation avec l’action locale, l’objet technique et sa présence physique (Vinck, 1999). Nous risquons de réduire considérablement le rôle de la matérialité dans les processus de transfert de technologie et la transformation des connaissances des acteurs en situation. »
(Geslin, 2002).
Singularité
Ce troisième et dernier récit photoethnographique est plus long que les autres. Plus long dans le sens où à travers sept photographies, nous décor-tiquons la réaction d’une seule passante. Une passante qui a particuliè-rement attiré notre attention d’observateur. Notre attention est restée sur elle pendant tout le temps où elle observait le vélo. Pas de généralisation possible ici, c’est un cas singulier (d’autant que le travail de terrain était court). Néanmoins, cette réaction singulière est intéressante dans son déroulement.
Sur la première photographie, on peut lire une expression de surprise sur le visage de la passante. Ses yeux sont écarquillés, ses sourcils « levés ». Son corps a marqué un premier arrêt. Sur la deuxième photographie, elle s’est rapprochée et regarde l’objet avec plus d’attention. Sur la troisième photographie, elle contourne le vélo, toujours avec toute son attention portée sur l’objet. Sur la quatrième photographie, elle avance, mais son regard ne se détourne pas du vélo. À la cinquième photographie, elle s’est arrêtée, son regard toujours fixe, sur l’objet. Sixième photographie, elle a avancé encore de quelque pas, puis a effectué un demi-tour. Son regard est à nouveau fixé sur le vélo. Elle porte sur son visage une expression d’effroi, elle est comme atterrée. La main sur le ventre. Nous avons une impression de douleur. D’autres passants la regardent, elle, et non l’objet. Entre cette sixième photographie et la septième, elle effectue un signe de croix, puis embrasse sa main. Une expression de tristesse profonde et de compassion a parcouru son visage. Mais l’opérateur-observateur n’a pas eu le temps de saisir le geste. La septième photographie est déclenchée quand la main gauche de la passante, redescend. Comme un « au revoir », sa main est en suspend. Ironie du déclenchement qui provoque chez le spectateur une impression toute différente de celle de l’observateur, qui a lui, vu le geste de croix, et par conséquent sait que ce n’est pas un « au revoir ». Le corps de la passante, sur cette septième et dernière photo-graphie est à nouveau en mouvement. Elle reprend sa trajectoire initiale. Pendant tout ce temps, de nombreux passants sont passés, ils ont traversé le champ de l’image. Certains ont été photographiés.
Nous n’avons pas ici parlé de punctum au sens barthesien du terme. Tout d’abord car le geste qui point n’est pas apparent. Il est suggéré entre la sixième et le septième photographie. Deuxièmement Barthes par du principe que les sujets photographiés sont toujours en représentation. « Or,
101Justine Blanckaert Aporie visuelle
dès que je me sens regardé par l’objectif, tout change : je me constitue en train de « poser », je me fabrique instantanément un autre corps, je me métamorphose à l’avance en image. » (Barthes, 1986 : 25). Pourtant le dispositif d’observation mis en place ici s’en défend. Les passants ne savaient pas qu’ils étaient photographiés. Ce geste « singulier » est propre à cette passante. Comme Ariès l’a souligné, chacun réagit différemment face à la mort. Se signer fait plutôt référence à une habitude, un geste incorporé à travers un apprentissage. On se rapporte ici plus à la notion d’habitus de Pierre Bourdieu. Le geste est incorporé à un point tel, qu’il en devient d’apparence spontané. C’est justement ici la spontanéité du geste ou son « instinctivité » qui nous point. Nous ferons alors ici plutôt appel à une nouvelle forme de punctum, pourquoi pas un « punctum spectral ». C’est un punctum qui apparaît en filigrane. Il est le résultat des photographies prises et disposées à la suite les unes des autres. Spectrale aussi car sa spontanéité et sa rapidité le rendent insaisissable. Le récit photoethnographique entre cette femme et l’objet semble être en sus-pend dans le temps, fait de séquences immobiles. Pourtant, les nombreux passants qui traversent le champ, regards ailleurs, absents, soulignent le temps qui passe. Le temps continue de s’écouler. L’image est comme mobile. Ironiquement, seuls les passants sont mobiles. Au premier plan, les chaises, et à l’arrière-plan les embouteillages posent comme un décor fixe, immobile. Ce décor est comme un tunnel que traversent les pas-sants. Le référent premier, le vélo, est lui aussi immobile, pourtant avec sa blancheur et ses fleurs, il se détache du décor fixe pour entrer dans le jeu des passants. Il participe à l’action, il en est le générateur, le provocateur et sa continuité. Aussi, comme l’objectif suit la passante, nous pouvons penser que le vélo se déplace de droite à gauche. L’idée de mouvement est encore une fois mise en valeur. On peut donc dire que la suggestion de mouvement dépend au moins de trois éléments : le cadre, la vitesse d’obturation et le support matériel. Cette idée de mouvement est d’autant plus accentuée par le récit dans sa forme : l’enchaînement des images.
&
Nous avons mis en place un dispositif expérimental. Une suggestion de la mort en pleine rue. Nous voulions observer la réaction des passants face à cette suggestion « mortifère » anonyme. Pouvons-nous parler ici de montage ? De trucage ? Est-ce que l’anthropologue a le droit de provoquer la réaction des sujets observés ? Pour autant, la situation d’observation, ce que nous avons appelé terrain, après sa mise en place n’a plus été modifiée. Cachés, dissimulés, nous avons observé. Peut-on parler d’observation semi-participante ?
Mais plutôt que de création, n’aurions-nous pu pas non plus parler d’innovation au sens de l’anthropotechnologie ? Ce qui souligne le disposi-tif expérimental et interroge la position du chercheur, qui dans le cas d’une
102 Justine Blanckaert Aporie visuelle
innovation utilise le milieu social qui l’entoure. « On trouve par exemple chez Olivier de Sardan (1995 : 78) une définition de l’innovation assez représentative de cette intégration des acquis : il s’agit de toute greffe de techniques, de savoirs ou de modes d’organisations inédits (en général sous formes d’adaptations locales à partir d’emprunts ou d’importations) sur des techniques, savoirs et modes d’organisation en place. » (Geslin, 2002)
Et plutôt que de dispositif expérimental, aurions-nous pu parler d’art et de « happening » ? Et dans ce cas comment nous serions nous posi-tionnés ? Quels auraient été les modes de cadrage ? N’aurions-nous pas pu utiliser la photographie noir et blanc ? En noir et blanc, le vélo aurait pris une apparence plus spectrale. La situation n’aurait-elle pas été plus dramatisée ? Le but des sciences sociales n’est-il pas d’objectiver les situa-tions ? Dans ce cas, le rapport à la mort dans les sciences sociales est conçu comme « adramatique ». La mise en scène en sciences sociales doit être relativisée, partielle. En art, elle peut être accentuée et mise en valeur. D’un point de vue artistique nous aurions pu médiatiser plus les relations aux passants. Et mettre en valeur des cadrages plus ambigus, le réel et le contexte n’étant plus descriptifs mais objets. Peut-être ne pas attendre l’instant « punctum », mais le provoquer directement.
La création, à l’issue des prises de vue, de récits photoethnographiques, met en relief à la fois notre démarche et l’objet étudié, par la décomposi-tion possible de ce dernier. Ces récits photoethnographiques permettent un discours visuel indépendant du texte d’analyse. Le peu de travail de postproduction laisse au contexte et à la démarche un maximum de réalisme. Néanmoins, le prisme de la prise de vue est prégnant. Et la présence de l’observateur est sensible à travers sa démarche.
Nous avons pu aussi cerner les limites de ce travail et de cette démarche. Premièrement, des limites humaines, quand nous avons « raté » le signe de croix de la passante. Mais aussi des limites épisté-mologiques : la photographie ne se suffit pas à elle-même dans le cadre d’un travail anthropologique de terrain. La photographie est un outil, qui permet un discours. Pour que le travail soit des plus exhaustif, la photographie doit être un outil, à combiner avec d’autres. Des entretiens « post-rencontre » auraient étoffé l’analyse. Ils auraient sans doute permis de l’approfondir et sans doute de répondre aux questions de départ. Des entretiens courts en aval de la scène, pour recueillir des impressions orales spontanées. Pourtant, ces entretiens aussi auraient leurs limites. Dès lors que nous interrogeons un individu, il y a une situation cognitive qui le pousserait sans doute à réfléchir et reformuler ses impressions. La photographie reste ici le meilleur moyen de capturer des réactions spontanées, des détails que l’œil ne pourrait enregistrer. Néanmoins, la vidéo semblerait un moyen de recueillir les actions dans leur processus complet et de briser le silence.
Quelques remarques aussi sont à faire par rapport à la subjectivité des photographies. Par exemple, sur les différentes photographies, nous voyons rarement les visages des passants. Et l’on prend pour acquis qu’ils sont en train de fixer l’objet. Pourtant, nous n’en avons pas la preuve « réelle », « matérielle » ou « visible ». Ce qui souligne encore une fois les limites de la photographie. Et cette problématique abordée par de nombreux
103Justine Blanckaert Aporie visuelle
auteurs du réel. Le cadrage et la mise en scène, volontaires ou non, sont des interférants à la notion de réel.
Ce travail est une expérience et doit être considéré comme tel. Avons-nous apporté des réponses à notre questionnement sur la mort et sa sugges-tion ? Sans doute, mais elles sont partielles. Cette expérience est plutôt une façon d’appréhender la photographie ethnographique. Et d’expérimenter des concepts tels que le récit photoethnographique comme procédé d’uti-lisation de la photographie dans une recherche en sciences sociales et comme forme complexifiée d’élaborer une ethnographie visuelle. C’était aussi l’occasion d’approfondir et de relativiser dans un dispositif expé-rimental la notion de punctum de Roland Barthes. À cette notion nous avons ajouté deux hypothétiques formes dérivées : le punctum banalisé (en tant qu’outil d’essentialisation pour construire une typologie) et le punctum spectral (ce qui apparaît en filigrane). L’influence de Roland Barthes a aussi été importante quant au champ lexical du théâtre utilisé pour décrire le dispositif expérimental. C’est un champ lexical auquel il fait beaucoup recours dans son analyse synchronique de l’actualité française, Mythologies.
Pour conclure, nous aimerions citer un passant. Au moment où nous détachions le vélo, il a lancé : « C’est une bonne idée ! ». À quoi faisait-il référence ? À notre supposition de suggestion de la mort ? Ou à une campagne de la prévention routière ? Toute notre démarche est alors à remettre en question et un nouvel angle d’interprétation des photogra-phies est possible. À quel point les campagnes publicitaires influent sur les représentations visuelles et l’imaginaire des gens ? Après tout, est-ce que les passants percevaient tous une représentation de la mort ? L’objet lui-même n’est-il pas une aporie visuelle ?
« Or, aucune de ces photographies, trop habiles, ne nous atteint. » (Barthes, 1957 : 119)
104
NOTES
1. « Une photographie peut être l’objet de trois pratiques (ou trois émotions, ou trois intentions) : faire, subir, regarder. » (Barthes, 1980 : 20)
2. « Le récit photoethnographique se présente sous la forme d’une série de photos, en relation les unes avec les autres et qui composent une séquence d’informations visuelles. Celles-ci peuvent être l’objet du seul regard ; aucun texte intercalé ne
doit détourner l’attention du lecteur/spectateur. Cette méthode est envisagée comme une sorte d’enrichissement des récits anthropologiques, et comme un « don » à l’égard des personnes rencontrées sur le terrain d’enquête. » (Achutti, 2007 : 112) Nous utiliserons ici le mot de photoethnographie en italique, pour souligner son utilisation expérimentale.
105
RÉFÉRENCES
Achutti Luiz Eduardo Robinson, 2004, L’homme sur la photo, manuel de photoethnographie, Paris, Téraèdre.Achutti Luiz Eduardo Robinson, 2007, « Photoethnographie. Dans les coulisses de la BNF », in Ethnologie
française 2007/1, Tome XXXVII, p. 111-116.Aries Philippe, 1982, La mort aujourd’hui, Paris, Rivages.Aries Philippe, 1977, L’homme devant la mort, Paris, Seuil.Barthes Roland, 1980, La Chambre Claire, note sur la photographie, Paris, Les Cahiers du Cinéma, Galli-
mard, Seuil.Barthes Roland, 1957, Mythologies, Paris, Éditions du Seuil.Baussant Michèle, 2007, « Penser les mémoires », in Ethnologie française 2007/3, Tome XXXVII, p. 389-
394.Bourdieu Pierre (dir.), 1965, Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Les Éditions
de Minuit.Clavandier Gaëlle, 2004, La mort collective, Pour une sociologie des catastrophes, Paris, CNRS Éditions.Conord Sylvie, 2007, « Usages et fonctions de la photographie », in Ethnologie française 2007/1, Tome
XXXVII, p. 11-22.Ferreol Gilles et al, 2004, Dictionnaire de Sociologie, Paris, Armand Colin.Geslin Philippe, 2002, « Les formes sociales d’appropriations des objets techniques, ou le paradigme
anthropotechnologique », in ethnologie.org, Numéro 1 – [en ligne]. http://ethnographiques.org/Le Breton David, 2004, Les passions ordinaires, Anthropologie des émotions, Paris, Payot et Rivages.Legros Patrick et Herbé Carine, 2006, La mort au quotidien, Contribution à une sociologie de l’imaginaire de la
mort et du deuil, Paris, Éditions Erès.Maresca Sylvain, 1997, La Photographie : Un miroir des sciences sociales, Paris, L’Harmattan.Revel Jacques, 1996, « Micro-analyse et construction du social », in Jacques Revel (ed.), Jeux d’échelle. La
micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Seuil, p. 71-94.Spinelli Luciano, 2007, « Techniques visuelles dans une enquête qualitative de terrain », in Sociétés
2007/2, N° 96, p. 77-89.Venault Philippe, 1992, Histoire de voir, Une initiation à l’histoire de la photographie, (documentaire vidéo),
Centre National de la Photo.







































!["Un filosofo mancato" Aporie della concezione plotiniana della natura ["A Philosopher manqué". On Some Difficulties in Plotinus' Doctrine of Nature]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63240d803c19cb2bd106ce51/un-filosofo-mancato-aporie-della-concezione-plotiniana-della-natura-a-philosopher.jpg)
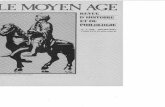



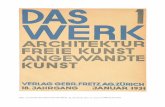
![Saillance visuelle des maillages 3D par patches locaux adaptatifs [Anass Nouri - Christophe Charrier - Olivier Lézoray] (Conférence Reims-Image, 2014, France)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632364ad48d448ffa006a732/saillance-visuelle-des-maillages-3d-par-patches-locaux-adaptatifs-anass-nouri-.jpg)

