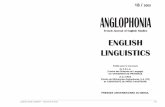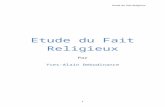« Saint Odilon devant la mort. Sur quelques données implicites du comportement religieux au XIe...
-
Upload
ephe-sorbonne -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of « Saint Odilon devant la mort. Sur quelques données implicites du comportement religieux au XIe...
LE ENreEREVUN
I)'HISTOIREETDNPHII/OIOGIEN" 2. U)90. TRIMESTRIELTOME XCW (f série, tome 4)
tue équestre d'un roi Carolingien.
Saint-Odilon devant la mort.Sur quelques données implicites du comPortement
religieux aû 11' siècle
Le récit de la mort a'ôaiton de Cluny par ]otsuald est long et détaillé (1);
il decrit soigneusement toutes les précautions à prendre dans les momentsqui précèdent la mort, depuis les premiers assauts de la maladie jusqu'à sondénouement. C'est une page classique de spiritualité clunisienne, dont nousne nous proposons pas d'épuiser ici toute la richesse. Plusieurs lectures ensont possibles. L'historien des rites et des coutumes monastiques (2) peutavec profit comparer le déroulement de cet événement rapporté fidèlementpar un témoin, jotsuald, avec des textes normatifs clunisiens, dont l'étude a
été entreprise depuis longtemps (3). Bien que la confrontation de deux typesde sources soit enrichissante, cette lecture ne sera pas la nôtre : tout en nelaissant jamais de côté le contexte spirituel de ce passage, nous aimerionsutiliser le texte en privilégiant son autonomie et sa cohérence interne. Endécrivant si prfusément les derniers instants d'un homme, d'un individuréputé saint de son vivant, la <vita Odilonis> permet d'analyser lareprésentation mentale qu'un moine peut se faire de la mort. (4) Mieux, ellepermet de savoir, au moins dans une certaine mesure, comment l'aborder etla rendre bonne. Involontairement, elle donne des recettes révélatrices d'uneconception du monde et plus proches peut€tre de Ia réalité vécue que les
coutumiers. L'étude du texte doit donc déboucher sur une sorte de
(1) Nous avons utilisé la plus ancienne vie d'Odilon, Édigee par le moine
Jotsuald entre 1049 et 1053, qui constitue le témoignage le plus fiable des derniersmoments du saint. Edition dans J.P. Mrcue, PatrologieIatine,CXLU, 897.944. Le récitde la mort d'Odilon se trouve aux colonnes 909-912. Sur Odilory on consultera L.Corq Saint Oâiton, abbé de Cluny de 994 à 7A49, Moulins, 1949, et surtout J. Hount-nçSaint Odilon abbé ile Cluny, Louvain, 1964.
(2) Voir Dom L. Goucauo : La mort du moine, Anciennes coutumæ claustrales,
Ligug4 1930,p. 69-95.
(3) Bien qu'aucune synthèse récente ne soit disponible.(4) Ici comme dans tout ce travail, c'est d'abord d.e la mentalité de Jotsuald, et
non d'Odilon, qu'il est question.
228 P. HENRIET
phénoménologie du comportement religieux. Bien que fragmentaire cartributaire de quelques colonnes de la patrologielatine, elleinvite à poserdesquestions essentielles :
D'abord, quelle est la part de la morale dans le bilan d'une vie ? Il s'agit desavoir ce qu'Odilon privilégie avant de se présenter devant son créateur : lebilan d'une vie pieuse,et chrétienne, ou ltensemble des rites qui encadrent lepassage d'un monde à l'autre ?
Ensuite, y-a-t-il un rapport direct et bien établi par le texte entre ces riteset une foi intériorisée ou sont-ils efficaces par eux-mêmes ? C'est le graveproblème de la part magique du comportement religieux qui est ainsi posé.Ce dernier point doit nous inciter à comparer la vie d'Odilon avec d'autressources narratives comn€ les recueils de miracles.
fnfin,la lecturedu texte montreà l'évidence la place centrale occu@parun ensemble de pratiques qu'on peut regrouper de façon très vague sous leterme de prière. il faufse demander pouiquoi. Quet est le rôle de ies prières,à qui s'adressentellet quelles formes revêtent-elles, quand, enfin, ont-elleslieu ? Cet examen ne peut-il fournir quelques informations sur le rôle de laparole, entendue ici au sens général de manifestation orale, dans ta piétémédiévale?N'ya-t-ilpaslàaussiuneinvitationàreconsidérerattentivementle rôle de la liturgie ? (5)
Sur l'ensemble de la Vita Odilonis, un seul des deux livres correspondexactement au titre, puisque I'autre est consacré aux miracles survenus posfmortem.La mort de l' abbé occupe le quatorzième des d ix-sept chapitres, alorsque le seizième et le dix-septième traitent déià de visions postérieures.L'importance accordée par l'auteur à ce moment est exceptionnelle : sur lesquatorze colonnes consacrées à la vie d'Odilon, trois et demi s'occupent dela seule description de sa mort, soit environ un quart. Si l'on sait que tous lespremiers chapitres ne font que décrire assez conventionnellement lesprincipales vertus du saint (6) sans constituer un véritable récit, il fautadmettre que pour |otsuald, la mort d'Odilon est l'événement le plusimportant de sa vie. Il n'y a pas là obligation ou nécessité pour l'hagiographe
(5) Les pratiques liturgiques ne sont pas toujours dominantes dans ce texte. Leproblème suivant ne se pose pas moins : y a-t-il différence de nature ou seulement dedegré entre les comportements étroitement ritualisés, dits liturgiques, et ceu&appar€mment plus spontanés, qu'on a coutume d'englober sous le terme de "religionpopulaire> ? C'est aussi dans cette optique qu'on peut lire les nombreux travauxportant sur la liturgie clunisienne, en particulier P. ScHurz, La liturgie de Cluny,Spiritwlitàcluniacense,Todi,7960,p.83-99;N. Htr.rr, Cluny under Saint Hugh(7049-llûg),chapitre III, Londres,1967,p.7W-123; R. Fot-2, PierreleVénérableet la liturgie,Pierre Abélard-Piene le Vénérabte, CNR$ Paris, 7975, p.1,43-1.63.
(6) "Prudenti4 justiti4 fortitudo et temperantia>, P.L. CXLII,901.
SAII{
médiéval et toutes les vserait peut-être pas inutirôle clé accordé à la morune signification particrpas un exemple isolé (8)
d'un an avant l'échéanc
Croyant la mort très ptextene laisse aucun dorut ibi sub t ant o rum apo s t olinaotis lnbuerat. (9)
Il reçoit durant sonClément II et de l'archeviOdilon doit quitter Rompresque un an une vie asaggrave vraisemblableroccupent une part impo:
(7) Ainsilavied'Odorpar Syrus (A.A.S.S. maiCependant la comparaison i
communauté de pensée colprise en compte du livre II dde Saint Hugues racontéeenviron 15Vo,mais avec unde Saint Hugues abbê de CIut
Chez Hildebert de I2A Vo) avec un nombre de uRainaud deVézelaydit peuque deux exemples, Roberquelques phrases, d'ailleur:A.A.S.S., awil lil, p.32a). Udont la vie fut écrite entrejotsuald, ne voit sa mort guToulrr, Dom Calmet, Histsit
(8) M. LauwERs, Lâ modu Haut Moyen-Âge,Le lv'[t
des derniers instants dans ]'estimée. Comme pour Odmoyenne 25% du récit, parAge qui semble finalemensaintcté en Occident aux derm
(9) P.L. CXLII,909.(10)
"Jeiuniis, orationibr
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT 229
m&iéval et toutes les vies ne présentent pas cette caractéristique (7). Il neserait peut-être pas inutile de savoir pourquoi, et l'on peut se demander si lerôle clé accordé à la mort dans les récrits proches du milieu clunisien n'a pasune signification particulière. Quoiqu'il en soit la Vita Odilonrs ne constituepas un exemple isolé (8) et nous met en présence d'un récit qui débute plusd'un an avant l'échéance fatale.
Croyant Ia mort très proche, Odilon entreprend un pèlerinage à Rome. Letexte ne laisse aucun doute : le saint homme espère y mourir : Eo wto, ea spe,
utibisub tantorumapostolorumprotectionedebitummortisexsolaeret,sicutsanrpninaotis lwbuerat. (9)
Il reçoit durant son séiour de fréquentes visites, dont celles du papeClément II et de l'archevêque d'Amalfi. Contre son espoir, après quatre mois,
" Odilon doit quitter Rome pour rentrer vivant à Cluny. Il y pratique durantpresque un an une vie ascétique à la limite de ses capacités physiques, ce quiaggrave vraisemblablement sa maladie. (10) Sermons et conseils pieuxoccupent une part importante de son activité. il annonce sa mort prochaine
(7) Ainsi la vie d'Odon par Jean de Salerne (P.L. CXXXII, 43-86), celle de Maïeulpar Syrus (A.A.S.S. mai II, 668-6U) s'étendent nettement moins sur le sujet.Cependant la comparaison avec les vies du successeurd'Odilory Hugues, montre unecommunauté de pensée concernant la place accordée à la mort. Si l'on admet la non-priseencomptedu livrell chezJotsuald,lamortoccupeenviron25 % durécit.Lamortde Saint Hugues racontée par le moine Gilon donne un pourcentage inférieur,environ "LS Eo,mais avec un nombre de mots sensiblement égal (fi. A. Unvwuax,Viede Saint Hugues abbê de Cluny, Solesmes,1888, p.57441,8).
Chez H ild ebert de Lavard i n (P. L. CLIX, 857 39 4) le chiffre est voisin (presque
20 %) avec un nombre de mots légèrement supérieur. Toujours à prropos d'Hugues,Rainaud deVézelaydit peudechoses. Hors du domaineclunisien etpourne prendreque deux exemples, Robert, abbé de la Chaise-Deu mort en 1467 n'a droit qu'àquelques phrases, d'ailleurs intéressantes,danslaviedeMarbode (VitaSanctiRoberti,
A.A.S.S., awil III, p.324). Un évêque comme Saint Gérard deToul, mort en 994 maisdont la vie fut écrite entre 1031 et 1M8 soit pr€sque en même temps que celle dejotsuald, ne voit sa mort que très peu détaillée (éd.
"Vie de Saint Gérard évêque deTouln, Dom Calmet, Histoire de la l-onaine, T éd., t.I., preuves, col. 174-208).
(8) M. Lauwsns, La mort et le corps des saints. La scène de la mort dans les oitaedu Haut Moyen-Âge,Ic Moyen-Age, t. 94, 1988, p. 21"50 , vient de rappeler la placedes derniers instants dans l'hagiographie du Haut Moyen-Age place iusque là sous-estimée. Comme pour Odilon, les vies des VII" et VIII" siècles y consacrent enmoyenne 25 % du recit, parfois jusqu'à un tiers, voire la moitié. Pour le Bas Moyen-Age qui semble finalement l'héritier d'ufie longue tradition, voir A. Ytuanw, Lasainteté en Occident aux derniers siècbs du moyenâge, Paris-Rome,7987, p. 59M00.
(9) P.L. CXLII,909.(10)
"Jejuniis, orationibus et vigiliis vehementer afflixit>. Idem.
2n P. HENRIET
(11). Dans cette deuxième phase du récit, le pèlerinage romain semble avoirpour équivalent la visite, plus modeste, des abbayes et prieurés clunisiens dela région. L'auteur ne donne guère de précisions d'ordre géographique (12)
et parle desmorusteriasua. Cette fois le but premier est l'exhortation. Odilon
ioue le rôle d'un prédicateur itinérant et ne s'adresse pas uniquement auxmoines clunisiens. C'estau coursdecette tournée, à Souvigny, qu'il rechute.
|otsuald ne présente pas l'arrêt définitif en ce prieuré comme un choixdéliberé du mourant. C'est donc une coïncidence si Souvigny a déià vu ladisparition d'un autre grand abtÉ, Maïeul, et conserve sa sepulture. Onnotera tout de même le bonheur de ce hasard pour notre hagiographe, hasardqui prolonge en effet la similitude avec le premier pèlerinage : dans le cas
d'une mort romaine, Odilon eût été enterré au côté des saints apôtres Pierreet Paul. Dans le cadre un peu plus modeste de la Gaule, il le sera auprès deSaint Maïeul. Il y a bien un parallèle entre les deux voyages, et les lieux de lamort ne sont pas indifférents. Ils sont signes divins, favorables au mort. Dieun'a pas autorisé, à la grande déception du malade, une fin romaine, mais ilaccorde le prieuré de Souvign|, haut lieu du monachisme; c'est un indice dela sainteté d'Odilon.
Ses souffrances le reprennent là, à l'approche des fêtes de NcËl. Une seriede rites préparant le décès sont alors accomplis : les moines défilent avec despalmes et récitent une profession de foi audessus du corps du malade; lacommunion lui est donnée. (13) Il est à noter que parallèlement aux prièresdont il sera question plusloin, Odilonportecontre Satan une terribleattaqueverbale quasi rituelle, dont |otsuald reproduit la teneur Par le moyen d'undiscours direct. Dans un texte où ce proc&é est quasiment absent, le choixrhétorique prend une portee religieuse. II y a là un effet de style, sans doute,mais aisément iustifiable. C'est pour fotsuald l'occasion de prononcer unenouvelle fois cette apostrophe au démon et de lui rendre ainsi sa vigueuroriginelle. Le petit texte en question prend valeur de modèle. Conformémentarix textes normatifs, Odilon se rend ensuite au chapitre où il prie et fait unsennon, l'un des meilleurs de sa vie selon son biographe. Dan s la petite église
(11) "Sui corporis depositionem imminere praedixit". Idem.
(12) Pour une tentative de restitution du parcours, on pourra consulter J.
Hount-mç op. cit., p. 114-115.
(13) La communion ne joue iamais dans ce texte un rôle déterminant. Le textenarratif minore l'importance des sacrements par rapport aux coutumiers, comme le
montre ce passage des coutumes de Farfa sur la communion : <mox ut anima adexitum propinquasse visa fuerit, communicandus est homo ipse corpore et sangueDomini, etiamsi ipsa die commederit, quia ipsa communio erit ei ad adjutoriumcontra diabolum et insidia ejus". Les coutumes de Farfa sont strictementcontemporaines de la dernière partie de l'abbatiat d'Odilon. Passage cité d'après lanouvelle édition de K. Hat-uruceç Liber tramitis aeai Odilonis abbatis,l95/1,10-15,Siegburg,1980.
SAI
consacrée à Marie oùbénédictions. C'est copasser Ia plus grandedébordantedu rrrouraninquiétude devant Ia rndoute due à Ia craintrcoutume chez les sainll'imminence de sa rnorlne détaille pas pour la
C'est l'occasion d'urL'analogie est cette foMai'eul : l'abbé mourraami Cuillaume, abbépréparatifs de la mort e
toutes les directives n(parfums, etc.). Qu'on n
pour Ie monde terestrqu'Odilon se désintéreschapitre et à la volontéconcerne plus. I-a raisosemble claire : il n'y a pOdilon avant sa <vocatipar les frères au cada'pratiques religieuses etmarque pas le terme. Cocorrectement exécutes c
La veillede la circoncfois tous les préparatiftcondamnation du démoutile qu'au moment où ilque prévu, il faut le ripéséries de rites estici d'urà l'affaire. En fait,l'acconfatidique sembleêtre la rdes frères devant le nexhortations paternellessaint homme entonnel'exemple, il assure lui-n
(14) "Diem suae vocatir
connaissance anticipo d"premières hagiographies lap.183-210.
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT
consacrfu à Marie où il se trouve ensuite, Odilon èhante et donne desbénédictions. C'est couché dans une litière, devant l'autel, qu'il semblepasser Ia plus grande partie du temps qui lui reste. Derrière I'activitédébordante du mourant le recit laisse apparaître de façon voilee une certaineinquiétude devant la mort, inquiétude dont on verra plus loin qu'elle est sansdoute due à Ia crainte d'une préparation insuffisante. Comme il est decoutume chez les saints, l'abbé de Cluny annonce ensuite avec assuranc€l'imminence de sa mort, qui lui a été communiquee d'une façon que l'auteurne détaille pas pour la fête de la Circoncision (1"'ianvier) (14).
C'est l'occasion d'un nouveau parallèle avec un prédécesseur d'Odilon.L'analogie est cette fois-ci temporelle et non plus spatiale conune avecMai'eul : l'abtÉ mourra pour Ia fête de la circoncision du Christ corrune sonami Guillaume, abbe de Diion. L'importance accordée par Odilon auxpréparatifs de la mort explique qu'il donne soigneusement et avec autoritétoutes les directives nécessaires au soin de son corps défunt (sépulture,parfums, etc.). Qu'on n'interprète pas ce souci conune un résidu d'intérêtpour le monde terrestre qu'il est sur le point de quitter. La preuve en estqu'Odilon se désintéresse totalement de sa succession eten remet le soin..auchapitre et à la volonté divine>, autre façon de dire que ce problème ne leconceme plus. Ia raison de l'intérêt que le malade porte à son colps mortsemble claire : il n'y a pas de différence entre les dernières prières dites parOdilon avant sa <vocatio", son rappel à Dieu, et les premiers soins accordéspar les frères au cadavre. La mort se situe au cæur d'un ensemble depratiques religieuses et de rites qui doivent a$surer le salut d'Odilon et n'enmarque pas le terme. Comment celui-ci pourrait-il être plus sûr qu'ils serontcorrectement exécutés qu'en les orchestrant tous avant de mourir ?
I"a veille de la circoncision du Christ, le mourant accomplit une deuxièmefois tous les préparatifs déià decrits : communion, adoration de la croix,condamnation du démon, profession de foi. Tout ce rituel semble donc n'êtreutile qu'au moment où il est accompli puisque,la mort intervenant plus tardque prévu, il faut le répéter dans son intégralité. La durée qui sépare les deuxséries de rites est ici d'une semaine, mais le temps ne change sans doute rienà l'affaire. En fait, l'accomplissement de tous ces gestes juste avant le momentfatidique semble être la meilleure garantie d'efficacité. Vient ensuite le défilédes frères devant le mourant. Nouveaux conseils d'Odilon, nouvellesexhortations paternelles. Porté pour les vêpres devant l'autel de Marie, lesaint homme entonne encore une dernière fois les psaumes. Donnantl'exemple, il assure lui-même le parfait respect des règles de la psalmodie et
(14) "Diem suae vocationis pro certo téstatur>. P.L. CXLII,909. Le thème de la
connaissance anticip* d" la mort est ancien. Voir P. Boct tou, [a mort dans lespremières hagiographies latines,Lesentiment delamwt aumoyenâge,Montréal, \989,p.183-210.
231
232 P. HENRIET
rePrend les frères négligents. Alors que la nuit tombe, une nouvelle attaquele terrasse. Suivant un rite monastique classique, son corps est posé sur uncilice, lui même installé sur des cendres à même le sol (15). Après avoir rendugrâce à Dieu et s'être assuré que l'assemblée des frères est au complet, Odilonfait une dernière prière, silencieuse, et meurt. Son corps ne présente aucunetrace de désordre physique ou mental. Viennent enfin les soins ordonnés parlui de son vivant. Le récit s'achève après avoir mentionné l'enterrement, enprésence d'une immense foule secourâe par les pleurs.
Comme une analyse seulement superficielle le laisse voir, le récit de lamort du grand moine clunisien n'est pas composé sans soin; jamais l'auteurne se laisse mener par les événements. L'ensemble est rigoureusementconstruit et aucune précision n'est fortuite. La mort d'Odilon ne doit rien auhasard. Elle s'inrrit dans le cadre infini des desseins divins, auxquels Odilona aecès puisqu'il peut la prédire avec exactitude, bien que tardivement etaprès avoir perdu I'espoir de finir ses jours à Rome. Il semble que tout un jeude correspondances permette de retirer à ce décès son caractère individuel etpurement historique pour lui permettre d'occuper sa place reelle. C'est parces correspondances qu'Odilon acquiert sa grandeur, c'est par elles qu'ildevient partie prenante de l'Histoire conçue comme dévoilement de lavolonté divine. Odilon meurt au bon moment, c'est-à-dire lors d'une fêteimportante qui a déjà vu la mort de l'un de ses saints amis, et au bon endroit,dans une abbaye où est enterré son prédecesseur. Le temps et l'espacesanctifient le plus grave moment de sa vie, sa mort. Ces constatationsmontrent en partie comment jotsuald envisage le salut humain. Les preuvesde celui-ci sont là plus que dans une vie menée selon les préceptes chrétiens,vie dont il n'est pratiquement pas question au moment de dresser le biland'une existence. Plus que les critères moraux, étrangement absents de cechapitre XlV, ce sont les signes environnant la mort qui permettent deconnaître avec une quasi-certitude l'issue de celle-ci. Voilà qui invite às'interroger sur la conception de la mort au milieu du )Ou siecle et à tenter dedélimiter la part de la recette et celle des convictions morales et spirituelles,pour comprendre dans quelle mesure le comportement religieux est pénétréd'attitudes magiques.
Entre le moment où il est saisi par la maladie et sa dernière prière, Odilonchante, prie et serrnonne. Il ne reste pratiquement jamais silencieux. Sesinterventions sont de trois types : serrnons, prières, activité liturgique.
Les sermons d'Odilon sont mentionnés clairement à quatre reprises dansce seul passage de la mort. La première fois, Odilon est revenu de Rome mais
(15) Pratique souvent attestée. Le texte du coutumier de Farfa reprend presquemot pour mot une tradition attestée dans la vie de Saint Martin par Sulpice Sévère :
"Quia filius Christiani non debet migrare nisi in cinere et cilicio, sicut jam in multisexemplis sanctorum experti sumusD. Voir sur ce sujet L. Goucauo, op. cit., p. 80.
SA]N
n'a pas encore entamé s;peu de détails : fratræinstruxit, et oelocerfl sui cr
Il faut noter le succèsaux moines faisant le vobut éducatif plus que sa
phrase, à l'annonce de lade l'orateur et son actirtsitue au lendemain de Ir
clunisiennes et au débuthème,la fête de Noël quréservés aux moines :
...de die in diem pogdenuntiaret. .. (17)
Selon ]otsuald, Ia prporteuse ni d'un contetconseils précisde sa part.qu'ensuite qu'il tombe ndolores simul ad aitalia cot
Le sermon le plus impchapitre et au milieu desparle avec icie et mieuxfætioe et luculenter ut nuru(1e)
Ce passage semble o<
Odilon ne la craint éridpourtant la fin de la phrtantae fæ tiaitatis inter æs e
Le motclé est sans douprésent aux fêtes et la perqui vont se dérouier ,
préoccupation d'Odilon
(16; p.1. CXLII,909.(17) Idem.
(18') Idem.
(19) P.L. CXLII,91O. H. Pquelques sources des Pays &289, p. 161-174, donne qu,miraculeusement à eux pou:Ainsi Poppon de Stavelot (f
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT 233
nia pas encore entamé sa tournée. Il est donc à Cluny. |otsuald ne donne quepeu de détails : fratres ibi manentes et supentenientes piis exhortationibusirætruxit, et aeloceru sui corporis dqositiottent imminerepraedixit (16).
Il faut noter le succès probable de ces exhortations, qui Jadressent aussiaux moines faisant le voyage à Cluny. Cette première série de sermons a unbut éducatif plus que salvateur. Elle est cependant associée, dans la mêmephrase, à l'annonce de la mort : Ie narrateur établit donc un lien entre la mortde l'orateur et son activité de prrâdicateur. I-a deuxième série de sermons sesitue au lendemain de la tournée itinérante d'Odilon dans ses possessionsclunisiennes et au début de son sépur à Souvigny. Le texte en indique lethème,la fête de Noël qui approche. Les serrnons sont surtout publics et nonréservés aux moines : .
...de die in diem populo tantae fætiaitatis gaudia in sua semone publice"denuntiaret. .. (17)
Selon jotsuald, Ia pr&ication est quotidienne. Elle n'est cependantporteuse ni d'un contenu particulier concernant l'homme Odilon ni deconseils précis de sa part. L'abtÉ est alors relativement bien portant et ce n'estqu'ensuite qu'il tombe malade : subito iIIi sui diuturni cruciatus, et antiquisimida:laræ simul ad oitalia congregantur... (78)
Le sermon le plus important est le troisième, prononcé à Souvigny lors duchapitre et au milieu des frères. Après une prière effectuee à genoux, Odilonparle avec irie et mieux qu'il ne l'a iamais fait de son vivant: Post haec tam
fætioeetluculenterutnunquammeliusanteinaitasuafecerat,sermonemperorat...(19)
Ce passage semble occuper un sorrunet dans la préparation à la mort.Odilon ne la craint évidemment pas, raison pour laquelle il est luculus, etpourtant la fin de la phrase mentionne son anxiété : deinde cum illis gaudiistantae fætiaitatis interæse sollicitus procurat.
Le mot clé est sans doute interesse,qui traduit Ia volonté du mourant d'êtreprésent aux fêtes et la peur de ne pas assister aux manifestations liturgiquesqui vont se dérouler ou de ne pouvoir y participer. La principalepréoccupation d'Odilon concerne sa préparation, c'est-à-dire un ensemble
(16) P.L. CXLII,909.(77) Idem.
(18) Idem.
(19) P.L. CXLII,910. H. Pra-reu.q La mort précieuse. La mort des moines d'aprèsquelques sources des Pays Bas du Sud, Reane Mabillon, no 288, 7982,p. 151-160, et n'289, p. 767-174, donne quelques exemples similaires d'abbés qui reviennentmiraculeusement à eux pour faire de magnifiques sermons juste avant de mourir.Ainsi Poppon de Stavelot (+ 1048) ou Gossuin d'Anchin (t 1166).
narù,r .-.hJluJllihllliillllr,,!,
2U P. HENRIET
d'actes qui assureront son salut : pour cette raison, leur accomplissement nepeut que le rendre pyeux. Au contraire, dans l'intervalle qui les sépare, ilrisque de mourir dans un état d'impréparation dangereux. Quelques lignesplus loin fotsuald ajoute : erat certe sollicitus aalde, ne minus imparatum se
inoeniret jam imminens diairue oocationis exitus (2A).
On ne peut être plus clair. L'activité sermonnante et prédicatrice fait partied'un ensemble de dispositions précises. Dans la mesure où sa finalité moralen'est pas très nettement marquée, il semble qu'elle ait le même rôle qu'un ritecodifié. [a mention par l'auteur de la perfection formelle d'un sermonrenforce cette idee. Le dernier prêche d'Odilon se place dans les momentsprécédant sa mort, bien qu'il ne s'agisse pas de sa dernière action. Il s'agitcette fois de <paternelles exhortations et de bénédictions>>, adressées auxfrères présents. Ia substance du discours Ie concerne directement : l.It deaocetione sua solliciti sint ailmonetur (21').
On peut discerner dans ces quatre passages une évolution vers la mortprochaine, toupurs plus présente. Si le deuxième sermon, plus moral que lesautres, semble n'avoir que ce rôle, il faut relever qu'il est aussi le seulprononcé hors du milieu monastique et sans doute celui où Odilon jouit dela meilleure santé. Le troisième, doté de toutes les qualités, est comme on l'avu un point culminant du livre. On note bien une certaine retombée avec lequatrième, assez proche du premier, mais la perfection formelle qui luimanque se manifeste immédiatement après dans l'activité liturgique dumourant. En ce sens il y a une continuité certaine dans l'activité d'Odilon àSouvigny. En schématisantceque le texte suggère, on ne peut s'empêcherdefaire la constatation que l'abbé de Cluny parle mieux à mesure que son étatde santé empire. Il ne se contente plus de sermons classiques et éducatifs,mais insère ses interventions dans le cadre d'une préparation à sa propremort. Les sermons sont uneconséquencede son prochain décès et traitentdecelui-ci. La predication, qui faisait d'Odilon un grand orateur jusqu'au termede sa vie, devient une efficace ascèse personnelle.
Elle n'est pas la seule. Prières et chants liturgiques relèvent de la mêmeconception. Dans l'épisode étudié, |otsuald mentionne huit fois les prièresd'Odilon, toutes n'ayant pas une importance égale. La premièreinterrogation concerne la finalité deces prières. Doit-onyvoir une pénitencePersonnelle, des demandes visant à être exaucrâes ou une glorification deDieu sans autre but ? ]otsuald donne au début du chapitre quelques
(20) P.L. XLil,910. DomJean Lecr-eRce a bien mis en valeur l'aspect joyeux de lamort monastique, sans toutefois insister sur cette angoisse proc&urière, oulituqgique si l'on préfère. Cf. de cet auteur, La mort d'après la tradition menastiquedu moyen -àge, Studia missionalia, t . 3L ,1982 , p .71,-77 et aussi La ioie de mourir selonBernard de Clairva ux, Dies illa . Death in tlu middb ages, Liverpool, 1984, p . 195-207 .
(21) P.L. CXLII,9O9.
SAf\
précisions sur sa conc€tin quantum infirmitas cu(2D.
L'association d'expre(23) et le verbe choisi poI-a prière est un exercicela maladie. Elle est aussi(24). Pourtant, elle ne gprecise. Odilon se mortiqu'il porte un rugueuxépreuves tout en gardandes fautes qu'il a comndoute pour Odilon un psur lui, et I'invariabilitémobile tout aussi imporlest, aux yeux de |otsualdpersonnel mais affirme iIe pardon des péchés cocomme Ia toute puissand'importance, car s'il estavant l'aspect personneldéterminante pour son s
de commenter tous l* p"exemplaire de certains s'croit au bord de la mortrenouvelee. Selon une c(croix qu'il ne quitte pasvention où le mourant,<glorifie la majesté dir.i nrII n'est pas indifférent detuinomin rs (25) appelle urà voix très haute. I^a préc
(22) Idem.
(23) Jotsuald utiiise à lserviteurs deDieu "in seditirVI,5) et d"autres écrits nâr-jejunium".
(24; Putrr le chapitre )Ol(... quam duras i
sibiadscivit... so
caro hoc tolerare(25) P.L. CXLII,910.
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT
précisions sur sa conception de Ia prière. Au retour de Rome en effet, Oditonin quantum infirmitas concessit, jSuniis, orationibus et aigiliis oehementu afflixit(22).
L'association d'expressions bibliques n'est sans doute pas faite au hasard(23) et le verbe choisi pourlier les veilles, les ieûnes et les prières estafflixue.La prière est un exercice physique difficile, rendu plus éprouvant encore parla maladie. Elle est aussi mortification, ce que l'auteura dép laissé entendre(24). Pourtant, elle ne semble pas faire partie d'une conduite pénitentielleprécise. Odilon se mortifie en priant iusqu'à l'épuisement de la même façonqu'il porte un rugueux cilice, pour prouver à Dieu qu'il supporte les piresépreuves tout en gardant intacte sa confiance en lui. Certes, le désir d'expierdes fautes qu'il a commises ou dont il se sent responsable constitue sansdoute pour bditott un puissaht stimulant : l'accent n'est cependant pas missur lui, et l'invariabilité de la foi, dont il nous faudra reparler, semble unmobile tout aussi important. Avant d'être une tentative d'expiation la prièreest, aux yeux de lotsuald, une preuve. En conséquence son contenu n'est paspersonnel mais affirme invariablement la gloire de Dieu. Plus que d'obténirle pardon des péchés commis, il s'agit de marteler des réalités supérieurescomme la toute puissance divine ou l'existence du démon. La nuance estd'importance, car s'il est une periode de sa vie où Odilon aurait pu mettre enavant I'aspect personnel et moral de ses prières c'est bien celle de son agonie,déterminante pour son salut. Il ne semble jamais le faire. Il serait fastidieuxde commenter tous les passages illustrant ce trait de mentalité, mais la valeurexemplaire de certains s'impose. Odilon fait sa troisième prière alors qu'il secroit au bord de la mort, lors d'une première série de rites qui devra êtrerenouvelee. Selon une coutume bien établie le moine se fait présenter unecroix qu'il ne quitte pas des yeux. C'est le début d'une déchirante inter-vention où le mourant, dans un même mouvement, confesse ses pechés,<glorifie la majesté divine> et <invoque>> son nom, sa passion, sa rédemption.II n'est pas indifférent de considérer le vocabulaire employé : quûeircocatiatui nomin s (25) appelle un commentaire. Une inaocafio est orale et prononcéeà voix très haute. La précision avec laquelle jotsuald donne le contenu de la
(22\ Idem.
(23) Jotsuald utilise à la fois Saint Paul (les fidèles doivent se montrer lesserviteurs de Dieu "in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in jejuniis... 2 CorinthiensVI,5) et d"autres écrits néo-testamentaires dont Mathieu XVII, 20 : "pro orationes etjejunium".
(24) Dans le chapitre XII :
<... quam duras corporis poenas in jejuniis, in vigiliis, in orationibus ipsesibi adscivit.. . solo deo teste, membra sua ita damnaverat, ut vix humanacaro hoc tolerare potuerib. P.L. CXLI[,907.
(25) P.L. CXLII,910.
235
2% P. HENRTET SAINT.
c on tr ac tionibus enim innEEt ut oerbis ipsius loqtmr :.
Au mot <invocatio>> \rl'interventi on, correspoftL'auteur nous fait part d
Surtout, il prend soin d
irrcrryar e. Les autoritairesqu'il ne s'agit pas là de c
concernant la prière est liédonne quelques précisiohaute; elles ne plongent pne lui permettent pas dsilencieuse intimité. Il t
bruyantes. Ainsi, de mêmon le voit, en parfaite sclameur. [.a volonté d'affiicorune dans les prières plil prend l'allure d'un crerDomini mei mecum æt quer
Ce n'est bien sûr pas leI'un des comportements lOdilon doit d'abord reporcorps. La crainte est bien I
la littérature cornme dansintéresse ici est le remèdeprière inversée, car négapossède les caractéristiqu,
(29) P.L. CXLII,910.(30) Idem.
(31) On peutcomparercEAinsi Pierre Damien s'écrie r
satellitibus suis; in adventrmaeterna noctis chaos immanelegiones, et ministri Satanae:
La crainte de factifonctionnent pourtant pas à Itexte comme l'emploi rep€tÊune prière au sens strict de dn'attend rien de Dieu, il codeviennent autonomes dansde sa Conespondance, P.L. Q(.Sterben in mittelalter, Francfor
prière, les soupirs et les gémissements qui l'accompagnent, confirment cette
impressiotr. Odilot affirme fortement sa foi, et cela de façon publiqu,e.
Iotsuald a vraisemblablement assisté à la scène. La dimension pénitentielle
de l'épisode n'est pas absente mais elle est noyée dans le flot de la prière et
des loïanges. Le mourant se confesse, ce qui ne surprend pas. L'obligation
en est attestée dans les coutumiers. L'auteur n'y accorde pourtant que peu
d,importance, ne mentionnant brièvement cette confession que pour lafondie dans l'irruption violente et bruyante qui secoue Odilon (26).L' acte de
confession, qu'unè certaine religiosité mettra en avant comme possibilité de
repentir et désir de pénitence,iemble n'avoir ici que peu d'autonomie. Ilnlàxiste que dans le cadre de prières qui le dépassent en_ importance'
L,amalgame est complété sur u.n plan formel. L'auteur semble connaître
assez bien cette confession pour qu'on puisse penser qu'elle fut faite à voix
haute.
Quaerecorilntio et confæsio delictorum(27). Odilon s'estouvertde ses péchés
pnbliq.ru*"nt, de même qu'il a prié devant les frères présents. Cela ne
sutpteta Pas : la pratique àe la cônfession privee ne naîtra q"" pllg hld,indice et ionséquèt." à la fois d'une intériorisation de la piété (28). Cet
épisode dévoile àonc les aspects essentiels de la prière odilonienne : il s'agit
dà rappeler à tous la transcendance divine et non de demander directement
.tr. p"ràon. Il serait cependant naif d'en tirer la conclusion que cette prière,est
désintéressée. Lors dè son agonie, Odilon ne Pense qu'à assurer son salut.
Tout comme les sermons, les prières font partie d'une stratégie et leur rôle est
essentiel. Il est d'éliminer toute possibilité de malentendu : le mourant
possède une foi solide. Comment la montrer mieux qu'en la clamant bien
iraut ? Cest aussi de cette façon qu'il faut comPrendre l'important anathème
proféré contre Satan imm&iatement après ce passage. On sait que |otsualdie retranscrit en discours direct, fait rarissime chez lui. Là aussi le caractère
public et oral du discours est certain, mis en relief Par un vocabulaire plus
è*pti"it" encore que d ans l' exemple précrilent. La phrase de présenta ti on est
clâire : aideres iltum, et libero clamore audires quibusdam terribilibus
(26) Il n'y aura aucune autre mention de confession, même lorsque tous les gestes
destinés à accueillir la mort et à repousser Satan seront accomplis une deuxième fois.
G. DE VALOUS rappelle pourtant que la confession publique au chapitre est sans
doute une innovatiàn clunisienne et ne se trouve pas dans la ,.Concordia regulariso(fin du X" siùle). Elle doit préc&er l'extrême onctiory dont il n'est pas question dans
la vie d'Odilon, pas plus que du lieu où se déroule cette scène. Seule la communion
est mentionnée deuf fois, brièvement. Faible rôle des sacrements... Cf. G- DEValous'
Le monachisme clunisien des origines au XV siècle,T.l, ch. IV, Paris, 7935, p- 294'298.
(27) P.L. CXLII,910.(28) Voir c. vocnç Iz péclwr et tnpnitence au Moyen-Age, Paris, 1969.
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT 237
contractionibus enim incrqare, et ut a se longe recederet imperi^alibus aerbis iubere.Et ut rserbis ipsius loquar :... (29)
Au mot <invocatio>) vu precédemment et attestant le caractère oral del'intervention, correspond exactement ici, mais dans un sens négatif, clamor.L'auteur nous fait part de son regret que nous ne l'ayons pas entendue.Surtout, il prend soin de rendre ses imprécations presque palpables :
incrqare. Les autoritaires paroles d'Odilon ont tonné. Notre conviction estqu'il ne s'agit pas là de détails stylistiques : toute la mentalité de l'auteurconcernant la prière est lieeà cette attitude. Les prières surlesquellesJotsualddonne quelques precisions sont consciencieusement prononcées à voixhaute; elles ne plongent pas leur auteur dans un dialogue avec lui-même etne lui permettent pas davantage de se rapprocher de Dieu dans unesilencieuse intimité. il sernble nécessaire qu'elles soient publiques etbruyantes. Ainsi, de même qu'on a vu Odilon crier les louanges du Seigneuron le voit, en parfaite symétrie, repousser le démon dans une violenteclameur. La volonté d'affirmer hautement et clairement sa foi est évidente icicomme dans les prières plus positives" Le contenu du discours le prouve, caril prend l'allure d'un credo : quia crux Domini mei aita mihi mors tibi. CruxDomini mei mecum est quem semper adoro, seTnper benedico etc...(30.
Ce n'est bien sûr pas le seul objet de ce discours, qui décrit certainementl'un des comportements les plus mêlés de magie du récit. Par cet anathèmeOdilon doit d'abord repousser le démon qui guette son âme au sortirde soncorps. La crainte est bien connue et a été montrée d'innombrables fois dansla littérature corrune dans l'art, tout au long du moyen-âge (31). Ce qui nousintéresse ici est le remède adopté : plus que d'anathème il faudrait parler deprière inversée, car négative, mais prière tout de même puisqu'elle enpossède les caractéristiques : louange publique et orale de Dieu.
(29) P.L. CXLII,91O.(30) Idem.
(31) On peut comparer cet épisode avec d'autres manifestations de ce sentiment.Ainsi Pierre Damien s'écrie dans une prière : "Cedant tibi teterrimus Satanas cumsatellitibus suis; in adventum tuum te comitantibus angelis contremiscat, atque inaeterna noctis chaos immane diffugiat... Confudantur igitur, et erubescant tafrareaelegiones, et ministri Satanae iter tuum impedire non audeant>.
La crainte de l'action démoniaque est la même. Les deux prières nefonctionnent pourtant pas à l'identique. Chez Pierre Damien la tonalité générale dutexte comme l'emploi répété des subjonctifs semblent indiquer un souhait très fort,une prière au sens sFict de demande. Chez Jotsuald il y a affirmation. Le mourantn'attend rien de Dieu, il compte sur le Credo pour repousser Satan. Les motsdeviennent autonomes dans l'aire du sacré. Læ passage de Pierre Damien est extraitde sa Correspondance,P.L. CXLIV, 497-498. Cité dans K. Srûnnn, Commendatio anitnae.
Sterbm in mittelalter, Francfor+, 1,976, p. 1,24.
2æ P. HENRIET
On a jusque là procédé en isolant tel ou tel épisode significatif. Unregroupement par thèmes, tenant compte des fréquences, Peut permettre de
savoir ce qui est nôrmal ou exceptionnel dans la prière odilienne. Pourchaque ligne, on a rapporté le nombre de cas relevés à celui des prières assez
circonstanciées pour fournir aux questions posées des réponses sans
ambiguité. Ainsi, on peut clairement savoir quatre fois si la prière est orale
et elle l'est dans trois cas (no 3) etc.
1. Prière à Cluny:
2. Prière à Souvigny :
3. Prière orale :
4. Prière silencieuse: '5.. Prière publique:
6. Prière privee:
7. Contenu de la prière
Pénitence, demande de pardon :
Louanges de Dieu ou condamnation de satan : 4 cas sur 5.
Plusieurs commentaires s'imposent. Le premier est d'ordregeographique. Sur les huit scènes de prière mentionnées, seule la premièreà tieu à Cluny, aucune à Rome. Certes Souvigny, où ont lieu les autres, est le
lieu central de tout l'épisode, mais les sept huitièmes de l'action ne s'ydéroulent pas. Le récit concentre donc la quasi totalité des prières (d'autantque la première mention ne donne aucun détail) dans les derniers momentsde la vie du saint : cela confirme qu'elles occupent un rôle précis dans lastratégie adoptee en vue du trépas. [a cinquième ligne fait apparaître le
caractère résolument public des prières. C'est la preuve que Pour l'auteurI'idée d'un recueillement solitaire est secondaire. Il faut cependantmentionner le désir une fois exprimé par le saint abbé de prier seul (ligne 6).
L'épisode est trop rapidement évoqué pour qu'il soit possible d'en tirer des
conclusions.
Cette brièveté ne manque pourtant pas d'intérêt : elle empêche de
connaître les motifs d'Odilon mais nous renseigne sur fotsuald : la prièrejugee la moins digne d'être détaillée à lieu à l'écart des frères. Il y a sans douteune raison bien matérielle à cela : |otsuald n'était pas présent. L'explicationparaît cependant un peu superficielle et il faut bien parler d'un relatifdésintérêt de sa part. [æs autres rubriques confirment les observations déjà
faites, à une exception près, la dernière prière, publique mais silencieuse (32).
(32) "... et motu labiorum quedam ultimae orationis verba sub silentio profert."P.L. CXLII,912.
SAIh
Deux interprétations sola prière quelques minuà voix haute par manquIe contexte mental dinteqprétation. La rnortmots seront pour demaestprésente (33). Or lescas, la prière est silenciemots (34). Tout donne Ilouanges de Dieu : il se bet prie. Simplement, lesaucun cas il ne semblintériorisation par Ie silrtotal, d'après la derript
1) Publique. Elle nr
assistance nombreuse (i
D Orale. C'est à voidialogue entre le mour;croyances orthodoxes.
3) Efficace. Dans pld'assurer une bonne rnolsérieuse garantie de sah
Pour terminer cepan(place à l'activité proprerEn raison du choix mêmaspect, nous seront plusdeux fois. Dans les deu:rquand Odilon agonise.dédié à la vierge Marcommunauté assemblée
(33) "Deinde si inlante
Idem.
(34) Un passage de lasemblable. Lors de son iputaretur.n, Ed. L'Huru.nn
(35) Notionquisemblerermites, jean HEuctf,îi, Ln€rx
t.68,19U,p. 153-168, parle r
Aperçus sur la mentalité m<
p.415426,qui rapporte la mrites entourant la mort *cor
1 cas sur 8.
7 cas sur 8.
3 cas sur 4.
1 cas sur 4.
6 cas sur 7.
1 cas sur 7.
2 cas sur 5.
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT 239
Deux interprétations sont possibles : le mourant a pu vouloir seretirer dansla prière quelques minutes avant de quitter la vie, ou bien il n'a pu s'exprimerà voix haute par manque de forces. La description de ce moment autant queIe contexte mental déjà décrit nous poussent vers cette deuxièmeinterprétation. La mort de l'abbé est publique à tel point que ses derniersmots seront pour demander avec inquiétude si toute l'assemblee des frèresest présente (33). Or les prières publiques sont normalement orales. Dans ce
cas, la prière est silencieuse mais les lèvres du mourant prononcent bien les
mots (34). Tout donne l'impression qu'Odilon veut mourir en chantant les
louanges de Dieu : il se trouve en face d'une croix sur laquelle il porte les yeuxet prie. Simplement, les mots ne franchissent plus le seuil de sa bouche. Enaucun cas il ne semble possible d'interpréter ce Passage conune uneintériorisation par Ie silence, nofion que ]otsuald ne met guère en avant. Autotal, d'après Ia description de Ia mort d'Odilory on peut dire que la prière est
1) Publique. Elle ne semble prendre tout son sens que devant uneassistance nombreuse (35).
2) Orale. C'est à voix haute que le mourant Prouve sa foi. Il n'y a Pasdialogue entre le mourant et Dieu, mais proclamation d'un ensemble decroyances orthodoxes.
3) Efficace. Dans plusieurs cas elle éloigne les démons. Elle permetd'assurer une bonne mort. A cet égard,le fait de mourir en priant semble unesérieuse garantie de salut.
Pour terminer ce panorama desinterventionsoralesd'Odilon, il faut faireplace à l'activité proprementliturgique, principalement fondée sur le chant.En raison du choix même de |otsuald qui accorde moins d'importance à cetaspect, nous seront plus brefs. Le chant liturgique d'Odilon est mentionnédeux fois. Dans les deux cas ce sont des épisodes tardifs, situés à Souvignyquand Odilon agonise. [a première fois, il se trouve dans le petit oratoiredédié. à la vierge Marie, n'ayant pas pu rejoindre l'ensemble de lacommunauté assemblee dans la grande église de Saint-Pierre. Il y dirige
(33) "Deinde si infantes et conventum fratrum adessent sollicitus interrogat>.Idem.
(34) Un passage de la mort d'Hugues de Semur raconte un épisode presquesemblable. Lors de son agonie, le mourant .,movebat linguam ut concinereputaretur.'r, Ed. L'HuIt uen, op. cit., p. 613.
(35) Notion qui semble rattacher Odilon à une ancienne tradition. A propos de ses
ermites, Jean HEucLrru; L'ermite et la mort durant le haut moyen-âge, Reuue duNord,t.68,79{%,p. 153-16$ parle d'une mort "participative".
(p. 161). Selon Paul AuanqeçAperçus sur la mentalité monastique en Provence au XIe siècle, Annalæ 85C,7972,2,p.41,5426,quirapportelamortd'unmoinedansleMinervoisen \077,1'enæmbledesrites entourant la mort .,confère au groupe une plus grande sécurité>, (p.426).
2N P. HENRIET
quelques frères dans le chant des psaumes. Le caractère dominant dupassage est la joie, que l'auteur indique à trois reprises en quatre lignes.Odilon est fætiaus praecantor, laetus, enfin iucundus et fætir:us (36).
Son aptitude à chanter au bord de la tombe est stupéfiante puisqu'il dirigeses compagnons. Le chant prépare la mort imminente, Une expression dubiographe, reprise à Saint-Paul, retient l'attention : ... fætioe, non jam puspeculumetinaenigmate,sedfacieadfaciem,DominumzsenientemsuscipereoolebatG7).
Le passage biblique est classiquement interprété comme l'oppositionentre une vision déformee de Dieu, semblable à l'image trouble que renvoieun miroir, et la connaissance directe qui récompense un chrétien après sa
mort (38). La véritable rencontre avec Dieu se fera bientôt et il est nécessairede chanter ioyeusement pour la préparer. Le chant liturgique est une activitéidéale au moment de mourir. Il ôte toute angoisse à Odilon et prépare sa
découverte du divin. [a deuxième mention de l'auteur renforce cetteimpression : le saint psalmodie pour les vêpres le jour même de sa mort, sansque son immense détresse physique soit un handicap : cum psallentibusmorteta psallit (39). Par souci de perfection l'abbé reprend même sescompagnons qui, peu attentifs en raison de leur tristesse, négligent quelquepeu leuroffice. Onretrouve làcedésird'exactitude déià mentionné dans sontroisième serrnon. C'est pour lotsuald un signe merveillertx, rem miram.Lemourant chante mieux que les vivants et peut leur rappeler ce qui a été oublié.Quel meilleur exemple de I'immense importance accordée aux aspectsformels du comporternent religieux ? Il semble qu'il ne suffise pas de chanteret de prier pour préparer sa mort, mais qu'il soit préférable de le faire bien etsans erreurs. Certes il faut voir dans ce passage la preuve d'une spiritualitéélevee qui sait surmonter les douleurs physiques pour assurer le bondéroulement de l'office. On y discerne pourtant aussi, sans qu'il y ait pourcela contradictiory un attachement scrupuleux aux formes extérieures de laprière et Ia croyance que leur parfait respect est, sinon le seul moyend'assurer le salut, tout au moins un signe de celui-ci.
(36) P.L. CXLII,91O.(37) Idem. Chez Saint Paul :
"Videmus nunc per speculum inaenigmate; tuncautem facie ad faciemo.(I, Corinthiens XIII, 12).
(38) Le même Saint Paul dit plus loin :
(nos vetro omnes revelata facie gloriam Domini speculantes, in eademimaginem transformamur, a claritate in claritatem, tanquam a Dominispiritu". (2, Corinthiens, III, 18).
(39) P.L. CXLII,911.
SAI
Il faut pour finir dresnaturedu lienunissantextérieure, de l'autre lail serait absurde de nerépétitifs que nous avolde ne pas constater le rr
est en effet le dénominliturgique. Il semble sa
moyens, de prétextes, Idonc une dimension inà prendre en considératque Dieu sauvera ceux r
lui signifie pas clairemr
Ce raisonnement entparoles sou s d i verses foA cet égard, il ne semblcodifiée (chant des ps(sermonsimproviséspril s'exprime pour confe:idéal est donc de parld'entourer ses derniersposition d'être sauvé. C
pas le besoin d'expliqurci ne fait qu'amplifierconception du monastètle ciel. L'originalité de r
conception passe à celuéternelle (41). Plus riermaladie, mais ceile.cicroyances sont si fortesune véritable matériali:malade qui va conduinomnibus legitur (42).
(40) g"OPelons que l'tjotsuald.
(41) De même que le s
premiers temps de Clunv, r
<une participation au si-le:
interprétation possible. Q:se rejoindre.
(42) P.L. CXLII,9i1.
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT
Il faut pour finir dresser un bilan. Nous nous interrogions plus haut sur lanaturedu lien unissant d'uncôté des ritesetunepratique sorrune touteassezextérieure, de l'autre Ia foi profonde de celui qui les accomplit (40). Autantil serait absurde de ne pas prendre en compte les aspects ostentatoires etrépétitifs que nous avons essayé de mettre en lumière, autant il serait erronéde ne pas constater le rôle central que la foi occupe dans tous ces actes. Elleest en effet le dénominateur corrunun des sermons, des prières et du chantliturgique. Il semble souvent que toutes ces manifestations sont autant demoyens, de prétexteq pour affirmer bien haut un credo salvateur. La foi adonc une dimension individuelle et un enracinement profond, qui invitentà prendre en considération les convictions morales du mourant : celui-ci saitque Dieu sauvera ceux qui ont foi en lui. Mais comment le saura-t-il s'il ne lelui signifie pas clairement ? o
. Ce raisonnement entraîne automatiquement un flot à peu près continu deparoles sous diverses forrnes, liturgiques ou non, qui ont toutes un même but.A cet égard, il ne semble pas y avoir de différence de nature entre la liturgiecodifiée (chant des psaumes, prières...) et les autres paroles d'Odilon(sermons improvises par exemple). Le mourant sait qu'au moment précis oùil s'exprime pourconfesser son attachement à Dieu, il est irréprochable. Sonidéal est donc de parler, de sennonner ou de chanter sans cesse, afind'entourer ses derniers moments d'un halo de mots de foi qui le mettent enposition d'être sauvé. Cette croyance, que fotsuald n'éprouve évidemmentpas le besoin d'expliquer, entraîne la continuité de la louange divine; celle-ci ne fait qu'amplifier les activités monastiques classiques, puisque laconception du monastère est celle d'un flot continu de prières s'élevant versle ciel. L'originalité de ce récit est peut€tre que du niveau de fidéal, cetteconception passe à celui d'une pratique totale et préfigure à cet égard la vieéternelle (41). Plus rien n'empêch" Odilon de prier sans cesse, sinon Iamaladie, mais celle-ci n'est iamais insurmontable. C'est un signe. Cescroyances sont si fortes qu'elles prennent un ton résolument magique parune véritable matérialisation de la foi. Ainsi, lors de la dernière crise dumalade qui va conduire à sa mort, il est dit: pro scuto fidei symbolum coramomnibus legitur (42).
(40) puppelons que l't4tude porte non pas sur Odilon mais sur Odilon selon
Jotsuald.(41) De même que le silence monastique. K. HalLnrce& Le climat spirituel des
premiers temps de Cluny, Ræue Mabillon,nn M,1956,p.117-140,voit dans ce dernier.,une participation au silence éternelr', (p. 126), ce qui n'est peutétre pas la seuleinterprétation possible. Quoi qu'il en soit, le silence codifié et les prières semblent icise rejoindre.
(42) P.L. CXLII,911.
241
242 P. HENRIET
L'utilisation du "bouclier de la foi" des écritures (43) n'est pas que
rhétorique puisqu'il doit protéger le corps d'Odilon des assauts répétés de
démons (maligrnrurn spiituumillusionæ (tA). D'autres Passages ont montréqu'il s'agit d'une crainte réelle et non symbolique. Il semble que l'arrêt des
prieres pourrait ouwir des brèches par où les esprits malins sauraient
s'engouffrer. Une profession de foi lue sur le corps d'un mourant permet de
patei au danger d'un tissu de louanges divines déchiré. Il faut noter que lalecture du symbole de la foi trouve sa force en elle-même puisque le mourantn'y participe pas. Elle n'implique aucun effort de sa part. Le raisonnementqu'on a tenlé de reconstituer est ici poussé à l'extrême : entouré d'une efficace
prière, le malade est à l'abri. La foi est bien la clé de voûte du système spirituelde Jotsuald, mais son existence ne se suffit pas à elle même : elle nécessite unvecteur privilégié qui est la voix humaine, seule capable de l'exprimercu,rr"ttablement et en permanence. On voit là comment une nécessité
d'ordre physiologique (quel autre instrument que la voix serait possible en
ce monde oral ?) s'articule sur des convictions religieuses. [a prière orale est
un moyen au service d'un ensemble de croyances : n'exagérons PaS
cependânt sa qualité de subordonnée. Si les manifestations orales sont le seul
*ôyet d'assurer un salut fondé sur une pleine adhésion à quelquesprincipes, elles en deviennent par là necessaires et autonomes. Au même titre(ue tJfoi en Dieu, elles occupent donc le cæur du système. Peut-on en tirerlà conclusion que le rôle de premier plan assigné aux <prières> Permet des
pratiques de type magique ?
I-a quasi réification d'une lecture,l'obligation implicite de continuité dudiscours,le pouvoir des mots sur les démons comme sur la décision divinemilitent en ce sens malgré l'absence de miracles (45). Ia comParaison avec
d'autres sources narratives nous conforte dans cette opinion : ainsi dans les
recueils de miracles de la même époque, le cceur de la piété populaire semble
être une foi solide d&oublee de prières orales de demande qui, elles,
entraînent une manifestation tangible du sacré : le miracle (46). Ce n'est pas
(43) Ephésiens, VI, 16.
(44) A rapprocher par exemple de la mort de Liebert, évQue de Cambrai (t 1076)
à qri on lit l'évangile (pour que les esprits des démons soient chassés par le souffle
de cette lecture". Voir H. Plarru-4 op. cit., p.1'56.
(45) Selon R. MaNspr-r-r, Symbolismo e magia nell'alto medioevo, Simboli e
sitnbologianell'altomeilioan,t 1, Spolète, 7976,p.293-329. La différence entre prière et
magie est que la première peut obtenir un résultat quand l'acte magique le doit (p.
296). Toute mentalité religieuse fondée sur ces critères d'efficacité et d'autonomie
participe donc du raisonnement magique. La limite exacte entre religion et magie
ieste cependant des plus floues, sans doute rebelle à toute analyse. Cette dernière
remanque concerne aussi Jotsuald.(46) Voir par exempleleLîbq miraanlorum Sanctne Fidis, &.. BotnLLE-t, Paris, 1897 .
SAN
ici le lieu de développx|otsuald, la notion dmagiques n'existe pas"condamné, c'est dans rchapitre XIII, consacré id'un jeûneexcessif engut et superstitionem fuge
Il s'agit de rester moriginale. L'éloge de laconception ancienne desuivant des voies incor
Cette idee ne fait qrtrai temen t systéma ti quau dessus du raisonnerlasuperstiflo comme déalors que puisqu'aucu:modalités de la prièraccumulation qui peutdonne un exemple :
s'endormait parfois la icdirectement quelquescontinuait à prononcer c
franchit là les limites duque certains peuvent êtuncomportementexcesune catégorie intouchabcondamnerla superstifr
(47) P.L. CXLII,907"(48) Définition repr-
medictnle, Florence, 197:, i(pratiques religieuses noI
Onpeutvoiraussit.74,2763-2766, par Paui Sest quod sit superflua au: s
Augustin emploie surtoii:revient au sens isidone::Somme,Ila-llae, q. XCII, a-
Jotsuald, commeétymologique (< super sta:
(49) P.L.CXL[,901. Lede Saint Jérôme. JotsualC :
(50) P.L. CXLII,901.
SAINT-ODILON DEVANT LA MORT
ici le lieu de développer cette analogie remarquablement stimulante. pour|otsuald, la notion de comportement chrétien recelant des attitudesmagiques n'existe pas. Si le mot supustitio apparaît dans le texte pour êtrecondamné, c'est dans un s€ns différent de son acception moderné. Dans lechapitre XIII, consacré à la tempérance, Odilon donne la preuve de son refusd'un ieûne excessif en goûtant systématiquement tous lei plats servis, et celaut et superstitionem fuguet et continentiam ræentaret (47).
Il s'agit de rester mesuré sans excès. Cette reconunandation n'est pasoriginale. L'éloge de la tempérance, vertu traditionnelle, rencontre ici uneconception ancienne de la superstition qui en fait <un culte religieux excessifsuivant des voies incorrectes" (48).
Cette idée ne fait qu'affleurer dans la vie d'Odilon et ne reçoit aucuntraitement systématique. La prière en particulier, reste en dehors et commeau dessus du raisonnement. Elle n'estlusceptible d'excès d'aucune sorte etla_superstifio comme dérèglement du culte ne peut la concerner. On conçoitalors que puisqu'aucune suspiscion ne sem6le s'attacher aux différentesmodalités de la prière, la porte soit ouverte en ce domaine à uneaccumulation qui peut prendre les couleurs du merveilleux. L'auteur endonne un exemple : du temps où sa santé était florissante, odilons'endormait parfois la pue contre une page des saintes écritures afin d'en liredirectement quelques lignes au réveil. Lors de son sommeil, sa bouchecontinuait à prononcer des psaumes (49). Aux dires de |otsuald lui-même, onfranchit là les limites du normal : rem miram dicturus stttn, et auam(So). Atorsque certains peuvent être tentés de voir dans les prières continues d'Odilonun comPortement excessif, jotsuald n'y voit rien que de normal. La prière estune catégorie intouchable, pure et positive par essence. Il est donc logique decondamner la superstitio tout en exaltant ce comportement.
@77 p.1-.CXLll,g'7.
(48) Définition reprise à F. Caxonvt, Magia, stregoneria, superstizioni nell'Occidantemedieule, Florence, 1979,p.98. L'auteur étudie surtout l,autre sens de osuperstitio>(pratiques religieuses non chrétiennes et condamnées comme telles).
Onqeut voir aussi l'article "superstitio> du Dictionnaire dettuotogie chrétientæ,t.74,2763-2766, par Paul sE or.rRNE. Isidore de seville dit clairement ..suferstitio dictaest quod sit superflua aut superstatuta observatio,>. (Etymologiesl, vlil,;. ilD. Si SaintAugustin emploie surtout le terme comme un Quivalent dtdolâtrie, Saint Thourasrevient au s€ns isjdo_rien_("suPerstitio quemdam excessum importare videturr>.Somme,IIa-IIag q. XCII, a-l ad 2um et 3um).
]otsuald, comme Saint Isidore et Saint Thomas, prend en fait le sensétymologique (osuper-stare>).
(49) P.L. CXLil, ml: F procfié du sommeil contre les saintes écritures est reprisde Saint Jérôme. Jotsuald rappelle cette dette.
(s0) P.L. cxlrl 901.
243
2M P. HENRIET
Si I'on doit en définitive se prononcer pour savoir ce qui l'emporte dansl'attitude d'Odilon au seuil de la mort, haute spiritualité ou fondementsmagiques de la pratique religieuse, il semble qu'il faille s'orienter vers laseconde solution sans reieter la première. Plutôt que de pouvoir opposer des
attitudes en apparence contradictoires, il faut admettre qu'elles cohabitentsans difficulté dans les mentalités religieuses de cette époque. Contrairementà ce que nous observons chez des hommes moins cultivés qu'Odilon, la foichrétienne est rigoureusement définie et affirmée. La quasi totalité des actes
s'inscrit dans le cadre des pratiques ecclésiastiques. L'ensemble de celles-ciest parfaitement ritualisé. Des convictions surprenantes subsistentpourtant : autonomie de la parole, poids des mots dont on privilégiel'efficacité plus que la fonction de communication ou de signification. On apeut€tre ici l'exemple d'une Spiritualité intermédiaire entre la religiositépopulaire la plus brute et I'intériorisation du sentiment religieux qui se
développera lentement par la suite. Odilon sera sauvé parce qu'il croit enDieu et milite pour lui, mais aussi et surtout parce qu'il le clame et le chante.
Il reste une question, qui déborde les limites de cette étude. Les
contemporains de jotsuald peuvent-ils concevoir une mort sensiblementdifférente, où les mots n'auraient qu'un rôle secondaire ? Toute réponseimplique une étude de fond sur la nature de la parole à cette époque.
Uniaersité dePrwence Patrick HENRIET