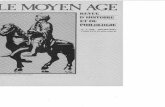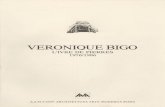2011 « Pierres dressées, bétyles, urbanisme et espace religieux à Mari, nouvelles recherches au...
Transcript of 2011 « Pierres dressées, bétyles, urbanisme et espace religieux à Mari, nouvelles recherches au...
La découverte puis la publication, en 1954, du bétyle découvert dans le temple de Ninni-Zaza par André Parrot a été un jalon essentiel de l’histoire de la recherche sur les pierres dressées aniconiques du Proche-Orient. Cette découverte isolée donnait aux historiens de ces pratiques religieuses, bien documentées aux époques classique et pré-islamique, une profondeur chronologique inédite. Depuis lors, les découvertes archéologiques 2, mais aussi l’étude des textes de Mari, Tuttul, Mumbaqa et Emar, ont permis de raffiner considérablement un domaine de pratiques religieuses qui frappe par sa richesse et sa diversité 3.
À Mari même, Jean-Marie Durand, en 1985, versait au dossier les premiers documents mentionnant des bétyles à la période amorrite 4, avant de donner, vingt ans après, une étude complète d’un dossier d’une très grande richesse 5. En outre, les recherches archéologiques des quinze dernières années ont considérablement élargi le dossier des pierres dressées et de leur usage à Mari à l’âge du Bronze ancien ou moyen en Syrie intérieure. Toute
* Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Directeur de la mission archéologique française de Tell Hariri-Mari (les documents utilisés ici sont sous copyright de la mission archéologique française de Mari).
1. Cet article est la version revue de la présentation proposée en juin 2006. Il se trouve que, trois mois après le colloque, nous avons retrouvé à Mari, en septembre 2007, deux pierres dressées, dont un fragment de bétyle qu’il nous a paru bien évidemment très intéressant de verser au dossier.
2. Voir dans ce volume notamment les communications de Christophe Nicolle et Corinne Castel.
3. Voir dans ce volume les communications de Lionel Marti et Patrick Michel. Sur l’usage des bétyles, à travers les textes, voir en dernier lieu, Durand 2005.
4. Durand 1985.
5. Durand 2005.
PieRReS DReSSéeS, BéTyLeS, uRBAniSme eT eSPAce ReLigieuX à mARi : nouveLLeS RecHeRcHeS Au « mASSif Rouge »
(SyRie, 2006-2007) 1
pierre dressée n’est assurément pas une stèle à vocation religieuse, c’est un point qui paraît assuré.
Le but de cet article est précisément de faire le point sur la diversité de l’usage de ces pierres, à travers la présentation de quelques exemples précis, qui n’épuisent pas le sujet, loin s’en faut (Fig. 1). La découverte specta-culaire, en 2007, d’une série de nouveaux exemples a considérablement élargi notre corpus. Avant d’en venir à ces découvertes, faisons le point sur ce que nous savons des pierres dressées de Mari. Nous procéderons en trois étapes : nous reviendrons d’abord sur la notion de « bétyle » à Mari, en nous appuyant sur le contexte de découverte du bétyle du temple de Ninni-Zaza, puis nous présenterons les nouvelles pierres dressées découvertes en 2006 et 2007 dans le « massif rouge », avant de réfléchir sur le contexte urbain dans lequel elles s’inscrivent.
Stèles et bétyles mariotes
Dans l’univers religieux mariote du IIIe millénaire, où l’image humaine et divine est apparemment reine, tant dans la statuaire (mais que sait-on réellement des représen tations divines à Mari au IIIe millénaire ?) que dans la glyptique, les incrustations de nacre et les stèles gravées, les pierres dressées ne jouent qu’un rôle apparemment marginal. Un petit point de vocabulaire s’impose d’abord : on a couram-ment, depuis Parrot, qualifié la pierre de Ninni-Zaza de « bétyle » 6. Il n’est nul besoin ici de refaire tout l’histori que de l’usage de ce terme et de son application à des realia archéologiques très diverses dans leur nature : de la pierre soigneu sement travaillée et polie en forme conique du temple de Ninni-Zaza à des blocs grossiers monolithiques dressés, il y a un abîme qui a souvent été souligné, sans
6. Parrot 1954, p. 156-157.
Pascal butterlin *
p. butterlin
90
que l’on puisse préjuger par ce seul critère de la sacralité ou non de l’objet. C’est un problème que nous allons rencontrer tout au long de cet exposé.
Le terme akkadien, dans les textes de Mari, est, on le sait, sikkanum 7. Nous réserverons le terme de bétyle à une pierre taillée ou polie, travaillée en tout cas en vue de son exposition, par opposition à la notion peut-être plus neutre de pierre dressée qui désigne, comme le terme l’indique, une pierre volontairement dressée dont l’état d’achèvement ou de taille peut être très limité. Il faut toutefois souligner qu’en l’état cette distinction formelle de l’archéologie ne paraît pas avoir de correspondance dans la documentation textuelle. Pourtant, on retiendra qu’un point crucial de la discussion philologique est le caractère apparemment transitoire de l’érection ou de
7. Durand 2005, p. 32-36, où l’étymologie de sikkanum comme habitation divine est rectifiée au profit d’une autre définition : sikkanum ne signifie que « stèle installée pour une occurrence particulière », même si la morphologie nominale (non akkadienne) n’en est pas claire » (ibid., p. 36). Le lien entre sikkanum et bêyt-‘El, ou demeure du dieu, reste donc indéterminé et Jean-Marie Durand propose la notion d’habitation transitoire, en considérant que la notion de « pierre de feu » relève d’une autre tradition religieuse, mêlée tardivement à celle, syro-phénicienne, des bétyles.
l’exposition de ces pierres qui paraissent amovibles et dont le sort, une fois les rituels achevés, reste incertain 8.
Le fameux bétyle du temple de Ninni-Zaza est resté longtemps un hapax de la documentation archéologique mariote. Entouré d’un véritable peuple de statues, il semble faire référence à une tout autre conception de l’image et de la représentation. Découverte dans l’espace central du temple de Ninni-Zaza, cette pierre ne se trouvait pas couchée sur le sol du temple, comme le montre une photo reproduite partout 9, mais prise dans des décombres 10 (Fig. 2).
Le bétyle en basalte, haut de 1,50 m et d’un diamètre de 0,35 m à la base 11, a été découvert le 28 octobre 1953 au moment de la reprise des recherches dans la cour n° 10, devenue par la suite cour n° 12. Le carnet de fouilles de Parrot est des plus lapidaires : après avoir mentionné la découverte de fragments de statues, il signale « renversé,
8. Durand 2005, p. 25, évoque un lieu-dit, les « bétyles de Dagan », qu’il suppose être le lieu de stockage où les bétyles sont mis de côté : « on pourrait imaginer qu’y étaient rangés les bétyles du culte à Dagan, à la fin de chaque cérémonie » (ibid., p. 25).
9. Parrot 1967, pl. VII.1 et 2. Il s’agit de l’objet M 2800.
10. Ibid., fig. 19, p. 25.
11. Ibid., p. 25.
Fig. 1 – Mari centre monumental, de la ville II, situation des zones mentionnées dans le texte. Chantier Temple nord 1.
PierreS dreSSéeS, bétyleS, urbaniSme et eSPace reliGieux à mari : nouVelleS recHercHeS au « maSSiF rouGe »
91
Fig. 2 – Bétyle M 2800 : 1 et 2 redressé (N° 6379 et N° 6378), 3 et 4 in situ (N° 6382 et 6384).
1 2
3 4
P. butterlin
92
un bétyle en basalte, intact ». On a conservé dans les archives Parrot une série de clichés qui donnent une idée du contexte extrêmement troublé de la découverte (Fig. 2). On y voit les restes d’un puisard de la Ville III, mais on ne distingue pas clairement les vestiges du temple lui-même. Le bétyle n’est pas couché horizontalement mais de biais : il gît dans des décombres dont la situation stratigraphique n’est pas très claire. S’agit-il des décombres du temple ou de niveaux terrassés postérieurs ? Parrot mentionne à plusieurs reprises dans son journal la présence, au-dessus des vestiges des deux temples, de niveaux d’habitations et de tombes tardives. Les photos mentionnées ne permet-tent guère de préciser la chose, si ce n’est qu’elles nous montrent clairement qu’il s’agit de fondations. Parrot, rappelons-le, considère que le bétyle se trouve sur le second sol de l’édifice, un sol de briques crues 12, résultat de l’exhaussement volontaire du niveau du temple. Le bétyle, initialement situé au centre de la cour du premier niveau, aurait été récupéré pour être installé au second niveau, où les statues cassées ont été découvertes. Toutefois, il souligne qu’aucune installation visant à le caler ou le mettre en valeur n’a été retrouvée sur place.
L’objet lui-même a suscité des interprétations variées. Il est presque assuré qu’on doit exclure une fonction funéraire. Parrot ne mentionne aucune tombe dans son environnement immédiat, même s’il a retrouvé des tombes dans ce secteur. Si le bétyle se dressait dans l’espace central de l’édifice, ce qui semble avoir été le cas, faute d’information contradictoire, il faut toutefois souligner alors qu’il se dressait dans un espace dont on a supposé récemment qu’il était couvert, et non pas découvert comme l’imagine Parrot dans une restitution célèbre 13. Jean-Claude Margueron, en analysant les temples de Mari, a proposé une reconstitution de l’édifice avec une couverture de l’espace central, et notamment une vue restituée de cet espace avec son bétyle et son allée processionnelle 14 (Fig. 3). Il a surtout souligné que le bétyle ne se trouve pas dans le lieu très saint (siège de la divinité) mais dans le lieu saint (emplacement de l’offrande), si bien qu’une interprétation comme maison ou comme représentation divine même lui paraît difficile 15. Le bétyle appartiendrait quand même, sous toutes réserves, à un univers religieux qu’il qualifie de « facette syrienne » de l’univers religieux de Mari, comme l’usage du temple-tour. Qu’il s’agisse donc là
12. Ibid., p. 24.
13. Ibid., fig. 19, p. 25.
14. Margueron 2004, p. 241-245 : fig. 231, p. 243 pour la vue de l’espace central, fig. 232, p. 244 pour une coupe transversale et fig. 233, p. 245 pour une vue générale, toujours restituée, de l’édifice.
15. Margueron 2004, p. 264, spécialement note 30.
d’une facette très originale (mais jusqu’à quel point ?) de la vie religieuse mariote ne fait aucun doute. Il a aussi souligné à quel point les supports matériels du culte évoluent à Mari, ne serait-ce qu’au cours de l’histoire de la Ville II.
À ce sujet, nous ferons trois remarques :1 – d’abord, si le bétyle se dresse dans l’espace central
du temple, depuis l’état le plus ancien, il se dresse dans un es pace où la voie bitumée laisse supposer des rites de type processionnel. C’est rouvrir là le dossier bien connu de la circumambulation et de la course rituelles attestées dans l’Arabie préislamique 16. Jean-Marie Durand a rassemblé tous les indices en faveur de tels rites dans la Mari amorrite et on peut donc se demander si les processions qui se déroulaient dans le lieu saint du temple ne sont pas liées au bétyle. Jean-Marie Durand précise toutefois : « le bétyle retrouvé par Parrot se trouvait brisé dans la cour du temple d’Eshtar (sic). On ne sait s’il avait été mis intention nellement hors de la cella, ni s’il doublait une représentation anthropomorphique » 17. S’il s’agit d’une représentation divine aniconique, elle ne devrait pas se retrouver dans le lieu saint mais dans le lieu très saint, à moins qu’un rapport complexe de dédoublement ait eu lieu. C’est ouvrir là le dossier pour le moins complexe de la représentation divine dans ces sanctuaires sur lequel on n’insistera pas ici 18. Disons que si le bétyle est un accessoire du culte, objet de circumambulations ou d’onctions diverses, rituels qui sont bien attestés à la période amorrite, il peut alors, au même titre que les divers bassins et plates-formes, avoir sa place dans l’espace central.
2 – Deuxième observation, les bétyles mentionnés dans la documentation textuelle sont souvent utilisés à l’air libre : installés à l’entrée des villes (exemple de la porte aux bétyles d’Emar 19 ou de celui d’El Hanni 20), ils sont aussi présents dans des rituels à ciel ouvert (comme sur le toit de maisons à Emar) et on se demandera si les bétyles qui, à l’origine, sont pour certains des pierres vénérées sur place, ne sont pas des objets disposés et vénérés à l’air libre. Cela poserait alors un problème pour la
16. Parrot s’est interrogé dès 1954 sur les liens entre la voie processionnelle et le bétyle, qu’il situe volontiers au cœur de cet ensemble (Parrot 1954, p. 156-157).
17. Durand 2005, p. 29.
18. Sur la notion de « dieu pierre », voir Durand 2005, p. 4. Durand insiste sur deux conceptions concomitantes du culte : celui qui s’adresse au simulacre (représentation figurée) et celui qui réclame une pierre recueillie dans la nature.
19. Durand 2005, p. 29.
20. Loc. cit.
PierreS dreSSéeS, bétyleS, urbaniSme et eSPace reliGieux à mari : nouVelleS recHercHeS au « maSSiF rouGe »
93
couverture de l’espace central du temple de Ninni-Zaza. C’est là une simple hypothèse car, la plupart du temps, nous ne savons rien de la situation de ces bétyles.
3 – En revanche, et ce sera notre troisième remarque, Jean-Marie Durand a réuni un impressionnant faisceau d’arguments en faveur d’une origine « occidentale » du culte des bétyles à Mari, qu’il oppose volontiers aux tendances « orientales » attestées à ses yeux à l’époque éponymale 21. Si tel est le cas, il faut là encore se demander quelle signification donner au bétyle de Ninni-Zaza : s’agit-il d’un trait occidental comme semblent l’indiquer Jean-Marie Durand et Jean-Claude Margueron ? Dans ce cas, Ninni-Zaza serait-il un sanctuaire spécifique ?
21. Ibid., p. 23.
Il se trouve qu’il ne s’agit précisé ment pas d’un sanctuaire-tour, d’inspira tion occi dentale (qu’est-ce que cela signifie au milieu du IIIe millénaire ?), mais d’un cas dans lequel Jean-Claude Margueron voit une profonde spécificité mariote, Ninni-zaza étant bâti selon un parti qui est celui de l’enceinte sacrée, dans laquelle, notons-le, on n’a pas retrouvé de bétyle. Les informations textuelles documentent une période très tardive, on le sait, et très brève, si bien qu’il paraît bien difficile en l’état d’y distinguer ce qui serait étranger ou local, tant nos informations sur la longue durée sont limitées. L’usage de bétyles paraît en tout cas s’inscrire dans la longue durée, sans que l’on puisse pour autant déterminer s’il s’agissait d’un usage exotique ou au contraire d’une marque de fabrique locale.
Fig. 3 – Restitutions du temple de Ninni-Zaza et de son espace central. 1 : restitution Parrot ; 2 : restitution Parrot de l’espace central ; 3 : restitution Margueron de l’espace central du temple de Ninni-Zaza (dessin N. Bresch) ; 4 : restitution Margueron du temple de Ninni-Zaza (dessin N. Bresch).
P. butterlin
94
Le « massif rouge » et les pierres dressées
Les dernières recherches archéologiques menées à Mari 22 ont permis de mesurer les problèmes d’interpré-tation que ces pierres dressées peuvent poser. En effet, au cours des campagnes de 2006 et 2007, toute une série de pierres dressées, dont les fonctions étaient visiblement différentes, ont été dégagées à l’angle nord-est du « massif rouge ». Ces prospections s’inscrivent dans l’axe 1 du nouveau projet de recherches archéologiques à Mari entamé en 2005 (Fig. 4) : il s’agit d’étudier
22. Pour une présentation synthétique des premiers résultats des nouvelles recherches conduites à Mari, voir Butterlin 2007b et 2008.
l’environnement du centre monumental de Mari, dans un secteur crucial, celui de la via sacra à la hauteur du « massif rouge ».
L’objectif de ces recherches est d’obtenir des infor-mations stratigraphiques fiables sur le quartier dans lequel se trouvait le « massif rouge » : on cherchera non seulement à intégrer le monument dans le nouveau plan topographique du site, mais on reprendra également l’exploration archéo-logique au nord du « massif rouge », vers le cœur supposé de la ville, une fouille que Parrot avait amorcée et abandonnée en 1953. Les recherches comprennent deux volets : une étude de l’édifice d’une part, de son contexte d’autre part. On a retrouvé dans les deux cas toute une série de pierres dressées, dont un nouvel exemplaire de bétyle par lequel on va commencer.
Fig. 4 – Mari, situation des chantiers ouverts en 2006.
PierreS dreSSéeS, bétyleS, urbaniSme et eSPace reliGieux à mari : nouVelleS recHercHeS au « maSSiF rouGe »
95
Un nouveau bétyle à Mari
Une des difficultés que pose l’étude de la documen-tation mariote est celui de la dimension des bétyles. Pour résumer les données du problème, il existe là encore un décalage entre une documentation épigraphique qui évoque des monolithes d’une taille considérable et les deux bétyles connus à Mari, plutôt modestes, d’un calibre que l’on pourrait presque qualifier de « portable ». C’est une question qu’a déjà soulignée Jean-Marie Durand 23, sur laquelle nous n’insisterons donc pas, si ce n’est pour verser ici au dossier une nouvelle pierre, mis au jour en 2007.
Le « bétyle » dégagé en 2007 sur le chantier Temple nord 2 par D. Beyer est en effet une pierre d’un calibre moindre que le bétyle découvert par Parrot. Nous lui réservons l’appellation de « bétyle » parce qu’il s’agit d’une pierre taillée puis polie, cette fois en calcaire et non en basalte (Fig. 5). Il s’agit d’un bloc de pierre
23. Durand 2005, p. 9-10.
Fig. 5 – Bétyle IV J 2 NO 22, chantier Temple nord 2, 2007.
claire (IV J 2 NO 22), grossièrement poli, de section ovale : haut de 46 cm, sa largeur maximale est de 18 cm et son épaisseur de 14 cm. La partie inférieure est aplatie, la pierre s’affine vers le sommet. La partie supérieure est cassée mais la pierre ne devait probablement pas dépasser 60 cm au vu de son profil. Une petite dépression a été observée à la base de la pierre mais on ne peut aller beaucoup plus loin dans l’analyse de l’objet. Découverte à la cote 181, 95, elle se trouvait prise dans les couches litées du remplissage des fondations d’un bâtiment monumental de la Ville III, situé au nord-est du « massif rouge ».
Ces fondations massives, que Parrot avait identi-fiées à l’est du « massif rouge » au cours de la huitième campagne, semblent délimiter le secteur de l’édifice monumental de la Ville II, dont on ne sait pas très bien s’il était encore en usage ni même visible au cours de la période de la Ville III. Sans anticiper sur les problèmes de stratigraphie du « massif rouge », sur lesquels nous allons revenir plus loin, disons que les travaux très importants qui se sont déroulés dans le secteur des terrasses de Mari ont non seulement concerné la haute terrasse et sa rampe, mais aussi les secteurs situés à l’est, depuis l’esplanade de Dagan jusqu’au « massif rouge ». L’ensemble du « massif rouge » a été noyé dans des couches de terres cendreuses et d’imposantes fondations ont alors été installées, probablement pour accueillir, entre le secteur des terrasses et celui du vieux palais, un complexe monumental dont elles sont les seuls vestiges. On a retrouvé au nord-est du « massif rouge », entre ces fondations, un nombre conséquent de tombes sur lesquelles nous n’insisterons pas ici. C’est dans ce contexte très particulier que le bétyle cassé a été dégagé. Nous n’en apprendrons donc pas plus sur l’usage des bétyles avec cet objet, dont nous savons seulement qu’il a été enseveli dans un secteur particulier très riche en tombes. Sa seule présence peut indiquer que le monument avait un rôle symbolique important dans ce quartier central de la ville, mais on ne peut guère aller plus loin. Si le bétyle de Parrot date probablement de la Ville II, celui-ci a été enseveli pendant la période de la Ville III, sans que l’on puisse bien entendu le dater plus précisément : les tombes dégagées dans le secteur datent de la période récente des Shakkanakkû de Mari et Parrot a retrouvé, au sud du secteur fouillé en 2007, un tesson inscrit au nom du Shakkanakkû Ilum Ishar. Tout ceci ne nous donne qu’une série de termini qui situent ces travaux au xxie s. avant notre ère, au cours de la période que j’ai qualifiée ailleurs de période des Shakkanakkû royaux. Nous avons donc là un exemplaire qui pourrait dater de la période de la Ville III, mais malheureusement pas de l’époque des textes amorrites.
En tout cas, les dimensions de ce bétyle, nettement plus petit que celui qu’a trouvé Parrot, nous donnent un deuxième exemple de bétyle portable (il pèse 8 kg),
P. butterlin
96
bien loin des dimensions évoquées par la documentation textuelle, si tant est que les mesures utilisées dans ces textes soient réellement compréhensibles. Le fameux texte de Bannum (FM VIII N° 12 [A.652]) donne des informations précieuses sur la taille et les dimensions de ces bétyles : quatre bétyles de douze coudées doivent être débités par une centaine d’ouvriers. Jean-Marie Durand a recensé toutes les occurrences de dimensions des bétyles, d’une taille de quatre coudées jusqu’à l’énigmatique bétyle de FM VIII 14, long de quarante coudées…, soit 20 m si on estime la coudée mariote à 50 cm 24. La majeure partie de ces bétyles mesure toutefois entre quatre et cinq coudées, semble-t-il. Jean-Marie Durand a proposé de ramener la coudée mariote à 16,6 cm : un bétyle de douze coudées ferait donc un peu moins de 2 m et nos bétyles trouvés en fouille seraient alors dans la gamme basse évoquée dans la documentation textuelle. Celle-ci évoque précisément le débitage de ces blocs de pierre ainsi que l’outillage et la main d’œuvre utilisés à cette occasion. Que ceux-ci soient débités dans le roc ou prélevés dans la nature, on n’évoque pas, semble-t-il, de travaux de finitions sur ces pierres, mais surtout les problèmes d’extraction puis de transport, c’est un détail important. Nos deux exemples mariotes sont travaillés et polis, encore une petite discordance entre nos données textuelles et archéologiques.
L’angle nord-est du « massif rouge » : pierres dressées
La première opération menée sur le « massif rouge » est un sondage de 5 m de largeur sur 10 m de longueur, placé sous la responsabilité de Julien Chanteau (UVSQ), pratiqué à l’angle nord-est. Ce sondage a été à la fois élargi et approfondi en 2007. L’angle nord-est de l’édifice avait été partiellement dégagé par Parrot en 1952 25. Noyé depuis sous les déblais, en 2005 il était simple-ment marqué dans la topographie par un bourrelet de terre rougeâtre qui dessinait grossièrement l’empreinte de l’angle du monument. On a donc repris la fouille à ce point l’année suivante. Rappelons que Parrot avait trouvé à l’angle nord-est de l’édifice un « blocage » de pierres, qu’il a suivi sur une vingtaine de mètres en façade est. Ce blocage a été relevé et figure sur le dernier plan du « massif rouge » publié en 1952 (plan A 88).
Une série de clichés inédits dans les archives Parrot nous a permis de comprendre la stratégie de l’archéologue : pour dégager l’angle nord-est du massif, il a ouvert une tranchée étroite, large d’environ 1 m
24. Ibid., p. 9-10.
25. Parrot 1954.
seulement. La fouille s’est arrêtée sur un chaos d’éboulis de pierres et n’a pas atteint la base du mur. À cet endroit, on pouvait donc espérer retrouver, au plus près de l’édifice, des couches encore en place et envisager une section de la via sacra, un enjeu majeur de toute étude de l’environnement du centre monumental de Mari.
De fait, on a retrouvé l’angle nord-est tel que l’avait dégagé Parrot, au détail près (Fig. 6). Dans ce secteur, l’état de dégradation du monument est spectaculaire : il ne reste rien du superbe système de niches et redans décou-vert sur la façade ouest. L’angle nord-est est conservé à une altitude beaucoup plus faible que dans les autres secteurs du « massif rouge ». C’est même l’angle le plus mal conservé. L’ensemble du massif présente en effet une nette dissymétrie, une forte pente d’ouest en est. À l’ouest, le massif a été protégé par la masse considérable des lits de galets de la rampe de la haute terrasse, alors qu’à l’est s’est formé un sillon d’érosion qui passe, ce n’est pas une surprise, par la via sacra.
Au nord-est, Parrot avait dégagé quatre assises de ce « blocage ». La fouille a procédé en trois étapes : retrouver d’abord la situation au moment du dégagement par Parrot, poursuivre ensuite la fouille pour atteindre la base du blocage et en profiter pour étudier, aux endroits qui le permettraient, la stratigraphie de l’environnement de l’édifice, à l’est. Une fois cette situation comprise, il serait alors possible d’élargir la tranchée vers l’est, pour obtenir une section de la via sacra qui longe par l’est le « massif rouge », rappelons-le.
On a dégagé sur plus de trois mètres de hauteur l’angle nord-est de l’édifice : il s’agit, à l’est comme au nord (de l’édifice), d’un mur fait de moellons et de grands blocs de gypse non taillés, ces derniers posés dans le sens de la longueur alternant avec des moellons de petites dimensions qui permettaient de caler les assises de blocs (Fig. 7). Ces grands blocs, dont certains sont longs de plus d’un mètre et épais de 50 cm, ne sont pas taillés mais ont été débités pour exploiter au mieux les lits horizontaux du gypse. Au nord comme à l’est, ce mur de pierres venait renforcer la maçonnerie de briques du massif et devait être recouvert d’un parement de briques qui a disparu, si l’ensemble n’était pas seulement en fondation. On reviendra sur ce problème.
L’ensemble, très imposant, présente des caractéris-tiques différentes au nord et à l’est. À l’est, le mur révèle un fruit sensible vers l’intérieur et surtout une semelle, absente au nord, qui déborde de 30 cm à la cote 179,56. Cette semelle était haute de 1,05 m. Au nord, le mur ne fait pas apparaître ce décrochement, il est conservé d’une seule venue sur 3,50 m de hauteur et parfaite ment chaîné avec le blocage est. Sous le niveau de la semelle est, le mur nord est moins soigneusement appareillé et les deux dernières assises sont plus courtes à l’est,
PierreS dreSSéeS, bétyleS, urbaniSme et eSPace reliGieux à mari : nouVelleS recHercHeS au « maSSiF rouGe »
97
avait partiellement dégagés, avant d’arrêter la fouille dans le secteur. Un grand bloc long de plus de 1,20 m et large d’environ 70 cm n’est clairement pas en place : il est tombé du massif sur le socle de l’édifice au moment de sa ruine 26. Il a basculé sur une grande pierre dont on pouvait penser qu’elle non plus n’était pas en place. Mais
26. Parrot a arrêté ses dégagements après avoir effleuré ce bloc. La photo N° 5262 des archives Parrot, prise le 17 décembre 1952, montre l’angle nord-est et deux blocs posés de travers, l’un sur le massif et l’autre en contrebas. Ils dessinent une ligne de biais comme s’il s’agissait d’un plan de chute. Cette situation ne laisse pas d’interroger. Il s’agit de la fossili sation d’un état très dégradé de l’édifice, prise dans des couches de terrassement. Le premier bloc trouvé par Parrot n’était plus en place en 2006, on l’a retrouvé à quel-ques mètres du chantier. En revanche, on observe sur notre cliché comparatif un petit sillon à l’angle nord-est du massif, qui correspond au point où la pierre était prise dans la brique.
ce qui indique qu’à ce niveau nous sommes clairement en fondation.
L’angle lui-même a été particulièrement soigné : outre l’alternance de moellons et de blocs, on observe en effet une alternance de grands blocs, les uns disposés en longueur en façade est et les autres en façade nord. Au point de contact avec la semelle est, ce sont deux blocs qui ont été disposés en carreau et boutisse, pour renforcer encore la structure de la construction. L’ensemble a donc été construit, sans aucun doute, en une seule fois, avec un souci évident d’aménager à l’est un renfort que l’on n’a pas jugé nécessaire au nord, où l’on s’est contenté d’un mur d’une seule venue. Il faudra expliquer cette dissemblance qui renforce et privilégie la circulation dans la via sacra.
On a rencontré là une situation archéologique com plexe : à l’est du blocage, au point de contact avec la via sacra, on a trouvé deux blocs massifs que Parrot
Fig. 6 – Chantier Temple nord 1 : angle nord-est du « massif rouge » : état en 1952 et en 2006 après la fouille.
P. butterlin
98
les recherches conduites en 2007 nous ont amené à voir les choses différemment. À la suite de la découverte, sous le grand bloc que l’on vient d’évoquer, d’une statue fragmentaire d’orant assis, on a décidé de déplacer ce bloc qui scellait visiblement une situation archéo lo gique prometteuse. On a ainsi découvert d’autres fragments de l’orant et pu étudier une seconde pierre, cachée par le grand bloc provenant du massif. Cette grande pierre ne vient pas de la ruine du massif mais elle est profon dé ment prise dans les terrassements qui reposent contre le socle du massif (Fig. 8). Elle est inclinée vers le nord mais cette inclinaison résulte de la chute du grand bloc qui a scellé une situation très intéressante : une pierre dressée qui a légèrement basculé sous le choc et un orant assis qui reposait au pied de cette pierre dressée. Celle-ci, qui n’a pas été
dégagée totalement, était haute d’au moins 60 cm et se dressait à l’angle nord-est du massif.
De surcroît, la poursuite des recherches a permis de montrer qu’une rangée de pierres dressées était appliquée contre le socle du « massif rouge » (Fig. 9) : deux d’entre elles ont été effleurées en 2006, mais on a établi en 2007 que c’est tout le long du socle que de telles pierres dressées, hautes d’environ 50 cm, furent posées. Ce sont des blocs de gypse d’une épaisseur d’environ 10 cm disposés réguliè rement contre le socle, de telle sorte que leur sommet ne le dépasse pas. On a là deux ensembles bien distincts : une grande pierre dressée d’une part et, par dessous, une rangée de petites pierres dressées appliquées contre le socle du massif. Comment comprendre ces installations ?
Fig. 7 – Chantier Temple nord 1 : angle nord-est du « massif rouge », élévation est et nord, vues générales depuis le nord-est (fouille 2006).
PierreS dreSSéeS, bétyleS, urbaniSme et eSPace reliGieux à mari : nouVelleS recHercHeS au « maSSiF rouGe »
99
Stratigraphie urbaine, « massif rouge » et pierres dressées
L’étude de l’angle nord-est du massif a été accom-pagnée d’une tranchée de sondage de 5 m de largeur, de direction est-ouest, partant de l’angle du « massif rouge » jusqu’à un énorme tas de déblais issus de la fouille de l’« esplanade de Dagan » en 1938. Situé à l’est du « massif rouge » et partiellement évacué par Parrot en 1952, ce tas de déblais limite les recherches et on l’a partiellement entamé pour réaliser une section en travers de la via sacra. On a d’abord retrouvé le long du « massif rouge » les limites de la fouille Parrot et son arrêt de fouille de la huitième campagne. Les grands blocs de gypse évoqués plus haut reposent sur le socle du « massif rouge » et scellent des couches de terre rougeâtre qui sont en place. Ces blocs, visibles sur les photos de fouille de 1952, proviennent clairement de la ruine de l’édifice et ont été pris dans des remblais rougeâtres que l’on peut encore observer au sud.
À l’est de la limite de la fouille Parrot, on a élargi la tranchée pour fouiller des niveaux en place, là où passait la via sacra de la Ville II. On a dégagé sous la surface les fondations très massives d’un édifice monumental : un mur large d’au moins 2,50 m a été mis au jour, il présente des briques de 44/44 cm et repose sur une épaisse couche de terre cendreuse litée. À l’aplomb du mur, on a pratiqué une section qui a livré la stratigraphie suivante (Fig. 10) :
– des couches litées grisâtres, très chargées en charbons de bois, correspondent au sous-œuvre des terras se-ments réalisés par les Shakkanakkû dans l’ensemble du secteur Temple nord. Ces couches ont été identi-fiées et bien décrites par Parrot 27 ;
– des nappes alternées de terre rougeâtre et jaunâtre extrêmement compacte provenant peut-être de la destruction du « massif rouge » : elles correspondent à des terrassements dont la datation est incertaine. Épaisses de 1,30 m, elles ont scellé les dalles de gypse qui ont glissé du massif ;
– les couches en place de la Ville II : il s’agit d’une mince couche de gravillons située le long du massif à la même altitude que le sommet du socle est.Enfin, un sondage réalisé à l’angle nord-est du
massif, en 2006, a permis d’identifier une couche de terre brunâtre sur une épaisseur de 1,50 m. Les fondations du massif ont été noyées dans ces terrassements, à la base desquels un lit de gravillons a été repéré.
27. Parrot 1954.
Fig. 8 – Pierre dressée à l’angle nord-est du « massif rouge », octobre 2007.
Fig. 9 – Chantier Temple nord 1 : angle nord-est du « massif rouge » : alignement de pierres dressées contre
le socle du massif, état octobre 2007.
P. butterlin
100
Il est bien évidemment crucial de lier ces terras sements successifs à l’évolution du « massif rouge » lui-même et à ce blocage de pierres qui, par son ampleur, est unique dans l’architecture de la Ville II. Le sommet du socle correspond à une surface de gravillons bien marquée dans la via sacra, à la cote 179,65. En sous-œuvre, appliquée contre le socle mais pas visible, une rangée de pierres dressées protège la base du socle. Noyée dans les gravillons, se trouve la base d’une pierre dressée et on a retrouvé sur le socle, rappelons-le, une statue fragmentaire cassée. Cet ensemble a été scellé par la chute d’une grande dalle massive et le tout pris en l’état dans des terrassements de terre rougeâtre et jaunâtre. Il faut supposer que la destruction du monument a été assez sérieuse, au point de faire basculer une grande dalle de gypse du coffrage de blocs de gypse. Une explication alternative serait de considérer que l’ensemble de ces installations se trouve en fondation et correspond à d’importants travaux réalisés pour renforcer le « massif rouge » à l’est et au
nord. Cette possibilité ne nous paraît pas toutefois rendre compte de la situation observée à l’angle nord-est. En effet, il faut comprendre comment les grands blocs de gypse sont tombés : ils ont glissé dans un espace à l’air libre, en non fondation. La grande difficulté est de reconstituer, à partir de données qui restent très maigres en l’absence de tessons signifiants, l’histoire de la destruction du « massif rouge » dont l’angle nord-est a été exposé à un cycle comprenant phases de construction, réparations éventuelles et érosion de grande ampleur qui n’a laissé que peu de traces.
Il nous semble donc, au vu de ces données limitées, nous le concédons volontiers, qu’une partie du blocage de pierre (le socle en l’occurrence) est en fondation et que la partie supérieure renforçait la base du mur, notamment à l’angle nord-est de l’édifice. Le scénario que l’on peut proposer est dès lors le suivant : suite à la ruine de l’édifice, le niveau est exhaussé de 90 cm après netto-yage, avant d’être complètement noyé dans les couches
Fig. 10 – Chantier Temple nord 1, angle nord-est du « massif rouge » et stratigraphie de la via sacra.
PierreS dreSSéeS, bétyleS, urbaniSme et eSPace reliGieux à mari : nouVelleS recHercHeS au « maSSiF rouGe »
101
de terres cendreuses qui ont scellé tout le massif sous les Shakkanakkû de Mari 28. La datation de ces opéra-tions reste encore extrêmement incertaine. Le matériel recueilli dans ces couches terrassées a livré un mélange de céramiques qui paraissent plutôt dater d’une période récente ou tardive des Shakkanakkû. L’état de l’édifice lui-même au cours de cette période est difficile à estimer au vu de ce que Parrot dit avoir trouvé dès sa première campagne de fouilles dans ce secteur (« première tranchée »).
En somme, l’étude de l’angle nord-est nous livre une belle situation stratigraphique où nous trouvons :
‒ une série de pierres dressées en sous-œuvre que l’on peut comparer à la situation repérée au croisement Ninni-Zaza-via sacra plus au sud ;
‒ mais aussi une unique pierre dressée à l’angle nord-est de l’édifice.Enfin, on peut se demander si la présence au pied
de cette pierre dressée d’un orant assis est absolument fortuite : s’agit-il simplement des hasards du pillage, l’orant ayant été jeté là ou bien était-il en place et lié à la pierre dressée ? S’il était en place, on aurait dû retrouver tous les fragments de la statue. Malgré nos recherches soigneuses, seuls trois fragments ont été recueillis, si bien que l’on restera là sur cette interprétation.
En conclusion, l’histoire du secteur se présenterait ainsi :1 – terrassement de la Ville II et édification du massif
avec ses limites telles qu’on les connaît ; ce massif est doté au nord et à l’est d’un coffrage de pierres, avec semelle à l’est. À la base de la terrasse, à l’est, la surface de la rue est faite de graviers ;
2 – ruine de cet ensemble avec chute des pierres ;3 – scellement et restauration du « massif rouge », avec
dépôt de couches rubéfiées et rougeâtres sur 90 cm d’épaisseur ;
4 – enfin, l’ensemble est noyé dans des terrassements grisâtres de terre cendreuse et accompagné de la cons truc tion de puissantes fondations : le matériel céramique recueilli en contexte bien sûr secondaire date de la Ville III et ne nous donne qu’une datation très relative.
Les installations repérées à l’angle nord-est du « massif rouge » jettent donc une lumière nouvelle sur les travaux qui ont accompagné l’évolution d’un tel édifice au cœur monumental de Mari. Outre les installations religieuses repérées à la base du massif, dont nous
28. Sur l’ampleur des activités de construction des Shakkanakkû de Mari, voir en dernier lieu Butterlin 2007a avec la bibliographie correspondante.
avons donc ici un nouvel exemple, nous semble-t-il, nous avons surtout des informations sur les travaux et installations réalisés pour renforcer l’édifice du côté de la via sacra. Les pierres dressées repérées le long de la façade est de l’édifice sont à verser au dossier des pierres similaires dégagées dans d’autres secteurs de la via sacra.
On pense ici à deux exemples : d’une part, deux pierres dressées repérées le long de la façade du « massif rouge » lui-même et, d’autre part, la série de pierres dressées dégagées par D. Beyer en 1999, sous la direction de Jean-Claude Margueron. Les pierres mises au jour par Parrot, les « bornes » A et B, étaient hautes respectivement de 52 cm et de 86 cm. À la base larges de 22 cm (borne A) et 19 cm (borne B), elles s’affinaient vers le haut (borne A, 9 cm) 29. Il s’agit donc de monolithes fichés dans la rue (leur base n’a pas été atteinte), qui sont très différents des exemples que nous avons dégagés dans le secteur du « massif rouge » : ce ne sont pas des pierres aplaties mais des blocs effilés qui protègent la base du mur au niveau du croisement des deux rues. Parrot en fait un intéressant trait d’urbanisme. Önhan Tunca s’est demandé s’il ne s’agissait pas là de deux bétyles 30, mais il nous semble que la situation de ces pierres, au point où la rue s’incurve, relève davantage de la protec tion de la base des murs contre les roues de chariot, selon un procédé largement utilisé plus tard. L’interprétation de Parrot reste donc pour le moment tout à fait valable.
Les pierres dressées dégagées en 2001 sont très diffé-rentes de celles qu’a trouvées Parrot. Jean-Claude Margueron a fait une analyse détaillée de l’ensemble dans son ouvrage et on s’en tiendra à ses conclusions 31 : l’instal-lation repé rée consiste en une dizaine de dalles de gypse dressées qui dessinent un angle au point de croisement de la rue de la maquette et de la via sacra. Ces dalles ne s’appuient contre aucun mur et Jean-Claude Margueron en a conclu qu’il s’agit pour l’essentiel d’une installation en sous-sol qui était un repère topographique, deux dalles seulement émergeant au niveau de la rue. Cette installation remonte aux travaux d’aménagement de la cité et témoigne donc d’un schéma d’implantation des rues au cours des travaux. Le dallage de la rue a d’ailleurs été repéré au contact de ces pierres et la coupe publiée 32 permet de bien matérialiser le niveau d’établissement des dalles d’une part et, de l’autre, le niveau de la rue.
29. Parrot 1967, fig. 27, p. 33, description et commentaire, p. 32.
30. Tunca 1984, p. 162.
31. Margueron 2004, p. 144-145.
32. Ibid., fig. 119, p. 145.
P. butterlin
102
Ces dalles disposées en sous-œuvre ressemblent à la fois par leur format et leur disposition aux dalles que nous avons repérées, appliquées contre le mur de pierre du socle du « massif rouge ». Elles sont, comme celles du « massif rouge », situées en sous-œuvre, mais leur fonction ne nous paraît pas identique : autour du « massif rouge », les dalles sont appliquées contre les fondations d’un édifice, ce qui n’apparaît pas dans le secteur de Ninni-Zaza. Il s’agit dans les deux cas de procédés de construction.
Notons que ces installations sont liées à la via sacra et à son aménagement. Il n’est pas absolument certain que ces installations soient contemporaines les unes des autres : elles datent de la Ville II mais celles de Ninni-Zaza remontent aux travaux de construction de la Ville II, alors que les installations repérées au nord du « massif rouge » sont probablement plus tardives. Nous avons donc là tout un dossier pierre dressée / urbanisme qui se dessine, à la hauteur tant du temple de Ninni-Zaza que du « massif rouge ».
conclusion
Cette revue des données, très limitées et disparates, qu’ont livrées les fouilles de Mari sur les pierres dressées nous conduit à quelques remarques de conclusion. Il existe un évident décalage entre la documentation archéologique et ce que nous savons par les textes des bétyles utilisés à
Mari : l’écart est chronologique bien sûr, mais c’est aussi et surtout une différence d’échelle, on l’a souligné en détail. Les dimensions des pierres retrouvées en fouille sont beaucoup plus modestes que celles que donnent les évaluations les plus raisonnables des philologues. Aucune de ces grandes pierres n’a été retrouvée à Mari. Il est pourtant peu probable, vu leur poids, qu’elles aient été emmenées par les pillards de la Ville III, alors que les petits modules retrouvés en fouille peuvent être plus facilement transportés.
Toute pierre dressée à Mari n’est pas un bétyle, assurément, et toute une série d’installations repérées à Mari, qu’il s’agisse du temple de Ninni-Zaza et de la rue attenante, ou de ce que nous venons de dégager autour du « massif rouge » (rangée de pierres dressées contre le socle du massif), relèvent davantage de procédés de construction de la voierie ou des édifices.
On dispose désormais, à la suite de nos découvertes de 2007, non plus d’un seul mais de deux bétyles à Mari et d’une pierre dressée à l’angle nord-est du « massif rouge », qui a pu avoir, sous toutes réserves, une fonction religieuse.
Dans ce dernier cas, la pierre dressée se situe à un point remarquable, l’angle nord-est de l’édifice, si bien qu’urbanisme et pierres dressées présentent également un aspect religieux. C’est là une illustration supplémentaire excellente des liens complexes qui existent entre pierres dressées, urbanisme et évolution du centre monumental et religieux de Mari au IIIe millénaire.
butterlin P. 2007a, « Mari, les shakkanakkû et la crise de la fin du IIIe millénaire », in C. Kuzugluoğlu et C. Marro (éds), Sociétés humaines et changement climatique à la fin du IIIe millénaire : une crise a-t-elle eu lieu en haute Mésopotamie ?, Actes du colloque de Lyon, 5-8 décembre 2005, Istanbul, Institut français d’études anatoliennes Georges Dumézil, p. 227-247.
butterlin P. 2007b, « Les nouvelles recherches archéologiques françaises à Mari, un premier bilan (2005-2006) », Orient Express 1, p. 5-13.
butterlin P. 2008, « Les nouvelles recherches archéologiques françaises à Mari (2005-2006) », Studia Orontica II, p. 61-89.
durand J.-M. 1985, « Le culte des bétyles en Syrie », in J.-M. Durand et J.-R. Kupper (dirs), Miscellanea Babylonica, mélanges offerts à Maurice Birot, Paris, p. 79-84.
durand J.-M. 2005, Le culte des pierres et les monuments commémoratifs en Syrie amorrite, Mémoires de NABU 9, Florilegium marianum 8, Paris.
marGueron J.-C. 2004, Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Paris.
nicolle C. 2005, « L’identification des vestiges archéologiques de l’aniconisme à l’époque amorrite », in J.-M. Durand (dir.), Le culte des pierres et les monuments commémoratifs en Syrie amorrite, Mémoires de NABU 9, Florilegium marianum 8, Paris, p. 177-189.
Parrot A. 1954, « Les fouilles de Mari, huitième campagne (automne 1952) », Syria XXX, p. 196-221.
Parrot A. 1967, Mission archéologique de Mari. III, Les temples d’Ishtarat et de Ninni-Zaza, BAH 86, Paris.
tunca Ö. 1984, L’architecture religieuse protodynastique en Mésopotamie, Akkadica Supplementum II, Louvain.
BIBLIOGRAPHIE














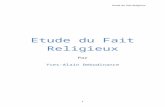
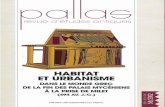







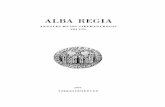
![Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ca7d5665120b3330bf65c/urbanisme-insoupconne-projeter-la-ville-egyptienne-au-nouvel-empire-unsuspected.jpg)