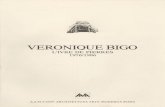[Compte-rendu] Sally Price: au musée des Illusions. Le rendez-vous manqué du Quai Branly
1974 Pierres gravées Romanies du comitat Fejér dans le lapidaire du Musée d'Eger
Transcript of 1974 Pierres gravées Romanies du comitat Fejér dans le lapidaire du Musée d'Eger
SZERKESZTŐ -RÉDACTEUR
FITZ JENŐ
SEGÉDSZERKESZTŐ—RÉDACTEUR ADJOINT
FARKAS ZOLTÁN
Kiadja A F E J É R M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S A G A
A kiadásért felel Dr Fitz Jenő megyei múzeumigazgató Készült 1250 példányban
INDEX
TANULMÁNYOK - ABHANDLUNGEN
D. G A B L E E : Sigillaten auf dem Gebiet des Palatiums von Gorsium 9
É. KOCZTUR: Ausgrabungen im südlichen Stadtviertel von Gorsium (Tác — Margittelep) 69
T. G. R A D AN : Angaben zur Frage der sogenannten „Leucht türme" 149
E. T Ó T H : Zur Entwicklung der Bezeichnung consularis der Statthalter 163
Á. N A G Y : Origine et iconographie du sarcophage de Székesfehérvár 167
fBODROG GYÖRGY: A jobbágyság kisnemesi szövetségesei az 1514. évi parasztfelkelésben 185
KÖZLEMÉNYEK - MITTEILUNGEN
F I T Z J E N Ő — BÁNKI ZSUZSANNA: Kutatások Gorsiumban 1972-ben — Forschungen in Gorsium im, Jahre 1972 195
ViSY ZSOLT: Előzetes jelentés Intercisa 1970 — 72. évi feltárásáról — Atisgrabungen in Intercisa (1970-72) 245
I. T Ó T H : Pierres gravées romaines du comitat Fejér dans le lapidaire du Musée d'Eger 265
B. SERGŐ ERZSÉBET : Népi táplálkozás és étkezési szokások Dunapentelén . . . . 273
IRODALOM - BESPRECHUNGEN
ÜRÖGDI GYÖRGY : L. L e n g y e 1, Le secret des celtes 287
G. ÜRÖGDI : J . M. С a r t e r, Die Schlacht bei Aktium 287
G. ÜRÖGDI : P . R. F r a n к e, Kleinasien zur Römerzeit 288
J . F I T Z : Spätrömische Gardehelme 289
5
Notices bibliographiques:
J . F I T Z : A. N e u m a n n, Vindobona. Die römische Vergangenheit Wiens. Geschichte, Erforschung, Funde 291
J . F I T Z : M.-L. K r ü g e r , Die Reliefs des Stadtgebietes vonCarnuntum. I. Die figürlichen Reliefs 291
J. F I T Z : S. P a h i с, Nov seznam Norisko-Panonskih gomil. Neues Verzeichnis der norisch-pannonischen Hügelgräber 291
J. F I T Z : В. C z u r d a - R u t h , Der Schatzfund von Jabling, 1934 (313 - 375 n. Chr.) 291
J. F I T Z : Claustra Alpium Iuliarum I. Fontes 292
J. F I T Z : Sirmium. Archaeological Investigations in Syrmian Pannónia . . 292
J . F I T Z : C . D a i c o v i c i u , Dacica 292
J. F I T Z : V. B e s e v l i e v , Untersuchungen über die Personennamen bei den Thrakern 292
J . F I T Z : R. S y m e, Danubian papers 292
J. F I T Z : J . W i e 1 о w i e j s к i, Kontakty Noricum i Pannoniizludami Pólnocnymi. Die Beziehungen Noricums und Pannoniens zu den nördlichen Völkern 293
J . F I T Z : H. B u s c h h a u s e n , Die spätrömischen Metallscrinia und frühchristlichen Reliquiare. I, Katalog 293
J . F I T Z : E. K e l l e r , Die spätrömische Grabfunde in Südbayern 293
J . F I T Z : W. A. R e i t z e n s t e i n , Untersuchungen zur römischen Ortsnamengebung 293
J. F I T Z : E. B. T h o m a s , Helme, Schilde, Dolche 293
SZEMLE - RUNDSCHAU
J . F I T Z : Epigraphica VI 295
J. F I T Z : Notes 297
E. T Ó T H : Epigraphisches aus Savaria 299
The Meeting of the Comission for Urban History
E. F Ü G E D I : Medieval topography of Fehérvár 303
A. KRALOVANSZKY: The early history of Alba Regia in the light of archaeological excavations 305
L. N A G Y : Some problems of the modern history of Székesfehérvár 305
G
ÉVI J E L E N T É S 1972 - JAHRESBERICHT 1972
F I T Z JENŐ : Jelentés a Fejér megyei Múzeumok helyzetéről, 1972 — Jahresbericht über die Lage der Museen im Komitat Fejér 1972 307
CSUKÁS GyÖRGYi : Régészeti kutatások — Archäologische Forschungen 309
PESOVÁR F E R E N C : Néprajzi gyűjtőutak — Etnographische Excursionen 313
Gyűjtemények, új szerzemények — Sammlungen, Neuerwerbungen 314
Kiadványok — Publikationen 314
Állandó kiállítások — Ständige Ausstellungen 315
Időszaki kiállítások — Sonderausstellungen 315
MAJOR MÁTÉ : Népi építkezés 316
Konferenciák — Konferenzen f 317
F . P E T R E S É V A : Előadások — Vorträge 318
A múzeumi kutatók irodalmi munkássága az 1972. évben — Wissenschaftliche Tätigkeit 320
Személyi hírek — Personalnachrichten 321
A Fejér megyei Múzeumok létszáma az 1972. évben — Personalstand 321
JAKAB ISTVÁNNÉ : Az 1972. évi zárszámadás — Budget 323
Állandó rövidítések — Ständige Abkürzungen 324
A kötet munkatársai — Die Mitarbeiter dieses Bandes 325
7
PIERRES GRAVÉES ROMAINES DU COMITAT
FEJÉR DANS LE LAPIDAIRE DU MUSÉE D'EGER
Lors de la mise en ordre de la réserve(1) on a retrouvé quatre pierres gravées romaines dans le lapidaire du Musée „István Dobó" de la ville d'Eger. Trois de ces pierres ont été transférées au musée de lapidaire de l'ancien Lycée Archiépiscopal<2), la quatrième est d'origine inconnue. Nous savons que les trois pierres furent acquises à la collection du Lycée<3) de la succession de G y u l a B a r t a l o s (1839 — 1923), chanoine titulaire, l'un des initiateurs du musée à Eger. D'autre part, il n 'y a aucune indication à trouver la succession manuscrite de Bartalos — conservée d'ailleurs dans les Archives Archiépiscopales de la ville — qui nous dirait, quand et comment Bartalos lui-même avait acquis ces monuments. ( i )
1. Pierre d'autel. Site: Erd (aujourd'hui: Comitat Pest, autrefois: C. Fejér).(5) Pierre calcaire d'un blanc grisâtre, très poreuse. Endommagée à plusieurs endroits: le abacus est complètement défrité (aucune trace des anciennes décorations), le tronc est transversalement cassé en deux pièces {fig. 1.). Hauteur: 89 cm, largeur maximale mesu-
( 1 ) Les monuments furent trouvés par Á r p á d N a gy. L'auteur tient à lui exprimer ses profonds remerciements pour avoir cédé le droit de publication ainsi que les photographies, et pours on assistance valable au présent travail.
(2) M. SZMRECSÁNYI, Az egri Érseki Liceum lapidáriu-rndnak tárgymutatója (Catalogue du lapidaire du Lycée Archiépiscopal d'Eger). Eger, 1932, 5, 1/1-3. Cette courte description se limite à nommer les trois monuments de pierre, et à en publier les sites et les principales dimensions, sans donner une analyse des inscriptions ni d'en publier le texte.
(3) M. S Z M R E C S Á N Y I , О. С. (4) L'héritage fut examiné par Á r p á d N a g y que
je remercie à cette occassion de ses informations Я ТХЛ1 С* Я 1 (~* Й
(6) R. FRÖLICH, AEM, XIV, 1861, 60.; I D . , A Fejérvármegyei és Székesfejérvár városi történeti és régészeti egylet Évkönyve, Annales de la société historique et archéologique de la ville Székesfehérvár et du Comitat Fejér. I I , 1893, 150.; GIL, III, 10377 ;A. ALFÖLDI, AÉrt, 1940, 195.; T. NAGY, Budapest története I (L'histoire de Budapest), 1942, 417.; A. MÓCSY, Die Bevölkerung von Pannonién bis zu den Markomannenkriegen. Budapest, 1959, 70, 190/1 G. ALFÖLDY, AntTan,'VI, 1959, 21, note 20. Le site
rée à la moulure frontale et au plintlios^^ 42 cm. Profilée de trois cotées, fond rustique en ligne droite. La moulure abacus (hauter: 6 cm) et le socle (hauteur: 15 cm) sont rénuis au tronc de l'autel par un profil composé de rainures et languettes. Hauteur du tronc: 43 cm, largeur: 31 cm, épaisseur: 25 cm.
Les 6 lignes de l'inscription se trouvent à la face du tronc; quoique défraichies, les lettres sont nettement gravées et en général de forme régulière. La surface disponible est remplie proportionnellement par la légende.
Lecture: Libero/patri sac(rum)/M(arcus) Vlp(ius) Qua /dratusj5 dec(urio) m{unicipii) Aq(uincensium) q(uin)q {uennalis?-uennalicius?) u(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
D'après la citation de municipium Aquincense la date d'origine de l'inscription peut être fixée entre les années 124 et 194.- Selon les résultats des recherches sur l'historié de la population, l'autel peut être daté avec la plus grande probablité à la période précédant les guerres marcomanes, soit à l'époque de Hadrianus au Antoninus Pius.">
Comme tous les décurions(8) connus aujourd'hui de municipium d'Aquincum, M. Ulpius Quadratus fut d'origine autochtone et descendit de cette aristocratie indigène(9)
qui obtint assez tôt les droits civiques et dont les domaines
du monument est indiqué à faux par T. NAGY, О. С , ; l'autel Liber-Libera, OIL, III, 10359, est originaire de Etyek. A. ALFÖLDI, О. С , compte cet autel aussi parmi les monuments ammenés d'Aquincum, ce qui fut réfuté par les recherches ultérieures (T. NAGY, О. С. G. ALFÖLDY,O. С. ). Cf. encore la littérature citée par la note No. 14.
(6) A. ALFÖLDI, SZ, LXX, 1936, 30. et ID . , Bp. Tört. 1/1, 274, A. MÓCSY, AÉrt, LXXVIII, 1951, 107. et I D . , RE, Suppl.IX, 1962, col. 599. - Sur la promotion de la ville au rang d'une colonie cf. B. KTJZSTN-SZKY, JÖAI, II, 1899, Bb. 58.
(7) Cf. A. MÓCSY, Die Bevölkerung, passim. (8) Ibid., 70 et ID, о. с , R E Suppl. IX, 1962, col._588. (9) Sur l'attribution des droits civiques aux environs
d'Anquincum par Trajan, cf., ID . , Die Bevölkerung, 70.
265
se trouvèrent sur le territoire de la ville.(l0) Liber paler, le dieu de la viticulture et, en général, de l'agriculture,<U)
entre en scène sans doute comme le protecteur divin des travaux agricoles dans les domaines de M. Ulpius Quadratics. En plus des traits gréco-romains classiques, sa figure représente en même temps les ideations religieuses de la population locale éravisque.(12) Il est hors de doute que l'autel dont, il est question ici et qui fut érigé par un Eravisque ne représenta pas seulement l'aspect latin et romain de Liber mais aussi les traits de différentes divinités tribales et indigènes qui, certainement, en différèrent considérablement.
11 y a toutefois encore une circonstance qui mérite d' être notée. 11 existe notamment encore une pierre d'autel que ce même M. Ulpius Quadratus a dédié à luppiter optimus maximus.<13) Cette inscription fut trouvée à Székesfehérvár, parmi les ruines de la Basilique Royale, à un site secondaire. Autrefois la science proposa Aquincum comme lieu d'origine, alors que les recherches récentes tâchent de faire accepter Gorsium.(14) Ce n'est, de notre
! (10) Cf., T. NAGY, о. c, en détails: G. ALFÖLDY, AntTan
VI, 1959, 19. Sur la distribution des domaines du territoire d'Aquincum entre indigènes et étrangers cf. A. MÓCSY, Die Bevölkerung. . . 70.
(11) Cf., en général G. Wissow A,' Myth. Lex., II , 1894-1897, 2021, et récemment A. BRÜHL, Liber Pater. Origine et expansion du culte Dionysiaque à Rome et dans le Monde Romain, Paris, 1953, 355.
(12) T. NAGY, О. С, 414; С. ALFÖLDY, AArchHung, XIII, 1961, 106.
(13) СП III 10334 ( = 3348) (14) A. ALFÖLDI, AÉrt, 1940, 195, et J. FITZ, A Fejér
megyébe hurcolt római kövek kérdéséhez — Zwr Frage der ins Komitat Fejér verschleppten Steindenkmäler aus der Römerzeit. IKMK A/7, 1958, 6 - П . ; J . FITZ, A római kor Fejér megyében — L'époque romaine en comitat Fejér. Fejér megye története 1/4, 1970, 23.; ID. , Alba Regia, XI, 1970, 152. — Quant au résumé complet des examens y relatifs et la mise au point des problèmes y posés, cf., ID . , AArchHung, XXIV, 1972, 45.
avis, pas par hasard que le décurion a choisi le chef-lieu de la province soit le centre du culte provincial impérial pour y ériger un autel dédié à la principale divinité de l'Etat, en démontrant aissi sa propre loyauté<15), alors que l'autel de Liber, exprimant aussi les ideations religieuses indigènes, fut érigé dans une agglomération provinciale effleurée ancore à peine par la romanisation. En Pannonié aussi ce furent les étrangers qui introduisirent le culte des dieux indigènes sous des noms romains,(1C)
ayant acquis les droits civiques, les classes dirigeantes de la population autochtone furent les premières à adopter les éléments formels du culte romain, y compris le coutume d'ériger des inscriptions.07* L'autel de Liber que nous venons d'analyser est également un exemple de ce groupe d'inscriptions, et nous avons toute raison de croire que ces autels érigés dans les agglomérations provinciales ont exercé une influence sur la mentalité religieuse de la population autochtone aussi.
2. Fragment d'une dalle tombale. Site: Men- (Comitat Fejér).0 8 ' Pierre calcaire d'un gris clair. Endommagé de deux côtés : la partie supérieure — probablement décorée de reliefs — est perdue, de même que la vignette gauche de l'inscription. Le champ avec l'inscription est presque intacte, ce n'est que la I™ ligne qui est endommagée, et — à partir de la 6e ligne — une ou deux lettres manquent d u commencement d u texte. (fig. 2 .^Hauteur act i telle du fragment : 1 33 cm, largeur en haut : 98 cm, en bas : 61 cm. A droite, dans une bande large de 17 cm, il y a une bordure et un motif fleuronné. Largeur maximale du champ avec l'inscription (en haut): 82 cm, hauteur: 83 cm. Epaisseur de la la (lalle : 1 9 — 22 cm.
Tout ce qui est resté de la décoration, c'est une bordure composée d'un rang de feuilles aux tiges ondulées. Ces feuilles cordiformes un peu allongées furent généralement répandues en Pannonié Orientale au début du 11 Ie siècle auquel le monument peut être daté avec certitude d'après la légende. Puisque l'inscription nous permet de supposer des contactes avec la légion de Brigetio, il n'est que logique de comparer ces décorations avec des détails similaires des pierres sépucrales de Brigetio.°!)) Certes, ce motif ne suffit pas à attacher définitivement ce monument aux ateliers des tailleurs de Brigetio, mais cette possibilité doit quand même être en considération.
La plupart de l'inscription est bien lisible, et et; ne sont que les signes 5 — 6 et 8 qui causent quelques difficultés de l'interprétation. ( 1re ligne : immesurable, 2e ligne : 5 cm, 3 — 4e ligne : 6 cm, 5eligne: 5 cm — la lettre réduite: 3,5 cm, 6e ligne: 4,5 — 5,5 cm, 7 — 8e ligne: 5 — (i cm, 9e ligne: 5 cm.) П y a plusieurs eigatures dans le texte: AVR (lignes 3, 6, *7, ANN (aussi) (4e ligne), XXVI1! (5e ligne). Traits caractéristiques: la hampe qauche oblique de la lettre N, et la gravure permettant de confondre les lettres I, L et T. U n'y a pas de différence visible entre С et G. Les petits signes foliacés séparatifs se trouvent pour la plupart à leur place (entre les mots), ils manquent cependant à la fin de la 2e ligne, dans la seconde moitié de la 5e et dans la 7e après ET.
lre ligne: La pierre est cassée en haut vers le milieu des lettres D et M qui sont néanmoins nettement reconnais-sablés de leurs restes.
(15) Ibid. (16) A. MÓCSY, Die Bevölkerung. . . 125., ID . , RE, Suppl.
IX, 1962, col. 743. (17) Cf. Le culte de luppiter — Iuno Regina ramenable
a des antécédents indigènes ;ï Aquincum et environs : T. N A « Y , o. c, 407.; G. ALFÖLDY, О. С, 106, les inscriptions dans la note No. 23. Récemment: D. GABLER, AÉrt, XCIV, 1967, 194.
(18) M. SZMRECSÁNYI, 0. С, 5. (19) Cf. L. BARKÓOZI, Brigetio. DissPann, 11/22, 1944,
1951, IL t. 4, VII. t. 2, X. t. 2, X. t. 2, XIV. t. 2, ainsi que XIX. t. 2, 3, (grappes au lieu des feuilles) et LU. t. 2 (feuilles d'un côté, grappes de l'autre). — Quant aux ateliers des tailleurs de pierre de Brigetio cf., ibid. 35, avec littérature complémentaire,
266
Fig. 2.
4e ligne: La lettre A n'est pas barrée dans la ligature ANN.
5e ligne: La lecture de la seconde moitié de la ligne est rendue difficile par l'absence de la ponctuation, par le fait que les lettres peuvent être confondues et, en plus, par une erreur du tailleur. Après les lettres nettement lisibles meriewí^o^í^ imo^nouslisonsles caractères suivants: ORIIBITE.
6e ligne: Au commencement de la ligne, près de la ligne de rupture, il y a la tige inclinant à droit du signe sépa-ratif, et immédiatement après: TEV. Tenant compte de la place de ce passage dans la légende (après le nom du mort) ainsi que des déformations résultant de l'entassement des caractères, nous aurons les alternatives suivantes pour la lecture de la ligne en question : mer(enti) opt(imo) o(r) (to) (sit) tibi te/\_r(ra)~] leu (is) ou mer(entissimo) optor (sic!) (sit) tibi te/[r(ra)~\ leu(is). La permutation des lettres P et R (dans la première variante) et l'emploi d'une forme flexionnelle incorrecte (dans la deuxième) s'expliquent probablement par une erreur du tailleur.(20)
(20) Cf., sur les fautes d'écriture se trouvant dans les inscriptions de l'époque des Sévères A. MÓCSY, RE, Suppl. IX, 1962, 767, avec littérature.
Le nom du père étant inconnu sous cette forme, il est justifié de le compléter à la forme fréquente de Mode(s)-fo.<21)
7 — 8e ligne: A la fin de la 7e ligne se trouve la mot SGENVEM ou SCENVEM, dont la suite est cassée du commencement de la 8e ligne. Puisqu'il s'agit ici du cognomen de la mère, le mot se laisse peut-être compléter à la forme Scenuern(ae) et se rattacher aux noms illy-riens dérivant de radicales similaires.<22)
9e ligne: Devant le mot po(suit) c'est l 'attribut des parents — pi(entissimis) — qui nous paraît le mieux motivé.
Ainsi le texte complet se lit comme suit: D(is) m(ani-bus)jAel(ius) Nigrinus mil(es) leg(ionis) 1 /Ad(iutricis) Se(uerianae) stra(tor) con('sularis) Aur(elio) Vic/tori fratri
(21) Cf., CIL, III, Indices s. v. (22) A. MÓCSY, Die Bevölkerung. . . 189.; L. BARKÓCZI,
AArchIlung, XVI, 1964, 323; A. MEYEB, Die Sprache der alten Illyren. Wien, 1957, 312; I. I. RTJSSTI, Illirii. Bucuresti, 1969, 245,
267
qui uic(sit) (sic!) ann(is)/5 XX VI11 mer(enti) opt(imo) o(r)to ou mer(entissimo) optor (sic!) (sit) tibi te/[r(ra)] leu(is) Aur(elio) Mode(s)to uet(erano) le/g[(ionis)I~\ Ad(iutricis) Se(uerianae) et Aur(eliae) See-nuem/[ae?~\ uiu(u)s uiuis par(entibus) suis [pi(entissi-mis)~\ po(suit).
La pierre tombale fut donc érigée par Aelius Nigrinus, soldat de la legio I Adiutrix, à la mémoire de son frère, Aurelius Victor, qui a vécu 28 ans, ainsi que de ses parents Aurelius Mode(s)tus, vétéran de la legio I adiutrix, et Aurelia Scenuemlfi?], tous les deux encore en vie.
Figurant même deux fois, l'épithète de la légion nous permet de dater le monument avec certitude au règne de Sévère Alexandre (222 - 235).<23)
Ce qui doit nous surprendre en lisant les noms des personnes, c'est que le nornen du fils (Aelius) diffère de celui des parents et du frère ( Aurelius ) . i u )
Puisque dans ce cas la date de l'inscription ne nous permet pas de penser que Aelius Nigrinus aurait reçu l'indigénat de l'empereur Hadrien encore avant son père et les autres membres de sa famille, il s'impose l'hypothèse qu'il n'était pas le fils consanguin, mais un adoptivus, c' est á dire fils adoptif de Aurelius Mode(s) tus.i25)
Le nornen des autres est, probablment en rapport avec la réforme du droit civil introduite par Caracalla en 212.(2,i) En ce qui concerne les cognomina, Mode(s)tus s'emploit fréquemment surtout en Italie Septentrionale et dans la Gaule méridionale, mais se retrouve souvent en Pannonié et dans les provinces danubiennes aussi.<27)
Le cognomen Scenuem\_a?~\ d'une finale incertaine mais d'une radicale certaine est un nom illyrien appartenant probablement à une personne indigène d'origine azale.(28)
Le nom Victor fut très populaire dans tout l'Empire, notamment dans les familles de soldats.(29) Ainsi les personnages nommés dans l'inscription sont à regarder comme (les indigènes, ce qui est conforme avec le fait bien connu qu'il y avait, au début du IIIe siècle, beaucoup de soldats et de vétérans de la legio I adiutrix qui étaient des indigènes ayant obtenu tout récemment les droits civiques.(30> Dans le cas de notre Aelius Nigrinus ее nom rappelle surtout les environs d'Aquincum.<31)
Son affectation militaire} — strator consularis — montre qu'il s'agit d'un simple soldat détaché de la légion stationnée à Brigetio à l'officium du gouverneur à Aquincum.
Il est surprenant de trouver môme plusieurs fautes d'écriture dans l'inscription qui, cependant, ne se conçoivent pas toujours comme des erreurs du tailleur de pierre, comme dans le cas de o[(r)~]to = opto (5e ligne). L'autre alternative de la lecture — optor — serait déjà une faute grammaticale plus grave, alors que vic(sit) — = vixit (4e ligne) est une faute orthographique résultant de l'ignorance considérable de la langue écrite. La forme
(23) Cf., J. FITZ, AArchHung, XIV, 1962, 106. (24) Le terme fráter n'est pas à interpréter comme
„frère d'armes" puisque le nom du mort — Aurelius Victor — n'est pas suivi de la spécification de son rang militaire; par ailleurs, cette possibilité est exclue par le terme par(entibus) suis qui se rapporte nettement à Aelius Nigrinus.
(25) Une situation similaire cf. : CIL, III, 11049 = L. BARKÓCZI, Brigetio No. 47: D. M. Aur. Ursinae sorori posuit Sep. Atta fráter, etc.; Ibid., No. 115: D. M. Gla. Verecundum. . . et Aur. Gelsianum qui et Placidum . . . Aurelius Celsinianus 7 leg. I. ad. et Ulpia Atticilla parentes infelicissimi etc.
(26) ID. , AArchHung, XVI, 1964, 294. (27) Cf. note No. 21 et L. BARKÓCZI, О. С, 318, s. v. (28) Cf. note No. 22 et A. MÓCSY, Die Bevölkerung. . .
189, s. v. Scenobarvus, Scenus, 71/1. (29) Cf., L. BARKÓCZI, О. С, 327, s. v. Victor, Victorianus. (30) Ibid., 272, 274. (31) Ibid., 277, quant a Aelius Nigrinus cf. A. MÓCSY,
BE, Suppl. XL 1968. col. 80.
Mode(s)to et l'abrévation inusitée de con(sularis) — co(n) s(ularis) appartiennent aux fautes d'écriture se retrouvant assez fréquemment dans les inscriptions en Pannonié (et des provinces danubiennes en général), et provenant de connaissances linguistiques superficielles ou de l'inexpérience dans l'écriture.(32)
3. Fragment d'épitaphe. Site: Mór (Comitat Fejér).(33)
Pierre cascaire grisâtre. La table oblongue sans bordure consiste à présent de deux fragment appareillés. La côté d roi te est incomplète, il en manque àpeuprès un tiers, (fig.3.) Longueur des deux pièces : 75 cm (47 -f 28) ; hauteur : 31 cm, épaisseur: en haut 15 cm, en bas 13 cm. Originairement c'était vraisemblablement une partie d'un monument funéraire important (groupe cinéraire?); le manque de la bordure et l'épaisseur diminuant de haut en bas en sont les indices/34 '
Les trois lignes de l'inscription sont soigneusement gravées et bien lisibles : M(arcus) Aurelius Do[ ] /ueter(anus) ex benef(ci-ario) co(n)s(ularis) \leg(ionis) I ou / / Ad(iutricis) ?~\ sanctissim(ae) m[atri p(osuit) ?\
C'est d'après la coutume d'ériger des tombeaux majeurs ou des groupes cinéraires que nous saurons définir primairement l'origine du monument en question; conformément c'est au premier tiers du III e siècle qu'il y a lieu de penser avec la plus grande probabilité.<35)
La même époque s'impose comme date d'origine en vue des belles formes des caractères et du nombre relativement bas des ligatures (2e ligne: benEF), ainsi que de l'emploi fréquent d'attributs éthiques comme sanctissi-mus et autres.(3C)
En ce qui concerne le nom du donateur, nous n'en connassions aven; certitude que M(arcus) Aurelius, alors nous devons renoncer a compléter le cognomen puisqu'il y a encore beaucoup d'autres possibilités en plus des deux alternatives les plus fréquentes: Do\mitius~] et Do[natus~].(37) Le nornen gentile lequel doit peut être son origine a l'un des empereurs Marc Aurele, Commode ou Caracalla, ne laisse pas identifier l'origine du personnage. Par le fait que les monuments funéraires plus grands et plus coûteux sont à observer en Pannonié Orientale surtout parmi la population orientale,<38)
c'est peut-être une famille orientale que nous puvons supposer dans ce cas.
Il est surprenant que la légende ne nomme pas le défunt à la mémoire duquel l'épitaphe fut érigée. Vu que dans la forme actuelle de l'inscription le nom de personne n'y aurait pas de place, nous supposons qu'il était inscrit sur une autre table, à une autre partie du monument.
4. Fragment d'épitaphe. Site inconnu. Grès d'un gris jaunâtre, tes poreux, (fig. 4.) Largeur: 45 cm, hauteur: 36 cm. Epassieur inégale, maximum: 20 cm.
(32) ID . , BE, Suppl. IX, 1962, 767, avec littérature complémentaire. ID . , Die Gesellschaft und Romani-sation in der römischen Provinz Moesia Superior. Budapest, 1970, 212.
(33) M. SZMRECSÁNYI, О. С, 5. (34) Le manque de la bordure porte à supposer l'incor
poration dans un cadre architectonique. Cf., L. NAGY, Bp. Tört., I, 1942, 479.
(35) Ibid., 473, 479.; A. MÓCSY, BE, Suppl. IX, 1962, 726.
(36) Cf., G. AIJFÖLDY, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatien. Heidelberg, 1969, 29.
(37) Cf., A. MÓCSY, Die Bevölkerung. . . 172, L. BARKÓCZI AArchHung, 16, 1964, 310.; I . KAJANTO, The Latin Cognomina. Helsinki-Helsingfors, 19657 s. v,
(38) L. NAGY, О. С
268
Fig. 4.
L'inscription est presque complètement effacée, il n 'y la 2e ligne était peut-être pa\f\ent\ibus\. La terminaison a que quelques fragments de mots a reconnaître: . . .NO NO laisse supposer que la 3e ligne contenait également P O M P . . . / . . . В ? AINT / I . . . / . . . F I I N O . . . / . . . un nom de personne en datif, alors que la 4e ligne laisse FR?IPETI . . . / plutôt penser à une forme conjuguée du verbe eripio.
Dans la première ligne se trouvait probablement le nom du défunt en datif: . . . /no Pomp[eio? -onio? etc.} I. Tóth
269













![[Compte-rendu] Sally Price: au musée des Illusions. Le rendez-vous manqué du Quai Branly](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313f5353ed465f0570aea38/compte-rendu-sally-price-au-musee-des-illusions-le-rendez-vous-manque-du-quai.jpg)




![L'Évangile de Judas, de la tombe au musée. L'épopée rocambolesque du manuscrit damné [2006]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ef3ea0ff042c6110c9cb3/lievangile-de-judasi-de-la-tombe-au-musee-lepopee-rocambolesque.jpg)