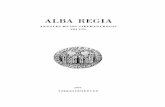Chemical composition of urban aerosols in Toulouse, France during CAPITOUL experiment
Un nouvel antoninien de Julia Domna au buste sans croissant dans le médaillier du musée...
Transcript of Un nouvel antoninien de Julia Domna au buste sans croissant dans le médaillier du musée...
JJOOUURRNNÉÉEESS NNUUMMIISSMMAATTIIQQUUEESSMMOONNTTAAUUBBAANN44--66 JJUUIINN 22001100
Bulletin de la Société Française de Numismatique53es Journées Numismatiques de Montauban
65e année — n° 6 — juin 2010
Société Française de NumismatiqueMédaille des Journées numismatiques de Montauban
Son dessin est inspiré de la célèbre médaille des « mendiants de Montauban »
Au droit : Le saule étêté sans feuilles, emprunté aux armoiries de Montauban, portant dansl’axe du tronc les trois lettres SFN, et sur le tertre JUIN 2010. À 5 h Signature : J.P.GARNIER . Grénetiscordonné.
Au revers en quatre lignes : JOUR-/NÉES./DE.MON-/TAVBAN (AV liés), en dessous signatureen monogramme.
Médaille en étain, fondue et patinée.Tirage : 60 exemplaires (hors épreuves d’auteur).Diamètre moyen 67 mm hors bélière.
Prépresse : Cymbalum – ParisImprimerie France-Quercy — Mercuès
BULLETIN DE LA SOCIBULLETIN DE LA SOCIÉTÉFRANFRANÇAISE DE NUMISMATIQUEAISE DE NUMISMATIQUE
— 129 —
Publication de la Société Française de Numismatique
65e année — N° 6 JUIN 2010
SOMMAIRE
ÉTUDES ET TRAVAUX
BERDEAUX-LE BRAZIDEC (Marie-Laure) et LE DANTEC (Jean-Pierre) —Monnaies gauloises de Midi-Pyrénées dans les collections du muséed’Archéologie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
GENEVIÈVE (Vincent) — Un nouvel antoninien de Julia Domna au buste sanscroissant dans le médaillier du Musée Saint-Raymond, musée des Antiquesde Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
CRINON (Pierre) et CHWARTZ (Bernard) (†) — Deux exemples de soulèvementaquitains illustrés par des monnaies inédites, l’une de Marseille, l’autre deCahors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
PARVÉRIE (Marc) — La circulation des dirhams d’al-Andalus entre Gascogne et Aquitaine au IXe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
DIAZ (Jean-Marie) — Denier d’Eudes retrouvé pour Toulouse . . . . . . . . . . . . .150PROT (Richard) — Une monnaie inédite de Raymond VII de Turenne (1285-
1304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153BERDEAUX-LE BRAZIDEC (Marie-Laure), MEISSONNIER (Jacques) — À propos
de la signature d’un jeton des États de Bourgogne de 1688 au Musée deMontauban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
TURCKHEIM-PEY (Sylvie de) — Le jeton de l’Académie de Montauban . . . . .159GARNIER (Jean-Pierre) — Les médailles de mendiants. À propos de quelques
types inédits pour les mendiants de Montauban et du département de Tarn-et-Garonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
BERDEAUX-LE BRAZIDEC (Marie-Laure) — La collection numismatique de J.-U. Devals au musée Ingres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
JOYAUX (François) — Entre numismatique, médecine et magie. La collection demonnaies sino-vietnamiennes d’un érudit toulousain : le Dr Albert Sallet . .180
CORRESPONDANCECOUPLAND (Simon)— Le trésor de Bourgneuf-en-Retz et les monnaies de
Melle au monogramme d’un roi Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
SOCIÉTÉCompte rendu des séances des 4 et 5 juin 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
dans l’Aveyron. Or nous pouvons rapprocher cette monnaie d’un courrier de l’abbé Cérèsconservé dans les papiers Barthélemy (3), daté de Rodez du 3 août 1881 ; cette lettreest en effet accompagnée d’une empreinte sur papier d’une « jolie gauloise » quel’abbé Cérès vient juste de trouver (il écrit « toute à l’heure ») et qu’il n’a pu joindre àl’envoi d’objets et de monnaies destiné à A. de Barthélemy qu’il avait déjà préparé. Maisil précise toutefois qu’il attend l’occasion « de lui transmettre en nature ». L’abbé Cérèsdécrit ensuite la pièce de la façon suivante : « La tête à droite barbue avec moustachependante paraît ceinte d’un bandeau dont on aperçoit à la nuque le nœud flottant. Onvoit au revers un cavalier marchant à droite, fort drôlement coiffé, et portant uneespèce de cravache à la main. On lit assez bien à l’exergue la légende TATINO. » L’abbéprécise alors qu’il ne se rappelle pas avoir vu de gauloise semblable. Et il ajoute : « Jevoudrai bien vous donner la douce satisfaction d’une nouvelle découverte et le plai-sir d’ajouter, à la suite de tant d’autres que vous avez su tirer des ténèbres, un nouveauchef gaulois ». Ce courrier, inédit, nous permet donc sans doute de faire le lien entrela monnaie conservée au MAN et celui qui l’a transmise à A. de Barthélemy, sansconnaître pour le moment le mode d’acquisition (achat ou don ?). Quant à la prove-nance exacte, elle n’est malheureusement pas mentionnée.
Département de la Haute-Garonne Le département de la Haute-Garonne a également connu plusieurs découvertes dans
le courant du XIXe siècle, mais nous n’en avons pas trace apparemment dans les col-lections du MAN.
En revanche, le MAN a acquis à la vente de la collection Soulage (4), de Toulouse,250 monnaies d’argent gauloises provenant du site de Vieille-Toulouse. Cette impor-tante série n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie.
Département du LotLe Lot est illustré dans les collections du MAN par deux trésors et par deux séries
de monnaies de fouilles de la seconde moitié du XIXe siècle.- Le premier trésor est celui de Cuzance, découvert en 1878. Il comportait environ
4000 monnaies à la croix, dans un vase. Le MAN en conserve 27 exemplaires (inv. num.3391 à 3410, 3431 et 6 sans numéro), dont deux sont issus de la collection Forrer etun à la légende LVXTIIRI (inv. num. 3431). Ce dernier exemplaire est de même typeque BN 4369a, mais de couplage de coins différents et répond à la description suivante :
A / Entre deux pentagrammes aux extrémités bouletées, figure la légende LVXTIIRIdisposée en deux lignes horizontales.
R/ Croix cantonnée de quatre symboles (sceptres fleuronnés ou enseignes, rappe-lant le motif figurant au-dessus du cheval sur les exemplaires en bronze).
Les autres exemplaires examinés sont tous de type mosaïqué au droit. Cependantil faut distinguer l’exemplaire MAN 3403 qui présente au droit un type à la tête trian-gulaire, le revers ne laissant voir dans un canton que la hache, mais le poids de 1,29 gne semble laisser aucun doute sur son appartenance au type dit de Cuzance.
Nous savons que la plupart des monnaies conservées au MAN ont été achetées parA. de Barthélemy auprès de plusieurs des collectionneurs qui en avaient recueillies (5).
3. Archives du Cabinet des médailles, 2 APM 11, dossier Aveyron.4. É. de NIEUWERKERKE, Rapport sur la situation des musées impériaux pendant le règne de
S. M. Napoléon III (1853-1869), Paris, 1869, p. 143.5. Bull. de la Soc. scient., hist. et archéol. de la Corrèze, III, 1881, p. 330.
— 131 —
BERDEAUX-LE BRAZIDEC (Marie-Laure) et LE DANTEC (Jean-Pierre) — Monnaiesgauloises de Midi-Pyrénées dans les collections du musée d’Archéologie nationale.
Le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye conserve de nombreusesséries de monnaies gauloises et romaines qui sont actuellement en cours de récolement(1). Les monnaies de la période romaine ayant déjà été présentées dans leur ensemblelors des Journées numismatiques de Saint-Germain-en-Laye en 2008 (2), nous avonspensé mettre à profit celles de Montauban pour faire un point sur les trésors et les mon-naies de l’époque gauloise provenant de la région Midi-Pyrénées.
Les lots de monnaies gauloises du MAN sont pratiquement tous entrés dans les col-lections pendant la seconde moitié du XIXe siècle, par dons ou achats. Nous n’avonspas cependant le détail précis de toutes ces acquisitions, car l’histoire des collectionsnumismatiques reste encore en grande partie à établir. Les principales informations quenous ayons comme source, en dehors du type même des monnaies, sont les indicationsportées sur l’inventaire numismatique, tenu à partir de juin 1867 par Anatole deBarthélemy.
À partir de cet inventaire principalement, nous pouvons ainsi présenter une listede fragments de trésors et de monnaies de fouilles provenant de la région Midi-Pyrénées.
Département de l’AveyronL’Aveyron est riche de découvertes monétaires au XIXe siècle, avec notamment l’en-
semble exceptionnel de Goutrens. Ce trésor est attesté dans les collections du MAN,ainsi que celui de la Loubière ; par ailleurs, il se trouve quelques monnaies isolées etun lot de provenance imprécise.
– Du trésor de Goutrens, découvert fin 1867, le MAN conserve un lingot d’argent(inv. Duval 1475) et 26 monnaies d’argent (inv. num. 2398 et 2399, 2405 (?), 4656 à4679 et 4733 à 4742, soit 37 inscrites à l’inventaire) : 13 de type LT 3433 au sanglierattribuées aux Rutènes et 13 de type BN 3476 dit type de Goutrens, également don-nées aux Rutènes.
– Du trésor de La Loubière, commune de Maleville, inventé vers 1875 mais dontl’histoire semble plus complexe et ancienne, le MAN offre 7 monnaies d’argent (inv.num. 4680 à 4686), dont quatre sont indiquées comme don de l’abbé Cérès, de Rodez.Ces monnaies se répartissent entre les types LT 3132 et variantes dit type cubiste, attri-bué aux Volques tectosages, le type LT 2956 variante, le type LT 3108 variante et le typeSavès S302, tous les trois attribués aux Longostalètes.
– Il existe aussi une petite série de « monnaies trouvées dans l’Aveyron » (inv.num. 3031 à 3045), soit 15 exemplaires, dont la provenance précise n’est pas connue.Il s’agit de monnaies de type LT 2956 variante, LT 3104 , LT 3108, LT 3111 et LT 3132.
– Enfin, il se trouve une monnaie rutène à la légende de revers TATINOS et cava-lier à droite (inv. num. 3429) (LT 4383, RIG 278 ; 2,61 g), indiquée comme découverte
1. J.-P. Le Dantec, chargé de mission au MAN pour les monnaies gauloises.2. M.-L. BERDEAUX-LE BRAZIDEC, coll. H. CHEW, « Les collections numismatiques du dépar-
tement gallo-romain du musée d’Archéologie nationale », BSFN, juin 2008, p. 118-124.
— 130 —
ÉTUDES ET TRAVAUX
le MAN conserve plusieurs monnaies provenant du site de Cosa, entrées grâce à l’in-termédiaire de J.-U. Devals.
– De Cosa, le MAN possède ainsi de façon certaine neuf monnaies à la croix,achetées par J.-U. Devals fin 1871 pour le musée et remises à A. de Barthélemy ; ellesont été enregistrées sous les numéros d’inventaire numismatique 2491 à 2499 ; tou-tefois, elles ne sont plus actuellement en place (les étiquettes existent, mais les mon-naies ne sont pas localisées). Il faut d’ailleurs très certainement les lier, de manière erro-née, à l’information signalée dans le Dictionnaire archéologique de la Gaule (II, 1923,p. 263) qui n’hésite pas à parler d’un « important trésor de monnaies à la croix », décou-vert à Cosa ; il y a sans doute eu confusion entre le petit lot provenant du site et un tré-sor supposé, qui n’est pas attesté à l’heure actuelle.
Enfin, il faut également signaler un lot important de monnaies à la croix, totalisant107 exemplaires qui n’ont pas été réexaminés pour le moment (inv. num. 3270 à3376), dont la provenance n’est pas indiquée sur le registre et donc inconnue actuel-lement. Il pourrait s’agir d’un lot provenant d’un trésor présentant des quantités consé-quentes. G. Savès (6) en a publié deux exemplaires, tous les deux du type dit deGoutrens (Savès n° 261 p. 176 : MAN 3296, sans poids et n° 262, p. 176 : MAN 3341,sans poids).
Notons pour terminer que nous ne disposons pas d’éléments concernant les dépar-tements du Gers, qui a pourtant livré des trésors gaulois, de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées, ces deux derniers toutefois pauvres en la matière.
Voici donc les éléments actuellement relevés, concernant les découvertes moné-taires gauloises de Midi-Pyrénées conservées au MAN. Les études de ces différents lotsrestent encore à faire et d’autres informations viendront sans doute compléter pro-chainement ce premier état de la question.
6. G. SAVÈS, Les monnaies gauloises « à la croix » et assimilées du sud-ouest de la Gaule : exa-men et catalogue, Toulouse, 1976.
1. J.-P. GARNIER, « Un antoninien de Julia Domna sans le croissant (Rome, 215 ap. J.-C.) », BSFN,5, 1989, p. 576-577.
2. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France, Inv. 6648 BnF ; pds 5,24 g.
— 133 —
– Le second dépôt est celui d’Uzech-les-Oules, inventé en 1880 à un kilomètre duvillage. Il était composé d’environ 30 imitations de Rhodè et deux monnaies à la croixde type cubiste. Le MAN en conserve les deux monnaies à la croix de type cubiste(série 1, variété 1 de Savès, dont un droit mosaïqué) et trois imitations de Rhodè ou pièceslourdes de type dégénéré (inv. num. 4334 à 4338 et inv. gén. 28223), avec deux tes-sons du vase. Elles sont entrées au musée le 23 juillet 1884, données par A. deBarthélemy.
– La première série de monnaies de fouilles provient de l’oppidum de Murcens etfut donnée en mars 1869 par l’empereur Napoléon III, suite aux fouilles de la Commissionde la Topographie de la Gaule. Elle comprend 13 exemplaires (inv. num. 2261 à 2274),dont 9 monnaies à la croix. Parmi les types présents, on trouve des monnaies à lacroix à la tête triangulaire et un bronze biturige au loup de type BN 4329. On noteraque ces informations correspondent bien aux descriptions données à l’époque, notam-ment dans le Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique (I, 1875, p. 320) :« L’oppidum de Murcens a fourni quelques monnaies gauloises dont voici l’énuméra-tion : le bronze n° 116 des pl. de monnaies (correspondant au bronze des Bituriges auloup et cheval ailé à droite) ; 7 deniers dits à la croix, dont 3 reproduits aux n° 275,276 et 277 de la pl. des monnaies ; enfin 3 petites pièces d’argent, dont 2 au mêmetype, n° 278 et 279, qui ont été rencontrées pour la première fois. (coll. du musée deSaint-Germain et de Saulcy). » Les mêmes informations sont également données parA. Castagné dans le Congrès archéologique de France, XLIe cession de 1874 (Agen etToulouse), 1875, p. 521-522, qui ajoute toutefois des monnaies de Nîmes.
Le MAN conserve également 5 autres monnaies, enregistrées plus tardivement(inv. num. 3199 à 3204), dites « trouvées à Murcens ». Parmi celles-ci se trouve un bronzearverne à la légende MOTVIDIACA.
– La seconde série de fouilles est issue du site de Luzech. Il faut très certainement,compte tenu des exemplaires en présence, la différencier du petit dépôt connu pourle même site, inventé vers 1880 à proximité de la mairie, qui comprenait un petitnombre de monnaies à la croix. Le MAN conserve en effet seulement une monnaie àla croix (inv. num. 4627) provenant de Luzech, accompagnée de cinq bronzes romains(inv. gén. 16696, don), ce qui doit correspondre aux fouilles de l’oppidum de l’Impernal,sur lequel le Dictionnaire archéologique de la Gaule (II, 1923, p. 128) précisait : « Ony a trouvé des deniers tectosages à la croix en argent et diverses monnaies romaines. »
Département du TarnLe département du Tarn a livré deux trésors de monnaies gauloises vers le milieu
du XIXe siècles : celui des environs de Castres en 1846 et celui de Garric en 1850. Seulle premier est représenté dans les collections du MAN, sans doute par un achat tardifd’A. de Barthélemy auprès d’un collectionneur de ses réseaux.
– Du trésor des environs de Castres, le MAN ne conserve ainsi que trois exemplairesrutènes au sanglier, de type LT 3433 (inv. Duval 660, 661 et 665), comme ceux qui appar-tiennent aux collections du Cabinet des médailles.
Département de Tarn-et-GaronneLe trésor le plus connu sans doute pour le département de Tarn-et-Garonne est celui
du Causé, regroupant au total plus de 1600 monnaies à la croix dans un vase. Maiscomme il ne fut découvert qu’à l’extrême fin du XIXe siècle, en 1897, à un momentoù il semble que les acquisitions du MAN diminuèrent dans le domaine de la numis-matique, il ne fit sans doute pas l’objet d’un achat, ni même d’un don. En revanche,
— 132 —
GENEVIÈVE (Vincent) — Un nouvel antoninien de Julia Domna au buste sanscroissant dans le médaillier du Musée Saint-Raymond, musée des Antiques deToulouse.
Le musée Saint-Raymond de Toulouse conserve dans son médaillier un rare anto-ninien de Julia Domna au buste sans croissant dont un autre exemplaire fut déjà publiépar J.-P. Garnier dans les pages du BSFN en 1989 (1). Cette nouvelle monnaie, inven-toriée dans les collections sous le numéro 2000-22-220, est issue de la même paire decoins que l’exemplaire conservé au cabinet des médailles de Paris (2) et se décritainsi :
IVLIA PIA FELIX AVG ; buste diadémé à d. sans croissant sous le buste.VENERI GENETRICI ; Vénus debout à g., tenant une patère en main d. et un sceptre
long en main g.Pds 4,87 ; axe 12 ; diam. 22-20 ; RIC 387 v. ; BMC 20 ; Hill 1470 ; Cohen 186.
l’étude des médailles antiques les exemplaires suivants :Page 147, 12e carton, n° 74, 98 : Idem ; R/ VENERI GENETRICI ; Vénus debout
tenant une patère et la haste.Il reprend cette mention du Catalogue des médailles appartenant à l’Académie
Royale des Sciences, Inscriptions et belles-lettres de Toulouse, déposées par les soinsde l’Administration municipale dans les salles du musée, rédigé en 1847 par Alexandredu Mège, Edward Barry et Alexandre Larrey, sous la forme :
Page 90, 12e carton, n° d’ordre 2870, n° 74 du carton : Idem ; R/ VENERI GENE-TRICI ;
Page 91, 12e carton, n° d’ordre 2894, n° 98 du carton : Idem ; R/ VENERI GENE-TRICI ; debout ; haste ; patère.
Une première précision apparaissait dans l’inventaire de 1833, connu sous le titrede Grand médaillier de l’Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettresde Toulouse. Composé de 70 tiroirs dans lesquels sont renfermées des MédaillesGrecques, Consulaires, Impériales et autres ; en Or, en Argent, en Grand Bronze et petitBronze. Etaient alors citées :
Page 52, 52e tiroir, 12e rang, n° 1684 : Idem ; R/ VENERI GENETRICI ;Page 52, 52e tiroir, 12e rang, n° 1685 : Idem ; R/ idem av. diff.Leur mention la plus ancienne provient de l’inventaire de la collection personnel
de Charles Clément Martin de Saint-Amand dont l’auteur a achevé la rédaction en 1760-1761, intitulé Catalogus Veterum Numismatum quae Tolosae Collegit Carolus ClemensMartin de St-Amand, ab anno 1747. Les deux monnaies sont alors précisées :
Tome II, p. 51, n° 1680 : IVLIA PIA FELIX AVG. Caput Iulia Pia ; VENERI GENE-TRICI. Mulier dextrossum stanir ; dextrâ Pateram, sinistrâ hastam.
Tome II, p. 51, n° 1681 : idem nummus sed minoris moduli.Cet inventaire précieux nous apprend donc que le médaillier de l’Académie des
Sciences de Toulouse possédait depuis le milieu du XVIIIe siècle cet antoninien maisaussi, d’après la formule minoris moduli, le denier du même type. Néanmoins, aucundenier de Julia Domna associant les légendes Iulia Pia Felix Aug et Veneri Genetricin’est actuellement connu et il faut, selon toute vraisemblance, identifier un exem-plaire émis sous le règne de Septime Sévère mais avec la légende de droit Iulia Augusta(RIC 578). Si ce denier est pourtant plus commun que l’antoninien, il a, semble-t-il, dis-paru des collections après 1858, tout comme au moins sept autres monnaies au nomde l’impératrice, dont un exemplaire Luna Lucifera sur lequel on ne dispose d’aucuneprécision, denier ou antoninien. À une date que l’on ne peut déterminer, mais qui sesitue obligatoirement après 1858, un énième comptage de la collection a eu lieu et quis’est effectué sur la base même du catalogue de Saint-Amand puisque des marques aufeutre noir qui ne sont pas de la main de l’auteur ont été rajoutées en marge. Une barredevant l’antoninien signale la présence de la monnaie dans la collection ; en revanchel’absence de marque devant la mention du denier nous indique qu’il avait alors dis-paru.
— 135 —
La réforme de Caracalla en 215 introduit dans la circulation une nouvelle espècemonétaire d’argent : l’antoninianus. Cette monnaie se caractérise par le portrait de l’em-pereur coiffé de la couronne radiée qui marque le doublement de sa valeur par rap-port au denier dont l’effigie est laurée. Le module de cette nouvelle monnaie est aussiplus large. Afin de distinguer les antoniniens de Julia Domna de ses deniers, le bustede l’impératrice est complété d’un petit diadème dans la chevelure et surtout d’uncroissant lunaire sur lequel il repose. Si cette règle iconographique est rigoureusementappliquée pour toutes les séries monétaires frappées entre 215 et 217, elle fait défautpour la première émission.
L’antoninien au buste sans croissant portant le revers Veneri Genetrici semble le toutpremier type frappé pour Julia Domna dans l’atelier de Rome en 215, suivi de peu dutype Luna Lucifera dont J.-P. Garnier a montré qu’un coin de droit était couplé à cesdeux revers. On considérera, comme le proposait l’auteur, que l’atelier de Rome n’apas jugé pertinent, dans un premier temps, de différencier l’antoninien du denier autre-ment que par le module et l’adjonction du diadème, mais que cette nécessité s’est ensuiteimposée. Un faible nombre de matrices a dû être gravé avant que le croissant lunairene soit ajouté et ce dès l’introduction du second type au revers Luna Lucifera (3).
Si ces quelques remarques restaient à préciser, nous nous attarderons plus sur laprovenance et le parcours de cette rare monnaie dans la collection du musée Saint-Raymond. Quatre catalogues sont à notre disposition pour reconnaître les exemplairesdispersés dans la collection et leur pérégrination au sein du médaillier. On y apprendnotamment que deux monnaies d’argent à légende Veneri Genetrici étaient conservéesdans le médaillier toulousain. Étaient, car seul reste actuellement cet antoninien au bustesans croissant.
En 1858, Casimir Roumeguère mentionne dans sa Description des médaillesgrecques et latines du musée de la ville de Toulouse, précédée d’une introduction à
3. Un recensement de ces rares antoniniani est actuellement en cours : J.-M. DOYEN et V.GENEVIEVE, « Les antoniniens de Julia Domna au buste sans croissant émis dans l’atelier deRome en 215 », BCEN, à paraître.
— 134 —
(Fig. 1) Toulouse
(Fig. 2) Paris
(Fig. 3) Extrait du Catalogus veterum numismatum quae Tolosae collegit Carolus Clemens Martin de Saint-Amand, vol. 2, p. 51,
Bibliothèque de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres, Toulouse.
niniani sont-ils les seuls exemplaires rescapés du trésor de Sainte-Suzanne conservésdans le médaillier du musée Saint-Raymond ?
Nous ne le pensons pas et c’est peut-être du marquis Jean-Jacques Lefranc dePompignan que nous vient la solution, à son insu. Car son intérêt pour la sciencenumismatique et son amitié pour Saint-Amand l’ont conduit à détailler l’histoire de cetévénement exceptionnel dans l’éloge qu’il lira à l’Académie des Sciences de Toulousele 10 avril 1766 en l’honneur de son ami défunt (7).
En effet, de nombreuses personnes eurent entre les mains des monnaies apparte-nant à la trouvaille, des modestes ouvriers inventeurs, des collectionneurs, des antiquaireset il est certain que tous les intervenants ne nous sont pas connus. Pourtant, seuls deuxhommes eurent le privilège de disposer de la majeure partie de ce trésor : MessireBourdeau, le directeur de la Monnaie de Toulouse, et son ami, Charles Clément-Martinde Saint-Amand, receveur général des tabacs de la ville et surtout membre éminent del’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. Peut-on envisager qu’un col-lectionneur aussi passionné que Saint-Amand, après avoir disposé d’une si grandequantité de monnaies, ait laissé passer l’occasion de ne récupérer que quatre exem-plaires aussi exceptionnels soient-ils ? Lefranc nous éclaire de manière précise sur cesujet : « Les recherches continuées pendant trois semaines, donnèrent, sinon de cesmédailles capitales, plusieurs de moindre prix, et des revers très rares ». Saint-Amand,même s’il n’eut pas toujours l’aide de M. de Romecour, son frère, consulta dans le détailet durant trois semaines toutes les monnaies qu’il put, certainement les trente mille évo-quées et données par sacs de mille par le Directeur de la Monnaie. André Aymard, dans
7. Le texte complet de cet éloge dans : Histoire et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences,Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, vol. II, 1784, p. 94-97. Une première lecture et inter-prétation dans, V. GENEVIEVE et M. COMELONGUE, « J.-J. Lefranc de Pompignan numismate :sa collection disparue, son ami Charles-Clément Martin-de-Saint-Amand et le trésor de Sainte-Suzanne (Ariège) », dans Colloque international, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan : unhomme de cultures au siècle des Lumières, Toulouse-Montauban, Pompignan, 22-23 septembre2006, à paraître.
— 137 —
Il est clair que les antoniniens de la première émission de 215 sont très rares et qu’unepièce de ce type devait être, dès le XVIIIe siècle, remarquée des collectionneurs.Qu’elle provienne des doubles de la collection Pellerin comme Saint-Amand se plai-sait à le signaler pour certaines de ses monnaies reste à démontrer et il eut déjà falluque le garde du roi en possède deux de ce type et accepte d’en céder une à son amitoulousain. Mais on ne peut écarter que Saint-Amand ait pu acquérir cette pièce excep-tionnelle autrement et qu’elle puisse notamment provenir du trésor de Sainte-Suzanne (4).
Compte tenu du caractère exceptionnel de ce trésor, on comprend aisément qu’ilait figuré comme un événement majeur dans la vie de Saint-Amand et qu’il y ait consa-cré plusieurs pages lors de la rédaction du catalogue manuscrit de sa collection. Pourmieux saisir l’importance de la découverte à laquelle il fut confronté, il convient de lareplacer dans le contexte numismatique de son siècle. Le trésor exhumé à Sainte-Suzanne (Ariège), au lieu-dit Saint-Ybars en 1752, est à cette époque l’un des trésorsmonétaires romains les plus conséquents que l’on connaisse dans toute l’Europe. Legrand numismate autrichien Joseph Hilarius Eckhel (1737-1798) évoquera d’ailleurs,quelques années plus tard, son passage à l’Académie toulousaine et ce trésor dans lepremier volume de sa Doctrina Numorum Veterum (5). Si quelques dépôts de taille com-parable sont connus par ailleurs, la plupart d’entre eux ont terminé dans les creusetsdes orfèvres ou des ateliers monétaires. Une trentaine d’ateliers sont encore en acti-vité en France à cette époque et un apport de monnaies aussi important, particulière-ment s’il s’agit de pièces d’argent comme celles de Sainte-Suzanne, permettait à sonpropriétaire de recevoir en échange une rétribution intéressante. Dans la plupart descas, les collectionneurs et érudits ont connaissance, mais trop tard, de ces décou-vertes et seuls quelques exemplaires sont miraculeusement préservés. La banalité despièces récupérées à la hâte ne permet généralement pas de les retrouver dans lesmédailliers actuels qui n’ont, le plus souvent, pas gardé traces de leur origine. Lesquatre antoniniani de Sainte-Suzanne actuellement connus sont un cas particulierpuisque la grande rareté de ces monnaies permet de les identifier sans difficulté dansles collections numismatiques de l’Académie des Sciences conservées au musée Saint-Raymond de Toulouse : il s’agit de deux Pacatien, une Tranquilline et une Cornelia Supera(6). Ce trésor a donc logiquement fasciné les esprits en raison de son volume excep-tionnel et des insignes raretés monétaires qu’il contenait, d’autant plus que son destinfut identique à d’autres trésors recueillis sous le sol français : il fut entièrement refondupar la monnaie de Toulouse quelques mois après sa découverte. Mais ces quatre anto-
4. Les publications traitant de ce formidable trésor sont nombreuses. On retiendra notammentparmi les plus importantes : U. GONDAL : « Importante découverte de monnaies romainesdans le Lézadois au XVIIIe siècle », Annales du Midi, LXXXI, 1969, p. 443-453 et LXXXII, 1970,p. 277-283.
5. J.-H. ECKHEL, Doctrina Numorum Veterum, I, Vienne, 1792, p. LXXXII, cite « In agro Fuxensiinventum est dolium vetus, in quo continebantur LX. millia numorum, quorum nullus Gallieniimperium excessit. Erant inter hos rarissimi Tranquillinae, Corn. Superae, Pacatiani duo.Excepi haec Tolosae ex catalogo MS. academiae, ubi adhuc numi rariores ex omni numeroselecti adservantur ». Sur ce pionnier de la numismatique, voir G. DEMBSKI, « Joseph HilariusEckhel (1737-1798) », Commission Internationale de Numismatique (CIN), Compte rendu 48,2002, p. 55-59.
6. Ces monnaies sont notamment illustrées dans D. CAZES, « Quatre monnaies (antoniniani) dutrésor découvert en 1752 à Sainte-Suzanne (Ariège) », Toulouse et l’Antiquité retrouvée auXVIIIe siècle, catalogue d’exposition, Musée Saint-Raymond, Toulouse, 1989, p. 28-29.
— 136 —
(Fig. 4) Médaillon en marbre de Charles-Clément Martin de Saint-Amand, Musée des Augustins, Toulouse.
A/. PPaC (lettre A et C ou AVC en monogramme). Bustecasqué, drapé et cuirassé, presque de face, tenant une lance transversale de la maindroite ; un bouclier sur l’épaule gauche. L’aigrette du casque sert de césure à la légende.Sur le buste une étoile.
R/. croix potencée posée sur un degré et un grand globe.Le globe est accosté des lettres M et * et au-dessous du chiffre X XI. CONOB àl’exergue, sous un trait horizontal.
Or. 3,82 g. (6h), fig. 1 (1).Pour l’atelier de Marseille, on connaissait des solidi de 21 siliques au nom de l’em-
pereur Maurice Tibère (août 582-novembre 602), mais aucun au nom de son prédé-cesseur, l’empereur Tibère Constantin. La marque pondérale XXI signifie que la valeurde cette monnaie est de 21 siliques. Ce monnayage permet de penser que Byzance n’estpeut être pas étrangère à l’aventure marseillaise de Gondovald qui ne débute pas sousMaurice Tibère, mais sous l’empereur précédent, Tibère Constantin, ce que nousapprend la numismatique (2).
Ce solidus vient en illustration de la thèse de Lenormant, qui met en relation lessous d’or de Maurice Tibère avec le débarquement de Gondovald à Marseille en 582,à l’époque du patrice Mummole. Avec Lenormant, Prou est persuadé que Constantinoplea favorisé l’entreprise pour replacer la Provence sous la domination impériale ; Grégoirede Tours rapporte que le roi Gontran reprochait à l’évêque de Marseille « d’avoir intro-duit un étranger en Gaule pour soumettre le royaume des Francs à la puissance impé-riale » (3).
Le trésor d’Escharen, enfoui vers 600, trouvé aux Pays-Bas et étudié par J. Lafaurie,contenait plusieurs solidi de 21 siliques frappés dans les ateliers d’Arles et de Viviers,mais au nom de l’empereur Maurice Tibère (4). On connaît un seul solidus provençalde 21 siliques frappé à la titulature de Tibère Constantin, provenant de l’atelier d’Arles(fig. 2). Il était contenu dans le trésor de Wieuwerd (Frise) ; il a été monté en bijou etpèse 7,03 g avec sa monture (5).
Est-ce que l’opération de Gondovald permet de débuter le monnayage marseillaisau nom de l’empereur, dès son débarquement, sous le règne de Tibère Constantin ? Prouse posait la question pour le monnayage de Maurice Tibère, on a maintenant connais-
V
1. Cette monnaie était décrite sous le n° 220 de la Collection Bernard Chwartz, vente le lundi14 juin 2010, Hôtel Régina (Paris).
2. Voir E. FELDER, « Zur Münzprägung der Merowingischen Könige in Marseille », Mélanges… offerts à Jean Lafaurie, Paris, 1980, p. 223. Le monnayage pseudo-impérial marseillais débu-tait auparavant sous Maurice-Tibère.
3. Voir M. PROU, Catalogue des monnaies de la Bibliothèque Nationale. Les monnaies méro-vingiennes, Paris, 1892, p. XXIII et suivantes. La thèse de Lenormant était contredite par C.Robert et par Blancard qui objectait que Gondovald avait probablement quitté Constantinopleavant l’avènement de Maurice Tibère. Nous en avons aujourd’hui la preuve par ce mon-nayage au nom de l’empereur précédent. D’après Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Paris,1995, 2 vol., réédition, VI, 24.
4. J. LAFAURIE, « Escharen », RN, 1960, n° 9 et 10. Le Midi semble privilégier l’étalon léger avant600.
5. A. DE BELFORT, Description générale des monnaies mérovingiennes, 5 vol., Paris, 1892-1895,n° 5917 = RIGOLD, NC, 1954, n° 6 = LAFAURIE, ibid., p. 94, n° 16, et p. 98, n° E. Ce bijouest conservé au Rijksmuseum van Oudheiden à Leiden (Musée National des Antiquités desPays-Bas). Nous remercions A. Pol qui nous a communiqué la photographie de l’exemplairefrappé à Arles.
— 139 —
l’article qu’il a rédigé sur Saint-Amand, ne s’y est pas trompé, mais nous nous permettonscompléter ici le raisonnement du professeur toulousain (8).
Face à cette accumulation d’empereurs qui comblait en pièces d’argent sa suite impé-riale, Saint-Amand dut orienter ses recherches sur les revers. Car tous furent regardéset triés puisque Lefranc de Pompignan livre ce précieux détail que certains étaient trèsrares. Cette remarque implique que d’autres plus courants constituaient le lot commundu trésor, mais qu’il fallait de fait tous les consulter pour en extraire les plus remarquables.La découverte de quatre monnaies rarissimes est un appât suffisant pour se lancerdans de telles recherches, d’autant que ces dernières devaient être bien lisibles puis-qu’elles auraient été identifiées au premier coup d’œil. D’après les indications livréespar Lefranc, l’examen des monnaies qui dura trois semaines permet de déduire approxi-mativement la consultation de 10 000 monnaies par semaine ; soit, en raisonnant surnos bases actuelles, 2 000 monnaies par jour pendant cinq jours à une, voire deux per-sonnes. Un tel dépouillement, long et fastidieux permet d’isoler finement un grandnombre de variantes et d’assurer, en un temps record et à moindre frais, un médaillierexceptionnel. J’en conclue, d’après l’éloge de Lefranc, que Saint-Amand, afin de com-pléter sa collection, s’est attaché, avec ou sans l’aide permanente de son frère, à exa-miner toutes les monnaies disponibles et qu’il s’est appliqué à mettre de côté tous lestypes de revers appartenant à chaque empereur représenté dans le trésor. Et si la décou-verte de Sainte-Suzanne ne figure effectivement plus qu’à l’état de légende dans l’es-prit des numismates, le musée Saint-Raymond conserve certainement, avec la collec-tion de Saint-Amand, le squelette de ce trésor, soit approximativement une pièce dechaque type. Les premières observations effectuées sur les monnaies d’argent de la pre-mière moitié du IIIe siècle conservées dans le médaillier du musée vont dans le sensde cette hypothèse. À l’appui de cette interprétation, ce nouvel antoninien au buste sanscroissant de Julia Domna pourrait tout à fait rejoindre le carré connu des pièces pres-tigieuses ayant appartenu à ce riche thésaurisateur ariégeois et que Charles ClémentMartin de Saint-Amand a réussi à préserver.
8. A. AYMARD, « A propos de quelques monnaies romaines du musée Saint-Raymond »,Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, XX, Toulouse, 1943, p. 1-38 et249-256.
— 138 —
CRINON (Pierre) et CHWARTZ (Bernard) (†) — Deux exemples de soulèvementaquitains illustrés par des monnaies inédites, l’une de Marseille, l’autre de Cahors.
1- Un solidus de 21 siliques au nom de Tibère Constantin (septembre 578-août582), émis à Marseille et l’expédition de Gondovald, roi de Brive (584-585), mort àSaint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne).
Fig. 1 : Solidus de MarseilleFig. 2 : Solidus d’Arles
(8). Ces deniers présentent les légendes suivantes : Pipinus Rex, buste et Aquitanorumautour d’un temple simplifié composé d’une croisette entre deux colonnes et deux baseshorizontales dont la supérieure surmontée d’un toit.
Les autres monnaies au nom de Pépin sont classées à Pépin II. S. Coupland énu-mère des produits rares des ateliers de Bourges (buste), de Bordeaux (temple), de Dax(temple) et d’autres plus abondants de Melle (temple) et de Toulouse (monogramme).On connaît des deniers au temple au nom d’Aquitaniorum, attribués à Bordeaux.D’autres deniers au temple anonymes peuvent être attribués aux ateliers de Melle etun autre à Dax (9).
Pour l’époque carolingienne, l’atelier de Cahors n’a révélé, à ce jour, que des mon-naies de Pépin II. On connaît une première obole, avec PipinusRex Eq autour d’une croix et en deux lignes au revers. Elle provient dutrésor de Lauzès (Lot), fig. 3, étudié il y a un siècle par Béchade, elle est du même typeque les oboles d’Aquitania (10). Une seconde obole provenant du trésor de Luzancy(Seine-et-Marne), fig. 4, est passée en vente aux enchères en 2008, non pesée.
et croix. R/. en deux lignes (11).Le denier que nous présentons est le premier denier connu pour cet atelier. Nous
l’avions signalé à S. Coupland qui en fait mention dans la réimpression de son article
8. E. GARIEL, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, Strasbourg, 1883-1884,6 pl. XX, coll. 792 = Berlin et un autre de 1,67 g : M. PROU, n° 665 = K. F. MORRISON etH. GRUTHAL, Carolingian coinage, New-York, 1967, n° 597). J. DUPLESSY, « Numismatiquede Pépin II, roi d’Aquitaine (839-864) », RBN, 1978, p. 217.
9. S. COUPLAND, « The coinages of Pippin I and II of Aquitaine », RN, 1989, p. 194-222 et pl. XX.10. Au sujet du trésor de Lauzès près de Rocamadour, voir : J. L. BECHADE, « Une trouvaille de
monnaies carolingiennes », RN, 1906, n° 27 p. 304-305, 8 pl. XII pour l’obole de Cahors avecPipinus et pour le denier attribué à Dax, n° 9 pl. XII ; du même auteur, « Distinction des mon-naies portant le nom de Pépin », RN, 1907, p. 278-279. MORRISON et GRUNTHAL, n° 620.L’auteur place d’abord toutes les monnaies du trésor de Lauzès à Pépin Ier. Il conclut que cetteobole (la seule monnaie de Cahors connue alors) a probablement été frappée lors de l’un desfréquents voyages de Pépin en Quercy et au monastère de Rocamadour que Charlemagne avaitparticulièrement protégé. Pépin visita maintes fois le Quercy ; fonda l’église Saint-Sauveur àFigeac et fit construire une église abbatiale et collégiale à Marcillac. L’auteur revient sur sonclassement l’année suivante, plaçant plutôt les monnaies avec Equitania à Pépin II. Le trésorde Lauzès contenait 32 monnaies (28 décrites) dont 4 attribuables à Pépin II : une obole deCahors, un denier anonyme au temple, un denier au buste de Bourges et une obole anonymed’Aquitania. Ce dépôt contenait également des monnaies de Louis le Pieux et une seulemonnaie de Charles le Chauve, probablement de Melle, au type Christiana religio.
11. Vente à Drouot du 10 octobre 2008, n° 82 « Pépin I ou Pépin II ». Voir S. SOMBART, « Letrésor carolingien de Luzancy (77138), enfoui ou perdu vers 865-870 », BSFN, juin 2008, p.128-129, poids non signalé. En fait, toutes les monnaies de ce trésor, au nom de Pépin,appartiennent au règne de Pépin II d’Aquitaine.
— 141 —
sance de deux exemplaires : ce solidus marseillais et un seul autre exemplaire d’Arles.Peut-on réétudier cette hypothèse ?
Gondovald se disait fils de Clotaire Ier (511-561), mais il n’y a pas de preuve desa filiation. Il s’enfuit en Italie en 561 puis s’installe à Constantinople, chez l’empereurJustin II puis sous Tibère Constantin. En 581/582 il débarque à Marseille avec de« grands trésors ». Après des luttes diverses au sujet de ces trésors, il rejoint Mummoleà Avignon puis soulève une partie de l’Aquitaine. Il est proclamé roi de Brive en 584,élevé sur le pavois. Gondevald n’a laissé à ce jour, aucune monnaie à Brive, àAngoulême, à Périgueux, à Bordeaux ou à Toulouse où il a séjourné. On ne connaîtaucune monnaie au nom de Maurice Tibère frappée dans ces localités. On ne peut doncpas lui attribuer le monnayage marseillais, comme remarquait Prou d’après Blancard.
Gondovald est tué l’année suivante à Conbenas (Saint-Bertrand-de-Comminges) assié-gée par le roi Gontran (roi d’Orléans et de Bourgogne 561-592), protecteur de son neveuClotaire II après l’assassinat de Chilpéric. Le siège commence à partir de février 585.Ensuite Gontran exila en Bourgogne l’évêque de Marseille Théodore. En fait, Gondovaldavait tenté sa chance en profitant des luttes entre les peuples francs et entre les roisChilpéric Ier (roi de Soissons puis son fils Clotaire II), Childebert II (roi d’Austrasie575-595) et Gontran (6).
Les deux monnaies au nom de l’empereur Tibère, qu’elles soient émises à Arles ouà Marseille peuvent être des conséquences de l’expédition de Gondovald qui avait l’ac-cord de Constantinople et avait apporté des trésors, mais ces émissions ne peuvent luiêtre attribuées. Seuls ces deux solidi présentent une étoile au centre du buste et la mêmeterminaison de l’avers avec un monogramme des lettres A et C ou AVC. Au revers, onobserve une étoile après la lettre A. Ces similitudes de buste et de légende nous amè-nent à voir une même autorité pour les émissions à Marseille et à Arles.
C’est bien aux rois de Marseille que revient l’inauguration d’un type monétaire aunom de Tibère Constantin et plus certainement à Gontran qu’il faut accorder cetteautorité puisqu’Arles relevait à cette époque de Gontran qui y avait fait enfermée uneépouse au monastère de Saint-Jean. Arles subit plusieurs sièges entre 560 et 574(Lombards), en 586 par les Visigoths en représailles contre l’invasion de la Septimaniepar Gontran. Quant à Marseille, à la mort de Sigebert en 575, Childebert II cède la moi-tié de la ville de Marseille à Gontran qui lui rend en 584. C’est donc au roi Gontranque doit revenir cette émission. La direction de la ville de Marseille revenant àl’Austrasien Dynamius, pour le compte des deux rois (7). Prou avait bien compris l’im-portance des trésors de Gondovald, roi de Brive, et l’opportunité de son action enAquitaine. On peut ajouter que son débarquement suscita certainement une certainecrainte chez les Francs, soucieux de leur indépendance vis-à-vis de l’empereur deByzance. Ils marquèrent une sorte d’allégeance en monnayant immédiatement au typeimpérial, à Arles et à Marseille, conjointement avec le débarquement de Gondovaldqui ne passa pas par Arles mais par Avignon avant de rejoindre l’Aquitaine.
2– Un denier inédit de Pépin II (839-852) émis à Cahors (Lot)On admet que seuls les rares deniers au buste sont attribués à Pépin Ier (817-838)
6. Grégoire de Tours, op. cit., livre VII, 9 à 38.7. P. RICHÉ, Dictionnaire des Francs, Paris, 1996, Gondevald et Gontran, p. 173-174, Marseille,
p. 225-226, d’après Grégoire de Tours, ibid., livre VI, 11 et IX, 21-22 ; et R. BUSQUET,Histoire de Marseille, Toulouse, 1983, p. 51-55.
— 140 —
Fig. 3 : Trésor de Lauzès Fig. 4 : Trésor de Luzancy
R/. temple à deux colonnes, sur un degré, surmonté d’unecroisette. Cette obole manque aux ouvrages de référence et pèse 0,63 g.
Même si le type au temple est créé en 822, il est admis, grâce aux trésors en par-ticulier, que Pépin Ier n’a pas frappé monnaie à ce type. Pépin II commence son règneen 839, les actes de sa chancellerie le prouvent. Il soutient alors Lothaire Ier lors de laguerre civile contre Charles le Chauve de 840-843. L’empereur Lothaire et Pépin II frap-pent monnaies dans divers ateliers, au gré des raids vikings. Nantes est prise en 843,Toulouse en 844 ; la Saintonge est occupée en 845. Melle ferme en 848. La circula-tion du monnayage de Pépin II est restreinte à l’Aquitaine et au Poitou, entre 845 et 848et c’est à cette période, pour S. Coupland, que sont frappées les monnaies au templesans mention d’atelier. Charles le Chauve bat Pépin II en 852. On admet que sonrègne se termine alors, après sa défaite contre Charles le Chauve.
Les raisons de l’attachement de Pépin Ier au Quercy restent valables pour son fils.Les possibilités de retranchement dans cette région ont certainement été utilisées parPépin II qui a donc émis plusieurs types de monnaies à Cahors : des oboles bilinéaireset un denier au temple. S. Coupland avait proposé trois types de monnayage pour sonrègne. Tout d’abord des deniers avec Aquitaniorum ont probablement été frappésBordeaux avant 840 et vers 840-841. Bordeaux a également frappé des oboles avecAquitania et des deniers avec Christiana Religio. Des oboles avec Aquitania ou Equita-niorum ont pu être frappées à Bourges ; une variante à Cahors avec Catu/ricis (dont onne connaît maintenant deux exemplaires). Pour le troisième type avec Christiana reli-gio, il a été utilisé par d’autres ateliers. Ce type débute après 840 à Melle sous Charlesle Chauve s’y poursuit sous le règne de Pépin II.
Ce denier au temple, au nom de l’atelier de Cahors, est le seul connu à ce jour aunom d’une localité. Ceci indique que cet atelier a fonctionné, après Bordeaux etBourges, mais avec une circulation infiniment plus restreinte. Par le style, notre deniersemble plus proche du monnayage de Louis le Pieux par le type de temple et du mon-nayage de Pépin Ier par le type de temple et par le style des lettres. Il a probablementété émis à Cahors à la même époque que l’obole bilinéaire. On peut écarter la possi-bilité qu’il ait été frappé après le Traité de Saint-Benoît-sur-Loire date où Charles le Chauveabandonne l’Aquitaine à Pépin et se réserve Poitiers, entre 845 et l’année 848 durantlaquelle Charles se fait sacrer roi des Aquitains à Orléans. À partir de ce traité de 845,les deux rois frappent conjointement à Melle (14). On peut penser que Charles enautorisant des frappes au nom de Pépin à Melle a dû restreindre sa liberté de frappeen d’autres lieux. Mais ceci n’est que supposition. La dernière charte de Pépin date demars 848 (monastère de Saint-Maixent). Charles est en effet le recours contre lesattaques des Normands car Pépin II est incapable de défendre le pays. En 855, Charlesfait couronner à Limoges son fils aîné Charles l’Enfant comme roi d’Aquitaine. Pépin IImène alors une vie errante, sans cour, et ne sera livré à Charles le Chauve qu’en 864.
Il serait logique de placer ce denier au tout début des frappes de Pépin II, au débutde la guerre civile, vers 840/843, et de proposer qu’il soit contemporain des oboles.Cahors est pour l’instant une exception dans le monnayage au temple puisque nousvoyons là le premier denier au temple de ce règne localisé. Cela s’explique par l’im-portance de Cahors dès le règne de Pépin Ier. Cette monnaie provenant d’une anciennecollection, nous ignorons malheureusement le contexte d’origine.
14. COUPLAND, ibid., p. 215.
— 143 —
de 1989 (12).A/. croix cantonnée de globules.R/. RIO temple simple à deux colonnes, sur un degré et surmonté
d’une croisette.Denier 1,49 g. (8h), fig. 6. Le poids est équivalent à celui d’un denier de ce type
ou de la même époque. On a relevé une moyenne de 1,55 g pour 35 exemplaires deToulouse au monogramme (13).
Ce denier possède, comme les oboles mentionnées précédemment, un seul P àPipinus. La légende se lit Pipinus Rex Equitaniorum. On retrouve cette particularité ortho-graphique sur les monnaies attribuables d’après S. Coupland aux ateliers de Dax,Limoges, Melle et Poitiers. Il faut également remarquer une similitude de temple entreles deniers au buste de Pépin Ier, fig. 7 (illustré par S. Coupland) et cet exemplaire : letemple ne possède que deux colonnes. Ce denier rentre dans la série des deniers autype Christiana religio de Pépin II. Un autre rapprochement s’impose : un O final aulieu de Q comme on le voit sur le denier n° 18 du trésor de Lauzès (attribué à Dax parS. Coupland) ; l’unité de style est remarquable avec les produits de l’atelier de Dax.
Cette monnaie est originale pour légende du revers. Comment interpréter la légende :RIO ? À première vue, on ne peut être certain de la signification de ces lettres qui n’ontaucune interprétation avérée connue. On peut penser à une contraction de CaturcisRacio mais ce mot de racio (qui a le même sens de moneta) est associé en général avecnom d’un monastère, pas un nom de lieu. Ce type d’abréviation ne se rencontre pas.Cela conviendrait plus probablement à Religio qui est toujours associé à Xristiana surle monnayage au temple. Caturcis Religio n’aurait aucun sens mais doit être lu commeun trompe-l’œil et reste bien une exception.
Le temple sur cette face est simple, une croix centrale entre deux colonnes, commesur les deniers au buste attribuables à Pépin Ier et comme sur une rare obole de 0,63 gau nom de Louis le Pieux que nous présentons en fig. 5. Il n’y a pas de trait à l’inté-rieur du temple. Même le style des lettres correspond à celui des deniers au buste.
A/. croix cantonnée de globules.
12. S. COUPLAND, Carolingian Coinage and the Vikings, Studies on Power and Trade in the 9thCentury, Aldershot, 2007, Addenda and corrigenda, VIII, p. 4, p. 212 (mentionné comme étantune obole au lieu d’un denier).
13. COUPLAND, RN, 1989, p. 216, note n° 81.
— 142 —
Fig. 6 : Denier inédit Fig. 7 : Denier de Pépin Ier
Fig. 5 : Obole au nom de Louis le Pieux
mètre. Bien que cassé et usé, il peut être daté de AH 199 (= 815, règne d’al-Hakamier). Référence : Vives 105, Miles 90a.
Droit :
Il n’y a de divinité que Dieu, l’Unique, le Sans-Égal
Au nom de Dieu a été frappé ce dirham à al-Andalus en l’an 199Revers :Coran CXII sur quatre lignes, avec un point entre les deuxième et troisième lignes.Coran IX, 33 en légende circulaire.La cassure de la monnaie ne laisse apparaître que le dernier chiffre de la date (9),
le nûn final ( ) du chiffre des dizaines, et le tâ marbuta final ( ) du mot cent. Le styleet la présence d’un point dans les champs du droit et du revers permettent d’attribuerce dirham à l’année 199. Cette lecture est confirmée par la décoration du motif circulaireavec alternance caractéristique d’annelets pointés et de trois points en triangle, donton devine encore la présence à 11 heures (5).
Le deuxième dirham (Fig. 2) pèse 1,45 g, pour 22 mm de diamètre. Il a été frappéà al-Andalus en AH 227 (= 842, règne de ‘Abd al-Rahman II). Référence : Vives 181(année 227 avec point), Album 342.
Droit :
Il n’y a de divinité que Dieu, l’Unique, le Sans-Égal
Au nom de Dieu a été frappé ce dirham à al-Andalus en l’an 227Revers :Coran CXII sur quatre lignes, avec un point au-dessus, un au centre et un en des-
sous.Coran IX,33 en légende circulaire, en partie hors flan.
5. Merci à Lutz Ilisch, de l’université de Tübingen, pour son aide précieuse.
— 145 —
PARVÉRIE (Marc) — La circulation des dirhams d’al-Andalus entre Gascogne etAquitaine au IXe siècle.
Dans une récente étude (1), nous avions tenté de faire le point, cinquante ansaprès l’article fondateur de Jean Duplessy (2), sur la circulation des monnaies arabo-musulmanes dans les régions méridionales de l’empire carolingien.
L’étude de plus de soixante-dix monnaies issues de fouilles archéologiques et sur-tout de découvertes fortuites a permis de confirmer et de préciser la chronologie de lapériode comprise entre le début du VIIIe et le milieu du IXe siècle avancée parJ. Duplessy. Les monnaies les plus anciennes (toutes trouvées en Septimanie) datent dela conquête (après 710). Le dirham le plus récent (découvert en Aquitaine) date desannées AH 250 (vers 860). Cette période est suivie d’un fossé chronologique de deuxsiècles et demi avant que ne commencent à apparaître dans les trésors monétaires lespremiers dinars d’or almoravides (vers 1120-1130).
Ces nouvelles découvertes confirment de même le cadre géographique de la cir-culation monétaire durant cette première période :
– un courant majeur diffuse depuis les côtes italiennes des dinars et dirhams pro-venant d’ateliers nord-africains et orientaux dans toute la vallée du Rhin et jusqu’enAngleterre ;
– en Septimanie, la conquête puis la domination musulmane de 719 à 759 ont livré3 dinars, 3 dirhams et 38 fulûs de bronze. Des dirhams frappés en al-Andalus conti-nuent à circuler après la conquête carolingienne ;
– un courant important relie l’Espagne musulmane à l’Aquitaine : franchissant lescols des Pyrénées (3), les dirhams d’argent d’al-Andalus aboutissent dans les confinsbasques du sud de la Garonne, puis suivant toujours les voies romaines, gagnent la val-lée de la Loire par le seuil du Poitou.
Dans ce dernier cas, la présence des monnaies sur des itinéraires de commerce,souvent de surcroît à des points de rupture de charge (passage d’une rivière, au piedd’un col…) confirme la permanence des voies d’échanges à longue distance entre lapéninsule Ibérique et l’Aquitaine (4) durant le haut Moyen-Âge.
Les trois monnaies, objet de la présente communication, proviennent des bords deGaronne, sur les marges de cette Wasconia qui semble encore au IXe siècle sous uncontrôle assez théorique du pouvoir carolingien. Les deux premières ont été décou-vertes dans la commune de Donzac (82) sur un gué antique ou alto [???] médiéval per-mettant la traversée de la Garonne. La troisième provient d’un champ de la communede Grenade (31), qui a livré aussi des monnaies du IVe siècle et des ardillons deboucles mérovingiens.
Le premier dirham (Fig. 1), frappé en al-Andalus, pèse 0,99 g, pour 22 mm de dia-
1. PARVÉRIE 2007.2. DUPLESSY 1956. Jean Duplessy montrait par l’étude critique des trésors monétaires et des
sources littéraires l’importance de la circulation et de l’utilisation du numéraire arabo-musul-man dans l’Occident médiéval.
3. Roncevaux et le Somport. Les Arabes nommaient précisément les Pyrénées le Djebel al-Burtât, la montagne des ports (c’est-à-dire des cols), ce qui renvoie plus à l’idée de lieu depassage qu’à celle d’obstacle ou de frontière.
4. Iter hispanicus dont Michel Rouche a bien montré l’importance (ROUCHE 1979, 249-254).Il montre notamment que les principales voies romaines sont toujours utilisées durant le hautMoyen-Âge.
— 144 —
Attention : la non-conformité de cet article avec les Instructions du BSFN et un problème avec les notes automatiques de Word ont entraîné de nombreuses erreurs de conversion et laperte de plusieurs appels de note (mais pas tous…). Merci de bien relire ! J’ai laissé les références, non conformes elles aussi…, comme elles étaient. Vérifier les siècles romains et l’AH(qui n’étaient pas en grandes capitales). TD
Agen, elles poursuivaient au nord vers Périgueux et Limoges (9), à l’ouest vers Bordeaux(10) et à l’est vers Cahors et Rodez. Une autre voie Toulouse-Agen-Bordeaux, ditevoie Tolosane, suivait la Garonne d’abord en rive gauche, puis à partir de Castelsarrasinen rive droite, évitant ainsi le territoire de la cité de Lectoure (11).
Le gué de Donzac, quant à lui, ouvrait au sud sur un itinéraire secondaire de rivegauche de la Garonne rejoignant probablement Toulouse. La présence au sud du guéd’un embranchement vers Lectoure est possible mais non confirmé. Au nord, le guépermettait de rejoindre la «voie tolzane», tandis qu’un embranchement situé sur la com-mune de Clermont-Soubiran (47) permettait peut-être d’accéder à un ancien chemi-nement réputé relier les bords de la Garonne au Massif central (12). Notons par ailleursla présence sur cette rive droite de la Garonne de plusieurs nécropoles et sanctuairespaléochrétiens, souvent liés à des villae de l’Antiquité tardive, notamment sur les com-munes de Puymirol et Saint-Pierre-de-Clairac (47) (13), ce qui pourrait indiquer unezone assez occupée et peuplée pendant le haut Moyen-Âge. C’est dans cette même zonede la vallée de la Séanne, distante du gué d’une dizaine de kilomètres seulement,qu’a été découvert un autre dirham d’al-Andalus daté de AH 190 (14). Peut-être les troisdirhams faisaient-ils partie d’un même « ensemble dispersé » (14) ?
Ainsi, les dirhams du gué de Donzac semblent bien être sortis des grandes voiesde long parcours traversant l’Aquitaine, pour suivre des itinéraires plus régionaux et pro-bablement être utilisés dans un circuit économique local.
Cette hypothèse est renforcée par la rognure manifeste de ces deux monnaies. Lapremière, par ailleurs cassée, ne nous livre aucun élément déterminant. En revanche,on peut voir que la seconde a été très soigneusement ramenée par coupure circulaireau poids d’un denier carolingien, pour un diamètre à peine supérieur. Depuis le capi-tulaire d’Attigny de 822, le poids du denier est fixé à 1/264e de livre soit 1,55 g (16),mais le poids moyen constaté dans les trésors de cette période est plus proche d’1,48 g(17), ce qui correspond assez bien à notre exemplaire (1,45 g) (18). Dans la mesure oùla rognure des dirhams est rarissime en al-Andalus même – où existent encore à cetteépoque des divisionnaires de bronze –, il faut en conclure que ces deux exemplaires– ou trois, si l’on compte celui de Saint-Pierre-de-Clairac – sont arrivés entiers enGascogne et y ont été volontairement découpés pour leur permettre de circuler aux côtésdes deniers carolingiens.
9. La permanence au haut Moyen-Âge de cet axe reliant les régions pyrénéennes au nord del’Aquitaine apparaît notamment à la lecture de la lettre de Ruricius, évêque de Limoges,remerciant l’évêque d’Éauze pour l’envoi de colonnes de marbre. Ruricius, Epist. II, 54.
10. Par la voie Agen-Bordeaux ou par la Garonne.11. Peut-être s’agit-il d’une déviation plus septentrionale de l’itinéraire antique due à la domination
vasconne sur les cités du sud de la Garonne ?12. CAG 47, 281. Celle voie est dite « voie clermontoise ». Elle est attestée sur la commune de
Saint-Urcisse (47), quelques kilomètres au nord du gué.13. CAG 47, 217.2, 217.6, 217.9, 217.12, 269.14. Sur la commune de Saint-Caprais-de-l’Herm (47), au lieu-dit Lasbrugues. GUNDELWEIN
1983, 224-225.15. Au sens donné par J.-P. Callu : groupement de monnaies forment à l’origine un ensemble unique
qui s’est trouvé disséminé sur une aire plus ou moins étendue.16. DEPEYROT 1993, 23.17. DEPEYROT 1993, 68. 18. Le poids théorique du dirham d’al-Andalus est 2,97 g, mais les poids réels constatés pour cette
période sont plus proches de 2,5-2,6 g.
— 147 —
La lecture 227, rendue difficile par l’écriture en partie corrompue des centaines etdes dizaines, est confirmée par la présence des trois points du revers (en haut, aumilieu et en bas) et du point du droit (effacé, au milieu).
Le troisième dirham (Fig. 3) ne pèse que 0,59 g, pour 11 mm de diamètre. Larognure circulaire a totalement éliminé les légendes marginales, de sorte qu’il estimpossible d’identifier avec certitude l’atelier et la date.
Droit :
Il n’y a de divinité que Dieu, l’Unique, le Sans-ÉgalLégende circulaire hors flanRevers :Coran CXII sur quatre lignes.Légende circulaire (Coran IX, 33) hors flan.La présence de la sourate CXII au revers montre cependant qu’il s’agit d’une mon-
naie de type umayyade, qu’il est possible de dater au plus large de la période 699-912(6). Cependant, le style de la calligraphie, avec des « dâl » ( ), « sâd » ( ) et « kâf »( ) remarquablement allongés, nous invite à formuler l’hypothèse d’une frappe en al-Andalus dans les années AH 150-200 (768-816), peut-être plus précisément des annéesAH 160 (vers 780) ?
Cette nouvelle découverte de dirhams d’al-Andalus s’intègre parfaitement dans leschéma général de circulation présenté en introduction. Chronologiquement toutd’abord, les deux dirhams du gué de Donzac se placent plutôt dans la partie basse dela période étudiée (9 dirhams datés des années 750-800, 4 des années 800-820 et 4des années 840-860). La datation du dirham de Grenade est trop hypothétique pourqu’un quelconque classement soit pertinent.
Géographiquement, ces trois exemplaires ont été découverts, comme les autresdirhams d’Aquitaine, sur les grands itinéraires reliant l’Espagne à l’Aquitaine, le plussouvent sur des sites de l’Antiquité tardive, et pour la plupart au sud ou à proximité dela Garonne (7).
L’originalité de la découverte des deux dirhams du gué de Donzac tient à ce qu’ellea été faite en marge des itinéraires majeurs de l’Antiquité tardive. Le principal point detraversée de la Garonne se trouve en effet au sud d’Agen, à une douzaine de kilomètresen aval. C’est ici que traversaient les voies, mentionnées par la Table de Peutinger, venantde Toulouse (8) et de l’ouest de la Wasconia, après s’être rejointes à Lectoure. Depuis
6. Les califes umayyades de Damas frappent des dirhams de ce type entre 699 et 750 ; lesémirs umayyades d’al-Andalus entre 765 et 912.
7. La Garonne reste jusqu’à la fin du VIIIe siècle une zone frontière entre l’Aquitaine et lescités sous domination vascone. CAG 47, 83.
8. Voie Toulouse-Lectoure-Agen mentionnée par la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin.
— 146 —
Echelle x 2,5
pour un diamètre de 20/22 mm, découvert dans le lit de la Loire près d’Ancenis (44)(28), et le troisième daté AH 241 (856) pesant 1,69 g, découvert à Castelnau (32),dans la vallée de l’Adour (29), lui aussi en marge des voies principales.
Très intéressante découverte, ces trois nouveaux « deniers arabes » (30) permettentnon seulement de confirmer l’apport régulier par des marchands de dirhams d’al-Andalus dans l’empire carolingien, mais encore de prouver l’utilisation d’une partie aumoins d’entre eux dans un circuit économique local, certains étant à cette fin soi-gneusement ramenés au module et au poids du denier ou de l’obole.
Reste à éclaircir certaines questions que le faible nombre de découverte ne permetpas encore de trancher : cette pratique de la découpe des dirhams a-t-elle été constanteau cours des VIIIe et IXe siècles, ou est-elle directement liée à une pénurie plus ponc-tuelle de numéraire intervenue au milieu du IXe siècle (31) ? Etait-elle limitée auxmarges qui pouvaient échapper au contrôle rigoureux des autorités fiscales et moné-taires, comme ici en bordure de Garonne, ou était-elle aussi connue des régions pluscentrales et mieux contrôlées de l’empire ? Les prochaines découvertes monétaires nemanqueront pas, nous l’espérons, d’apporter des éléments de réponse.
BibliographieClément F. (2008), «Les monnaies arabes et à légende arabe trouvées dans le Grand
Ouest», Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. 115, n° 2.Depeyrot G. (1993), Le numéraire carolingien, Paris.Duplessy J. (1956), « La circulation des monnaies arabes en Europe Occidentale
du viiie au xiiie siècle », RN 1956, 101-164.Fages B. (1993), Carte Archéologique de la Gaule. Le Lot-et-Garonne (47), Paris.Grierson P. et M. Blackburn (1991), Medieval European Coinage, 1 : The Early
Middle Ages (5th-10th centuries), Cambridge.Gundelwein P. (1983), « Une monnaie arabe médiévale en Agenais, Saint-Caprais-
de-l’Herm, lieu-dit Lasbrugues », Revue de l’Agenais.Mavéraud-Tardiveau H. (2007), Carte Archéologique de la Gaule. Le Tarn-et-
Garonne (82), Paris.Moesgaard J.-C. (2008a), « L’importation de monnaies étrangères dans l’empire caro-
lingien », BSFN, 63e année, n° 8, p. 170-171.Moesgaard J.-C. (2008b), « Dirhams in Western Europe », dans Actes du Colloque
de Damas, publication en cours.Parvérie M. (2007), « La circulation des monnaies arabes en Aquitaine et Septimanie,
VIIIe-IXe siècles », Aquitania, 23, p. 233-246.Rouche M. (1979), L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes, Paris.Saget, Y. et L. Ménanteau (2003) : « Des monnaies carolingiennes trouvées dans
le lit de la Loire entre Ancenis et Oudon », Histoire et patrimoine au pays d’Ancenis,Ancenis.
Vives y Escudero A. (1893), Monedas de las Dinastias arábigo-españolas, réimpr.Madrid, 1998.
28. SAGET & MÉNANTEAU 2003, 51, n° 29. CLÉMENT 2008, 161.29. PARVÉRIE 2007, 236 et Annexe n°23.30. L’expression « Andalusi pennies » est de Lutz Ilisch.31. DEPEYROT 1993, 23.
— 149 —
En effet, Jens-Christian Moesgaard (19) a bien montré que, contrairement aux zonesd’économie non monétaire des marges septentrionales du monde carolingien, où lesmonnaies, ne valant que leur poids de métal fin, sont découpées – pour faire l’appoint– pliées, entaillées ou testées – pour en vérifier la qualité – l’empire carolingien dis-pose d’une économie monétaire très contrôlée par le pouvoir central : monnaies ayantun cours officiel garanti (20), fréquentes démonétisations d’espèces anciennes (21), traquede la fausse monnaie (22), obligation de porter aux ateliers monétaires les monnaiesétrangères, pour qu’elles soient fondues et refrappées en deniers (23). Ce contrôlerigoureux de la masse monétaire en circulation a pour conséquence de rendre, archéo-logiquement, presque « invisible » la circulation des espèces étrangères. Ainsi ne sontguère retrouvés, dans les marges les moins efficacement contrôlées, que des exemplairesisolés ou de petites bourses de marchands, c’est-à-dire des pertes accidentelles ayantéchappé au change et à la refonte par les ateliers monétaires carolingiens (24).
Le dirham de Grenade, ramené quant à lui au poids d’une obole, renforce cetteimpression d’une économie monétaire plus développée qu’on ne l’imaginait, le besoinne numéraire poussant la population locale à réutiliser des monnaies étrangères de poidsajusté en appoint des espèces officielles.
Peut-on avancer une datation de la circulation et de l’utilisation de ces dirhams dansles marges méridionales de l’empire carolingien ? La datation du dirham de Grenadeest trop hasardeuse pour apporter la moindre indication. En revanche, pour les dirhamsde Donzac, un terminus a quo nous est donné par la monnaie la plus récente, c’est-à-dire 842. On sait par ailleurs que vers 910, la taille des deniers passe de 264 à 312à la livre (25), ce qui entraîne une réduction pondérale de 1,55 à 1,31 g. Il est peu pro-bable que notre exemplaire ait été ramené à 1,45 g à une époque où le poids légal dudenier était de 10% inférieur, ce qui nous donnerait un terminus ad quem. Peut-êtrepeut-on resserrer encore un peu la datation si l’on tient compte de « l’impact de la démo-nétisation » de l’Édit de Pîtres de 864, qui a fait disparaître totalement de la circula-tion les espèces plus anciennes, et donc manifestement aussi la fausse monnaie et lesespèces étrangères (26). On arriverait alors à une période d’une vingtaine d’annéeseulement entre l’émission des dirhams à Cordoue et leur perte en bord de Garonneoù ils ont circulé, ne serait-ce qu’un laps de temps assez court, au poids et à la valeurdes deniers carolingiens.
Ces trois exemplaires provenant des bords de la Garonne ne sont pas les seulespreuves d’une circulation effective des monnaies étrangères – en l’occurrence lesdirhams d’al-Andalus – dans un circuit économique local. Trois autres cas seulementnous sont connus : un dirham découvert près de Tours « ramené par coupure circu-laire au module des deniers de Pépin » (27), un autre daté AH 238 (852) pesant 1,36 g
19. MOESGAARD 2008b.20. DEPEYROT 1993, 17 et 68-69 : « il s’agissait tout d’abord d’imposer la circulation des mon-
naies officielles qui pouvaient être refusées soit en raison de l’existence de fausses mon-naies, soit en raison de l’apparition de nouveaux types monétaires officiels ».
21. DEPEYROT 1993, 16-17 et 70 : G. Depeyrot note l’absence presque totale de monnaies plusanciennes dans les trésors enfouis après 864 (Edit de Pîtres).
22. DEPEYROT 1993, 15-16.23. MOESGAARD 2008a, 170-171.24. MOESGAARD 2008b.25. DEPEYROT 1993, 71.26. DEPEYROT 1993, 70 et GRIERSON 1991, 233.27. DUPLESSY 1956, Annexe 1, n°5.
— 148 —
Au dire du rédacteur, il semblerait que pour les numismates de cette époque cesmonnaies ont continué à être frappées au même type longtemps après la mort du roiEudes. Nous pensons que ces auteurs ont voulu parler des monnaies d’Eudes pourLimoges. En effet, 440 deniers, soit 80 % de la trouvaille de la rue de l’Ort-en-Salvy àAlbi daté du XIe siècle présentaient encore le type odonique, créé à la fin du IXesiècle, sous le roi Eudes. Ce type « immobilisé » fut frappé pendant plus de 200 ans.Limoges conserva ce type jusqu’à la fin du XIe siècle (4).
Description de notre monnaie :A/ : + ODO REX S FR C ; croix au centre R/ : + TOLVSA CIVI ; au centre ODDO posé en croix Poids : 1,48 g - Diamètre : 20 mm –Axes des coins : 3 hCet exemplaire avec la combinaison de légende à l’avers [ODO (un seul D) et S
FR C et au revers [TOLVSA (à la place de TOLOSA)] ne se rencontre pas dans les prin-cipaux livres de numismatique carolingiennes et féodales (5).
La variante de légende TOLVSA CIVI se rencontre rarement sur les deniers d’Eudes.On la trouve mentionnée seulement par Karl F. Morrison et Henry Grunthal, sous lenuméro 1343, signalé comme conservé au British Museum. La légende d’avers de cedernier est transcrite : +OOORE + CRC, cet exemplaire n’est pas illustré. Il n’est mêmepas mentionné par le même auteur dans le catalogue des monnaies carolingiennes duBritish Museum (6), ce qui nous semble surprenant !
Un exemplaire aux légendes similaires est cité dans l’ouvrage du R.P. GabrielDaniel, Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie, Paris, 3 vol., 1713-1720, p. 96. Il était alors conservé au collège Louis-le-Grand à Paris.
4. P. BLOQUÉ, « Trésor monétaire du XIème siècle découvert à Albi et méthode originaled’étude appliquée », Revue du Tarn, 106, 1982, p. 225-239 et 107, p. 42-46.
5. F. POEY D’AVANT, Monnaies féodales de France, 3 vol., Paris, 1856-1862, E. GARIEL, Lesmonnaies royales de France, 2 vol., Strasbourg, 1883-1884, E. CARON, Monnaies féodalesfrançaises, Paris, 1882, M. PROU, Les monnaies carolingiennes, Paris, 1896, K.F. MORRISON,H. GRUNTHAL, Carolingian Coinage, New York, 1967, P. NOUCHY, Les rois carolingiensde Francie Occidentale, 1994, J. DUPLESSY, Les monnaies féodales françaises, Paris, 2004,G. DEPEYROT, Le numéraire carolingien, 3e éd., Wetteren, 2008). Il n’est également pas men-tionné par l’Histoire de Languedoc de dom C. DEVIC et dom VAYSETTE, en particulier dansle chapitre numismatique rédigé par Jules Chalande.
6. R. H. M. DOLLEY and K. F. MORRISON, The Carolingian coins in the British Museum,Londres, 1966.
— 151 —
DIAZ (Jean-Marie) — Denier d’Eudes retrouvé pour Toulouse (1).
Nous vous présentons un type inédit de denier d’Eudes frappé à Toulouse, non reprisdans les principaux ouvrages de référence, mais dont on peut trouver trace dans la lit-térature du XVIIIe siècle. Cette présentation sera complétée par des illustrations :
– d’un denier du même roi à la légende rétrograde,– et d’une obole aux légendes identiques à celles du denier présenté dans cet
article.Une trouvaille importante, faite en 1845, de deniers d’Eudes pour Toulouse a été
publiée dans la RN 1846 puis résumée dans l’ouvrage d’Ernest Gariel (2) et repris parles répertoires plus récents jusqu’à Monsieur Jean Duplessy (3). Nous reprenons cettepremière publication qui est peu connue.
« Il y a quelque temps, un cultivateur des environs de Castelsarrasin, en labourantson champ, a heurté et soulevé avec le soc de sa charrue un pot de terre grossière, quis’est brisé dans le choc et a couvert la terre qui l’entourait d’un grand nombre de mon-naies d’argent du module de nos pièces de 1 franc, mais moins épaisses. Ce laboureurs’est empressé de les recueillir au nombre de trois cents ; toutes paraissaient être desexemplaires d’un même type. On a reconnu que ces pièces, frappées à l’atelier moné-taire de Toulouse, étaient royales et qu’elles offraient toutes également des deniers duRoi de France, Eudes, fils de Robert-le-fort, et qui régna de l’an 888 à l’an 898. Ces mon-naies sont peu rares, du moins en Languedoc, et ont continué d’être frappées auxmêmes types longtemps après le règne de Eudes. En voici le signalement :
+ ODDO REX FRANC. Dans le champ une croix, à quatre branches égales. R/ + TOLOSA CIVI. Dans le champ quatre annelets. Les amateurs exercés remarquent de légères variétés ou des signes différents figu-
rés sur les quatre coins monétaires, provenant du même atelier, qui ont servi à lafrappe successive de ces pièces, dont la majeure partie a été vendue à un brocanteurde Bordeaux ; mais dont un certain nombre avait préalablement été acquis par des col-lectionneurs du pays, et particulièrement Monsieur le sous-préfet de Castelsarrasin. »(Source : RN 1846, p. 84).
Malheureusement, nous n’avons pas l’inventaire précis de cette découverte et il nousest impossible de répondre aux questions suivantes : Ce trésor contenait-il uniquementdes deniers ? Quelles variantes de légendes des deniers d’Eudes pour Toulouse conte-nait-il ? Ce laboureur avait-il trouvé quatre coins de frappes ou bien les monnaiesavaient-elles été frappées avec quatre coins différents ? Dans l’esprit du rédacteur del’époque, l’expression quatre coins successifs pouvait sans doute désigner des varié-tés de type autant que des coins (matrices) différents.
1. Je tiens à exprimer toute mon amitié, ma gratitude et à remercier M. Georges Cuyssot pourm’avoir initié aux monnaies féodales et carolingiennes du Languedoc. M. Richard Prot dem’avoir parrainé à la SFN. M. Marc Bompaire, pour sa grande érudition et de sa gentillesse.Je le remercie particulièrement pour sa relecture et des corrections apportées. Leurs conseilset soutiens pour publier cet article m’ont été précieux. Je remercie également le collection-neur qui m’a présenté l’obole correspondante à mon denier une fois l’article rédigé, et quim’a autorisé à la publier.
2. E. GARIEL, Les monnaies royales françaises sous la race carolingienne, t. 2, Strasbourg, 1884,Pl. XLVIII, n° 52.
3. J. DUPLESSY, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France, Paris, 1985,n° 73.
— 150 —
Poids : 1,27 g - Diamètre : 20 mm – Axes des coins : 12 h
– un exemplaire d’une obole à la légende d’avers + ODO REX FR C et de reversTOLVSA CIVI
Poids : 0,63 g - Diamètre : 15 mm – Axes des coins : ?
1. E. CARTIER, RN 1841, p. 6 et n° 7 pl. 1 ; F. POEY D’AVANT, Monnaies féodales françaises,Paris, 1858, I, n° 2334 p. 364, et gravée sur la planche LII n° 3 dans le tome II, Paris, 1860.
— 153 —
On trouve trace d’un autre exemplaire (ou peut être s’agit-il encore de celui de GabrielDaniel) dans le Catalogue des médailles antiques et modernes, principalement desinédites et des rares, en or, argent, bronze, etc du Cabinet de M. d’Ennery, écuyer, Paris,1788, p. 682. Selon Michelet d’Ennery, l’interprétation de cette légende est la sui-vante : ODO REX S (peut-être Signatus, Sacratus) FR(anciae).
L’exemplaire que nous présentons, qui serait donc le second exemplaire connu, estd’un aspect visuel de surface médiocre laissant présumer une émission de bas titre ;le fait d’un ajout de lettres (le S), la forme de la légende TOLVSA, qui n’apparaît plusaprès Charles le Chauve sinon sur un type de Guillaume (Caron 308) ou sur une pièceau nom d’Eudes du trésor du Puy daté vers 1005 (7) : il y a là un faisceau d’indices quinous laissent penser que ce denier se situe à la fin du monnayage d’Eudes.
Nous émettons l’hypothèse suivante sur la chronologie du monnayage toulousaind’Eudes.
Il semble logique qu’Eudes utilise en premier la légende « GRATIA D-I REX », avecses variantes au début de son règne, puisqu’une vingtaine d’ateliers l’ont utilisée, dontla plupart sont situés au nord de la Loire où il est comte de Paris, comte de Troyes, ducdes Francs et marquis de Neustrie (nord-ouest de la France actuelle).
La faible fréquence à ce jour des découvertes des pièces de ce type pour Toulousepourrait être un argument pour une frappe relativement peu étendue dans le temps.
Toulouse aurait ensuite adopté la légende d’avers « ODDO REX FR C » et au revers« TOLOSA CIVI » pour les deniers et oboles qui semblent assez communs. Il est pos-sible que ce type a été créé suite au passage en Languedoc du roi Eudes en 890. Tousles exemplaires dont nous avons pu voir une illustration sont à ces légendes.
Le classement serait donc :1 : denier à l’avers + GRATIA D-I REX et revers TOLOSA CIVI (1,54 g à 1,60 g)2 : denier à l’avers + ODDO REX FR C et revers TOLOSA CIVI (1,33 g à 1,71 g)3 : denier présenté ici, avers + ODO REX S FR C et revers TOLVSA CIVI (1,48 g)
Illustration du denier 1 :
Poids : 1,58 g - Diamètre : 20 mm – Axes des coins : 12 h
Nous terminerons cet article en présentant :– un exemplaire de denier à la légende rétrograde du revers ; nous le reproduisons
car il nous paraît d’une grande rareté. Il est à remarquer que les légendes rétrogrades(écrite en miroir, la légende se lit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) sontsouvent confondues avec les légendes dégénérées. Il est d’ailleurs à relever que sur cetexemplaire le L et le S n’ont pas été gravés en miroir.
7. J. LAFAURIE, « Le trésor monétaire du Puy, contribution à l’étude de la monnaie à la fin duXème siècle », RN 1952, p. 51-169, n° 94.
— 152 —
PROT (Richard) — Une monnaie inédite de Raymond VII de Turenne (1285-1304).
La monnaie connue depuis 1841Le premier, Cartier décrivait une monnaie de Turenne qu’il attribua à Raymond VI
par comparaison avec la monnaie de Hugues X comportant CHE dans le champ, touten précisant qu’elle était de facture plus moderne que celles de Turenne connuesjusque-là. On retrouve cet exemplaire dans l’ouvrage de Poey d’Avant (1).
Droit : +TVRENE VICEC avec en partie centrale : +OMES+Revers : + RAIMVNDVS croix dans le grènetis intérieur.Denier. 0,75 g (3h). Collection privée. Cette monnaie est réapparue sur le marché parisien en provenance du Sud-Ouest
de la France.
Cette pièce de Turenne se retrouve dans l’ouvrage de Caron avec des éléments àcaractère historique ; l’auteur précise qu’elle appartient à Cartier et qu’il n’a jamais vuce denier en nature. Il propose de le mettre en parallèle avec une monnaie d’Aquitaineavec ANGLE et deux traits et deux croisettes, une au-dessus, une au-dessous (PlancheX), et Poey d’Avant Planche LX. Monsieur Duplessy reprend et corrige la lecture en AGL
Fig. 1 : photographie Fig. 2 : dessin de Poey d’Avant
la base du T annelé. La présence d’une pièce d’Aquitaine avec ce T annelet dans unebourse (obole du type Elias n°110c) trouvée lors de la fouille de Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse, dont le terminus post quem est antérieur à la datation d’Elias, infirmecelle-ci (4).
Autre argument mis en valeur par Caron dans la partie consacrée à Turenne : un actedu 22 avril 1263 (Justel, preuves) entre Henri II, roi d’Angleterre et Raymond VI deTurenne, sur le transfert d’hommage au roi d’Angleterre pour ses châteaux, ses fiefs« etiam pro moneta sud et jure eudendi eam » sur les instances « ad preces » du roi deFrance saint Louis ; il en conclut qu’il est « donc rationnel d’admettre que le vassal duroi d’Angleterre, seigneur des domaines limitrophes à l’Aquitaine, […] ait imité lesespèces circulant dans cette province », augmentant d’autant la circulation de sonnuméraire (5). A. Viré, pense que les monnaies de Turenne ont été frappées à Martel (6).
DatationCompte tenu de la rareté aussi bien du prototype aquitain – du type mentionné plus
haut en note 3 – que des deux deniers de Turenne, il paraît difficile d’atteindre une plusgrande précision de datation, ces exemplaires ne figurant dans aucune trouvaille.
La présence de monnaies des types Elias n° 20 et 22 est avérée dans les trésors desannées 1310. Les différentes variations du type monétaire Elias n° 95 en Aquitaine ainsique ses imitations dans les petites seigneuries de la vallée du Rhône dans les années1325-1348 éliminent l’hypothèse de datation d’Elias qui propose 1325-1355 (7).
Ce monnayage ne peut qu’être antérieur à la mort de Raymond VII à la bataille deMons-en-Pévèle en 1304. Ensuite, la seigneurie de Turenne passe dans la Maison deComminges ; Bertrand II épouse la fille de Raymond VII. Turenne n’est pas cité dansl’ordonnance de 1315. Dans le cas de la validité de cette hypothèse comme terminus,nous pouvons dater le prototype et son imitation entre 1285-1304.
4. M. BOMPAIRE, BSFN, novembre 1999, p. 185-187 citant F. DIEULAFAIT, « Les monnaies dansl’ancienne église Saint-Pierre-les-Cuisines à Toulouse », Mémoires de la Société Archéologiquedu Midi de la France, t. 48, 1988, p. 121-131 (obole au léopard, Elias n° 110c).
5. E. CARON, op. cit., p. 124-125.6. A. VIRÉ, « Les monnaies du Quercy du IVe siècle avant J.-C. au XXe siècle», BSEL, 1938-1939,
LIX, p. 54, 166, 254, 327 et LX, p. 65.7. Voir M. BOMPAIRE, BSFN, novembre 1999, p. 186 et ELIAS, p. 49. Pour la Vallée du Rhône,
voir R. CHAREYRON, BSFN, janvier 2003, p. 9-12.
— 155 —
avec une lettre E en dessous et un léopard au-dessus et le graphisme à juste titre, la mon-naie décrite par Caron étant une chimère. L’un et l’autre l’attribuent à Raymond VII (1285-1304). Cette monnaie est illustrée par Elias (2).
Fig. 3
La monnaie inéditeL’autre exemplaire, celui-ci inédit aussi bien pour le droit que pour le revers en ce
qui concerne la légende est pratiquement le même pour la partie centrale du droit. Envoici la description :
Fig. 4
Droit : +RAMVND’.VICEC avec en partie centrale : +OMES+Revers : DE.TVRENNA croix dans le grènetis intérieur.Denier. 0,80 g (6h). Collection privée (Fig. 4).Nous notons la plus grande finesse de gravure sur cet exemplaire.Bien que cette monnaie ne soit dans aucun trésor, la composition de l’avers a attiré
mon attention sur un denier d’Aquitaine illustré par Caron et Elias dont le droit est occupépar un léopard tourné vers la gauche entre deux traits, avec une croisette au-dessus etau-dessous (3).
Fig. 5 (Caron, n° 12 pl. X)
Cette composition pouvant être interprétée comme un trompe-l’œil en lieu et placede celle-ci, la fin du mot VICEC – OMES pouvant être perçu en image et non par lalecture. La datation de ce denier reste hypothétique, Elias l’attribuait à Edouard III sur
2. E. CARON, Monnaies féodales de France, Paris, 1882, p. 124-125 ; J. DUPLESSY, Les mon-naies françaises féodales, Paris, 2004, Tome I, n° 905 ; E. R. DUNCAN-ELIAS, Les monnaiesanglo-françaises, Paris-Londres, 1984, n° 18.
3. E. CARON, op. cit., n° 12 pl. X ou E. R. DUNCAN-ELIAS, op. cit., n° 99. Ce dernier mentionneque Hewlett avait classé cette monnaie à Edouard Ier (1252-1272-1307).
— 154 —
BERDEAUX-LE BRAZIDEC (Marie-Laure), MEISSONNIER (Jacques) — À propos dela signature d’un jeton des États de Bourgogne de 1688 au Musée de Montauban.
Le Musée Ingres de Montauban possède un jeton en cuivre des États de Bourgognequi se décrit ainsi :
Droit : . ESTATS . DE – BOURGOGNE . ; écu aux armes de Bourgogne timbré d’unecouronne et posé sur un manteau aux armes de Bourgogne à l’extérieur et d’hermineà l’intérieur.
Revers : IL . ASSEURE . MON . REPOS . ; Louis XIV en perruque, lauré, nu, ladépouille du lion de Némée flottant sur ses épaules et autour du bassin, debout àgauche, main droite appuyée sur la massue d’Hercule, la main gauche sur la hanche,
sous le règne de François Ier, mais à partir de 1540, Dijon prend la lettre P comme marqued’atelier qu’elle conserve jusqu’en 1774 sous le règne de Louis XV. Enfin, depuis 1631les jetons doivent être frappés à la Monnaie de Paris. Le B ne peut donc pas être la marqued’atelier de ce jeton.
Le B est-il une signature de graveur ? Lorsque les graveurs signent leurs médailles,ils placent fréquemment leurs initiales justement à l’exergue. Explorons cette possibi-lité pour notre jeton. Les Archives départementales de la Côte-d’Or (AD 21) conser-vent l’essentiel des archives des États de Bourgogne. Nous y avons cherché en vain cepen-dant le contrat rédigé entre les représentants des États de Bourgogne et l’artiste chargéde graver les coins du jeton de 1688. Toutefois, les AD 21 conservent les contratspour le jeton précédent (1686) et le jeton suivant (1692) (4). Le graveur Pierre Soubiran(date de naissance ?, décédé avant le 29.X.1693) a signé le 22 janvier 1686 devant lenotaire Lange un contrat stipulant qu’il devait graver les coins nécessaires à la fabri-cation de 300 jetons d’or, 3950 jetons d’argent et 9000 jetons de cuivre (« le plusbeau qu’il se pourra »), jetons à livrer pour le 9 février 1686. Soubiran a donc 18 jourspour graver les coins et frapper les jetons. Deux jours avant, le 20 janvier 1686, les repré-sentants des États de Bourgogne signent un contrat avec Maître Henry Tresneau, mar-chand boursier, qui doit fournir les bourses nécessaires à la remise des jetons (5).
En 1692, les représentants des États de Bourgogne signent le 1er février un nouveaucontrat avec Henry Tresneau pour les bourses (6). Le 4 février 1692, ils signent un autrecontrat avec un artiste qui doit graver les coins et frapper les jetons sous 15 jours. Cegraveur s’appelle Hercule Le Breton. Nous proposons de reconnaître dans le B dujeton de 1688 l’initiale de Le Breton utilisée comme signature. De plus, la représen-tation de Louis XIV en Hercule, peu ordinaire puisqu’on attendrait davantage Mars, dieude la guerre, ou Apollon, dieu du soleil, qui sont les dieux gréco-romains préférés duRoi-Soleil alors à l’apogée de son règne, nous paraît conforter cette hypothèse parcequ’elle est aussi une allusion évidente au prénom peu banal du graveur. Déjà en 1990,Jean-Pierre Garnier avait proposé d’identifier H. Le Breton derrière un B figurant sur descoins de monnaies du duc de Bouillon datées de 1683 et 1684 (7). Les AD 21 conser-vent les contrats conclus avec les graveurs pour certains des jetons des États deBourgogne des années suivantes. Outre 1692, H. Le Breton est signataire des contratsde 1701, 1704, 1707, 1710 et 1713 (8). Entre 1692 et 1713, des jetons des États deBourgogne portent les millésimes de 1694 et 1698. Le contrat pour celui de 1694n’est pas aux AD 21 et toute la fabrication, bourses et fourniture des métaux comprises,de celui de 1698 est confiée à un mandataire, Cler (9), ce qui fait que nous ignoronsle nom du graveur. En 1715, le graveur est le Norvégien Reug (10). À partir de 1719et pour de nombreuses années, les jetons des États de Bourgogne sont gravés par Jean
4. Cotes AD 21 : C.3345.1 et C.3345.4.5. Cote AD 21 : C. 3345.2.6. Cote AD 21 : C. 3345.3.7. J.-P. GARNIER, « Les monnaies de Godefroi-Maurice de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon
(1652-1721) », RN 1990, p. 179.8. Cotes AD 21 : C. 3345, pièces 8, 11, 15, 17 et 23.9. Cote AD 21 : C. 3345.6.10. Orthographe de la signature (cote AD 21 : C. 3345.31). Il s’agit de Michel ou Michaël Rög,
dont le nom est orthographié tout aussi bien Rog, Roeg, Roëg, Ruck ou encore Rugh, né vers1679 à Rögenäs en Norvège, arrivé en 1715 à Paris où il décède en 1736 ou 1737. Ce jetonde 1715 est l’un de ses premiers travaux en France.
— 157 —
au milieu d’un champ de bataille déserté et jonché à gauche d’un cadavre sur le dos,d’un étendard et d’une cuirasse, à droite d’un cadavre sur le ventre et d’un canon, àl’arrière plan le sol est couvert de pics ; à l’exergue : MDCLXXXVIII / B.
N° d’inventaire : MI 2007.0.850 ; poids : 8,59 g ; diamètre : 30,5 mm ; orientationdes coins : 6 h.
Cf. Rossignol p. 184-186 ; cf. Feuardent t. 2, n° 9820 (argent) et 9821 (cuivre) ; cf.Bertrand n° 1175 ; Berdeaux-Le Brazidec p. 34-35 (cet exemplaire) (1).
L’ouvrage de référence de Rossignol sur les jetons des États de Bourgogne décrit bience jeton, mais ne mentionne pas le B à l’exergue, ni dans sa description, ni dans sondessin. Il en va de même pour Feuardent et la collection Ernest Bertrand au Musée archéo-logique de Dijon. Pourtant les deux jetons (Musée de Montauban et collection Bertranddu Musée archéologique de Dijon) semblent de même coin de revers. Leur frappeparaît légèrement décentrée, l’une vers le haut omettant le B (Dijon) et l’autre vers lebas reproduisant le B (Montauban). Cette présence du B à l’exergue n’est cependantpas complètement nouvelle. En effet, le B est mentionné dans la description du jetonn° 286 de la collection Gueneau d’Aumont publiée en 1884 (2). H. de La Tour en cata-loguant la collection Rouyer (n° 3677) a certainement mal lu le B puisqu’il mentionneun R à l’exergue sous le millésime (3).
Si le B n’est pas inédit, il n’a jamais été expliqué à notre connaissance pour ce jeton.Il ne peut pas s’agir de la marque de l’atelier de Dijon pour trois raisons. La marquede l’atelier de Dijon sous le règne de Louis XI après la mort de Charles le Téméraire,de 1477 à 1483 est une coquille, style St-Jacques. Cette marque est conservée jusque
1. C. ROSSIGNOL, Des libertés de la Bourgogne d’après les jetons de ses États, Autun, 1851.F. FEUARDENT, Collection Feuardent, jetons et méreaux depuis Louis IX jusqu’à la fin duConsulat de Bonaparte, Paris et Londres, 1904, rééd. Paris, 1995 ; t. 1, XVI et 503 p. ; t. 2,517 p. ; t. 3, 506 p. ; t. 4, 16 p. et XXII pl., 68 p. et VIII pl., 71 p. et pl. IX à XVI, 24 p. et pl.XVII-XVIII. J. MEISSONNIER (dir.), Musée archéologique de Dijon, monnaies & jetons, col-lection Ernest Bertrand, Dijon, 2009. M.-L. BERDEAUX-LE BRAZIDEC, Les collections numis-matiques du musée Ingres, Montauban, 2010, p. 34-35.
2. P. GUENEAU D’AUMONT, « Catalogue descriptif du médaillier légué à la Commission desAntiquités du département de la Côte-d’Or par M. Philibert Gueneau d’Aumont, membre titu-laire », Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, X, 1878-1884, p. 293-564 et 2 pl. (p. 73 du tiré à part).
3. H. de LA TOUR, Bibliothèque nationale, Catalogue de la collection Rouyer léguée en 1897au département des médailles et antiques, 2e partie : Jetons et méreaux de la Renaissance etdes Temps modernes, Paris, 1910, pl. XXIX à LVI.
— 156 —
Fig. 1 : Exemplaire du musée Ingres du jeton de 1688 (photo Olivier Balax, musée Ingres).
à Hercule Le Breton pour son travail dûment effectué 156 livres dont 6 « pour les vinsà ses garçons ainsi qu’il est accoutumé » (20). Les « garçons » sont ses aides ou com-mis. Le Breton avait au moins un fils né vers 1683 qui a également commencé une car-rière de graveur, puisqu’un poinçon conservé porte la mention « Breton fit à l’âge de18 ans chez son père ce poinçon et le finit le treize septembre 1701 » (21).
Même si la preuve irréfutable manque, faute d’avoir retrouvé le contrat liant le gra-veur des coins et les élus des États de Bourgogne pour le jeton de 1688, nous consi-dérons comme hautement probable que le B figurant à l’exergue soit l’initiale et la signa-ture du graveur Le Breton. L’étude de ce jeton complète nos connaissances sur cegraveur et la fabrication des jetons des États de Bourgogne.
20. Cote AD 21 : C.3345.26.21. J. JACQUIOT, loc. cit., p. 394-395.
— 159 —
Duvivier (1687-1761) (11). Notons que, comme Le Breton en 1688, Duvivier signe deses initiales DV son premier jeton pour les États de Bourgogne en 1719.
H. Le Breton est fort peu connu. J.-J. Guiffrey (12) lui a consacré sept pages qui consis-tent essentiellement en une liste des médailles gravées par Le Breton et qui n’ont faitl’objet que de petits résumés en anglais par L. Forrer (13) ou en français par J. Jacquiot(14) qui n’apportent rien de plus. Il ne figure même pas dans Bénézit (15). SelonGuiffrey, « nous ne savons rien de précis sur la date de sa naissance et sur celle de samort. Et pourtant, il travailla presque sans interruption pour la Monnaie des médaillesdepuis 1685 jusqu’à sa mort arrivée entre 1712 et 1714… [Il] travaillait pour la Monnaiedes médailles depuis quarante années » (16). Le Breton est cependant un artiste de talentqui « fut plus d’une fois chargé de la partie la plus délicate des médailles, c’est-à-diredes portraits et des bustes… il ne fut pas jugé indigne d’achever quelques pièces com-mencées par les plus fameux graveurs du temps, par Warin et par Roettiers » (17). Lesdifférents auteurs que nous venons de citer mettent l’accent sur la gravure de médaillespar Le Breton. Nous insistons sur son travail pour des jetons qui est resté jusqu’à pré-sent dans l’ombre. Son nom, Le Breton, le prédestinait à graver des jetons des États deBretagne, ce qu’il fait en 1683, 1685 et 1687 en signant HB (18). Le Breton a réaliséun jeton pour la Comédie Française dont il signe le droit à l’effigie de Louis XIV, de sonnom, BRETON, sous le buste (19). Les documents conservés aux AD 21 apportentquelques lumières supplémentaires. Dans le contrat du 4 février 1692, il est précisé « gra-veur du roi demeurant à Paris au pavillon françois joignant la porte du Louvre ». Ceuxde 1701, 1704, 1707, 1710 et 1713 le qualifient de « graveur de S. M. [Sa Majesté]demeurant en la place du carousel aux galeries du Louvre ». Nous connaissons désor-mais son adresse qui n’avait jamais été précisée jusqu’à présent. La fourchette de data-tion pour son décès peut être resserrée puisque le 3 mai 1713 il signe son contrat degraveur pour le jeton des États de Bourgogne et que, le 30 mai 1713, les élus des Étatsde Bourgogne ordonnent à François Chartraire, trésorier général desdits États, de payer
11. C. ROSSIGNOL, op. cit., p. 212.12. J.-J. GUIFFREY, « La monnaie des médailles, histoire métallique de Louis XIV et de Louis XV
d’après les documents inédits des Archives nationales, Deuxième partie : les graveurs (suite) »,« Hercule Le Breton », RN 1889, p. 267-273.
13. L. FORRER, Biographical dictionnary of medallists coin-, gem-, and seal-engravers mint-masters, etc. ancient and modern with references to their works B.C. 50-A.D. 1900, vol. 1,London, 1904, p. 279-280.
14. J. JACQUIOT, La Médaille au temps de Louis XIV, catalogue de l’exposition tenue à l’Hôtelde la Monnaie, Paris, 1970, p. 167-168 : « La biographie d’Hercule Le Breton est inexistante ;de ce graveur, on ignore le lieu et la date de naissance, la formation qu’il reçut, la date de samort… [Il] ne fut pas membre de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture. »
15. E. BÉNÉZIT (héritiers), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessi-nateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays…, Paris, 1976 (éditions précédentes1911-1923, 1948-1955), en 10 vol.
16. J.-J. GUIFFREY, loc. cit., p. 267 et 269.17. Idem, p. 272.18. J. DANIEL, Les jetons des États de Bretagne, La Ferté-Macé, 1980, p. 21-25 n° 26-33.19. Nous remercions J.-P. Garnier de nous avoir fait connaître ce jeton (Feuardent 5058) qui a fait
l’objet d’une reprise en 1980 par la Monnaie de Paris qui sert de jeton de présence aux assem-blées de la Comédie Française (P. DEVAUX, « 4. La Comédie-Française : une institution, 4.1Brève histoire administrative et des relations avec le pouvoir », Les Nouveaux Cahiers de laComédie-Française, Hors série, Paris, novembre 2009, p. 91-98, illustration p. 92-93).
— 158 —
Fig. 2 : Signature (et empreintes digitales ?) d’Hercule Le Breton sur le contrat de graveur du 3 mai 1713.
TURCKHEIM-PEY (Sylvie de) — Le jeton de l’Académie de Montauban.
Par Lettres Patentes, données à Dunkerque le 19 juillet 1744, et enregistrées auParlement de Toulouse le 21 août suivant, Louis XV accordait à la Société littéraire deMontauban le titre d’Académie des Belles-Lettres. Le règlement joint aux Lettres Patentesprécise que « le sceau de l’Académie sera un saule, tel qu’il est dans les armes de laville de Montauban, poussant de sa tige une branche de laurier, avec ces mots deVirgile : “Miraturque novas frondes” (Géorgiques, livre II, vers 78sq.). Dorénavant, onapposera ce sceau sur toutes les lettres et expéditions de l’Académie. Le sceau, œuvrede Viviers [sic], graveur du Roi, figurera à partir de 1745 au frontispice du premier recueilde l’Académie. »
Pour tous, l’évocation de l’arbre et de ses nouvelles frondaisons était synonyme d’en-chantement et de foi en l’avenir, si bien que « miraturque novas frondes » avait été favo-rablement retenu comme devise de la Société littéraire dès 1730 et repris pourl’Académie.
Le jeton présenté ici ne fait pas référence à la Société littéraire, ce que certains deses membres regrettaient. Il existe toutefois un jeton plus tardif avec, au droit, la repré-sentation de Minerve assise à gauche offrant de chaque main une couronne, et, au revers,inscrit en cinq lignes SOCIETE.DES. SCIENCES.BELLES. LETTRES. ET. ARTS. DE . TARN-ET-GARONNE (Feuardent II-11072), et un exemplaire en bronze avec le même revers
ronné de l’évêque Michel de Verthamon (Ex Dono D. D.(dedit) Verthamon EpiscopusMontalbanensis).
Argent, diam. 30 mm. Feuardent II – 11069. Coll. part.Ce jeton non signé est probablement l’œuvre de Duvivier.Avec l’autorisation du comte de Saint-Florentin, protecteur de l’Académie, et l’agré-
ment de l’évêque, il fut décidé en juillet en 1747 que le prix de 250 livres fondé parMonseigneur de Verthamon serait converti en une bourse de 100 jetons d’argent depareille somme. Les coins de ces jetons furent payés 300 livres en 1748 au célèbre« Viviers » (Duvivier), graveur du Roi. L’hôtel des Monnaies consentit à les frapper.Monseigneur de Verthamon n’ayant pas assuré à l’Académie la somme qu’il avait des-tinée au prix annuel, l’abbé de La Tour, se chargea de rétablir l’attribution de cette récom-pense avec le soutien de la ville de Montauban. Un jeton fut alors commandé au nomde ce nouveau et généreux protecteur, mais à ce jour nous n’en connaissons pasd’exemplaire (2).
Monseigneur de Verthamon était l’un des quatre académiciens fondateurs avecBertrand de La Tour, Louis de Cahuzac et Jean-Jacques Le Franc, marquis de Pompignan,avocat général à la Cour des Aides. Celle-ci avait été transférée de Cahors à Montaubanpar édit de 1661.
C’est 600 ans (en 1744) après la fondation de la ville de Montauban par AlphonseJourdain, comte de Toulouse en 1144, que fut créée l’académie. Les 30 premiers aca-démiciens montalbanais sont tous issus de la Société Littéraire et 3 sont désignés parle Roi : le premier président de la Cour des Aides, l’intendant et l’evêque.
La Révolution de 1789 eut pour conséquence la dissolution de l’académie qui seréunit pour la dernière fois en 1791. Par la suite l’académie connut bien des change-ments qui sont à l’origine de ses différents appellations : Société des Sciences, Agricultureet Belles-Lettres de Tarn-et-Garonne, avant de redevenir « Académie » en 1883 et, enfin,de prendre sa dénomination actuelle en 1926 : Académie de Montauban (Sciences,Belles-Lettres, Arts, Encouragement au Bien).
Petit rappel historique pour planter le décor de notre propos « pré-académique » :Henri IV, dit le Grand, mais que nous préférons appeler ici « le bon Henri », dont ona commémoré le 14 mai la mort tragique en 1610, est le fils d’Antoine de Bourbon etde Jeanne d’Albret, reine de Navarre. Élevé dans la religion réformée, il échappe pour-tant au massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, mais il fut emprisonné. Il s’évadeen 1576 et se met à la tête du parti huguenot.
En remontant du Béarn vers Paris, le roi emprunte en partie le circuit du pastel quipasse par Puylaurens (Tarn) et les hauts coteaux, fuyant les troupes du duc de Guise.En dépit de l’opposition catholique, ce roi habile pacificateur réussit à établir, à Lisle-sur-Tarn puis à Castres en 1595, une cour de justice mi-partie (9 juges protestants et 9catholiques), appelée «chambre de l’Édit» en application des recommandations del’Édit de Poitiers de 1577.
L’Édit de Nantes signé par Henri IV le 13 avril 1598 se présente comme une loi dontles textes sont l’aboutissement d’une négociation laborieuse. L’Édit se proclame per-pétuel et irrévocable. Les principaux documents contenus sont :
– des brevets, actes de concession royale dont les plus connus concerne les villesde sûreté accordées aux Huguenots, notamment La Rochelle, Montauban et Montpellier ;
2. Pour l’attribution des prix et des jetons à partir de l’abbé de La Tour, voir E. FORESTIÉ NEVEU,La Société littéraire et l’Ancienne Académie de Montauban, Montauban, 1888.
— 161 —
que précédemment et, au droit, le buste de Minerve à droite, signé (A) Dubois (FeuardentII-11072a).
Le jeton de l’Académie se décrit comme suit (Fig. 1) :
Droit : MIRATURQUE NOVAS FRONDES (« Il admire les frondaisons nouvelles »)surmontant un saule dont les six branches sont tronquées ; une bouture ligaturée surle tronc génère une branche de laurier bien feuillue et garnie de ses fruits.
L’exergue, inscrite sur trois lignes, précise la fondation de l’Académie par Louis XV,dans la 29e année de son règne, donc en 1744 :
ACAD.(emia) MONTALB.(anensis) FUND.(ata)AUSP.(ice). / LUD(ovico)XV.P.(ater)P.(atriae) PIO F.(elice)AUG.(usto)/
IMP.(perii) AN.(no) XXIX.
P.P. pourrait aussi être lu P.(er)P.(etuus), contrairement à ce qui est proposé dans leRecueil de l’Académie de Montauban, tome IV, année 2003, p. 200.
Le saule qui figure également sur le armes de la ville de Montauban concourt à ladésignation de la ville : SALIX ALBA (le saule blanc) peut être rapproché de MONS ALBA-NUS (la terre blanche des fortifications) pour exprimer tout à la fois MONTALBANUSet le saule emblématique (1).
Revers : EX DONO D. D. DE VERTHAMON EPISC. MONTALB.Sous le chapeau épiscopal orné de ses rubans et d’une mitre figure le blason cou-
1. Nos sincères remerciements vont à M. Norbert Sabatié, membre titulaire de l’Académie deMontauban, pour ces précisions ; et à M. Roland Garrigues, membre du Conseil général, quia fait circuler un jeton en bronze du type Feuardent II- 11702a, poids 21,34 g. Nous adres-sons notre vive reconnaissance à M. Michel Ferrier pour les précisions qu’il a bien voulu nousfaire connaître.
— 160 —
Détail de l’exergue
rédemption, mais tout doit être fait pour améliorer les conditions de vie des pauvres.Il fallait donc toujours réglementer la mendicité, car l’éternel problème que posaientles mendiants des villes, c’était leur identification afin de permettre aux forces del’ordre de faire la chasse aux « faux » mendiants, hélas toujours très nombreux.Cependant il fallait agir, comme l’écrivait Anne-Robert-Jacques Turgot en 1808 (6),« ...avec la modération nécessaire pour ne point risquer de confondre deux choses aussidifférentes que la pauvreté réelle, et la mendicité volontaire occasionnée par le liber-tinage et l’amour de l’oisiveté. La première doit être non-seulement secourue, mais res-pectée; la seconde seule peut mériter d’être punie. » Ces faux mendiants étaient nom-breux dans les villes, et ils étaient même parfois agressifs, voire même souvent violents,ce qui est souligné par tous les rapports écrits concernant la réglementation ou l’in-terdiction de la mendicité, et ce, quelle que soit l’époque concernée.
Un décret impérial du 5 juillet 1808 prescrit la création d’un « dépôt de mendi-cité » dans chaque département, établissement dans lesquel on devait placer les per-sonnes arrêtées pour mendicité.
Un seul numismate, René Bredin, à qui il faut rendre hommage aujourd’hui, atenté autrefois de répertorier ces médailles (7), mais malheureusement très sommairement,et sans véritables illustrations. Ces médailles de mendiants sont les vestiges, à desépoques différentes, des diverses réglementations concernant la mendicité dans tousses états. Nous allons parler de toutes celles que nous avons pu retrouver, en portantun intérêt particulier à celles de Montauban et du département de Tarn-et-Garonne (8).
Pour Montauban (Tarn-et-Garonne)• 1er type (fig. 1)
6. A.-R.-J. TUGOT, Œuvres de M. Turgot, T. VI, p. 2, « Suite des travaux relatifs à la disette del’année 1770, Supplément aux instructions du 1er août et du 20 novembre 1768, concernantla suppression de la mendicité ».
7. R. BREDIN, « Médailles de mendiants », CahNum, n° 29, 1971, p. 95-100.8. Seules les médailles du département du Lot-et-Garonne figureront dans le BSFN des Journées
numismatiques. L’ensemble des médailles feront l’objet, après acceptation, d’un corpus dansla RN 2011.
— 163 —
– des actes particuliers ou secrets, comme l’article 34 ouvrant aux Réformés la pos-sibilité de tenir des synodes ;
– tourné vers l’avenir, l’édit fixe le statut de la « Religion Prétendue Réformée » (l’ex-pression humiliante y est déjà) et l’organisation des églises qui sera à l’origine de la créa-tion des « académies ».
La première académie fut fondée à Nîmes en 1561, puis le synode national de 1598de Montpellier décida la création de deux nouvelles académies à Saumur et àMontauban. Ces académies protestantes sont des écoles gratuites d’enseignementsupérieur qui rappelaient le premier établissement de Genève appelé « académie » parJean Calvin.
L’Académie de Montauban s’installa donc en octobre 1600 près du collège fondéen 1580. Elle comprenait une faculté des arts et une faculté de théologie où l’ensei-gnement était prodigué à une compagnie mi-partie, catholique et protestante. Mais, àpartir de 1629, l’acte d’abolition édicté par Louis XIII enlève aux huguenots leursforces et leurs privilèges politiques tout en leur laissant le libre exercice de leur culte.Dès 1663, le collège-université académique de Montauban est l’objet de conflits entreprofesseurs et collégiens des deux religions, fomentés en grande partie par le partijésuite et les fanatiques de la Compagnie du Saint-Sacrement. Une bagarre entre col-légiens fut l’occasion de dissoudre l’académie et, le 12 décembre 1658, Louis XIV, encore« peu aux affaires du royaume », ordonna le transfert à Puylaurens de l’Académie deMontauban, ce qui eut lieu le 5 février 1660. Elle y demeura jusqu’à la Révocation del’Édit de Nantes en 1685. Montauban resta sans académie de 1658 à 1743 mais la célèbreSociété littéraire siégeait dans l’attente de retenir l’attention de Louis XV en 1744.
1. A. BLANCHET et A. DIEUDONNE, Manuel de numismatique française, T. III, Paris, 1930, p. 46.2. Déjà, après bien d’autres, Louis XV fit publier en 1724 une « Ordonnance sur la mendicité »
où tous les aspects des problèmes posés par la mendicité sont exposés. 3. Louis-Alphonse Savary, marquis de Lancosme, député d’Indre-et-Loire, présente à l’Assemblée
nationale le 27 octobre 1790 : « opinion et projets de décrets sur la mendicité ».4. Saint Ouen, Vita Sancti Eligii, traduction de l’abbé Parenty, 2e éd., Lille-Paris, 1870, p. 127.5. M. LUTHER, Œuvres, T. V, Genève, 1978, p. 248.
— 162 —
GARNIER (Jean-Pierre) — Les médailles de mendiants. À propos de quelques typesinédits pour les mendiants de Montauban et du département de Tarn-et-Garonne.
Il existe des médailles ayant servi de « permis de mendier » et l’intérêt des numis-mates pour celles-ci ne semble dater que de l’extrême fin du XIXe siècle (1). Enrevanche, la réglementation de la mendicité a, quant à elle, suscité depuis toujours desétudes et des discussions approfondies qui seraient trop longues à présenter dans notreexposé (2, 3).
Lié à la religion, pour les uns, et à une réflexion philosophique, pour les autres, notreregard sur la pauvreté résulte d’une lente et longue évolution. À propos de l’aumônefaite aux pauvres, il est écrit dans la vie de saint Éloi (4) : « Celui que la Providence apourvu de plus grands biens sera jugé plus sévèrement, car Dieu aurait pu rendre tousles hommes riches; mais il a voulu qu’il y eût des pauvres en ce monde, pour fournirà ceux qui possèdent davantage l’occasion de racheter leurs péchés ». C’est ce dogmede la « donatio pro anima » qui divisera plus tard les chrétiens. En effet, c’est surtoutla Réforme qui, au XVIe siècle, fera changer le regard que tous les chrétiens portentaujourd’hui sur l’aumône faite aux pauvres (5) : le don à un pauvre n’a plus valeur de
Fig. 1 : droit et revers, diamètre hors bélière : 35 mm
Droit : Le saule étêté, en partie copié par surmoulage sur le type précédent, maisen réduisant le tertre.
Revers : Grand 78 sur l’un et 82 sur l’autre, moulés en même temps que lesmédailles.
Rond, alliage cuivreux couleur laiton.Diamètre hors bélière 46 mm.Poids : n° 78 = 47,10 g, n° 82 = 30,61 gBredin : manque
• 3e type (fig. 3)Un modèle différent, en forme de cœur est datable du début du XIXe siècle (11):
Droit : Le saule étêté semblable à celui de la médaille précédente, est placé au centred’un cœur entouré d’un grènetis en creux (12).
Revers : au centre, grand numéro 137 en relief, souscrit de la mention Mendianten caractères cursifs et en creux. Le cœur entouré d’un grènetis en creux.
Alliage cuivreux jaune, H. 50 mm sans la bélièreBredin p. 97, autre exemplaire avec le numéro 124.
• 4e type (fig. 4)À l’invitation de Sylvie de Turckheim-Pey, que nous remercions vivement (13),
nous avons recherché puis retrouvé dans les collections du Cabinet des médailles et
11. Vente Delavenne-Lafarge, expert Christian Blondiau, Drouot 8 mars 1996, que nous remer-cions vivement pour la reproduction.
12. Malheureusement nous n’avons pas la reproduction du droit.13. Il y a quelques mois, Sylvie de Turkheim-Pey, que nous tenons à remercier aujourd’hui, nous
avait glissé dans la main une enveloppe avec une vieille diapositive datant des années 1990,et sur le cliché un peu sombre figurait le droit seul de cette médaille. Nous ignorions alorssa cote, ses dimensions et son métal. C’était le début d’un jeu de piste, dont l’aboutissementdevait être obligatoirement les Journées numismatiques de Montauban. Ce fut le début de notrerecherche.
— 165 —
La plus célèbre de ces médailles, et peut-être la plus ancienne aujourd’hui connue,date du XVIIIe siècle. Elle concerne les mendiants de Montauban. Un exemplaire sansbélière fut décrit pour la première fois, accompagné d’un dessin par Henri Rolland en1926 (9). Le Musée Ingres en possède un exemplaire dont voici la description :
Droit : Dans un grénetis cordonné, un « saule étêté » (emprunté au armes deMontauban, de gueules au saule d’or étêté, ayant six branches sans feuilles, trois à dextre,trois à senestre; au chef cousu d’azur chargé de trois fleurs de lis d’or).
Revers : MAN-/DIANT/.DE MON-/TAVBAN (AV liés), en quatre lignes dans un gré-netis cordonné.
Alliage cuivreux couleur laiton.Diamètre hors bélière : 35 mm.Collection du Musée Ingres à Montauban (fig. 1)Bredin : cité p. 97De ce type, nous avons rencontré d’autres exemplaires : Un dans la collection de l’Administration des Monnaies et Médailles n° 773 de leur
catalogue, lequel provient d’une vente aux enchères Delavenne-Lafarge, expert AlainWeil 17/10/1989, lot 499.
Un autre sans bélière collection JPG, qui ne semble pas être celui reproduit en des-sin par Henri Rolland.
• 2e type (fig. 2)
Un type inédit, dont deux exemplaires viennent de m’être communiqués, estdatable de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle (10):
9. Courrier numismatique d’Henri Rolland, 1925-1926, p. 65. L’auteur datait son exemplaire duXVIIe siècle, mais nous pensons qu’il est plutôt de la deuxième moitié, voire de la fin du XVIIIesiècle.
10. L’un portant le numéro 82, appartient à Monsieur Roland Garrigues, ancien maire deMontauban, l’autre portant le numéro 78, apparttient à Monsieur Michel Ferrier de Montauban.Je les remercie vivement d’avoir bien voulu me permettre de les reproduire ici.
— 164 —
Fig. 2 : droit et revers, diamètre hors bélière : 46 mm
Fig. 3 : droit et revers, largeur maximum 50 mm
de la Charente (16) , nous avions ordonné le classement des mendians : 1° en indigensinfirmes ou hors d’état de travailler; 2° en indigens manquant de travail; 3° enfin, enindigens valides, mais se refusant au travail.
Tous ceux qui, appartenant à la première classe ne pouvaient être admis dans leshospices ou secourus suffisamment à domicile, étaient autorisés, après un examenattentif de leur situation, à recourir à la charité publique dans l’étendue de leur com-mune, porteurs d’une médaille apparente et munis d’un certificat délivré par le sous-préfet. Ceux qui manquaient de travail étaient temporairement, et pendant l’interrup-tion des travaux seulement, recommandés à la charité et autorisés à porter une médailled’indigent. Il fallait une autorisation du sous-préfet pour dépasser les limites de lacommune ou du canton. Quant aux indigens valides et se refusant au travail, ils deve-naient l’objet de la surveillance et des poursuites de la police administrative et judi-ciaire ». Tous les éléments gravés sur les deux médailles en losange, se retrouventdans ce texte et confirment notre datation : le « département du Tarn-et-Garonne », la« commune », le « canton », le mot « indigent » moins frustrant que celui de mendiant,et « recommandé à la charité», ce dernier mot étant traduit par « bienfaisance » sur nosmédailles.
• 5e type (fig. 5) Un autre modèle d’époque Louis-Philippe existe pour Montauban :
Droit : En légende circulaire, BONNE VILLE DE MONTAUBAN., au centre, lesarmes de la ville, surmontée d’une couronne comtale et entourées de deux palmes. Lechef chargé de trois roses remplaçant les lis. Une ordonnance de Louis-Philippe du 16février 1831 supprime la fleur de lis du sceau de l’État, d’où leur remplacement par troisroses sur l’écu de la ville.
Revers : MENDIANT / DE / MONTAUBAN / N.°, aucun numéro n’a été poinçonné.
16. Jean-Paul Alban de Villeneuve Bargemont fut préfet du Tarn-et-Garonne de 1814 à 1817(excepté les Cent-Jours), de la Charente de 1817 à 1820, de la Meurthe de 1820 à 1824, dela Loire-Inférieure de 1824 à 1828, et du Nord de 1828 à 1830.
— 167 —
antiques de la BnF, un modèle de Montauban qui nous a paru inédit ; il est, semble-t-il, en étain, en forme de losange et agrémenté d’une bélière :
Droit : légende extérieure commençant à 9 h, DEPARTEMENT DE-TARN ETGARONNE-CANTON DE- MONTAUBAN, au centre : Lis / COMMUNE- / lis-DE-lis /MONTAUBAN / lis-lis / rose (les deux mentions de Montauban sont poinçonnées encreux).
Revers : Légende extérieure commençant à 9 h, RECOMMANDÉ À LA BIENFAI-SANCE-PUBLIQUE. Entrecoupé de fleurons en forme de double feuille. Au centre : fleu-ron à quatre pétales / INDIGENT / INVALIDE / rose.
Hauteur hors bélière : 63 mm.Hauteur avec bélière : 75 mm.Bredin, manque.Les deux mentions de MONTAUBAN étant poinçonnées en creux après que la
médaille eut été fabriquée nous indique que nous sommes en présence d’une médaillepasse-partout destinée à tout le département de Tarn-et-Garonne.
Cette médaille agrémentée de lis ne peut pas être de l’ancien régime, car elle faitmention du département du Tarn-et-Garonne qui ne fut crée qu’en 1808 (14). Elle estdonc datable de la Restauration, et plus précisément vers 1817. En effet, un ouvrageécrit par le vicomte Jean-Paul Alban de Villeneuve-Bargemont (15), ancien conseillerd’état, préfet du Nord et ancien député, nous en donne la confirmation :
« ...chargé, en 1817, de l’administration du Tarn-et-Garonne et, en 1818 de celle
14. Antérieurement à 1808, Montauban était un chef-lieu de district du département du Lot.15. A. de VILLENEUVE-BARGEMONT, Économie politique chrétienne ou recherche sur la nature
et les causes du paupérisme en France et en Europe et sur les moyens de le soulager et de leprévenir, Paris, 1834, chap. XX, p. 336-337. C’est cette étude très complète qui inspira Alexisde Tocqueville pour son « Mémoire sur le paupérisme », exposé dans les Mémoires de la SociétéRoyale Académique de Cherbourg, 1835, p. 293-344. Société royale académique de Cherbourg,dont il était membre correspondant.
— 166 —
Fig. 4 : droit et revers, hauteur totale 75 mm
Fig. 5 : droit et revers, diamètre hors bélière 45 mm
Revers : en partie identique à celui de Montauban, sauf le centre où est inscrit entrois lignes INDIGENT / SANS / TRAVAIL.
Bredin : manque.Remarque : cet exemplaire nous confirme notre attribution de ce modèle du Tarn-
et-Garonne à l’organisation mise en place par le vicomte Alban de Villeneuve Bargemonten 1817. Le revers mentionne « indigent sans travail », c’est à dire la deuxième caté-gorie citée dans son texte, et autorisée à mendier. Celui de Montauban (fig. 4) portecomme nous l’avons vu la mention « indigent invalide », c’est-à-dire la première caté-gorie citée dans le même texte.
ChronologieNous avons effectué une analyse typologique purement hypothétique des différents
modèles, mais cet ordre pourra, en fonction d’éléments nouveaux, être modifié.
Autres villes de FranceIl existe des médailles pour d’autres villes : Bordeaux (Gironde), Mugron (Landes),
Tarbes (Hautes-Pyrénées), Sète (Hérault), Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, ancienneSeine-et-Oise). Il en existerait du canton de Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres,d’Avignon dans le Vaucluse, de Lodève dans l’Hérault, d’Arbois dans le Jura et de Bar-le-Duc dans la Meuse.
À l’énoncé des nom de communes que nous venons de citer, on remarquera quela majorité sont situées géographiquement dans le moitié sud de la France. Ce n’est pasétonnant car, autrefois, il était plus facile de passer l’hiver à la belle étoile dans le sud,que dans le nord.
Pour mémoireDe 1810 au 1er mars 1994, le vagabondage de clochards, qui n’avaient ni domi-
cile certain (on parle de « SDF » aujourd’hui), ni moyens de subsistance, ni métier habi-tuel, et la « mendicité », la quête ou l’aumône, en vue d’un don charitable étaient desdélits réprimés par les articles 277 à 281 ancien du code pénal.
Depuis le 1er mars 1994 et l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la mendi-cité n’est plus considérée comme un délit, si elle ne présente aucun caractère mena-çant ou violent, d’où la multiplication des faux mendiants. Cependant, elle peut êtreinterdite dans certains lieux par des règlements de police pris par le maire, notammentpour des raisons de sécurité, comme les arrêtés prescrivant le couvre-feu pour lesmineurs. L’actualité de ces arrêtés tend à réapparaître avec l’été, et les villes du sud dela France sont les plus concernées. Ainsi, dans les années récentes, Montpellier, Nice,Sète, Prades, etc. dans le sud, mais aussi Colmar dans l’Est, ont pris de tels arrêtés dontcertains ont été annulés par les juges du tribunal administratif. Ce sont les excès, quiont obligé à différentes époques, les autorités à réglementer la mendicité. Les mêmescauses produisant toujours les mêmes effets, le sujet est loin d’être clos, car il ne fautjamais oublier que l’histoire est un éternel recommencement.
ConclusionLes médailles que nous avons étudiées présentent un intérêt historique indéniable,
surtout quand elles peuvent être replacées dans le contexte des lois ou décrets qui ontmotivé leur attribution. Elles sont aussi la preuve d’une certaine compassion des auto-rités administratives envers le problème que posaient les vrais indigents lorsqu’il fal-lait lutter contre les faux mendiants.
— 169 —
Remarque : Sur ce modèle, le saule étêté a curieusement huit branches latérales aulieu des six traditionnelles.
BnF, 2 exemplaires sans numéro, Z 2158, reg. 98 (échanges) 1934, p. 123, et T 1135.Métal étain (?)Diamètre hors bélière : 45 mm. Bredin p. 97, lequel ne comprenait pas la présence du chef chargé de roses au lieu
de lis. Remarque : Ces deux exemplaires sans numéro d’attribution proviennent certai-
nement d’un reliquat de stock non utilisé. Cependant, un exemplaire attribué avec len° 42, mais sans sa bélière d’origine, vient de m’être signalé (fig. 6).
Pour Auvillars (Tarn-et-Garonne)Nous avons, par bonheur, pu retrouver un exemplaire du type au losange de
Montauban, mais portant le nom de la commune et du canton d’Auvillars. Il estconservé dans le musée de cette ville (fig. 7) :
Droit : identique à celui de Montauban, sauf le nom de la commune et du cantond’Auvillar poinçonnés en creux.
— 168 —
Fig. 6 : droit et revers, diamètre 45 mm
Fig. 7 : droit et revers, hauteur totale 75 mm
archives municipales le 25 septembre 1854, puis archiviste de la ville de Montaubanle 1er juillet 1857.
Enfin, en mars 1862, le poste d’archiviste départemental étant vacant, il se portacandidat bien que ne sortant pas de l’École des chartes. Il fut nommé archiviste dépar-temental par arrêté préfectoral du 29 mars 1862 et installé le 11 avril suivant. Il dut cepen-dant passer un examen relatif à ses compétences à Paris en août 1862, qu’il réussit avecsuccès. Il occupera ce poste jusqu’à son décès, le 2 septembre 1874, à son domicilefaubourg du Moustier (n° 53), après une courte maladie.
Nous savons également que quelques distinctions qui lui furent attribuées. Ainsi,le 16 mai 1844, il reçut un laurier d’argent décerné par la Société archéologique deBéziers. En 1865, lors du Congrès archéologique de France qui se tenait à Montauban,il est récompensé d’une médaille de première classe «pour ses nombreux travaux his-toriques, son judicieux classement des archives». Enfin, en mai 1868, J.-U. Devals estnommé officier d’Académie.
Devals est décrit par l’abbé Pottier (2) comme « doué d’une heureuse mémoire, d’unepatience bénédictine dans ses recherches, passionnément épris de son pays dont il fai-sait revivre le passé par ses écrits ». Pour Georges Passerat (3), « la mort prématuréede l’historien-archéologue du siècle dernier, à l’âge de soixante ans, privait les cerclescultivés de Montauban d’un collaborateur zélé et érudit. Bien entendu son nom restelié à l’Histoire de Montauban (paru en 1855) et aux nombreuses études archéolo-giques publiées dans le Bulletin archéologique ». L’un des membres de la Société, G.Forestié, lui rendit hommage dans l’un des Bulletins en disant que parmi les historiensde Montauban aucun n’avait étudié avec autant de soin et de compétence que Devalsaîné tout ce qui touche à son origine et à son histoire à travers les âges. Il explique qu’ilavait consacré toute sa vie à fouiller les archives de la ville et du département, à lesclasser pour en tirer ensuite les sujets de multiples études d’un intérêt incontestable.
Pour l’anecdote, il faut savoir que peu après son décès, parut une notice nécrolo-gique dans la Revue de Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la causerie hebdomadairesignée J. M.-L (4). Le contenu, très condescendant, et le jugement politique porté surleur père, dit légitimiste et clérical, froissèrent terriblement deux de ses fils qui rédigèrentalors une lettre à l’attention du rédacteur du Courrier de Tarn-et-Garonne, qui la publiadans le numéro du journal du 29 septembre 1874, afin de revenir sur les propos écritspar le pharmacien de Villebourbon, J. Milliès-Lacroix, et le mot d’excuses qu’il leur fitporter après avoir reçu leur visite à son domicile.
La constitution de la collection d’antiquités de Jean-Ursule DevalsJ.-U. Devals s’est intéressé assez tôt à l’archéologie et a procédé à des «fouilles»
dans le département de Tarn-et-Garonne et principalement sur le site de Cosa (Albias).Pour certains, «c’est d’ailleurs à lui que l’antique ville de Cosa devait sa résurrectionscientifique».
Les premières collectes d’objets antiques sur le site de Cosa datent de 1844-1845 ;il raconte qu’en neuf jours, il y a ramassé une trentaine d’objets divers : fibules, mor-
2. F. POTTIER, Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, IV, 1876, p. 8.3. M. MAURIÈRES et G. PASSERAT, 800 auteurs : Dix siècles d’écriture en Tarn-et-Garonne, dic-
tionnaire bio-bibliographique, Montauban, 1992, p. 112.4. J. M.-L. [MILLIÈS-LACROIX], « Causerie », Revue de Tarn-et-Garonne, 1874, p. 309-312
(semaine du 24 septembre 1874).
— 171 —
BERDEAUX-LE BRAZIDEC (Marie-Laure) — La collection numismatique de J.-U.Devals au musée Ingres.
Le musée Ingres conserve une importante série de monnaies romaines recueilliespar le collectionneur Jean-Ursule Devals, qui légua sa collection d’antiquités à la villede Montauban.
Jean-Ursule Devals (1814-1874)En l’absence de notice biographique contemporaine très détaillée de l’archiviste,
archéologue et collectionneur Jean-Ursule Devals, afin de retracer sa vie nous présentonsici les informations trouvées dans différentes sources.
Jean-Ursule Devals, dit Devals aîné, est né à Montauban le 21 octobre 1814. Sonpère, Pierre Devals, occupe alors les fonctions d’employé au bureau des hypothèques.Sa mère, Marie Magdeleine, surnommée Hélène, Monnier, est sans profession.
De ses années de jeunesse, nous ne savons que peu de choses ; l’élément le plusimportant à retenir est qu’il fut reçu bachelier en lettres à la faculté de Toulouse le 30août 1831 (1). Il semble ensuite s’être adonné assez tôt aux études historiques etarchéologiques, sa première publication datant de 1840, d’après la liste qu’il a lui-mêmeétablie. Il s’en suivit sans doute une certaine reconnaissance car il fut alors élu dès juin1841 membre correspondant de l’Institut historique. Puis le 6 juin 1845, il est nommécorrespondant du Ministère de l’Instruction publique pour les Travaux historiques.Dans ce cadre, il participera plus tard à la Commission de la Topographie des Gaules,créée en 1858, et à ce titre transmit de nombreuses informations relatives au Tarn-et-Garonne à son président et à son secrétaire.
Sur le plan local, il est élu le 4 janvier 1847 membre de la Société des Sciences,agriculture et Belles-Lettres de Tarn-et-Garonne, dont il sera archiviste-adjoint etmembre du bureau en 1865. Il appartenait également à la Commission du muséearchéologique départemental avec Prosper Débia, l’abbé Marcellin et l’architectedépartemental Olivier. Enfin, il sera à l’origine de la création de la Société archéolo-gique de Tarn-et-Garonne, dont il est un des 25 membres fondateurs en novembre 1866.
Dans le cadre régional, il est élu membre correspondant de la Société archéolo-gique du Midi de la France le 8 avril 1857 et membre correspondant de l’Académiedes Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, le 11 juillet 1861. Enfin, dansle cadre national, il est nommé membre de la Société française d’archéologie le 10 juin1863.
Entre temps, il s’est marié le 23 octobre 1843, à 29 ans, à Montauban avec JeanneJoséphine Marie Forestié, fille de l’imprimeur Antoine Forestié, domicilié place Royale.Ils auront au moins trois fils : Pierre Louis Théodard Henri, né le 21 janvier 1845,Félix Antoine Abdon, le 30 juillet 1848, et Henri Charles Justin Richard, le 3 avril1852.
Cette même année 1852, on découvre dans les combles de l’Hôtel de ville deMontauban les archives de la commune et de la généralité de Montauban. Dans descirconstances qui ne sont pas connues précisément mais très probablement en lien avecles études précédemment menées par Devals, on lui confie alors le classement de cesarchives le 29 juin 1852. À la suite de quoi, il sera nommé conservateur honoraire des
1. Arch. dép. Tarn-et-Garonne, dossier du personnel des Archives départementales, dossierDevals, 124 T 1 : lettre du 21 mars 1862 au préfet récapitulant ses charges et nominationsainsi que ses publications scientifiques.
— 170 —
(p. 39), qui n’apparaît pas dans cette liste, preuve qu’il s’en était également défaitavant 1857.
Sa collection de monnaies ne comprend que des monnaies romaines impériales etquelques républicaines : il ne s’y trouve pas notamment de monnaies gauloises, ni demonnaies ibériques qui devaient se trouver en nombre relativement important, surtoutpour les premières. Il écrivait d’ailleurs en 1865 que «il ne s’y donne pas [à Cosa] unseul coup de pioche (…) sans ramener à la surface des monnaies ibériennes, gauloiseset romaines (…)» (11). Il connaissait bien ces différentes monnaies, puisqu’il en signalela découverte aux commissions parisiennes et notamment à la Commission de laTopographie des Gaules, mais il n’y a apparemment pas porté son attention : soit il nes’est pas intéressé du tout à ces monnaies et ne les a pas inclus dans sa collection, soitil ne les a pas conservées dans ses séries (vente, dons à d’autres,…). Les lettres adres-sées à A. de Barthélemy montrent en tout état de cause qu’il était au courant desdécouvertes de monnaies gauloises de Cosa et qu’il connaissait les collectionneurs pos-sédant des monnaies de cette période.
Le legs à la ville de Montauban pour le musée IngresAprès avoir certainement eu l’intention de vendre sa collection vers 1857, ce qui
le conduisit à en dresser un inventaire , Jean-Ursule Devals la léguait par testament àla ville de Montauban, sous réserve d’une somme compensatoire de 3 000 francs des-tinée à ses héritiers. On notera que, contrairement à ce qui a pu être écrit antérieure-ment, ces 3 000 francs ne représentent pas la valeur marchande de l’ensemble de lacollection, mais les « débours » de Devals à son sujet, comme il le stipule dans sontestament, c’est-à-dire les dépenses engagées pour sa constitution.
La municipalité mit quelques temps a accepté ce legs et la dépense qui lui était liée,d’une part parce que le maire avait une nouvelle fois changé entre temps et qu’elle pritle temps de faire expertiser la collection par une personne compétente extérieure à laville et au département, et choisit pour ce faire Adolphe Magen, secrétaire perpétuelde la Société académique d’Agen. L’abbé Pottier, président de la Société archéolo-gique de Tarn-et-Garonne, semblait tout désigné pour accomplir cette tâche, maisayant été l’ami de Devals, « il crut, par une extrême délicatesse, devoir refuser » (13).Après une visite sur place, A. Magen remit son rapport, favorable, le 21 novembre 1874.Enfin, en décembre 1874, la municipalité accepta le legs contre la somme de 3 000francs payable en trois anuités.
État de la collection en septembre 1874A. Mangen (1818-1893), inspecteur des pharmacies du Lot-et-Garonne, secrétaire
perpétuel de la Société académique d’Agen, et plus tard directeur de la Revue del’Agenais, fut donc chargé d’expertiser la collection Devals. Il envoya un rapport datédu 21 novembre 1874 au maire et au Conseil municipal. Celui-ci accordait une men-tion favorable à la collection Devals, notamment pour sa provenance locale et son authen-ticité (14) : « c’est presque dire qu’un modeste choix d’objets d’authenticité non dou-teuse et de conservation suffisante possède une valeur vénale qui n’est nullement en
11. J.-U. DEVALS, « Invasions barbares », Congrès archéologique de France, XXXIIe session,séances générales tenues à Montauban, Cahors et Guéret en 1865, Paris, 1866, p. 87.
12. J.-M. GARRIC, loc. cit., 1990, p. 71 et n. 32 p. 72.13. G. THOLIN, loc. cit., 1875, p. 350.14. G. THOLIN, loc. cit., 1875, p. 351.
— 173 —
tiers, poids de tisserands, morceaux de bronze, fragments sculptés, lampes, deux sta-tuettes de bronze dont une jolie tête d’Amour joufflu et 17 monnaies de bronze (5). C’estainsi qu’il commença la constitution de sa collection. Il acheta également un bonnombre d’objets, au moins jusqu’en 1865.
En mai 1862, la collection Devals, ou une partie importante de celle-ci soit 134 numé-ros totalisant 512 objets, fut présentée à l’exposition des Beaux-Arts et des produits del’Industrie de Tarn-et-Garonne (6), à Montauban.
La collection de J.-U. Devals est souvent décrite de provenance départementale,comme le signale entre autres J. Milliès-Lacroix : « Sa collection de médailles, bijoux,ustensiles, spécimens de céramiques antiques, etc., est d’une valeur réelle, non seu-lement au point de vue intrinsèque, mais parce que la plupart des objets qui en fontpartie ont été trouvés dans des fouilles pratiquées par lui dans le département, princi-palement à Cos, cette riche cité gallo-romaine enfouie dans les profondeurs du limonde l’Aveyron ». G. Tholin (7) indique que Devals « avait formé une collection d’objetsantiques recueillis dans la région et le plus souvent par lui-même, c’est-à-dire dans lesplus parfaites conditions d’authenticité». Le rapport d’A. Magen (8) précise que le sitede Cosa « en aurait, à lui seul, fourni plus de la moitié ».
La collection de monnaies romaines de Jean-Ursule DevalsJ.-U. Devals décrit plusieurs monnaies, qualifiées de rares, dans une de ses premières
publications sur Cosa (9), datée du 15 décembre 1845. Il indique bien qu’il s’agit « desmonnaies les plus rares que j’ai recueillies, jusqu’à présent, sur le territoire de Cos ».Les monnaies, uniquement romaines, sont ensuite présentées par catégories : grandbronze (7 ex.) ; moyen bronze (5 ex.) ; petit bronze (10 ex.) ; argent (14 ex.) ; or (1 ex.).
Il s’agit vraisemblablement du premier noyau de sa collection numismatique. Nousen avons retrouvé certaines dans la collection actuellement conservée, ce qui pourraitindiquer qu’il en a vendu (ou distribué ?) une partie avant 1874.
En décembre 1857, Devals décrit sa collection de monnaies, au nombre de 553,de la façon suivante (10) : 232 petits bronzes, à fleur de coin et d’une très belle patine,49 têtes d’empereurs ou impératrices ; 123 moyens bronzes, 46 têtes d’empereurs oud’impératrices ; 81 grands bronzes, 37 têtes d’empereurs ou d’impératrices ; 116 mon-naies d’argent et de billon, 71 têtes d’empereurs et d’impératrices ; 2 quinaires d’or,de Zénon et d’Anastase, barré et remplacé par 1 quinaire d’or d’Anastase.
Cette dernière mention laisserait supposer qu’entre le moment où il commença soninventaire et qu’il le retoucha, il vendit le quinaire de Zénon. En 1845, il avait d’ailleurspublié comme faisant partie des monnaies recueillies à Cosa un aureus de Néron
5. J.-M. GARRIC, « La collection archéologique du musée Ingres », Bulletin du Musée Ingres,61-62, 1990, p. 71.
6. Exposition des Beaux-Arts, des produits de l’industrie de Tarn-et-Garonne, mai 1862,Montauban, 1862, p. 67-77, n° 251 à 384.
7. G. THOLIN, « Le musée de Montauban et la collection Devals », Revue de l’Agenais, 2, 1875,p. 349.
8. Ibid., p. 351.9. J.-U. DEVALS, « Rapport adressé à Son Excellence M. le Ministre de l’Instruction publique
sur les antiquités de Cosa », Bulletin archéologique du Comité historique des Arts et Monuments,III, 1844-1845, p. 492-494.
10. Inventaire manuscrit conservé aux Archives départementales, Ms 25, intitulé « Catalogue dela collection d’objets gallo-romains appartenant à M. Devals aîné, de Montauban, dressé le5 décembre 1857 ».
— 172 —
tion Devals est bien signalée comme exposée dans le musée Cambon dans les Annuairesde Tarn-et-Garonne à partir de 1894 (p. 196) ; cette mention demeure jusqu’en 1939.
En 1953, D. Ternois trouve les monnaies dans le soubassement de la vitrine Devalsqui était « fermé à clef et qu’il a fallu démonter, la clef étant introuvable » (18). Ils’agit alors de « deux plateaux portant environ 700 pièces de monnaie antique ». Il estfort probable que le long maintien de ces monnaies dans une partie inaccessible dela vitrine soit l’explication de la conservation en intégralité et sans mélange de cettecollection, une chance…
En 1962, les monnaies sont confiées pour identification à M. Labrousse, à Toulouse,qui réalise le travail avec une de ces étudiantes, Mademoiselle Justau (19). Elles revien-nent au musée, à une date indéterminée, rangées dans des petites enveloppes portantdescriptions et identifications, réunies dans une boîte en carton.
En 2007, l’informatisation de la collection numismatique commence par cettesérie en raison des informations figurant sur les enveloppes.
La collection aujourd’hui (2010)Il est généralement admis que les achats de Devals pour former sa collection pro-
viennent en grande majorité de Cosa et de quelques autres sites départementaux desenvirons.
Il y en existe plusieurs mentions. Nous en noterons une plus particulièrement,émanant du baron Chaudruc de Crazannes, qui s’est aussi intéressé aux « fouilles » etaux antiquités de Cosa, comme inspecteur des Monuments historiques. Dans un articlepublié en 1857 (20), il indique qu’il a l’intention de publier dans un prochain volumede la Revue archéologique divers objets découverts à Cosa, dont des « médailles his-paniques ou ibériennes, puniques, gauloises, romaines, consulaires et impériales, duHaut et du Bas-Empire ». Il précise également que « plusieurs de ces objets ont été ache-tés par M. Devals aîné, membre correspondant du Comité pour la langue, l’histoire etdes arts de la France, à Montauban », bien que lui-même ait préféré les voir dans lemusée départemental ou dans un local dépendant de la bibliothèque d’Albias.
En décembre 1857, dans le brouillon de lettre que Devals écrit dans le but d’es-sayer de vendre sa collection, il indique qu’il est « parvenu à réunir une assez remar-quable collection d’objets gallo-romains », ce qui implique effectivement qu’il a faitdes choix et que particulièrement dans le domaine numismatique, il s’est concentrésur les monnaies romaines, revendant très certaines les gauloises et ibériques qu’ilavait pu trouver ou acheter précédemment. Le meilleur exemple qu’il en soit est l’ab-sence dans sa collection de monnaies de l’exemplaire gaulois en bronze au nom deLuctérius, qu’il avait trouvé à Cosa le 10 mai 1845 et publié par la suite.
A. Mangen nous donne à ce sujet quelques précisions (21), lorsqu’il réalise l’ex-pertise de la collection pour la municipalité, fin 1874 : «Il n’est pas douteux que M.
18. D. TERNOIS, « Musée Ingres. Archéologie, Liste sommaire des collections, État dans lequelje les ai trouvées, janvier 1953 », document tapuscrit dans le dossier Collections archéolo-giques du musée, sous-dossier Historique du musée archéologique et de ses collections.
19. Lettre de M. Labrousse du 21 mars 1962 dans le dossier Numismatique du musée. MademoiselleJustau est la future Madame Labrousse.
20. Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES, « Antiquités inédites récemment découvertes à lamansio et au castrum de Cosa (Tarn-et-Garonne) », Revue archéologique, 1ère série, 13,1856-1857, 2, p.
21. G. THOLIN, loc. cit., 1875, p. 352.
— 175 —
rapport avec son peu d’importance numérique et les humbles proportions du meublequi la contient». Ainsi, s’il semblait la considérer comme modeste, il lui accordaittoutefois une valeur importante par sa qualité.
Ce rapport totalise alors 1250 objets, répartis ainsi (dans l’ordre de la publication,p. 352) : monnaies ou médailles : 509 ; bronzes : 305 ; objets d’art en pierre grès, marbre: 12 ; onyx, cornaline, émeraude : 9 ; silex taillés (époque préhistorique) : 20 ; verreblanc ou bleu, poteries : 69 ; or, 4 ; argent, 4 : 8 ; fer : 28 ; os ivoire : 15 ; objets diversnon classés, environ : 200.
Les monnaies représentent donc la part numérique la plus importante de la collectiondevant les objets en bronze. A. Magen décrit ainsi la série de monnaies (p. 352) : 127en argent ; 81 en grand bronze ; 129 en moyen bronze ; 172 en petit bronze. On noted’emblée qu’il n’y a plus de monnaies d’or : le « quinaire » d’or d’Anastase, qui appa-raissait encore dans l’inventaire de 1857, aura donc été vendu entre temps. A. Magenprécise encore que « l’entière série des empereurs romains s’y déroule de Tibère àRomulus Augustule, du Ier siècle au Ve. Sans parler des pièces d’argent, qui résistentdans les circonstances ordinaires aux agents naturels d’oxydation, la plupart des autressont remarquables par leur conservation et l’éclat de leur patine ».
Les éléments fournis par Magen au sujet de la composition des séries monétairesde Devals nous semblent très imprécis et ne semblent pas correspondre pour ce quiest des limites chronologiques. Tout d’abord parce qu’il semble omettre les exem-plaires républicains, les bronzes coloniaux ainsi que les exemplaires d’Auguste, lepremier empereur, qu’il serait difficile de ne pas voir représenté dans ces séries. Nouspensons d’ailleurs, qu’en raison du nombre de monnaies annoncé, inférieur à celui desmonnaies présentes (581), A. Magen a dû oublier de comptabiliser les premières mon-naies de cet ensemble. Ensuite, parce qu’il est très rare de voir dans les collections desmonnaies du Ve siècle et qu’il doit s’agir d’une erreur d’un siècle, les séries de bronzeset d’argent s’arrêtant souvent sous les empereurs théodosiens.
Si l’on compare cet état des lieux à l’inventaire de décembre 1857, on constate qu’unseul nombre est identique, celui des grands bronzes, resté à 81 exemplaires ; les autressont un peu plus élevés en dehors de la catégorie des petits bronzes qui voit chuter sesexemplaires de 232 à 172, soit 60 exemplaires de moins ; ce qui explique aussi le défi-cit par rapport au total de 553 monnaies annoncé en 1857.
Nous avons cependant tout lieu de penser que ces soixante exemplaires, ainsi queceux d’époque républicaine et augustéenne, ont été oublié du rapport d’A. Magen, soitpar omission simple, soit parce qu’ils ne se trouvaient pas avec les autres au momentde sa visite. Toujours est-il que ces monnaies figurent dans la collection aujourd’hui.
Conservation et étude des monnaies romaines de 1874 à 2007À son arrivée au musée et jusqu’en 1877, la collection Devals fut exposée dans la
première salle du musée de peinture (15). En 1877, elle fut présentée à l’exposition desBeaux-Arts (16), placée dans sa vitrine d’origine, et rejoignit alors le premier sous-sol.
Dans les années 1920, la vitrine Devals est dans le musée des Arts décoratifs, dansla première salle du sous-sol (17). Cet emplacement datait sans doute de l’établisse-ment du musée des Arts décoratifs par A. Cambon, avant 1885. D’ailleurs, la collec-
15. J.-M. GARRIC, loc. cit., 1990, p. 71.16. Catalogue de l’exposition des Beaux-Arts, mai 1877, Montauban, 1877, p. 46.17. F. BOUISSET, Le musée Ingres, 1926, p. 61.
— 174 —
plaires dans la collection conservée au musée Ingres ; en voici quelques exemples.• grand bronze de Jules César à la proue de navire (p. 35) = dupondius MI 2007.0.15
et 16 ;• grand bronze de Néron au revers de Cérès (p. 492) = sesterce MI 2007.0.54 ;• grand bronze d’Aelius (p. 492) = sesterce MI.2007.0.112 ;• grand bronze de Marc Aurèle (p. 492) = sesterce MI 2007.0.130 ;• grand bronze de Faustine jeune (p. 492) = sesterce MI 2007.0.140 ;• grand bronze de Lucius Verus divinisé (p. 493) = sesterce MI 207.0.146 ;• grand bronze de Commode (p. 36) = sesterce MI 2007.0.15 ? ;• grand bronze de Julia Domna (p. 39) = sesterce MI 2007.0.161 ;• grand bronze d’Otacilie Severa (p. 493) = sesterce MI 2007.0.197 et 198 ;• grand bronze de Trajan Dèce (p. 36) = sesterce MI 2007.0.202 ;• grand bronze d’Herennius Etruscus (p. 36) = sesterce MI 2007.0.204 ;• moyen bronze de Néron (p. 493) = as MI 2007.0.58 ;• moyen bronze de Julie (p. 37) = as MI 2007.0.75 ;• moyen bronze de Commode (p. 493) = dupondius MI 2007.0.156 ;• petit bronze de Tibère (p. 493) = semis MI 2007.0.34 et 35 ;• petit bronze de Quintille (p. 493) = antoninien MI 2007.0.265 ou 266 ;• petit bronze d’Aurélien (p. 493) = antoninien MI 2007.0.341 ;• petit bronze de Florien (p. 38) = aurelianus MI 2007.0.346 ? ;• petit bronze de Numérien (p. 38) = aurelianus MI 2007.0.356 ;• petit bronze d’Hélène (p. 493) = nummus MI 2007.0.380 ;• petit bronze de Maxime (p. 493) = bronze MI 2007.0.571 ;• argent Julie Maesa (p. 494) = denier de Julia Domna MI 2007.0.160 (manquante) ;• argent Julia Mamée (p. 494) = denier MI 2007.0.175 ;• argent Gordien III (p. 494 ) = antoninien MI 2007.0.184 ;• argent Philippe (p. 494) = antoninien MI 2007.0.192 ;• argent Gallus (p. 494) = antoninien MI 2007.0.205 ;• argent Volusien (p. 494) = probablement MI 2007.0.207 (manquante) ;• argent Gallien (p. 494) = antoninien MI 2007.0.212 ;• argent, quinaire, Arcade (p. 494) = silique MI 2007.0.573.Toutes les monnaies décrites par Devals en 1845 n’ont pas été retrouvées dans sa
collection, mais pour celles qui ont pu être identifiées avec certitude, nous pouvonsavoir la satisfaction de signaler ainsi d’anciennes découvertes encore conservées.
Notons toutefois pour finir que la collection Devals présente plusieurs monnaiesmanquantes, soit du fait de l’absence de certaines enveloppes numérotées, soit del’absence de la monnaie dans l’enveloppe, parfois remplacée par un autre exemplaire.Ces exemplaires manquants sont au nombre de douze. Ils ont pu faire l’objet de vols,comme d’autres monnaies des collections.
Nous retiendrons tout particulièrement de la collection numismatique de J.-U.Devals conservée au musée Ingres qu’elle est presque intégralement conservée depuisson arrivée en 1874, qu’elle a été constituée patiemment dans le but de former unensemble assez complet, notamment pour la représentation des différentes espèces duHaut-Empire, et qu’elle offre une part majoritaire de provenances locales, principale-ment du site de Cosa.
Composition actuelle de la collection de monnaies DevalsLes numéros entre parenthèses après chaque exemplaire renvoient à la terminai-
son du numéro d’inventaire MI 2007.0.X :
— 177 —
Devals n’ait fait un choix parmi les pièces nombreuses qui lui venaient de ses amis ouqu’il achetait des paysans dont la charrue les avait mises au jour ». Le fait que certainesdes monnaies de sa collection puissent venir par le biais d’amis de Devals ne garantitdonc pas toujours une provenance de Cosa ou locale. C’est là un élément à prendreen compte. Mais sans liste, même sommaire, des monnaies de la collection avec uneindication d’origine, il est très difficile de faire la part des choses. Seule une petite par-tie des monnaies peut vraiment être identifiée comme provenant de Cosa, grâce à unede ses premières publications.
De toutes les façons, la collection de monnaies de J.-U. Devals ne peut représen-ter qu’un échantillon des découvertes monétaires de Cosa, après un tri préalable : toutd’abord parce que cette collection ne contient que des monnaies romaines et parailleurs en comparaison du nombre très élevé avancé par le baron Chaudruc deCrazannes pour l’ensemble des découvertes du site (22) qui est estimé à 14 000 ! Pourdes raisons qui seront développées ultérieurement, ce nombre est tout à fait recevable.
La collection Devals offre aujourd’hui 581 monnaies romaines, de la Républiqueet de l’Empire, apparemment issues d’un assemblage d’exemplaires formant des sériespar empereur et impératrices : ainsi pour l’Empire on remarque une représentation desmonnaies depuis Auguste, avec la présence pour les empereurs du Haut-Empire d’uneou deux monnaies en argent (deniers puis antoniniens), suivie de monnaies de bronzede tous les modules (sesterces, dupondii, as, semis et quadrans le cas échéant) ; la raretéde certains exemplaires (quadrans notamment) exclut qu’ils aient pu être tous trouvéslors de fouilles, ce qui se vérifie par l’état de conservation, le plus souvent très bon.
À partir de Gordien III, les antoniniens et les grands bronzes semblent provenir, pourl’essentiel, de deux ou trois trésors, les exemplaires présentant des traces d’oxydationde contact sur leur face. Certains des bronzes de la période antonine présentent éga-lement cette caractéristique et pourraient provenir également de trésor ; ce qui n’ex-clut pas qu’ils aient été achetés chez des marchands, plutôt que de venir de découverteslocales ; cependant toutes les hypothèses sont envisageables. Il faudrait connaître defaçon plus approfondie la constitution de la collection Devals et l’ensemble de ses fouillespour pouvoir trancher. L’élément le plus surprenant sans doute, posant particulièrementla question d’une provenance locale ou régionale, est la présence d’un aurelianus deCarausius, issu de l’atelier continental localisé probablement à Rouen : si cette rare mon-naie était bien attestée comme découverte locale, elle serait ainsi la découverte laplus méridionale connue à ce jour du monnayage de l’usurpateur breton. Mais nousn’en avons pas la preuve formelle.
Toutefois, certaines des monnaies présentes proviennent bien de Cosa, comme laliste, classée par modules et matière publiée par Devals en 1845 permet de l’établir(23). Or nous avons retrouvé, d’après les descriptions fournies, plusieurs de ces exem-
22. Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES, « Antiquités de Cosa », Revue archéologique, 1ère série,16, 1859-1860, 2, p. 499.
23. J.-U. DEVALS, « Rapport adressé à Son Excellence M. le Ministre de l’Instruction publiquesur les antiquités de Cosa », Bulletin archéologique du Comité historique des Arts et Monuments,III, 1844-1845, p. 487-496. Devals a semble-t-il fait réimprimer cette notice en tirage à parten 1845 par l’imprimerie Forestié de Montauban, sous le titre Mémoire sur la direction, à tra-vers le territoire de Montauban, de la voie romaine de Toulouse à Cahors, et rapport adresséà... M. le Ministre de l’instruction publique sur les Antiquités de Cos, en y apportant quelquesmodifications et la liste des monnaies y est notamment bien plus complète ; nous en men-tionnerons la pagination quand d’autres informations sont apportées.
— 176 —
• Gordien III : 6 antoniniens (182 à 187), 4 sesterces (188 à 191).• Philippe I : 2 antoniniens (192 et 193), 2 sesterces (194 et 195).• Otacilie : 1 antoninien (196), 2 sesterces (197 et 198).• Philippe II : 1 antoninien (199).• Trajan Dèce : 2 antoniniens (200 et 201), 1 sesterce (202).• Étruscille : 1 antoninien (203).• Herennius Etruscus : 1 sesterce (204).• Trébonien Galle : 2 antoniniens (205 et 206).• Valérien I : 3 antoniniens (208 à 210).• Gallien : 3 antoniniens du règne joint (211 à 213), 22 antoniniens du règne seul
(214 à 235).• Salonine : 4 antoniniens (236 à 239).• Valérien II : 4 antoniniens (240 à 243).• Claude II : 15 antoniniens (244 à 258), 1 imitation (259).• Divo Claudio : 3 antoniniens (260, 262 et 263), 1 imitations (261, 264).• Quintille : 2 antoniniens (265 et 266).• Postume : 6 antoniniens (267 à 272).• Marius : 1 antoninien (273).• Victorin : 11 antoniniens (274 à 284).• Tétricus I : 8 antoniniens (286, 289, 293, 295, 307, 308, 309, 310), 24 imitations
(285, 287, 288, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,306, 311, 312, 313, 314, 315, 316).
• Tétricus II : 4 antoniniens (326, 328, 329, 336), 17 imitations (317 à 325, 327,330 à 335, 337).
• Aurélien : 6 antoniniens (338 à 343), 1 aurelianus (344).• Tacite : 1 aurelianus (345).• Florien : 2 aureliani (346 et 347).• Probus : 7 aureliani (348 à 354).• Carus : 1 aurelianus (355).• Numérien : 2 aureliani (356 et 357).• Carin : 3 aureliani (358 à 360).• Dioclétien : 4 aureliani (361 à 364), 2 nummi (365 et 366).• Maximien Hercule : 4 aureliani (367 à 370), 5 nummi (371 à 375).• Carausius : 1 aurelianus (376).• Constance Chlore : 2 nummi (377 et 378), 1 Divo (379).• Hélène : 4 nummi (380 à 383).• Théodora : 2 nummus (384 et 385).• Galère : 4 nummi (386 à 389).• Sévère : 1 nummus (390).• Maximin II : 2 nummi (391 et 392).• Maxence : 2 nummi (393 et 394).• Licinius I : 2 nummi (396 et 397).• Constantin I : 48 nummi (398 à 445).• Période constantinienne : 1 nummus (446).• Constantin I divnisé : 2 nummi (447 et 448).• Constantinopolis : 11 nummi (449 à 459).• Urbs Roma : 5 nummi (460, 462 à 465), 1 imitation (466).• Fausta : 1 nummus (467).• Crispus : 11 nummi (468 à 478).
— 179 —
• République : 1 quinaire de L. Calpurnius Piso Frugi (1), 1 quinaire de L. RubriusDossenus (2), 1 denier de P. Crepusius (3), 1 as républicain (4), 1 quinaire indéterminé(5) ; 1 quinaire de Marc Antoine frappé à Lyon (8), 2 deniers de Marc Antoine frappéà Éphèse (9 et 10), 1 denier d’Octave (11).
• Bronzes coloniaux : 1 as d’Ampurias (6), 1 dupondius de Vienne (7), 2 dupon-dii de Narbonne (15 et 16), 1 as de Turasio (23), 2 as de Nîmes (30 et 31).
• Auguste : 1 denier (12), 1 as des monétaires (13), 1 as de Rome (14), 3 as de Lyon(17 à 19), 3 semis de Lyon (20 à 22), 2 as pour Tibère (32 et 33), 2 semis pour Tibère(34 et 35).
• Tibère : 3 as pour Auguste (24 à 26), 2 as de Rome (36 à 37), 1 as d’Osca (38),1 as de Sagonte (39).
• Caligula : 1 as (40), 2 as pour Germanicus (41 et 42), 3 as pour Agrippa (27 à29).
• Claude I : 1 sesterce (44), 1 dupondius (45), 4 as (46 à 49), 2 quadrans (50 et 51).• Néron : 1 denier (53), 2 sesterces (54 et 55), 4 as (56 à 59), 1 semis (60).• Galba : 1 as (61).• Vitellius : 1 denier (63).• Vespasien : 2 as (64 et 66), 2 dupondii (65 et 67), 1 sesterce (68).• Titus : 1 as sous Vespasien (69), 2 as (70 et 74), 2 deniers (71 et 72), 1 sesterce
(73).• Julie, fille de Titus : dupondius (75).• Domitien : 2 deniers (76 et 77), 4 sesterces (78 à 81), 4 as (82 à 85).• Nerva : 1 sesterce (87), 2 as (88 et 89).• Trajan : 5 dupondii (91 à 95), 2 as (96 et 97), 1 quadrans (98).• Hadrien : 1 denier (99), 5 sesterces (100 à 104), 1 dupondius (105), 5 as (106 à
110).• Sabine : 1 as (111).• Aelius : 1 sesterce (112), 1 as (113).• Antonin : 4 sesterces (114 à 117), 1 dupondius (119), 3 as (120 à 122), 1 sesterce
pour Marc Aurèle (126), 1 sesterce pour Faustine II (138).• Faustine I : 2 as (123 et 124).• Marc Aurèle : 1 sesterce pour Antonin divinisé (118), 1 denier (127), 5 sesterces
(128 à 132), 4 dupondii (134 à 137).• Faustine II : 2 sesterces (139 et 140), 4 as (141 à 144).• Lucius Verus : 2 sesterces (145 et 146), 2 as (147 et 148).• Lucille : 3 sesterces (149 à 151).• Commode : 1 sesterce pour Marc Aurèle (133), 3 sesterces (152 à 154), 2 dupon-
dii (155 et 156).• Crispine : 1 sesterce (157).• Septime Sévère : 1 sesterce (159).• Julia Domna : 1 sesterce (161).• Caracalla : 1 denier sous Septime Sévère (162).• Plautille : 1 as (163).• Géta : 2 deniers sous Septime Sévère (164 et 165).• Élagabale : 2 deniers (166 et 167).• Sévère Alexandre : 2 deniers (168 et 169), 4 sesterces (170 à 173), 1 as (174).• Julia Mamaea : 1 denier (175), 1 sesterce (176).• Maximin : 1 denier (177), 3 sesterces (178 à 180).• Maxime : 1 sesterce (181).
— 178 —
namienne et les pratiques de magie conjuratoire, ce qui est étroitement lié à la numis-matique, nous y reviendrons. C’est bien évidemment durant ces mêmes décennies deséjour en Annam qu’il avait constitué sa collection de monnaies, objet de cette com-munication. Il avait quitté l’armée en 1925, mais était demeuré six autres années enIndochine, période durant laquelle lui avait été confiée, en tant que membre corres-pondant de l’École Française d’Extrême-Orient, la conservation du Musée d’art chamde Tourane. C’est à l’issue de ce séjour, qu’il s’était installé à Toulouse et était devenuconservateur du Musée Georges-Labit (qui comprend d’ailleurs un fonds non négligeabled’art cham).
Une collection coloniale classiqueD’un certain point de vue, sa collection numismatique, toujours conservée dans
sa famille, est tout à fait caractéristique des collections constituées en Indochine à lapériode coloniale.
Elle n’est plus tout à fait complète car le Dr Sallet, dès avant 1925, avait fait donde certaines de ses monnaies au Musée Kha?i-–Di.nh (2), fondé dans le palais impérialde Huê en 1923, et après son décès, d’autres monnaies furent prelevées par sa famille.Dans son état actuel, elle compte environ 5 800 pièces : près de 4 700 sont chinoiseset environ 1 100 vietnamiennes. Cela ne résulte pas des choix du collectionneur, maisplutôt de la composition de la masse monétaire dans le Vietnam ancien où les mon-naies chinoises ont toujours été beaucoup plus nombreuses que les monnaies vietna-miennes proprement dites. Par ailleurs, cette collection est essentiellement le fruit detrouvailles locales et non d’achats dans le commerce. Le Dr Sallet était très proche del’équipe de la revue Les Amis du Vieux Hué, dont il fut un des fondateurs et des ani-mateurs, très proche aussi de l’École Française d’Extrême-Orient dont il fut, on l’a rap-pelé, membre correspondant : cela le mettait tout naturellement en relations directesavec les trouvailles qui étaient faites à l’occasion des fouilles archéologique et desgrands travaux. C’est dire que la plupart des monnaies qui composent cette collectionont circulé au Vietnam, qu’elles soient chinoises ou vietnamiennes. Toutefois, il semblequ’une partie de celle-ci provenait d’une autre collection, fort connue dans le petit milieudes numismates d’Indochine au début du XXe siècle, celle de Louis Marty, commis puisadministrateur des Services civils au Tonkin, qui avait d’ailleurs été détaché à l’EFEOen 1912 (3). Mais la collection Marty avait probablement été constituée de la mêmefaçon que celle du Dr Sallet, à partir de trouvailles locales.
Pour ce qui est de la partie chinoise, toutes les périodes sont représentées, mais lesmonnaies les plus anciennes – on en a trace par les archives qui ont été conservées paral-lèlement à la collection – ont été dispersées. Il s’agissait de « monnaies-bêches » et de« monnaies-couteaux » de la période des « Royaumes combattants » (IV-IIIes siècles),dont il ne subsiste plus que quelques schémas. En revanche, la collection, telle qu’ellenous est parvenue, compte encore quelques très anciennes pièces comme les banliang[1] (période des Royaumes combattants et Han de l’Ouest, IVe s. av J.C.- 8 ap. J.-C.),les huoquan [2] et daquan wushi [3] (période des réformes de Wang Mang, 7-25 ap.
2. Lettre du P. Maximilien de Pirey, 28 juillet 1925. Fonds Sallet.3. Cf. lettre du P. Maximilien de Pirey, 24 février 1926, Fonds Sallet : « On m’a encore signalé
la collection Marty qui serait en la possession de Mr Salet à Haïphong ». Cf. également la lettred’A. Salles au P. Maximilien de Pirey, 30 sept. 1919, Bulletin des Amis du Vieux Huê, 1920,p. 459-460 : « La collection Marty qui est, paraît-il, fort importante … ». Concernant le déta-chement de Louis Marty à l’EFEO, cf. BEFEO, 1912, p. 218.
— 181 —
• Constantin II : 16 nummi césar (479 à 494), 1 nummus auguste (495).• Constant : 3 nummi césar (496 à 498), 5 nummi auguste (499 à 502, 504), 3 demi-
maiorinae (505 à 507), 3 maiorinae (508 à 510).• Constance II : 13 nummi césar (503, 511 à 521, 523), 11 nummi auguste (522,
524 à 533), 1 demi-maiorina (534), 8 maiorinae (535 à 542).• Magnence : 8 maiorinae (543 à 549, 551).• Décence : 4 maiorinae (550, 552 à 554).• Julien : 1 imitation de silique (555), 2 bronzes (556 et 557).• Valentinien I : 2 bronzes (558 et 559).• Valens : 3 bronzes (560 à 562).• Gratien : 3 bronzes (563 à 565).• Valentinien II : 2 bronzes (566 et 567).• Théodose : 2 bronzes (568 et 569).• Maxime : 1 silique (570), 1 bronze (571).• Arcadius : 1 silique (573), 2 bronzes (574 et 575).• Théodose II : 1 bronze (576).• Indéterminé : 1 antoninien illisible (578.2).Hors classement identique :• Commode : 1 as (579).• Tranquilline : 1 bronze provincial (580).
1. Nous remercions bien vivement les héritiers du Dr Sallet qui nous ont aimablement ouvertcette collection et le fonds qui l’accompagne. Les chiffres entre crochets renvoient à la tabledes caractères chinois, en fin d’article.
— 180 —
JOYAUX (François) — Entre numismatique, médecine et magie. La collection demonnaies sino-vietnamiennes d’un érudit toulousain : le Dr Albert Sallet (1).
C’est en 1931 que le Dr. Albert Sallet s’installe à Toulouse et entre en relations avecle Musée Georges-Labit. Ce dernier est en fait une ancienne collection privée devenuemusée municipal d’art oriental à la suite de son acquisition par la Ville en 1905-1921,mais plus ou moins laissé en sommeil depuis cette date. Le Dr Sallet en devient conser-vateur en 1934 et réussit à le transformer et le moderniser : l’inauguration a lieu en 1935.Mais les difficultés financières, puis la guerre, contraignent le musée à une seconde périodede sommeil. Il faudra attendre une nouvelle inauguration en 1945 pour que le muséerénové par le Dr Sallet entre définitivement en activité. C’est aujourd’hui un des fleu-rons culturels de la Ville de Toulouse qui possède ainsi le seul musée d’art oriental(Asie et Égypte) de province. Il est tout naturellement devenu le siège d’une Académietoulousaine des Amis de l’Orient créée en 1992. Quant au Dr. Sallet, la Ville de Toulousea rendu hommage à son action – fondamentale pour l’épanouissement de ce musée –en lui dédiant, en 1999, une de ses artères, la promenade du docteur Albert Sallet.
Toutefois, c’est dans un tout autre cadre que le Dr Sallet (1877-1948) avait com-mencé sa carrière. Jeune médecin militaire, il avait été affecté en Indochine en 1903,plus précisément dans le Sud-Annam, seule région où subsistait une population deChams. Il avait appris leur langue (en même temps que le vietnamien et les caractèressino-vietnamiens), étudié leur culture et publié nombre d’articles à leur sujet. Mais paral-lèlement, il s’était investi dans une vaste enquête sur la médecine traditionnelle viet-
« Numismatique médicale » Toutefois, considérer cet ensemble comme le simple résultat du goût d’un homme
pour la collection équivaudrait probablement à en restreindre la signification. En effet,le Dr Sallet consacra une grande partie de ses longs séjours en Indochine, à l’étude dela médecine et de la pharmacopée traditionnelles vietnamiennes, et ce qui en est indis-sociable, la « magie conjuratoire », pour reprendre ses propres termes. En cela, il s’ins-crivait dans une tradition qui mérite d’être rappelée pour mieux comprendre sa démarche,celle de la « numismatique médicale », c’est-à-dire cette numismatique bien particu-lière, pratiquée par des médecins autour de monnaies à connotation médicale. Dans lecas qui nous intéresse, il s’agit essentiellement des premiers médecins de France etd’Indochine qui se penchèrent sur la question des amulettes chinoises et vietnamiennes.
Un précurseur fut le Dr. J.-J. Matignon, médecin militaire à la légation de Franceà Pékin, qui dès 1898, avait publié un article sur « Quelques superstitions médicalesdes Chinois » (4). On y lisait par exemple que, dès leur naissance, les enfants étaient« protégés par des chaines spéciales, auxquelles sont suspendues de vieilles mon-naies » (5). Cette étude, pourtant bien courte, sera par la suite très souvent citée enIndochine (6). Eut également un certain succès, le livre du médecin de marine JulesRegnault (1873-1962), Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites,publié en 1902 (7). D’autres médecins, au contraire, abordaient la question par un biaisplus culturel, mais qui, lui aussi, pouvait contribuer à l’étude des amulettes. Parexemple, le Dr. G. Gieseler s’intéressa plutôt aux symboles et mythes dans la Chineancienne. Ainsi publia-t-il en 1916 sur « Le jade dans le culte et les rites funéraires enChine, sous les Tcheou et Han » (8), en 1918 sur « Le mythe du Dragon en Chine »(9) ; il donnera plus tard, en 1933, une courte étude sur Les symboles de jade dans leTaoïsme (10), et fera don au Musée Guimet de quelques objets archéologiques chinois.Si ces travaux étaient très en marge de l’étude des amulettes, ils s’en rapprochaient néan-moins par certains aspects, notamment l’interprétation de leur iconographie.
4. Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, 1898, vol. 9, n° 9, p. 408-413. Du même auteur :La Chine hermétique. Superstitions, crime et misère, Lyon, 1898.
5. Op. cit., p. 410.6. Le « Dr Matignon, qui occupe ici (en Indochine) une place hors de proportion avec l’importance
de ses recherches… », Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient, 1903, n° 3, p. 469.7. Paris. C.r. dans BEFEO, 1903, n° 3, p. 469-473.8. Revue archéologique, juillet-août 1916, p. 61-118.9. Ibid., 1918, p. 104-170.10. Paris, 1933, 26 p.
— 183 —
J.-C.), ou encore les wuzhu [4] (IIe s. av. J.-C. – VIIe s. ap. J.-C.). Mais ce sont des mon-naies assez exceptionnelles dans une telle collection car la grande période de circu-lation des monnaies chinoises au Vietnam est plutôt postérieure. En fait, c’est surtoutà partir de la dynastie Tang (618-907) que la collection devient plus riche ; ainsi com-prend-elle un grand nombre de kaiyuan [5], une monnaie qui fut produite durant prèsde trois siècles et se répandit dans toute l’Asie orientale, notamment au nord duVietnam, alors partie intégrante de l’empire chinois. Et, comme dans toute collectionde monnaies chinoises, celles-ci deviennent surabondantes pour ce qui est des dynas-ties des Song du Nord (960-1127) et Song du Sud (1127-1279). Dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911) sont évidemment bien représentées, mais finalement moinsque les Song du Nord.
Fig. 1 (échelle 1)D/ Da Zhong tongbao [6] (1361-68) du prince de Wu.R/ shi Guang [7] (valeur 10, province du Guangdong)
Dans cet ensemble, les monnaies rares sont très peu nombreuses. Des exemplairescomme la Da Zhong tongbao [6] (1361-68) du prince de Wu, au revers shi Guang [7],de valeur 10, émise au Guangdong, alors qu’il n’était encore qu’un rebelle contre lesMongols et avant qu’il ne fonde la dynastie des Ming et prenne le nom de règne de TaiZu [8] (1368), sont assez exceptionnels.
La partie vietnamienne, quoique très classique elle aussi, est plus intéressante. Elleprésente un échantillonnage assez vaste de l’histoire monétaire du pays, au moinsdepuis la dynastie des Lê postérieurs (1428), à l’exception de quelques monnaies anté-rieures. Certaines de ces monnaies sont assez rares, telles les –Da.i Ba?o thông ba?o [9](1440-42) du règne de Lê Thái Tông (1434-42). Certaines ères sont bien représentéespar des monnaies de qualité, telles les Hông –Dúc thông ba?o (1470-97), qui sont sou-vent de très belles pièces, ou les Hông Thuâ.n thông ba?o [10] (1509-16). Et comme danstoute collection numismatique vietnamienne, on y trouve maintes monnaies inclassables,telles les Phúc Bình nguyên ba?o [11] et autres.
Toutefois, la partie la plus riche est celle consacrée à la dynastie Nguyê~n (depuis
1802). Y figure, par exemple, un bel ensemble de « monnaies de présentation » desères Thiê.u Tri. (1841-1847) et Tu.’ –Dú’c (1848-1883). De la même façon, la collectioncomporte nombre de ba?o sao [12], ces « monnaies fiduciaires » émises à partir de 1861,sans grand succès d’ailleurs, devenues assez recherchées de nos jours. Enfin, on trouvedans cette collection de monnaies des Nguyê
~n, quelques spécimens fort rares, telles
ces Hàm Nghi thông ba?o [13] de 1884-85, émises à 24 000 exemplaires (40 ligatures)seulement.
Au total, donc, une collection classique de colonial du début du XXe siècle, éru-dit et passionné de Vietnam traditionnel.
— 182 —
Fig. 2 (échelle x1,7)Hàm Nghi thông ba?o [13]
1929), ancien inspecteur des colonies et bon connaisseur des monnaies colonialesd’Indochine (17).
Cette étude des Dr. Blanchard et Bui Van Quy avait été très minutieusement rédi-gée. Les noms chinois étaient suivis des caractères correspondants (prêtés par l’ImprimerieNationale). Le Dr. Blanchard avait pris soin d’analyser chimiquement tous les contre-poisons que lui avait fait parvenir du Yunnan le Dr. Bui Van Quy. La curiosité du Dr.Blanchard pour ces questions était grande : ainsi apprend-on, au fil de l’article, qu’ilpossédait deux épées votives de sapèques et qu’il était allé examiner celle que possé-dait le Musée de l’Armée aux Invalides (18). Certes, l’étude comporte de nombreuseserreurs d’interprétation et une de ses faiblesses est de ne présenter que des dessins desamulettes étudiées, et non des estampages. Il n’en demeure pas moins que c’était làune contribution toute nouvelle en France qui, aujourd’hui encore, mérite d’être citéedans les bibliographies sur le sujet.
Le Dr. Sallet, médecin numismateC’est clairement dans le contexte de cette « numismatique médicale » que s’ins-
crivaient les préoccupations du Dr. Sallet. Comme nombre de ses confrères métropo-litains et coloniaux, il fut sensible à l’originalité des pratiques médicales et magiqueschinoises et vietnamiennes, ce qui le conduisit à l’étude des amulettes. C’est ainsiqu’en 1926, il réussit à faire diffuser administrativement dans une partie de l’Annam,un questionnaire destiné à recueillir dans certains villages, des informations sur les cou-tumes, les traditions, les plantes médicinales et surtout les pratiques magico-médi-cales ; de même, il fit peindre par des sorciers, surtout le « sorcier de Tourane » qu’ilcite souvent, des « images » pour pratique de « magie conjuratoire » et confection d’amu-lettes. De tout cela, subsiste dans les papiers du Dr Sallet un fonds documentaire d’en-viron 2 500 pages et 500 images, d’une extraordinaire richesse.
Pour mieux se convaincre du sérieux avec lequel il menait cette vaste enquête, ilsuffit de se reporter à une partie de sa bibliographie : « Les esprits malfaisants dans lesaffections épidémiques au Binh Thuan » (1926), « Un grand médecin d’Annam, Hai-thuong la nong (1725-1792) » (1930), « Les démons particuliers aux épidémies et lesesprits malfaisants dans le Sud-Annam » (1932), ou encore « Les esprits malfaisants en
17. Collection André Salles. Monnaies , Médailles Jetons des Colonies françaises (…). Vente auxenchères publiques, 1er et 2 juillet 1929, Expert Étienne Bourgey, Paris, Hôtel Drouot.
18. Autre exemple de cette grande curiosité : à notre connaissance, le Dr. Blanchard est le seulà avoir fait le rapprochement (note 1, p. 142) entre les illustrations et vœux inscrits sur les amu-lettes et ceux qui étaient inscrits sur les boites d’allumettes alors fabriquées au Japon (et à unmoindre degré en Indochine) et que de nombreux coloniaux collectionnèrent.
— 185 —
En fait, la première enquête systématique sur les amulettes sino-vietnamiennes parun médecin fut celle du Dr. Raphaël Blanchard (1857-1919). Parasitologue fort connu,membre de l’Académie de médecine et fondateur de l’Institut de médecine colonialeen 1902, le Dr. Blanchard s’intéressa à de très nombreux sujets paramédicaux, notam-ment à la « numismatique médicale » (l’expression est de lui). Il possédait d’ailleursune importante collection de ce genre.
Pour apprécier ses travaux, peut-être faut-il faire un détour par une autre person-nalité, américano-anglaise, à savoir Henry Wellcome (1853-1936). Ce dernier n’étaitpas médecin, mais fabricant de produits pharmaceutiques, à la tête d’une société fortimportante de Londres, la Burroughs Wellcome & Co. Il avait amassé une fortuneconsidérable comme en témoigne, de nos jours encore, les richesses du Wellcome Trust(11). Il était notamment grand collectionneur d’objets de médecine : ceux-ci furent àl’origine du Historical Medecine Museum, établi à Londres en 1913, lors d’un congrèsinternational de médecine. Or le Dr. Blanchard avait une grande admiration pourHenry Wellcome, le connaissait assez bien et avait eu accès à sa collection de numis-matique médicale qui comptait précisément des amulettes d’Extrême-Orient. Celaavait attisé sa curiosité pour le sujet, de même, d’ailleurs, que l’examen des quelquesamulettes que possédait le Musée Guimet.
Il se trouva qu’en 1910-1911, un médecin vietnamien, Bui Van Quy, vint à Parissuivre les cours du Dr. Blanchard à l’Institut de médecine coloniale. Comme l’écrirace dernier, cela lui donna « l’idée d’entreprendre avec lui des recherches sur lescroyances et superstitions médicales de la Chine méridionale et du Tonkin ». De retouren Indochine, le Dr. Bui Van Quy fut nommé à l’Hôpîtal consulaire français à Yunnanfu(aujourd’hui Kunming). Pour le compte de son ancien patron, Bui Van Quy se mit à« faire la chasse aux amulettes » et dès 1912, en envoya à Paris une petite collectionde 53 pièces. C’est cette collection qui permit au Dr. Blanchard de rédiger une étudepionnière sur le sujet, cosignée avec le Dr Bui Van Quy : elle sera publiée en 1918,dans la Revue anthropologique, sous le titre « Sur une collection d’amulettes chi-noises » (12).
Ce fut la première étude française aussi détaillée rédigée sur le sujet : elle présen-tait deux fois plus de spécimens que celle de Schroeder dans ses Études numismatiques(13). On y constate que le Dr. Blanchard était parfaitement au courant de la bibliographiealors existante. S’il s’appuyait largement sur le livre de Schroeder, il connaissait éga-lement les travaux étrangers de Lockhart (14), Stuart (15) ou Ramsden (16). Il recevaitdes catalogues de marchands numismates de Yokohama. En France, il était en relationsavec le Dr. Gieseler, mentionné ci-dessus, qui relut les épreuves de son étude et lui donnade « très utiles indications ». Il se référait souvent au Dr. Regnault, lui aussi cité ci-des-sus. En outre, il était en relations avec des numismates connus, tel André Salles (1860-
11. F. LARSON, An Infinity of Things : How Sir Henry Wellcome Collected the World, Oxford,2009.
12. R. BLANCHARD et BUI VAN QUY, « Sur une collection d’amulettes chinoises », Revueanthropologique, tome XXVIII, mai-juin 1918, p. 131-172.
13. Paris, DATE ?, 651 p.14. The Currency of the Farther East, Glover Collection, 3 vol., Hong Kong, 1895-1907.15. Catalogus der munten en amuletten van China, Japan, Corea en Annam (…), Batavia, 1901,
227 p.16. Corean coins, charms and amulets, Yokohama, 1910, 40 p. ; Chinese openwork amulet-
coins, Yokohama, 1911, 60 p.
— 184 —
Fig 3. Un exemple d’amulette reproduite et commentée par le Dr. Blanchard :« Sapèque des cinq objets vénimeux »
Fig. 5 (échelle 1). Médaille talismanique n° 1 (estampage)
Cette première amulette comporte au droit (image de droite) le zodiaque avec lesdouze animaux en périphérie et les douze signes cycliques leur correspondant. Safonction protectrice découle de ce que, selon les croyances chinoises et vietnamiennes,chaque individu est protégé par une divinité résidant dans telle ou telle étoile de la GrandeOurse en fonction de son année de naissance. Au revers (image de gauche), on trouveles ba gua [16], les « Huit trigrammes », symboles, entre autres, des différents stadesde la vie, et moyens de protection contre les désordres et nuisances. Au centre, figurele Taiji [17], union des principes yin et yang. Autant d’éléments qui ne peuvent queprotéger contre les esprits malfaisants.
Mais ce sont là des précautions d’ordre général ; contre ces esprits, il existe des amu-lettes plus spécialisées. Tel est le cas de la « médaille talismanique » n° 5 dans le cata-logue du Dr Sallet.
Fig. 6 (échelle 1)Médaille talismanique n° 5 (estampage)
Cette autre amulette, en effet, est d’un type différent, mais son objet est assez com-parable : il s’agit toujours de chasser les esprits malfaisants. Au droit, on trouve une for-mule très classique, l’invocation au dieu du Tonnerre, supposé chasser les démons :« Ô dieu du Tonnerre, anéantis les démons, subjugue les fantômes, chasse les influencesdémoniaques, garde-nous toujours sains et saufs (…) ! » (19). L’invocation est flanquéeà droite et à gauche de deux caractères talismaniques taoïstes fu [18], réputés capablesde chasser les pestilences et généralement tracés de façon si ésotérique que seuls lesinitiés taoïstes peuvent les déchiffrer. Ici le fu de droite est composé des deux carac-tères shan [19] (montagne) et gui [20] (mauvais esprit), celui de gauche, de lei [21] (ton-nerre) et ling [22] (ordre), d’où « Ordre du dieu du Tonnerre aux mauvais esprits de lamontagne ». Au revers (que le Dr Sallet appelle avers par erreur), on retrouve les bagua [16], les « Huit trigrammes », comme sur l’amulette précédente. Une fois encore,on est bien là au cœur de la magie conjuratoire sur laquelle travaillait le Dr Sallet.
19. Cf. TING Fubao, Gu Qian Da Cidian (Encyclopédie de monnaies anciennes), Pékin, 1982 (réédi-tion), vol. 1, p. 385.
— 187 —
Annam », dans les Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettresde Toulouse (1937). Au moment de son installation à Toulouse, il publia en outre unlivre très érudit sur L’officine sino-annamite. Le médecin annamite et la préparation desremèdes (Paris, Van Oest, 1931).
Or, au Vietnam comme en Chine (voire Corée et Japon), la monnaie a toujours jouéun grand rôle dans la pharmacopée et les pratiques de « magie conjuratoire ». Il estd’ailleurs remarquable que le mot qian [14] sert tout à la fois à désigner la « monnaie »au sens économique et numismatique, mais aussi l’« amulette » destinée, entre autresfonctions, à combattre démons et pestilences. D’ailleurs, tous les grands ouvragesasiatiques de numismatique portent en partie sur les amulettes.
Les papiers du Dr. Sallet ne permettent pas de mesurer exactement l’importance dulien qu’il établissait entre ses recherches sur les pratiques thérapeutiques et magiquesvietnamiennes et sa collection numismatique. Mais, bien évidemment, il connaissaitparfaitement la relation existant entre ces deux domaines. D’ailleurs, ses travaux en por-tent témoignage. Ainsi écrit-il dans son Officine sino-annamite, à l’article « Sapèquesanciennes / Co? van tiên » (p. 119) : « On frotte une sapèque ancienne sur une surfacerugueuse : le produit de l’usure obtenu est glissé sous les paupières dans les cas d’in-flammations conjonctivales : la guérison serait rapidement assurée ». Et une note com-plète cet article : « C ?u’a tùng. Les sapèques anciennes sont portées par les enfants enprotection contre les maladies semées par les mauvais esprits (croyance générale) ».
Une collection d’amulettesPour preuve que le Dr Sallet était fort intéressé par ce lien entre monnaie et « magie
conjuratoire » : non seulement il collectionnait monnaies et amulettes pertinentes ence domaine, mais encore ce sont ces dernières qu’il plaça en tête du catalogue de sacollection, rédigé lorsqu’il fut installé à Toulouse. Comme le Dr. Blanchard avant lui,le Dr. Sallet s’était fait aider, lorsqu’il était en Indochine, par un lettré de grande cul-ture, à savoir son ami Nguyen Dinh Hoe, directeur de l’école mandarinale de Huê. C’esttrès probablement à lui qu’on doit toutes les notices et étiquettes qui ont suivi cette col-lection de monnaies et amulettes.
Malheureusement, très peu nombreuses sont ces amulettes – que le Dr Salletnomme « médailles talismaniques » — dans la collection telle qu’elle nous est parve-nue. Quant à celles que les Chinois appellent ya sheng qian [15] « monnaies / amu-lettes (qian) pour écraser (ya) et vaincre (sheng) (les démons et esprits malfaisants) »,elles en ont toutes été retirées, mais nous en connaissons encore un certain nombregrâce aux estampages contenus dans les archives écrites de la collection.
Prenons par exemple la n° 1 de ces « médailles talismaniques » dans le cataloguedressé par le Dr. Sallet lui-même.
— 186 —
Fig. 4. Exemples d’ « images » de « magie conjuratoire » de la collection du Dr Sallet
Liste des caractères chinois mentionnés dans l’article
— 189 —
Fig. 7 (échelle 1). Médaille talismanique n° 9 (estampage). Voir Fig. 3 ci-avant.
Citons un dernier exemple, celui de l’amulette n° 9. On y trouve au droit ce quele Dr Sallet appelait « les 5 animaux redoutables ». En fait, ces cinq animaux traditionnelsétaient l’araignée, le crapaud à trois pattes, le serpent, le lézard, mais aussi le scorpionqui manque ici. Le cinquième animal de cette amulette est le tigre blanc, qui n’est nul-lement à classer parmi « les 5 animaux redoutables », mais au contraire qui, animalbénéfique, est ici pour chasser les démons. En Indochine, à la période coloniale, onutilisait encore les os de tigre dans certaines potions magiques. Au revers, le « sorcier »du Dr Sallet n’est autre que Zhong Kui, chasseur de démons extrêmement populaire.Ici, il menace l’araignée (le mal) de sa tablette de lettré (le légendaire Zhong Kui étaitun lauréat des examens mandarinaux finalement mis à l’écart tant il était hideux).Quant à la formule chinoise, [23] (parfois écrit [24]) [25], Qu xie jiang fu, elle signi-fie effectivement, comme noté par le Dr Sallet, « Chasser le mauvais et conférer le bon-heur ».
On comprend que de telles amulettes intéressaient au plus haut point le Dr Salletpour ses études sur la magie conjuratoire vietnamienne. Et ces exemples pourraient êtremultipliés. Avec cette partie de sa collection, on était clairement au-delà de la numis-matique pure, en plein cœur de ces pratiques magiques sur lesquelles il a tant travaillé.
En dépit de son importance numérique, cette collection, répétons-le, ne saurait doncs’apprécier uniquement par elle-même, d’autant qu’elle a malheureusement été ampu-tée. Ce qui en fait son véritable intérêt, c’est le fait qu’elle s’intègre dans un ensemblesur l’Indochine qui est d’une grande richesse : bibliothèque, milliers de photographies,importante enquête ethnographique, nombreuses publications scientifiques, témoi-gnages historiques, etc. C’est aussi le fait qu’elle est caractéristique de cette « numis-matique médicale » des médecins métropolitains et coloniaux de l’Indochine de la pre-mière moitié du XXème siècle. Le Dr Albert Sallet, « Indochinois » de cœur, Toulousaind’adoption, premier conservateur du Musée Georges-Labit et « médecin-numismate »,méritait bien qu’on lui rendît hommage à l’occasion de nos « Journées numismatiques2010 » dans le Sud-Ouest.
Note concernant la bibliographieDepuis l’époque du Dr. Sallet, la bibliographie relative aux amulettes chinoises et
vietnamiennes a beaucoup évolué. Parmi les ouvrages français, citons tout d’abord lesdeux livres de F. Thierry, Amulettes de Chine et du Viet-Nam, Paris, 1987, et surtoutAmulettes de Chine. Catalogue, Paris, BNF, 2008 ; également K. Petit, Talismans moné-tiformes de Chine et du Japon, Paris, 1981. Parmi les ouvrages étrangers, citons A.A.Remmelts, Chinese Charms and Amulets, Amsterdam, 1968 ; Yu Liu-liang et al.,Zhongguo huaqian, Shanghai, 1993. Bien que portant sur une zone différente, citonsenfin l’excellent catalogue de J. Cribb, Magic Coins of Java, Bali and the MalayPeninsula, Londres, British Museum, 1999.
— 188 —
Fig. 1
— 190 —
CORRESPONDANCE
COUPLAND (Simon) — Le trésor de Bourgneuf-en-Retz et les monnaies de Melleau monogramme d’un roi Charles.
À la fin de 2009, une série de monnaies et de fragments de monnaies fut mise envente en trois lots sur un site Internet (Fig. 1). Ces monnaies étaient toutes du mêmetype, frappées par un roi Charles (« +CARLVSREXFR »), à l’atelier de Melle en Poitou(« +METVLLO »). Elles étaient aussi très homogènes du point de vu de leur fragmen-tation. Il s’agit de toute évidence d’un petit trésor contenant dix ou peut-être onze mon-naies ; il n’est en effet pas certain que la onzième monnaie, moins fragmentée que lesautres de même qu’un lot différent aient fait partie du dépôt. Le vendeur affirme les avoirachetées à Bourgneuf-en-Retz (44580 Loire-Atlantique, « à un vide grenier ») et il estfort probable qu’il s’agisse aussi du lieu de leur découverte. La commune de Bourgneuf-en-Retz est située entre la ville de Nantes et l’île de Noirmoutier, à moins de dix kilo-mètres de l’île de Bouin, vicus saccagé par les Normands en 820 (1), mais à pas moinsde 165 kilomètres des mines d’argent et de l’atelier carolingien de Melle. Ces monnaiesont-elles frappées par Charlemagne ou Charles le Chauve ? Est-il possible de faire ladistinction entre les monnaies au monogramme de ces deux règnes et donc de daterce petit trésor ?
Les deniers au monogramme de Melle qu’on peut définitivement attribuer àCharlemagne ont tous étés trouvés dans des trésors contemporains: Bondeno en Italie(2), Wiesbaden-Biebrich (trois monnaies), Ibersheim et Münster en Allemagne (3),Borne (trois monnaies) et Wijk bij Duurstede aux Pays-Bas (4), ainsi qu’avec des mon-naies de Louis le Pieux à Apremont-Veuillin et Belvézet (). Peu de ces monnaies ontété illustrées, mais celles qui l’ont été (5) présentent toutes un style identique auxmonnaies trouvées à Bourgneuf-en-Retz, c’est-à-dire :
(I) le nom de l’atelier, +METVLLO, n’a pas la deuxième croix que l’on trouve surcertains deniers (+MET+VLLO) ;
(II) la croix au commencement de la légende est alignée à 35º-40º de la ligne ver-ticale du monogramme ;
(III) la forme des lettres est nette et claire.Dans les trésors du règne de Charles le Chauve, on trouve quelques deniers de Melle
avec la deuxième croix dans la légende de revers ; c’est le cas des dépôts trouvés àBressuire, Brioux, Chaumoux-Marcilly et Roermond par exemple, qui datent tousd’entre 840 et 864 (6). Mais à Roermond, seul un des deniers porte cette deuxième croix ;
1. Annales Regni Francorum 820, éd. F. Kurze, MGH, SSrG, Hannovre, 1895, p. 154; M.ROUCHE, L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes, 418-781, Paris, 1979, p. 204-207, 247.
2. RIN 1896, p. 144.3. H.H. VÖLCKERS, Karolingische Münzfunde der Frühzeit (751-800), Göttingen, 1965, nos XLII
et XLIII ; C. STIEGEMANN et M. WEMHOFF (éd.), 799 : Kunst und Kultur der Karolingerzeit,Mayence, 1999, 1.389.
4. Overijsselse Historische Bijdragen, 105 (1990), p. 147-151 ; RBN 1857, p. 34-36, HAERTLEn° 7, VÖLCKERS III.20, 29, 35 (6 monnaies), 44, 48, 69, 72, 78-79, 86 (mais non 85).
5. F. BOMPOIS, Notice sur un dépôt de monnaies carlovingiennes découvert en juin 1871 auxenvirons de Veuillin, commune d’Apremont, département du Cher, Paris, 1871, HAERTLE n° 2 ;RN 1837, p. 347-359, 376, HAERTLE n° 5.
6. Celles des trésors de Wiesbaden-Biebrich, Münster et Borne.
— 191 —
sor de Château-Roussillon comptait, en plus d’une obole de Melle, un denier deBourges, un de Narbonne, un de Pavie, un de Toulouse et un de Tours ; parmi lesquinze deniers au monogramme trouvés à Borne en Overijssel, il y avait les trois deMelle dont on a déjà parlé, mais aussi un de Bourges, un de Dax, deux de Dorestad,trois de Mainz, trois de Pavie et un de Toulouse, ainsi qu’un denier à la légende ita-lienne et au monogramme grec. Par contre, sous les fils de Louis le Pieux, après la guerrecivile et la partition de Verdun dans les années 840, il semble que les monnaies cir-culaient moins loin. Les trésors de Charles le Chauve et de Pépin II contiennent doncplus de monnaies locales, surtout en Aquitaine où ceux de Brioux et d’Auzeville et celuivendu chez Spink en 1989 (12) sont dominés par la présence de monnaies d’ateliersde la région, et peu de deniers provenant d’ailleurs (13). Le même phénomène est visibledans le territoire de Lothaire I (14).
On peut donc conclure que ce petit dépôt de dix ou onze monnaies fut probable-ment confié à la terre sous le règne de Charles le Chauve. L’absence de deniers de Pépinindique une date avant 845 ou après 850, mais il est impossible d’être plus précis. Onpeut facilement imaginer que le propriétaire de ces deniers se soit senti menacé et aitpar conséquent décidé de cacher son argent. En effet, nous savons qu’il y eût beaucoupd’incursions de Bretons et de Scandinaves au cours de cette période (15). Il ne s’ima-ginait sûrement pas que ses monnaies resteraient là pendant près de 1200 ans.
12. S. COUPLAND, « Boom and bust at ninth-century Dorestad », dans A. WILLEMSEN et H. KIK(éd.), Dorestad in an International Framework. New Research into Trade Centres in CarolingianTimes (à paraître).
13. S. COUPLAND, « Early coinage of Charles the Bald », loc. cit., p. 133.14. D.M. METCALF, « A sketch of the currency in the time of Charles the Bald », dans M. GIB-
SON et J.L. NELSON (éd.), Charles the Bald : Court and Kingdom, 2e édition, Aldershot, 1990,p. 65-97 ; S. COUPLAND, « The coinages of Pippin I and II of Aquitaine », RN 1989, p. 194-222, pages 217-218.
15. S. COUPLAND, « The coinage of Lothar I (840-855) », NC, 161, 2001, p. 157-198, page 192.16. Par exemple G. TESSIER (éd.), Recueil des actes de Charles II le Chauve roi de France, 3 vol.,
Paris, 1943-1955, n° 81 (845), vol. 1, p. 228 : « propter persecutionem barbaricam scilicetNormannorum et Brittannorum frequentissimam atque inprovisam ».
— 193 —
les seize autres sont tout à fait semblables aux monnaies de Charlemagne avec lalégende simple (7). D’autre monnaies de +METVLLO, sans croix, sont également pré-sentes dans les trésors de Brioux, Rijs, St-Julien d’Angers, Pilligerheck, Achlum,Tessoualle, Kättilstorp en Suède et Mullaghboden en Irlande (8). (Ces dernières mon-naies ont sans doute été pillées par des pirates normands qui ravageaient l’Aquitainedans les années 840-850.) Il existe aussi quelques deniers rares qui portent le titre dePépin II sur une face (« +PIPPINVSREXEQ ») et le nom d’atelier +METVLLO autour dumonogramme de Charles (Fig. 2) sur l’autre face. Au début du règne de ce roi en 845,le monnayeur continua évidemment d’utiliser un ancien coin de Charles le Chauve pourle revers tout en gravant un nouveau coin de droit. Il est donc évident que sous Charlesle Chauve, on frappait des monnaies avec la légende +MET+VLLO et d’autres avec+METVLLO. Philip Grierson a émis l’hypothèse que les premières fussent frappées àPoitiers et les dernières à Melle (9), mais le fait que Pépin II ait frappé des deniers à cettepériode avec le nom de lieu de Poitiers (« PECTAVO ») rend cette thèse invraisemblable.
Ainsi, il semble impossible d’attribuer à Charlemagne ou à Charles le Chauve cepetit dépôt trouvé au pays de Retz en se basant sur les légendes. Comme M. Sarah l’adémontré récemment, même l’analyse du titre d’argent de ces deniers ne le permet-trait pas (10).
Il y a cependant un indice précieux qui nous permet de décider que dans ce cas,il soit plus probable que le trésor de Bourgneuf-en-Retz date du règne de Charles leChauve plutôt que de celui de Charlemagne, c’est sa composition. En effet, il est évi-dent que pendant la période de production des monnaies au monogramme deCharlemagne, entre 793 et 813, les monnaies circulaient bien loin de leurs régions d’ori-gine et se mélangeaient de façon extraordinaire. Par exemple, à Wijk bij Duurstede,l’ancien Dorestad, on a trouvé des monnaies au monogramme de Charlemagne émisesdans vingt-neuf des quarante ateliers connus, avec des exemplaires provenant d’ate-liers aussi lointains qu’Arles, Mainz, Melle, Milan, Pavie et Toulouse (11). Le petit tré-
7. HAERTLE 23/013-14, 47/215, 50/994 ; BSFN 50 (1995), p. 1154.8. HAERTLE 50/980-993.9. S. COUPLAND, « The early coinage of Charles the Bald, 840-864 », NC, 151, 1991, p. 121-
158, à la page 133.10. P. GRIERSON et M. BLACKBURN, Medieval European Coinage, Cambridge, 1986, vol. 1,
p. 238-239. 11. G. SARAH, « Analyses élémentaires de monnaies de Charlemagne et de Louis le Pieux du
Cabinet des Médailles: le cas de Melle », dans A. CLAIRAND et D. HOLLARD (éd.),« Numismatique et archéologie en Poitou-Charentes », Actes du colloque de Niort 7-8décembre 2007, Musée Bernard-d’Agesci, Paris, 2009, p. 63-83, aux pages 73-74.
— 192 —
Fig. 2
La séance ordinaire est présidée par M. Jean-Pierre Garnier.Membres présents : Mlles, Mmes et MM. M. Amandry, F. Beau, M.-L. Berdeaux-
Le Brazidec, M. Bompaire, A. Bourgeois, L. Calmels, P. Crinon, J.-M. Diaz, V. Drost,P. Dubourg, J. Françoise, J.-P. Garnier, V. Geneviève, M. Hourlier, F. Joyaux, P. Mathieu,J. Meissonnier, M. Parverie, R. Prot, A. Ronde, S. de Turckheim-Pey, R. Wack.
Membres excusés : Mmes, Mlles et MM. J. Bouvry-Pournot, J.-C. Desfretier, G.Gautier, Y. Jézéquel, J.-P. Le Dantec, X. Loriot, M.-C. Marcellesi.
ÉlectionM. Ludovic Liétard, maître de conférences à l’Université Rennes 1, dont la candi-
dature avait été présentée lors de la séance de mai, est élu à l’unanimité membre cor-respondant de notre société.
CandidaturesLa candidature de M. Henri Térisse, d’Argenton-sur-Creuse, parrainé par MM. J.-P.
Garnier et J.-C. Desfretier, est ensuite soumise à l’assemblée.
AnnoncesL’annonce de la tenue, les 16 et 17 septembre 2010 au Queen’s College à Cambridge,
d’un symposium en l’honneur de Peter Spufford (« Money and its Use in MedievalEurope ») nous est parvenue après les Journées mais mérite d’être mentionnée ici.
PublicationsLe président présente les publications suivantes :M. Christol, Une Histoire provinciale. La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle
av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C., Paris, Publications de la Sorbonne, 2010.M.-L. Berdeaux-Le Brazidec, « Monnaies d’or conservées au musée d’Archéologie
nationale », tiré-à-part de Antiquités nationales, 40, 2009, p. 147-154.Les publications reçues dans le mois sont ensuite mises en circulation :Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, 47/1, janvier-avril 2010.Buletinul Societatii Numismatice Romane, XCVIII-CIII, 2004-2009.Svensk Numismatisk Tidskrift, 4, mai 2010.
À l’issue de la séance ordinaire, la deuxième séance de communications débute.Elle est présidée, dans sa première partie, par Mme Sylvie de Turckheim-Pey et, danssa seconde partie, par Mme Florence Viguier-Dutheil. Les communicants suivantsinterviennent successivement : V. Geneviève ; P. Crinon ; J.-M. Diaz ; R. Prot ; S. deTurckheim-Pey ; J.-P. Garnier.
La séance est levée à 18h15.Les participants se retrouvent enfin à 19h30 au restaurant « Bourdelle » pour le tra-
ditionnel dîner de clôture.
— 195 —
53èmes JournÉes NumismatiquesMONTAUBAN (4-5 juin 2010)
Les 53èmes Journées Numismatiques de la Société française de Numismatique(SFN), se sont déroulées à Montauban du 4 au 6 juin 2010. Elles ont été organisées avecle concours de la Ville de Montauban et du musée Ingres.
Ont participé aux Journées :M. et Mmes Amandry, F. Beau, C. Beau, M.-L. Berdeaux-Le Brazidec, M. Bompaire,
Mme Bompaire, A. Bourgeois, L. Calmels, P. Crinon, M. Crinon, J.-M. Diaz, V. Drost,P. Dubourg, M. et Mme de Falguerolles, J. Françoise, J.-P. Garnier, V. Geneviève, M.Hourlier, J. Hourlier, F. Joyaux, Mme Joyaux, P. Mathieu, Mme Mathieu, J. Meissonnier,M. Parvérie, M. D. Pey, R. Prot, A. Ronde, R. Ronde, M. Suspène, S. de Turckheim-Pey,B. Vacherot, F. Viguier-Dutheil, R. Wack.
Vendredi 4 juin
Les participants sont accueillis à partir de 13h30 dans la Chapelle du musée Ingres,dans laquelle se tiendront les séances de communications. Le dossier des Journées estremis aux participants. Il contient notamment la plaquette éditée pour l’occasion (M.-L.Berdeaux-Le Brazidec, dir.), Les collections numismatiques du musée Ingres. Montauban(Tarn-et-Garonne), Paris, SFN, 2010, 62 p.) ainsi que la médaille réalisée par J.-P.Garnier.
Les Journées sont ouvertes à 14h15. M. Jean-Pierre Garnier, président de la SFN,et Mme Florence Viguier-Dutheil, directrice du musée Ingres, prononcent les allocu-tions de bienvenue.
La première séance de communications débute à 14h45. Elle se déroule en deuxparties séparées par une courte pause. La première demi-séance est présidée par M.Marc Bompaire tandis que la seconde est présidée par M. Michel Amandry.
Les intervenants suivants présentent successivement leurs communications : J.Meissonnier et M.-L. Berdeaux-Le Brazidec ; M.-L. Berdeaux-Le Brazidec ; [J.-P. LeDantec] et M.-L. Berdeaux-Le Brazidec ; M. Parverie ; F. Joyaux ; [G. Gautier], M.Amandry et M.-L. Berdeaux-Le Brazidec.
La séance est levée à 18h. Elle est suivie de l’inauguration de l’exposition numis-matique au musée Ingres, en présence des représentants la municipalité, dont M.Philippe Maurin, adjoint chargé de la culture, et M. Roland Garrigues, ancien mairede Montauban, représentant le Conseil général . Le président de la SFN, Jean-PierreGarnier, remet alors à Mme Florence Viguier-Dutheil et à M. Philippe Maurin un exem-plaire de la médaille qu’il a réalisée pour l’occasion.
Les participants sont ensuite conviés à un vin d’honneur organisé dans la salle dumusée Ingres consacrée à Bourdelle.
Samedi 5 juin
Les participants se retrouvent à 10h au musée Ingres pour une visite guidée du muséeIngres.
Après le déjeuner, les membres se réunissent à 14h dans la chapelle du musée pourla séance ordinaire de la SFN.
— 194 —
Prépresse : Cymbalum – ParisImprimerie France-Quercy — Mercuès
TARIFS POUR 2010Cotisation (avec le service de la Revue numismatique, mais sans le BSFN) :
Membres correspondants (France et étranger)...................................26 €Membres titulaires............................................................................34 €
Droit de première inscription ..................................................................................8 €
Abonnement au BSFN seul :Membres de la SFN :
France ...................................................................................24 €Étranger .................................................................................29 €
Non membres de la SFN :France ...................................................................................36 €Étranger .................................................................................40 €
Vente au numéro................................................................................5 €Changement d’adresse........................................................................................1,50 €
Compte bancaire : BRED Paris BourseRIB : 10107 00103 00810033767 88
Code BIC : BRED FRPPXXXN° IBAN : FR76 1010 7001 0300 8100 3376 788
Chèques ou mandats à libeller en Euros.Les chèques bancaires en provenance de l’étranger doivent être libellés en euros, etimpérativement payables sur une banque installée en France.
BBUULLLLEETTIINN DDEE LLAA SSOOCCIIÉÉTTÉÉ FFRRAANNÇÇAAIISSEE DDEE NNUUMMIISSMMAATTIIQQUUEEPublication de la Société Française de Numismatique
10 numéros par anISSN 0037-9344
N° de Commission paritaire de Presse : 0510 G 84906
Société Française de Numismatiquereconnue d'utilité publique
Bibliothèque nationale de France58 rue de Richelieu, 75002 Paris – tél./fax 01 53 79 86 26
Internet : http://www.sfnum.asso.fre-mail : [email protected]
Le responsable de la publication : Jean Jézéquel ([email protected])
SSOOCCIIÉÉTTÉÉ FFRRAANNÇÇAAIISSEE DDEE NNUUMMIISSMMAATTIIQQUUEE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2010
14 h 30
BnF Salle des Commissions
SAMEDI 5 OCTOBRE 2010
14 h 30
BnF Salle des Commissions
PROCHAINES SÉANCES