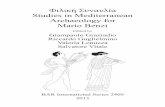2012: Diskursordnungen des Lernens, Dispositive des Schöpferischen
Fabrication des moules, diffusion des produits moulés. À propos d'une « figurine-patrice » du...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Fabrication des moules, diffusion des produits moulés. À propos d'une « figurine-patrice » du...
Karin Hornung-BertemesDominique Kassab TezgôrArthur Muller
Fabrication des moules, diffusion des produits moulés. À proposd'une «figurine-patrice » du Musée de VolosIn: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 122, livraison 1, 1998. pp. 91-107.
Citer ce document / Cite this document :
Hornung-Bertemes Karin, Kassab Tezgôr Dominique, Muller Arthur. Fabrication des moules, diffusion des produits moulés. Àpropos d'une «figurine-patrice » du Musée de Volos. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 122, livraison 1, 1998.pp. 91-107.
doi : 10.3406/bch.1998.7168
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_1998_num_122_1_7168
RésuméLa statuette de terre cuite du Musée de Volos, inv. M 2004, recueillie au début du siècle dans lesfouilles de A. S. Arvanitopoulos aux abords du rempart de Démétrias, est une tanagréenne hellénistiquetout à fait banale du point de vue iconographique. Ses caractéristiques techniques lui confèrentcependant un intérêt exceptionnel : elles permettent en effet de l'identifier comme une figurine- patrice,c'est-à-dire un objet moulé spécialement pour servir à la réalisation de nouveaux moules. Le bandeaupériphérique qui l'entoure devait faciliter la délimitation entre les valves d'avers et de revers dessurmoules à fabriquer. Cet objet, destiné à l'atelier qui ne produisait pas encore ce type, illustre doncune forme particulière de diffusion dans l'artisanat de la coroplathie. À côté de la commercialisation desproduits eux- mêmes, les figurines (que n'importe quel artisan céramiste pouvait d'ailleurs reproduireensuite par surmoulage), et des outils de production : les moules, existait donc une diffusion par le biaisd'objets à statut ambigu : ni produit, ni outil de production, mais produit modifié pour fabriquer denouveaux outils de production. Le surmoulage est ainsi institué en véritable pratique commerciale. Parailleurs, la figurine de Volos et les rares documents comparables que l'on a pu réunir permettent demieux comprendre certains aspects techniques de la prise d'une empreinte bivalve sur un positif.
AbstractThe terracotta, Volos Museum inv. M 2004, found at the beginning of the century in the excavations ofA. S. Arvanitopoulos on the edge of the ramparts at Demetrias, is a Hellenistic Tanagra figurine and isquite commonplace from an iconographie point of view. It does, however, have a special interestbecause of its technical characteristics, which identify it as a figurine patrix, in other words a mouldedobject especially fabricated to serve in the making of new moulds. The peripheral band around it wouldhave facilitated the demarcation between the front and rear sections of the derivative moulds whichwere to be fabricated. The figurine, destined for a workshop that was no longer producing this type,illustrates a particular form of diffusion encountered in the field of coro- plasty: alongside thecommercialisation of the products themselves (the figurines, which any ceramic craftsman couldsubsequently reproduce by the use of derivative moulds) and the tools for producing them (the bivalvemoulds), there was a parallel diffusion of objects of ambiguous status, being themselves neither an endproduct nor a tool of production, but a product designed to fabricate new tools of production. Derivativemoulding is thus established as belonging to actual commercial practice. Moreover, the Volos figurineand the rare comparable examples that it has been possible to discover enable a better understandingof the technical aspects of taking a two-part mould impression from a positive or patrix mould.
περίληψηΤο πήλινο αγαλματίδιο του Μουσείου Βόλου, με αριθμό ευρετηρίου Μ 2004, που βρέθηκε στις αρχές τουαιώνα στις ανασκαφές του Α. Σ. Αρβανιτόπουλου κοντά στο τείχος της Δημητριάδος, είναι μιαελληνιστική ταναγραία απολύτως κοινή ως προς τον εικονογραφικό της τύπο. Τα τεχνικάχαρακτηριστικά του, ωστόσο, του προσδίδουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον : επιτρέπουν να το ταυτίσουμεμε ειδώλιο-αρχέτυπο, δηλαδή ένα αντικείμενο κατασκευασμένο σε καλούπι ειδικά για να χρησιμεύσειστην παραγωγή νέων μητρών. Η περιφερική ταινία που το περιβάλλει θα πρέπει να διευκόλυνε τοχώρισμα μεταξύ του πρόσθιου και του οπίσθιου τμήματος των δευτερογενών μητρών που επρόκειτο νακατασκευαστούν. To αντικείμενο αυτό, προοριζόμενο για ένα εργαστήριο που δεν παρήγε ακόμη τοσυγκεκριμένο τύπο, δίνει επομένως στοιχεία για έναν ιδιαίτερο τρόπο διάδοσης στον τομέα τηςκοροπλαστικής βιοτεχνίας. Παράλληλα με την εμπορευματοποίηση των καθαυτό προϊόντων, δηλαδήτων ειδωλίων (που οποιοσδήποτε κεραμοπλάστης μπορούσε να αναπαράγει από δευτερογενήεκμάγευση) και των εργαλείων παραγωγής, δηλαδή των μήτρων, λειτουργούσε ένα σύστημα διάδοσηςμέσω αντικειμένων με διττό χαρακτήρα : τα αντικείμενα αυτά δεν ήταν ούτε απλά προϊόντα, ούτεεργαλεία παραγωγής, αλλά προϊόντα τροποποιημένα για την κατασκευή νέων εργαλείων παραγωγής. Ηδευτερογενής εκμάγευση αναδεικνύεται επομένως σε μια πραγματική εμπορική πρακτική. Επιπλέον, τοειδώλιο του Βόλου και τα σπάνια παράλληλα που μπορούν να συγκεντρωθούν βοηθούν στην καλύτερηκατανόηση ορισμένων τεχνικών της παραγωγής διμερών μητρών από θετικό αντικείμενο.
Fabrication des moules,
diffusion des produits moulés
Apropos d'une «figurine-patrice» du Musée de Volos
par Karin Hornung-Bertemes, Dominique Kassab Tezgôr et Arthur Muller
Au Musée archéologique de Volos est exposée depuis longtemps une figurine de terre cuite restée inédite. Dans un parfait état de conservation, elle représente une femme debout drapée a priori banale ; ses caractéristiques techniques en font cependant un objet exceptionnel qui apporte quelques lumières sur la fabrication des moules et la diffusion des produits moulés1.
1 Nos plus vifs remerciements vont à Argyroula Doulgeri- Intzesiloglou, Éphore des Antiquités de Volos, qui nous a permis d'étudier et de publier ici cet objet. Son accueil au Musée Archéologique de Volos restera pour chacun d'entre nous le meilleur souvenir de cette collaboration. Abréviations bibliographiques : Arvanitopoulos 1928 = A. S. Arvanitopoulos, Γραπται
στήλαι Δημητριάδος-Παγασών, Bibliothèque de la Soc. Arch. d'Athènes 23 (1928).
Besques 1972 = S. Besques, Musée national du Louvre. Figurines et reliefs : III, époques hellénistique et romaine, Grèce et Asie Mineure (1972).
Besques 1986 = S. Besques, Musée national du Louvre. Figurines et reliefs : IV-1, époques hellénistique et romaine, Italie méridionale, Sicile, Sardaigne (1986).
BESQUES 1992 = S. BESQUES, Musée national du Louvre. Figurines et reliefs : IV-2, époques hellénistique et romaine, Cyrénaïque, Egypte ptolémaïque et romaine, Afrique du Nord et Proche-Orient (1972).
Edgar 1903 = M. C. C. Edgar, Greek Moulds. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire (1903).
Hornung-Bertemes 1997 = K. Hornung-Bertemes, «Die sogenannten "Kausia"-Darstellungen aus Demetrias (Thessalien) » dans Moulage 1997, p. 181-206.
Jeanlin 1993 = M. Jeanlin, «La fabrication des figurines», dans Les figurines en terre cuite gallo-romaines,
ments d'Archéologie Française 38 (1993), p. 96-102. Kassab Tezgôr, abd el fattah 1997 = D. kassab tezgôr,
A. Abd el Fattah, « La diffusion des Tanagréennes à l'époque hellénistique: à propos de quelques moules alexandrins», dans Moulage 1997, p. 353-374.
Moulage 1997 = A. Muller (éd.), Le moulage en terre cuite dans l'Antiquité. Création et production dérivée, fabrication et diffusion. Actes du XVIIIe Colloque du CRA-Lille 3, déc. 1995 (1997).
Muller 1996 = A. Muller, Les terres cuites votives du Thesmophorion, ÉtThas XVII (1996).
MULLER 1997 = A. MULLER, « Description et analyse des productions moulées», dans Moulage 1997, p. 437-463.
Nicholls 1995 = R. V. Nicholls, «The Stele-Goddess Workshop : Terracottas from Well U 13:1 in the Athenian Agora», Hesperia 64 (1995), p. 405-492.
SCHMIDT 1994 = E. Schmidt, Martin-von-Wagner-Museum der Universitât Wûrzburg. Katalog der Antiken Terrakotten (1994).
Stâhlin, Meyer, heidner 1934 = F. Stâhlin, e. Meyer, A. Heidner, Pagasai und Demetrias. Beschreibung der Reste und Stadtgeschichte (1934).
Stillwell 1948 = A. N. Stillwell, The Potters' Quarter, Corinth XV/1 (1948).
Vertet 1983 = H. Vertet, Recherches sur les techniques de fabrication des lampes en terre cuite du Centre de la Gaule (1983).
BCH122 (1998)
92 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
1. Contexte de h trouvailk
La figurine a été recueillie lors des fouilles que A. S. Arvanitopoulos a menées de 1905 à 1912, pour le compte de la Société archéologique, aux abords du rempart Sud de la ville de Démétrias, à peu près en face de la troisième porte à partir de l'Est2. Le fouilleur a trouvé à cet endroit un certain nombre de vestiges, qu'il pense être ceux d'un sanctuaire3, en particulier de petites fosses remplies de matériel votif: figurines de terre cuite, quelques petites statues de marbre, vases, lampes, autels miniatures en terre cuite et en pierre, dont l'un avec une dédicace à Pasikrata, ainsi qu'une autre dédicace de « Boubalis à Pasikrata »4. L'ensemble de ce mobilier permet de conclure à une fréquentation du sanctuaire aux IIIe et IIe s. av. J.-C. surtout ; elle se serait prolongée durant l'époque romaine5.
Le seul reste architectural attribué un moment par le fouilleur au sanctuaire, un stylobate, appartiendrait en fait à un monument funéraire6. En effet, toute cette région était surtout occupée par une des nécropoles de Démétrias, celle d'où proviennent les fameuses stèles peintes du Musée de Volos. Les hésitations du fouilleur sur l'emplacement exact du sanctuaire et sa limite par rapport à la nécropole7, l'imprécision des données de fouille et les aléas de la conservation des trouvailles invitent à ne pas exclure que mobilier votif et mobilier funéraire aient pu être mélangés : il convient donc de rester réservé sur la nature du contexte de notre figurine8.
À en juger d'après les photographies d'ensemble des trouvailles, où dominent les types iconographiques de la femme debout drapée et du garçon à la kausia9, ces fouilles d'Arvanitopoulos ont livré vraisemblablement une grande partie des figurines de terre cuite recueillies à Démétrias même et à proximité immédiate, et certainement les mieux conservées d'entre elles10.
2 Sur ces fouilles, voir A. S. Arvanitopoulos, Prakt 1912, p. 198-209 et Prakt 1920, p. 21-25, et ARVANITOPOULOS 1928, p. 42-48. 3 Sur ce sanctuaire, voir Arvanitopoulos 1928, p. 42-48 et Stâhlin, Meyer, Heidner 1934, p. 123 et 165. 4 II s'agit sans doute d'une épiclèse d'Aphrodite (Arvanitopoulos 1928, p. 23), peut-être liée à un sanctuaire d'(Artémis) Enodia, connue par une dédicace de Démétrias : Stâhlin, Meyer, Heidner 1934, p. 188. 5 Sur la datation : Arvanitopoulos 1928, p. 44 et Stâhlin, Meyer, heidner 1934, p. 204. 6 ARVANITOPOULOS 1928, p. 45; STÂHLIN, MEYER, HEIDNER 1934, p. 123. 7 ARVANITOPOULOS 1928, p. 23-24. 8 HORNUNG-BERTEMES 1997, p. 186.
9 ARVANITOPOULOS 1928, p. 46-47, fig. 52-57. Notre figurine M 2004 = TK 378 se trouve fig. 55, rangée supérieure, 3e objet à partir de la gauche. 10 K. Hornung-Bertemes prépare actuellement, dans le cadre d'une thèse de doctorat, l'étude et la publication de ce corpus de quelque 400 figurines et fragments conservés au Musée archéologique de Volos. Ces objets se répartissent de la façon suivante: fouilles anciennes à Démétrias: 140 pièces; fouilles allemandes de Démétrias (1972- 1976) : 156 pièces ; trouvailles provenant d'autres sites de la région (Pharsale en particulier) ou d'origine inconnue: 100 pièces. Le sigle TK 000 renvoie aux numéros de ce catalogue. Pour une première contribution à la connaissance de la coroplathie de Démétrias, voir Hornung- BERTEMES 1997.
BCH122 (1998)
Illustration non autorisée à la diffusion Illustration non autorisée à la diffusion
A PROPOS D'UNE < FIGURINE-PATRICE » DU MUSÉE DE VOLOS
2. La statuette Volos inv. M 2004 (TK378)
La statuette est intacte, d'assez petite taille11. La partie figurée est entourée d'un bandeau périphérique en saillie sur tout le pourtour ; il confère à la figurine une largeur inhabituelle et un profil disproportionné, qui montrent à l'évidence qu'il n'appartient pas à la représentation. De fait, il n'a qu'une raison d'être technique : aussi en faisons-nous abstraction dans le premier temps de la description (fig. 1-2)12.
_^T · * 2$*.??
Fig. 1. Figurine Volos M 2004 (TK 378) : face, arrière (Clichés D. Kassab Tezgôr).
Fig. 2. Figurine Volos M 2004 (TK 378) : profils droit et gauche (Clichés D. Kassab Tezgôr).
11 Dimensions maximales, bandeau compris: haut.: 17,9 cm; larg. : de 6,1 cm aux épaules à 5,6 à mi-hauteur; larg. du profil à mi-hauteur: 4,6 cm. Dimensions de la partie figurée seule, sans le bandeau: haut, de la figure: 17,1 cm avec la base ; 15,1 cm sans la base ; larg. aux épaules : 3,9 cm (avers) et 4 cm (revers) ; larg. au bas du chiton : 4,5 cm (avers) et 4,3 cm (revers) ; larg. du profil à mi-
hauteur: ± 3,6 cm; haut, de la base: 2 cm; larg. de la base : 5,3 cm (avers). Dimensions du bandeau périphérique : projection de 0,6 à 1,6 cm ; ép. de 0,8 à 1,2 cm. 12 Le vocabulaire technique est utilisé conformément au lexique Muller 1997 proposé à la suite du colloque de Lille (Moulage 1997).
BCH122 (1998)
94 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
2.1. Description, parallèles, datation
La figurine représente une femme debout drapée, placée sur une base rectangulaire. Elle prend appui sur sa jambe gauche ; la droite est libre, le genou saillant, le pied placé en arrière et un peu sur le côté. Le bras droit est ramené en travers de la poitrine, tandis que le gauche, fléchi, est serré contre le flanc, l'avant-bras contre la taille. La tête est légèrement tournée vers la droite. L'ensemble du corps est bien proportionné et d'allure plutôt élancée. Il est drapé d'un chiton, dont on ne voit que le plissé vertical, fin et serré, au bas des jambes, et d'un lourd himation qui cache tout le reste du corps. Posé sur l'épaule et le bras gauche, il recouvre tout l'arrière, remontant en voile jusque sur la tête13 ; il est ramené autour du flanc droit vers l'avant, avec son bord supérieur massé en un bourrelet d'étoffe qui traverse le torse depuis l'épaule droite pour retomber par-dessus le poignet gauche, en une étroite chute de plis le long de la cuisse. L'étoffe de l'hima- tion est traitée en larges pans presque lisses qui s'opposent à plusieurs faisceaux de longs plis en arête, tous logiquement déterminés par les saillies du corps et les points de retenue de l'étoffe. Seul fait problème le long pli vertical qui tombe dans le dos depuis l'épaule gauche : on rencontre une telle chute, plus volumineuse il est vrai, lorsque le manteau est rejeté par-dessus l'épaule14, ce qui n'est pas le cas ici. Peut-être ce pli est-il simplement provoqué par le geste de la main droite, qui retient et tire l'étoffe sur l'épaule gauche ? Ou alors faut-il imaginer qu'à une génération antérieure, on a adapté à l'avers le revers d'un autre type, créant ainsi le prototype secondaire dont dérive notre statuette ? La base, peu élevée et de forme plutôt irrégulière, présente une moulure à ses bords supérieur et inférieur.
Ce type iconographique et cet agencement du drapé sont tout à fait banals: le petit monde des tanagréennes offre de nombreux parallèles parfois assez proches, en Béotie15 ou parmi d'autres figurines de Démétrias16. Notre figurine se distingue cependant par sa construction plus rectangulaire et frontale, alors que les tanagréennes s'élargissent plus souplement vers le bas, ainsi que par l'organisation de son drapé : le triangle de l'himation sur le buste, comme posé sur une base horizontale et délimité par un bord oblique doublement incurvé, et surtout le plissé en V sur la région abdominale17 sont originaux par rapport aux types iconographiques similaires. On peut supposer que nous avons affaire à une statuette dont l'archétype, sans doute attique ou béotien, nous reste inconnu par ailleurs. En tout cas, le type de la femme drapée de Volos relève bien de cette koinè tanagréenne de la fin du IVe et du IIIe s. av. J.-G, période à l'intérieur de laquelle il
13 La médiocrité du rendu ne permet pas d'exclure que ce allant du dernier quart du IVe au milieu du IIIe s. av. J.-C. qui ressemble, surtout à l'avers, à un himation serré en 16 Musée de Volos: TK 22, 119, 120: le plissé du chiton voile sur la tête soit en fait une masse de cheveux non de ces figurines fragmentaires n'a cependant pas la même détaillée. Au revers, on pourrait alors reconnaître un volumi- finesse. Objets inédits, neux chignon. 17 On trouve cependant cette organisation du drapé sur la 14 Entre autres nombreux exemples, voir Besques 1972, zone abdominale dans la grande plastique funéraire : voir par D 51 et D 54, pi. 12 c et d; D 58, pi. 13 d; D 74, pi. 17 b, exemple le marbre Athènes, Mus. Nat. n° 3622, copie etc. Malheureusement, les revers sont rarement illustrés. romaine d'un original grec de ca 300 av. J.-C. (illustré 15 Voir en particulier les figurines BESQUES 1972, D 60 à R. A. HlGGlNS, Tanagra and the Figurines [1986], p. 129, D 67, p. 16-17 et pi. 14-15: Béotie, datations proposées fig. 153).
BCH122 (1998)
A PROPOS D'UNE «FIGURINE-PATRICE» DU MUSÉE DE VOLOS 95
est prudent à l'heure actuelle de renoncer à proposer des datations. Quant à celle de l'exemplaire Volos M 2004, le contexte de la trouvaille ne peut hélas guère donner qu'un vague terminus post quem, celui de la fondation de la capitale de Magnésie, Démétrias, en 293 av. J.-C.
2.2. Description technique
2.2.1. Caractéristiques de production
La statuette est moulée. Son raisonnement est des plus simples, puisqu'elle est tirée d'une pièce, tête, corps et base18, d'un seul moule bivalve, dont la valve de revers est aussi détaillée que celle de l'avers. La frontière entre les valves de ce moule ne s'inscrit pas dans un plan : elle forme, dans les vues de profil, une ligne en S très ouvert et, dans la vue du dessus, un arc très prononcé vers l'avant; cette frontière est matérialisée par le «bandeau périphérique» (fig. 2). Celui-ci est en fait constitué de deux épaisseurs, qui prolongent et entourent l'une l'avers de la figurine, l'autre le revers.
La petite taille de la figurine et la médiocre qualité de son rendu19 — le plissé du vêtement n'est pas d'une grande netteté, surtout au revers, et le visage ne présente quasiment aucun détail — montrent à l'évidence que les moules utilisés n'ont pas été pris sur un prototype : nous avons affaire à un surmoulage, d'une génération très vraisemblablement assez éloignée, que nous désignerons conventionnellement ici comme génération n.
2.2.2. Caractéristiques de facture
La terre utilisée est une pâte argileuse à grain fin, sans mica, mais avec d'assez nombreuses inclusions blanches de granulométrie irrégulière ; elle est un peu rugueuse au toucher. Elle a été déposée dans les valves du moule en une croûte plutôt épaisse20 : l'objet est relativement lourd. L'intérieur a été égalisé assez soigneusement, mais il subsiste quelques aspérités. La suture entre l'avers et le revers a été écrasée et lissée de l'intérieur, dans le bas de l'objet, sur la hauteur accessible au doigt, un peu plus haut à droite qu'à gauche. Sur le bord extérieur du bandeau périphérique, la jonction des deux parois a été égalisée à l'outil : mais elle se distingue encore à la partie supérieure de ce bandeau et à droite, à côté de la tête.
Après démoulage, le réparage a été des plus limités : un pli a été repris au revers, près de la fesse gauche, un trait a été gravé pour délimiter le bas du chiton de la base de la figurine, le bas
18 II n'y a aucun «abattis», terme de métier qui n'a ceperv tuti Romani Regni Sueciae 5, Opuscula Archaeologies 2 dant pas, en raison de ses connotations, la faveur de tous (1941), p. 1-28 et Muller 1996, p. 42-43. les signataires de cet article: voir Muller 1997, p. 448. 20 L'épaisseur des parois est difficilement mesurable; elle 19 Sur les indices qui trahissent les surmoulages: rapetis- varie apparemment de 0,5 à 0,8 cm; l'épaisseur du ban- sement et dégradation de la qualité, voir E. Jastrow, «Abfor- deau périphérique, de 0,8 à 1,2 cm, correspond à peu près mung und Typenwandel in der antiken Tonplastik», Acta Insti- à l'épaisseur des croûtes d'avers et de revers réunies.
BCH122 (1998)
96 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
de la base a été égalisé. Mais les déformations accidentelles, sur la joue droite, à l'angle supérieur droit de la base, au bas de la chute de plis de l'himation au revers, n'ont pas été corrigées. Enfin, un petit trou de suspension a été percé juste au-dessus de la tête, à travers le bandeau périphérique. Il faut surtout signaler l'absence de l'ouverture découpée au revers de la plupart des figurines hellénistiques : la simplicité du raisonnement et donc l'absence de parties à rapporter à la masse de l'œuvre la rendaient évidemment inutile comme fenêtre d'assemblage — encore qu'elle aurait permis de consolider la suture à l'intérieur jusque dans le haut de la statuette21 — , tandis que l'ouverture du bas suffisait pour assurer l'évent à la cuisson.
Celle-ci est de très bonne qualité, à température apparemment élevée et peut-être mal contrôlée si l'on en croit le début de vitrification au côté gauche, à hauteur des hanches. La terre a pris une couleur rouge orangé assez clair, ou rosâtre soutenu (MUNSELL 2.5 YR 6/8).
Une grande partie de l'épiderme est recouverte d'une pellicule ocre sale (surfaces claires sur les photographies). Il ne s'agit pas d'un engobe ni d'une couverte destinée à servir de support pour la peinture, mais de concrétions qui n'ont pas été retirées au nettoyage : l'intérieur de la statuette en est également tapissé. Il n'y a absolument aucune trace de polychromie.
2.2.3. Le bandeau périphénque
Épais de 1,2 cm sur les deux tiers supérieurs de la figurine, de 0,7 à 0,8 cm sur le tiers inférieur, le bandeau forme par rapport à la silhouette du personnage une projection au contour à peu près régulier, mais de largeur variable : elle est assez étroite en bas à droite (0,6 cm), plus large en bas à gauche (1,1 cm) et surtout tout autour de la moitié supérieure de la figurine (jusqu'à 1,6 cm) (fig. 1-2).
Un certain nombre d'irrégularités affecte les surfaces de ce bandeau, tant à l'avant qu'à l'arrière. À première vue, on pourrait croire que ces creux et bosses sont fortuits, et qu'ils résultent par exemple du serrage, entre les doigts de l'artisan, des deux croûtes constitutives du bandeau, au moment de la consolidation de l'assemblage.
En fait, un examen plus précis montre que ces irrégularités se répondent de façon précise de l'avant à l'arrière du bandeau : aux reliefs d'une face correspondent en volume, dimensions et emplacement des creux sur l'autre (fig. 3-4). C'est particulièrement net de part et d'autre de la tête : à droite, une bosse allongée la à l'avant répond à un creux lb à l'arrière, tandis qu'à gauche, deux petites bosses 2a à l'avant répondent à deux faibles creux 2b à l'arrière. De même, au côté droit, juste sous le coude, une bosse étroite et allongée 3a à l'avant répond à un creux allongé 3b à l'arrière ; enfin, de part et d'autre des genoux, aux bosses 5a et 6a à l'avant correspondent les creux 5 b et 6b à l'arrière. Seule la bosse de l'avant 4a à côté de la main reste sans symétrique à l'arrière. Le reste de la surface du bandeau n'est pas parfaitement lisse.
21 Sur l'utilisation, à Thasos en particulier, de « trous masse de l'œuvre, voir MULLER 1996, p. 38-39 et p. 40. d'évent» pour l'assemblage des éléments rapportés à la
BCH122 (1998)
Illustration non autorisée à la diffusion Illustration non autorisée à la diffusion
A PROPOS D'UNE · FIGURINE-PATRICE· DU MUSÉE DE VOLOS 97
3a
5b 5a
Fig. 3. Figurine Volos M 2004 (TK 378) : détail des irrégularités du bandeau périphérique, face avant
(Cliché D. Kassab Tezgôr).
Fig. 4. Figurine Volos M 2004 (TK 378) : détail des irrégularités du bandeau périphérique, face arrière
(Cliché D. Kassab Tezgôr).
Il y a donc correspondance exacte entre les surfaces avant et arrière du bandeau, qui se répondent en relief et en creux. Il est évident que le bandeau a en fait pris en négatif sur ses deux faces l'empreinte des bords de chacune des deux valves du moule d'où est tirée la statuette, et plus précisément celle des ensembles clef-contreclef qui assuraient leur mise en regard précise : apparaît ainsi sur la face arrière du bandeau l'empreinte en creux des clefs (qui étaient en relief sur les bords de la valve de revers du moule) et sur la face avant du bandeau l'empreinte en relief des contreclefs (qui étaient en creux sur les bords de la valve d'avers du moule). Autrement dit, l'artisan a, pour fabriquer cet exemplaire exceptionnel, tapissé d'argile les creux des deux valves en recouvrant aussi leurs bords respectifs22 au lieu de les réserver, comme dans la fabrication des figurines normales, pour lesquelles le moule doit être fermé avec les valves bien jointives (fig. 5).
22 La très grande majorité des moulages modernes tirés de moules antiques dont une seule valve est parvenue constituent un excellent parallèle à cette façon de faire : on prend en général l'empreinte en débordant du creux figuré sur le bord non figuré, ce qui donne l'impression d'un relief (voir
par exemple : Besques 1986, D 3912, pi. 100). On ne procède en revanche jamais ainsi lorsque les deux valves du moule sont parvenues (voir par exemple Besques 1972, D 221, pi. 49, a et b, ou M 1978, p. 419, fig. 11-13).
BCH122 (1998)
98 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
3. Destination-utilisation de VobsM2004 : «une figurine-patrice»
3.1. Une figurine-patrice
L'artisan qui a fabriqué cette statuette en utilisant son moule de façon aussi inhabituelle ne la destinait évidemment pas à être un simple ex-voto dans un sanctuaire ou à accompagner un défunt dans sa tombe. En réalité, le bandeau périphérique, mais aussi la solidité de l'objet, due à l'épaisseur des parois et à la qualité de la cuisson, ainsi que l'absence de fenêtre au revers qui permet de préserver l'intégralité du dos, permettent d'y reconnaître avec certitude une figurine- patrice23, c'est-à-dire une figurine réalisée de telle sorte qu'elle puisse facilement servir à son tour à la fabrication de nouveaux moules, plus précisément des surmoules. En effet, le bandeau permet de supprimer ici les deux difficultés de la prise d'une empreinte bivalve, celle de la délimitation des deux valves du moule et celle de l'adaptation de leurs bords respectifs de façon à ce qu'ils soient aussi jointifs que possible, moule fermé : la saillie du bandeau par rapport à la partie figurée matérialise la frontière entre les deux valves, et ses surfaces qui se répondent se reproduisent en négatif sur les bords de ces valves.
Les deux valves du surmoule peuvent donc être faites en deux fois ou en même temps ; mais elles sont matériellement séparées dès le début de l'opération. Celle-ci peut bien sûr être répétée pour la réalisation d'autant de surmoules que l'on désire, d'où l'on tirera des figurines de génération n + 1, surmoulages de Volos M 2004 et évidemment plus petits (fig. 6).
De l'abondante production potentielle de figurines de ce type, il ne nous est cependant parvenu aucun exemplaire : il n'y a dans le corpus étudié au Musée de Volos24 aucune figurine ni aucun fragment que l'on puisse rattacher à cette série, en particulier rien qui atteste la présence, que l'on pouvait espérer, d'exemplaires « normaux » de la même génération n que Volos M 2004, ou de l'éventuelle génération n + 1 qui en dérive. La figurine-patrice de Volos est donc le seul représentant connu à ce jour d'une série qui peut être illustrée par le schéma de filiation théorique de la fig. 7.
3.2. Un mode de diffusion des produits moulés
Quelle était donc la raison de fabriquer une figurine-patrice destinée à créer une nouvelle génération de moules, alors que le moule dont elle est issue était encore utilisable ? C'est peut-être une façon pour le coroplathe de constituer les « archives » de l'atelier : il se réservait avec la figurine-patrice la possibilité de remplacer son moule n, en cas de perte ou de bris, par un surmoule
23 Sur cette expression, voir Muller 1996, p. 520, et type» de Nicholls 1995, p. 411, n. 19. Muller 1997, p. 452, s.v. «réplique-patrice». Il s'agit de la 24 Voir ci-dessus, n. 10. «Zwischenpatrize» des Allemands ou du «secondary arche-
BCH122 (1998)
Illustration non autorisée à la diffusion
Illustration non autorisée à la diffusion
À PROPOS D'UNE «FIGURINEPATRICE» DU MUSÉE DE VOLOS 99
avers
Flg. 5. Utilisation du moule de génération n: a) pour la fabrication de figurines normales; b) pour la fabrication de la figurine- patrice Volos M 2004 (coupes schématiques dans un plan perpendiculaire au moule et aux figurines ; gris sombre : terre
cuite ; gris clair: terre crue) (dessin J.-S. Roose et V. Anagnostopoulos).
avers
Flg. β. a) Fabrication du moule de génération n + 1 ; b) utilisation de celui-ci pour la fabrication de figurines n + 1 (coupes schématiques dans un plan perpendiculaire au moule et aux figurines ; gris sombre : terre cuite ; gris clair: terre crue)
(dessin J.-S. Roose et V. Anagnostopoulos).
n + 1, certes de qualité et de dimensions inférieures. Ou bien la figurine-patrice pouvait servir à multiplier les moules en vue d'une fabrication plus abondante. Mais dans l'une et l'autre hypothèse, il faut supposer que l'artisan ne possédait qu'un seul exemplaire du moule n, sans la possibilité d'en faire d'autres de même génération en remontant au positif de la génération n — 1 antérieure. La figurine-patrice Volos M 2004 pourrait ainsi illustrer le phénomène du surmoulage interne25.
25 Sur les notions de surmoulage interne et externe, voir MULLER 1996, p. 44-45 et MULLER 1997, p. 455.
BCH 122 (1998)
100 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
ARCHÉTYPE
PROTOTYPE
Moule I
Ι Π Γ Figurines I...
Ί I I I I
[ X générations ]
Moule n I
I I I I I I Figurines η Figurine patrice
Volos M 2004
Moule n+1 a Moule n+lb
Γ I Figurines n+1 a Ι Γ Figurines n+1 b
Moule n+1 c
I I I I Figurines n+1 c
Fig. 7. Place de Volos M 2004 dans le schéma de filiation du type.
BCH122 (1998)
A PROPOS D'UNE « FIGURINE-PATRICE» DU MUSÉE DE VOLOS 101
Mais plus vraisemblablement, la figurine-patrice était destinée à un autre atelier qui allait fabriquer lui-même son (ou ses) surmoules : c'est donc un mode supplémentaire de commercialisation et de diffusion dans le domaine de la coroplathie. On savait en effet qu'elles se faisaient soit par le commerce des produits finis, les figurines, que n'importe quel artisan céramiste pouvait éventuellement surmouler pour en fabriquer à son tour — c'est le phénomène du surmoulage externe26 — soit par le commerce des outils de production eux-mêmes, les moules, ceux-ci pouvant être multipliés à chaque génération et l'atelier créateur gardant toujours au moins un moule de référence27. La figurine-patrice de Volos atteste la possibilité d'une autre forme de commerce et de diffusion, par le biais d'un objet au statut hybride : ni produit, ni outil de production, mais produit modifié pour faciliter la réalisation de nouveaux outils de production. Le fabricant de la figurine-patrice laisse à l'acquéreur le soin de fabriquer lui-même son ou ses propres surmoules, opération que facilitent les caractéristiques de l'objet. On se trouve donc dans une situation qui tient à la fois du surmoulage interne et du surmoulage externe, puisque c'est l'atelier d'origine, fabriquant la génération n, qui met lui-même en place les conditions d'une production dérivée de figurines η + 1 dans un atelier extérieur. Le surmoulage n'était pas dans ce cas un acte de « piraterie » ou de « contrefaçon » — pour reprendre des notions modernes qui de toute façon ne peuvent avoir cours dans l'Antiquité, puisqu'elle ignorait la notion de propriété artistique — , mais une véritable pratique commerciale.
3.3. Documents parallèles
On peut rapprocher de la figurine-patrice de Volos quelques autres objets aux caractéristiques techniques comparables :
— Musée archéobgique de Volos, inv. M 2002 (= TK 388) (fig. δ)28: statuette tirée d'un moule simple qui comportait la tête et la base, sans revers, complète (haut. : 23,5 cm), représentant une femme debout drapée, un petit enfant sur l'épaule (Aphrodite et Éros?). La partie figurée est entourée là aussi d'un bandeau29 à peu près lisse, sans trace de clef, percé en haut d'un trou de suspension. La qualité de la cuisson et les caractéristiques de la terre, l'absence de tout reste de couverte et de polychromie sont identiques à celles de M 2004. On a sans doute affaire à une autre figurine-patrice, qu'il est bien sûr tentant d'attribuer au même atelier. Mais cet objet n'a jamais eu de revers : existait-il une autre demi-figurine
26 Les attestations de cette pratique sont nombreuses : voir Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 1983, 2 par exemple Muller 1996, p. 118, 197, 208 des exemples (1988), p. 20-24. de séries où interviennent en même temps ou successive- 28 Même provenance que la figurine-patrice M 2004 (TK ment le surmoulage externe et interne. 378) étudiée plus haut. Objet inédit, simplement signalé 27 Sur ce moule de référence ou «moule-mère», voir Kassab Arvanitopoulos 1928, p. 47, et fig. 54 (objet au milieu de la Tezgôr, Abd el Fattah 1997, p. 359-360. Pour des deuxième rangée). Aucun autre objet du Musée de Volos ne exemples d'exportation de moules, voir S. Besques, « Le peut être attribué à la même série. commerce des figurines de terre cuite au IVe s. av. J.-C. entre 29 On pourrait penser qu'il s'agit d'un voile qui nimbe la les ateliers ioniens et attiques», dans Proceedings of the déesse, comme par exemple sur les protomés D. lazaridis, Xth International Congress of Classical Archaeology, Ankara Πήλινα ειδώλια Αβδήρων (1960), A 32, Β 58 et B 59, 1973 (1978), p. 617-626, ainsi que « Quelques problèmes p. 29-30 et pi. 15. Mais la position du bras gauche et l'ab- concernant les transferts de thèmes dans la coroplathie du sence de tout plissé sur les côtés de ce bandeau nous monde méditerranéen », dans Πρακτικά του XII Διεθνούς paraissent écarter cette interprétation.
BCH 122 (1998)
Illustration non autorisée à la diffusion
102 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
Fig. 8. Figurine Volos M 2002 (TK 388) (Cliché Κ. Hornung-
Bertemes).
patrice, séparée, pour prendre des surmoules du revers ? ou bien les figurines de ce type recevaient-elles un revers simplement modelé ? ou encore les laissait-on sans revers et étaient-elles destinées à être suspendues ? — Wiirzburg, Martin-von-Wagner-Museum, inv. H 5001 d30 : revers d'un personnage féminin debout, bras gauche levé. La partie figurée est entourée d'un large bandeau avec quatre contredefs. L'auteur de la publication de cet objet, qu'il date du Ve ou du IVe s. av. J.-C, en a bien vu l'intérêt et la destination : il s'agit d'un demi-positif destiné à la prise d'une valve de revers de moule31 en une seule opération avec ses clefs qui devaient s'emboîter dans les contredefs de la valve d'avers réalisée de la même façon. Mais il n'en a pas précisé la technique de fabrication ni le statut dans la série : il s'agit vraisemblablement d'un moulage et donc d'une figurine-patrice, plutôt que d'un modelage et donc d'un prototype. D'autre part, la description ne permet pas de savoir si l'objet est intact, auquel cas il faut restituer un autre demi-positif indépendant pour l'avers, ou si l'avers de l'objet est simplement décollé et perdu, auquel cas on aurait l'équivalent strict de la figurine-patrice de Volos. — Athènes, Musée de l'Agora, inv. Τ 4147 et Τ 41 48 32: deux fragments d'un prototype33 de figurine du début du style riche (fin du V^IV6 s.) : le corps modelé d'un personnage féminin, dont la tête a été coupée pour une prise d'empreinte séparée, est appliqué contre une plaque lisse. Celle-ci joue le même rôle de délimitation du moule à prendre que le bandeau des exemples de Volos et de Wiirzburg. Il s'agit ici d'un prototype pour la fabrication de moules de première génération. On remarquera qu'il est creux (contrairement à l'idée que l'on se fait généralement des prototypes) et cuit : il a pu éventuellement servir à la prise de plusieurs moules parallèles.
4. La fabrication des moules de terre cuite
Si le détail des procédés du moulage, c'est-à-dire de l'opération qui consiste à tirer des figurines d'un moule, est assez bien connu désormais, la fabrication des moules eux-mêmes, et plus précisément la prise de l'empreinte sur un positif (quel que soit son statut : prototype pour la fabrication de moules de première génération, figurine dans le cas d'un surmoulage), fait encore difficulté dans le cas de la réalisation d'un moule bivalve. Le problème est de savoir comment on procédait à la délimitation des deux valves tout en obtenant une jonction parfaite de celles-ci sur toute la surface de leurs bords. La figurine-patrice de Volos et les documents réunis ci-dessus permettent de suggérer des solutions.
30 SCHMIDT 1994, n° 353, p. 207, pi. 67. 31 SCHMIDT 1994, p. 17.
32 NICHOLLS 1995, n° 3, p. 407, 477 et pi. 110. 33 «Archetype» dans le vocabulaire de NICHOLLS 1995, p. 407.
BCH122 (1998)
A PROPOS D'UNE « FIGURINE-PATRICE .DU MUSÉE DE VOLOS 103
4.1. La prise d'une empreinte bivalve
4. 1. 1. L· découpage dit «àL· grecque » H
Les hypothèses traditionnellement proposées reposent sur le principe de la séparation de deux valves réalisées en une seule opération. Le positif, préalablement débarrassé de toutes ses parties en projection, dont l'empreinte sera prise séparément, est enveloppé entièrement dans une chape d'argile, feuilletée ou non, qui en prend l'empreinte. L'artisan ouvre ensuite cette chape en deux, soit en la découpant avec une lame, soit en tirant sur un fil préalablement posé sur le contour du positiP5. On a pu effectivement quelquefois pratiquer de la sorte, pour des formes simples, comme des lampes36 ; mais dès qu elles étaient complexes, les difficultés pratiques d'un découpage à l'aveuglette avec une lame37, ou avec une ficelle difficile à maîtriser, devaient nuire à la nécessaire précision de la frontière entre les valves, qui doit strictement suivre la ligne de dépouille du positif, celle qui sépare le futur avers du revers38.
Surtout, l'observation des bords de nombreuses valves de moules39 montre bien que ce n'est pas ainsi que l'on procédait. Ces bords ne présentent jamais des traces que l'on pourrait identifier comme celles d'un découpage à la lame ou au fil40, mais ont presque toujours un aspect qui semble résulter d'un travail de pressage. Ils sont parfois lisses et à peu près plans, mais présentent le plus souvent des irrégularités diverses, dépressions et bosses plus ou moins marquées, changements d'inclinaison. Surtout, lorsque les deux valves d'un moule sont parvenues, on voit que ces irrégularités se répondent exactement d'une valve à l'autre en positif et négatif, ce qui ne saurait être le cas s'il s'agissait de retouches ou déformations postérieures au découpage et à la séparation des valves. Enfin, dans le cas de valves réalisées par la superposition de plusieurs croûtes, on ne retrouve pas le même feuilletage en coupe sur les parties en regard des bords des deux valves, ce qui devrait évidemment être le cas si celles-ci étaient obtenues par découpage d'une seule enveloppe d'argile41.
34 Expression reprise par M. Franc, dans son annexe à de l'Éphorie des Antiquités de Nauplie, qui m'a généreuse- Jeanlin 1993, p. 103, mais dont nous ignorons l'origine... ment montré les très nombreux moules d'Argos qu'elle est 35 B. Neutsch, «Studien zur vortanagrâisch-attischen Koro- chargée de publier et m'a autorisé à faire ici état de plastik», JDAI Ergënzungsheft 17 (1952), p. 4; S. BESQUES, quelques observations que j'avais faites (sur cet ensemble, Les terres cuites grecques (1963), p. 22 et encore Muller voir A. Ban aka-Di maki, «La coroplathie d'Argos. Données 1996, p. 32; M.-T. Baudry, D. Bozo, La sculpture. Méthode nouvelles sur les ateliers d'époque hellénistique», dans et vocabulaire (1978), p. 106-107, décrit le procédé du Moulage 1997). J'ai pu confirmer ces observations sur les découpage au fil utilisé aujourd'hui pour la réalisation de quelques moules du Musée de Délos (voir A. Laumonier, moules à creux perdu en plâtre. Les figurines de terre cuite, EAD XXIII [1956]) et surtout 36 Voir Vertet 1983, p. 43-45. ceux, originaires de Tarente, du Musée d'Art et d'Histoire 37 Les lignes gravées sur les contours des prototypes de de Genève, que m'a fait connaître Chantai Courtois et dont figurines gallo-romaines devaient, selon certains, guider la Jacques Chamay m'a autorisé à parachever la publication lame; mais Jeanlin 1993, p. 97, fait très justement remar- (voir: W. DEONNA, MonPiot 30 [1929], p. 45-60; L'Acropole quer qu'elles sont souvent discontinues («en pointillé») et 1930, p. 108-117; GenavaS, [1930], p. 67-74). [A. Muller]. ne peuvent donc servir de cette façon. 40 Voir cependant ci-dessous, n. 52. 38 Voir Jeanlin 1993, p. 93, et surtout l'annexe de 41 Au Musée d'Argos, exemple d'un moule dont une valve M. Franc, p. 103. est faite d'une seule épaisseur, l'autre de trois croûtes 39 En particulier moules d'Argos, de Délos et de Tarente. superposées. Mes plus vifs remerciements vont à Anna Banaka-Dimaki,
BCH122 (1998)
104 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
4. 1.2. Prise d'empreinte bivalve sur positif destiné à cette opération
La figurine-patrice de Volos et les documents que nous en avons rapprochés montrent au contraire que l'on pouvait beaucoup plus facilement délimiter les deux valves en les fabriquant indépendamment : il suffit pour cela que le positif dont on veut prendre l'empreinte comporte déjà lui-même la limite entre les valves, matérialisée sous forme d'un bandeau périphérique ou d'une plaque, contre lesquels on peut tasser la pâte de la future valve. Ce procédé pouvait donc être mis en oeuvre dans les cas où l'on prenait le moule sur un positif spécialement fabriqué dans ce but:
— un prototype de relief, collé sur une plaque lisse, ou peut-être même un prototype de ronde-bosse, coupé en deux moitiés collées chacune sur une plaque lisse (exemple d'Athènes) ou de part et d'autre d'une même plaque, pour la prise de moules de première génération ;
— une figurine-patrice moulée avec bandeau périphérique reproduisant les surfaces des bords des valves du moule de génération n, pour la prise de surmoules de génération n + 1. L'avers et le revers de cette figurine-patrice pouvaient rester séparés (peut-être exemples de Wiirz- burg et de Volos M 2002) ou être réunis (exemple de Volos M 2004).
Dans les deux situations — peu fréquentes s'il faut en croire le nombre d'exemples reconnus jusqu'à présent — , les valves obtenues étaient parfaitement jointives sur toute la surface de leurs bords.
4.1.3. Prise d'empreinte bivalve sur positif non destiné à cette opération
Restent cependant les cas, nombreux, où le prototype a des formes trop complexes pour pouvoir être simplement coupé en deux suivant la ligne de dépouille et ceux où l'on prend un surmoule sur une figurine qui n'a pas été spécialement fabriquée dans ce but et sans doute simplement acquise dans le commerce (cas du surmoulage externe)42. Il est vraisemblable que dans ces situations aussi on devait réaliser séparément les valves du moule, mais selon un procédé qui réclamait un peu plus de savoir-faire, analogue dans son principe à celui de la fabrication de moules en plâtre43. La première étape au moins a déjà été décrite pour la coroplathie gallo- romaine44 :
— on recouvre une seule face du positif d'une épaisse croûte de terre éventuellement feuilletée, que l'on presse soigneusement pour lui en faire prendre l'empreinte. On la bordure
42 Ces surmoules pris sur des figurines «normales», se fenêtre, et encore le font-ils imparfaitement: un exemple reconnaissent souvent au fait que la valve de revers a pris signalé Muller 1996, p. 44, n. 82, un autre à Argos. En l'empreinte de leur fenêtre découpée au revers (trou d'as- revanche, on ne découpait sans doute pas de fenêtre au semblage et/ou d'évent): aux exemples mentionnés Muller revers d'une figurine moulée fabriquée pour servir de 1996, p. 44, n. 81, on peut ajouter Besques 1972, D 1385, patrice, comme Volos M 2004 : ci-dessus, p. 96. p. 189 et pi. 268 a et b, et plusieurs cas parmi les moules 43 EDGAR 1903, p. XV. Voir aussi Vertet 1983, p. 36. d'Argos (voir ci-dessus, n. 39) ; les artisans ne prennent que 44 M. Franc, annexe à Jeanlin 1993, p. 103. rarement la peine d'oblitérer dans le moule la trace de cette
BCH122 (1998)
À PROPOS D'UNE « FIGURINE-PATRICE » DU MUSÉE DE VOLOS 105
ensuite, c'est-à-dire qu'on découpe ou tasse la terre le long de la ligne de dépouille, peut-être gravée sur le positif; le bord de la première valve est ainsi délimité45, et éventuellement garni de contreclefs ;
— dès que la terre de cette première valve est ressuyée, donc rigide, on recouvre la deuxième face du positif d'une croûte que l'on presse à la fois sur le positif et contre le bord de la première valve, préalablement enduit d'un produit isolant (huile, tout simplement?). Le bord de la deuxième valve prenait ainsi l'empreinte de celui de la première, avec le négatif de toutes ses irrégularités et donc les éventuelles clefs ; c'est à ce moment, valves réunies, que l'on devait égaliser le contour du moule et tracer sur les côtés les incisions-repères ;
— on pouvait alors séparer la première valve du positif, puis extraire celui-ci de la deuxième dès que la terre en était à son tour ressuyée, et en tout cas avant que le retrait dû au séchage ne rende l'opération difficile. Il ne restait plus qu'à laisser sécher et à cuire les deux valves du moule.
Les modalités de détail de cette suite d'opérations devaient varier suivant les habitudes de chaque artisan et aussi suivant la dimension des empreintes à prendre, qui pouvait imposer éventuellement la réalisation de chapes de consolidation. Il n'en reste pas moins que ce principe d'une réalisation des deux valves séparément mais avec les bords de l'une moulés sur ceux de l'autre, permet d'obtenir un moule bivalve aux bords parfaitement jointifs et de rendre compte de toutes les observations faites sur de nombreux objets.
4.2. L'assemblage des valves : clefs et contreclefs
Le bon ajustement des deux valves d'un moule était le plus souvent assuré tout simplement par la sinuosité de la frontière qui les séparait : elles venaient en quelque sorte s'emboîter dans la bonne position46 ; ce devait d'ailleurs être le cas pour le moule dont est tirée la figurine Volos M 2004. Le même effet était parfois obtenu par l'inclinaison prononcée et inversée des bords des deux valves47. Mais les moules sont souvent pourvus d'éléments supplémentaires, qui ne sont en fait indispensables que lorsque la frontière entre les valves s'inscrit à peu près dans un plan : lignes guides incisées avant cuisson sur le pourtour du moule fermé, en travers de la fron-
45 Selon M. Franc, ibid., la deuxième valve était réalisée grecque diffère manifestement. de la même façon, tout à fait indépendamment de la pre- 46 Voir un bel exemple Besques 1972, D 221, p. 40 et mière, les lignes incisées sur le positif (voir ci-dessus, pi. 49 a et b: ce moule de jeune garçon assis (Béotie, n. 37) servant à guider le bordurage dans les deux opéra- début du me s. av. J.-C.) n'a pas d'incision guide ; mais sa tions successives. C'est effectivement sans doute le cas valve de revers comporte le dessus de la tête et vient en dans la coroplathie gallo-romaine: en effet, d'une part les quelque sorte coiffer le haut de la valve d'avers. Nous moules gallo-romains n'ont qu'exceptionnellement des remercions Violaine Jeammet, conservatrice au Départe- valves parfaitement jointives et des repères d'assemblage; ment des Antiquités grecques et romaines du Louvre, pour d'autre part plusieurs indices suggèrent que l'on tirait les la description de ce moule qu'elle a eu l'obligeance de nous figurines des moules sans en réunir les deux valves : communiquer. Jeanlin 1993, p. 99. Sur ces deux points, la technique 47 Nicholls 1995, n° 13, p. 478 et pi. 104.
BCH122 (1998)
106 KARIN HORNUNG-BERTEMES, DOMINIQUE KASSAB TEZGÔR ET ARTHUR MULLER
tière entre les deux valves, qui en assurent la mise en regard parfaite48, et clefs sur les bords qui calent les valves dans la bonne position l'une par rapport à l'autre49. La figurine-patrice de Volos donne — indirectement certes — une attestation supplémentaire de ce dernier procédé et surtout un jalon dans le perfectionnement progressif de la technique des mouleurs.
La moindre irrégularité — bosse ou creux — sur le bord d'une valve de moule peut jouer le rôle d'une clef, pourvu qu'une autre irrégularité lui réponde, en négatif ou en positif selon les cas, sur la partie en regard de l'autre valve. Aussi les premières clefs ont-elles pu être tout simplement accidentelles, comme de profondes empreintes digitales en cuvettes, reproduites en bosses sur l'autre valve lorsque celle-ci a été pressée sur la première50. On a ensuite pratiqué le procédé de façon intentionnelle et de plus en plus systématique pour caler les valves dans la bonne position l'une par rapport à l'autre. Les sillons disposés assez régulièrement en arcs de cercle sur de rares valves de moules51 relèvent-ils de cette explication ? On ne peut en être sûr, dans la mesure où les valves qui devraient présenter les reliefs correspondants ne sont pas connues52.
En revanche, la figurine-patrice de Volos permet de reconstituer, pour le IIIe s. av. J.-C, un bel exemple d'ensemble de six clefs disposées de façon systématique, par paires, en haut de part et d'autre de la tête, au milieu de part et d'autre des coudes, et vers le bas de part et d'autre des genoux de la figurine : ces emplacements sont suggérés par le contour du personnage. À la génération attestée par Volos M 2004, ces clefs ont bien perdu de leur netteté : il faut certes faire la part de la dégradation inhérente au procédé du surmoulage, mais il n'est pas sûr pour autant que les creux et bosses observés dérivent de clefs au contour et au volume soigneusement délimités à l'origine. De telles clefs apparaissent sur d'autres documents : plusieurs valves de la collection de moules du Musée d'Argos53, d'époque hellénistique avancée, présentent ainsi de très nettes contreclefs triangulaires, d'environ 5 mm de côté et 2 mm de profondeur. Mais la forme de clef la plus courante est celle de la saillie en demi-sphère, avec la cuvette correspondante: elle est attestée par la figurine-patrice de Wiirzburg, dont il nous paraît falloir descendre la datation proposée au moins jusqu'à l'époque hellénistique, peut-être même avancée54.
48 Procédé bien connu, dès l'époque archaïque: Stillwell Besques 1972, D 221, pi. 49 a et b (ci-dessus, n. 46), pour- 1948, p. 83, et abondamment illustré : voir les quelques raient relever de cette explication. exemples mentionnés MULLER 1996, p. 32, n. 29. 51 Stillwell 1948, p. 83 : voir en particulier n° 21, p. 95 et 49 En revanche, les « languettes », « pastilles » (BESQUES pi. 32 (Corinthe, 2e moitié du Ve s. av. J.-C), n° 49, p. 103 et 1986, par ex. à propos de D 3906, p. 102 et pi. 98 c), pi. 36 (Corinthe, IVe s. av. J.-C); BESQUES 1972, D 1374, «pastillages» ou «proéminences d'argile» (W. Deonna, Mon- p. 187 et pi. 264 a (Smyrne, Hellénistique Récent). Piot 30 [1929], p. 47 et 52) et autres «clay tabs» (D. BURR- 52 Aussi ne peut-on tout à fait exclure que ces traces résul- Thompson, Hellenistic Pottery and Terracottas [1987], tent d'une séparation des valves au moyen d'un fil, chacun p. 206; B. M. KlNGSLEY, GMusJ 9 [1981], p. 43) très sou- des «sillons» se formant lors d'un à-coup de l'opération. vent présents — mais rarement signalés (par ex. Besques Mais peut-être plutôt qu'une succession de «sillons» bien 1986, D 3922 bis E: comparer la pi. 106 c et la p. 106) — marqués se formerait-il alors dans ces conditions de petits sur le bord de la face externe de valves de moules relèvent décrochements. d'une autre explication : ils interviennent, me semble-t-il, 53 Ci-dessus, n. 39. Observation faite uniquement sur des dans le processus de fabrication du moule, et ne sont pas moules de l'ensemble B. destinés à assurer la mise en regard des valves. Je revien- 54 Schmidt 1994, p. 207: «5.-4. Jh. v. Chr. (?)». Cet objet drai sur cette question à propos des moules du Musée d'Art évoque cependant plutôt des documents comme les Déméter- et d'Histoire de Genève (voir ci-dessus, n. 39). [A. Muller]. Isis d'Egypte, BESQUES 1992, D 4494 et 4495, D/E 4496 à 50 Les irrégularités (double cuvette et double bosse) qui se 4499, p. 103-104 et pi. 62-63, datées respectivement de la répondent au bord inférieur gauche des valves du moule « haute » et de la « basse » époque hellénistique.
BCH122 (1998)
A PROPOS D'UNE « RGURINEPATRtCE» DU MUSÉE DE VOLOS 107
Pour l'époque romaine, les exemples de moules bivalves avec des ensembles de clefs rondes sont plus nombreux. Les quelques exemples que nous mentionnons ici sont tous d'Asie Mineure55 :
— deux valves, l'une d'avers, l'autre de revers, mais appartenant à deux moules différents, de poupées de gladiateur à jambes articulées56, chacune avec quatre clefs passablement réduites, sans doute par des surmoulages successifs ;
— une valve d'avers de buste de femme ailée, avec quatre belles contredefs57 ; — deux pièces d'un moule de coq qui devait en comporter une troisième, plus petite; ces
deux valves principales ont huit clefs58 ; — un superbe moule de tête de taureau, avec cinq clefs59. Ce perfectionnement de l'ancrage des valves de moules en terre cuite à partir de l'époque
hellénistique pourrait bien avoir été inspiré par les belles clefs des moules en plâtre60 ou en pierre61, qui en étaient pourvus presque systématiquement, qu'ils aient servi à la fabrication d'objets et de figurines de terre cuite ou de métal (bronze ou plomb)62.
55 Le catalogue du Musée du Caire ne comporte que deux exemples de valves de moules en terre cuite avec des clefs : Edgar 1903, nos 32199 et 32311 ; tous deux sont de datation incertaine. Tous les autres sont en plâtre: voir ci- dessous n. 60. 56 BESQUES 1972, n° E/D 901 et E/D 902, p. 134 et pi. 168: «première moitié du Ier s. ap. J.-C. ». Selon S. Besques, ces valves appartiendraient à deux moules du même type, de deux générations successives : ce point demanderait à être vérifié, des différences dans le drapé (en particulier, E/D 901 avec une seule ceinture, alors que E/D 902 en a deux) pouvant signaler soit l'appartenance à deux types différents, soit l'appartenance au même type mais avec des modifications pratiquées sur la figurine- patrice intermédiaire. 57 BESQUES 1972, n° E/D 905, p. 134 et pi. 170 a: «Ier s. ap. J.-C.». 58 P. Leyenaar-Plaisier, Les terres cuites grecques et romaines du Musée national de Leiden (1979), n° 1588, p. 548 et pi. 208: «époque romaine». 59 W. Radt, « Pergamon. Vorbericht 1977 », A4 1978, p. 419 et fig. 11-12. Ce moule présente à la fois des clefs et des incisions guides, ainsi qu'une inscription EY soigneusement gravée à l'extérieur. Pas de datation proposée: il a été recueilli dans un remblai qui contenait surtout du mobilier
hellénistique mais posé à l'époque romaine pour combler une citerne. 60 On se reportera en particulier aux trouvailles d'Egypte ptolémaïque : - EDGAR 1903, p. Ill et p. XV: très nombreux moules en plâtre, pour la fabrication de figurines et d'objets eux aussi en plâtre le plus souvent, parfois en terre cuite. - BESQUES 1992, n° 4548, p. 129, pi. 82 : valve de revers de Déméter-lsis, en plâtre, avec six contre-clefs (date et origine de ce dernier document restent vagues : « Alexandrie (?), fin du IVe s.-début du IIIe s. av. J.-C. » mais : « seconde moitié du IIe s. av. J.-C. » dans la première publication, S. BESQUES, RLouvre 1973, p. 280). - Ph. Bruneau et al., Délos, île sacrée et ville cosmopolite (1996), fig. p. 96: valve de moule en plâtre, à huit clefs, pour pied de lit en bronze. - Les moules de plâtre destinés à la fabrication d'objets en bronze se reconnaissent souvent à la présence d'un petit canal : par exemple Edgar 1903, pi. Il, 32010 a-e ; pi. VII, 32035, 32044, etc. 61 W. Deonna, Le mobilier délien, EAD XVIII (1938), pi. I, 6 = id., «Notes d'archéologie détienne », BCH 62 (1938), p. 210 : moule en marbre, avec clefs, de petit vase. 62 Pour un autre exemple d'application à l'argile d'une technique propre au plâtre, celle des moules à clefs, voir Vertet 1983, p. 45-50.
BCH 122 (1998)