Gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’information...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’information...
Programme de recherche
sur le Mont Beuvray
Rapport annuel 2012
Synthèse
Établissement Public de Coopération Culturelle F — 58370 GLUX-EN-GLENNE
Décembre 2012
É d i t i o n s n u m É r i q u e s
Programme de recherche
sur le Mont Beuvray
Rapport annuel 2012
Établissement Public de Coopération Culturelle F — 58370 GLUX-EN-GLENNE
Décembre 2012
Photo de couverture : Bibracte, Mont Beuvray. Domus PC1. Vue de l’intérieur de la canalisation [8028] (cliché Bibracte/A. Maillier)
Rapport 2012 : BIBRACTE, programme de recherches sur le Mont Beuvray. Rapport annuel 2012. Glux-en-Glenne : BIBRACTE, 2012, publication numérique : http ://www.bibracte.fr, mot-clé rapport 2012.
Direction scientifique du programme de recherche Vincent Guichard (BiBracte)
Suivi éditorial Sébastien Durost, Myriam Giudicelli, Pascal Paris (BiBracte)
Mise en page Sébastien Durost, Myriam Giudicelli (BiBracte)
Traitement graphique Sébastien Durost, Arnaud Meunier (BiBracte)
Crédit iconographique Sauf mention contraire, les photos et dessins sont réalisées par les équipes de fouille ; les mises au net de certains plans et les normalisations sont réalisées par l’atelier graphique (BiBracte).
Ce rapport est publié uniquement sous forme numérique. Il rend compte des travaux effectués au cours de l’année 2012 dans le cadre du programme de recherche sur le Mont Beuvray sous la direction scientifique de Bibracte, Centre archéologique européen (Vincent Guichard, directeur scientifique).
Les comptes rendus à caractère scientifique qui y sont consignés sont provisoires et ne correspondent qu’à une étape de futurs publications.
mot-clé : rapport 2012
3BIBRACTE. Centre archéologique européen
rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le mont Beuvray
AVERTISSEMENT
Le sommaire du présent rapport présente des particularités qui ont deux origines. Elles résultent d’abord de la volonté d’exposer de façon plus complète et rigoureuse les recherches conduites pendant l’année écoulée, comme on l’argumente et le précise dans un des chapitres qui suit (chapitre VI.6). Elles découlent aussi du caractère atypique de la campagne 2012 : inscrite dans le prolongement du programme triennal 2009-2011, cette campagne a permis de compléter des actions développées durant les années précédentes et surtout de préparer une nouvelle programmation pluriannuelle, plus précisément quadriennale (2013-2016).
Ce volume rend donc compte de façon synthétique des recherches et travaux de l’année 2012 auxquels s’ajoutent des compléments d’information pour des travaux réalisés en 2009-2011. Ce rapport s’appuie sur un référentiel analytique, dossier documentaire regroupant autant que possible la totalité des données collectées et traitées durant la campagne (catalogues des unités de fouille avec inventaire sommaire du mobilier, catalogues des minutes de fouille et diagrammes stratigraphiques…) et téléchargeable en ligne sur le site internet de Bibracte.
Ce rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont beuvray est complété du projet scientifique pour les quatre années à venir. Ce projet, sous forme de volume séparé, propose un tour d’horizon des enjeux scientifiques que le site du Mont Beuvray permet d’aborder en s’appuyant sur les résultats déjà réunis depuis la reprise des fouilles en 1984 et en tentant de hiérarchiser les enjeux en fonction de considérations scientifiques générales et des contraintes opérationnelles propres au site. Il décrit le projet opérationnel pour les quatre années à venir, articulé en actions de recherche thématiques et en actions fédératrices et s’attache enfin aux moyens et méthodes qui seront mis en œuvre pour atteindre les objectifs préalablement définis.
Vincent GUIChARDDirecteur général de BibracteDirecteur scientifiqueDécembre 2012
437
RappoRt annuel 2012 du pRogRamme de RecheRche suR le mont BeuvRay VI – Méthodologie de la RecheRche
vi-5. gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’infoRmation aRchéologique
BIBRACTE. Centre archéologique européen
aRnaud meunieR aRchéologue géomaticien, BiBRacte
Gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’information archéologique
Le SIA UrBiS : Urbanisme de Bibracte et Spatialité
bâtiments ?), et chronologiques (quels bâtiments entre telle et telle période ?) ; c’est-à-dire selon la fonction, l’espace et le temps. Cela permet de répondre ainsi à trois questions simples mais essentielles par rapport aux attentes vis-à-vis d’un SIG : Quoi ? Où ? Quand ? L’apport du SIG se situe donc principalement dans les perspec-tives d’analyse spatiale offertes par le croisement des données archéologiques entre elles.
Cela va donc se traduire par la création d’un SIA dénommé UrBiS (Urbanisme de Bibracte et Spatialité) comprenant un SIG qui comportera les données graphiques associées à une base de données relation-nelles qui contiendra les données sémantiques, et ce afin de faciliter la gestion et l’exploitation des données. Cette double approche, géographique et sémantique, garantit la qualité de l’analyse spatiale, indispensable à mener, pour des études combinées de topographie et de morphologie urbaine.
CONTEXTE ET CADRE DE L’ÉTUDE
Mise en cohérence des données de l’archéologie spatiale à l’aide d’un SIG : un projet de longue haleine
Depuis 2006, le projet d’un système d’informations géographiques à Bibracte est inscrit au programme de recherche comme projet prioritaire. En effet, la multiplication des opérations archéologiques et la masse de documentation qui en découle nécessitent une mise en cohérence des protocoles d’archivage des données spatiales. Il s’agit par la même occa-sion de fournir aux chercheurs un outil adapté pour exploiter ces données spatiales. Il est tout d’abord
INTRODUCTION
Dans la continuité de la réflexion sur la spa-tialisation des données archéologiques à Bibracte débutée en 2006, l’utilisation d’un système d’infor-mations géographiques ou SIG, avec ses capacités à gérer simultanément le spatial et le sémantique, s’im-pose d’elle-même. Le travail de thèse de doctorat de Benjamin Bohard, qui doit se conclure prochainement, a permis des avancées, notamment sur la nomen-clature des données et les protocoles d’archivage de l’information (travail réalisé en partenariat avec Émeline Degorre, qui a occupé le poste de topographe de Bibracte jusqu’à début 2011). Une nouvelle étape, qui a été identifiée comme une action de recherche à part entière pour les années à venir, doit néanmoins être franchie. La finalité du projet est de fournir un outil numérique capable de gérer facilement l’ensemble de l’information spatiale générée par l’activité archéolo-gique sur l’oppidum et d’en faciliter l’accessibilité et l’exploitation par l’ensemble des chercheurs. Pour cela, l’information archéologique doit être spatialisée et hié-rarchisée afin de faciliter les passages entre l’échelle de la structure archéologique et celle de l’oppidum entier. Cette organisation doit offrir un rendu évolutif et dyna-mique compatible avec les exigences d’une démarche scientifique qui vise à retracer l’évolution d’une agglo-mération depuis sa fondation.
C’est pourquoi, au-delà de la (relativement) simple élaboration de la cartographie de Bibracte, l’intérêt de la création d’un SIG archéologique ou système d’informa-tion archéologique (SIA), consiste à concevoir un outil d’aide à l’analyse et de recherche concernant l’oppidum sur la base de critères thématiques (quel type de bâti-ment trouve-t-on ?), géographiques (où se trouvent tels
438
BiBRacte – centRe aRchéologique euRopéen
Rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont Beuvray
important de rappeler à quoi servent les SIG : il s’agit d’outils informatiques de gestion, d’interrogation, d’analyse, de modélisation et de restitution de l’in-formation spatialisée. Leur caractéristique principale est donc de gérer des objets géoréférencés.
Bien que lors du triennal 2006-2008 le projet, qui semblait dès le début extrêmement prometteur, (rap-ports annuels 2006, p. 216-217 ; 2007, p. 17 ; 2008, p. 63) n’ait pas abouti, ce dernier a pris un nouveau tournant en 2008 grâce au travail réalisé par B. Bohard dans le cadre d’un mémoire de Master 2 en archéosciences et géo-environnement de l’université de Bourgogne (rapport annuel 2008, p. 463-466). Ce travail était guidé par deux problématiques : la première était la modéli-sation de la topographie du substrat géologique et la détermination des épaisseurs de sédiments archéo-logiques ; la deuxième était la corrélation de niveaux archéologiques remarquables (couches d’incendie, de destruction…) équivalents d’un chantier à l’autre. Cette étude se poursuit actuellement par une thèse de docto-rat débutée en 2009, grâce à une bourse cofinancée par Bibracte et le Conseil régional de Bourgogne.
Dans un premier temps, en collaboration avec la topographe-cartographe de Bibracte de l’époque − Émeline Degorre (arrivée la même année, i.e. 2009) − l’ouvrage a donné lieu à la mise en place d’un pro-tocole de numérisation et d’archivage des minutes de terrain afin de permettre un partage plus efficace de la documentation entre les chercheurs et les ges-tionnaires de la documentation ; ce qui a engendré la numérisation d’un nombre important de minutes de terrain. Cela a également donné lieu à la mise en place de recommandations en vue d’harmoniser le rendu de la documentation graphique pour le rapport d’activité (rapport annuel 2009, p. 297-308). Ce travail a continué en 2010, avec des avancées méthodolo-giques, principalement dans l’archivage des minutes numérisées. Un début de SIG a également vu le jour (rapport annuel 2010, p. 466-474).
Depuis, le remplacement d’E. Degorre au début de l’année dernière s’est accompagné d’un changement provisoire de priorité pour réviser les modalités de prix et d’archivage des données de terrain, tandis que B. Bohard se concentre à la rédaction de son mémoire de thèse. D’ailleurs, comme il a été mentionné dans le rapport de l’an dernier (rapport annuel 2011, p. 640), même si ce travail n’a pas réellement abouti sur le plan pratique, ce dernier a toutefois eu pour bienfait, entre autres, l’enrichissement très notable de l’information spatiale géoréférencée sur le site par la mise en place de protocoles efficaces pour la numérisation des minutes de terrain. Bien qu’en appa-rence la dynamique du projet semble s’être ralentie pour
les raisons que l’on vient d’évoquer, le projet n’est pas abandonné pour autant et le travail sur la mise en cohé-rence des données de l’archéologie spatiale est toujours en cours, mais nécessite une évolution et une refonte à la fois dans son approche méthodologique et dans sa problématique.
Un nécessaire remaniement
Les SIG sont encore trop souvent considérés comme des outils de cartographie automatique et sont donc souvent utilisés comme tels. Ils offrent pourtant des possibilités beaucoup plus vastes et intéressantes. Ils peuvent, voire même doivent, être utilisés comme un outil de recherche pour la spatiali-sation des données archéologiques afin de répondre à des questions d’analyse spatiale. L’information archéologique doit donc être à la fois spatialisée et hiérarchisée, afin de faciliter les passages entre l’échelle de la structure archéologique et celle de l’oppidum entier.
En l’état, le SIG précédemment proposé n’est pas aisément exploitable. Même s’il semble intéressant, comme il a été proposé, de spatialiser les UF en séparant UF positives et UF négatives, existantes et res-tituées (rapport annuel 2010, op. cit.), ce SIG reste un outil cartographique qui n’offre pas de dynamisme et qui ne facilite ni les critères de recherche, ni les mises à jour. Sa conception doit donc être repensée de manière à rendre son utilisation simple, claire et intuitive, tout le monde n’ayant pas une connais-sance approfondie des SIG et des SGBD (systèmes de gestion de bases de données). L’objectif du projet est qu’il devienne, à terme, un outil utilisable par n’importe quel chercheur travaillant sur l’oppidum. Il semble donc nécessaire de revoir le SIG ébauché et de le faire évoluer.
Loin de repartir d’une feuille vierge, le travail établi permet de servir de base à une nouvelle problématique, un SIG étant conçu selon une problématique donnée. Celle du travail de thèse de B. Bohard portant sur des problèmes d’ordre stratigraphique, il a été jugé plus intéressant de tenter de répondre à une problématique plus large, concernant l’organisation de l’espace urbain qui sera au coeur des préoccupations de la prochaine programmation quadriennale.
La ville gauloise comme objet de réflexion ou l’étude du fait urbain à l’âge du Fer
Même si aujourd’hui le site de Bibracte se situe au beau milieu d’une forêt, il est bien évident qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Il convient donc de distinguer
439BIBRACTE. Centre archéologique européen
RappoRt annuel 2012 du pRogRamme de RecheRche suR le mont BeuvRay VI – Méthodologie de la RecheRche
vi-5. gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’infoRmation aRchéologique
1. Triade Fonction – Espace – Temps.
« archéologie en milieu urbain » où la ville est le lieu de recherche et « archéologie urbaine » où la ville est l’ob-jet de recherche (Colloque international d’archéologie urbaine 1982, p. 22). Cette distinction terminologique est importante car elle permet de replacer le cœur même de l’étude et de la réflexion, à savoir la ville. Cela pose par là même la question de la notion de ville ou, au sens plus large, du fait urbain : il s’agit d’une ques-tion simple à formuler mais à la réponse complexe.
En 1980, Chr. Goudineau et V. Kruta se questionnaient sur l’existence d’une ville protohistorique (Goudineau, Kruta 1980, p. 143-231). Il est aujourd’hui admis par beau-coup que la ville gauloise existe, comme le prouvent le titre sans ambiguïté de l’ouvrage de St. Fichtl La ville celtique, publié en 2000, réédité en 2005 (Fichtl 2000) ; la communication faite par M. Vaginay lors du 32e colloque de l’AFEAF à Bourges en 2008 (Vaginay 2009) ayant pour titre Les Gaulois sont dans la ville ; ou encore comme l’affirme G. Kaenel lors de la table ronde de Cambridge en 2005 concernant les mutations de la fin de l’âge du Fer : « oui, il y a une ville celtique originale », répondant ainsi à la question de Ch. Goudineau et V. Kruta. Il pour-suit d’ailleurs en disant que : « un véritable urbanisme existe, reposant sur différents critères, à commencer par le tracé d’un rempart. On peut vraiment parler de ville, comme le font St. Fichtl ou O. Buchsenschutz par exemple, ‘‘Town’’, à la suite de J. Collis ou de P. Wells. […] S. Rieckhoff a entièrement raison lorsqu’elle propose en 2002 de parler de la ville ‘‘celtique’’ en mettant les guillemets sur celtique et non sur ville comme le font la plupart des auteurs » (Kaenel 2006, p. 22), même s’il nuance ses propos en admettant que : « tous les oppida ne sont pas des villes, ou de véritables villes au sein desquelles se déroulent toutes les activités centralisées d’une société » (ibid., p. 23). Il affirme toutefois que dans le cas de Bibracte : « un plan d’aménagement [existe] dès l’origine de l’oppidum à Bibracte, avec des phases de construction superposées les unes aux autres […] ; on passe ensuite du bois à la pierre, dans les zones résiden-tielles comme chez les artisans, le tout s’exprimant dans la durée. […] À Bibracte, on est sans aucun doute en pré-sence de l’exemple le plus éclatant de l’aboutissement du modèle urbain. […] La mutation urbaine, qui semble donc achevée à Bibracte dès le milieu du ier s. av. J.-C., se développe jusqu’à l’époque augustéenne. » (ibid., p. 35).
De plus, dans sa thèse sur l’architecture et l’urba-nisme de l’oppidum de Bibracte, Fr. Meylan (2005) a mis en évidence un réseau viaire dense, non perçu jusque-là, ainsi que des travaux urbanistiques de grande ampleur et suggère aussi la possibilité de trames modulaires. Il montre que l’espace de l’oppidum a fait l’objet de planifications, dont une partie est imputable aux influences romaines. Il montre également que des
quartiers s’organisent et sont structurés sur la base d’un plan, en fonction d’axes préétablis et non de manière aléatoire, et qu’une trame urbaine est envisageable dès les premières constructions qui remontent au début du ier siècle avant notre ère.
Ainsi, si l’oppidum possède diverses caractéristiques de type urbain, il demeure problématique de définir la ville gauloise car il reste souvent difficile d’identifier précisément la fonction des ensembles immobiliers repérés par la fouille sur ce type de site. Cette difficulté a donc des répercussions méthodologiques évidentes. La démarche que nous proposons de développer dans le cadre du programme de recherche 2013-2016 aura donc aussi comme enjeu d’évaluer la pertinence de l’utilisation de grilles d’analyses développées pour l’étude du phénomène urbain historique ; tout en gar-dant à l’esprit que la ville gauloise est spécifique. La complexité est donc de s’affranchir du modèle clas-sique de la ville méditerranéenne sans pour autant le rejeter ni négliger son influence.
Le fait urbain, produit de trois dimensions : la fonction, l’espace et le temps
Afin d’appréhender au mieux l’espace de l’oppi-dum : « il va falloir reprendre la documentation d’une manière critique, en intégrant bien sûr la topographie et la superficie des sites, mais surtout établir des représen-tations cartographiques différenciées tenant compte de la chronologie, de la durée d’occupation et de la fonction des sites. » (Kaenel, op. cit., p. 22). On dénote ainsi que sa caractérisation relève de trois dimensions : la fonction (usage social), l’espace (localisation et morphologie) et le temps (datation et chronologie), correspondant aux trois adverbes « quoi », « où », « quand ».
En effet, comme il convient tout naturellement en archéologie d’identifier et de dater une information mise au jour, il convient également de la localiser dans
Où(espace)
Quoi(fonction)
Quand(temps)
440
BiBRacte – centRe aRchéologique euRopéen
Rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont Beuvray
un espace (Galinié et al. 2004 ; Rodier, Saligny 2010). Comme l’a montrée D. Peuquet dans son modèle de triade (Peuquet 1994, p. 447-451), l’association des trois ensembles implique que chacun est conditionné par les deux autres (ill. 1) :• l’interprétation fonctionnelle, qui se fait par le choix
d’une fonction dans un thésaurus, est influencée autant par la temporalité que par la localisation ;
• la temporalité se caractérise par une date d’appa-rition et une date de disparition. Un changement morphologique significatif ou de fonction consti-tue une rupture temporelle ;
• la localisation et la forme d’un objet sont détermi-nées par la fonction et la chronologie.
On constate également que les méthodes d’analyse appliquées à l’archéologie utilisent trois approches cor-respondant à autant de niveaux de compréhension des phénomènes et des changements, à savoir : l’approche descriptive, l’approche inductive et l’approche déduc-tive. Chaque niveau implique une observation des faits, des événements ou des relations causales selon les trois dimensions précédemment définies. Mais lorsque l’on décrit un « processus spatio-temporel » (Theriault, Claramunt 1999), on met l’accent sur des mécanismes d’interaction qui permettent alors de tenter de répondre à deux autres questions : comment ? et pourquoi ? (ill. 2).
Ainsi, en mutualisant les résultats des recherches des équipes de fouilles par l’intermédiaire d’un sys-tème d’informations archéologique, l’analyse des données archéologiques a pour objectif d’améliorer les connaissances sur l’agglomération protohistorique et pré-antique de Bibracte. Il ne s’agit donc pas ici de simplement construire un système de gestion du type « carte archéologique » mais de pouvoir réaliser une réelle analyse spatiale : évolution fonctionnelle et spa-tiale, caractérisation de la trame urbaine.
CONCEPTION DU SIG : DÉMARCHE ET MÉTHODE
Considérations préalables
Conçu selon un modèle spatio-temporel, le SIG pro-posé n’a rien de révolutionnaire. Il s’agit de présenter un modèle qui tend à ne pas considérer la ville comme une simple concentration de vestiges mais comme un ensemble a priori cohérent, permettant d’établir une réelle analyse spatiale. En revanche, c’est dans la réflexion méthodologique et la structuration des don-nées que pourrait se distinguer ce SIG.
Aussi, comme l’explique Xavier Rodier dans sa présenta-tion du SIG TOTOPI (TOpographie de TOurs Pré-Industriel), SIG construit pour la recherche archéologique urbaine à Tours : « contrairement à une idée reçue, l’utilisation d’outils informatiques (SGBD, SIG) n’est pas synonyme d’un gain de temps. Cela nécessite une réflexion approfondie sur la structuration des données et des phases d’acquisition (saisie, DAO) ingrates et longues avant d’atteindre l’étape valorisante d’analyse et de mise en évidence des résultats » (Rodier 2000, p. 3). La conception puis la création d’un SIG sont donc avant tout une démarche intellectuelle reposant sur une approche systémique (Pirot, Varet-Vitu 2004) qui passe par un processus de modélisation de la problématique. C’est pourquoi il est nécessaire avant tout traitement informatique de concevoir le modèle concep-tuel de données (MCD) (Servigne, Libourel 2006) qui est une représentation simplifiée de la réalité.
La modélisation spatiale : modélisation hypergraphique selon la méthode HBDS
Parmi les différentes méthodes existantes pour trai-ter les phénomènes spatiaux, c’est la méthode HBDS
Où
Quoi Quand
Descriptive
Description
Faits
Observer et décrire
Où
Quoi Quand
Comment
Inductive
Expérimentation
Processus
Vérifier des hypothèses
Où
Quoi Quand
Pourquoi
Explication
Déductive
Causes
Comprendre les mécanismesd’évolution
Approche
Méthode
Compréhension
Objectifs
Composantes
2. Processus d’interprétation en archéologie (d’après Theriault, Claramunt 1999, p. 77).
441BIBRACTE. Centre archéologique européen
RappoRt annuel 2012 du pRogRamme de RecheRche suR le mont BeuvRay VI – Méthodologie de la RecheRche
vi-5. gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’infoRmation aRchéologique
(Hypergraph Based Data Structure) qui a été choisie pour organiser les données. Elle fut l’objet de la thèse de Fr. Bouillé (1977) qui présente une modélisation reposant sur la Théorie des Graphes, des Hypergraphes et des Ensembles. Il s’agit d’une méthode générale de modélisation de la structuration de l’information spatiale, thématique et temporelle, s’appuyant sur une approche phénoménologique (Pirot 2009). Le principe de cette méthode est en effet de déduire la structure des données directement de la structure des phénomènes eux-mêmes, et non des seuls problèmes posés, dans une organisation
en classes et en hyperclasses d’objets reliées par un réseau de liens et d’hyperliens (Saint-Gérand 2005). Tous ces éléments peuvent porter des attributs qui en définissent la signification. Cette méthode emploie donc quatre concepts fondamentaux : l’objet, la classe, l’attribut et le lien. Le but est ainsi de construire un modèle synoptique s’inscrivant dans une démarche hypothético-déductive.
L’étape de création du modèle conceptuel de données (MCD) est donc primordiale. Elle permet de faire le lien entre la problématique de l’étude et la construction du SIG (ibid.).
Ensemble
Structure
UF
Fouille
Opération
Emprise
Géographie humaine
Classe
Hyperclasse
Géographie physique Méthodesde prospection
Voies decommunication
Bati
Topographie
Hydrographie
Géologie
Lidar
Géophysique
Entités archéologiques
Données archéologiques
Cadastre
Est composéde (0,n)
Est composéde (1,n)
Estcomposéde (1,n)
Forme(0,n)
Forme(0,n)
Forme(0,n)
Comporte(1,n)Se situe
(1,1)
Comporte (0,n)
Lien
En lienavec
Informent sur
Données géographiques de référence
3. Modèle conceptuel de données (MCD) proposé pour le SIG de Bibracte selon la méthode HBDS.
442
BiBRacte – centRe aRchéologique euRopéen
Rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont Beuvray
Le modèle conceptuel de données (MCD)
Reposant sur cette méthode, le MCD proposé (ill. 3) structure les différents phénomènes sous forme de graphes, de classes et d’hyperclasses, de liens et d’hyperliens. Le modèle élaboré à la lecture suivante : prenons l’exemple du graphe « données géographiques de référence ». Lorsque les classes ont la même relation une à une avec les mêmes autres classes, on peut les regrouper en hyperclasses. C’est ainsi que les classes « cadastre », « voies de communication » et « bâti » composent l’hyperclasse « géographie humaine » ; cette dernière composant avec les hyperclasses « géographie physique » et « méthodes de prospection » le graphe « données géographiques de référence ».
De plus, graphes, hyperclasses et classes peuvent être mis en relation par des liens sémantiques, ces der-niers pouvant faire apparaître des cardinalités, comme entre les classes « opération » et « emprise » de l’hyper-classe « fouille » où l’on peut lire qu’une opération peut comporter une ou plusieurs emprises.
Ainsi, pour modéliser le SIG, deux parties ont été définies, structurées en deux graphes : « données archéologiques » et « données géographiques de référence ».
Données archéologiques
Cette partie traite uniquement les opérations archéologiques de terrain. Elle comprend des don-nées de fouilles et des entités archéologiques.
Pour les données de fouilles, l’opération (ou intervention), purement administrative (qui ne comportera donc aucune représentation gra-phique), a été différenciée de l’emprise de fouille, qui consiste en la représentation cartographique sous forme de polygone de l’emprise de chaque opération de fouille ; sachant qu’une emprise ne peut se situer que sur une seule opération mais qu’il peut y avoir plusieurs emprises par opération. Toutefois, dans le cas où certaines découvertes manqueraient suffisamment de précision, cela engendrera une cartographie sous la forme d’un polygone basique (un simple rectangle) voire sous une forme ponctuelle.
Directement associées aux emprises, les « entités archéologiques » ont fait l’objet d’un travail de hiérar-chisation de manière à pouvoir travailler à trois échelles distinctes et faciliter les passages entre l’échelle de
Mur [9/55]
Mur [7/53]
Mur [7]
Mur [11/75]
Mur [8/58]
Seuil [779]
Local A
Local B
Local C
Bâtiment PS 0
Local A Local B Local C
Bâtiment PS 0
Mur [7/53] Seuil [779]Mur [9/55]Mur [11/75] Mur [7] Mur [8/58]UF
Structure
Ensemble
4. Structuration des données en UF – Structure – Ensemble par l’exemple du bâtiment PS 0.
443BIBRACTE. Centre archéologique européen
RappoRt annuel 2012 du pRogRamme de RecheRche suR le mont BeuvRay VI – Méthodologie de la RecheRche
vi-5. gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’infoRmation aRchéologique
l’entité archéologique et celle du site entier. Ainsi, trois niveaux hiérarchiques sont proposés sur le modèle mur – pièce – maison : l’UF – la structure – l’ensemble (ill. 4).
L’UF (Unité de Fouille) définit le plus petit ensemble résultant d’un même phénomène (un four, une fosse, un mur). La structure est une adjonction d’UF formant un tout cohérent (une pièce, une basilique, une boutique). Le regroupement des structures et/ou des UF forme un ensemble (une villa, un temple, un forum). Chaque entité sera cartographiée de manière surfacique dans le SIG et sera définie sémantiquement, notamment par le biais d’un thésaurus et d’une période (terminus post et ante quem), dans la base de données associée.
Cette structuration des données archéologiques s’inspire à la fois des travaux réalisés par Th. Lohro dans
son SIG mis en place pour le traitement des archives du sol en milieu urbain pour la ville de Rennes au sein du SRA Bretagne, en partenariat avec la ville, intitulé SIGUR (SIG URbain) (Lorho 2008) et ceux du service archéo-logique de la ville de Lyon (Hofmann 2005) dont le SIG ALyAS (Archéologie Lyonnaise et Analyse Spatiale) a, entre autres, été conçu dans le but de pouvoir reconsti-tuer l’état de la ville aux différentes époques. Développé initialement sous Arcview 3.3, le SIG SIGUR reprend l’organisation générale de PATRIARCHE (PATRImoine ARCHEologique), SIG du ministère de la Culture. Mais la structuration en est différente par l’ajout de différents niveaux de hiérarchisation de l’information faisant défaut au SIG national (Lorho, ibid., p. 62). Le projet ALyAS, quant à lui, s’inspire également de PATRIARCHE et se présente sous la forme d’un SIG développé sous MapInfo associé à une base de données spécifique sous
Entités archéologiques
Structure
� Id / n° structure [S_n°]� N° opération� Domaine d’activité (thésaurus)� Fonction (thésaurus)� Interprétation (thésaurus)� Chronologie (idem Ensemble)� Nature découverte (fouille récente, prospection, fouille ancienne)� Commentaire� UF constitutives
UF
� Id (n° UF de bdB c-à-d : année_chantier_n°UF)� N° opération� Type (positive, négative, englobante)� Interprétation (thésaurus)� Chronologie (idem Ensemble)� Commentaire
Opération
� Id / n° opération� Responsable opération� Nom opération� Date début� Date fin
Emprise
� Id � N° opération� Superficie� Type (emprise, sondage)
Fouille
Ensemble
� Id / n° ensemble [E_n°]� N° opération� Nom (PC1 , PS0, ...)� Domaine d’activité (thésaurus)� Fonction (thésaurus)� Interprétation (thésaurus)
� Chronologie
� Nature découverte (fouille récente, prospection, fouille ancienne)� Commentaire� Structures constitutives� UF constitutives
Date de disparition
Date d’apparition Période d’apparitionTPQ
Période de disparitionTAQ
5. Schéma de l’organisation de la future base de données
444
BiBRacte – centRe aRchéologique euRopéen
Rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont Beuvray
Access, où sont hiérarchisées, tout comme pour le projet SIGUR, les données archéologiques issues du terrain.
Cette individualisation et hiérarchisation spatiale des entités proposée possèdent un triple avantage :• Elles donnent tout d’abord la possibilité de travail-
ler à plusieurs échelles d’analyse, allant de celle de l’oppidum dans son ensemble à une échelle plus restreinte comme celle d’un quartier, d’un îlot ou même d’une entité archéologique.
• Elles permettent ainsi la restitution de différents états selon l’évolution chronologique et fonction-nelle, cela sans avoir à redessiner tous les éléments à chaque fois selon les interprétations ou selon les phases chronologiques.
• Ce qui offre enfin l’avantage de pouvoir suivre l’évolution d’une fouille – primordial lors de cam-pagnes programmées – sans avoir à redessiner les entités à chaque nouvelle campagne.
Cette hiérarchisation est donc dynamique et faci-lite les mises à jour au fur et à mesure de l’apport de nouvelles fouilles.
Données géographiques de référence
Définis ainsi par J. Denègre et Fr. Salgé (2004, p. 39), il s’agit d’un ensemble de données relatives à la descrip-tion générale du territoire, à la fois en objets naturels (rivières, reliefs…) et anthropiques (routes, bâti, limites cadastrales…). Concernant les données de géographie humaine, il s’agit des données cadastrales fournies par le service des cadastres, des voies de communications comme les routes et chemins actuels et des bâtiments comme le musée.
La géographie physique comprend les données topographiques (courbes de niveau), les données hydrographiques extraites de la BDcarto de l’IGN et des données géologiques extraites des données du BRGM. Ces données ont déjà été regroupées dans le SIG ébau-ché en 2010. Ont été adjointes à ces informations à caractère général des données raster issues du relevé Lidar et des différentes campagnes de prospections géophysiques qui composent quant à elles les moyens de détection des entités archéologiques. Toutes ces données de références possédant une table attributaire simple déjà intégrée au SIG ne nécessitent pas de figu-rer dans la base de données.
Domaine d'activité Fonction Interprétation
Bâtiment civil
Edifice public
Espace public
Habitat
Artisanat
Boutique
Carrière
Industrie
Architecture funéraire
Espace funéraire
Structure funéraire
Espace fortifié
Structure fortifiée
Aire culturelle
Architecture religieuse
Adduction
Aménagement relief / terrain
Evacuation d'eau
Réseau routier
Reserve
Abandon
Indeterminé
Thésaurus bdB
Autre
Civil
Commerce / Artisanat
Funéraire
Religieux
Voirie /
Aménagement
Militaire / Défensif
6. Thésaurus des domaines d’activités et des fonctions des entités archéologiques.
445BIBRACTE. Centre archéologique européen
RappoRt annuel 2012 du pRogRamme de RecheRche suR le mont BeuvRay VI – Méthodologie de la RecheRche
vi-5. gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’infoRmation aRchéologique
ÉLABORATION DE LA BASE DE DONNÉES RELATIONNELLES
Structuration de la base de données
Comme le mentionne à juste titre Th. Lorho : « la spatialisation et la hiérarchisation des données doivent impérativement être pensées simultanément. La géométrie d’une information scientifique ne consiste pas simplement en sa traduction cartogra-phique, elle contribue à part égale à la description sémantique dans la définition de cette unité docu-mentaire » (Lorho op. cit., p. 61).
Pour l’heure, la base de données n’est pas encore édifiée mais une ébauche de sa structuration présen-tant les différents champs a été établie (ill. 5).
Requêtes thématiques
Pour effectuer des recherches thématiques, les enti-tés vont être décrites par un domaine d’activité, une fonction et une interprétation correspondant à trois niveaux de requêtes, définis par le biais d’un thésau-rus (ill. 6). Ceux des deux premiers niveaux s’inspirent de deux thésaurus préexistants que sont celui de l’application nationale PATRIARCHE et celui du CNAU (Centre National d’Archéologie Urbaine) et se veulent extrêmement simples afin de pouvoir effectuer des requêtes basiques (même s’il reste souvent difficile, voire discutable, de proposer une identification ou une interprétation pour certaines entités). Le thésaurus de l’interprétation reste quant à lui celui de la base de données bdB d’où seront extraites les données de bases.
Requêtes chronologiques
Afin d’effectuer des requêtes chronologiques, la datation sera précisée par des bornes chronologiques de début et de fin que l’on pourra plus ou moins détailler. Elle peut s’appuyer pour cela sur une pério-disation propre au site ou à l’aire culturelle à laquelle elle appartient (La Tène D1b, La Tène D2a…) ainsi que la possibilité de préciser une date d’apparition ou ter-minus post quem (TPQ) et une date de disparition ou terminus ante quem (TAQ) notées en chiffres arabes. L’expression « vers telle date » pourra se faire grâce à un TPQ et un TAQ égaux (par exemple : TPQ : -50/TAQ : -50 = vers 50 av. J.-C.). Enfin, l’an 0 n’existant pas, le couple TPQ = 0/TAQ = 0 sera réservé pour les éléments soit non datés, soit non datables. Il peut également être intéressant d’inclure un critère de jugement de valeur quant à la précision de la datation grâce à une échelle de valeur numérique de 1 à 3 :• 1 : datation précise.• 2 : datation moyennement précise.• 3 : datation peu précise.
Données logicielles
Pour des questions pratiques et afin de faciliter les échanges entre le SIA UrBiS et la base de données bdB (ill. 7), la base de données du SIA sera construite sous le logiciel Filemaker pro. Il s’agit également d’un logiciel manipulable aisément et largement connu par l’ensemble des chercheurs, ce qui permettra une utili-sation aisée lors des futures requêtes.
Le SIG sera quant à lui construit sous le logiciel ArcGis mais pourra également être utilisé avec le logi-ciel libre Quantum Gis qui gère le format shapefile d’ArcGis, ce dernier offrant toutefois plus de fonction-nalités d’analyse spatiale que le logiciel libre.
Description Interprétation
bdB
Inventaires Analyse et cartographie thématique
UrBiSSIG archéoarchive de terrain
7. Schéma explicatif de la relation entre bdB et UrBiS.
446
BiBRacte – centRe aRchéologique euRopéen
Rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont Beuvray
Aussi, deux moyens sont possibles pour lier les don-nées sémantiques engrangées dans la base de données et les données spatiales organisées dans le SIG :• soit on lie la base avec le SIG, au niveau logiciel, par
un lien ODBC (Open Data Base Connectivity) ;• soit on exporte les tables qui nous intéressent de la
base de données dans un fichier que l’on lie aux données spatiales dans le SIG.
Vers une normalisation graphique
En concomitance de la réflexion sur l’élaboration d’un SIA pour la gestion et l’exploitation des données spatiales, cette année a également permis d’avancer dans la mise en place de protocoles en vue d’une harmonisation du rendu graphique pour le rapport scientifique, débutée par E. Degorre.
Le dessin, qu’il soit manuel (minute de terrain) ou informatique (DAO), est un mode d’expression dont le seul but est de communiquer à d’autres ce que l’on a vu. Ce but est aussi la condition nécessaire pour abou-tir à l’exécution d’un dessin archéologique valable. La fonction essentielle d’un dessin est de définir la nature de l’objet tout en donnant une description aussi
précise que possible. Il constitue lui-même un discours autonome, dont la finalité reste avant tout la présenta-tion d’un document de travail. De ce fait, l’illustration doit permettre à tout chercheur de pouvoir travailler en l’absence du document concret. Si, étymologique-ment, illustrer c’est rendre clair, on ne doit pas pour autant perdre de vue l’objectif scientifique. En effet, il ne suffit pas qu’une illustration soit juste et/ou belle, encore faut-il que l’utilisateur puisse l’interpréter correctement.
De plus, l’usage des techniques informatiques, qui ne doit pas par ailleurs inciter à la facilité, ne dispense pas de respecter les règles fondamentales en cartogra-phie (utilisation d’une échelle graphique non absurde (échelle au 1/10 plutôt qu’au 1/8,25683), indiquer l’orientation de la coupe et/ou du plan, présence des coordonnées géographiques…).
Le but est donc de fixer les règles essentielles et de les codifier. Bien entendu, la normalisation a ses limites, on ne peut aborder tous les problèmes et les cas particuliers qui peuvent se présenter. La représen-tation des cas particuliers sera laissée à l’appréciation du dessinateur mais devra être réalisée dans le même esprit logique que le reste du code.
820 m
825 m
[925]
791,38
[926]
A BVV
Limite de fouille (zone de fouille)
Elément conservé (structure) / observé (limite d’UF pour une coupe)
Elément restitué (non visible) / limite restituée logique
Elément restitué (hypothètique) / limite incertaine
Indicateurs de pente (structures en creux par exemple)(La longueur des traits dépend de l’importance de la pente.Plus celle-ci est douce, plus les traits sont longs, et inversement)
Localisation de coupe (avec orientation et sens de vue)
Limite de sondage (indique un sondage à l’intérieur d’une zone de fouille)
Courbes de niveau(les courbes maitresses, en général toutes les cinq courbesà partir de l’altitude zéro, sont accentuées et leurs altitudessont généralement indiquées et dirigées vers le haut du terrain)
Numéro d’unité de fouille positive
Numéro d’unité de fouille négative
Cote altimétrique (en mètres NGF)
8. Exemple de normes graphiques fournies.
447BIBRACTE. Centre archéologique européen
RappoRt annuel 2012 du pRogRamme de RecheRche suR le mont BeuvRay VI – Méthodologie de la RecheRche
vi-5. gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’infoRmation aRchéologique
Ce travail de normalisation est en cours d’achèvement mais le résultat est déjà visible dans le présent rapport. Pour cela, un dossier numérique a été fourni aux chercheurs avant le post-fouille, comprenant un certain nombre de normes graphiques déjà établies (échelles graphiques de différentes tailles mais réalisées sur le même modèle, flèche nord unique, bibliothèque de conventions pour la représen-tation des limites de fouilles, d’UF…) (ill 8).
En collaboration avec B. Desachy et S. Durost, des séances hebdomadaires de formation et d’information sur les normes des relevés et de la production graphique à utiliser ont également été proposées durant la campagne 2012 aux étudiants et chercheurs des équipes présentes. Ces séances ont aussi présenté les nouveautés apportées à la base de données dbB et l’organisation pratique pour le rendu du rapport scientifique. Un résumé des normes et recommandations graphiques est présenté ci-après.
Normes et recommandations des relevés nécessaires à l’homogénéité des dessins et à la pertinence de l’illustration
Minute de terrain :- Coupe localisée sur un plan (croquis) du chantier ;- Date de la minute ;- Marquer l’orientation de la coupe et/ou du plan ;-Pourlesaltitudes:Identificationdupointvisé+sonaltitude(=altitudederéférence),lecturelue,altitudedelalunetteetindiquer
si les altitudes prises sont en lecture directe ou calculée ;- Échelle ;- Auteur ;- Titre ;- Légende ;
Dessin général :- Les relevés ont un nord et tous les dessins une échelle ;-Lescoupesontdesréférencesd’altitudeenmNGFetuneorientation;- Les coupes sont positionnées sur un plan ;-Leséchellesnesontpasabsurdes(ex.:1/8,2364).CarteIGN=1/25000parex.ouminutedeterrainau1/20ou1/50doncDAO
idem ;-LesappellationsdesUFsontlesmêmesdansletexteetl’ill.;-UFetsecteurdefouillelocaliséssurleplangénéraldelafouille;
DAO:- Légendage sur calque distinct ;-Lestramagesetsymbolessontréférencésenlégendesurledessinlui-mêmeouendocumentannexeetbiendifférenciés
(attention aux trames et couleurs trop proches) ; -Traitépaisseurminimale0,2ptpourdudessinvectorielet5pxpourdudessinpixellisé;-Attentionaussidenepasoublierdefournirunfichierliésansliaison:soitfournirlefichier(engénéraluneimage)d’originedansunfichieravecledocumentIllustrator,soitincorporerlefichier(mieuxmaisfichiervectorielplusvolumineux);
-Taillemaximalepourl’illustrationdurapport:17cmx24cm(LxHt);- Attention aux dégradés de couleur ;
Imagesscannéesouphotosà300dpi
Rappels pour l’archivage des minutes de terrain (bdB205)ScannerlesminutesdeterrainaveclescannerA2(protocoled’utilisationaffichéàcôtéduscanner)ArchivagedansbdB205-Scandesminutesdeterrain:205_n°intervention_n°minute-Scanficheinventairepapierminutesdeterrain-ListingExcelaveccommenom:205_n°intervention.xlsprésentésouscetteforme
D’iciàlaprochainecampagnedefouilles,ilestprévuderééditerlemanuelderecommandationpourl’enregistrementdesdonnéesarchéologiquesdeBibracte(dontladernièreversiondatede2004,avecunajoutconcernantl’utilisationdulogicielLeStratifianten2009)danslequelfigureranotammentlamiseàjourdesconventionsgraphiquesutiliséesparlecentrederecherche(épaisseurdetrait,trames,typeettailledepolice…).
Num intervention Num minute Echelle Plan/coupe Resp. opération A B C D E
1 745 1 50 Plan Ph. Barral / M. Joly 2 745 2 50 Plan Ph. Barral / M. Joly 3 745 3 10 Coupe Ph. Barral / M. Joly 4 745 4 50 Plan Ph. Barral / M. Joly 5 745 5 20 Plan Ph. Barral / M. Joly
448
BiBRacte – centRe aRchéologique euRopéen
Rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont Beuvray
BiBliogRaphie
Bouillé 1977 : BOUILLÉ (F.) — Un modèle universel de banque de données simultanément partageable, portable, répartie. Paris : université Pierre et Marie Curie/Paris VI, 1977 (Thèse d’État).
Colloque international d’archéologie urbaine 1982 : COLLOQUE INTERNATIONAL D’ARCHÉOLOGIE URBAINE — Archéologie urbaine. Actes du colloque international, Tours, 17-20 novembre 1980. Paris : AFAN, 1982.
Denègre, Salgé 2004 : DENÈGRE (J.), SALGÉ (F.) — Les systèmes d’information géographique. Paris : Presses Universitaires de France, 1996 (Réed. 2004).
Fichtl 2000 : FICHTL (St.) — La ville celtique : les oppida de 150 av. J.-C. à 15 apr. J.-C. Paris : Errance, 2000 (Réed. 2005).
Galinié et al. 2004 : GALINIÉ (H.), RODIER (X.), SALIGNY (L.) — Entités fonctionnelles, entités spatiales et dynamique urbaine dans la longue durée. In : Histoire & Mesure, XIX - 3/4, 2004, p. 223-242. URL : http://histoiremesure.revues.org/761 (octobre 2012)
Goudineau, Kruta 1980 : GOUDINEAU (Chr.), KRUTA (V.) — Les antécédents : y a-t-il une ville protohistorique ? In : DUBY (G.) dir. — Histoire de la France urbaine, tome I, La ville antique. Paris : Le Seuil, 1980, p. 143-231.
Hofmann 2005 : HOFMANN (E.) — Présentation de la base AlyAS : de l’entre deux eaux à l’entre deux fleuves, ou les méandres du SIG lyonnais. In : FUCHS (M.) dir. — Positionnement des collectivités territoriales dans la chaîne de l’archéologie : vers une logique de coopération ? Actes de la table Ronde. Strasbourg, 21-22 octobre 2005. Strasbourg, 2005, p. 23-27.
Kaenel 2006 : KAENEL (G.) — Agglomérations et oppida de la fin de l’âge du Fer : une vision synthétique. In : HASELGROVE (C.) dir. — Celtes et Gaulois, l’Archéologie face à l’Histoire, 4 : les mutations de la fin de l’âge du Fer. Actes de la table ronde de Cambridge, 7-8 juillet 2005. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2006, p. 17-39 (Bibracte ; 12/4).
Lorho 2008 : LORHO (Th.) — SIGUR : un SIG pour la pratique de l’archéologie en milieu urbain. In : MOSCATI (P.) éd. — Archeologia e Calcolatori, n° 19. Rome : Edizioni All’Insegna del Giglio, 2008, p. 61-72.
URL : http://soi.cnr.it/archcalc/indice/PDF19/5_Lorho. pdf (octobre 2012).
Meylan 2005 : MEYLAN (F.) — Les influences romaines dans l’architecture et l’urbanisme de l’oppidum de Bibracte (Mont Beuvray). Dijon ; Lausanne : université de Bourgogne ; université de Lausanne, 2005 (Thèse de 3e cycle des universités de Bourgogne et Lausanne ; Vol. 1 – texte, en ligne). URL : http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,40,5,20060621170232-QX/These_Meylan. pdf (octobre 2012).
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’information archéologique doit être spatia-lisée et hiérarchisée afin de faciliter les passages entre l’échelle de l’entité archéologique et celle de l’oppidum entier. L’organisation doit ainsi être à la fois dynamique et évolutive. De ce fait, le SIA va permettre de réaliser l’inventaire des découvertes archéo-logiques à Bibracte dans une base de données à référence spatiale tout en étant un outil de recherche dynamique d’occupation de l’oppidum sur la base de critères thématiques, spatiaux, et temporels, avec la possibilité d’une combinaison de ces derniers. Cela va permettre de tenter de répondre aux nombreuses questions concernant l’évolution de l’agglomération gauloise et pré-antique à travers la construction et l’architecture (en lien avec la mise en place d’un pro-chain groupe de travail sur l’architecture) en tenant compte des trois composantes.
Dans l’immédiat, le travail va se concentrer sur la création de la base de données, suivie des premières implémentations sémantiques et géo-graphiques afin de tester la bonne cohérence du système en implémentant les nouvelles données issues des fouilles qui seront produites dans le cadre du prochain programme quadriennal. Dans ce même laps de temps, l’objectif sera aussi de recenser et d’implémenter toutes les opérations et les emprises des fouilles qui ont eu lieu à Bibracte depuis le milieu du xixe siècle.
Enfin, dans un projet beaucoup plus large, il serait intéressant de réfléchir à la manière de pouvoir inclure au SIA les informations 3D (photogrammétries, res-titutions architecturales…) qui commencent à être proposées par les équipes de recherche.
449BIBRACTE. Centre archéologique européen
RappoRt annuel 2012 du pRogRamme de RecheRche suR le mont BeuvRay VI – Méthodologie de la RecheRche
vi-5. gestion et exploitation des données spatiales à l’aide d’un système d’infoRmation aRchéologique
Peuquet 1994 : PEUQUET (D. J.) — It’s about time : A conceptual framework of temporal dynamics in geographic information systems. In : Annals of the Association of American Geographers, 84, 3, 1994, p. 441-461.
Pirot 2009 : PIROT (F.) — De la modélisation spatiale. Application de la Théorie des Graphes au domaine spatial (géographique). In : L’interprétation des graphes, atelier méthodologique TIC-Migrations. Paris, mars 2009. URL : http://www.en.ticmigrations.fr/wp-content/uploads/2011/11/graphes-pirot.pdf (octobre 2012).
Pirot, Varet-Vitu 2004 : PIROT (F.), VARET-VITU (A.) — Introduction. In : Histoire & Mesure, XIX - 3/4, 2004, p. 219-222. URL : http://histoiremesure.revues.org/index1216 (octobre 2012).
Rapport annuel 2006 : BIBRACTE, Centre archéologique européen. Rapport annuel d’activité 2006. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2006, 240 p.
Rapport annuel 2007 : BIBRACTE, Centre archéologique européen. Rapport annuel d’activité 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2007, 265 p.
Rapport annuel 2008 : BIBRACTE, Centre archéologique européen. Rapport annuel d’activité 2008. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2008, 475 p.
Rapport annuel 2009 : BIBRACTE, Centre archéologique européen. Rapport annuel d’activité 2009. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2009, 309 p.
Rapport annuel 2010 : BIBRACTE, Centre archéologique européen. Rapport annuel d’activité 2010. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2010, 475 p.
Rapport annuel 2011 : BIBRACTE, Centre archéologique européen. Rapport annuel d’activité 2011 ; rapport triennal 2009-2011. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2011, 640 p.
Rodier 2000 : RODIER (X.) — Le système d’information géographique TOTOPI : TOpographie de TOurs Pré-Industriel. In : Les petits cahiers d’Anatole, 4, 2000. URL : http://citeres.univ-tours.fr/doc/lat/pecada/F2_4.pdf (octobre 2012).
Rodier, Saligny 2010 : RODIER (X.), SALIGNY (L.) — Modélisation des objets historiques selon la fonction, l’espace et le temps pour l’étude des dynamiques urbaines dans la longue durée. In : Cybergeo : European Journal of Geography [revue en ligne], Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, article 502, juin 2010. URL : http://cybergeo.revues.org/23175 (octobre 2012).
Saint-Gerand 2005 : SAINT-GERAND (Th.) — Comprendre pour mesurer… ou mesurer pour comprendre ? HBDS : pour une approche conceptuelle de la modélisation géographique du monde réel. In : GUERMOND, (Y.) dir. — Modélisations en géographie. Déterminismes et complexités. Paris : Hermès Science, 2005, p. 261-298.
Servigne, Libourel 2006 : SERVIGNE (S.), LIBOUREL (Th.) — Fondements des bases de données spatiales. Paris : Hermès Science, Publications Lavoisier, 2006.
Theriault, Claramunt 1999 : THERIAULT (M.), CLARAMUNT (C.) — La représentation du temps et des processus dans les SIG : une nécessité pour la recherche interdisciplinaire. In : CASSINI, GROUPE TEMPS ET ESPACE — Représentation de l’espace et du temps dans les SIG, Revue internationale de géomatique, 9, 1, 1999, p. 67-99.
Vaginay 2009 : VAGINAY (M.) — Les Gaulois sont dans la ville : décoloniser la ville celtique de l’âge du Fer. In : BUCHSENSCHUTZ (O.), CHARDENOUX (M.-B.), KRAUSZ (S.), VAGINAY (M.) dir. — L’âge du Fer dans la boucle de la Loire – Les Gaulois sont dans la ville. Actes du 32e colloque international de l’AFEAF, Bourges, 1er au 4 mai 2008. Tours : FERACF, 2009, p. 169-181 (Revue Archéologique du Centre de la France [RACF], supplément ; 35).
v
Le sommaire du présent rapport présente des particularités qui ont deux origines. Elles résultent d’abord de la volonté d’exposer de façon plus complète et rigoureuse les recherches conduites pendant l’année écoulée, comme on l’argumente et le précise dans un des chapitres qui suit (chapitre VI.6). Elles découlent aussi du caractère atypique de la campagne 2012 : inscrite dans le prolongement du programme triennal 2009-2011, cette campagne a permis de compléter des actions développées durant les années précédentes et surtout de préparer une nouvelle programmation pluriannuelle, plus précisément quadriennale (2013-2016).
Ce volume rend donc compte de façon synthétique des recherches et travaux de l’année 2012 auxquels s’ajoutent des compléments d’information pour des travaux réalisés en 2009-2011. Ce rapport s’appuie sur un référentiel analytique, dossier documentaire regroupant autant que possible la totalité des données collectées et traitées durant la campagne (catalogues des unités de fouille avec inventaire sommaire du mobilier, catalogues des minutes de fouille et diagrammes stratigraphiques…) et téléchargeable en ligne sur le site internet de Bibracte.
Ce rapport annuel 2012 du programme de recherche sur le Mont beuvray est complété du projet scientifique pour les quatre années à venir. Ce projet, sous forme de volume séparé, propose un tour d’horizon des enjeux scientifiques que le site du Mont Beuvray permet d’aborder en s’appuyant sur les résultats déjà réunis depuis la reprise des fouilles en 1984 et en tentant de hiérarchiser les enjeux en fonction de considérations scientifiques générales et des contraintes opérationnelles propres au site. Il décrit le projet opérationnel pour les quatre années à venir, articulé en actions de recherche thématiques et en actions fédératrices et s’attache enfin aux moyens et méthodes qui seront mis en œuvre pour atteindre les objectifs préalablement définis.
Pour télécharger le rapport et ses référentiels analytiques
www.bibracte.fr.
Édition numÉrique ISBN : 978-2-909668-75-8
F - 58370 GLUX EN GLENNE / Tél. : (33) 03 86 78 69 00 / Fax : (33) 03 86 78 65 70 E-mail : [email protected] Site web : http://www.bibracte.fr
Centre archéologique européen
mot-clé : rapport 2012




















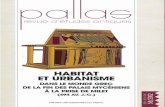











![Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ca7d5665120b3330bf65c/urbanisme-insoupconne-projeter-la-ville-egyptienne-au-nouvel-empire-unsuspected.jpg)






