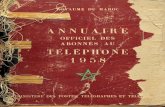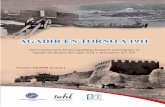Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc : étude de leurs...
Transcript of Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc : étude de leurs...
Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
Etude de leurs pratiques socio-spatiales
Mémoire de master 1 de géographie soutenu le 23 septembre 2014Pôle Géographie Aménagement Environnement
Elsa Lachaud
COMPOSITION DU JURY
Directeur : M. Ali BENSAAD, maître de conférence, IREMAM, Aix-Marseille.
Co-directeur : M. Mohamed CHAREF, professeur, ORMES, Agadir.
Examinateur : M. Marc CÔTE, professeur émérite, Aix-Marseille.
Ce mémoire a obtenu la note de : / 20
Date : 23/09/2014
Signature du directeur de recherche :
Remerciements
Je souhaite remercier les personnes qui m’ont aidée à la réalisation de ce mémoire en m’offrant leur temps et leurs compétences :
- à Monsieur Bensaad et Monsieur Charef pour avoir accepté de m’encadrer le temps d’une année et m’avoir fourni de précieux conseils ;
- un grand merci à l’équipe des doctorants (et futurs doctorants) en géographie de l’Université Ibn Zohr, pour leur accueil et leurs suggestions ;
- une attention toute particulière à Hamid Jamour, pour son soutien sans faille, son amitié et les bons moments passés ensemble ;
- merci à Brenda Le Bigot pour notre belle rencontre due au hasard, pour sa patience et ses conseils de rédaction ;
- une pensée à Sara Ouddir, sa disponibilité et nos échanges d’informations ;
- merci à Sophie, pour m’avoir accueillie chez elle, m’avoir orientée et conseillée lors de mes premiers pas au Maroc ;
- merci à ma famille pour leurs encouragements et le temps passé à me relire ;
-etenfin,untrèsgrandmerciàtouslesEuropéensquiontacceptéde me rencontrer, et m’ont encouragée dans ma démarche. Ce mémoire n’aurait pu aboutir sans leur participation.
Photo de première de couverture : La baie d’Agadir vue depuis la Kasbah. Cliché : Lachaud E., mars 2014
1
Résumé
Le phénomène croissant des migrations « Nord-Sud » à destination du Maroc soulève de nouvelles problématiques. Ces mobilités, qualifiées de lifestyle migration, traduisent la recherche d’une meilleure qualité de vie par une population privilégiée. L’objectif de ce mémoire est d’étudier les pratiques socio-spatiales de ces migrants européens venus résider dans le Grand Agadir. Mots clés : Grand Agadir, migrants européens, lifestyle migration, pratiques socio-spatiales.
Abstract
The Grand aGadir as a place of residence for european miGranTs in morocco : sTudy of Their socio-spaTial pracTices. The growing phenomena of ‘North-South’ migrations to Morocco raises new issues. These mobilities, called lifestyle migration, reflect the search of better quality of life by a privileged population. The purpose of this essay is to study the socio-spatial practices of these European migrants came to reside in the Grand Agadir. Key words : Grand Agadir, European migrants, lifestyle migration, socio-spatial practices.
3
5
Sommaire
Introduction ................................................................................................................................................................................................................... 7
Chapitre I - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire ....................... 11
1. Méthodologie ................................................................................................................................................................................................... 122. Concepts et choix des termes ...................................................................................................................................................... 213. Lifestyle migration .................................................................................................................................................................................... 264.LesEuropéensauMaroc:cadragestatistique,juridiqueetlittéraire ....................................... 32
Chapitre II - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir .. 43
1.Entretourismeetrésidence,unterritoireauxparticularitésbienencrées .......................... 442. Les raisons de migrer : un facteur typologique essentiel ......................................................................... 493.Deladiversitédesmigrantsàl’établissementdehuitprofilstypologiques .................... 624. Des migrations à l’origine de tensions socio-spatiales sur le territoire .................................. 77
Chapitre III - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoire ................................................................. 85
1.LarelationdesEuropéensavecl’espaceurbaind’Agadir:entreparcours résidentiel et lieux de vie quotidienne ............................................................................................................................ 86
2.LaperceptionetsocialisationdesEuropéensàproposde leur migration à Agadir ..................................................................................................................................................................... 100
3. Une migration dans un pays culturellement très différent : adaptation, attachement,etdéfinitiondesoi ............................................................................................................................................ 107
Conclusion .......................................................................................................................................................................................................................... 119
Bibliographie .................................................................................................................................................................................................................... 127Sitographie ........................................................................................................................................................................................................................... 131
Table des annexes ....................................................................................................................................................................................................... 133Table des matières ...................................................................................................................................................................................................... 160Table des illustrations ............................................................................................................................................................................................ 162
7
Introduction
LeMarocestidentifiécommeunespacedetransitetd’immigration,accueillant un grand nombre de migrants subsahariens en route pour le continent européen. Il est moins courant d’évoquer ce pays d’immigration selon une logique « Nord-Sud ». Pourtant, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2004 a répertorié une majorité d’étrangers d’origine européenne, constituant 45,9 % de la population étrangèrerésidantauMaroc,avecunemajoritédeFrançaisetEspagnols(Direction de la Statistique, 2009). Ce nombre est à relativiser car le RGPH ne prend pas en compte tous les étrangers en situation irrégulière sur le territoire1.Cependant,celametenavantl’importancedesfluxmigratoires«Nord-Sud»,etpasuniquementlesflux«Sud-Sud»et«Sud-Nord».
Le Maroc est une destination très touristique, notamment pour les Européens,maisaussiuneterreancienned’immigration.Lesprincipalespréfectures accueillant ces étrangers sont Casablanca et Rabat, ainsi queFès,Marrakech,Tanger, etAgadir.La littérature scientifique a toutparticulièrement étudié ce phénomène à Casablanca (McGuinness, 2012), Fès (Berriane, 2009 ; Berriane et al., 2010), Marrakech et Essaouira(EscherandPetermann,2012;Ernst,2012;Programme«Emergence(s)»,2012-2014), avec notamment l’établissement des Européens dansles centres anciens, favorisant ainsi une gentrification des médinas(Kurzac-Souali, 2010). Ces villes sont surtout occupées par des membres de l’élite, de nombreux retraités, et de jeunes étrangers venus s’installer au Maroc pour se lancer plus facilement dans la vie professionnelle, fuyant ainsilesconséquencesdelacriseenEurope.
Il est intéressant de poursuivre ces études à la ville d’Agadir, témoin d’une extension du phénomène migratoire vers le sud du pays. De plus, le profil desmigrants européens semble se différencier par rapport auxvilles situées au nord et à l’est du Maroc. Cependant, ces mobilités sont multiples et difficiles à définir. Les facteurs communs à la populationétudiée sont donc à préciser. Le migrant est traditionnellement désigné par un changement de son lieu de résidence, associé à une dimension espace-temps impliquant différents critères de distance et de durée (Boyle, 2009). Dans cette étude les migrants européens correspondent à tout Européen résidant régulièrement auMaroc pendant aumoins troismoisparan.Eneffet,certainsdecesEuropéenspossèdentunerésidenceprincipale ou secondaire à Agadir. D’autres n’ont pas toujours le même lieu de résidence, mais reviennent régulièrement dans le Grand Agadir. Le choix de cette population repose donc sur la durabilité de leur présence au Maroc d’une année sur l’autre, et sur le fait qu’ils se considèrent comme différents des touristes.
Dans le langage courant les Européens sont désignés par le termed’ « expatrié », alors que les Subsahariens sont des « immigrés ». Pourtant seule la connotation négative accordée à ce dernier terme justifie cette
1. Ce recensement est effectué à partir de la déclaration des enquêtés, et sur la base de résidence au Maroc, sans tenir compte de la détention d’un permis de séjour. Enthéorie,leRGPH inclut les populations en situation irrégulière, mais celles-ci sontdifficilementestimables, et peu favorables à être approchées pour un recensement.
IntroductIonLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
8 9
différence d’appellation. Dans ce mémoire le choix est fait de désigner lesEuropéensrésidantauMaroccommedes«migrants».Cecipermetdecombattre les faux préjugés et de conserver la dimension de mouvement qui est moins présente pour la notion d’ « expatrié ». De plus, le terme de «migrant»permetd’étudiercesEuropéenssanssefocalisersurunangled’approche à sens unique avec le binôme « émigré »/« immigré ». Cette étudemetenvaleurladifficultédedéfinirlapopulationétudiée,etremeten cause les limites entre les notions de touriste, résident et migrant. La plupartdecesEuropéenspartagentunemotivationcommuneconcernantle choix de leur mobilité. Le climat attrayant d’Agadir, sa situation géographique, et le coût moins élevé de la vie sont ainsi les principaux facteurs pour ces personnes à la recherche d’une meilleure qualité de vie. Ce phénomène, récurrent dans plusieurs régions dumonde, est qualifiéde lifestyle migration par les chercheurs anglo-saxons (Benson and O’Reilly, 2009). Ce concept, abordé du point de vue des migrations plutôt que des mobilités, conforte le choix du terme de migrant pour désigner la population étudiée.
Ces migrations internationales se déroulent selon différentes tempora-litésenfonctionduprofildesmigrants.Ellespeuventêtrepermanentes,outemporaires avec une résidence alternée pour venir en villégiature. Cette présence de migrants européens n’est pas sans conséquences – qu’elles soient positives ou négatives – pour la ville d’Agadir. Il convient d’étudier ce phénomène afin de comprendre quelles relations cesmigrants entre-tiennent avec l’espace et les populations locales.
Plusieurs questionnements apparaissent en lien avec la présence des Européensrésidantdanslavilled’Agadir.Ilsserontabordésselonquatreaxes tout au long de ce mémoire.
Le premier axe de questionnement choisi est celui de l’homogénéité dugroupeétudiéetsatranscriptiondansl’espace.Eneffet,afind’établirunetypologiedecesmigrants,ilestimportantdes’intéresseràleurprofilsociologique et migratoire. Le milieu social dont ils sont issus, ainsi que leur profession ou leur statut sont à prendre en compte. De plus, la temporalité de leurs migrations et la fréquence de leurs retours dans le pays d’origine sontdesfacteurssignificatifs.Seposeainsilalimitedesstatistiquessurcesmigrants, car certains peuvent travailler de façon informelle, ou renouveler leur visa touristique tous les troismois en retournant en Europe. Il estégalement nécessaire de s’interroger sur une corrélation qui pourrait être établie entre le profil desmigrants européens et leur territorialité, ainsique leur intégration dans le milieu socio-spatial. Cette homogénéité parmi les migrants incite à s’interroger sur les liens qui s’établissent entre eux. Peut-on observer un regroupement par nationalité, ou au contraire une certaine homogénéité avec un sentiment commun d’identité en tant qu’EuropéensouOccidentaux?
Un second axe de questionnement concerne l’intégration de ces migrants au sein de la société marocaine et de l’espace urbain. Une attention spécifique doit être portée aux espaces de vie quotidiennede ces migrants afin de questionner leurs modes d’appropriation del’espace local. Ils peuvent mettre en évidence des lieux communs, de regroupement, ou de rattachement à une même identité. Cela peut aussi répondre à une recherche de sociabilité et d’échanges avec les populations locales. L’appartenance de ces migrants à une certaine catégorie sociale peut également influer sur le territoire et l’organisation de l’espace.Eneffet, l’arrivée massive de retraités en camping-cars pour une durée limitée durant la belle saison engendre un fort impact sur l’espace. Dans une même perspective,uneprogressivegentrificationdesquartiersdeprédilectiondeces communautés européennes peut avoir lieu. Cette double dimension de la société marocaine et de l’espace urbain est étroitement liée à la plus ou moins grande intégration des migrants européens. Peut-on distinguer une fragmentation spatiale et/ou sociale du fait de la présence de ces migrants, ouàl’inverseuneouvertureverslamixitéetunmulticulturalisme?
Dans un troisième axe de réflexion, l’interrogation porte sur laperception de leur propre migration par les individus interrogés. Les migrations ne sont pas sans conséquences, qu’elles soient positives et/ou négatives, pour le développement local, la population d’accueil et pour les migrantseux-mêmes.MaisquelleperceptioncesEuropéensont-ilsdeleurpropreprésencesur le territoirevis-à-visdespopulations locales?Celapourrait être considéré comme positif car permettant de faire fonctionner l’économie locale, avec notamment la construction de nouveaux logements spécialisés dans l’accueil de ces migrants2. Cependant, la concurrence sur le marché du travail peut être perçue comme une limite. Des réglementations sont mises en place telle que l’Agence nationale de promotion de l’emploi etdescompétences(ANAPEC),obligeantl’employeuràjustifierl’emploid’unétrangerlorsqu’aucunMarocainnecorrespondpasauprofilrecherché(Khrouz, 2013). Mais malgré cette initiative il subsiste toujours une concurrence, comme celle du secteur des hébergements touristiques dans lequellesEuropéensdéveloppentdeschambresd’hôtesoudeshôtelsdemanière informelle.
Le quatrième axe de questionnement s’intéresse aux différences culturelles entre Marocains et migrants. Les mariages binationaux et souvent intergénérationnels peuvent entraîner un problème éthique pour lespopulationslocalesoulesEuropéens.BienqueAgadirsoitconnuepoursamodernitéprochedel’Europe,etsonsurnomde«villedelatolérance»(Bensimon, 2012), les différences culturelles ne peuvent être omises. Certains migrants arrivent au Maroc avec de nombreuses idées reçues et sontconfrontésàdesobstaclesqu’il leurestdifficiledesurmonterpours’adapter. Le passé colonial peut également ressurgir face à la venue de beaucoup de Français à Agadir. Ainsi, les différences sociologiques et religieusessont-ellesunesourcedetensionentrelesdeuxcommunautés?
2. Le village de l’Orangeraie, situé à 40 minutes d’Agadir, accueille depuis 2011 des seniors européens venus s’installer dans des villas conçues spécialement pour eux par le groupe immobilier Dyar Shemsi. Ce concept peut sembler négatif pour son apparence de « gated-community », mais il est aussi possible de mettre en avant l’offre de nombreux emplois pour les ouvriers du bâtiment de la région. (Giedinger, 2011)
11
Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
10
La question principale de recherche est une synthèse de ces quatre axes de questionnements. Elle porte sur la territorialité et l’expressionsociale de ces migrants. Comment se traduit spatialement et socialement laprésencedesmigrantseuropéens résidantdans leGrandAgadir?Cephénomène de migration « Nord-Sud » n’est pas unique à la ville d’Agadir. Cependant chaque situation est différente, Agadir n’attire pas les mêmes profilsd’Européensqued’autresvillesmarocaines.Latraductionspatialeet sociale de ces migrants doit donc être étudiée pour en comprendre les particularités, mais aussi de possibles points communs généralisables à l’échelle nationale.
Deux hypothèses principales répondent à cette question de recherche. La première suppose que la présence des migrants européens est à l’origine de tensions socio-spatiales. Celles-ci se caractérisant par une augmentation duprixdu foncierdans lesquartiersprivilégiéspar lesEuropéenspoury résider, ainsi que par une concurrence très marquée dans l’activité économique majeure qu’est le tourisme. Il est ensuite posé comme hypothèse que ces migrants ont tendance à se regrouper par communauté. Ils recréent leur propre espace de vie européen en ne facilitant pas toujours le contact avec les populations locales. De ce fait, il y aurait une tendance à une double fragmentation, à la fois sociale et spatiale du territoire.
Afinderépondreàcettequestionderecherche,plusieursméthodesontété mises en place. Une recherche de données quantitatives a été effectuée au préalable et durant le travail de terrain. Cette démarche fut complétée parlalecturedenombreuxarticlesetouvragesscientifiquespermettantdemieuxdéfinirlesujetderecherche.Puisaucoursd’uneenquêtedeterrainde sept semaines consécutives effectuée à Agadir, l’observation et la mise en place de trente entretiens semi directifs ont été combinées.
Un premier chapitre permettra d’expliquer la démarche de recherche et d’introduire les principaux concepts tel que la migration, le territoire et les lifestyle migrations. Il conviendra également de présenter les particularités des Européens au Maroc, lors d’un cadrage statistique, juridique etlittéraire.
Puis un deuxième chapitre s’ouvrira sur un essai typologique permettant de mettre en évidence les caractéristiques de ces migrants européens dans le Grand Agadir. Ces catégories seront déterminées en fonction de six facteurs typologiques. L’hypothèse des tensions socio-spatiales liées à la présence des migrants sur le territoire sera ensuite abordée.
Enfin,lesmigrantsontunerelationplurielleàl’espaceurbaind’Agadir.Ceci sera démontré dans un troisième chapitre en lien avec leur perception etlatraductionsocio-spatialedecesEuropéenssurleterritoire.
Chapitre I
Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
12 13
1. Méthodologie
Ce mémoire est le résultat d’un travail de terrain de sept semaines, effectué dans le Grand Agadir du 10 février au 31 mars 2014. Le choix de cettepériodeétaitidéalafinderencontrerlesretraitésvenuspasserl’hiveràAgadir,etrepartantgénéralementàlafindumoisdemarsoudébutavril.
Un contrat de stage en laboratoire de recherche a été établi entre l’Université Aix-Marseille, et l’Observatoire régional des migrations, espacesetsociétés(ORMES)àAgadir.Bienquecetravailderechercheait été effectué en grande partie de façon autonome, il a été possible d’échanger avec les professeurs et les étudiants doctorants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Ibnou Zohr.
La carte 1 ci-dessous permet de situer l’étendue du terrain d’étude. Le Grand Agadir est composé de cinq communes rurales et quatre communes urbaines dont celle d’Agadir. Il est situé au sud du Maroc dans la région du Souss Massa Drâa. Le choix de ce terrain permet de comprendre le phénomène dans son ensemble, et d’observer deux types demigrantsEuropéenstrèsprésentsdanslescommunesruralesd’Aouriret de Taghazout : les surfeurs et les camping-caristes. Ces derniers sont principalement sur la côte, mais également dans l’intérieur des terres.
Carte 1 : Les délimitations du Grand Agadir telles qu’elles sont représentées sur cette carte correspondent aux limites données par le Plan communal de développement de la ville d’Agadir 2010 / 2016.
Cependant, pour des raisons de temps et de transport, une grande partie des observations, et tous les entretiens ont été menés au sein de la Commune urbaine d’Agadir qui correspond au chef-lieu de l’agglomération du Grand Agadir.
La démarche déductive utilisée dans ce mémoire de recherche empirique peut être établie grâce à différentes méthodologies.Afin d’aborder lesnotions de perceptions et de sentiments d’identité il est pertinent d’utiliser des méthodes qualitatives. Celles-ci se sont déroulées selon trois phases : la conception, la réalisation de terrain puis l’analyse des données. La mise en place d’une telle méthodologie, afin de confirmer ou infirmerles hypothèses posées, a nécessité un protocole préparé au préalable. Les enquêtes de terrain étaient également précédées par une première prise decontactaveclespersonnesconcernées,etuneidentificationdeslieuxles plus fréquentés par ces migrants. La plupart de ces démarches sont recensées dans un planning (Cf. Annexe 1). De plus, tout au long du travail deterrainunjournaldebordfutrégulièrementmisàjourafindefairepartdesdifférentesréflexionsetobservationsméthodologiquesetsubjectives(Cf. Annexe 2).
Le travail concernant l’état de l’art fut poursuivi durant le séjour au Maroc. La rencontre avec quelques étudiants et doctorants travaillant sur un sujet proche, a permis l’échange de contacts et de références bibliographiques. Des informations concernant les migrations et la ville d’Agadir ont pu être trouvées dans la petite bibliothèque du pôle géographie à l’Université Ibn Zohr, et au centre de documentation de l’Institut français d’Agadir. Une phase de recherche a également consisté à prendre connaissance des différents blogs et forums disponibles sur Internet,carlesEuropéensrésidantauMarocfonctionnentbeaucoupparl’intermédiaire de ces forums de voyage et d’expatriés pour des échanges d’informations et de ressentis.
L’interprétation des données qualitatives a été réalisée en prenant en compte le biais dû au statut social ainsi que celui de la position de jeune chercheur(Fournier,2006).Ladifficultédecetravaildeterrainreposaitdonc en grande partie sur les incompréhensions pouvant s’établir lors des entretiens : « Le décalage entre ce que l’enquêté essaye de "transmettre" et ce que l’enquêteur "perçoit" reste incommensurable » (Aggoun, 2009 : 14).
Deux principales méthodes ont été croisées lors du travail effectué sur le terrain : l’observation et l’entretien. Il convient d’abord de préciser quelle est la population étudiée.
1.1 Population étudiée
La population étudiée lors de ce travail de terrain correspond à tous les Européens,quellequesoitleurnationalité.Cechoixestdûaufaitdelaproximité du continent avec le Maroc, et donc du nombre non négligeable demigrationsdel’EuropeversAgadir.Cependantlatypologieneprend
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
14 15
pas en compte les touristes européens, mais uniquement ceux venus vivre un certain nombre de mois dans le Grand Agadir, ou renouvelant leur venue tous les ans. LesMarocains résidant à l’étranger (MRE) nesont pas pris en compte dans cette étude car leur parcours et leur mode de vie nécessiteraient un travail séparé. Les personnes ayant une double nationalité, marocaine et d’un pays européen, ne sont donc pas étudiées.
Par manque de temps sur le terrain cette population étudiée a été restreinte avec des facteurs supplémentaires pour mener les entretiens. Seulestroispersonnesontfaitexceptionàcescontraintesafindediversifierlesprofilsetdefaciliterunetypologieplus juste.Cesont troisFrançaisrésidant en camping-car pendant plus de trois mois l’hiver dans le camping situé au centre d’Agadir. Hormis leur logement, ils correspondent aux critères établis, et sont sédentaires durant toute la période passée à Agadir.
Troiscritèresontétéassociéspourdéfinirlapopulationinterrogée:- Le facteur temporel : ils résident au moins trois mois par an à
Agadir, que ce soit de façon consécutive ou non. - La situation et le statut : ils vivent dans un logement dont ils sont
propriétaires ou locataires, autre que dans une chambre d’hôtel et dans un camping-car. Ils possèdent leur résidence principale à Agadir, ou ils reviennent régulièrement tous les ans dans la même ville.
- Un facteur de perception : ils ne se considèrent pas comme des touristes.
Aucuncritèren’aétédéfiniselonl’âge.Parmilespersonnesinterviewéesil y a huit actifs et trente retraités. Ces derniers représentent effectivement lamajoritédesEuropéensvenantvivreàAgadir.
1.2 Observation
L’observationfutalternéeavecunepériodederéflexionetd’écrituredu journal de bord. Cette méthode permet de comprendre les pratiques réelles qui ne sont pas toujours soulevées lors des entretiens, et il peut y avoir certains décalages entre le discours et la pratique. Les migrants interviewésn’ontpas toujoursdereculsur leurmodedevieetpeuventdonner une image de leur pratique quotidienne qui diverge de la réalité. Certains d’entre eux font aussi le choix de ne pas tout transmettre lors des entretiens, soit parce qu’ils ont peur d’être jugés, soit pour conserver une plus grande intimité.
La rédaction quotidienne d’un carnet de bord est un moyen de communiquer de façon plus personnelle le ressenti et les observations faites durant les journées de terrain. Rédigé à la première personne, il transmet également les doutes, les incompréhensions, et les obstacles rencontrés. Cet exercice permet d’ordonner et de poser sur papier le fourmillement d’idées et d’impressions omniprésentes à l’esprit lors d’un tel séjour de terrain à l’étranger. Le fait de vivre sur son terrain d’étude donne le sentiment de constamment observer autour de soi. Le terrain est vécu par le chercheur.
L’écriture du journal de bord permet de retranscrire partiellement ce vécu,uneautrepartieaideà laconstructiond’une réflexionsur lesujetde recherche. Ce vécu a été accentué par le fait de vivre aux côtés d’une Française résidant toute l’année à Agadir. L’observation et les discussions auquotidienontpermisd’apporterdenouveauxélémentsderéflexion.
Les étapes suivant l’observation sont l’écriture des faits tels qu’ils ont été observés, puis une phase de réflexion afin de s’interroger surla signification du phénomène observé. L’observation « statique » del’environnement urbain permet de mieux appréhender les pratiques socio-spatiales des gens qui habitent la ville. Mais ce territoire est également en mouvement, comprendre son évolution en cours telle que la modernisation d’un quartier, c’est saisir le territoire dans son ensemble afinderéfléchirsurdenouvellespratiques.Ilaparfoiséténécessairederetournersurleterrainpourconfirmerouinvalideruneobservationfaiteauparavant. Le chercheur doit s’efforcer de tendre vers une plus grande objectivité, en passant outre ses préjugés de départ.
Afindemieuxs’approprierl’espaceetdecomprendrelediscoursdesEuropéenslorsdesentretiensconcernantleurspratiquesdanslaville,lesdéplacements ont été effectués majoritairement à pied, laissant une certaine place à l’imprévisibilité. Cependant le taxi était aussi un moyen d’observer différemment, et de discuter avec les chauffeurs, apportant ainsi de nouveaux éléments au travail mené. L’appareil photo et le carnet de notes ontétédefidèlescompagnonstoutaulongduterrain.Cetteobservationpermettaitégalementàlapersonneinterviewéed’expliquerdansledétailses pratiques quotidiennes sans être gênée du fait de la méconnaissance du terrain par le chercheur.
La méthodologie privilégiée pour observer la ville fut celle de la répartitionparquartiers.Eneffet,letypedebâtietl’atmosphèrequis’endégagent sont particuliers à chaque quartier ou regroupement de quartiers. L’observation morphologique de la ville fut également complétée par celle du comportement des personnes, que ce soit dans un commerce, un restaurant, ou sur un lieu public. De nombreuses photographies ont été prisesafinderendrecomptedelamorphologiedesquartiersenfonctionduchoixderésidencedesEuropéens.
1.3 Entretiens individuels
L’entretien individuel est une technique très souvent utilisée dans la collecte de données qualitatives. A la différence des enquêtes quantitatives qui nécessitent un échantillon représentatif de la population, l’entretien utiliseunéchantillonpermettantd’interviewerdespersonnesauxprofilsdifférents. Il est ainsi possible de mieux comprendre la perception des populations vis-à-vis d’une situation.
Parmi les trois types d’entretiens, le semi-directif semblait le plus appropriécarintermédiaireauxdeuxautresapproches.Eneffet,l’entretien
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
16 17
dirigé se rapproche du questionnaire, avec des questions fermées afind’obtenir le même type d’informations auprès de différentes personnes. A l’opposé, l’entretien ouvert laisse une plus grande place à l’expression des personnesinterviewées,maistoutengardantunfilconducteurgrâceàdesquestionsfixéesàl’avance.
Sept entretiens libres ont été conduits avec différents acteurs en relation avec lesEuropéens afind’obtenir deplus amples informations.De plus, trente entretiens semi-dirigés ont été menés en suivant une grille d’entretien établie au préalable (Cf. Annexe 3). Vingt-cinq d’entre eux ont été enregistrés, les autres personnes ayant refusé. Les questions n’ont pas été systématiquement abordées mais chaque grande thématique fut évoquée,enfonctionde ladisponibilitédespersonnes interviewées.Untiers des enquêtés ont manifesté le souhait de connaître les résultats du mémoire, une restitution des informations recueillies sera donc effectuée.
L’échantillonnage est basé sur la méthode non probabiliste par « boule de neige », aussi appelé échantillonnage par réseau. Les individus interviewés sont choisis en fonction de leur appartenance à un réseaud’amitié, d’expatriés, social (tel qu’un blog d’expatriés) etc., selon leurs liens avec d’autres personnes interviewées. Pour ne pas introduire unbiais dans l’enquête, plusieurs « réseaux » différents ont été abordés. Cecis’estdoncfaitenfonctiondescontactsobtenus,maisendiversifiantaumaximum les profils afin d’obtenir des propos contrastés. Plusieurspersonnes ont également été abordées dans la rue ou sur leur lieu de travail afindefacilitercettediversificationdesprofils.
Les principales thématiques abordées lors des entretiens sont : - le parcours et les motivations de départ ;-lestatutofficieletlasituationadministrativeetfinancière;- le mode de vie et les pratiques spatiales quotidiennes ;- la perception.
Cette dernière thématique semble particulièrement importante, car elle permet aux personnes interviewées de s’exprimer à propos de leurperception du territoire et de leur mode de vie. C’est également l’occasion de comprendre quelle représentation ils ont d’eux-mêmes, mais aussi desautresEuropéensvenusvivreàAgadir.Lesprécédentesthématiquespermettent d’éclaircir leur situation actuelle et passée, et d’aborder leur relation avec l’espace urbain.
Le tableau 1 (page 17), présente une synthèse des entretiens semi-dirigés menés sur le terrain.
Nb total par nationalité F H Couple Actif Retraité Résident à
l’année« Bi-
résident »« Winter
bird »26 Français 12 14 3 7 19 15 5 66 Suédois 1 5 1 0 6 0 4 22 Anglais 1 1 0 0 2 2 0 02 Belges 1 1 1 0 2 0 2 01 Norvégien 0 1 0 0 1 0 0 11 Allemand 1 0 0 1 0 1 0 0
Total : 38 16 22 5 8 30 19 10 9
Trente entretiens semi-dirigés ont été effectués tout au long du terrain, d’une durée de 10 minutes à 2h15. L’âge des personnes interviewéesse situe entre 30 et 85 ans, avec une moyenne de 55 ans. Le tableau récapitulatifci-dessusprendencomptetouteslespersonnesinterviewées,même celles rencontrées lors d’un même entretien : cinq couples et deux groupesd’amisontétévusensemble.Afindefaciliterladifférenciationdecesmigrantseuropéens,troiscatégoriesontétédéfinies:
- Les résidents à l’année, qui sont propriétaires ou louent une résidence principale à l’année dans la commune d’Agadir.
- Les « bi-résidents », qui possèdent une résidence secondaire à Agadir. Leur vie est partagée entre leur pays d’origine et le Maroc où ils passent environ six mois par an.
- Les «winter birds », nom donné dans la littérature scientifiqueanglophone, désignent les Européens résidents auMaroc durant l’hiverpour une durée supérieure à 3 mois.
Cestroiscatégoriessontégalementlerefletd’unmodedeviedifférentet de pratiques quotidiennes distinctes dans la ville d’Agadir. Il est cependant possible que des personnes passent d’une catégorie à l’autre suivant l’évolution de leur projet de vie. Certains vont commencer par être«winterbird»pourfinalementdéciderdes’installerdéfinitivement.Le tableaudénombre le statut desEuropéens aumoment où ils ont étéinterviewés.
1.4 Méthodes employées pour répondre à chaque question de recherche
Lacombinaisondeplusieursméthodesestutiliséeafinderépondreauxcinq axes de questionnement présentés dans l’introduction.
Lepremieraxederéflexionportesurl’étudedel’homogénéitédugroupeétudié et sa retranscription dans l’espace. La méthodologie employée pour approcher ce phénomène fut particulièrement alternée. Une première phase d’observation fut facilitée par le statut de chercheur de nationalité française, bien que l’important écart d’âge rappelle constamment la différence de statut parmi la population étudiée. Mais ce dernier élément était également
Tableau 1 :Tableau de synthèse
des entretiens semi-dirigés.
Réalisation : Lachaud E., 2014.
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
18 19
un avantage car l’absence d’appartenance à un « groupe » en particulier permettait de mieux appréhender les individus et de passer outre certaines méfiances.Chaqueentretienapermisdeconfirmerounonlesobservations.Concernant un possible sentiment commun d’identité, les réponses étaient très personnelles. Les réactions des personnes interrogées lors des entretiens semblaient donc très distinctes, mais malgré les apparences elles étaient complémentaires. Ceci permit d’apporter des éléments de réponses et certains résultats alors inattendus lors de la première phase de terrain.
Le second axe de questionnement aborde les thèmes de l’intégration et de l’appropriation de l’espace par ces migrants. Le travail d’observation futtoutd’abordtrèsimportantafindesefamiliariseravecleterritoireetpermettant ainsi de mieux rebondir lors des entretiens. Cette observation au quotidien permettait de se faire une première idée de lieux particulièrement fréquentésparlesEuropéens,etàl’inverse,decertainsquartiersoùilssefont plus discrets. Les dates d’entretiens furent étalées tout au long de la période de terrain, permettant ainsi de les alterner avec de plus grandes phasesd’observation,etdelaisserplaceàlaréflexionetàl’élaborationdespistes sur les interrogations annoncées.
LetroisièmeaxederéflexionestessentiellementcentrésurlaperceptiondesEuropéensdeleurpropremigration.Lesentretiensfurentlesprincipauxmoyensderéponse,maiségalementlesdiscussionsquisuivirent.Eneffetl’entretien, bien que semi-dirigé, donne le sentiment d’une rencontre plus conventionnelle. Certains individus rencontrés s’ouvraient parfois plus à la suite de l’entretien, tout en s’informant sur les premiers résultats de l’enquête.
Le quatrième axe aborde les différences culturelles entre Marocains et migrants.Unedifficultésupplémentaires’estprésentéeàproposdecettethématique, du fait de la culture et de l’éthique du chercheur. Les personnes rencontrées, aux avis très différents, ressentaient parfois le besoin de se confier,deparlerdecertainesfrustrations,maistoutenjustifiantleurdésirde rester.D’autressouhaitaientprendreàpartie lechercheurafinde lesconforter dans leur discours. Il était donc nécessaire de trouver un équilibre lors des entretiens pour être le plus objectif possible dans les résultats de l’enquête.
Le cinquième axe de questionnement correspond à une interrogation principale regroupant les quatre premiers axes. L’étude de la traduction spatiale et sociale de ces migrants européens dans le Grand Agadir a donc été effectuée grâce à la combinaison de toutes les méthodes d’enquêtes citées précédemment. Les premières conclusions ont été confrontées avec leslecturesscientifiquesdestravauxdéjàeffectuésdanslerestedupays.Les échanges de ces résultats, lors de discussions avec des personnes plus ou moins reliées à l’étude, ont permis d’éclaircir les idées, de mettre des mots sur certains ressentis, et d’aboutir à la rédaction de ce mémoire.
1.5 Bilan critique de la méthodologie adoptée et retour sur le terrain
Le statut de chercheur en tant que jeune étudiante française fut en grand avantage pour s’introduire auprès de la population européenne. L’expérience d’une étudiante marocaine voilée a révélé de plus grandes difficultéspourmeneruneenquêteauprèsdesseniorsfrançaisd’Agadir.De plus, le fait de loger chez une Française contactée via le site expatblog durant tout le séjour de terrain, était une bonne opportunité pour trouver depremierscontactsetobserverlequotidiend’uneEuropéenneàAgadir.Cependant, le bilan de cette première expérience de terrain met l’accent surlaméfiancedelaplupartdesEuropéensvis-à-visdesentretiens,telsque le souligne l’extrait suivant du journal de bord :
« Je suis probablement arrivée à Agadir avec de nombreux préjugés, mais je pensais qu’il serait plus évident de rencontrer des Européens volontaires pour faire un entretien. Je réalise maintenant qu’il n’en est rien. Certaines personnes manifestent un très grand intérêt pour mon travail, ils me demandent de les tenir au courant des résultats de l’enquête. Cependant la grande majorité est réticente à l’idée de discuter. Parfois méfiants, ils me demandent si je travaille pour le gouvernement Marocain ou pour le Consulat. D’autres semblent peu ouverts à l’idée de partager leur vécu dans le cadre d’un entretien plutôt que d’un questionnaire. Il est vrai que l’entretien peu représenter une enquête plus personnelle et plus intime. Je suis donc régulièrement confrontée à des personnes méfiantes qui ne souhaitent pas me dévoiler leur parcours migratoire et leur vécu à Agadir. Je pense également que quelques personnes sont réticentes du fait de leur statut qui n’est pas en règle, tel que par exemple ceux qui fuient les impôts en ne se déclarant résidents ni au Maroc et ni en Europe. » (Extraitdujournaldeborddulundi10mars)
Les entretiens se sont pour la plupart déroulés comme prévu. Ils ont été menés en anglais avec les Suédois, Norvégien et Anglais. Ceci ne fut pasunobstacle,maiscertainsEuropéensneparlantpastrèsbienl’anglais,ontmontrédeplusgrandesdifficultésàexprimerleurperception.Ilétaitimportantdebiendéfinirlapopulationétudiéedèsledébut,carcemémoires’inscrit à la limite entre les termes de migrant, résident et touriste, les remettant tour à tour en question.
Ce travail de terrain de sept semaines fut très autonome, mais la rencontre avec plusieurs étudiants et doctorants marocains et français s’est avérée très enrichissante, de part le partage d’expérience, la possibilité de discuter du travail en cours, et l’échange de contacts et d’informations. Plusieurs démarches administratives n’ont pas abouti. Le Consul de France ayant changé en septembre 2013, il s’est montré moins coopératif
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
20 21
pour donner des statistiques chiffrées par rapport aux années précédentes (une étudiante marocaine avait fait ces démarches en 2012). Le Centre régional d’investissement, n’a lui aussi pas pu fournir de données à propos desinvestisseursEuropéens,carcen’estquedepuisunerécenteréformeque la différence est faite entre les investisseurs marocains et les étrangers.
L’extrait de journal de bord ci-dessous exprime un bilan critique du terrain et évoque les limites de l’étude menées :
« Pour ce dernier week-end au Maroc j’ai fait le point sur mon travail de terrain. Même en sept semaines à Agadir, j’ai le sentiment de ne pas avoir pu faire tout ce que je voulais pour mon mémoire. J’aurai souhaité me rendre à Aourir et Tamraght car de nombreux Européens choisissent ces communes pour y séjourner durant l’hiver. Faute de transport et de temps je n’ai également pas pu me rendre à la résidence fermée, l’Orangeraie, spécialement conçue pour les Français, située à mi-chemin entre Agadir et Taroudant. Je fais part de tout cela à Brenda Le Bigot3 qui pourra me faire un retour de son terrain sur ces mêmes lieux. Je suis contente du nombre d’entretiens que j’ai pu effectuer. Mais une limite se pose par rapport à la représentativité des nationalités européennes des personnes interviewées. Je n’ai en effet rencontré aucuns Espagnols à l’exception de Monsieur le Consul. Je pense que cela est révélateur d’une différence de mode de vie et de cercle de relations. Excepté les tenants d’un commerce, parmi les Européens rencontrés, personne ne connaît et ne fréquente des Espagnols. Ils étaient tous surpris en apprenant qu’environ 400 d’entre eux vivent dans le Grand Agadir. J’ai fait l’erreur de réaliser ceci trop tard. Si j’avais quelques jours de plus je contacterai des sociétés espagnoles, principalement présentes dans le domaine de la pêche et de l’agriculture, afin de confronter leur mode de vie à celui des autres Européens. » (Extraitdujournaldeborddusamedi29mars)
Si le temps et les moyens de locomotion l’avaient permis, les entretiens auraient dû se dérouler dans les autres communes du Grand Agadir et non se limiter à la ville d’Agadir. Ils auraient également pu être élargis aux camping-caristes européens qui présentent un profil intéressant àétudier du fait de leur omniprésence dans le Grand Agadir. Mais pour une durée courte de terrain il semblait judicieux de restreindre la population interviewée. Ce mémoire portant sur les pratiques quotidiennes desEuropéensouvredenouvellespistesde recherchespour interviewer lesMarocains et connaître leur propre perception de ce phénomène croissant des migrations Nord-Sud.
3. Brenda Le Bigot est doctorante contractuelle au laboratoire Géographie-cités. Rencontrée lors de la dernière semaine de terrain à Agadir, elle fait une étude de cas auprès des retraités en mobilité internationale de longue durée à Agadir.
2. Concepts et choix des termes
Ce sujet de mémoire fait appel à un grand nombre de concepts. Ceux de migration et de territoire ont été choisis comme les deux principaux car ils évoquent à la fois le processus employé par les migrants européens, et l’étude même de leur présence à Agadir en lien avec leur relation au territoire.Ilestégalementnécessairedejustifierlechoixdestermespourdésigner la population étudiée, tel que migrants plutôt que expatriés ou immigrés.
2.1 La migration, un concept majeur en géographie
La migration est un concept majeur en géographie, elle peut être analysée dansbeaucoupdechampsd’étudesdifférentsdeladiscipline.Unedéfinitionde base donnée par le dictionnaire Larousse serait : « Déplacement volontaire d’individus ou de populations d’un pays dans un autre ou d’une région dans une autre, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. » (Eveno andGarnier, 1998)Mais cedéplacement est-iltoujoursvolontaire?Certainesdichotomiestelquevolontairevs forcée, légale vs illégale, interne vs internationale sont pourtant au cœur de l’étude scientifiquedesmigrations.
Il convient donc de donner une définition plus large du concept.Beaucoup de géographes emploient à cet effet la distinction du lieu de résidence avec, par exemple, cette définition d’un dictionnaire degéographie humaine : « The residential relocation of an individual, family or group from one place to another. It is distinct from tourism or other short-term visits that do not involve a change of residence. »4 (Gregory et al., 2011) Cependant cela peut encore mener à débat, car certaines études parlent de migrations touristiques. Celles-ci semblent plutôt se rapprocher du concept de mobilité, qui permet de désigner tous types de mouvement sans distinction temporelle ou géographique. Alors que la migration est un phénomène spatial et temporel qui a donc toute sa place en géographie, comme le rappelle Russel King (King, 2012).
Les principaux facteurs permettant de faire une typologie des migrations sont la distance, la temporalité, l’échelle géographique, le statut familial, le cycle de vie et la fréquence. Cette question de temporalité est particulièrement pertinente dans le cadre de ce mémoire car la migration desEuropéens vers leMaroc est pour beaucoup temporaire. Soit parceque cela correspond à une certaine période du cycle de vie du migrant, et qu’ilprévoitderetournerenEuropequelquesannéesplustard.Soitparceque c’est un « rythme » de migration avec une fréquence annuelle et un changement de résidence de quelques mois seulement.
L’étude des migrations intègre également les acteurs du champ migratoire, c’est-à-dire les migrants, mais aussi toutes les personnes qui
4. Traduction française : « Le changement de résidence d’un individu, une famille ou un groupe, depuis un lieu vers un autre. Cette mobilité se différencie du tourisme ou de tout court séjour n’impliquant pas un changement de résidence. »
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
22 23
onteuuneinfluencedirecteouindirectesurcesmigrations.Etantdonnéson changement de résidence, le migrant change également de territoire, donc d’appropriation de l’espace et « d’habiter » (Lévy and Lussault, 2003).
L’histoire de la discipline illustre une évolution dans la façon d’appréhender les migrations. Les premières approches ont pendant longtemps été quantitatives et focalisées sur les statistiques et à une généralisation du phénomène.Ce n’est qu’à la fin duXXème siècle que l’individuestplacéaucoeurdelaréflexion,etmisenrelationavecl’étudedes systèmes et des réseaux. L’identité des migrants, leurs expériences migratoires et les stratégies de migration sont donc de nouvelles thématiques d’étude. Ceci est complété par la notion de migrations transnationales, désignant ainsi la création de relations entre le pays d’accueil et le pays d’origine par l’intermédiaire de liens économiques, religieux, culturels, familiaux etc.
Malgré tout il existe toujours un double débat sur ce concept, concernant sadéfinition,maisaussiparrapportàsesrelationsavecd’autresconcepts.Il y a donc un débat sur la place du tourisme entre mobilité et migration. Etaussiundébat trèsactuelquiest celuide la relationentremigrationet développement. Pour la plupart des scientifiques le développementintensifielephénomènemigratoire,alorsquelespoliticienssontpersuadésde l’inverse (Geiger and Pécoud, 2013). Michel Lussault insiste sur le fait que « le déplacement migratoire ne doit plus être pensé avant tout comme un arrachement et en terme « d’impacts » sur des espaces cibles. » (Lévy andLussault,2003:617).Cettedernièreréflexionpermetdegarderunecertaineobjectivitépournepastomberdanslepièged’unavisprédéfinietnégatif du phénomène.
La migration correspond à un processus, le mouvement, et elle implique également des acteurs, dont le migrant. Le territoire, en tant que destination, est imprégné de beaucoup d’attentes. L’étudier permet de mieux appréhender la vie de ces migrants, et leur participation à l’élaboration du territoire.
2.2 Le territoire, un concept polysémique très discuté
Le territoire est un terme polysémique issu du latin territorium – également à l’origine du mot terroir. Initialement, il était utilisé comme synonyme d’espace, puis de lieu pour se référer au local ou à un espace subjectif d’identité tel que le terme place de la géographie anglophone (Tuan, 2001). Ce n’est que récemment, dans les années 1980, qu’il est devenu un concept complexe de la discipline géographique.
Pour certains géographes le territoire constitue un sous-ensemble de l’espace, alors que pour d’autres c’est une alternative conduisant à une démarche géographique différente. C’est selon cette dernière assertion
que Christian Grataloup considère l’histoire de la géographie en trois étapes:celledumilieu,puisdel’espace,etenfinduterritoire(LévyandLussault, 2003). Julien Aldhuy souligne également que le territoire est une possibilité, mais toutes les parties de l’espace ne sont pas nécessairement un territoire, et « il se construit toujours à partir ou sur d’autres territoires. » (Aldhuy, 2008 : 8).
Chaquegéographedéfinitetadoptesapropreconceptionduterritoire,mais deux principes ressortent régulièrement et semblent faire l’unanimité :
Lepremierestleplusancien,datantdudébutduXXème siècle. C’est l’idée que le territoire est un espace délimité à dimension politico-juridique, et souvent dominé par un État (Vanier, 2009). En effet, cette approchedéfinitleterritoirecommeune«mailledegestiondel’espace».(Brunetet al., 1993 : 480)
Le second principe introduit la notion d’appropriation d’une portion d’espace, mais les chercheurs restent partagés entre les différentes façons de définir ce type de territoire. Les trois espaces d’Armand Frémont – espace de vie, espace social, et espace vécu – sont souvent évoqués comme base pour la démonstration du concept de territoire. Roger Brunet l’assimile à l’espace vécu, mais en lui ajoutant une dimension politique ou administrative (Brunet et al., 1993). Pour Claude Raffestin, chaque espace vécu est un territoire (Raffestin, 1982), alors que pour Julien Aldhuy, un espace vécu ne peut être territoire que s’il est approprié collectivement (Aldhuy, 2008). Mais du point de vue de Guy Di Méo cela n’estpassuffisant,leterritoireestcomposédel’espacevécuetdel’espacesocial, ainsi que d’une dimension politique, d’une dimension symbolique renforçant le sentiment d’appartenance (Di Méo, 2001), et d’une prise en compte de la temporalité. C’est ainsi que Joël Bonnemaison souligne le fait que le territoire est un « espace géographique produit affectivement, socialement, culturellement et symboliquement. » (Bonnemaison et al., 1999 : 11)
Cettedernièreapprocheesttrèssubjectiveetimpliqueuneidentificationà un espace donné, une appropriation de celui-ci, et un sentiment d’appartenance commune à un groupe, qu’il soit social, ethnique, politique, ou religieux (Lacoste, 2003). Il y a donc une dimension collective et culturelle de cette portion d’espace. C’est ainsi que Julien Aldhuy part de l’espace vécudanssadémonstrationpourarriveràidentifierdepotentielsterritoires,etainsivérifierqueleterritoireestpartagéparunecollectivitéd’individus(Aldhuy, 2008). C’est pourquoi ce concept « permet de réintroduire le sujet et l’acteur, ses pratiques et représentations, que l’analyse quantitative et fonctionnelle fait perdre de vue. » (Vanier, 2009 : 33). Jacques Lévy met en évidence la triple approche du concept : à la fois subjective, objective et conventionnelle. La seconde se réfère à la « matérialité des pratiques » alors que la dernière se rapporte à la « construction collective », et donc conventionnelle du territoire social.
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
24 25
La notion de territorialité est très fortement liée au concept de territoire, elle sera également bien abordée au sein de ce mémoire. C’est en effet un terme employé pour désigner la relation que les individus entretiennent vis-à-vis du territoire (Vanier, 2009 ; Raffestin, 1986). Ce rapport peut être collectif et constitue souvent la base des groupes sociaux. Roger Brunet évoque ainsi le fait que les migrants se « refont un territoire » (Brunet et al., 1993 : 480). Cet élément sera tout particulièrement étudié à propos de la relation que les migrants européens ont avec le territoire. Mais doit-on parlerdecesEuropéensentantquemigrant,immigré,ouexpatrié?
2.3 Expatrié, immigré ou migrant : quelles distinctions ?
Lorsd’unevisiteauConsulatdeFranced’Agadir,unemployéaffirmequ’il n’y a pas d’immigrés français au Maroc, mais uniquement des expatriés.Cettedistinction,souventfloue,reposesurl’usagedecestermesdans le langage courant. Selon Béatrice Verquin « on parle aujourd’hui beaucoup plus fréquemment d’expatriation que d’émigration, car la durée du séjour à l’étranger est plus courte que par le passé. » (Verquin, 2001 : 28) ElledistinguetroiscatégoriesdeFrançaisàl’étranger:les«émigrés»sontcaractérisésparleurinstallationdéfinitivedansunautrepays,etilssontanimés par la volonté de couper tous liens existants avec l’administration française.Ilssedistinguentdes«résidentspermanents»définisparunedurée de séjour à l’étranger supérieure à trois ans, mais avec le souhait de rester Français. Ces derniers constituent la grande majorité de la population et sont différents des « détachés » tel que les fonctionnaires et diplomates.
Le terme d’« expatrié », venant du latin « ex » et « patrie », désigne étymologiquement une personne qui a quitté sa patrie, son pays d’origine. Denombreuxdictionnairescontinuentàutilisercettedéfinition(Stevensonand Waite, 2011 ; Eveno and Garnier, 1998), pourtant, ce terme estuniquement réservé aux migrants occidentaux (Fechter and Walsh, 2010). Juridiquement, le statut d’expatrié correspond aux travailleurs embauchés spécialement pour travailler à l’étranger, ou envoyés pour une durée indéterminée. Aurélia Picod fait ainsi la différence entre les expatriés et les immigrés : « Ces deux distinctions permettent de mieux saisir pourquoi, dans le cadre de l’adaptation socioculturelle des Français au Maroc, les uns favorisent une sociabilité franco-française et les autres, une sociabilité franco-marocaine. » (Picod, 2008 : 430)
L’usage du terme « expatrié », dans le langage courant, pour désigner tout Européenpartantvivreàl’étranger,s’expliqueenpartieparlaconnotationfortement négative du terme « immigré ». Ceci est illustré par les propos de Pierre Bourdieu : « L’ « immigré » se situe en ce lieu « bâtard » dont parle aussi Platon, la frontière de l’être et du non-être social. Déplacé, au sens d’incongru et d’importun, il suscite l’embarras. » (Sayad, 2006 : 13) Il semble important de combattre cette connotation négative et d’utiliser le
termede«migrant»afindeconserverladimensiondemouvementliéeàla migration. Ainsi, au sein de ces migrants européens seulement certains d’entre eux sont des expatriés.
Le concept émergeant du « transnationalisme » remet en cause l’approche binaire « immigrer » / « émigrer ». En effet, la plupart deschercheurs commencent à accepter le fait qu’une grande partie des migrants gardent des liens avec leur pays d’origine en même temps qu’ils s’intègrent dansleurpaysd’accueil(LevittandJaworsky,2007).Iln’estdoncplusquestion d’une migration à sens unique accompagnée d’un processus d’assimilation. Les études sur les migrants ne doivent plus seulement être effectuées du point de vue du pays d’accueil, mais avec une perspective plus globale. Le terme générique de « migrant » est préféré car il implique les deux angles par lesquels une migration peut être étudiée.
Cette difficulté à définir les Européens migrant au Maroc s’ajouteà celle de qualifier le typedemobilité qu’ils pratiquent.Le concept delifestyle migration semble être l’un des plus pertinent pour le nommer.
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
26 27
3. Lifestyle migration
Les études sur les lifestyle migrations sont particulièrement présentes dansla littératurescientifiqueanglophone(BensonandO’Reilly,2009;Huete and Mantecon, 2011 ; Janoschka and Haas, 2013 ; Torkington, 2012), et commencent à être traitées par les chercheurs francophones (Bourdeau et al.,2012).Ceconceptpermetdequalifierunnouveaumodedemigrationet de confronter les notions de touriste, résident et migrant aux frontières deplusenplusfloues.Eneffet,ilregroupedenombreuxtypesdemobilité,concernéspar différentes temporalités et profils demigrants,mais avecla recherche commune d’une meilleure qualité de vie par la migration. Il est possible de rattacher ce concept à certains des migrants européens résidant à Agadir. Ils sont de plus à plus nombreux à migrer pour de telles motivations, se distinguant des traditionnelles migrations économiques et politiques.
3.1 Une migration privilégiée en quête d’un meilleur mode de vie
Laprincipaledéfinitionduconceptdelifestyle migration admise dans la littérature anglophone provient de Michaela Benson et Karen O’Reilly : « Lifestyle migration is the spatial mobility of relatively affluentindividuals of all ages, moving either part-time or full-time to places that are meaningful because, for various reasons, they offer the potential of a better quality of life. [...] Lifestyle migration is a search, a project, which continues long after the initial act ofmigration.»5 (Benson and O’Reilly,2009:2)Cettedéfinitionsedistinguedecelledonnéedanslalittératurefrancophonepourqualifierlesmigrationsd’agrément6 comme des « migrations temporaires ou permanentes de personnes à la recherche d’une différenciation culturelle et d’une qualité d’environnement perçues comme supérieures ». (Bourdeau et al., 2012) Les critères d’une meilleure qualité de vie sont donc ici précisés et concernent des individus souhaitant s’installer sur leur lieu de loisir où ils ont précédemment pratiqué du tourisme. Ce type de mobilité est donc caractérisé par l’importance du lieu de loisir par rapport au lieu de travail dans le choix d’un changement résidentiel. De ce point de vue il se situe entre les deux principaux concepts que constituent le tourisme et la migration (Janoschka and Haas, 2013).
Pour tous ces individus la migration est considérée comme un itinéraire vers un meilleur mode de vie comparé à celui qu’ils laissent derrière eux. Le changement de résidence ne doit pas seulement leur fournir de nouvellesopportunités,maisdoitsurtoutmodifierdefaçonimportanteetbénéfiqueleurmodedevieactuel.Lapossibilitédecettemobilitéenvued’un bien-être personnel, constitue une forme privilégiée de migration. Le facteur économique est donc une motivation parmi d’autres pour améliorer leur qualité de vie. Ces migrants proviennent majoritairement
5. Traduction française : « Le concept de lifestyle migration correspond à la mobilité spatiale d’individus de tout âge, relativement riches, et se déplaçant de façon temporaire ou permanente, vers des lieux qui ont plus de sens car, pour diverses raisons, ils offrent la possibilité d’une meilleure qualité de vie. […] Le lifestyle migration est une recherche, un projet, qui continuent longtemps après l’acte initial de migrer. »
6. Le terme migration d’agrément correspond à la traduction de « amenity migration » venant de Romella S. Glorioso et Laurence A.G. Moss (Le Bigot, 2013).
des riches sociétés occidentales, et migrent surtout vers des pays au plus faiblecoûtdevieafind’augmenterleurpouvoird’achat.Leurniveaudevie est généralement supérieur à la moyenne nationale du pays d’accueil. Ceci implique également un statut privilégié leur permettant de rester dans le pays en comparaison à d’autres groupes de migrants. Bien que le phénomène se popularise progressivement, il est encore réservé à une certaine partie de la population pouvant se permettre de telles migrations. Kate Torkington affirme que le phénomène de lifestyle migration est « locatedwithinlatemodern,global,elitist,borderlessandhighlymobilesocial practices. »7 (Torkington, 2012 : 74) Ce type de mobilité est donc surtout observé selon des mouvements migratoires Nord-Sud ; depuis les pays occidentaux vers les pays en voie de développement ou vers les pays ayantunplusfaiblecoûtdelavietelqu’ausuddel’Europe.
La notion de lifestyle peut concerner toutes sortes d’éthiques de vie dont le quotidien est cadré par une certaine vision du monde, que ce soit en lien avec le comportement, une croyance, ou une attitude à suivre. La quête d’un meilleur mode de vie est donc unique à chaque migrant. Parmi eux, certains veulent revenir à une plus grande simplicité, ils recherchent de l’authenticité, ou un lieu de spiritualité. L’individualisme, la société de consommation et le matérialisme croissant des sociétés occidentales sont à l’origine de ce retour à un mode de vie plus simple et plus originel. Les lifestyle migrants qui vivent à Pucón, au Chili, en sont un bon exemple. Ils mènent un mode de vie utopique et rejettent les sociétés capitalistes qu’ils ont quittées (Zunino et al., 2013). Ces migrations représentent l’occasion d’entamer un nouveau départ et représentent donc la fuite d’un mode de vie. Celui-ci peut être lié à la société occidentale, mais aussi à la propre routine quotidienne des migrants. Le départ peut également être provoqué par un évènement personnel et douloureux tel qu’un divorce ou un décès. Comme le soulignent M. Benson et K. O’Reilly, la notion de fuite est un élément clé dans la préparation du voyage : « Lifestyle migration is about escape, escape fromsomewhereandsomething,whilesimultaneouslyanescape toself-fulfilmentandanewlife.»8 (Benson and O’Reilly, 2009 : 3) Cette forme d’évasion représente le désir de vivre leur rêve (Torkington, 2012) et de donner un sens à leur vie. Un imaginaire est ainsi créé autour de la mobilité, auquel participent le mythe du lieu de destination et l’idée d’Eldorado.
3.2 Des recherches centrées sur le migrant et sa mobilité au sein de son cycle de vie
La plupart des publications scientifiques concernant les lifestyle migrations se focalisent sur les migrants, l’imaginaire qui les entoure avant le départ, et leur nouveau mode de vie sur le lieu de destination. Les auteurs étudient le processus migratoire en tant qu’élément à part
7. Traduction française : « localisé au sein de pratiques sociales extrêmement mobiles, modernes, élitistes, mondiales, et sans frontières. »
8. Traduction française : « Le lifestyle migration est au sujet d’une fuite. Une fuite d’un lieu et de quelque chose, tout en s’échappant vers un accomplissement de soi et une nouvelle vie. »
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
28 29
entière du cycle de vie des migrants (Benson and O’Reilly, 2009). Ce projet constitue une continuelle quête d’épanouissement, avec le désir utopique d’atteindre le bonheur ultime. Ces études abordent également le nouveauquotidiendesmigrantsunefoissurleurlieudedestination.Eneffet,certainesdifficultésetcontradictionspeuventsurvenirlorsdecettenouvelle vie. Un profond changement du mode de vie n’est pas toujours facile à assumer. La vie que les migrants ont fuie peut les rattraper, et des particularités tel que le milieu social dans lequel ils ont grandi restent inchangéesmalgré lamigration.Une difficile adaptation et acceptationd’une nouvelle culture peuvent survenir sur le lieu de destination. Le temps peut paraître long avant de retrouver une vie sociale active. Mais ceci n’est pastoujoursvraicarparmilesEuropéensàAgadir,nombreuxsontceuxqui avouent la facilité avec laquelle ils se sont créé un cercle d’ami au sein des autres lifestyle migrants. Plusieurs semaines ou mois après l’arrivée sur place, les migrants peuvent connaître un certain désenchantement. Catherine Trundle l’illustre avec l’exemple de la différence culturelle au sein d’un mariage mixte en Italie. Le sentiment de liberté d’abord ressenti par la migrante mariée à un Italien semble perdu lorsqu’elle entre dans le cercle hiérarchique et traditionnel de la famille de son conjoint (Trundle,2009).Concernantcesdifficultésauxquelles lesmigrantssontconfrontés, M. Benson et K. O’Reilly évoquent l’ambivalence des lifestyle migrations. Les migrants sont à la fois pris entre deux cultures, mais aussi entre la réalité et l’imagination : « Followingmigration, everyday lifebecomesaconstantnegociationwhereby themigrants seek to reconciletheirexperienceswiththeirhopesanddreams.»9 (Benson and O’Reilly, 2009 : 9). Cela participe à l’ambivalence des migrants, la destination qu’ils s’étaient fixée n’est peut-être pas leur ultime but à atteindre pour êtreheureux, mais uniquement une étape dans leur parcours de vie. Certains migrants européens rencontrés à Agadir sont désenchantés de leur idée d’Eldorado.Déçus,ilsrepartentchezeuxouversunenouvelledestination.D’autres vivent au jour le jour et ne savent pas s’ils resteront longtemps. Pourlesmigrantssaisonniersettemporaires,unedifficultésupplémentaires’ajoute à cette ambivalence. Leurs va-et-vient réguliers entre deux univers différents et deux modes de vie distincts peuvent constituer un juste milieu,leurpermettantdebénéficierdesatoutsdechaqueterritoire,maiségalement un certain déséquilibre dans l’adaptation à chaque quotidien.
Encoretroppeud’étudesontétémenéesàproposdesconséquencesdes lifestyle migrations sur les lieux de destination. Ces mobilités sont souvent perçues comme positives, tel un levier économique pour le pays d’accueil, négligeant ainsi l’appréhension de certains impacts néfastes (Janoschka and Haas, 2013). Parmi ces conséquences, l’attrait d’une destination pour les migrants retraités participe au vieillissement du lieu. Etlamigrationd’ungrandnombredecamping-carstelqu’àAgadirpeutdégrader l’environnement local. La venue en masse de lifestyle migrants
9. Traduction française : « À la suite de la migration, la vie quotidienne devient une constante négociation selon laquelle les migrants cherchent à réconcilier leurs expériences avec leurs espoirs et leurs rêves. »
sur un même lieu de destination peut contribuer au développement local, mais aussi à la perte de certaines traditions culturelles au contact de nombreux Occidentaux. La migration d’un grand nombre d’Anglais vers Didim, en Turquie, est ainsi perçue de façon très hétérogène par les populations locales (Nudrali, 2007 ; Nudrali and O’Reilly, 2009). Certains habitants ressentent une sorte de concurrence au sein même de leur pays, ils n’ont pas les mêmes droits que ces étrangers, mais également un niveau social différent. La cohabitation entre les migrants anglais et les locaux se traduit par la création de nouveaux espaces de vie remettant constamment en cause leur identité. Ces migrations sont à la fois perçues comme la cause de l’étalement urbain et de la détérioration environnementale. Mais c’est aussi une opportunité pour améliorer les infrastructures de la ville et créer de l’emploi. Cependant une question subsiste en lien avec lecontrôledeceschangements, afindenepas remettreentièrement lesprojets d’aménagement urbain entre les mains des étrangers. La perception des lifestyle migrants par les populations locales est donc très souvent ambivalente, partagée entre de nouvelles opportunités pour la ville, et le sentiment d’envahissement ou de perte de pouvoir de la part des locaux.
3.3 Un type de migration encouragé par les pays d’accueil
La popularité des lifestyle migrations est accentuée par les multiples campagnes publicitaires mises en place sur les chaînes d’information, les blogsetlespagesinternet.Eneffet, lespaysd’accueilsouhaitentattirerces migrants au niveau de vie relativement élevé. Les lifestyle migrations sont pour beaucoup centrées sur une logique de loisir (Bourdeau et al., 2012), et donc de consommation, permettant de booster l’économie. Ces migrants, symboles du développement local, sont encouragés à venir dans les pays méditerranéens, dans le sud-est asiatique (Ono, 2009), et en Amérique centrale (Topmiller et al., 2011). L’ouverture des frontières enEuropegrâceàl’espaceSchengen,apermisuneplusgrandeaffluenceversl’Espagne,lePortugaletaujourd’huilaGrèce.Lesmigrationsversles pays plus éloignés ont également été accélérées par la libéralisation de l’espaceaérienetl’ouvertured’ungrandnombredeligneslowcost.
Cependant, une trop grande publicité pour une même destination peut contribuer à la destruction de l’image attractive donnée à celle-ci. La recherche d’authenticité est un point commun entre les lifestyle migrations et le tourisme. Mais ils peuvent tous deux détruire ce facteur de motivation dufaitd’unetropgrandeaffluence.Al’exceptiond’unerecherchespirituelleet d’un rejet total des sociétés capitalistes, les lifestyle migrants sont attirés par des lieux déjà développés pour le tourisme, selon une certaine normeafindedonnerlesentimentd’exotisme.Le lieu de destination est créé à la demande implicite des lifestyle migrants, tel que le souligne K. Torkington : « Discourse about the destination place is simultaneously mobilizedviatheglobalstageandfixedinlocalplace,asglocalmeanings
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
30 31
and identities are forged to create and perform a highly stylized version of theplacethatfitswiththeperceivedlifestylerequirementsandpreferredsocialidentitiesofitsnewresidents.»10 (Torkington, 2012 : 88) Ces pays d’accueil sont souvent le témoin d’une vie plus agréable pour les migrants, avec un climat plus chaud et des activités de loisir adaptées à la demande.
Ceseffetsd’annoncespublicitairessontamplifiésparlebouche-à-oreille,et encouragent les migrations « en masse » vers une même destination. Les migrants se regroupent instinctivement entre eux en fonction de leurnationalitéetdeleurlangue.EnFloride,unvéritableîlotquébécoiss’est ainsi formé avec plusieurs milliers de Québécois présents durant les quelques mois d’hiver ou toute l’année. Le risque d’un tel regroupement repose dans le transfert de la culture des migrants au sein de ce microcosme et un refus d’intégration ou d’ouverture vers le pays d’accueil. Célia Forget étudie ce phénomène de territoiremobile enFloride.Elle souligne que« de nombreux voyageurs se déplacent en conservant tout un patrimoine identitaire et culturel qu’ils transposent dans l’environnement qu’ils investissent » (Forget, 2010 : 459). Ceci incite à un repli sur Soi du lifestyle migrant, et questionne son projet de mobilité en tant que transposition d’un mode de vie identique vers un nouveau contexte culturel et géographique. De plus, ces migrations sont encouragées par les pays destinataires pour un plus grand développement, mais ils ne favorisent pas une ouverture sur leur propre patrimoine. La formation de résidences fermées pour les étrangers est de plus en plus fréquente, tel que le village de l’Orangeraie, spécialisé dans l’accueil des Français dans la région marocaine du Souss Massa Drâa (Giedinger, 2011). Les pays d’accueil mettent en place des campagnes publicitaires ciblées vers différents lifestyle migrants, en fonction de leur âge, de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. Ce concept de lifestyle migration est effectivement ciblé par rapport aux motivations de départ des migrants, mais la recherche d’une meilleure qualitédevieresteunenotiontrèsvasteetsubjective.Ellefaitdoncappelàdenombreuxprofilsdifférentsdemigrants.
3.4 Un concept subjectif désignant de nombreux profils de migrants
Le concept de lifestyle migration inclus un grand nombre de catégories de migrants. Les retraités en migration internationale, aussi appelés«snowbirds»ou«winterbirds»lorsdesmigrationssaisonnières(Viallon, 2012), sont particulièrement nombreux et privilégient les destinations au soleil. Les premières recherches menées sur ces migrations, rentraient dans le cadre des études sur le vieillissement et la gérontologie. Les backpackers sont également un groupe non négligeable de lifestyle migrants, ils peuvent être désignés comme des touristes itinérants pendant une longue période (Le Bigot, 2013). Ces lifestyles migrantssontdifficilesà désigner en tant que touriste ou résident. Les critères de la durabilité du
10. Traduction française : « Le discours portant sur le lieu de destination est à la fois mobilisé via l’échelle globale,etfixéàl’échelle locale. Lessignificationsetl’identité du glocal sont ainsi forgées pour créer et réaliser un lieu hautement stylisé correspondant aux conditions de ces nouveaux résidents, selon le mode de vie et les identités sociales qu’ils préfèrent. » [Note de l’auteur : aucune traduction correcte ne peut être donnée pour l’expression « local place »]
séjouretdustatutofficielquelepaysd’accueilleurattribue,peuventaideràmieuxdéfinircesmigrants.Maislaperceptiondecesderniersetleurspratiquesquotidiennessontégalementàprendreencompte.Eneffet,lesactivités de loisir et les lieux qu’ils fréquentent ne sont pas toujours les mêmes que ceux des touristes. Rémy Knafou fait le choix de désigner les retraités en migration comme des touristes. Mais leurs motivations de départ correspondent à celles des lifestyle migrations, avec la notion de fuite :«une fuiteenavantpours’éviter ladifficultéou la souffranceàpenser son vieillissement, […] changer de lieu met en avant notre capacité de rebond et peut donner le sentiment de repousser ses limites. » (Knafou, 2011 : 185)
Le travail de terrain mené à Agadir sollicite ce concept de lifestyle migration car beaucoup de migrants européens présentent des motivations en lien avec leur projet de vie et l’amélioration de leur quotidien. La volonté d’améliorer sa qualité de vie est un critère présent dans toute migration, même dans les migrations politiques et économiques. Mais pour ces deux dernières, elle ne représente qu’un critère parmi d’autres, et elle est le résultat d’une migration réussie. Ce concept, bien que très subjectif, permet de mieux appréhender le choix d’Agadir comme destination, et le mode de vie pratiqué par les migrants au sein de la ville. Ceci rappelle le perpétuel problème du choix des termes pour désigner un type de mobilité et ses acteurs, dans un contexte où les frontières entre ces catégories des scienceshumainessontdeplusenplusfloues.
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
32 33
4. Les Européens au Maroc : cadrage statistique, juridique et littéraire
Ce n’est que depuis quelques années qu’une prise de conscience commune a lieu en lien avec le nombre non négligeable d’Européensparmi les étrangers résident au Maroc. Leur migration est facilitée par des accords bilatéraux permettant leur entrée sur le territoire sans demande de visa.Ilexistecependantdesréglementationsafindecontrôlerlemotifetladuréedeséjourdecesmigrants.ParmilesétudesscientifiquesmenéessurcesEuropéensauMaroc, lechoixest faitdecitercellesconcernantlesmédinasafindefaireunparallèleaveclesobservationsmenéessurleterrain d’Agadir.
4.1 Particularités européennes de la population étrangère au Maroc
Laloimarocainedéfinitunétranger«commetoutepersonnen’ayantpas la nationalité marocaine, soit qu’elle ait une nationalité d’un autre pays soit qu’ellen’ait pasdenationalité (apatride). » (Elmadmad,2004 : 3).Cependant, parmi les étrangers au Maroc, le terme d’immigré est souvent réservé aux migrants subsahariens, alors que celui d’expatrié ou de résident est destiné aux Européens en situation régulière. Ces dénominationssont contredites par un certain nombre d’Occidentaux venant travailler illégalement dans le pays (Balenghien, 2013). Un premier pas vers la reconnaissance des étrangers est effectué en 2009 avec la publication, notamment dans la presse, d’un rapport du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2004 consacré aux 51 435 résidents étrangers au Maroc (Direction de la Statistique, 2009). Ceci permet de mettrefinaux idées reçuesconcernant lesmigrantsétrangers.Toutefoiscesstatistiquessontlimitéesparladifficultéderecenserunepopulationétrangère qui varie au cours de l’année (tel que les bi-résidents), ou n’est pas déclarée légalement. Les permis de séjours n’ont pas été pris en compte lors de ce recensement basé sur la déclaration des enquêtés, incluant ainsi une partie de la population en situation irrégulière ou illégale, mais tout en restant difficilement estimable. L’introduction méthodologique durapport souligne également l’absence de questions concernant la date de l’entrée dans le pays par ces migrants. Seules les données des précédents recensements permettent de comparer le nombre d’étrangers. De son côté, A. Balenghien (2013) critique l’absence de données concernant l’appartenance religieuse des étrangers, dans un pays où une grande partie du droit est en lien direct avec la religion.
Les principales communautés étrangères résidant au Maroc sont issues de pays dotés d’un lien étroit avec le Maroc, qu’il soit historique, économique,oudeproximitégéographique.LesEuropéensreprésentent
45,9 % de la population étrangère au Maroc en 2004, avec un poids important delacommunautéfrançaise,etlaprésencenonnégligeabledesEspagnols.Les ressortissants algériens et tunisiens sont également nombreux par leur proximité, comptant 23,9 % des étrangers. Puis la communauté du Moyen-Orient de 11,5 % est suivie des Subsahariens tel que les Congolais et les
Carte 2 :Représentation
cartographique de la communauté française
résidant au Maroc.
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
34 35
Sénégalais avec 10,4 %. Les ressortissants d’Asie (3,5 %), d’Australie et d’Amérique (4,8 %) sont les moins présents. Durant le Protectorat, les EuropéenssontnombreuxàvenirauMarocdansl’espoirdefairefortuneoupourfuirlecontextepolitiquedeleurpays.En1951,leservicecentraldesstatistiquesrecensait298975Françaiset25698Espagnols(Ouddir,2014). Mais ce ne sont pas seulement ces ressortissants des puissances colonisatrices qui migrent au Maroc, d’autres nationalités européennes, tel que les Italiens, les Portugais, les Britanniques et les Suisses pour la plupart sont présents. Suite à l’indépendance du pays, une partie des Européensontquitté leMaroc,mais leurnombrea réellementchutéen1973 dans le cadre de la loi sur la marocanisation des entreprises. Ce n’est qu’à partir de lafindes années 1990que lesEuropéens recommencentprogressivement à s’installer au Maroc. Pour la première fois depuis le dernier recensement de 1994, la population étrangère au Maroc augmente, avecunaccroissementglobalde2,5%.Eneffet, lapopulationen1952était de 539 000 étrangers, et plus que de 50 000 personnes en 1994.
En2011,l’AmbassadedeFranceenregistraitenviron44000Françaisau Maroc, mais une moyenne de 30 000 Français en plus est estimée du fait de la non-obligation de l’inscription à l’ambassade (Ouddir, 2014). La carte 2 page précédente souligne l’importance de la communauté française principalement située dans la moitié nord du pays et sur la côte Atlantique. 41,1 % de la communauté réside dans la préfecture de Casablanca, comptant
Figure 1 :La répartition des étrangers (15 ans et plus) selon le type d’activité et le groupe de nationalités.
un grand nombre d’actifs. Rabat et Marrakech accueillent respectivement 15,7 % et 12,5 %, alors que Agadir constitue la quatrième préfecture privilégiéepar lesFrançaisavec4,5%de lacommunauté.Et leszonesrurales sont très peu recherchées par les Français. Une particularité de cette nationalité au Maroc concerne le grand nombre de retraités par rapport aux autres communautés étrangères, tel que par exemple les Subsahariens qui comptentunemajoritéd’étudiants.Eneffet,56,7%desretraitésétrangers
Carte 3 :Représentation
cartographique de la communauté espagnole
résidant au Maroc.
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
36 37
sont français. Malgré tout, la plus grande part des étrangers actifs sont les Européens,commeledémontrelafigure1page34.
Les Espagnols représentent la troisième communauté étrangèreau Maroc (5,4 % de tous les étrangers) après les Français (29 %) et les Algériens (17,7 %). La communauté espagnole réside principalement danslenorddupays,àproximitédelafrontièreavecl’Europe,commel’illustre la carte 3. 25,2 % d’entre eux sont dans la préfecture de Tanger-Asilah, 23,7 % dans celle de Casablanca, et 14.3 % dans la province de Tétouan. Seul 9,9 % d’entre eux sont à Rabat, et 4.3 % à Agadir. La carte 3 témoigne du passé colonial du pays. La zone espagnole lors du Protectorat (1912-1956) se situait au nord du Maroc, et dans la partie sud à partir de Sidi Ifni. L’ancienneté de cette migration constitue une possible explication de la présence de résidents espagnols dans les provinces de Laayoune et de Oued ed Dahab grâce à la pérennité de la langue ibérique. Quant à leur nombre non négligeable à Agadir, cette ville constitue probablement le lieu le plus urbain et proche de ces anciennes terres d’immigration espagnole du sud marocain. Bien que le Protectorat n’ait pas attiré autant d’EspagnolsquedeFrançais(Albet-Masetal.,1995),certainsEspagnolsattachés affectivement à ce territoire choisissent peut-être le compromis de résider non loin de ces terres dans la ville d’Agadir.
Un tel nombre d’étrangers au Maroc nécessite une réglementation des entrées et séjours des migrants dans le pays. Des réglementations concernant le travail des étrangers sont également mises en place afind’éviter une concurrence trop accrue avec la population nationale.
4.2 Etre européen au Maroc : Réglementations et cadre juridique
Grâce aux conventions bilatérales, les Européens sont dispensés devisa pour entrer au Maroc. Ils sont alors autorisés à rester dans le pays pour motif de séjour touristique durant une période de trois mois, renouvelable unefois.Iln’estcependantpasrarequedesEuropéensrésidantàl’annéeauMaroc, renouvellent régulièrement leur autorisation d’entrée en effectuant un aller-retour dans leur pays, ou sur l’une des deux enclaves espagnoles que sont Ceuta et Melilla. Une certaine souplesse semble donc être accordéeauxEuropéens.Celas’expliqueprobablementparlesbénéficesqu’ils rapportent à l’économie du pays. Nadia Khrouz précise toutefois que même si ces étrangers sont autorisés à entrer dans le pays pour une durée limitée,«leMinistèredel’Intérieurviasesdifférentsservicesbénéficied’une certaine marge d’appréciation, en lien notamment avec « le risque migratoire », qui se traduit par de réguliers refus d’entrée à la frontière, notamment pour certains « dispensés de visas » et « détenteurs de visas » ; refus qui ne sont que peu rendus visibles. » (Khrouz, 2013)
La loi 02-03 concernant l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc, et traitant de l’émigration et l’immigration irrégulière, est entrée en vigueur
au mois de novembre 2003. Le décret d’application du 1er avril 2010 de la loi02-03,publiédansleBulletinofficieln°3836(Cf.Annexe5),préciseles différentes modalités pour l’obtention d’un titre de séjour. Il en existe deuxdifférents:lecertificatd’immatriculation,pourlesétrangersrésidantplusdetroismoisauMaroc,etlecertificatderésidencepourlesétrangersrésidant depuis au moins quatre années consécutives dans le pays. Ce dernier est délivré pour une durée renouvelable de 10 ans. Cependant, cette carte peut être retirée en cas de trouble à l’ordre public, ou après plus de deux années passées hors duMaroc (Elmadmad, 2004).Concernantlacarted’immatriculation,troismentionspeuventfigurerdessus:«pourletravail»,«étudiant»,«visiteur».Cedernierdoitjustifier«qu’ilpeutvivre de ses seules ressources et prendre l’engagement de n’exercer aucune activitéprofessionnellesoumiseàautorisation»(ElFassi,2010:1327).Cela concerne par exemple les retraités européens demandeurs d’un titre de séjour. La carte d’immatriculation peut également être délivrée sur justificationdedocumentsmédicauxpourdessoinsdelonguedurée.Lesemployés de missions diplomatiques et les étrangers séjournant moins de trois mois dans le pays sont exemptés de cette carte. Il est important de préciser que la possession d’une carte d’immatriculation n’atteste pas systématiquement que les étrangers séjournent de façon continue dans le pays.
Concernant le travail des étrangers, les réglementations de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC)peuvent représenter un obstacle à l’emploi. L’étranger doit présenter des compétences valorisantes par rapport aux candidatsmarocains afinde se faire employer.Pourunmêmeprofil, le travailleurmarocain seraprivilégié selon le principe de la « préférence nationale » (Khrouz, 2013). Uneattestationdoitêtreobtenueparl’employeurpourjustifierqu’aucunmarocainnecorrespondauprofilrecherchépourleposte.Grâceàdesaccordsbilatéraux, trois exceptions existent pour les ressortissant du Sénégal, de la Tunisie, et de l’Algérie. De plus cette procédure n’est pas nécessaire pour les conjoints de marocain(e), les natifs du Maroc ayant résidé dans le pays au moins six mois, et les dirigeants d’entreprise. La majorité des étrangers ayant obtenu cette autorisation de travail sont européens. Cependant, la facilitéaveclaquellelesEuropéenspeuventpénétrerdanslepayssansvisaen tant que touriste, a permis de façon croissante l’exercice d’une fonction sans cette autorisation de travail : « pour contourner la législation du travail et l’obligation du passage à l’ANAPEC, [ils] deviennent, aumaximumtous les trois mois, des passeurs de frontières, passeurs "réguliers" puisque touristes au passeport rouge. » (Balenghien, 2013 : 9) Parmi 3 000 étrangers travaillant au noir en août 2007, et recensés lors d’une enquête, lamajoritéd’entreeuxse révèlentêtreChinoisetFrançais (Elmadmad,2008).LesEuropéens,mêmemunisd’unbonniveaud’étude,sontparfoisles premiers à s’exposer aux emplois au noir. Les principaux secteurs
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
38 39
touchés sont l’hôtellerie et la restauration, mais les autres ne sont pas épargnés.Lemarchéprometteurdutourismeinciteplusd’unEuropéenàvenir exercer une fonction au noir dans un pays où il fait bon de vivre toute l’année. La grande opération de régularisation des sans-papiers débuté au mois de janvier 2014 concerne essentiellement les subsahariens. Mais une telle démarche questionne la possibilité d’une future prise en compte du problèmedesEuropéensexerçantuntravaildissimulé.Cettesituation,deplus en plus pointée du doigt par les chercheurs et les médias, ne tardera peut-être pas à faire instaurer de nouvelles mesures de contrôle.
Les scientifiques qui étudient les Européens au Maroc, révèlentrégulièrementdes exemplesde travailleursvenusprofiterdedifférentesopportunités d’installation. Mais plusieurs études traitent également des retraités résidant dans le pays. Il semble judicieux de se pencher sur celles concernant les Européens dans les médinas, car c’est un phénomènecroissant abordé par différents chercheurs, et les typologies proposées serontintéressantesàcompareraveclesprofilsdesEuropéensàAgadir.
4.3 Une littérature scientifique axée sur les Européens dans les médinas
La plupart des études menées sur les Européens au Maroc seconcentrent sur leur présence dans les médinas. Ces centres anciens et traditionnels sont l’objet d’une grande attraction pour les étrangers, qu’ils soient touristes ou résidents, pour une durée temporaires ou définitive.Suite au séisme dévastateur du 29 février 1960, Agadir ne possède plus de médina traditionnelle. A son opposé, Marrakech est réputée pour son patrimoine ancien, facilitant ainsi son ouverture par la mondialisation, et le développement d’un marché de l’immobilier à destination des étrangers. Ces derniers sont Français, mais aussi Hollandais, Allemands et Anglais pour la plupart. Les investisseurs Américains et Marocains sont également de plus en plus présents, à la recherche d’un bien immobilier résidentiel, ou d’un espace de commerce tel que les maisons d’hôtes, les cafés ou les boutiques d’art. Cette attirance pour les vieux centres marocains repose en partie dans le rejet de l’architecture des villes occidentales actuelles. Ces étrangers souhaitent revenir à un patrimoine plus authentique et au mode de vie de leur enfance. Au sein des médinas, les riads, ces habitations aux allures de petits palais, sont caractérisés par un patio de verdure ou un jardincentral.Selonlemêmeprofildepetitescoursfermées,lesdars sont des habitations de taille plus modeste (Kurzac-Souali, 2010). Un confort à l’Occidental est ajouté dans ces logements traditionnels très prisés. La possession de ces biens immobiliers représente un symbole de richesse aussi bien au Maroc qu’en Europe. Cependant, ces investissementsautrefois peu coûteux pour les occidentaux, sont devenus beaucoup plus chersdufaitdeleursuccès.Endixansleprixdesriads a quintuplé, alors qu’ils se vendaient à 100 000 dirhams en 1995 au cœur de la ville portuaire
d’Essaouira(Dalle,2010).Cetteaugmentationduprixdufoncierfacilitedonc la présence d’une catégorie sociale élevée.
LesEuropéensemménageantauMarocnesontpassystématiquementdans les médinas. Les grandes villes tel que Casablanca et Rabat attirent de nombreux entrepreneurs dans différents domaines et quartiers. Néanmoins, les chercheurs prêtent une attention toute particulière au phénomène grandissant des médinas, car cela représente un objet d’étude sur les espaces de rencontre et de sociabilité entre différentes cultures (Berriane, 2009 ; Kurzac-Souali, 2010 ; Escher and Petermann, 2012).Uneprogressivegentrificationprendplaceauseindesvillesmarocaines.Elleestaccentuéeparlavolontédesétrangersdepréserverlepatrimoinemarocain tel qu’ils se le représentent. Une partie de la population marocaine est ainsi repoussée à la périphérie du centre ancien. Mais la géographe Anne-Claire Kurzac-Souali (2010) souligne l’impact de ces étrangers sur la prise de conscience du patrimoine de la médina de Marrakech. Cela incite à une démarche de conservation de la cité traditionnelle : « les images et la représentation des médinas chez les Européens ont glisséd’un exotisme colonial teinté de dénigrement à la reconnaissance d’un art devivreorientaliséetraffiné.»(Kurzac-Souali,2010:2).CependantlesOccidentauxontunevisionprédéfinieetparfoisfausséedecette«médinarêvée et remodelée selon leurs choix, leurs perceptions et leurs espérances, parfois en décalage avec la réalité urbaine de celle-ci et avec les conditions de vie de la majorité de ses habitants marocains. » (Kurzac-Souali, 2010 : 5). Les entrepreneurs étrangers présents dans les médinas s’inscrivent pour la plupart dans le marché local grâce aux maisons d’hôtes. A Marrakech, lesmaisons d’hôtes déclarées sont passées d’une quinzaine à la fin duvingtième siècle, à plus de sept cent dans les années 2010 (Escher andPetermann, 2012). S’ajoute également le marché informel du tourisme qui se développe de plus en plus depuis les années 2000. Les Occidentaux commencent souvent par louer leur maison à des amis de façon spontanée, puis cela devient plus systématique, par l’intermédiaire du bouche-à-oreille et d’annonces sur Internet. Ce phénomène a été facilité par le manque de réglementation dans le domaine, évitant ainsi aux propriétaires le paiement d’impôts.Aucunesstatistiquesofficiellesn’existentconcernantcemarchéparallèledesmaisonsd’hôtes,carilestdifficilementquantifiableparsoncôté informel.
AntonEscheretSandraPetermann(2012)dressentunetypologiedesétrangersrésidantdanslesmédinasdeMarrakechetEssaouira(Tableau2).Leur particularité consiste à effectuer un « nouveau type de lecture qui distingue les individus en fonction de leurs itinéraires, leurs modes de vie et de pensée, leur mode d’appropriation des logements et leurs manièresd’êtreenrelationavecl’espaceurbain.»(EscherandPetermann,2012 : 189). Les sept profils proposés sont relatifs et les Européenspeuvent évoluer d’une catégorie à l’autre au cours de leur vie. Ils se basent
Chapitre i - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
40 41
sur les facteurs suivant : « a) les motivations pour acquérir une maison dans la médina ; b) la vie dans la communauté des étrangers ; c) l’attitude individuelle par rapport à la vie en général ; d) le capital à disposition pour l’organisation du quotidien au Maroc ; e) le rapport face aux employés marocains»(EscherandPetermann,2012:191).Lescatégoriesd’analyseproposéesparMohamedBerriane(2010)concernantlesEuropéensdanslamédinadeFèssontmoinsprécises(Tableau3).Ellesontétéforméesautour d’une logique migratoire, concernant la place de cette mobilité au seinde l’expériencemigratoiredesEuropéens, et leurprojetmigratoireà venir. Le choix du chercheur est de privilégier le terme de migrant plutôt que de « touriste-résident » concernant ces étrangers européens. Les questions d’identité, d’intégration et de représentations sociales sont également des facteurs pris en compte dans l’établissement des différents profils. Les villes de Marrakech et Essaouira sont particulièrementcaractérisées par la présence d’une élite étrangère et d’une population artistique et branchée, munie d’un bon niveau intellectuel (Elmadmad,2010).Cependant le profil desEuropéens se différencie entre ces deuxvilles.Lapremièreestlesymboled’unegentrificationeuropéenneassezancienne, tournée vers le luxe et encouragée par les élites. La seconde connaît une migration plus récente des étrangers, avec une activité sportive tournée vers l’océan (McGuinness, 2012). A partir des années 2000, la ville de Fès est plus populaire pour les Européens, lorsqueMarrakechdevient saturée et cher sur lemarchéde l’immobilier.Elle sembleplusconservatrice que Marrakech, et moins encline à faire évoluer sa culture urbaine (Kurzac-Souali, 2012). Mais l’espace de vie de sa médina reste un lieu de cohabitation et de confrontation entre deux types de migrants : lesmigrantssubsahariens,etlesEuropéens,souventdésignéscommedesétrangers installés au Maroc par choix (Berriane, 2009). Bien que souffrant d’une gentrification grandissante, la médina de Marrakech devient unespace de plus en plus cosmopolite, de part sa population résidente et l’affluencetouristique.LaplaceJemâaelFnaestunbonexempledecettemixité. Les terrasses des cafés sont le symbole de la cohabitation entre les touristes, les populations locales, et les anciens et nouveaux résidents étrangers(Kurzac-Souali,2012).La«regentrification»progressivedelamédinaparlesétrangerssuiteaudépartdesbourgeoismarocainsàlafinduvingtièmesièclesembleavoirpermisunenouvellemixitésociale(Ernst,2012). Mais cela ne constitue-t-il pas une transition vers une plus grande ségrégationauseindelaville?
Lieu Catégories Particularités
Marrakech Jet-settersSéjours courts. Habitations luxueuses. Contacts avec les Marocains de la même couche sociale. Ex:AssociationélitistedesAmisdeMarrakech.
Pionniers de la gentrification
Marrakechet
Essaouira
Artistes-intellectuelsLe Maroc comme source d’inspiration. Pas de grands moyensfinanciers.Contactavecartistesmarocains.Visionidéale de la médina et recherche du cosmopolitisme.
Promoteurs culturelsPeu nombreux mais rôle important. Activités critiquées pour être éloignées du vrai quotidien des marocains. Contribuent à l’image de la ville à l’étranger.
Entrepreneursmotivés
Fuite, changement, liens passés avec le pays, réalisation d’un rêve, concilier travail et loisir. Surtout maisons d’hôtes, et un peu en exportation d’artisanat, réhabilitation, et restauration.
Touristes huppésRésidences secondaires. Qualité de vie, ville authentique et exotique. Attachement au pays. Peu intégré, contact surtout avec la communauté étrangère.
Retraités en formeEuropéens,surtoutdesfrançais.BeaucoupdeséjoursauMarocdurantleurvieactive.Contactssuperficielsaveclapopulation locale.
SurtoutMarrakech Couple interculturel
Enmajoritédesfemmeseuropéennesethommesmarocains.Souvent propriétaires de maison d’hôte. Peu de contact avec les autres résidents européens.
Source:(EscherandPetermann,2012)
Lieu Catégories Particularités
Fès
“Des voyageurs cosmopolites…, ou des nomades du nouveau monde”
35-40 ans. Fès comme lieu de passage. Très attachésaupaysd’origine.EuropéensdontFrançaisayant des racines étrangères.
“Des étrangers convertis en nouveaux fassis”
Installationdéfinitive.SurtoutFrançaisetBelges.Assimilation à la culture marocaine, rejet du mode de vie occidental. « Intégration totale ».
“Crise d’identité ou double identité” Identificationàlafoisàlavillemarocaineetaupays d’origine. Surtout anglo-saxons.
“Citoyen du monde…, ou la dimension globale de la migration”
Identité commune sous le principe de citoyenneté. Référence au global.
Source : (Berriane et al., 2010)
Tableau 2 : Typologie des Européens installés dans les médinas de Marrakech et Essaouira.
Réalisation : Lachaud E. 2014.
Tableau 3 : Catégories d’analyse des Européens installés dans la médina de Fès.
Réalisation : Lachaud E. 2014.
43
Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
42
L’étude menée dans ce mémoire tire son originalité de l’absence d’une médinadanslavilled’Agadir.LefaitquelesEuropéenss’installentdansd’autres espaces que dans le centre ancien peut représenter un conflitsocio-spatial en moins. Cela n’a pas pu être évité à Marrakech, où les Marocains se sont retrouvés étranger dans leur propre ville, provoquant parfois de violentes réactions de la part de la population locale. Les trois premièrescatégoriesdemigrantsprésentéesparA.EscheretS.Petermannne peuvent pas être appliquées au cas d’Agadir. Mais les catégories suivantes et les profils proposés parM. Berriane peuvent être reportésdans l’étude. De plus, la notion de gentrification des médinas permetd’interroger une possible fragmentation spatiale du territoire. Bien que certains chercheurs tel que A-C. Kurzac-Souali, reconnaissent la naissance d’un cosmopolitisme au sein de la ville de Marrakech, des tensions sociales semblent inévitables du fait des différences culturelles, religieuses, et de niveau de vie.
Chapitre II
Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
44 45
1. Entre tourisme et résidence, un territoire aux particularités bien encrées
AgadirestunevillemoderneetbienéquipéequiattirelesEuropéenspar son côté occidentalisé. C’est aussi une ville avec toutes les qualités d’une station balnéaire. Les migrants européens résidant au Maroc sont pour la plupart venus une première fois en tant que touristes. Suite à un coup de cœur ou à des séjours touristiques répétés, ils ont alors décidé de s’installer pour connaître la ville sous un angle différent. La commune rurale de Taghazout attire également ces résidents. Le projet en cours d’une grande station touristique intégrée pourrait prochainement attirer un plus grandnombred’EuropéensàvivredanscettecommuneduGrandAgadir.
1.1 Agadir, de sa création à aujourd’hui : une ville moderne et diversifiée
La ville d’Agadir prend naissance en 1505 sous le nom de Santa Cruz. Les Portugais la créent dans le but de contrôler ce lieu stratégique d’un pointdevuemaritime,etpourbénéficierdesressourcesnaturellestellesqu’agricoles,minièresetmaritimes.EnconflitaveclesPortugais,lesultansâadien Mohammed ech Cheikh saisit Santa Cruz en établissant en 1541 la Kasbah d’Agadir Oufella au sommet de la colline haute de 230 mètres qui surplombe l’actuelle ville d’Agadir. Ce nom trouve son origine dans les «agadirs»,desgrenierscollectifsfortifiéssouventconstruitsenhauteurou sur des falaises escarpées pour leur défense. La Kasbah se développe en petite ville, et Santa Cruz est remplacée par un port pour favoriser le commerced’exportationavecl’Europe.Laréussitedeceportestcependantconcurrencéepar sa fermeture au trafic européen et l’ouverture duportd’Essaouira dans les années 1765-1770, faisant d’Agadir un village depêcheursjusqu’audébutduXXème siècle.
Suite à un conflit franco-allemand sur l’occupation de ce territoirestratégique, ce sont les Français qui arrivent en 1913 et participent au développement d’Agadir durant le Protectorat français (1912-1956). S’ensuit le réaménagement du port et l’essor de la ville à partir de 1920. Durant la période de l’après seconde guerre mondiale de nombreux cadres etinvestisseurseuropéenss’installentdanslacommune.En1946,MichelEcochardarriveàlatêteduservicedel’UrbanismeduProtectorat(jusqu’en1952), et met en place un nouveau plan d’aménagement pour la ville, avec notamment la construction de nouveaux immeubles et d’usines de conserves. Mais le 29 février 1960, un violent séisme d’une magnitude de 5.7 sur l’échelle de Richter sévit aux alentours de 23h40 avec un épicentre situé sous la ville (Noin, 1960). Les destructions sont innombrables dans les quartiers de Founti, Talborjt, Yachech, et la Kasbah. La ville nouvelle et le quartier Khiam en sont un peu plus épargnés. Les victimes de cette
catastrophe sont estimées entre 12 000 et 15 000 personnes pour une population d’environ 48 000 habitants à la veille du séisme (Dartois, 2011).
Peu de temps après cette catastrophe naturelle, le roi Mohammed V crée le Haut Commissariat pour la Reconstruction d’Agadir, après avoir déclaré le 9 mars 1960 : « Si le destin a décidé de la destruction d’Agadir, sa reconstruction dépendra de notre foi et de notre volonté. » (Groupe d’études et de recherches sur le sud marocain, 1997 : 9). L’actuelle ville d’Agadir doit donc beaucoup à cette période de reconstruction l’élevant à l’image de prestige du pays. La ville est reconstruite en béton apparent pour répondre au risque lié à sa situation, grâce à un plus grand nombre debâtiments anti-sismiques.Agadir adopteunprofilmoderne avecunearchitecture qui privilégie les espaces fonctionnels plutôt que l’esthétique : « Agadir, ville orpheline de son passé et de sa mémoire, reconstruite en adoptant l’image de l’Occident, dans le style comme dans l’organisation. » (Groupe d’études et de recherches sur le sud marocain, 1997 : 173). De jeunes architectes (Jean-François Zevaco, Elie Azagury etc.) inspiréspar Le Corbusier optent pour un style architectural en rupture avec le précédent. Ces dernières années ont cependant été les témoins d’une grande expansion immobilière, faisant place à une architecture hétéroclite etunedifficileidentitéurbaine.
Plusieursétapesd’urbanisationspeuventêtredéfinies(Grouped’étudeset de recherches sur le sud marocain, 1997). La période de 1960 à 1972 correspond à l’action du Haut Commissariat à la Reconstruction d’Agadir. Il permet la reconstruction et le développement du centre-ville, de la Cité Suisse (secteur de villas situé au nord du centre), du Nouveau Talborjt, de la zone touristique et balnéaire, et de l’Abattoir-El Hay El Hassani(Cf carte 4). Entre 1972 et 1982, la municipalité et la Délégation duministère de l’Habitat participent au développement des nouveaux quartiers Ennahda,Yahchach, Lakhiam-1, Laâzib et Les amicales. Puisentre 1982 et 1997, l’Etablissement régional d’aménagement et deconstruction – région Sud (l’E.R.A.C.-Sud) introduit l’extension descentres périphériques d’Agadir. Cela se caractérise par des immeubles et des lotissements, et a pour conséquence des habitats insalubres. Le ministère de l’Habitat, lawilaya de Souss-Massa-Drâa et la Communeurbaine d’Agadir mettent cependant en place l’opération nationale « villes sans bidonvilles » avec l’objectif de raser l’ensemble des bidonvilles d’ici 2008. Cela s’accompagne du relogement d’une partie des familles dans de nouveaux lotissements. Le bidonville du quartier Hay Mohammadi a par exemple été rasé pour permettre la construction de plus de 3000 logements par la société Al Omrane.
Le grand axe de l’avenue Mohamed V constitue une césure entre le centre de la ville et la partie touristique et balnéaire. Le bord de mer est toutefois bien aménagé sur une longueur de trois kilomètres : composé par la plage, la promenade, les restaurants, les jardins des hôtels et clubs de
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
46 47
vacances, puis la route dans l’intérieur des terres. Cela permet à Agadir de devenir une importante station touristique balnéaire, tout en étant une porte d’entrée entre le nord et le sud du pays. C’est aussi la capitale économique delarégion,grâceauxbénéficesdel’agriculturedanslavalléeduSouss,et de la pêche avec son grand port de sardines. Un lien étroit existe également entre Agadir et les autres centres urbains du Grand Agadir. Les mutations de la ville impactent par exemple sur Inezgane à sa périphérie. La commune urbaine d’Agadir regroupe aujourd’hui quatre territoires : l’ancienne commune urbaine d’Agadir, la commune urbaine de Bensergao, la commune urbaine d’Anza et la commune rurale de Tikiouine. Cela participe progressivement au déplacement et à l’extension du centre-ville vers le quartier du Haut Founty avec l’implantation de nouveaux bâtiments administratifs(UnionrégionaledelaCGEMSoussMassaDrâa,2010).
Carte 4: La ville d’Agadir témoigne d’un habitat assez dense en son centre. Les secteurs de villas aux populations aisées côtoient des quartiers limitrophes aux profils très différents. Les lotissements du quartier Hay Mohammadi sont aujourd’hui en partie achevés et sont sujets à l’attraction de nouveaux résidents Européens. Chacun de ces quartiers possède des caractéristiques propres de par leur morphologie urbaine et la population qu’ils abritent. Agadir présente un habitat de plus en plus diversifié. Le type de petit habitat économique date de la première phase de reconstruction, à laquelle s’ajoutent des villas, et des habitats collectifs verticaux économiques ou modernes (Ben Attou, 2003).
Grâce à ses atouts naturels et d’aménagement, Agadir est depuis longtemps une importante destination touristique balnéaire. Dans le Grand Agadir, la commune rurale de Taghazout constitue également un lieutouristiquepourlesEuropéens.Cesderniersfontparfoislechoixdes’installer pendant plusieurs mois d’hiver ou pour toute l’année.
1.2 Lieux de tourisme balnéaire et de migrations saisonnières, Agadir et Taghazout comme destinations phares des Européens
Agadir devient une importante destination de tourisme de masse à partir des années 1970. Le tourisme itinérant et culturel fait progressivement place au tourisme de séjour grâce à l’ensoleillement annuel et l’attraction du bord de mer. Au début des années 2000, la station balnéaire est cependant concurrencée par l’important tourisme culturel à Marrakech. Plus de la moitié des fréquentations touristiques du pays (60 % en 1960 et 80 % en 1979) sont représentées par les vacanciers européens, avec un grand nombre de ressortissants de la France (plus de 25 % de la clientèle touristiqueauMaroc),del’Allemagne,del’Espagne,del’Angleterre,dela Scandinavie et du Benelux (Haut Commissariat au Plan, 2008). Alors que les Français pratiquent à la fois le tourisme itinérant et de bord de mer, les Scandinaves et les Allemands préfèrent le tourisme balnéaire, tandis que les Britanniques se dirigent vers un tourisme de plus en plus culturel. Ces derniers sont très présents l’hiver et effectuent souvent un tourisme de groupe. Agadir attire donc des touristes tout au long de l’année, variant en fonction des nationalités et des activités qu’ils recherchent (Berriane, 2002). La pratique touristique hivernale incite progressivement les EuropéensàrésiderpendantlesmoislesplusfroidsauMaroc.
En2004,lalibéralisationdel’espaceaérien(aussiappeléeopensky)représente une opportunité pour le Maroc d’augmenter la fréquentation touristique. Les accords signés entre le Maroc et l’Union européenne permettent aux compagnies aériennes (proposant des vols à prix attractifs : les lowcost)de s’installerdechaquecôtéde lamerMéditerranée sansêtre limités par leur nationalité, leur capacité ou leur fréquence de vol (Haut Commissariat au Plan, 2008). Cela représente un nouvel argument pourlesEuropéensencorehésitantsàfranchirlepasetàdevenirrésidentsà Agadir. Ils sont nombreux à avouer s’être décidés grâce à l’ouverture d’unelignelowcosttelqueEasyJet,RyanairouJetairflyentreleurpaysetAgadir. La distance les séparant de leur famille et amis peut être parcourue plus rapidement et assez régulièrement grâce à un prix accessible. La libéralisation de l’espace aérien est donc un facteur décisif de départ pour les migrants, donnant ainsi un cas concret de l’effet de la révolution des transports sur la formation de nouvelles implantations humaines dans le monde. La baisse du prix des transports et la rapidité des vols favorisent la mondialisation par une augmentation des échanges migratoires, et la venue croissante de résidents européens au Maroc.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
48 49
Dans le Grand Agadir le tourisme balnéaire s’étend jusqu’aux communes rurales situées plus au nord telles que Aourir et Taghazout. Des travaux de grande ampleur sont actuellement en cours sur cette dernière communeafindepromouvoirlelittoraldanslecadreduPlanAzurpourledéveloppement et la promotion du tourisme au Maroc. La station touristique intégréedeTaghazoutBayconcerneunesuperficiede615hectaresavec4,5kmlelongdelacôte.Elleprévoitunecapacitéde7446litsdanslesétablissements touristiques (SAPST, 2012) et offrira également un certain nombre de villas à destination des résidents. Aujourd’hui, cette commune attire déjà un certain nombre de touristes, et notamment des surfeurs venant pratiquer le sport aquatique durant plusieurs mois d’hiver. Ce projet est présenté comme une opportunité pour favoriser le développement des communes autour de Taghazout, et apporter de l’emploi. Cette station de luxe proposant un grand nombre d’activités tel que le surf, le golf et le tennis, est toutefois sujette à débat parmi la population locale, et au sein des résidents européens. L’actuelle station balnéaire de Taghazout vit principalement grâce au tourisme lié au surf, mais ses côtes dépourvues d’urbanisation lui confèrent un charme encore sauvage. Le littoral est tout particulièrement apprécié par lesEuropéens qui établissent un campingsauvage de caravaning avec vue sur la mer durant les mois les plus froids enEurope(photo1ci-dessus).
Ce territoire attire des touristes puis de futurs résidents. Malgré ses particularités marquées par l’histoire, la venue de plus en plus nombreuse desEuropéensdanslarégioninterrogesurleursprincipalesmotivations.Comment ont-ils choisi leur destination ? Pourquoi ont-ils décidé departir ?Ces raisonspour lesquelleschacundesmigrantsdécidentde selancer dans ce voyage à la fois spatial, social et culturel, constituent un facteur essentiel pour établir la typologie.
Photo 1 : Taghazout, lieu d’attraction des
surfeurs et camping-caristes. La plage
située juste au sud de Taghazout est un spot
de surf connu parmi les pratiquants de ce
sport. En arrière-plan, il est possible de
distinguer les rangées de camping-cars
installés le long de la plage pendant les mois de l’hiver. Le 17 février
2004, G. Cognard a recensé 739 camping-
cars sur ce camping sauvage de Taghazout,
avec une majorité de Français, d’Allemands
et d’Italiens (Desse, 2010). Les travaux de Taghazout Bay se font
déjà ressentir par un nuage de poussière
soulevé en arrière-plan à droite de la photo.
Il semble que la future station intégrée pourrait repousser ces
retraités européens le long du littoral au
nord de Taghazout, ou à l’inverse attirer un
plus grand nombre de personnes aux abords de ce nouveau centre
d’activités. Cliché : Lachaud E.,
mars 2014.
2. Les raisons de migrer : un facteur typologique essentiel
Les motivations qui ont animé le projet de migration de la population étudiée et leur volonté de s’installer à plus long terme dans le Grand Agadir, représentent un élément essentiel pour établir une typologie de ces migrants européens. C’est également un moyen de souligner les particularités d’Agadir aux côtés des autres destinations urbaines possibles au Maroc. Le concept de lifestyle migration peut être mis en parallèle avec cecritèretypologique,afindevérifiersiilestpossibledel’attribueràlaplupart de ces migrants européens.
2.1 Quelles motivations pour un projet de migration au Maroc ?
Les principales motivations évoquées par les migrants au cours des entretiens semi-dirigés concernent la proximité, le climat, et la langue. Leur choix s’est souvent porté vers d’autres pays ensoleillés et exotiques comme l’Inde, la Thaïlande, le Brésil, l’Afrique du Sud ou les Iles Canaries. Mais ils ont préféré le Maroc qui possède également les atouts d’un climat agréable, tout en ayant aussi la facilité de la langue (pour les migrants francophones), et une proximité avantageuse avec le continent européen. Eneffet,l’absencededécalagehorairefacilitelecontactaveclafamilleetlesamisrestésenEurope.Aumoindreproblèmedesantéoupouruneurgence dans l’entourage du migrant, il leur est possible de revenir dans leur pays en très peu de temps grâce à l’aéroport bien desservi d’Agadir. L’Espagne,etrécemmentlePortugaletlaGrèce,sontsouventévoquésparcomparaison au Maroc. Mais le climat est toutefois plus frais l’hiver, et les Français préfèrent la facilité d’un pays francophone. La langue parlée constitue effectivement une barrière importante pour résider dans un pays, telsquel’ontsoulignélesEuropéensd’unenationaliténonfrancophonequis’exprimentprincipalementenanglaislorsdeleursséjoursauMaroc.Entenant compte uniquement de ces principaux critères, opter pour le Maroc comme pays de destination pourrait être considéré comme un choix par défaut. Un facteur peu évoqué, mais qui apparaît pourtant comme décisif, est le niveau de vie moins cher au Maroc. Les migrants n’admettent pas cet élément comme une motivation de départ, alors qu’il dicte toute leur vie quotidienne une fois à Agadir. Que serait leur nouveau lieu de résidence s’ils ne pouvaient pas régulièrement profiter des terrasses ensoleilléesdes restaurants, et de la multitude de produits régionaux proposés sur les marchés?Silecoûtdelavieétaittropcherauquotidien,ilsn’auraientplus les moyens suffisants pour retourner régulièrement en Europe, etsupporteraient probablement moins bien l’éloignement avec leur famille.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
50 51
Malgré ces facteurs décisifs dans le choix de la destination, un projet de migration ne se forme pas uniquement autour d’une destination. Il est en lien avec plusieurs éléments de décision en faveur d’un départ du pays d’origine pour s’établir dans un nouveau pays, selon des facteurs d’attirance et de rejet. Certaines motivations sont bien particulières à un type de migrant. Par exemple, ceux qui ne sont pas à la retraite et désirent entreprendre au Maroc, ou encore ceux qui connaissent le pays depuis tout jeune.
Les retraités représentent une majorité des Européens résidant àAgadir, à l’exceptiondesEspagnolsqui appartiennentàunepopulationtrès active sur place, mais quelques migrants emménagent aussi pour créer ou développer une entreprise. Cela constitue parfois un projet réfléchidepuis longtemps (par exemple en testant la possibilité d’entreprendre durant un congé sabbatique), une opportunité qui s’est créée rapidement, ou une des seules solutions qui s’est présentée pour vivre au Maroc tout en travaillant.Les réglementationsde l’ANAPECconcernant l’exerciced’une fonction par les étrangers au Maroc sont souvent perçues comme un obstaclepour lesEuropéenspossédantunequalificationquineprésentepas de valorisation supplémentaire à celle d’un Marocain. Il est donc plus facile de devenir son propre patron d’entreprise ou de s’associer avec un Marocain. Les migrants ne sont cependant pas toujours réalistes face à leur rêve d’entreprendre au Maroc. La différence culturelle peut constituer une barrière supplémentaire pour comprendre les codes de la société et développer son entreprise avec succès. Le projet de travailler au Maroc est justifiépard’autresmotivations,enlienavecunattachementaupays,àAgadir, mais aussi à la culture et une envie « d’ailleurs ».
La motivation qui anime ces migrants remonte pour certains d’entre eux jusqu’à leur enfance. Ce sont des Français, nés au Maroc ou arrivés très jeunes en compagnie de leurs parents fonctionnaires durant le Protectorat français. Suite à l’indépendance du pays ils sont contraints de rentrer en Europe en 1957, seuls quelques-uns choisissent de rester ou repartentaprès la catastrophe de 1960. A Agadir il n’est pas rare de croiser la route decesenfantsdedétachés,aujourd’huiretraitésouenfindecarrière.Jeana vécu dans cette ville jusqu’à ses 10 ans, son départ précipité du pays n’a fait qu’attiser sa nostalgie du passé et il a toujours eu le projet de revenir à sa retraite. Née à Casablanca, Nathalie11 se sent chez elle au Maroc car il représente toute son enfance. Quant à son mari, François, il a vécu à Agadir jusqu’à ses 14 ans et il évoque le souvenir d’une « jeunesse de rêve ». A l’inverse de Jean, il n’avait pas le projet de revenir vivre au Maroc, mais ayant gardé des contacts avec d’anciens amis, il venait pour des vacances et se laissa submerger par l’atmosphère de son enfance, pourfinalement décider de rester dans cette ville chargéede souvenirs.Il exprime son contentement d’avoir retrouvé la même tolérance qui
11. Afindeconserverl’anonymat des personnes interviewées,desnoms différents leur ont été attribués.Leprofilde ces personnes est disponible en annexe4afinderenseigner sur leur nationalité, leur âge, leur statut conjugal, leur principale activité, leur quartier de résidence, et leur profildemigrant(Résident à l’année, bi-résident,ouwinterbird).
« Chacun a son point de vue sur Agadir. On peut la définir comme une bourgade, une petite ville de villégiature, un chef-lieu militaire, un centre de ravitaillement ou un bled perdu du Sud marocain : les diverses identités de ma ville et son isolement me conviennent parfaitement. Ce lieu si peu connu, et pour ainsi dire hors du temps, détermine rapidement ma vision du monde. Cela me donne la certitude que, sur la terre, les êtres humains vivent en parfaite harmonie, comme dans ma région. Par-delà nos querelles de voisinage, en effet, une entente tacite et cordiale unit musulmans, juifs et chrétiens. » (Bensimon, 2012 : 119)
habitait autrefois Agadir. Ce sentiment est exprimé par Jacques Bensimon dans l’extrait ci-contre de son récit de mémoire « Agadir, un paradis dérobé », qu’il écrit en 2012 en hommage à son enfance dans la ville. Ces anciens d’Agadir reviennent tous avec le même objectif, à la recherche de leur passé, ils se connaissent et se retrouvent pour évoquer leurs souvenirs des moments vécus ensemble à l’école. Certains viennent régulièrement en tant que touriste et logent à l’hôtel. Mais d’autres deviennent winter bird, bi-résident, ou même résident à l’année pour revivre au moins quelques mois par an leur histoire. Marie a quitté le Maroc en 1954, mais tiraillée par le mal du pays elle revient s’installer à Agadir dès l’obtention de son diplôme d’enseignante en 1977, accompagnée de son mari né à Casablanca.
Dans cette même thématique des migrants tournés vers le passé, une importante motivation chez les retraités apparaît comme celle de la nostalgie d’une société européenne ayant évolué trop vite. Ils regrettent souvent la perte de valeurs encore ancrées au Maroc, telles que la famille. Mais pour ces personnes ayant grandi dans les années 1950 et 1960, vivre à Agadir représente un retour vers une vie quotidienne qu’ils chérissaient tant. Les petits commerces familiaux où l’on trouve de tout à deuxpasdelamaison,lescréditsquisontaccordésauxclientsendifficultés,la multitude de fruits et légumes frais dans le quartier… Ce sont autant de petitsdétailsquiparticipentàlamotivationdesEuropéenspours’installerà Agadir. Une ville à la fois moderne et un peu occidentalisée, mais tout en conservant une ambiance qu’il est aujourd’hui difficile de retrouverenEurope.Lorsd’unentretien,Jenspartagesoninquiétude: lesgrandssupermarchés commencent à arriver à Agadir, beaucoup de monde prend la voiture pour se rendre au supermarché Marjane, et le quartier populaire de Talborjt abrite depuis peu un centre commercial qui pourrait contribuer à la perte du charme actuel de la ville. Pour ce migrant suédois les petits commerces sont essentiels dans sa vie quotidienne au Maroc. Il se sent plus heureux, et aime discuter avec le vendeur qui le reconnaît à chaque fois. Ce contact quotidien avec la population locale est effectivement très apprécié desEuropéens. La gentillesse des gens et le fait que toutle monde se dise bonjour dans la rue leur donnent le sentiment d’être valorisés. Cette sensation est partagée par de nombreux retraités. Dans une société occidentale où on leur accorde moins d’importance, ils se sentent revivre au Maroc, au sein d’une ville conviviale dotée « d’une qualité de vie qu’il est rare de trouver ailleurs » (propos de Michelle). Mais cette qualité de vie ne serait-elle pas en partie due au statut des migrants en tant
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
52 53
qu’Européens?Lefaitd’êtrereconnuetsaluédanslaruen’estpeut-êtrepasvécu par les autres migrants provenant de pays en voie de développement. LesEuropéenssesententbienconsidérésauMaroc,maiscelaneserait-ilpas associé à la fractureNord-Sud et au différentiel économique ?Lesmigrantssedéfinissenttrèspeuparrapportàcettefracturealorsqu’elleinfluenceendenombreuxpointsleurquotidienàAgadir.
Cette qualité de vie est souvent évoquée concernant la nourriture,
du fait de consommer des produits frais et locaux, le tout pour un prix très abordable. Les migrants réalisent souvent cet avantage lorsqu’ils retournent enEurope et constatent qu’il y a un grand contraste avec leMaroc. L’atmosphère de la ville est un facteur essentiel pour que les Européens décident de s’installer à plus long terme.Marie évoque une«douceurdevivre,unrythmepluspaisiblequ’enEurope».Cerythmedevie « plus cool » est accentué par le grand nombre de retraités qui peuvent se permettre de prendre le temps et de pratiquer de nombreux loisirs. Ces derniers constituent principalement des sports de plein air, tels que les balades dans le désert, la plage, le surf ou le golf. Jack est ainsi venu à Agadir tout spécialement pour pratiquer le golf dans des conditions idéales qui sont absentes des clubs français durant l’hiver. Cette qualité de vie peut cependant être dépréciée du fait de certains points négatifs avec lesquels lesEuropéensnesontpas familiers.MaispourMoniquec’estunchoixde vie : « C’est une vie beaucoup plus simple et plus saine. Bien sûr il y a des choses qui… bah il faut faire la balance. Quand on veut vivre dans ces pays-là, il faut y vivre avec son cœur. ».
LamotivationquianimelesEuropéenspeutparfoisconstitueruntout, suite à une visite du pays ou d’Agadir par des personnes qui n’avaient auparavant jamais envisagé de vivre un jour à l’étranger. Ces coups de cœur pour le pays ou la population locale sont évoqués par plusieurs migrants lors des entretiens. Cela s’est passé très rapidement pour Jean-Pierre qui emménageait un mois et demi seulement après sa première semaine de vacances passée à Agadir. Loïc, lui, évoque plutôt « une installation sur uncoupde folie», et regretteaujourd’huidenepasavoir réfléchipluslongtemps avant de tout quitter en France. Quant à Ada, lors d’un long entretien semi-dirigé, elle raconte sa rencontre avec un jeune marocain qu’elle a hébergé en Suède, et se remémore son ressenti lorsqu’elle est venue visiter pour la première fois cet ami à Agadir : « I had travel a lot, butthefirsttimeIgetonthegroundattheairport,Ithought,Iamathome.Ihadneverfeelitinanyotherplacesintheworld.»12.CertainsEuropéenssont motivés par une passion générale qu’ils vouent à la culture arabe. Le choix s’est alors porté sur le Maroc car c’est le pays qu’ils considèrent le plus stable politiquement et le plus sûr actuellement. La plupart d’entre eux choisissent de vivre dans un quartier assez populaire qui leur permet de s’immerger dans la culture locale. Ce sont souvent des personnes qui
12. Traduction française : « J’ai beaucoup voyagé, mais la première fois que j’ai mis les pieds à terre à l’aéroport, j’ai pensé, je suis chez moi. Je n’avais jamais ressenti ça, dans aucun autre endroit du monde ! »
ont déjà vécu à l’étranger, dans des pays arabes, ou qui sont habituées à voyager.ParmicesEuropéens,ilssontquelques-unsàavoirdesoriginesfamiliales d’un pays du Maghreb, ou de familles pieds-noirs. Outre cet attachement et ces racines anciennes, beaucoup de retraités (essentiellement français) ont voyagé tous les ans en camping-car à travers le Maroc. Ils sontaujourd’huiplusâgésetdésirents’établiràAgadirdurantl’hiverafindeprofiterdupaystoutens’épargnantlafatiguedelaroute.
La retraite est une longue période souvent considérée comme un repos bienmérité. Elle incite lesEuropéens à profiter aumieux de cesannéesqu’illeurresteàvivre,maiscelasignifieparfoisdelonguesjournéesde solitude. C’est pourquoi plusieurs bi-résidents et winter birds retraités fuient l’hiver européen où tout le monde s’enferme chez soi à cause du froid,afinderetrouveruneviesocialeflorissanteauMaroc.Lemicroclimatqu’offre Agadir est également favorable à la venue de ces retraités (Cf.figure2).Ilauneinfluenceàlafoissurlemoral,etsurlephysique,avec par exemple son côté bénéfique pour certaines maladies commel’arthrose. Le coût économique de la vie au Maroc est un motif supplémentaire, il permet de payer peu de charges pour entretenir le logement, et de s’accorder de nombreux plaisirs comme le restaurant qui revientbeaucoupmoinscherparrapportà l’Europe.Parmilesmigrantsrencontrés, cette motivation n’est pourtant pas un facteur déterminant dans leur départ. Ils expliquent que cela constitue plutôt une valeur ajoutée à la destination, pour améliorer leur qualité de vie sur place. Ces propos sont toutefois à nuancer car toutes les pratiques socio-spatiales des migrants sont liées au facteur économique. Même les rapports humains sont influencésparledifférentieléconomiqueentrelesmigrantsetlapopulation
Figure 2 : La retraite des Français au soleil. Ce dessin est révélateur d’une motivation de départ liée au repos et au climat pour les personnes retraitées. Lors des entretiens, l’image d’une France pluvieuse et morose durant l’hiver est omniprésente. Le soleil d’Agadir apparaît donc comme une évidence dans leur projet migratoire.Source : (Dawid, 2013)
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
54 55
locale. Yannick avoue dépenser plus qu’en France car il mange au restaurant pratiquement tous les soirs et se permet un plus grand nombre de plaisirs. Cette baisse du coût de la vie sur place est donc toutefois à nuancer car elle n’est pas valable pour les migrants qui continuent à acheter uniquement des produits occidentaux dans les supermarchés et ne fréquentent que les restaurants situés dans la zone touristique. L’alimentation est tout de même encore très abordable, alors que les prix du foncier tendent progressivement vers des prix européens. Monique cite un exemple des frais qu’elle doit payer pour les charges de son appartement situé dans le centre d’Agadir : l’électricité revient à 60 dirhams/mois (l’équivalent d’un peu moins de 6 euros), et l’eau coûte 300 dirhams (environ 26 euros) pour une période dedeuxans.Hervéconfirmecesdiresetseréjouit:«Avec1500eurosici,on vit comme avec 3 000 euros en France ! ». Ces 1 500 euros concernent également les petites retraites avec lesquelles il est difficile de vivrepleinement en France ou dans les pays voisins. C’est la raison pour laquelle certains retraités choisissent d’emménager au Maroc, pour échapper aux difficultésd’unepetiteretraite,etpoursepermettredesloisirsqu’ilsnepourraientpass’offrirenEurope.Carlynnestdansunesituationdifférente;elle a saisi l’opportunité d’arrêter de travailler plus tôt que prévu, en échanged’uneretraitemoindre.Elleafranchicetteétapecarelleconnaissaitla possibilité d’emménager à Agadir avec un plus petit salaire. L’idée d’un repos bien mérité après avoir travaillé « dure » dans leur pays est régulièrementmiseenavantparlesEuropéensinterviewés.Ilexistedoncune ambiguïté entre leur discours et la réalité concernant la place qu’occupe le facteur du niveau de vie dans leur migration. La possibilité de vivre avec un petit salaire au Maroc constitue une importante raison de migrer, et serait impossible sans un bon pouvoir d’achat.
Ces migrants européens peuvent aussi avoir été influencés par lesnombreux avantages qui leur sont présentés. Les médias se sont intéressés ausujet«desEuropéensauMaroc»(etprincipalementdesFrançais)avecune grosse campagne d’information depuis les années 2000 (Pellerin et al., 2010 ; Lemaire and Mathlouti, 2012 ; Giedinger, 2011). Ils ont ainsi contribué à une grande publicité pour ces migrations. Une triple idée est mise en avant : la possibilité pour de jeunes entrepreneurs de se lancer danslavieactive,uneretraiteausoleil,etl’avantagefiscaledevivreauMaroc.Cedernierélémentprovientd’uneconventionfiscaleétablieentreleMarocetlaFrance(signéeen1970puismodifiéeen1989)afind’éviterune double imposition des résidents français au Maroc, et d’attirer un plus grand nombre de retraités, donc d’investissements dans le pays. Les retraités résidantauMarocpeuventbénéficierd’unabattementde40%sur la pension de retraite à déclarer (Consulat général de France au Maroc, 2011). Ilestégalementpossibledeprofiterde80%deréductionsur lemontant à payer, mais à condition de verser la pension sur un compte marocain en dirhams non convertibles13. Parmi les Français déclarés
13. Un compte en dirhams non convertibles est un moyen d’inciter ces Français à dépenser au Maroc, car une fois l’argent placé sur ce compte il n’est plus possible de le rapatrier en France. La seule exception concerne les Français qui abandonneraient leur statut de résident fiscal au Maroc, et pourraient donc faire revenir cet argent dans leur pays d’origine par étapes de 25 % par an.
commerésidantfiscalementauMaroc,beaucoupontpréférénetransférerqu’une partie seulement de leur pension sur leur compte marocain en dirhams non convertibles. Cela représente pour eux une certaine sécurité, et leur permet de ne pas être contraint de s’inscrire à des caisses de sécurité sociale payante, tout en conservant un compte en France.
Lors des entretiens, les Français sont nombreux à évoquer une connaissance ou un ami qui se serait laissé séduire par ces multiples campagnes d’information dans les médias. L’idée de l’eldorado marocain etdudépaysement,toutenbénéficiantd’unavantagefiscal,ontsouventencouragé la décision d’un départ précipité à destination d’Agadir en quittant tout en France. Ces témoignages révèlent une migration liée à de nombreux préjugés et à une déception de leur nouvelle vie une fois au Maroc. Philippe critique la vision faussée que diffusent les médias français. Ces derniers ne sont pas objectifs et présentent essentiellement les avantages d’une tellemigration, sans partager les difficultés liées àvivre au sein d’une nouvelle culture. Ces différentes motivations créées pour attirer des investissements au Maroc, induisent la venue d’un grand nombred’Européensenunmêmelieu.Parmiles38personnesrencontréesau cours des entretiens semi-dirigés, seule l’une d’entre elle, Carlynn, se ditavoirétéinfluencéeparlefaitdevenirdansunevilleabritantbeaucoupd’Européens. Le désir de se retrouver au sein d’une communautéeuropéenne à l’étranger ne semble donc pas constituer une motivation majeure.Cependant,pourcertainsEuropéensquicraignentuntropgrandisolement, cela peut jouer en faveur du choix de la destination.
Les nombreux facteurs d’attirance cités précédemment se doivent d’êtrecomplétésparlesconditionsquiencouragentcesEuropéensàquitterleur pays d’origine : suite à un problème personnel, tel qu’une rupture avec la famille, un divorce, ou un évènement douloureux. Louise partage cette expérience qui l’a amenée à résider de façon permanente au Maroc : «En2009, je suis partie pourmettredeskilomètres entremonmari etmoiàcemoment-là.Etpuis jesuisrestée, jenesuisplusrepartie.».Al’inverse, le départ est parfois précipité par la volonté d’un rapprochement familial, soit pour rejoindre sa famille européenne déjà sur place, soit pour se rendre dans le pays d’origine de son/sa conjoint(e). Au-delà de ces motivations, il peut également s’agir de la fuite d’un mode de vie, qu’il soit personnel ou fortement influencé par la société occidentale.Monique explique qu’elle aime être au Maroc car c’est une société moins matérialiste. Elle a fait le choix de vivre en alternance en France et àAgadir car elle est contre l’individualisme européen. Cette fuite du vieux continent est donc étroitement liée à une éthique de vie, à la recherche d’une société et d’un mode de vie qui conviendraient mieux. Ada se félicite queleMarocsoitenpleindéveloppementetprogrès.Pourelle,l’Europeest devenue déprimante car elle donne le sentiment de ne plus évoluer. Ces fuites du pays d’origine sont des facteurs importants qui pourront être mis
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
56 57
en relation avec le concept de lifestyle migration. Cependant, la société que les migrants disent fuir n’est pas toujours si différente de celle qu’ils atteignent au Maroc. Monique parle d’une société moins matérialiste, mais cette notion est à relativiser car cela s’explique peut-être par le fait qu’ils ont moins les possibilités d’être modernes. Les Marocains n’en sont pas moins matérialistes, car ils portent beaucoup d’importance à l’argent. Les migrants se construisent donc une idée de la société marocaine avant même de partir, elle est souvent préconçue et chargée de préjugés. Cet idéal marocain est créé par opposition à leur pays d’origine. Ils recréent ainsi eux-même une fracture Nord/Sud par le biais de leur imagination et de leur désir. Ils viennent trouver au Maroc ce qu’ils n’ont pas dans leur pays. Mais une fois sur place, leur vision utopique ne leur permet pas de reconnaître les points communs existants entre les deux sociétés.
Les motivations présentées précédemment sont essentiellement liées aux migrations vers le Maroc. Mais cela nécessite de connaître les raisons qui poussent ces migrants à emménager dans le Grand Agadir et non dans une autre région du pays.Ce choix devrait également définirquelles sont les particularités de ces migrants européens résidant à Agadir.
2.2 Le Grand Agadir : un choix de destination bien défini
Lesprincipalesmotivationsde lamigrationdesEuropéensàAgadirsont différentes de celles des villes au nord du pays. Ils ne viennent pas pour des raisons culturelles et patrimoniales, car il n’y a plus de médina depuis le tremblement de terre de 1960, et très peu d’activités culturelles comme des spectacles et cinémas. Les motivations sont donc plutôt tournées vers les activités de plein air telles que la plage, le golf, et le désert. CertainsEuropéensavouentavoirtestéd’autresvillescommeMarrakechou Casablanca, mais ils ont choisi Agadir pour sa population berbère réputée très accueillante, et son ensoleillement plus constant. Marrakech est critiquée pour son trop grand nombre de touristes, son rythme de vie stressant et étouffant, et sa situation à l’intérieur des terres qui implique destempératuresextrêmesdanslespositifsetnégatifs.Essaouirapossèdela qualité du littoral mais reste toutefois trop petite et avec moins de loisirs. Quant à Casablanca, elle est peu appréciée de ces migrants à cause de sa trop grande activité tournée vers les entreprises, son centre immense et son foncier à prix élevé. Agadir est donc privilégiée pour son ambiance de petite ville et sa tranquillité. Mais cela peut également constituer une limite, comme le souligneYannick en justifiant sa préférence pour la ville deTanger. Il explique que la multitude de touristes présents à Agadir favorise un regard oppressant des Marocains vis-à-vis de l’argent des Occidentaux. Phénomène qu’il avait moins ressenti lors de son séjour à Tanger. Selon Yannick, ladifficultéd’Agadirreposejustementdanscetteambiancedepetite ville dotée d’un esprit de village où tout le monde se connaît et peut s’épier. Ce témoignage soulève la question de la relation différentielle
entreMarocains etEuropéens. Pourquoi ce regard oppressant porté surl’argent desOccidentaux ?Ladimension économique est omniprésentedanslarelationentrelesmigrantsetlapopulationlocale.LesEuropéensprofitent de leur supériorité économique, avec par exemple l’avantaged’augmenter leur pouvoir d’achat et ainsi leur niveau de vie. Cependant ils supportent moins facilement les contraintes liées à ce différentiel : chaque migranttransporteavecluiuneimageetunsymboledel’Européen,ainsique toute la richesse qui lui est attribuée.
Parmi les avantages du Grand Agadir, la proximité des services peut être retenue. Ces migrants sont pour beaucoup retraités et s’informent de la présence de médecins compétents et de cliniques pouvant les recevoir encasdeproblèmesdesanté.LesFrançaisetlesEspagnolsbénéficientdela présence d’un consulat pour faciliter leurs démarches administratives et leur donner la possibilité de voter lors des élections dans leur pays d’origine. L’aéroport d’Agadir, Al Massira, est également un facteur important concernant l’accessibilité entre le pays d’origine et le pays d’accueil, avec notamment des liaisons régulières de vols low cost.Agadir est connuecomme une ville au climat agréable avec une population bienveillante etouverted’esprit,maisc’estaussiunevillequireflètelamodernitéduMaroc suite au séisme de 1960. Anne partage un avis similaire à beaucoup d’EuropéensrencontrésàAgadir,enlienaveclecôtéoccidentalisédelavillequiainfluencéleurchoixdulieuderésidence:«Cen’étaitpastropdans la culture complètement marocaine, il y avait ce côté un petit peu plus prochedel’Europe.»Celaseconfirmeparexempleaveclerécentquartier
Photo 2 : Le port de la Marina. Les travaux avaient débuté en 2001, et ils sont aujourd’hui achevés. La Marina se caractérise par des appartements de haut standing le long du port de plaisance. Entre grandes chaînes de magasins occidentaux et cafés‑restaurants proposant des menus très européens, ce nouveau quartier a tout pour donner le sentiment d’un retour en Europe.Cliché : Lachaud E., février 2014.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
58 59
delaMarina,dontleprofilestparticulièrementressemblantàceluid’unport de plaisance européen (Cf. photo 2). La rencontre avec trois Français résidant dans le camping d’Agadir met l’accent sur un autre facteur qui différencie Agadir des autres grandes villes marocaines. Ces dernières ne donnent pas la possibilité de circuler en camping-car dans le centre, il est donc nécessaire de garer son véhicule en périphérie puis d’utiliser un bus ou un taxi pour se déplacer. A l’opposé, le centre d’Agadir est facilement accessibleencamping-carpourlesEuropéenssouhaitantlevisiter.Malgréces nombreux facteurs attractifs, quelques déceptions se cachent dans le discours des Européens. Pour Carine, le manque de culture représentesouventunvide.EtJean-Pierreévoquel’évolutiondecettevillequis’estrapidement développée au cours de ces dernières années. De nouveaux quartiers, des immeubles modernes et élevés, la disparition d’une vue sur la montagne, ce sont autant de phénomènes qui, selon lui, contribuent à une progressive perte du charme d’Agadir.
Leprofildesmigrantsestégalementdifférentenlienavecleniveaude vie. Marrakech attire une population aisée et d’artistes « branchés ». LesEuropéensrésidantàAgadirsemblentprovenird’uneclassesocialemoyenne, motivés par le bas coût de la vie et les économies que cette migration leur apporte durant l’hiver (le climat favorable ne nécessite aucunes dépenses pour le chauffage). Une hausse de leur niveau de vie estainsiaccordéeparrapportàleurquotidienenEurope.UnEuropéendeclasse moyenne est considéré comme plus riche au Maroc, et cela lui permet de vivre au-dessus de ses moyens. La plupart des migrants s’octroient donc un plus grand nombre de loisirs et de récréations. Le bien-être est également au cœur du nouveau luxe qu’ils peuvent s’accorder. Les taches ménagères sont effectuées par une employée, chose que nombreux d’entre eux n’auraient pu se permettre en Europe, et les soins de beauté et deconfort tels que des séances quotidiennes de massages deviennent à porté de main.
Les principes du concept de lifestyle migration ayant été présentés auparavant, peut-on assimiler ce type de migration à ceux des résidents Européens?L’étudedeleursmotivationspermetdemettreenévidenceunpossible rapprochement avec la recherche d’une meilleure qualité de vie par une migration privilégiée.
2.3 Des motivations de départ semblables à celles des lifestyle migrations
Les lifestyles migrantssontdéfiniscommedespersonnesprivilégiées.Lorsdesentretiens,lesEuropéensconfirmentcefacteurcarilssedisentlibres de repartir à tout moment. Ils viennent au Maroc en toute tranquillité, conscients que si leur projet de migration n’aboutit pas comme ils le désiraientilspeuventchoisirdeseréinstallerenEurope.Danscettemêmelogique, plusieurs Européens sont venus tester la possibilité de résiderau Maroc durant quelques semaines pour être certain de leur décision. CesEuropéenspratiquentdoncunemigrationchoisie,etavecunretourpossible. Même si la population européenne d’Agadir est caractérisée par une classe moyenne et des salaires moins élevés que celle de Marrakech, cela constitue une migration privilégiée car son pouvoir d’achat est augmenté en venant au Maroc. De plus, ce type de mobilité est encouragé par le pays d’accueil car il est synonyme d’une rentrée d’argent grâce à l’importante consommation pratiquée par les migrants. Ces lifestyle migrations se caractérisent par la recherche commune d’une meilleure qualité de vie grâce à la migration. Leur quotidien peut être amélioré selon différents critères qui leur sont propres et constituent un projet en cours pour augmenter leur bien-être personnel.
Ce type de migration est ici synonyme d’un gain. Mais cela doit être nuancé car les migrants reconnaissent tous qu’ils doivent faire abstraction d’uncertainnombredefaitsquilesrévoltentetaveclesquelsilestdifficilede vivre. Cela concerne par exemple une limite au fort communautarisme. Anne explique combien le regard d’autrui importe à Agadir et peut aboutir sur beaucoup de jalousie. Le statut de la femme marocaine est également souventévoquépardesEuropéensrévoltés.Desdifficultéspeuventdoncêtre rencontrées face à ce nouveau mode de vie. Outre le choix parmi les différentes destinations possibles avec les critères de la langue et de la proximité, le tableau 4 page suivante présente les motivations sous forme d’avantages par opposition aux défauts présents des les pays d’origine. Avant le départ, ces avantages peuvent être surévalués du fait d’un mélange entre imaginaire et réalité. Cela se remarque par exemple dans les caractéristiques de la société et les valeurs de la famille. Ces dernières sont peut-être différentes au Maroc, mais sont-elles vraiment comme se les représententlesmigrants?
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
60 61
M. Benson et K. O’Reilly (2009) décrivent les lifestyle migrations comme une fuite vers une nouvelle vie, un nouveau quotidien. Parmi les différentes motivations citées précédemment, et les avantages mentionnés dansletableau,cettenotiondefuiteesttrèsimportante.Eneffet,ilyaunrejet des inconvénients présents dans le pays d’origine, pour rechercher par opposition les avantages du lieu de destination. La dimension économique est omniprésente dans ce tableau. Entre changement du niveau de vie,possibilité d’entreprendre, de pratiquer des loisirs, et de consommer de bons produits, le facteur économique est essentiel, alors qu’il est souvent nié parlesEuropéens.Uneparticularitésedessinechezlesmigrantsfrançais.Ils sont nombreux à évoquer la France avec écœurement concernant les thèmes de la politique, la forte imposition, le chômage et l’insécurité. Ce rejetdénonceunbesoinderecul.Ericn’aimepluslaFranceetnesouhaiteplus s’y rendre pour l’instant. Certains migrants français souhaitent ainsi se détacher de tout ce qui concerne leur pays d’origine. Mais malgré tout, ce sont souvent les premiers à suivre l’actualité française par le biais des médias et des chaînes satellites. Seulement, ils s’informent sans se sentir directement concernés, ils observent de loin. Ce sentiment n’est bien sûr pas généralisable à l’ensemble des migrants français d’Agadir, mais de façon assez surprenante, il est bel et bien présent parmi la communauté
française. Ce sentiment de fuite concerne également le changement de vie suite à un évènement douloureux tel qu’un divorce ou un décès, comme l’ontexpliquéplusieursmigrantsinterviewés.
Le concept de lifestyle migration semble donc bien correspondre à la plupartdesmigrantsEuropéens.Ilconcordeaveclesmultiplesmotivationsmises en avant ci-dessus, et constitue une fuite ou un rejet pour certains des migrants. La diversité des raisons qu’ont les migrants pour quitter l’Europeetvenirs’installerdansleGrandAgadirsoulignelapluralitédeleursprofilsenfonctiondecesmotivationsetdebiend’autresfacteurs.Uneclassificationpeutdoncêtreétablieafindedistinguercesdifférentsrésidents européens.
Tableau 4 : La construction
d’une destination en opposition au pays
d’origine. Réalisation : Lachaud E., 2014.
Destination : avantages(Justifiantlafuitedesinconvénientsdel’origine)
Origine : défauts(Par opposition aux atouts de la destination)
- Climat agréable, ensoleillé - Temps triste, ambiance morose
- Coût de la vie moins cher - Baisse d’imposition
- Vie trop chère pour se permettre des loisirs - Toujours plus d’impôts : forte critique
- Rythme de vie reposant, agréable - Vie stressante, fatigante - Pratique de nombreux loisirs - Moins de temps pour les loisirs
- Forte présence policière - Trop d’insécurité
- Retour vers une société communautaire (nombreux contacts dans la vie quotidienne)
- Présence de principes et valeurs
- Société individualiste - Perte des valeurs fondamentales comme celle de
la famille
- Qualité de vie, produits frais et locaux - Une qualité de vie qui se dégrade
- Société moins matérialiste - Société trop matérialiste
- Un pays qui évolue, porteur de progrès - Sentiment de stagnation
- Attachement sentimental - Dépaysement, « ailleurs culturel »
- Faible attachement au pays - Vie monotone, sans surprises
- Nouveauté, aucuns liens passés - Problèmes (lieux ou personnes) à fuir
- Un nouveau départ pour entreprendre -LacriseenEurope,hausseduchômage
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
62 63
3. De la diversité des migrants à l’établissement de huit profils typologiques
L’établissement de cette typologie prend en compte tous les migrants européens résidant au Maroc pour une durée supérieure à trois mois. Certainsprofilspeuventêtredéveloppésgrâceauxentretiensmenéssurle terrain, alors que d’autres sont déterminés uniquement sur la base de l’observation et de la documentation sur des travaux de recherche menés auparavant.La limitedece typedeclassification reposedans le faitdevouloir mettre une étiquette sur chacun des migrants. Ils ne peuvent pas tous être référencés dans un groupe, ou ils le seront du fait de quelques points communs avec les caractéristiques données. Le statut des migrants peut évoluer, valorisant ainsi les passerelles possibles entre chaque catégorie typologique.
3.1 Une typologie établie selon six facteurs
Unetypologieestunsystèmedeclassificationdesmigrantseuropéensen plusieurs types distincts. Elle est établie en fonction de traitscaractéristiques définis à l’avance. Cette méthode permet de mettre enévidence les différences de profils entre ces migrants. Cependant, cescatégories ne sont pas exhaustives, et elles peuvent évoluer. Le profilmigratoiredecertainsEuropéenspeutégalementnecorrespondreàaucunedecesentrées.Sixfacteursontétéchoisisafindeconstituerunetypologiepertinente concernant les résidents européens dans le Grand Agadir :
Facteurs typologiques
1 Motivations Projet m
igratoire
2 Statut3 Durée de séjour4 Type d’habitat5 Perception6 Adaptation
MotivationsLe premier facteur est essentiel pour la typologie, car il constitue la base
du projet migratoire. Les migrants ont la possibilité de se projeter dans le temps, formant ainsi la décision de migrer et le choix de la destination. Ce projetmigratoireestenconstanteévolutionetpeutdoncêtremodifiéàtoutmoment.LegrandnombredemotivationsincitantlesEuropéensàvenirrésider dans le Grand Agadir a été abordé précédemment.
StatutLedeuxièmefacteurconcerneégalementleprojetmigratoireetinflue
sur les motivations et le type de séjour pratiqué au Maroc. Cette notion de statut concerne à la fois l’activité du migrant, s’il est actif ou retraité, et sa catégorie socioprofessionnelle. Ce dernier élément permet de mieux appréhenderleniveaudeviedesmigrants,unsujetqu’ilestsouventdifficiled’aborder lors des entretiens. Cette notion de statut implique également le statutofficielquelesEuropéensontauMaroc:Possèdent-ilsunecartederésident?Sesont-ilssignaléscommerésidentsurleregistreduConsulat?
Durée de séjourLaduréeduséjourauMarocconstitueunepartduprojetmigratoire.Elle
est souvent envisagée à l’avance, mais un certain nombre d’évènements inattenduspeut survenirune fois installéauMarocetmodifier laduréede séjour prévue originellement. Ce facteur recoupe les trois catégories méthodologiquesdéfiniesauseindelapopulationétudiée:lesrésidentsà l’année qui sont résidents permanents au Maroc. Les « bi-résidents », qui vivent dans leur résidence secondaire au Maroc pendant environ six moisparan.Etles«winterbirds»,quicommelenoml’indique,résidentau Maroc uniquement pendant les mois les plus froids de l’hiver pour une durée supérieure à trois mois.
Type d’habitatLe quatrième facteur concerne le type d’habitat dans lequel résident
les migrants durant leur séjour au Maroc. Cet habitat peut être révélateur d’une différenciation des migrants entre eux. Parmi ces types d’habitats, peuvent être recensés :
- le logement en camping-car (au sein d’un camping ou en camping sauvage),
- le logement en hôtel ou résidence touristique, - la location régulière ou l’achat d’un appartement, maison ou villa.
Photos 3 et 4 : Deux types d’habitats privilégiés par les résidents Européens. Quartier Les amicales à gauche, résidence Tifaouine à droite. Cliché : Lachaud E., mars 2014.
Tableau 5 : Tableau récapitulatif des six facteurs typologiques.Réalisation : Lachaud E., 2014.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
64 65
Ces logements peuvent avoir une morphologie plutôt moderne, occidentalisée, ou au contraire rester dans un style traditionnel. Le quartier Les amicales est par exemple caractérisé par de grandes maisons traditionnelles avec une terrasse sur le toit, un puits de lumière central et très peu de fenêtres. La morphologie très différente de la résidence Tifaouine, situéedanslequartierIndustriel,estappréciéeparlesEuropéenspoursonarchitecture moderne et ses grandes fenêtres qui sont absentes des maisons traditionnellesmarocaines.Cesphotos3et4présententdoncdeuxprofilsdifférentsd’habitatprivilégiésetrecherchésparlesrésidentsEuropéens.
Perception La perception que le migrant a de lui-même et de son projet
migratoire est un élément subjectif important. Ce facteur sera tout particulièrement étudié au sein d’un troisième chapitre, en parallèle à l’étude de la traduction socio-spatiale de ces migrants sur le territoire. Eneffet,laperceptiondesEuropéenspeutêtrerévélatriced’unecertainepratique migratoire au Maroc.
Adaptation Le dernier facteur est étroitement lié au précédent. L’adaptation du
migrant au sein d’une nouvelle culture, d’un pays et avec un mode de vie très différent est un processus pouvant prendre du temps. La volonté ou non du migrant pour s’adapter met en évidence le choix de retranscrire son propre mode de vie européen à l’identique, ou au contraire de l’ajuster en fonction de la situation locale.
Après avoir souligné la multitude de motivations animant ces migrants, les questions de leur statut et du choix de la durée de séjour se doivent d’êtreabordésplusendétailsafindeconcevoirlesdifférentespossibilitésqui s’offrent à eux.
3.2 Le statut des migrants, entre carte de résident et inscription au Consulat
PourunepartiedesEuropéens,ilparaitnormaldedemanderlacartede résident car ils se considèrent comme tel et ne sont pas effrayés par lasignificationdecetengagement.D’autreseffectuentladémarchepluspar contrainte que volonté. Au sein d’un couple, c’est souvent le conjoint qui prend la carte en premier pour pouvoir acheter une voiture au Maroc, et sa femme le suit quelques mois ou années plus tard. Le passage d’une voiture européenne à la douane constitue effectivement une lourde démarche dont beaucoup de migrants préfèrent se passer (forte taxe douanière, et le véhicule étranger ne peut rester sur le territoire marocain que pour une durée de six mois). Pour les personnes pratiquant une activité professionnelle, l’ouverture d’une boutique nécessite la carte de résident.
Cependant,certainsEuropéenscréentuneentrepriseauMarocetnefontpas la démarche pour avoir le statut de résident. Sylvie est dans ce cas, résidente (officieusement) au Maroc depuis cinq ans, elle explique nepas encore avoir pris sa décision concernant la carte de séjour, car elle souhaite revenir en France une semaine tous les trois mois pour voir sa famille : « Tu demandes une prolongation touristique, tu dis que tu vas visiter le pays, en général ça marche, après ils sont un peu réticents. A l’aéroport, quand ils regardent ton passeport, tu as de temps en temps une réflexion « ahmais vous êtes souvent ici, vous êtes résident ? »,maisc’esttout,iln’yajamaiseudesoucis.Enprincipet’aspasledroit,maisbon… en général ils sont assez laxistes là-dessus. ». Il est donc assez courant au sein de la communauté européenne de rencontrer des résidents à l’année faisant ces allers-retours tous les trois ou six mois (s’il y a eu prolongation de la carte) dans leur pays d’origine. Ces personnes peuvent malgré tout être propriétaires d’une maison au Maroc, même s’il leur est interdit de posséder un compte en dirhams non convertibles. Plusieurs Européensinterviewéssontpendantlongtempsrestéssurleurréservecarils perçoivent la carte de séjour comme un engagement à créer un lien plus fortavecleMaroc,officialisantainsileurprésencedanslepays.Paulestbi-résident et possède une carte de séjour. Il a pourtant le sentiment d’être considéréparl’Etatmarocaincomme«untouristeendéplacement»,carseule la mention « visiteur » est écrite sur sa carte. A l’inverse, certains migrants ont décidé de ne plus avoir de carte de résident car cela constitue trop de démarches. Il faut par exemple s’inscrire à des caisses de sécurité socialepluschères, telleque laCaissedesFrançaisde l’Etranger.Maiscette dernière contrainte est esquivée par beaucoup de Français qui gardent un compte en France.
Les papiers nécessaires à l’obtention de la carte de résident deviennent de plus en plus nombreux. Depuis 2013 il est nécessaire de fournir un certificatmédicalétabliparunmédecinexerçantauMaroc,etunextraitde casier judiciaire (du pays d’origine dans le cadre d’une première demande, et du Maroc pour un renouvellement). Lors des réunions d’amisentreEuropéens,lesconversationss’oriententrégulièrementversla complexification de ces démarches qu’ils perçoivent souvent commeune volonté de faire obstacle à leur venue au Maroc. C’est ainsi qu’ils critiquent le fait de devoir échanger leur permis contre un permis marocain dans l’année de leur déclaration de résidence. Ce sujet est régulièrement voué à des critiques de la part des migrants ne comprenant pas que les touristes aient le droit de conserver leur permis, mais pas eux. La loi française est pourtant la même concernant les immigrés, avec l’obligation pour un résident d’avoir un permis français.
Unefoisenpossessiondelacartederésidence,lesEuropéensontlapossibilité de se déclarer auprès de leur Consulat. Seuls deux d’entre eux sontreprésentésàAgadir(leConsulatdeFranceetleConsulatd’Espagne),
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
66 67
les autres pays étant uniquement représentés par des Consuls honoraires. Cette inscription consulaire n’est pas obligatoire mais elle permet de localiser la communauté d’un pays européen au Maroc, et d’assurer sa protection. Lors d’un entretien libre, Monsieur le Consul de France à Agadir explique que le cas de cette ville est très particulier, avec un nombre record de Français (environ 50 %) ne souhaitant pas s’inscrire au registre des Français du Consulat. Il pense que cette particularité est due à l’absence d’un réel danger de sécurité dans le pays, mais aussi pour des raisonsfiscales.Selonlui,ilestfortpossiblequecertainsFrançaisnesedéclarentpasfiscalement,nienFranceniauMaroc.Eneffet,enFrance,seulelapreuved’unlogementauMarocsuffitpoursejustifieretnepasêtrefiscalementrésident.DesFrançaispeuventdoncnepassedéclarerentantquerésidentauMaroc(etgarderunvisatouristique),afindenepasêtrefiscalement reconnuauMaroc.L’inscriptionàce registreconsulaireesttoutefois nécessaire pour refaire une pièce d’identité, inscrire ses enfants à l’école française, ou voter aux élections présidentielles. Concernant ce dernier élément, les avis sont très variés. Certains résidents à l’année ne retournent jamais dans leur pays mais souhaitent voter. Alors que d’autres observent l’actualité de leur pays sans y participer. Pascal exprime cette opinion lors de son entretien : « C’est confortable cette impression d’être un peu loin, de juste voir ce qu’il se passe. Et puis on est tellementfiché etfliquédepartout, jenevaispas aller enplusm’inscrire là-bas.Symboliquement c’est aussi une façon de prendre un peu de distance. ».
IlexistedoncdenombreuxprofilsdifférentsauseindelacommunautéeuropéenneconcernantleurstatutofficielauMaroc.Ladécisionounondesedéclarerentantquerésidentpeutégalementêtreinfluencéeparladuréede leur séjour sur place, si les résidents ne migrent au Maroc que pour quelques années, ou s’ils sont bi-résidents ou winter birds.
3.3 Partir, rester, se projeter : quelles durées de séjours des migrants au Maroc ?
LesprojetsdemigrationdechacundecesEuropéenssonttrèsvariés.Lorsqu’ils sont prévus à l’avance, ces projets migratoires peuvent être définis pour un long terme ou une courte durée. Le premier cas relèvesouvent du désir d’entreprendre avec le développement d’une activité bien précise, ou de la volonté de s’installer pour passer toute sa retraite à l’étranger. Concernant les projets de courte durée, ils concernent les EuropéensprévoyantderesterauMarocseulementunepartiedel’année.C’est par exemple le cas des retraités en camping-car et des surfeurs sur lesplagesdeTaghazout.LeurretourenEuropeseprévoitenfonctiondel’évolution de la météo, à la fois au Maroc et dans leur pays d’origine. Ils dépassent rarement les six mois de résidence dans le Grand Agadir. Vivre au Maroc peut également constituer une étape migratoire au sein du parcours
deviedumigrant.CesEuropéensdécidentdevenirvivreuneexpériencele temps de quelques années, ou ils projettent de continuer leur migration dansunautrepays.Certainspartentaussisansprojetsbiendéfinis.Ilsontgénéralement peu d’attaches avec leur pays d’origine et n’envisagent rien au long terme. Leur philosophie se résume en une phrase : « Si j’en ai marre du Maroc, je vais autre part. ».
Le choix de repartir vivre en Europe est parfois lié à un imprévu,comme par exemple la réalisation d’un projet migratoire qui aurait échoué.Rencontréeàlaterrassed’uncafé,Catherineconfie,àlafoisavecdéception et un écoeurement pour Agadir, l’échec de son projet d’ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Associée avec son compagnon français et un Marocain, elle explique s’être fait escroquer en quelques mois seulement. Aprèsavoirplacétropdeconfianceensonprojet,elleestaujourd’huiencours de procédures judiciaires pour récupérer ses biens et elle ne souhaite plus qu’une chose : quitter ce pays et cette mauvaise expérience pour revenir en France. Loïc souhaite également repartir en France, pour lui ce voyage de six ans au Maroc est une erreur, il n’aurait jamais dû se laisser convaincre par sa compagne d’origine marocaine de venir sur un coup de tête. Nombreux sont les résidents européens à connaître des personnes dans ce cas, venues avec trop d’espoir et peut-être trop de rêves. Certains repartent avec le sentiment d’avoir passé une étape et de s’être enrichis par leur expérience. D’autres repartent la tête basse comme s’ils s’étaient fait déjouer par leurs propres espérances et désirs utopiques. A l’inverse, des migrants bien installés au Maroc ne souhaitent aucunement rentrer en Europe, sauf si ils sont trop âgés oumalades. Cependant, quelquespersonnescommeLouise,ontdéjàenvisagétouteleurfindevieàAgadir.Cela témoigne d’un attachement particulièrement fort pour le pays de la part d’une migrante qui est arrivée pour la première fois au Maroc un petit peu par hasard et dont toute la famille est en France :
« J’ai déjà tout prévu. S’il m’arrive la maladie d’Alzheimer, ou quelque chose d’important, c’est plus pratique d’être ici, d’avoir quelqu’un qui s’occupe de nous. En France les maisons de retraite c’est très cher. Ici pour 500 ou 600 euros, tu peux avoir quelqu’un qui s’occupe de toi la journée et la nuit. Tu vas être bien traité parce que, si ils ont un bon salaire chacun, ça correspond à deux fois et demi le SMIC marocain. Nourris/logés éventuellement, il faut avoir un œil dessus, mais ça peut être bien. Et si je me fais enterrer, j’irai au cimetière d’Agadir. »
Le lieu choisi pour vieillir puis être enterré est le symbole d’un fort sentiment d’appartenance, tel que le souligne Claudine Attias-Donfut dans son choix d’aborder ce sujet lors d’une enquête sur le parcours de vie des immigrés en France (Attias-Donfut, 2004). Mais la décision de Louisen’estpasuniquement liéeàsonfortattachementauMaroc.Elle
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
68 69
justifieaussisavolontéderestergrâceaufacteuréconomiqueavantageux.Les maisons de retraite coûtent très chères en France, alors que payer des employésmarocainsneluicoûteraitpresquerien.ElleadonccommencéàréfléchiràsasituationmigratoireenfonctiondesdifficultésfinancièresauxquelleselleseraitconfrontéeunefoisenFrance.D’autresEuropéenstentent de revenir vivre dans leur pays d’origine. Laura a fait ce choix, cela fait un an qu’elle a arrêté sa carte de résidence et a pris un appartement en France pour rentrer plus souvent. Mais elle souligne l’échec de cette tentative:«JevoulaisresterenFrance,maisfinalementlacartejevaisla refaire. Quand tu vas de l’autre côté, bah c’est pas extraordinaire, c’est superflu,lesgensilssonttousaigris.».
Trois types de migrants peuvent être évoqués concernant la durée de leurséjourauMarocetlafréquencedeleurretourenEurope:
- les premiers, n’ont aucune difficulté à rester toute l’année dans leGrand Agadir sans retourner dans leur pays d’origine ;
- les seconds, ressentent le besoin de rentrer assez régulièrement ;- les troisièmes sont au contraire partagés entre deux continents. Comme l’a souligné l’exemple précédent du projet defin de vie de
Louise,certainsEuropéensenvisagent,sansproblème,deresterauMarocpourunelonguepériode.Celasejustifiesouventparladéceptionqu’ilsressentent lorsqu’ils rentrent dans leur pays : « Des fois, je peux rester 18 mois sans aller en France, ça ne me manque pas. Dans la région parisienne les gens sont gris, tristes, et stressés. » (propos de Louise). Parmi les résidents à l’année, plusieurs personnes souhaitent donc rentrer lemoinspossibledansleurpays.D’autresreviennentenEuropeplusparobligation que par plaisir (visite familiale, formation pour le travail etc.). Ils se montrent souvent très contents de retour au Maroc car ils retrouvent le soleil, un rythme reposant et une mentalité différente de l’Occident. Pascal est un jeune retraité résidant toute l’année à Agadir depuis le mois de janvier. Il n’a plus envie de revenir à Paris car il se sent chez lui au Maroc. Maisiljustifiesaposition,parl’avantagedelatélésatelliteetducontactqu’il entretient régulièrement avec la France via Internet. Sans ces facilités de communication, il explique que ce serait plus dur de ne jamais rentrer, la rupture serait trop brutale. Ce témoignage révèle un exemple des impacts locaux de la mondialisation. L’évolution des réseaux de communication et d’Internet bouleverse les migrations des Hommes à travers le monde. Sans ces possibilités d’être connectés et en contact régulier avec leur pays d’origine, lesEuropéensne seraientpas sinombreuxàvenir résider auMaroc.
Pourunepartiedesmigrants,ilestnécessairederentrerenEuropedetemps en temps ou plusieurs mois dans l’année. Anne est bi-résidente et elle exprime ce besoin : « Moi je serai incapable de rester ici, complètement expatriée et ne pas rentrer dans ma culture. C’est vraiment indispensable pour nous. » Son mari la soutient en donnant l’image d’ « une bouffée occidentale à notre culture » lorsqu’ils rentrent une dizaine de jours en Belgique durant leur long séjour de résidence hivernale au Maroc. Malgré tout, ces personnes expriment régulièrement les difficultés qu’ellesrencontrentàlaveilledeleurretourenEurope.Leclimatetleurrythmede vie sont deux éléments principaux qui leur manquent dans leur pays d’origine.
Enfin, parmi les bi-résidents, certains expriment la dualité qui lesrattache à deux pays qu’ils aiment. La mobilité fait partie de leur quotidien et leurs deux modes de vie sont complémentaires. Ils ont à la fois besoin de leur famille en Europe, mais aussi de leur vie sociale au Marocaccompagnée d’une plus grande qualité de vie. Lucie exprime cette dualité qui lui convient bien : « On a deux vies nous. Cette semaine on repart. On a nos amis et famille en France, et nos amis ici. ». Cette réalité est surtout présente chez les bi-résidents, et non les winter birds car ces derniers sontmoinscaractérisésparlapossessiond’unerésidenceauMaroc.Etrepropriétaire d’un logement et revenir tous les ans au même endroit est un élément important pour se sentir chez soi dans un pays étranger.
L’analyse de chacun des facteurs typologiques permet déjà de faire ressortir différentes catégories de migrants en fonction de leur choix migratoire. Il a cependant été démontré qu’une part d’imprévus peut modifier ces projets et ainsi faire passer le migrant d’une catégorietypologique à une autre.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
70 71
3.4 Classement typologique des migrants européens dans le Grand Agadir
Suite au développement des six facteurs typologiques que sont les motivations, le statut, la durée de séjour, le type d’habitat, la perception et l’adaptation,huitcatégoriesontétédéterminéesafindeclasserpartypesles migrants européens résidant dans le Grand Agadir. Les deux derniers facteurs seront abordés plus en détail dans un troisième chapitre.
« Les Entrepreneurs motivés »14
Cenomestempruntéàla typologieétablieparEscheretPetermann(2012). Les particularités citées sont en effet similaires à une catégorie de migrants rencontrée dans le Grand Agadir. Leurs motivations correspondent pourl’essentielàcellesdéfiniesparleconceptdelifestyle migration. Ces personnes sont à la recherche de changements, elles fuient leur mode de vie européen ou une expérience qui les a déçus dans leur pays d’origine. Certains d’entre eux sont également motivés par des liens passés avec le Maroc, tels que des voyages touristiques ou un membre de la famille aux racines maghrébines. Ce désir d’entreprendre est souvent lié à la réalisation
14. Les noms de catégories entre guillemets sont issus de la typologie de EscheretPetermann(2012) présentés dans le chapitre I partie 4.3. Le choix de les reprendre permet de montrer un certain nombre de similarités entre les critères posés par EscheretPetermannet ceux établis pour le Grand Agadir.
d’un rêve. Ils sont donc dans la vie active, et possèdent pour la plupart une carte de résident leur permettant d’ouvrir une boutique, de créer une entreprise, ou de se faire embaucher via les contraintes de l’ANAPEC.Ils sont résidents à l’année et possèdent un habitat généralement situé à proximité de leur lieu de travail. Cet habitat peut être de type traditionnel, mais il sera la plupart du temps moderne et avec un aménagement intérieur de mobilier marocain. Très occupés par leur travail, leur rythme de vie est différent de celui des retraités européens. Cependant, le lieu de travail étant situé sur le lieu de loisir, leur quotidien laisse une plus grande place à ladétentecomparéàceluiqu’ilsavaientenEurope.Leur travailpeutêtre un moyen de s’adapter au pays grâce à de nombreux contacts avec la population locale, comme pour les agents immobiliers, les gérants d’une boutique, ou d’une société. Mais cela peut également constituer un isolement social si la pratique de leur travail est solitaire et occupe beaucoup de leur temps, avec par exemple un travail à domicile tels que les traders qui peuvent exercer leur fonction en autonomie.
Les Voyageurs solitairesCes personnes sont également motivées par une fuite de leur pays
d’origine.Ellesn’ontpasoupeud’attachesenEurope,etdécidentdetoutquitter pour venir s’installer au Maroc. Ce sont souvent des personnes seules,toujoursdanslavieactiveoujeunesretraités.Ellessonthabituéesàvoyager, à vivre à l’étranger ou n’ont aucun mal à s’adapter à de nouvelles situations. Résidents à l’année, leur projet migratoire est pour la plupart trèsflouetsansavenirbiendéfini.Cequotidienaujourlejourleurpermetd’apprécier l’instant présent et de partir lorsqu’ils le souhaitent. Ces voyageurs viennent de toutes sortes de catégories socioprofessionnelles et ne se déclarent comme résident que dans des buts précis tels que pour acheter une voiture ou ne plus être obligé de faire des allers-retours tous les troisousixmoisenEurope.Ilsnesouhaitentgénéralementpass’inscriresur le registre duConsulat afin de conserver une certaine liberté. Leurhabitat est souvent de type marocain, et situé dans des quartiers populaires ou du moins éloigné du centre touristique. En effet, ces migrants nerecherchent pas le contact avec d’autresEuropéens car ils ne partagentpas les mêmes points de vue. Leur vie sociale est donc très solitaire, liée avec celle d’autres voyageurs solitaires et avec quelques membres de la population locale, bien que les différences culturelles puissent dresser un certain nombre de barrières.
Les Travailleurs expatriés Ils ont juridiquement le statut d’expatrié et exercent leur fonction
au Maroc pour une durée déterminée. C’est par exemple les cas des fonctionnaires travaillant au Consulat d’Agadir. Ces Européens sontembauchés spécialement pour partir travailler à l’étranger, ou ils sont envoyésauMarocpourunepériodedéfinie.Sontinclusdanscettecatégorie
Figure 3 : Huit catégories ont été définies pour établir la typologie des migrants
européens résidant dans le Grand Agadir. Pour
chacune d’entre elles il existe trois sous-groupes
possibles dont les critères ont été exposés dans le
chapitre méthodologique : les résidents à l’année,
les bi-résidents et les winter bird. Les migrants
appartenant aux catégories « Retraités en forme »,
Couples / familles interculturelles, et Anciens gadiris peuvent appartenir
à l’un de ces trois sous-groupes. Concernant les
autres catégories, elles sont liées à un sous-groupe
en particulier.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
72 73
lesEuropéensvenustravaillerdansleGrandAgadirauseind’unesociétéde leur pays d’origine. La majorité des Espagnols présents à Agadirsont dans cette situation depuis l’arrivée d’un grand nombre de sociétés espagnoles pour la construction du nouveau port industriel d’Agadir. Ils résident rarement dans des quartiers populaires et leur vie sociale est restreinte à des relations avec leurs collègues de même nationalité.
Les Anciens gadirisLa venue de ces personnes au Maroc est tout particulièrement liée à
leur enfance durant le Protectorat français. La nostalgie d’une époque passée ressurgit, ils ne viennent pas tous d’Agadir, mais aussi de d’autres villes telles que Casablanca. Ils sont pour la plupart des retraités français, et après avoir fait de réguliers séjours touristiques au Maroc durant leur vie active, ils décident de résider à l’année ou le temps de quelques mois dans leur pays d’enfance. Seuls quelques-uns sont revenus juste après leurs études pour poursuivre leur vie à Agadir. Leur volonté de posséder la carte de résident et de se déclarer au Consulat est très variée en fonction de chaque personne. Lorsqu’il s’agit de bi-résidents, ils sont caractérisés par la dualité de l’amour pour deux continents et le fait de se sentir chez eux dans chacun des deux pays. Ce fait se rapproche de la catégorie d’analyse « crise d’identité ou double identité » proposée par Berriane (2010). Cela s’explique par leurs années de vécu au Maroc durant leur jeunesse et leur attachement à des lieux de mémoire comme leur école, la piscine où ils ontapprisànageretc.LemotifmêmedeleurvenueauMarocjustifielechoix de leur lieu de résidence : situé au plus proche des anciens quartiers d’Agadir, bien que d’autres critères interviennent et que tous ne résident pas dans le centre-ville. La mémoire commune à ces anciens les incite à se réunir entre eux et se retrouver régulièrement au sein de clubs des Amis gadiri, via des forums en souvenir d’Agadir. Le site Internet « Agadir 1960 » (Gaucher, 2011) témoigne par exemple de l’histoire de la ville d’Agadir avant le tremblement de terre de 1960, et il permet de retrouver le contact d’anciens camarades de classe de l’époque. Une ancienne gadiri (Dartois, 2014), s’est également emparée de ce devoir de mémoire avec un site Internet présentant l’histoire de chaque quartier avant 1960, illustré par des images d’archive, et un index des rues complétées par le nom des habitants à l’époque. Ces anciens se différencient des « nouveaux » résidents européens. Jean se réjouit que les Marocains reconnaissent qu’ils sont des anciens, selon lui, il y a une grande différence de mentalité, c’est pourquoi ilnesouhaitepastropfréquenterlesEuropéensquin’ontpasconnuAgadiravant 1960. Ils se perçoivent donc distinctement des autres migrants et se disent parfaitement intégrés dans le pays.
Les Couples ou familles interculturellesCes migrants ont en commun des liens familiaux avec le Maroc. Cela
peut correspondre à un mariage interculturel entre une femme européenne
et un homme marocain, ou l’inverse (bien que plus rare comme motif originel de venue à Agadir). Selon l’anthropologue Catherine Terrien, la mixité conjugale au Maroc peut être abordée sous l’angle de la métaphore d’un voyage prolongé (Therrien, 2009). Ce dernier a débuté par la rencontre amoureuse puis a été poursuivi par un enrichissement culturel au sein du couple. La migration dans le pays d’origine d’un des conjoints constitue une prolongation plutôt qu’une fragmentation, car il révèle le concept du « chez-soi » construit par chacun desmigrants. Certains Européensviennent également s’installer au Maroc pour se rapprocher d’un membre de la famille dont le conjoint est Marocain. Dans ce dernier cas la durée du séjour est variable, alors que concernant les couples mixtes la durée de résidence est généralement à l’année. Ces personnes entretiennent peu de contact avec les autres résidents européens et sont plus proches de la famille marocaine. Cela dicte, pour la plupart du temps, leur choix d’habitat de type marocain. Il y a cependant quelques exceptions concernant les parents retraités souhaitant se rapprocher de leurfille/filsmarié(e) avecun(e) marocain(e). Ils recherchent alors à se socialiser davantage avec d’autres retraités européens venus pour diverses raisons à Agadir.
« Retraités en forme »Le nom de cette catégorie typologique est à nouveau emprunté à la
classificationdeEscheretPetermann(2012),maiselleestsensiblementdifférente.Elleregroupedeuxsous-catégories: les«Retraitésenforme fauchés », et les « Retraités en forme au repos bien mérité ». Les premiers semblent être une particularité de la région d’Agadir par rapport à MarrakechetEssaouira.Cesontdejeunesretraités,oudumoinsencorebien en forme pour voyager. Ils sont issus de la classe moyenne et reçoivent une petite retraite (jusqu’à 1 500 euros par mois) ne leur permettant pas de vivre pleinement comme ils le souhaiteraient dans leur pays d’origine. Leur motif de migration est donc essentiellement économique, et dans le but de s’offrir un certain confort de vie. Ils viennent durant l’hiver pour économiserleprixduchauffageenEurope,ouilsemménagentàl’annéeauMaroc. Ils fontalorsensortedebénéficierde labaissed’impositionjusqu’à moins 80 % pour vivre au-dessus du niveau de vie qu’ils auraient enEurope.Leurvenueestsouvent liéeàuneconnaissanceayantfait lamême migration, ou aux informations fournies par les médias et sur les forums de voyages. Ils résident dans des quartiers au prix accessible mais abritant d’autres membres de la communauté européenne, et ils sont surtout locataires, soit d’une petite villa, soit d’un appartement en résidence. Ils n’admettent pas ouvertement que leur migration est effectuée dans un but économique,pouraugmenterleurpouvoird’achatetainsibénéficierd’unmeilleur niveau de vie.
Les « Retraités en forme au repos bien mérité » peuvent être des personnes qui ont effectué beaucoup de séjours touristiques au Maroc durantleurvieactive,oudesEuropéensnouvellementarrivéssuiteàun
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
74 75
effet de mode et à une forte communication menée sur la retraite au soleil au Maroc. Les motivations sont liées à la recherche d’une meilleure qualité de vie dans le cadre d’un repos bien mérité suite à de longues années de travail éprouvant. Locataires ou propriétaires, la plupart ont les moyens d’avoirunemaisonenEuropeetauMarocdanslecadred’unebi-résidence.Certainslouentleurrésidencedanslepaysd’originedurantleurabsenceafindepouvoirfinancerleurvoyage.Alorsqued’autrespréfèrentgarderleursdeux logements vides. Les contacts de ces « Retraités en forme » avec la populationlocalesontassezsuperficiels,ilsselimitentauvoisinageetauxpetits commerçants du quartier. Ils se sentent pour la plupart bien adaptés à leur vie au Maroc, et ils perçoivent leur migration comme quelque chose debienmais qui nedoit pas trop s’amplifierpour conserver un certaincharmeetnepasêtreenvahisparlesEuropéens.
Les Retraités en camping-carCes retraités en camping-car sont majoritairement Français, mais ils
viennent aussi d’Allemagne, de Belgique, et d’Italie. Selon le directeur du camping d’Agadir, il semblerait que les Italiens soient de plus en plus nombreux depuis les évènements du Printemps arabe, car beaucoup ont choisi de quitter la Tunisie pour venir dans un pays plus stable. Suite à une première analyse de son travail de terrain au camping Atlantica (à 8 km au nord de Taghazout), la doctorante Brenda Le Bigot, explique que ces retraités ont des revenus petits ou moyens, mais ce ne sont pas les difficultéséconomiquesquilespoussentàpartirauMaroc.Leurprincipalemotivation est surtout la recherche d’une meilleure qualité de vie, liée au soleil, à la nature, à une vie sociale, aux poissons et aux légumes frais. La grandemajoritéd’entreeuxpossèdentunemaisonenEurope,etnerésidentdonc pas en camping-car toute l’année. Une enquête menée auprès des retraités en camping-car le long de la côte Atlantique du Maroc (Viallon, 2012) démontre que 80 % des personnes interrogées appartiennent à la classe moyenne ou ouvrière. Il semble donc qu’il y ait une ségrégation desEuropéensparlepouvoird’achat.EnFrance,denombreuxretraitésvont passer les mois d’hiver dans le sud, mais cette migration a un coût, notamment concernant les prix du foncier et des denrées. La venue au Maroc de camping-caristes au niveau de vie moyen, est peut-être révélateur de leur impossibilité de rester dans le sud de la France. Ils poursuivent donc leur migration au sud de la Méditerranée. Agadir constituerait alors un substitue économique à d’autres destinations très prisées mais trop chères. Ils sont caractérisés par la dualité d’être à la fois en voyage et à lamaison,phénomèneaussinommé«homeandaway».Celogementencamping-carleuroffreunecertaineflexibilitédedéplacement.L’enquêtesouligne également que ces retraités sont essentiellement en couple et âgés de moins de 65 ans. La plupart se considèrent comme des touristes, mais ils préfèrent les petits commerces aux hauts lieux de l’industrie touristique. La particularité de ces migrants est donc leur venue hivernale avec leur
camping-car pour une durée de trois mois et plus (Cf. photo 5). Lorsqu’ils sont jeunes retraités beaucoup font de l’itinérant, puis ils se sédentarisent dans un camping ou sur un lieu idéalement situé face à la mer sous forme decampingsauvageafind’«hiberner»(selonlestermesdeRené).CesretraitésfinissentparfoisparsefatiguerdelalongueroutepouratteindreAgadir, et ils choisissent de venir en avion, de s’établir l’hiver dans une petite maison ou un appartement, et donc de devenir des « Retraités en forme ».
Les Jeunes surfeursCe sont de jeunes européens, étudiants ou dans la vie active, avec des
moyens souvent limités. Ils consacrent plus de trois mois à leur passion du surf durant l’hiver, et retournent régulièrement dans leur pays d’origine (principalement en France et en Allemagne) avec lequel ils entretiennent un contact important (Desse, 2010). Leur motivation principale est donc la pratique de ce sport dans les meilleurs spots de surf. Le Grand Agadir ne possède pas la majorité des clubs de surfs au Maroc, mais c’est pourtant dans cette région que les spots sont les plus réputés (Guibert, 2008). Ces migrants vivent dans une sorte de cocon et leur vie quotidienne est consacrée au surf. Ils sont présents à Agadir, mais particulièrement visibles dans la commune rurale de Taghazout. Celle-ci a tourné son activité vers le tourisme dédié au surf, créant une ambiance « cool » pour ces jeunes étrangers, avec une multitude de petits magasins mettant en vente des planches de surf, proposant des massages pour les sportifs ou des semaines de stage (Cf. le montage photo page suivante). Le lieu est en effet bien
Photo 5 : Aéroport Al Massira, des camping-caristes partis dans l’urgence. Cette photo témoigne de la longue durée pour laquelle les Retraités en camping‑car restent dans le Grand Agadir. Ces deux véhicules sont garés sur le parking de l’aéroport Al Massira. Cela s’explique probablement par un départ en urgence vers l’Europe, suite à un quelconque problème de santé, de famille, ou pour renouveler leur visa touristique. Cliché : Lachaud E., mars 2014.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
76 77
4. Des migrations à l’origine de tensions socio-spatiales sur le territoire
En rappel aux troisièmes et quatrièmes axes de questionnements dumémoire, la présence de tensions socio-spatiales sur le territoire doit être abordée en lien avec lamigrationdesEuropéens.Entre développementdu tourisme informel, de la prostitution, des mariages binationaux intergénérationnels, et de la présence croissante des camping-cars, les contraintes résultants des migrations sont nombreuses. Aborder ce sujet offre également une première réponse au questionnement concernant les tensions sociologiques et religieuses comme une possible source de tension entre les deux communautés.
4.1 Des migrants encourageant le développement du marché touristique informel
Une analyse concernant l’émergence du tourisme informel au Maroc a été menée par deux chercheurs marocains (Berriane and Nakhli, 2012). Ils inscrivent ce phénomène comme « venant du bas » mais dans une logique de connexion à l’internationale qui tend à se déployer exponentiellement. Leur étudedecassesituedansl’arrière-paysrurald’Essaouira,démontrantuneconnexion entre le local et le global, dans une logique de « mondialisation par le bas ». Ce tourisme informel se développe également dans le Grand Agadir. M. Berriane et S. Nakhli soulignent que la majorité des structures d’hébergement proposées, sont des maisons d’hôtes appartenant à des ressortissants français. Des migrants européens rencontrés à Agadir commencent par acheter un logement en tant que résidence secondaire, et suite à la forte demande touristique internationale que perçoit la région, ils mettent progressivement en place des locations. Certains migrants, tels qu’Anne et Paul, préfèrent louer à des amis, des connaissances, ou à des personnes choisies (suite à un contrôle d’information assez stricte). Le système d’échange de maisons de vacances et également pratiqué. Lorsque les propriétaires du logement sont en Europe pour plusieurs mois, laplupart embauchent une femme de ménage, voir un jardinier et un gardien (selon les moyens), afin d’assurer l’entretien de la maison et l’accueildes locataires vacanciers. Un certain nombre d’emplois sont donc créés, mais toujours de manière informelle. Lorsque les propriétaires vivent au Maroc et louent juste une partie de leur maison, il n’est pas rare qu’ils proposent des offres supplémentaires : une visite de la ville, une randonnée à la journée, une dégustation au souk etc. Du fait de l’informalité des démarches, ces locations d’appartements/maisons ou de chambres d’hôtes peuvent être considérées comme une concurrence au secteur hôtelier et touristique.YoussefElBoudribiliestchargédel’encadrementdel’activitétouristique à la Délégation régionale du tourisme. Son rôle consiste entre
connu au sein de la communauté des surfeurs qui communiquent via des forums sur les possibilités de venir habiter dans le village pendant plusieurs mois l’hiver. Ils logent pour la plupart dans des locations, des petites résidences ou des hôtels pas chers.
Au sein de ces différentes catégories typologiques, le profil desmigrants reste cependant très varié. Ceci a été démontré par la diversité des motivations, des projets migratoires et des choix de statut. Mais l’intérêt decetteclassificationestdefaireressortirplusieursparticularitésdecesEuropéens.Cettetypologierévèledepossiblestensionsliéesauxdifférentesmotivations et pratiques spatiales. De plus, les différences sociologiques et religieuses entre ces migrants et la population locale pourraient favoriser ces tensions.
Photos 6 à 10 : Taghazout, un village dont l’économie est organisée autour de la communauté de surfeurs. Réparation de planches de surf, école de surf, séances de massage, vente de matériel aquatique, résidences pour surfeurs. Ce montage photos est révélateur de l’importance qu’occupe la communauté de surfeurs à Taghazout. Clichés : Lachaud E., mars 2004.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
78 79
autres, à conseiller et orienter les propriétaires de maisons d’hôtes hors norme.Ausujetdesmaisonsd’hôtesofficieuses,ilévoqueprincipalementcelles de Taghazout qui s’improvisent également Ecole de surf. Lacommune rurale de Taghazout ne comprend en effet que deux résidences hôtelières et quatre gîtes classés de deuxième catégorie, dont deux sont tenus par des Anglais, selon la liste des établissements d’hébergement touristique classés en décembre 2013. Les locations, dont les annonces sont proposées via les nombreux sites de voyage disponibles sur Internet15, ne sont pas offertes en tant que « maisons d’hôtes » et ne peuvent donc pasêtreconsidéréescommetelles,mêmedefaçonofficieusecarellesnepossèdent pas de prestations particulières. Ce type de location est aussi de plus en plus répandu en France durant l’été grâce à des sites Internet comme Le BonCoin pour mettre à louer une chambre ou un logement à la nuitéeoulasemaine.Ilsembledonctrèsdifficiledecontrôlercetourismeinformel. Pour Eric, qui est gérant d’une résidence touristique dans lecentre d’Agadir, un plus grand nombre de maisons d’hôtes informelles inciterait à une nouvelle réglementation. Les propriétaires de ces logements touristiques improvisés ne sont pas seulement Européens, mais aussiMarocains.En2012,leMinistredutourisme,LahcenHaddad,s’estlancédansuneluttecontreletourismeinformel,afind’encouragerlestouristesà séjourner dans des établissements classés. Ceci passe également par la sensibilisationdespropriétairesafinqu’ilssoientenrèglefiscalementetreçoivent une autorisation.
Des tensions économiques se créent donc du fait de la concurrence conduite par le marché de l’hébergement touristique informel. A cela, s’ajoutent des tensions spatiales dues à l’augmentation des prix du foncier. Enacceptantd’acheterdesmaisonsàdesprixplusélevésquelamoyennelocale, les Européens encouragent les autres propriétaires marocains àaugmenter leur prix de location ou de vente. Ce problème est évoqué par touslesrésidentsEuropéensconcernantlenombrecroissantdemigrantsoccidentaux à Agadir. La population locale est la première à souffrir de ce phénomènedegentrification,maiscelafaitégalementobstacleàlavenued’étrangers au revenu moyen. Ils sont nombreux à s’entraider lors de leur arrivée au Maroc ; les anciens résidents indiquant aux nouveaux les vrais prixmarocainsafind’éviterd’acheterun logementpluscherqu’ilne levaut.
4.2 Des tensions socio-culturelles liées aux mariages mixtes intergénérationnels et à la prostitution
Les mariages à la fois mixtes et intergénérationnels posent des questions éthiques et sont créateurs de tensions entre les deux cultures marocaines et occidentales. Ce sujet est également présent dans d’autres pays, mais à Agadir, il concerne tout particulièrement les couples de très jeunes
15. Deux d’entres eux peuvent être cités du fait de leur grande fréquentation au sein de la communauté européenne d’Agadir : Voyage‑forum et Expatblog.
marocainesmariées avec desEuropéens (pour beaucoupFrançais) bienplus âgées qu’elles. Dans le cadre du mariage avec une femme marocaine, la loi exige que le futur mari se convertisse à l’islam (cette contrainte n’est pas valable pour le mariage d’une femme chrétienne ou juive avec un Marocain). Il est cependant très facile et rapide pour un homme de se convertir à l’islam. Un contrôle sur la sincérité du mariage est toutefois effectuéparleConsulat,maisilestconfrontéàladifficultédejugementpourdéfinirlalimiteentrelesmariagesd’amoursincèreounon.Danscedernier cas, les mariés sont piégés dans leur propre situation. La jeune marocaine est parfois sujette à la pression de sa famille pour séduire, se marieravecunEuropéen,etainsioffrirunechanced’évolutionsociale,d’un départ en Europe, ou juste d’une plus grande fortune. L’hommeeuropéen, bien plus âgé, est parfois aveuglé par l’amour de la Marocaine qu’il croit sincère, car il est heureux d’être aimé par une femme alors qu’il croyait toutes les possibilités écartées à son âge. Mais dans certains cas,ilprofiteégalementdelasituationdelaMarocaine.Selonmonsieurle Consul de France à Agadir, si un des conjoints est Français, alors la réglementation française doit être appliquée dans le cadre d’un mariage au Maroc.Lemariageestpermisaprèsavoirobtenuuncertificatdecapacitéà se marier. Celui-ci est délivré sous condition du célibat des futurs mariés et de l’absence d’opposition. Il y a obligation de publier des bans pendant dix jours dans la salle du Consulat et dans la mairie du quartier français d’origine. Si personne ne s’oppose aumariage, le certificat de capacitéàsemarierpeutêtredélivré.Cecertificatestégalementexigéparl’Etatmarocain qui a adopté la même réglementation dans le cadre d’un mariage avec un conjoint français. Lorsque les employés du Consulat français ont un doute sur le consentement d’un des conjoints (par exemple dans le cas où ils ne parleraient pas une langue commune), ils ne peuvent pas juger, mais ils peuvent approfondir l’examen. Il y a alors une réunion avec les deux futurs époux, puis avec chacun d’entre eux séparément. Si le doute subsiste concernant la sincérité du mariage et la possibilité d’un mariage blanc, il est possible de saisir le procureur. A Agadir, cela arrive une dizaine de fois par an pour une quinzaine de doutes de la part des employésduConsulat.Lanotiondesincéritéestcependanttrèsdifficileàcontrôler, elle est subjective et est limitée par le jugement d’autrui. Quant au mariage blanc, le même contrôle est réalisé en France, et semble donc plus facile à appliquer. Une moyenne de cinq cents mariages par an est effectuée avec essentiellement des couples franco-marocains. Seuls trois couples uniquement français se sont mariés à Agadir depuis le mois de septembre. Au regard de monsieur le Consul, dans la situation du vieux français qui vient se marier avec une jeune marocaine, « le français est souvent sincère, il ne se rend pas compte qu’il se fait plumer, il est complètement aveugle ». Généralement isolé de sa famille en France (car elle n’a pas accepté ce mariage), il se retrouve prisonnier de sa situation au Maroc, et « il croit sincèrement à son projet de vie ». Ceci dépend toutefois
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
80 81
des points de vue pour lesquels chacun opte. Lors des entretiens, plusieurs Européens évoquent leur aversionvis-à-vis de ces retraitésoccidentauxqui«profitent»delasituationdejeunesmarocainesattiréesparl’argent.L’opinion est donc partagée concernant la victime de ce type de mariage intergénérationnel. Néanmoins, cela soulève des tensions culturelles et sociales entre les deux communautés.
Le tourisme sexuel a subi une importante croissance à Agadir au cours de ces dernières années. Il est particulièrement encouragé par les hommes européens attirés par l’étendue de l’offre et d’autres motifs de venue. La demande est donc importante, et les Marocains(es) sont nombreux à offrir leurs services, car cela leur permet de survivre ou de compléter leur petit salaire à la fin dumois. En annexe 6, l’article du Journal Hebdo présente le fonctionnement de ce réseau et les principaux lieux qui l’abritent dans la ville d’Agadir. Il met ainsi en avant un type de pratique socio-spatiale qu’exercent certains Européens une fois la nuit tombée.Ce sujet qui « dérange » est souvent abordé de façon spontanée lors des entretiens. Certains disent ne pas aimer aller dans les boîtes de nuit car elles accueillent un grand nombre de prostituées. D’autres évoquent une mauvaise expérience, suite à la location ou à l’entretien à distance de leurmaisonlorsqu’ilsétaientderetourenEurope; lapersonnechargéede prendre soin de la maison a parfois saisi l’opportunité de louer des chambres pour une prostitution à l’abri des regards. La peine de prison encourue par les bi-résidents propriétaires, si le fait venait à être découvert, lesasouventincitésàuneplusgrandeméfianceparlasuite.Nombreuxsontlestémoignagesd’Européensayantétéconfrontésàcettesituationouconnaissant une personne qui l’a été.
4.3 Des tensions spatiales dues aux vagues hivernales de camping-cars
ChaqueannéedenombreuxEuropéensarriventencamping-carpours’établir à Agadir durant l’hiver. Un déséquilibre est ainsi marqué sur le territoire entre les périodes estivales et hivernales. Plusieurs campings sont présents dans le Grand Agadir. Celui situé en plein centre urbain de la ville est souvent complet et fréquenté par les mêmes personnes d’une année sur l’autre. A l’inverse, les campings dans les communes rurales comme Aourir offrent de nombreuses places, mais sont confrontés à la concurrence du camping sauvage. Cette facilité avec laquelle ces migrants évitent les frais pose un problème économique, mais également environnemental. Les cassettes des véhicules sont alors vidangées en pleine nature (parfois même au cœur du centre-ville). La réglementation a été renforcée dernièrement (Cf. photo 11), mais il est encore très courant dans le centre même d’Agadir de voir des retraités qui passent la nuit sur un parking ou une place. La plupart des quartiers sont concernés, quelle que soit leur
popularité. Le parking du supermarché Marjane (quartier Founty) fut également pendant longtemps, occupé la nuit. Cela est maintenant interdit, mais nombreux sont les camping-cars à se garer sur le parking durant la journée (Cf. photo 12 ci-dessous).
Photo 12 : Le parking du supermarché Marjane, le 19 février 2014. Ce petit village improvisé accueil des camping-cars essentiellement français, mais quelques plaques d’immatriculations allemandes sont aussi visibles. Quelques‑uns viennent faire leurs courses et repartent. Ce sont souvent des personnes résidant au camping Atlantica Park, de haut standing. Elles viennent à plusieurs dans un même camping‑car. D’autres restent sur le parking toute la journée, et n’hésitent pas à installer leur table pour manger, la parabole dressée sur le toit du véhicule, ou encore à faire leur lessive en plein cœur du parking. Cela témoigne d’un besoin de regroupement, d’une volonté de se garer sans avoir à payer, et le tout en étant à proximité d’un supermarché aux étalages de produits très occidentaux. Cliché : Lachaud E., février 2014.
Cette problématique des camping-cars à Agadir est un sujet fréquent dans les discussions des résidents européens. Cela s’explique par la grande visibilité de ce phénomène, mais il ne faut pas oublier que la plupart des camping-cars garés le long des trottoirs sont conduits par des personnes en itinérants pour quelques jours dans la ville (bien que cela ne soit pas toujours vrai : photo 13). Certains camping-caristes sont eux-mêmes révoltés par cette situation, les débats sont nombreux sur les sites Internet et forum de camping-caristes (A titre d’exemple : lemarocencampingcar.com ou maroc-camping-car).
Photo 11 : Panneau d’interdiction rue Mokhtar Soussi.Ces panneaux sont de plus en plus fréquents dans le centre-ville.Cliché : Lachaud E., février 2014.
Chapitre ii - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
82 83
Photo 13 : Un camping improvisé dans le centre d’Agadir. Cette photo a été prise sur le parking de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, en plein cœur du Secteur touristique. Environ dix camping-cars allemands ont établi domicile sur ce parking pour une période d’au moins un mois (le cliché ayant été réalisé à la mi-février, quelques semaines avant leur départ). L’ambiance est la même qu’au sein d’un camping : des retraités se prélassent sur une chaise longue tandis que d’autres regardent la télé dans leur véhicule. Cela témoigne bien de l’importante contrainte spatiale imposée par la venue des camping-cars, et de la nécessité d’une nouvelle réglementation afin d’éviter l’amplification de ces tensions spatiales. Cliché : Lachaud E., février2014.
En réponse à la première hypothèse, il existe bien des tensionssocio-spatiales liées à l’augmentation du prix du foncier, et des denrées alimentaires. Ces dernières années, le marché central est par exemple fréquenté principalement par les Occidentaux car les prix sont devenus trop excessifs pour les Marocains. Quelques migrants notent également que le prix de l’alcool au supermarché Marjane augmente considérablement durant l’hiver, témoignant de la hausse des prix due à la venue saisonnière des Européens. De plus, un tiers des propriétaires interviewés louentleur logement en tant que maison d’hôtes informelle lorsqu’ils sont en Europe.Cescontraintesspatialessontrenforcéesparl’arrivéed’unevaguede camping-cars durant la période hivernale. Les différences culturelles entre la population locale et les migrants sont également une source de tension concernant les mariages binationaux et intergénérationnels. Cela s’explique également par le contraste des pouvoirs d’achats entre Marocains et Européens. La question de l’argent est omniprésente etcrée souvent un biais au sein d’une relation amicale entre des personnes des deux cultures. La présence de ces migrants encourage également la corruption par la pratique des bakchichs. Certains Européens refusent
d’encourager ce système de corruption, mais d’autres n’hésitent pas à donnerunesomme(quipoureuxnereprésentepresquerien)afind’obtenircequ’ilssouhaitent.LafractureNord/Sudsereflètedanscesystèmedecorruption. Les migrants se confortent dans l’idée que les Marocains sont très accueillants et conviviaux avec eux. Mais ce comportement s’explique par le fait que lesEuropéens gardent les gens à leur portée,par l’intermédiaire des bakchichs, mais de leur image symbolique et économique. La corruption représente donc un rapport matérialisé en la faveurdesEuropéens.
85
Chapitre III
Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à
leur traduction socio-spatiale sur le territoire
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
86 87
1. La relation des Européens avec l’espace urbain d’Agadir : entre parcours résidentiel
et lieux de vie quotidienne
LechoixdulieuderésidencedesEuropéensetleurchangementd’habitataucoursdeleurvieàAgadirinfluentsurleursespacesdeviequotidienneet la relation qu’ils entretiennent avec l’espace urbain d’Agadir. Alors que certaines pratiques sont propres à des groupes de migrants, d’autres sont communes à tous et mettent en valeurs des lieux de regroupement et de mélange culturel.
1.1 Le parcours résidentiel des migrants
Laura est agent immobilier et travaille beaucoup avec une clientèle étrangère. Elle explique les principaux critères avec lesquelles lesEuropéensviennentluidemanderconseils:«S’ilsontuneterrasse,toutpeut passer. La plupart veulent un extérieur. Tout ce qui est traditionnel, les moulures, les couleurs partout, la plupart du temps ils ne veulent pas. Ils disent : pas trop marocain. » Ces migrants viennent en effet au Maroc pourrechercherlesoleilqu’ilsn’ontpasenEurope,unespaceprivépourenprofiterestdoncl’idéal.Leslocationssontsouventpréféréesauxachatscar celles-ci leur coûtent moins chères pour une courte durée et ils ont la possibilité de changer. Pour Yannick, la location c’est la liberté, alors qu’acheter une maison représente un engagement à long terme. Pourtant, lamajoritédesEuropéensinterviewéssontpropriétairesdeleurlogement,essentiellement lorsqu’ils sont résidents à l’année ou bi-résidents. Ces derniers déclarent leur habitation comme maison secondaire et payent donc plus de taxes. Alors que de futurs résidents viennent dans un hôtel durant quelques jours ou semaines le temps de trouver la maison qui leur convient, d’autres préfèrent la facilité d’acheter leur logement sur plan depuis l’Europe. Mais plusieurs d’entre eux témoignent de la grandedéception qu’ils ont eue à leur arrivée sur place.
La carte 5 page 87 met en évidence le choix résidentiel des Français dans la ville d’Agadir. Les quartiers de Charaf et Taddart sont privilégiés par cette communauté étrangère avec 559 résidents français (ils comptaient un total de 5 937 habitants selon la Monographie par quartiers effectuée dans les années 2010). Le quartier de Charaf est en effet très recherché par les Français, car il est proche du centre-ville, et le seul à présenter de petites villas avec jardin, pour un prix accessible auxEuropéens deniveau de vie moyen. Le choix des Français se porte majoritairement sur les quartiers bien réputés et abritant la bourgeoisie gadirie. Mais le quartier très chic de Illigh présente une minorité de Français. Quant au Secteur touristique, il est habité par 228 Français malgré sa situation idéale sur
le bord de mer et proche du centre-ville. Ceci s’explique par le peu de logement à prix abordables et disponibles parmi le grand nombre d’hôtels touristiques. Certains Français souhaitent également se distinguer de la « masse touristique » et choisissent donc un quartier résidentiel. Parmi lesFrançais interviewés, leurmobilitéquotidiennedéfinit leur choixdequartier. La Cité Dakhla - Riad Salam semble préférée par les Français possédant une voiture, alors que Charaf et Taddart sont résidentiels tout en étant à proximité du centre-ville pour s’y rendre à pied.
Cependant ce document apporte une information limitée car il représente uniquement la répartition des Français possédant une carte de résident. Et aucunes données ne sont fournies concernant ces résidents Françaisdans plusieurs quartiers centraux. De plus, les données sont groupées pour lesquartiersLesamicales,NajahetBouargane.Leprofildeshabitatsestpourtant bien différent selon les quartiers. Le premier présente de grandes maisons de style marocain avec terrasses sur le toit. Alors que les deux suivants abritent de grandes maisons ou villas avec jardin, et un certain nombre d’immeubles en construction. Sylvie et Louise justifient leurchoix d’habiter aux Amicales et à Ihchach car ce sont des quartiers calmes, populaires et fréquentésparpeud’Européens.LamajoritédesFrançaissemble donc privilégier Najah et Bouargane plutôt que Les amicales.
Carte 5 : Les lieux de résidence de la communauté
française dans la ville d’Agadir.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
88 89
La répartition des Français selon leurs critères de quartiers concorde avec les principales caractéristiques sociologiques des habitants de chaquequartier.Eneffet,Charaf,Taddart,leCentre-villeetlaCitésuisse(située dans le quartier Résidentiel) sont habités par une population ayant un bon niveau d’étude : 26,3 % des habitants de Charaf et Taddart sont issus d’études supérieures, et 27,1 % des habitants de la Cité suisse ont fait des études secondaires (Conseil communal d’Agadir, 2010). Quand au centre-ville, 25,4 % des habitants ont le niveau du secondaire, et 21,3% ont effectué des études supérieures. Ces données récoltées lors de l’élaboration de la monographie par quartier dans le cadre du Plan Communal de Développement d’Agadir 2010-2016, démontrent bien que les Français résident majoritairement dans les quartiers dont la population est dotée d’un bon niveau social. Les quartiers des Amicales et de Talborjt sont quant à eux réputés au sein de la communauté française pour leur ambiance populaire. Ils présentent des habitats datant de 20 à 50 ans, et ils regroupent en effet un certain mélange de la population, avec 21,8 % des habitants des Amicales ayant un niveau du primaire, 21,4 % du secondaire, 21,3 % du collégiale, et 20,3 % n’ayant pas fait d’études. Concernant la morphologie des quartiers, la majorité des habitations des quartiers Talborjt, Cité dakhla - Riad salam, Charaf, Taddart, et Les Amicales sont classifiésselonunmodemarocain.Mais38,8%deslogementsdeCharafet Taddart sont également des villas, et 88,7 % le sont dans la Cité suisse.
Les deux montages photographiques page 89 témoignent de la diversitédes typesd’habitatsquis’offrentauxEuropéens.Lesquartiersprivilégiés par les migrants ne sont pas tous représentés, il manque par exemple Dakhla, au niveau du Haut Founty dans l’intérieur des terres, et la Cité suisse, qui est située au sud de Charaf, et se confond avec le Quartier résidentiel.
LauraexpliquelechoixdesEuropéenspourlequartierCharaf:«Cequartier, c’est quand ils veulent un petit terrain. La villa traditionnelle marocaine fait 300 m², alors quand t’es à deux c’est trop grand. » Au Maroc une maison est appelée villa à partir du moment où il y a un petit bout de jardin. Pour Laura, Charaf est le seul quartier qui propose des prix raisonnables de villas proches du centre-ville. Une seconde caractéristique de ce quartier est également sa physionomie composée de petites allées fleuries pour accéder auxmaisons, repoussant les voitures sur les ruesprincipales. Les migrants résidant dans ce secteur sont nombreux à évoquer leurcoupdecœurpourlecharmedecequartierfleuri.AAgadir,Charafest connu pour son grand nombre de résidents étrangers. Au sein de la communauté européenne il est même surnommé « le ghetto français ». Lors d’entretiens semi-dirigés, la question du lien entre le choix du lieu de résidence et la volonté de fréquenter desEuropéens est abordée.Laplupart expliquent ne pas avoir choisi Charaf pour ses habitants, mais plutôtpoursoncharmefleurietsaproximitéàpiedducentre-ville.Ilest
Photos 14 à 19 : Les quartiers centraux d’Agadir, à proximité de la côte. La photographie de situation a été prise sur les hauteurs, depuis la Kasbah. Clichés : Lachaud E., février et mars 2014.
Photos 20 à 27 : Les quartiers résidentiels d’Agadir, situés dans l’intérieur des terres. Clichés : Lachaud E., février et mars 2014.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
90 91
également habité par des marocains ayant un bon niveau de vie, tels que des chirurgiens ou des procureurs et des familles franco-marocaines. Pour Duncan, la diversité des nationalités dans le quartier représente une richesse supplémentaire:«Ididn’tknowtherewasalotofEuropeaninCharafwhenI chosed the place. I just chose it because it’s friendly. It just have been a nicebenefitwhenImoveinandstarttoknowmyneighbour.It’snicetohaveaconnectivitywithotherpeoplefromotherplaces!»16. Cette vision esttrèsdifférentedecelledesEuropéensrésidentsdansd’autresquartiers,ilssontsouventtrèsnégatifsvis-à-visdeCharafetsontfiersdenepasyhabiter. Cette forte présence européenne semble cependant représenter une plus grande insécurité pour les habitants. Plusieurs résidents se plaignent d’avoir subi du chantage ou de s’être fait agresser et voler dans les petites ruelles.Louisehabiteà Ihchach,unquartierassezpopulaire.Elleseditplus en sécurité dans son quartier plutôt qu’à Charaf. Sylvie a vécu quelque temps à Charaf avant d’emménager aux Amicales pour son atmosphère vivante, commerçante et familiale avec de nombreux marocains. Ellen’aimait pas le fait que les villas soient très proches les unes des autres, etarencontrédesdifficultésliéesauregardportésurelle:«Jemesuisfait traiter de pute parce qu’un ami marocain est rentré chez moi. » Un autre critère pour résider à Charaf, est la proximité avec le groupe scolaire Français Paul Gauguin. Cependant, ce dernier ferme et va donc inciter de nombreuses familles à changer de résidence pour aller non loin du quartier Founty où se situe le second établissement français. Les retraités n’ont pas cette contrainte de situation, ils sont donc répartis un peu partout dans Agadir, selon leurs critères et leurs coups de cœur. Certains aiment être proches du souk, d’autres dans le centre-ville, ou assez éloignés de la mer pour fuir l’humidité qu’elle procure.
LerécentquartierdeHayMohammadiattiredeplusenplusd’Européensdans ses grandes résidences neuves grâce à des prix attractifs. Une partie de ce grand quartier est cependant encore en chantier, et l’éloignement avec le centre-ville et le bord de mer est perçu comme un gros inconvénient. A l’inverse, le secteur touristique est peu évoqué comme possible lieu de résidence car il ne permet pas une distinction entre les touristes et les résidents. Seule la Marina semble bien réputée parmi les résidents, mais elle est réservée à des migrants de haut standing et désireux de loger dans des logements très européanisés. La cité Suisse est également un quartier proche du centre, il est caractérisé par de grandes villas, et plusieurs membres du Consulat français disent l’apprécier pour son côté très chic.
L’avenue des F.A.R. fait la jointure entre la côte et le nord-est de la ville. Ellemarqueunecoupureentrelesquartiersrésidentielsprivilégiésparlesmigrants (Charaf, Tadart, et le Quartier résidentiel) et les quartiers plus populaires (Les amicales, Ihchach, Talborjt). Cette avenue est caractérisée par de hauts immeubles neufs proposant des locations d’appartements qui commencent à attirer des Européens à la recherche d’un logement
16. Traduction : « Je ne savais pas qu’il y avait beaucoup d’EuropéensàCharaf quand j’ai opté pour ce quartier. Je l’ai juste choisi parce qu’il était sympa. Ce fut une agréable surprise quand j’ai emménagé et que j’ai fait la connaissance de mes voisins. C’est super d’être en contact avec des personnes de différentes origines ! »
lumineux et neuf. Les appartements dans le quartier de Talborjt ont pendant longtemps été à des prix abordables, mais comme partout dans la ville, le prix du foncier a considérablement augmenté au cours de ces dernières années. Peter et Bror continuent cependant à louer tous les ans un appartement dans la Résidence Azour car elle est bien située, pas trop chère, et elle propose des services de surveillance et de ménage. Ils sont un certain nombre d’étrangers à vivre dans ce type de résidence le temps de quelques mois ou plusieurs années. La résidence Tifaouine dans le Quartier industriel abrite ainsi un bon nombre de Français.
Cesregroupementsd’Européensdansdesquartiersetlieuxponctuelsqu’ilsapprécient,contribuentàlaformationd’îlotsdegentrification.Laurasouligne par exemple, le changement de prix pour une villa à Charaf : en 2004 cela coûtait environ huit cent mille dirhams, alors qu’aujourd’hui le prix est entre un million sept cent et deux millions de dirhams. Il semble que ces regroupements ne soient pas faits de façon volontaire. La communication au sein de la communauté européenne incite les étrangers à s’installer dans tel ou tel endroit en fonction des effets d’information et des avis positifs. Cela se traduit par des échanges d’expérience et des recherches de conseils sur les forums, avec une forte demande d’information de la part des futurs résidents. Un réseau de relations et d’échanges de « bons plans » s’est progressivement mis en place de façon spontanée, et encourage cette localisation ponctuelle des migrants européens. Ce réseau social de migrant se crée à la fois via Internet, mais également lors de rencontres sur des lieux de vie quotidienne consacrés à leurs loisirs.
1.2 Les lieux de vie quotidienne : des espaces de loisirs et de convivialité
VivreàAgadirpermetauxEuropéensdemenerleurviequotidienneselon des habitudes. Ils effectuent leurs courses et pratiquent des loisirs dans des lieux qu’ils fréquentent régulièrement. Ces endroits deviennent alors des lieux de sociabilités, pour se retrouver entre Européens, ouéchanger avec la population locale. Quels sont donc ces espaces de vie quotidienne : des lieux de regroupement communs à ces migrants, ou des lieuxdesociabilitéetd’échange?Lespratiquesquotidiennesdesmigrantspeuventêtrediversifiées,maisellesprésententsouventdespointscommunsconcernant les habitudes. Il est plusdifficile de les déterminer pour lespersonnes actives, car elles passent leur journée au travail et rentrent chez elles le soir, laissant peu de place aux loisirs. Les retraités ont quant à eux des journées très chargées, mais bien souvent avec un rituel journalier qui s’est progressivement installé depuis qu’ils résident à Agadir.
La carte 6 page 92 ne présente pas une liste exhaustive des lieux fréquentés par les résidents Européens à Agadir. Lors des entretienssemi-dirigés, les migrants ont souvent cité les mêmes lieux concernant leurs
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
92 93
habitudes quotidiennes. Le Secteur touristique, le Centre-ville et Talborjt sont les quartiers centraux où ils se déplacent régulièrement pour faire des achats, pratiquer une activité de loisir, ou se faire plaisir. S’ajoutent à ces lieux, le Grand souk d’Agadir et le supermarché Marjane, entouré de quelques autres grandes chaînes de magasins comme Mr. Bricolage, au sud d’Agadir et en retrait du centre. La plage et la promenade de bord de mer d’Agadir sont les symboles de la fréquentation d’un même lieu parunepopulationtrèsdiversifiée.Cesontdeslieuxaccessiblesàtous,etpermettant de pratiquer un loisir peu coûteux. Les cafés et les restaurants sont quant à eux les marqueurs d’un pouvoir d’achat plus important, notamment pour les Européens qui profitent de la baisse des prix deconsommation par rapport à leur pays d’origine.
Le bord de mer : une fréquentation diversifiéeLa longue plage de sable d’Agadir fait partie intégrante de l’identité de
la ville et de ses habitants. Le matin, les coureurs sont nombreux à effectuer leur footing sur la promenade (Cf. photo 28), quelques touristes se mêlent auxrésidentsEuropéensetauxMarocains.Unebaignadematinaleouunepartie de football improvisée, le bord de mer s’anime progressivement. La journée, les chaises longues sont convoitées par les touristes des grands hôtels, mais aussi par les migrants (Cf. photo 29). Les paroles de Louise mettentenévidencedespartiesponctuellesdelaplageoùlesEuropéens
ont l’habitude de se regrouper : « J’ai qu’à descendre, je sais que je vais trouver mon amie sur la plage. Des fois à la plage on est dix-sept ou dix-huit comme ça, on met les transats en rond, on connaît du monde. » Le fait qu’elle soit sûre de retrouver une connaissance chaque jour à la plage, prouve bien une habitude de ces résidents à se regrouper pour pratiquer leur loisir balnéaire. Ces Européens se démarquent volontairement destouristes. Ils se regroupent entre eux aux mêmes chaises longues, et non avec les touristes présents pour une plus courte durée. Le soir, la promenade du bord de mer est le centre d’animation de la ville. Un réel mélange se crée entre tous types de personnes : des familles se promènent et se mêlent aux touristes, aux résidents étrangers, à des bandes de jeunes et à des promeneurs solitaires. Toute cette population se côtoie autour d’un même plaisir nocturne à déambuler le long du bord de mer jusqu’à une heure tardive.
Les cafés et restaurants : des espaces pour un public privilégiéLes restaurants et les cafés sont de véritables lieux de loisir et de
regroupement pour les résidents européens. Ce sont en effet les marqueurs de l’augmentation de leur pouvoir d’achat par rapport à celui qu’ils ont dans leur pays d’origine. Cet élément n’est pas présenté ouvertement par les migrants comme une motivation de départ. Il est pourtant à la base du bouleversement de leur mode de vie au Maroc, et il leur offre le sentiment agréable de se sentir plus riche que la majorité de la population locale. Les cafés et restaurants sont donc les témoins d’un différentiel économique entre lesEuropéensquiprofitentd’un tempsdedétentepeuonéreux,etlerestedelapopulationquinebénéficiepasdecettehaussedupouvoird’achat.
LeshabitudesdesEuropéenschangentenmêmetempsqueleurlieude résidence. Ils s’adaptent aux nouvelles offres dans leur pays d’accueil, et ajustent leurs activités en fonction du temps et de leur pouvoir d’achat. Louise remarque ainsi qu’au Maroc ses habitudes sont différentes avec ses amis, ils ne s’invitent pas chez eux : « C’est bizarre, en général on se
Carte 6 : Les lieux de vie quotidienne des Européens dans la ville d’Agadir.
Photos 28 et 29 : La baie d’Agadir, un
espace de promenade et de loisirs sur
la plage. Clichés : Lachaud E., février 2014.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
94 95
retrouve toujours à l’extérieur de chez nous. On ne dit pas je vais manger cheztoi.Onvitdehors.Entre100et150Dh17 tu peux très bien manger. Pourquoi se faire la cuisine alors que c’est tellement facile d’aller au restaurant. Systématiquement on se voit à l’extérieur, on se retrouve le vendredi pour le couscous. » Cette tradition du couscous du vendredi midi après la prière, est très pratiquée par les familles marocaines. Nombreux sontlesrésidentseuropéensinterviewésàévoquerleurtraditionnelrepasde couscous le vendredi. Soit ils vont au restaurant, soit ils s’invitent mutuellement pour déguster le couscous préparé par leur femme de ménage et cuisinière, soit, pour quelques plus rares personnes, ils vont partager ce repas avec des amis ou voisins marocains. Il y a donc une volonté de la part des migrants, de respecter et appliquer cette tradition culturelle du pays. Cette sortie au restaurant est pratiquée par tous types d’Européens, despersonnesseules,descouplesoudesgroupesd’amis,tousprofitentd’unemeilleurequalitédevieàmoindrecoûtqu’enEurope.Lerestaurantestunluxe qu’ils ne pouvaient pas s’offrir aussi régulièrement dans leur pays. CettedimensionéconomiqueenfaveurdesEuropéensestomniprésentedans leur motivation de départ et dans leurs pratiques quotidiennes à Agadir.Lesmigrantsjustifientsouventlegrandnombredeloisirsqu’ilspratiquent par le climat agréable, et leur rythme de vie leur laisse plus de temps libre quotidiennement. Mais la principale raison est avant tout économique : le moindre coût de la vie au Maroc leur permet de consacrer plus d’argents à leurs loisirs.
Les restaurants, dans le quartier de Talborjt et un peu plus au nord-est du côté de Anouar souss, proposent des plats à prix très raisonnables. A l’inverse, les restaurants situés dans le secteur touristique, offrent des menus plus luxueux destinés aux touristes et aux personnes pouvant se le permettre financièrement. Le restaurant Jour&Nuit (Cf. photo 30),fait partie des cafés-restaurants situés le long de la promenade du bord de mer. Il est réputé parmi les résidents Européens qui aiment s’yretrouverpourprofiterd’unbonrepasetunverred’alcoolfaceàl’océan.Les enseignes des restaurants de la promenade témoignent d’une offre
17. Une somme équivalente à 9 et 14 euros.
de repas internationaux, et les migrants se plaisent à déguster quelques saveursvenuesd’Europe.DeschaînesinternationalestellesquePizzaHotet Mc Donalds sont présentes dans le centre-ville ainsi que vers le quartier Fountyplusausud.LesprixsontsouventtrèsprochesdeceuxenEurope,mais Yannick prend plaisir à manger dans ces chaînes qui lui rappellent ses habitudesenFrance.L’Englishpub(Cf.photo31),estsituédansleSecteurtouristique, entouré par de luxueux hôtels. Il accueille une forte population étrangère, qui aime se retrouver autour d’une bière et célébrer ses origines culturelles. A l’opposé, le Café Tafarnout de la fontaine, situé boulevard Hassan II, en plein centre-ville, est l’illustration d’un mélange culturel. De la terrasse s’élèvent des discussions en arabe ou berbères, des brides d’anglais et d’allemand, ou encore des conversations en français. Les migrants d’Agadir ne s’isolent donc pas systématiquement entre eux dans des lieux où ils se retrouvent en nombre. Il est possible de les apercevoir aux terrasses de petits restaurants populaires auprès de la population locale. Certains noms de restaurants sont cependant régulièrement cités comme appréciés par les résidents Européens, et des cafés comme LeDôme, face à la place Al Amal le long du boulevard Hassan II, comptent ungrandnombred’habituésEuropéens.CommeledécritMichelDesse,ilestsouventpossibledereconnaîtrelesrésidentsEuropéensauxterrassesdes cafés, par leur comportement et le fait de se sentir à leur place au Maroc : « Aux terrasses, à côté de certains touristes esseulés, des groupes se constituent, s’interpellent montrant bruyamment qu’ils sont d’ici. Ces attitudes constituent les marqueurs de différentes formes de mobilité. » (Desse, 2010 : 62) Cette remarque interroge sur les raisons d’un tel comportementdelapartdesrésidentsEuropéens.Pourquoiseplaisent-ilsà manifester haut et fort leur présence aux côtés de touristes plus discrets etdequelquesMarocains?N’est-ilpastentantpourcesmigrantsd’étalerunerichessedontilsnepouvaientsevanterenEurope?Unefoisencorele pouvoir économique des Européens auMaroc constitue une réponseà ces attitudes de démonstration de richesse. Le fait de se rassembler en groupe à la terrasse d’un café peut également donner un sentiment de force à ces migrants qui vivent dans un pays culturellement très différent. Ce besoin de regroupement peut diminuer le sentiment de faiblesse qui atteint l’étrangerlorsqu’ilarriveauMaroc.Echapperàlasolitude,sesentirplusfort, se montrer, s’imposer, ce sont autant de raisons pour ces migrants de se rassembler tous ensemble autour d’une terrasse de café.
La place du marché de Talborjt : regroupement ou division ?Certains lieux d’Agadir sont très fréquentés par les résidents européens,
mais ils interrogent sur les attitudes des migrants au sein de la communauté européenne. Ont-ils tendance à se mélanger par nationalité ou à l’inverse forment-ilsdesgroupes trèsdistincts?Cetteplaceestsituéederrière lemarché deTalborjt et face à l’ancien cinémaSahara.Elle présente unerangée de restaurants très réputés auprès de la population européenne.
Photos 30 et 31 : Deux bars et restaurants très fréquentés par les résidents européens. Clichés : Lachaud E., mars 2014.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
96 97
Eloignée du secteur touristique, la fréquentation de ce lieu concerneessentiellement les résidents Européens. Ils viennent régulièrementdéjeunerdanslequartier,etjustifientleurchoixliéauxprixbienmoindrepar rapport aux restaurants proches du bord de mer. Cette différence de prix est également due au fait que dans le Secteur touristique, les restaurants vendent de l’alcool et doivent donc payer une licence, ce qui n’est pas le cas pour ces restaurants de Talborjt. Non loin de petits cafés-restaurants populaires où les travailleurs marocains viennent se poser pour manger un tajine, les terrasses de cette place comptent très peu de Marocains parmi lesEuropéens.Commel’indiquelesphotosci-dessous,lesplatsproposéssont à la fois des spécialités marocaines, et occidentales (françaises et italiennesdanslecasducafé-restaurantEtoiled’Agadir).Moniquevientmanger au même restaurant tous les midis, seule à une table, en compagnie desonchien.Avecletempselleracontequ’ellenevoitpaslesEuropéensse mélanger entre eux. Chacun a ses habitudes et une place distincte. A ses yeux, les Marocains mangent à l’intérieur, et la petite avancée de terrasse proche de la vitre du restaurant est toujours occupée par des résidents du quartier Charaf. Puis, plus loin sur la place, elle remarque essentiellement desretraitésencamping-carmélangésàquelquesautresrésidents.Etenfin,elle reconnaît les touristes qui n’hésitent pas à se mettre en plein soleil. Cette curieuse observation des habitudes prises par les clients est renforcée parlaremarquedeAdaconcernantlechoixdesrestaurantssurlaplace.Elle
observe que le premier restaurant, Mille et une nuits, est principalement fréquenté par les Français accompagnés de leurs chiens. Alors que le second sert de nombreux Scandinaves comme elle. Ce phénomène ne peut bien sûr pas être attribué à tous les clients de la place, mais le simple fait d’être observé est révélateur d’une certaine sectorisation au sein même d’uneplace fréquentée par unemajorité des résidentsEuropéens.C’està la fois un lieu de regroupement, mais sans un réel mélange entre les différents migrants, caractérisés par la localisation de leur résidence, ou par leur type de migration et motivations.
Souk, boutiques, supermarchés : consommer local, moins cher, ou européen ?
Pour effectuer leurs courses au quotidien, les habitudes dépendent des migrants. Certains privilégient les commerces de proximités où ils ont un bon contact avec les commerçants et peuvent faire leurs courses tard dans la soirée. D’autres préfèrent se rendre régulièrement au Souk où ils pourrontavoirunpluslargechoixdeproduits,etprofiterontdecettevisitepour s’offrir un thé ou des sardines grillées au cœur de l’animation de la ville.LeSoukElHad(Cf.photo35)s’étendsurplusde11ha,etconstitueainsi le plus grand souk urbain du Maroc. Il est ouvert tous les jours sauf le lundi, jour de nettoyage, et offre l’accès à environ 3 000 commerces. A la fois lieu de vie pour la population locale, et lieu d’attraction touristique de la région du Souss, il est très fréquenté par les résidents européens. Ces derniers apprécient tout particulièrement les grands étalages chargés d’une multitude de fruits et légumes produits dans la région. Le souk est également l’occasion de meubler et décorer leur nouvelle résidence, avec le secteur des meubles d’occasion et des tapis. Quelques résidents se plaignent cependant d’être trop souvent pris pour des touristes, et donc de se faire constamment arnaquer. C’est pourquoi quelques boutiques dans lecentre-ville(parexempleUniprix)proposentdesprixfixésparavance,commeenEurope,dispensantainsilesrésidentsettouristesàmarchander.Ces petites courses quotidiennes sont complétées par de plus gros achats
Photos 32 à 34 : La place près du Marché de
Talborjt, un lieu de regroupement
pour les résidents européens.
Cliché : Lachaud E., mars 2014.
Photos 35 et 36 : Le souk El Had et les deux supermarchés de Talborjt. Clichés : Lachaud E., mars 2014.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
98 99
dans les supermarchés. Dans le quartier de Talborjt, la récente création d’un nouveau pôle urbain devait se traduire par un Marché municipal, maisleprojetafinalementétéreprispardesgroupesprivéspourconstruiredes résidences modernes abritant au rez-de-chaussée de grandes chaînes commerciales (Cf. photo 36). Plusieurs résidents européens préfèrent se rendre à l’enseigne marocaine Aswak Assalam, alors que d’autresprivilégient le Carrefour Market Label’Vie situé juste à côté, afin depouvoirretrouverdesproduitsplusEuropéens.Marjane,estquantàelle,une grande distribution marocaine proposant une offre conséquente de produits occidentaux, dont un rayon consacré aux vins et autres alcools. LesEuropéensdisposantd’unevoitureserendentrégulièrementdanscesupermarché en retrait du centre-ville, alors que d’autres n’y vont qu’une fois par mois pour les courses importantes. Ce supermarché suscite une opinion partagée parmi la communauté européenne, car il est cher et souvent critiqué pour être « trop occidentalisé », alors que d’autres ne jurent que par cette chaîne. Lorsque des Européens critiquent le supermarchéMarjane, une envie de distinction et de défense se dégage. Ils ne veulent pasêtreconfondusavec«lesautresEuropéens»quiviennentauMarocpour consommer comme dans leur pays, sans s’adapter à la culture locale. Ces migrants précisent donc rapidement qu’ils ne font pas partie des clients réguliers de Marjane. Ce comportement ne traduirait-il pas la peur d’êtreprispourun«Européenenvahisseur»quinefaitpasfonctionnerl’économie locale en achetant chez les petits vendeurs ? Cela illustrel’ambiguïtédel’imagedel’Européenaveclaquellelesmigrantsarrivent.Eux-mêmesnesemblentpassavoircommentsepositionnerparrapportàla population locale, à leur venue au Maroc, et à l’histoire qui a marqué les deux continents. Bien que beaucoup de résidents consomment local, notamment dans les restaurants marocains, ils aiment pouvoir s’offrir quelques spécialités européennes de temps à autre. La poissonnerie Anisea (dans le complexe commercial de Talborjt, cf. photo 37) propose à la fois des produits de la pêche locale, et des produits issus de l’importation. Quand à l’épicerie Le Terroir (Cf. photo 38), située dans le Marché Central, elle
offredesspécialitésfrançaisestrèsrecherchéesparlesEuropéensàAgadir,tels que du fromage et de la charcuterie. Ces habitudes quotidiennes sont également dictées par le moyen de locomotion des résidents européens. Certains se déplacent en voiture mais pensent que le souk est trop éloigné du centre-ville. Alors que d’autres se rendent quotidiennement au souk à pied ou en taxi, cette balade faisant partie d’un de leurs loisirs de la journée. Lechoixdeslieuxd’achatpourlescoursesquotidiennesestdoncinfluencépar plusieurs facteurs : celui du moyen de locomotion, celui du plaisir de consommation et de promenade, celui du coût des denrées, et celui du regard de l’autre. A cela s’ajoute les particularités de chaque migrant, ceux qui apprécient de retourner régulièrement chez le même vendeur, alors qued’autrespréfèrentquetoutlemondepuissebénéficierdeleurapportéconomique.
EmménageràAgadirestsynonymed’unchangementderythmedevie,avec une pratique différente des activités de loisirs et de détente. Plusieurs EuropéennesexpliquentquelesoirellessortentmoinsauMarocqueenFrance, à la fois parce qu’elles sont seules, et parce qu’il y a moins de loisirs culturels. L’Institut français propose des expositions, des concerts et des séances de cinéma, mais Louise se plaint que la programmation soit tropcibléepour lespersonnesâgées.Beaucoupdemigrants interviewésn’ont pas connaissance de l’Institut français, et par exemple, de sa médiathèque qui propose un large choix de documents culturels. Celle-ci est en effet principalement fréquentée par des Marocains, et non par des Français désireux de se rapprocher de la culture de leur pays d’origine. La relation des migrants avec l’espace urbain d’Agadir est très souvent dictée par un mode de vie « tranquille et cool », avec une grande place faite aux loisirs. Des personnes comme Torsten ont le même rituel tous les jours : «Ithinkit’sgood,wesporttwohoursonthebeach.Thenwegototherestaurant. Afterwegotothebeach,tomeetpeople.»18 D’autres, sont très occupés tous les jours par diverses activités. C’est le cas des adhérents de l’UFE(l’UniondesFrançaisdel’étranger)quiparticipentàdenombreuxregroupements de Français, sur une terrasse de café, au cours d’une partie de pétanque, ou d’une sortie en 4x4. Les trois retraités en camping-car qui résident au camping d’Agadir racontent avec le sourire qu’ils sortent plus au Maroc qu’en France car ils n’ont pas d’occupations particulières. Ils ne sont pas sollicités par leur famille et amis, et peuvent donc se consacrer entièrement à leurs loisirs, au Casino, à la plage et au souk.
MalgréunpremierisolementàleurarrivéeauMaroc,lesEuropéenscréent progressivement un réseau social de connaissances, puis d’amitiés. Ils se retrouvent entre Européens autour de leurs loisirs et plaisirs dela journée. Ces lieux de vie quotidienne deviennent alors des lieux de convivialité et de partage. Toutefois, des groupes se forment en fonction del’opinionquechaqueEuropéenadesapropremigration.
18. Traduction : « Je pense que c’est bien, on fait du sport deux heures sur la plage. Puis on va au restaurant.Etaprèson va à la plage pour retrouver des gens. »
Photos 37 et 38 : Des commerces tenus par des résidents Européens, dans le quartier de Talborjt et du Centre-ville. Clichés : Lachaud E., mars 2014.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
100 101
2. La perception et socialisation des Européens à propos de leur migration à Agadir
LesEuropéensontunevisionnuancéedeleurmigration.Eux-mêmessont venus à Agadir, mais ils se considèrent très souvent comme « un cas à part ». Une critique mutuelle se met en place entre les migrants, créant ainsi des groupes distincts. Un certain malaise se dégage aussi lors de leur entretien. Ils ne savent pas toujours comment se positionner face à leur migration controversée et pouvant rappeler le passé colonial de leur pays. Ils sont également confrontés aux conséquences de la fracture Nord/Sud, et réagissent différemment face à cette situation délicate ou confortable selon l’avis des migrants.
2.1 Quelle perception les Européens ont-ils de leur propre migration ?
Aucoursdesentretiens,lesmigrantsmanifestentleurdésirdejustifierles aspects positifs de leur venue pour le Maroc et ses habitants. Les facteurs économiques sont les premiers à être cités, mais l’apport culturel de l’Occident est également présenté comme essentiel. Ces arguments reflètent à nouveau la fractureNord/Sud, et le différentiel qu’apportentlesEuropéensauMaroc.Alorsqu’ilspratiquenttouslamêmemigrationde l’Europe versAgadir, les migrants sont très partagés concernant laperception qu’ils ont de leur propre migration. Ils n’hésitent pas à critiquer les autres migrants, sans se sentir eux-mêmes concernés. L’avis général consiste à dire que ce type de migration est plutôt positif, cela apporte des devises et de l’emploi, ainsi qu’une ouverture d’esprit pour la population locale, par le fait de côtoyer une autre culture. Les migrants sont cependant conscients que leur venue accélère l’augmentation des prix du foncier et desdenrées.QuelquesEuropéensnecitentcependantpasceslimites,ilspensent que cela permet à Agadir et ses habitants d’acquérir un petit côté européen, et ils se confortent dans l’idée que les migrants ont raison de venirsereposeretprofiterdelavieauMarocaprèsavoir«travaillédur»dans leur pays. A travers ce type de discours, se dessine une défense de la part du migrant de son propre statut. Beaucoup approuvent donc la venue croissante de ces migrants, mais ils y voient également une limite. La présence de trop d’étrangers pourrait apporter du racisme, un sentiment d’étouffement pour les Marocains, et une perte du dépaysement qui saisit lesEuropéensquandilsarriventauMaroc.Danscesdiscours,unepartiedesEuropéenssembleseconsidérercommel’exception,ilsacceptentleurpropre migration, mais ne souhaitent pas qu’elle soit pratiquée par trop de monde. Cette peur de faire partie d’une « masse européenne » à Agadir ne traduirait-elle pas la volonté de garder un statut d’exception et donc d’êtremieuxconsidéréspar lesMarocains?Ouà l’inverse,ne serait-il
pas plus facile de se fondre dans la population locale et d’échapper ainsi audifférentieléconomiqueethumainqu’ilsneveulentpasreconnaître?
LesEuropéenssecritiquentmutuellement,endésignantdesmotivationsdedépartoudescomportementsqu’ilsdésapprouvent.PourEric,beaucoupd’EuropéensviennentauMarocpardéfaut,dufaitdelaproximité,delalangue française, et de la baisse d’imposition. Carine montre également cesgensdudoigtcarellepensequ’ilsprofitentdeleurconditionauMaroc,et repartent sans rien donner au pays. Une incompréhension se tourne vers lesEuropéensquines’estimentpasheureuxauMaroc:«MaispourquoiilsnerentrentpasenEurope?»,s’exclamentnombreuxdesrésidents.Ericne pense pas que ce type de migration soit durable : « S’ils peuvent vivre aveclesmêmesprixenEurope,ilsvontresterenGrèceouauPortugal.»,mais pour les Français la limite de la langue serait un obstacle. L’aspect économique apparaît ici comme très important dans la décision de migrer au Maroc. Cependant, même avec un niveau de vie équivalent en Grèce et auPortugal,lefacteurculturelneserapaslemême.LesEuropéensaimentvenir au Maroc pour être immergés dans une culture différente de celle de l’Occident. De plus, sans en être complètement conscients, certains EuropéensemménagentauMarocpourbénéficierdelareconnaissancedela population locale face à l’image encore très présente de l’homme venu del’Occident.AproposdelamigrationdesautresEuropéensversAgadir,le sujet des retraités en camping-car est systématiquement abordé par les résidents : « Ils viennent nous casser les pieds, et puis les camping-cars… » (propos de Philippe). Beaucoup réprouvent sévèrement la venue et le comportementdecesretraités,parcequ’ilssemblentprofiterdupayssansparticiper à l’économie locale car ils marchandent beaucoup. Ces critiques sont destinées aux campings caristes en général, mais elles ne concernent en fait qu’une partie d’entre eux, ceux qui se font les moins discrets. Cela faitréférenceauxEuropéensquiressententlebesoindemettreenavantleur supériorité par rapport à la population locale. Ils étalent ainsi plus facilement leur richesse, et se font remarquer aussi bien par les Marocains queparlesautresEuropéens.Cespersonnesn’auraientpasnécessairementun tel comportement dans d’autres pays, mais la culture et l’histoire du Maroc les incitent à profiter dudifférentiel existant.Quelquesmigrantsavouent même avoir honte du comportement de certains Européens,campings caristes ou autres. Ada est suédoise, elle se sent la bienvenue à Agadir, mais elle ne partage pas cet avis concernant les Français : « I am many time sorry for the French people, because they still think they are in 1956. They think they are better that people here. So sometimes I feel very angry. »19
Il y a donc une ambivalence de la perception des résidents, ils pensent pratiquer une migration à la fois juste et positive pour le pays. C’est aussi unefaçondejustifierleurprésence,auprèsdeleursprochesenEurope,etpour ne pas se culpabiliser. Mais ils sont conscients que ce phénomène ne doitpastrops’étendre,afinqueleurmigrationneperdepasdesoncharme
19. Traduction : « Je suis vraiment désolée pour les Français, parce qu’ils pensent toujours qu’ils sont en 1956. Ils pensent qu’ils sont mieux que les gens d’ici. Alors des fois je suis vraiment en colère. »
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
102 103
et puisse perdurer de façon équilibrée. La vision de leur propre migration peutégalementêtreinfluencéeparl’opiniondesMarocainseux-mêmes.
2.2 Le sentiment des migrants concernant le regard que les Marocains portent sur leur venue
Les Européens ressentent le besoin d’expliquer leur migration, etportent donc une certaine importance au regard de la population locale concernant leur venue. Les Marocains sont souvent surpris lorsqu’ils rencontrent une femme européenne chef d’entreprise ou qui vient vivre toute seule au Maroc.
Voici un extrait de l’entretien mené avec Carine, concernant le sentiment qu’elle pense que les Marocains ont vis-à-vis de sa venue au Maroc :
« Moi de mon ressenti, c’est qu’au Maroc tu es bien accueilli quand tu viens, que tu es à la retraite, et que tu dépenses ton argent. Mais à partir du moment où tu dois te batailler avec des locaux, t’es moins bien accueilli. Je pense que dans leur tête c’est mieux de venir dépenser que de commencer à créer et prendre sa place dans le marché. Quelque part on fait de la concurrence.
Quand j’ai ouvert la poissonnerie il y a trois mois, au début c’était choquant. J’avais des gens qui rentraient, beaucoup de Marocaines, qui me disaient « et pourquoi, nous, on n’est pas capable de faire ça ? », je disais « mais si, qu’est-ce qui vous en empêche ? ». Et comme je faisais un peu d’importation, on me disait « mais pourquoi vous n’achetez pas au Maroc ? », je répondez « mais qu’est-ce que vous avez là sur les tables, c’est du Maroc, il n’y a que ça qu’on n’achète pas au Maroc qu’on fait venir, si vous avez envie d’y goûter, si vous voulez ouvrir votre esprit, nous on mange bien vos poissons ». C’est très sectaire quand même ici. Il y a une classe où on n’a pas ce problème de discours, mais la classe de base c’est violent. Alors en plus vous êtes une femme, et au poisson, ça semble bizarre !
Au début mon mari a pris le relais parce que c’était très agressif. Après non, parce que je ne me laissais pas faire. Maintenant ça va, j’ai une bonne clientèle, je travaille de la même façon avec les Marocains et les Européens, je pense qu’ils le ressentent. »
Il semble en effet que les retraités étrangers soient moins « gênants » à Agadir, car ce sont eux qui consomment le plus et apportent donc de l’argent à l’économie locale. A ce sujet, beaucoup de migrants pensent qu’ils sont considérés comme des « portes monnaies ambulants ». Il y a probablement une part de vérité de cela, du fait que le pouvoir d’achat desEuropéensestaugmentéenvenantauMaroc,ilsontdonctendanceàdépenserplusvolontairementleurargentqu’enEurope.LesentimentdesécuritéesttoutefoisbienprésentchezlesEuropéens,quelques-unsontété
victimes de vols dans le bus ou à la veille des grandes fêtes marocaines, mais ils se sentent globalement en sécurité. Ce regard porté sur leur niveau de vie les gêne, mais ils n’en sont pas directement victimes, à l’exception de quelques arnaques. Le fait d’évoquer cette gêne liée à la différence de pouvoir d’achat prouve bien que les migrants sont conscients de la fracture Nord/Sud. Ils ne se font donc pas d’illusions sur la chaleur des rapports qu’ils entretiennent avec les Marocains, car l’argent semble s’immiscer dans chaque relation, même celles qui paraissent être les plus sincères. LesEuropéensneseraient-ilspasmieuxaccueillisquelesautresmigrantsdufaitde leurpouvoird’achatplus important?Borisaunavispartagéconcernant le regard que les Marocains portent sur sa migration. Il pense que par moments ils sont les bienvenues, mais certains leur font également comprendre qu’ils sont des intrus dans la société marocaine. L’opinion générale des migrants est bien souvent basée sur le respect mutuel, s’il a lieu, alors la cohabitation est possible. Quelques personnes ont le sentiment d’êtrerejeté,maiscesontpourlaplupartdesEuropéensquiontéchouédans leur projet de migration. Une grosse déception est alors succédée par un certain malaise dans le pays. Ces différentes façons de percevoir leur venue à Agadir, et le regard des Marocains sur leur migration sont le témoin de comportements distincts, à la recherche ou non d’une socialisation avec les autres migrants.
2.3 La formation de groupes distincts au sein de la communauté européenne : entre isolement et recherche d’une vie sociale avec les autres migrants
Venir habiter à l’étranger nécessite la création d’un nouveau réseau social de connaissances et d’amis. Ce mode d’adaptation des migrants est très variable en fonction de leur âge, leurs motivations de départ, et leur volonté ou non de se retrouver entre Européens. L’isolement esttrèsprésentchezlesEuropéensseulsetdanslavieactive.Lauraracontequ’elle a une vie sociale restreinte car il n’y a pas beaucoup de jeunes EuropéenscommeelleàAgadir.Celasous-entendqu’ellerechercheunevie sociale auprès des autres résidents européens. La grande majorité des migrants sont âgés de plus de 60 ans et vivent en couple, ils n’ont donc pas les mêmes goûts et occupations que les gens dans la vie active. Quant aux Voyageurs solitaires, ils expriment leur volonté d’être avec des Marocains et ils n’adhèrent pas à certaines mentalités de « colonisateurs ». Ils entretiennent cependant une relation sociale avec d’autres Voyageurs solitaires ou d’autres types de migrants partageant les mêmes opinions. Ces relations leur permettent de se passer des contacts, comme par exemple le nom d’une femme de ménage, ou d’un chauffeur de taxi apprécié, qui pourra venir les chercher à l’aéroport à une heure tardive. Un réseau se forme également autour des locations de maisons entre propriétaires européens, ils échangent leurs contacts, et s’envoient mutuellement leurs
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
104 105
amis et famille qui demandent à être logés à Agadir. Ces personnes ne souhaitentpasavoirtropdecontactaveclesEuropéens,ilsveulentchoisirleurs fréquentations, et pas seulement les migrants de même nationalité. Anne et Paul se souviennent de leur arrivée dans le quartier de Charaf, le placier de leur rue a tout de suite voulu les présenter aux voisins belges du quartier, alors qu’ils ne recherchaient pas spécialement un contact avec leurpaysd’origine.Edithn’aimeégalementpasfréquenterlesAllemands,car ils lui demandent systématiquement de faire la traduction, elle préfère donc rester avec les Marocains et les francophones. Bengt critique ses connaissances scandinaves qui manifestent constamment le besoin de se regrouper entre eux : « Nos amis ici sont toujours regroupés entre eux. Ils vivent dans leur monde. Je ne comprends pas ça. Moi j’ai été élevé en Argentine, et ma femme en Inde. On voyage beaucoup, c’est peut-être ça la différence. » A cela s’opposent les personnes qui souhaitent se retrouver, mais pas avec n’importe quels migrants, des groupes distincts se forment au sein même de la communauté européenne.
L’entretien qui s’est déroulé avec Jean et Lucie a permis de mettre en évidence l’isolement volontaire que les Anciens gadiris créent autour de leur cercle restreint de connaissances. Il y a quelques années, ils ont essayédes’inscrireàl’UFE(Uniondesfrançaisdel’étranger),maisilsontfinalementquittél’association:«Lesgensnesecomportentpastoujourscomme on le voudrait… Les anciens, on ne veut peut-être pas se mélanger avec les nouveaux, qui sont des gens bien, mais bon… » (propos de Jean). Lucie explique qu’à l’origine elle aimait bien cette association, parce que le président était un ancien : « c’était que des anciens à l’époque, c’était un peu notre association. On se retrouvait le dimanche pour déjeuner quelque part. » L’utilisation des termes « anciens » et « nouveaux » est révélatrice de la distinction qu’ils créent entre leur réseau d’amis et celui des nouveaux arrivants. Jean critique le comportement et la tenue vestimentaire de ces migrants qui ne respectent pas les coutumes locales : « Il y a beaucoup de Français qui viennent au Maroc, et qui se comportent mal. On est choqués parcesnouveauxFrançais.»Concernantl’UFE,quiestuneassociationapolitique mais avec une tendance plutôt de droite, elle caractérise également un regroupement de personnes. Pourtant, Jean-Pierre est membre du bureau,etilaffirmequ’iln’yapasdecommunautarisme,queparle«jeudesrelations»ilssesontretrouvésentreEuropéens.Commelesmembresde l’association font connaissance autour de la pratique de différentes activités, ils finissent par devenir amis, et se fréquenter uniquement ausein de l’organisme. Il semble pourtant que ces associations d’étrangers regroupent un cercle restreint de personnes. Beaucoup de migrants ne se reconnaissentpasdanscettecommunauté.Philippeatentéd’alleràl’UFEpour rencontrer d’autres Européens : «mais leur premier accueil a étécatastrophique, c’est une tout autre mentalité ». Assis à côté de lui, Hervé hoche de la tête : « Ils n’ont pas une mentalité simple. Ça veut péter plus haut que ce qu’ils sont. Nous, on est simples, il n’y a pas de bling bling. »
Ces propos soulignent les différents comportements que peuvent avoir les migrants, en fonction de la relation qu’ils entretiennent avec le différentiel économique, humain et culturel qui les distingue de la population locale.
Les non francophones doivent faire face à l’isolement et recherchent donc à échanger avec des personnes parlant la même langue qu’eux, même s’ilsnesontpasoriginairesdumêmepays:«It’snicetospeakyourownlanguage, especially in a country where French is spoken everywhere.Moroccanpeopletendstobewiththerefamilyallthetime,it’squitehardtobreakintothatgroup.It’smucheasiertobewithEuropeanwhoareinthe same situation. So yes, I did surch for more Europeans friends Iguess. »20 (propos de Carlynn). Ce sujet est régulièrement soulevé lors des entretiens.Lesmigrantspensentqu’ilestdifficiled’avoiruneréelleamitiéavec les Marocains car il y a une importante différence culturelle et de pouvoir d’achat. Anne et Paul sont bi-résidents, ils racontent qu’ils reçoivent de longues listes de demandes de cadeaux de la part de leurs voisins lorsqu’ils repartent en Europe. L’expérience de ces visitessuccessives de voisins marocains à la veille de leur départ les incite depuis à « semettre des barrières ».LesEuropéens sont donc confrontés à lareprésentation que les Marocains se sont construit de ces migrants. De plus,cettedemandedecadeauxconfirmelefaitquelasociétémarocainene soit pas complètement immatérialiste telle que la décrivent certains migrants. Les Marocains sont tentés de profiter du différentiel qui lessépare des Européens, mais ceci a pour effet d’accentuer la fractureexistante, car cela incite les migrants à se protéger et se fermer à la population locale.
La seconde hypothèse donnée en introduction du mémoire peut être réfutéeenpartie,carlesEuropéensseregroupentbienentreeux,maispasnécessairementenfonctiondeleurnationalité.Eneffet,desgroupestrèsdistinctsapparaissentauseindesEuropéens.Lorsdesentretiens,ilétaitsurprenant de constater les critiques spontanées entre chaque groupe. Les Retraités en camping-car ont ainsi tendance à rester ensemble et à être très critiquésparlerestedesrésidentsEuropéens.LesAnciensgadirisquiontvécu leur enfance à Agadir viennent au Maroc pour se retrouver entre eux. Les résidents non retraités ont un rythme différent et se regroupent entre actifs. Quand aux francophones, peu d’entre eux semblent vouloir parler anglaispours’ouvrirauxautresEuropéens.Touslesrésidentseuropéensn’appartiennent pas à ces groupes, mais cette distinction ressort tout de même très clairement avec une entraide au sein de chaque groupe. Leurs pratiques spatiales quotidiennes sont également distinctes. Certains lieux tels que la plage et le souk, sont communs aux Marocains, aux touristes et aux résidents européens, mais les distinctions restent visibles en lien avec le comportement et le choix des places. Au sein de la communauté française, lescritiquesenversdesEuropéensàl’espritcolonisateurnesontpasrares.
20. Traduction : « C’est agréable de pouvoir parler ta propre langue, surtout dans un pays où l’on parle français partout. Les Marocains ont tendance à toujours être avec leur famille, c’est assez dur de percer dans ce groupe. Il est beaucoup plus facile d’être avec desEuropéensquisont dans la même situation. Donc oui, je pense que j’ai effectivement cherché à avoir des amis européens. »
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
106 107
Cecipourraits’expliquerparleurbesoindejustifierleurprésencedansunpays au passé colonial, et face à l’incompréhension de leurs proches en France.LesEuropéensded’autresnationalitésonttendanceàdécrirelesFrançais comme ayant un comportement dominateur et la volonté de se retrouver entre eux dans un groupe. Lors des entretiens, les personnes ont globalement une vision positive de leur propre migration, mais plusieurs d’entreeuxsoulignentl’idéeque«beaucoupprofitentdupayssansfaireprofiter ses habitants ». Ces propos de Pascal sont également liés auxquestions d’intégration et d’adaptation du migrant à Agadir.
3. Une migration dans un pays culturellement très différent : adaptation, attachement,
et définition de soi
Le concept d’intégration peut-il être appliqué à la situation des EuropéensauMaroc?Ouledécalagesocialexistantaveclapopulationlocale convoquerait-il plutôt la notion d’adaptation ? Les différencesculturelles qui séparent les deux communautés sont aussi le symbole des imagesmystifiéesdonnéesàl’Orientetl’Occident.L’arrivéedesmigrantsdans un pays défendant la place de la religion musulmane au sein de la société, peut également constituer des obstacles à leur adaptation. Le degré d’adaptation des migrants se traduit également par leur perception etlesmotsqu’ilschoisissentpoursedéfinir.L’expériencemigratoirepeutbouleverser l’attachement que les migrants portent pour leur pays d’origine, augmentantainsileursentimentdefierté,ouaucontraireconfirmantleurdémarche de fuite du continent européen.
3.1 Intégration ou adaptation, quel statut pour les étrangers européens ?
Le concept d’intégration est régulièrement convoqué au sujet de la place des immigrés dans la société d’accueil. Il ne peut cependant pas être attribué de la même façon aux migrants européens et aux migrants subsahariens. Dans sa thèse sur la recherche d’un modèle d’adaptation socioculturelle, la sociologue Aurélia Picod aborde la notion d’intégration sous un angle moins étudié : celui des migrations depuis les pays occidentalisés vers les pays en développement. Elle passe outre leprocessus d’émigration, et fait le choix d’analyser le comportement des Français au Maroc, abordant ainsi les questions d’identité personnelle etcollectivedecettepopulation (Picod,2008).Elle réfute lapossibilitéd’associer l’intégration des immigrés au Maroc à celle des immigrés en France, par le simple fait que « la population française est en haut de l’échelle sociale au Maroc, contrairement aux immigrés de France souvent relégués en bas de l’échelle. » (Picod, 2008 : 434). Le statut du migrant européen au Maroc est donc inégalitaire face à celui des autres immigrés. LesresponsablesdecedéséquilibresontleniveausocialdesEuropéens,mais également l’image qui leur est conférée. Celle-ci est entourée d’un mythe de la personne encré depuis longtemps dans l’histoire du pays. Les Occidentaux sont souvent perçus comme un exemple à suivre, et ils sont le symbole d’une opportunité économique pour la population marocaine. Aurélia Picod admet toutefois que les étrangers ont une plus grande facilité d’adaptation au Maroc en construisant une identité qui leur est propre, car l’histoire de ce pays illustre l’acceptation de différentes communautés (par
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
108 109
exemplecelledesjuifs).Ellemetainsienavantlecontrasteaveclestatutde l’immigré en France, qui comporte de nombreuses contraintes.
A l’arrivée des migrants au Maroc, leur culture est confrontée à celle de la population locale. L’idée du modèle européen omniprésent dans le pays ne menace pas la culture du migrant, mais elle la questionne, et peut déstabiliser l’étranger. La citation ci-contre évoque l’instabilité ressentie par l’étranger, ils agissent différemment et se sententdistincts.LesEuropéensauMaroc rencontrentcettedifficultéde statutetnesavent pas toujours comment se positionner. Sylvain Beck analyse la situation des Français expatriés au Maroc selon ce qu’il nomme « un processus de carrière déviante » (Beck, 2010 : 24). Pour mener cette étude, il relie la culture au concept de norme
en faisant référence aux appartenances à des groupes d’individus avec une culture commune pouvant amener progressivement à l’établissement de normes. Il décrit trois étapes successives en s’inspirant de l’école de Chicago :
- « L’individu expatrié doit transgresser une norme », et fait l’apprentissage d’une nouvelle culture par l’intermédiaire de la langue, de nouveaux codes sociaux etc.
- Puis, « le stigmate de l’étranger » passe par sa prise de conscience de son statut particulier, et la reconnaissance par les autres individus de sa différence au sein de la norme.
- Enfin, « il se reconnaît et est reconnu comme appartenant à unmême groupe », avec par exemple une communauté de personnes partageant les mêmes normes, ou le même statut d’étranger.
Lorsqu’ils migrent au Maroc, les Européens passent d’une cultureconnue à un contexte nouveau et différent en de nombreux termes. Cette situation encourage le migrant à reproduire un lieu de vie qui lui est familier. Mais cela doit se faire tout en acceptant son statut d’étranger, sans avoir le sentiment d’être attaqué au plus profond de son identité. Certaines personnes vont réussir à surmonter cette étape de reconstruction de soi, alors que pour d’autres la migration se traduira par un échec suite à la disparition d’un trop grand nombre de repères. La reconnaissance d’un statut commun avec d’autres migrants peut permettre de surmonter les difficultésrencontréesdepartlechangementdemodedevieetladifférenceculturelle rappelée quotidiennement. Les associations de Français à l’étranger permettent par exemple aux migrants de conserver leur identité à l’aide de manifestations nationales, culturelles et religieuses.
Le rapport de force qui existe entre les Européens et la populationlocalepourraitjustifierlefaitquelesmigrantsnesouhaitentpass’intégrer,
mais plutôt s’adapter. La sociologue Jacqueline Costa-Lascoux définitl’intégrationparsaracineétymologiquesignifiant«rendreentier»:Intégrer,c’est « participer à la construction d’un ensemble créé à partir d’éléments différents, autrement dit un processus d’interactions et de réciprocités, rendu possible sur la base de principes communs. Le processus se veut àlongterme.»(Costa-Lascoux,2006:106).ElleajoutequececonceptesttrèsdistinctdanschaqueEtat,enfonctiondeleurspointsdevuesurle«vivreensemble».L’intégrationdesEuropéenspourraitdonclesramenersur un pied d’égalité avec les Marocains. Mais souhaiteraient-ils cette intégration, alors même que leurs motivations sont implicitement liées à ce rapportinégalitairedel’OccidentalfaceauMarocain?L’interculturalitéestsouventprésentéecommepositiveetenrichissante.Elleimpliquedesinteractions et un partage entre différentes cultures, les rencontres avec l’Autre sont fondées sur le respect mutuel et la volonté de préserver chacune de ces identités culturelles. Mais elle apporte également des contraintes.L’adaptationdesEuropéensreposedoncsurl’acceptationdecescontraintesafindeprofiterdesavantagesdeleurmigration,commelegain d’une meilleure qualité de vie. Lors des entretiens, la majorité des migrants préfèrent employer le terme d’adaptation plutôt qu’intégration. Plusieurs d’entre eux disent même ne pas vouloir s’intégrer dans la société marocaine car ils souhaitent garder du recul et une certaine liberté. D’autres expliquent que ce n’est pas possible car il existe une trop grande différence culturelle. Le concept d’intégration se différencie de celui d’assimilation qui consiste à effacer l’identité des personnes en les noyant dans un groupe dominant. Beaucoup de migrants confondent ces deux concepts et ne peuvent imaginer leur intégration au détriment de leur culture bien distincte de celle du Maroc. Mais peut-être craignent-ils aussi de perdre leur statut de privilégié en comparaison aux autres immigrés. D’autres se disent bien intégrés alors que leurs fréquentations se limitent au cercle restreint des Européens. Ilexistedoncundécalageentre lesdiscoursdonnésparcesmigrants et la faible volonté d’intégration que démontrent leurs pratiques. Leur sentiment de bonne intégration pourrait être lié à l’attention que les Marocains leur portent. Mais cette prévenance est bien souvent altérée par les dimensions économiques et symboliques de la fracture Nord/Sud.Concernantleurnouveaumodedevieetlesdifficultésqu’ilsont pu rencontrer au cours de leur installation, il est donc préférable de parlerd’une«adaptation»desEuropéensplutôtqued’une«intégration».
3.2 Perception et ressenti des migrants concernant leur adaptation à un nouveau mode de vie
A leur arrivée au Maroc, les migrants européens rencontrent des difficultés quant à leur statut et leur adaptation à ce nouveaumode devie. Les cultures occidentales et maghrébines s’opposent en de nombreux points, mais ce différentiel est également alimenté par l’image ancienne
« L’étranger, disaient Park et Stonequist, est un voyageur bien fragile, livré à la souffrance de la découverte du monde dans le labyrinthe urbain : un « homme marginal », qui échappe aux siens sans être encore des nôtres. » (Missaoui and Tarrius, 2006 : 44)
En référence à l’ouvrage de Park Robert E., etStonequistEverettV.:The marginal man, publié en 1928 par Chicago University Press.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
110 111
qui est attribuée à chacune des parties du monde. La fracture Nord/Sud est encoretrèsprésentedanslesesprits,etcomplexifieleressentidesmigrantslors de leur installation à Agadir. Le mythe de l’Orient construit par les Occidentaux nourrit les idées reçues des migrants et véhicule de nombreux espoirs autour de leur migration : « Dans un élan utopiste alimenté par les médias, le tourisme et les stéréotypes, les Français arrivent aveuglés par le scintillement de la « façade » moderne du pays qui se construit, oubliant que le Maroc est un pays de culture et de tradition musulmane. » (Picod,2008:310).CesproposillustrentbienlesdifficultésauxquellessontconfrontéslesFrançais,maiségalementlesautresEuropéensàleurarrivée au Maroc. Beaucoup emménagent suite à un séjour touristique, et ne connaissent donc pas le quotidien d’Agadir sous un regard objectif. Paul explique avec une pointe de regret que sa femme et lui étaient des novices lorsqu’ils sont arrivés pour la première fois au Maroc, ils étaient envoûtés par le pays. Mais leur regard a progressivement changé, et ils ontétéconfrontésàdesdifficultésculturelles.Cettedésillusionserait-elleen lien avec le malaise qui peut animer certains Occidentaux concernant leur statutdeprivilégié?Laconfrontationavec laculture locale reflèteleur image au travers du miroir marocain, celle-ci peut déranger, mais certains vont également l’apprécier. Plusieurs migrants évoquent une période d’adaptation d’environ trois mois, nécessaire pour chasser les illusions et oublier la vision idéaliste du pays avec laquelle ils sont arrivés. Pour Yannick cette phase de transition est encore récente, il ne perçoit plus le Maroc comme dans un rêve et la routine quotidienne s’est progressivement mise en place. Ces migrants se disent adaptés lorsqu’ils parviennent à mener leur vie quotidienne tout en faisant abstraction d’un certain nombre de faits qui paraissent révoltants à leurs yeux. Cela est lié à une confrontation culturelle avec les Européens qui arrivent dansun pays où leurs valeurs sont remises en cause : « Il est évident que le Français arrive avec des idées reçues sur le Maroc, mais surtout avec une conception démocratique et républicaine de l’organisation de la société. Ceux qui ne s’adaptent pas sont ceux qui ne peuvent pas penser la société autrement qu’en la structurant sur une base française. » (Picod, 2008 : 316). Pour ces migrants dont parle Aurélia Picod, il n’existe qu’une façon de concevoir la société : selon leurs valeurs occidentales. Ils arrivent donc au Maroc avec un esprit fermé, et imposent implicitement ou non leur regard et leur mode de vie. Malgré la situation particulière des Français de part leur important passé avec le Maroc, Aurélia Picod souligne la forte opposition culturelle entre les deux pays. Pour se faire, elle démontre le contraste important entre les valeurs prônées par chacun des Etats :« Liberté, égalité, fraternité » versus « Dieu, la Patrie, le Roi ». Cette distinction identitaire conduit à des incompréhensions culturelles entre les deux communautés. Les Marocains évoquent constamment Dieu, alors que les Français se conduisent pour la plupart selon la loi de la rationalité. Ce quotidien desEuropéens auMaroc constitue pourAurélia Picod un
véritable « choc des cultures ». Une partie des migrants restent ancrés dans leur conception du monde, alors que les autres essayent de comprendre ce chocculturelafindesecréerdenouvellesvaleursbaséessurlesrichessesde la multiculturalité. Dans le premier cas, les résidents étrangers sont confrontés à une lutte journalière pour conserver leurs valeurs tout en s’adaptant à celles des Marocains, beaucoup s’appuient sur la discrétion et évitent les sujets de conversation sensibles. Certains s’arment de patience et souhaitent respecter la culture du pays qui les accueille, mais d’autres font moins d’efforts, soit parce qu’ils ne souhaitent pas essayer de se faire une place au sein de la société locale, soit parce qu’ils veulent confronter leurs idées à l’opinion marocaine. La notion d’argent représente également une barrière importante entre les deux communautés. Comme le souligne EdwardSaïd:«Lefaitd’êtreunEuropéenenOrientimpliquetoujoursque l’on ait conscience d’être distinct de son entourage, et d’être avec lui dans un rapport d’inégalité. » (Saïd, 2005 : 184). Plusieurs migrants font le choix de garder de la distance, et de ne pas trop s’intégrer. Pour Carlynn, cela est synonyme de tranquillité car elle ne partage pas les mêmes valeurs familiales que les Marocains et souhaite prendre du recul face à un mode deviequi luiparaît envahissant.Elle seplaît àvivredansune«petitebulle », et se sent plus en sécurité ainsi car elle est protégée de la pression extérieure. Cette pression ne serait-elle pas à nouveau liée à la réalité de ladifférencedestatutentreMarocainsetEuropéens?Carlynnestdoncl’exemple d’une migrante qui souhaite continuer à vivre dans un voile d’illusion,sansêtreconstammentconfrontéeauxdifficultésdudifférentielhumain.
LesEuropéensvenanttravaillerauMarocsontgénéralementbeaucoupplus confrontés à la réalité par rapport aux retraités qui ont la possibilité de vivre dans une bulle. Ils doivent jongler entre leur conception du travail et les aléas culturels. Les Travailleurs expatriés sont souvent les personnes qui cherchent le moins à s’intégrer car leur migration constitue une étape, soit pour accumuler une réserve financière, soit le temps de quelquesannées avant la migration vers un nouveau poste de travail à l’étranger. Pour la plupart, leur but premier n’est donc pas l’échange culturel, et l’intégration est un processus qui s’effectue sur le long terme. A l’inverse, les « Entrepreneurs motivés » sont confrontés aux difficultés localeset doivent comprendre les différents codes de la société. Elise a connucettedifficulté lorsde l’installationde saboutiquedeproduits français,avec un étalage de charcuterie. Sa recherche pour la location d’un fonds decommerces’estavéréedifficiledufaitdesrelationsaveclevoisinagemarocain qui voyait d’un mauvais œil l’installation d’une boutique vendant du porc. Le rythme de travail doit également être adapté à la vie culturelle etreligieusedupays.Eliseexpliquequ’elleestobligéedefermerdurantla période du Ramadan car elle a trop peu de clients. Un autre exemple est celui de Carine, arrivée au Maroc avec sa famille en 2009, elle et son mari
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
112 113
souhaitaient partager leur expérience et intégrer une entreprise marocaine dans le domaine du poisson. Mais peu d’écoute leur a été donné, et ils ont donc décidé de se lancer dans une société d’import-export. Cela leur a demandé énormément de travail du fait de leur manque de connaissance dupaysetdesonfonctionnement.Ilsontétéconfrontésàdesdifficultésàla fois culturelles, mais également en lien avec la concurrence du secteur informel de vente de poisson : « Le problème ici c’est que le système il ne marche pas pour nous. Pour des sociétés comme nous, on est formaté Europe,ilfautallervite.Etonessayedefaireleschosescorrectement,maison est attaqué par des marchés informels. » Après une série d’obstacles, Carine opte finalement pour le marché national. Elle raconte que peud’encouragements lui ont été donnés lors de son arrivée au Maroc, à la fois pour son statut d’étrangère et de femme : « Quand t’arrives t’es surprise, on te dit « non ça, tu pourras pas parce que vous êtes Français » ! Au fond on sait qu’il y a des Français qui ont fait la misère ici aussi, avec le recul tu peux comprendre les choses. Mais des fois on te donne des papiers en arabeetontedit:«t’asqu’àlirel’arabe».Enplusjesuisunefille,jesuisau port, mais je suis un petit peu psychorigide, alors je n’ai jamais eu trop de problèmes. »
Le statut de la femme européenne est nourri par l’image que les Marocains ont de l’Homme blanc. Beaucoup d’espoirs liés à l’argent, mais aussi à une représentation imaginaire de la femme sont autant d’éléments qui influent sur l’adaptation des Européennes au Maroc.La différence de statut entre les femmes européennes et les femmes marocaines est également culturelle. Lors des entretiens, plusieurs femmes vivant seules expriment leur sentiment d’avoir une moins grande liberté de mouvement qu’en Europe, comme par exemple pour sortir le soir.Elles souffrent également des regards pesants qui sont portés sur elleslorsqu’ellesmarchentdanslaville.Ellesnesesententpaseninsécurité,mais elles sont fatiguées de se faire constamment accoster et draguer dans la rue. Ce sentiment n’est cependant pas présent chez les personnes plus âgéesqui elles, sontgénéralementflattéespar les complimentsqu’ellesreçoivent.Ellesapprécientdonclestatutqueleurconfèrecetteimagedela femme européenne. Mais elles sont dans l’illusion et ne réalisent pas toujours ouvertement que c’est un différentiel lié à leur nationalité qui les place à un niveau supérieur de considération aux yeux des Marocains. Edith travaille àAgadir dans le secteur touristique depuis dix-sept ans.Elleracontequesonintégrationauseindutravailaprisplusieursannées.Entantquejeunefemmeseuleetétrangère,ellesesentaitisoléeetadûse battre pour faire sa place et être acceptée à sa juste valeur. Certaines de ces femmes seules expriment également leur isolement au sein de la communauté étrangère, face à la majorité des résidents européens qui sont en couples. Ce changement de lieu de résidencemodifie la vie socialedes habitants, certains sont plus isolés et coupés de leurs amis restés en
Europe,alorsqued’autressecréentunréseausocialbienplusimportantà Agadir. Pour les migrants ne parlant ni l’arabe ou le français, la barrière de la langue peut contribuer à leur isolement de la société marocaine, car ils conservent un statut proche de celui du touriste et ne fréquentent que les migrants originaires de leur pays. L’anglais est cependant de plus en plus répanduetpeutpermettreà toutEuropéendese fairecomprendre.Le suédois Bengt explique qu’il est plus facile pour lui d’être avec des amisscandinaves,mais ilessayed’apprendreunpeu le françaisafindemieux s’intégrer. Malgré ces obstacles culturels et linguistiques, la plupart des migrants se sentent la bienvenue au Maroc et apprécient le fait d’être régulièrement salués par un « bonjour » dans la rue. Une fois de plus, cette attentiontouteparticulièrequisembleêtreportéeauxmigrantsEuropéensne serait-elle pas le résultat d’un rapport d’argent déséquilibré entre les deuxcommunautés,etdel’imageexemplairedonnéeauxOccidentaux?Tous les migrants sont-ils accueillis par ces mêmes rapports chaleureux lorsqu’ilsarriventauMaroc?
CettedifférencederapportsentreEuropéensetMarocains,estégalementmiseenévidenceparletrèsgrandnombred’Européensquiemploieunefemme de ménage. Beaucoup d’entre eux tissent une relation particulière avec elle et la considèrent comme un membre de leur famille. Alors que certainsembauchentuneemployéedemaisonpourprofiterdel’avantagedesoncoûtmoindreparrapportàl’Europe,d’autreslefontsurtoutpouraiderune famille marocaine. La femme de ménage, bien qu’embauchée sans être déclarée,tientuneplacetrèsimportanteauseindufoyerdesEuropéens.C’est également elle qui est chargée de la surveillance et de l’entretien des bienslorsquelesmigrantssontderetourenEuropepouruneplusoumoinslongue période. Bien que cela crée des emplois et puisse correspondre à unedémarched’aide,ladifférencedestatutetlasupérioritédesEuropéensn’en sont que plus renforcées. Concernant les couples franco-marocains, Aurélia Picod argumente qu’ils sont l’objet d’un multiculturalisme inégal, avec par exemple les contraintes pour l’un des conjoints de la conversion à l’Islam, du respect des interdits alimentaires etc. Cela incite donc le conjoint européen à un plus grand effort d’adaptation à la culture du pays de résidence. De ce point de vue, le conjoint européen serait donc dans une situation d’infériorité et de faiblesse, un statut très différent de la plupart des migrants venus s’installer à Agadir.
Le principal ressenti des résidents Européens est lié à la religionmusulmane omniprésente dans la vie quotidienne et collective du pays. Malgré tout, ils se sentent libres de leurs opinions, tant qu’ils ne sont pas dans la provocation et font abstraction de certains sujets. Les migrants se sentent en sécurité dans le pays, mais en même temps ils expriment souvent le fait qu’il y a certaines choses qu’ils ne peuvent pas ou ne pensent pas pouvoir faire au Maroc. L’adaptation culturelle du migrant est facilitée
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
114 115
lorsqu’il a déjà vécu à l’étranger, ou est issu d’une famille d’immigrés, il a ainsi déjà connu l’effort d’adaptation dans un pays. Cette perception du migrant concernant son sentiment d’intégration ou d’isolement à Agadir va influencerlafaçondontilsedéfinit,parsonpaysd’origine,ousonstatutau Maroc. Cela est également en relation avec un plus ou moins grand attachement à la culture d’origine, un facteur qui peut varier au cours de la période de résidence au Maroc.
3.3 Des définitions personnelles des migrants, à leur attachement pour leur culture et leur pays d’origine
Les pratiques réelles des migrants et la façon dont ils se conçoivent, peuventêtrerévélateursd’undécalageentreperceptionetréalité.Alafindesentretiens,ilétaitdemandéauxmigrantsdesedéfinirparleurspropresmots.Quelques-unsontprisunmomentpourréfléchiràlaquestion,alorsque pour d’autres la réponse était une évidence. La figure 4 retranscritlesprincipalesréponsesdonnéesparlesEuropéensinterviewésetcellesqui étaient récurrentes.Cinqaxesont étédéfinis suite aux résultatsdesentretiens. D’autres différenciations étaient possibles, mais le choix a été fait de privilégier le rapport que les migrants entretiennent avec leur nationalitéetleursracineseuropéennes.Celapermetd’ouvrirlaréflexionsur leur attachement au pays d’origine, et leur volonté de s’intégrer ou prendre du recul par rapport à la société marocaine.
- Le premier axedésignel’affirmationdelanationalitéd’originedumigrant. Pour Paul et Torsten il était évident de préciser qu’ils ne pourraient jamais être marocains. Cela pourrait également être interprété comme une impossibilité de s’intégrer dans le pays, ils souhaiteraient ainsi conserver le statut de privilégié que leur confère leur pays d’origine. Se dire marocain pourraitsignifierlapertedeleursvaleursoccidentales.
- Le second axe ne présente pas une telle opposition face à la possibilité desesentirMarocain.Ilssedéfinissentparleurnationalitéd’origine,touten précisant l’affection qu’ils ressentent pour le Maroc. Une frontière subsiste cependant entre le fait d’être Français ou Marocain. Ces migrants sont peut-être conscients au fond d’eux-mêmes que leurs pratiques sont en position d’inégalité avec celles de la population locale. Si Sylvie se désignait comme une Marocaine, alors cela signifierait qu’il n’existeplus d’ambiguïté dans son statut, et que les conséquences de la fracture Nord/Sud ne feraient pas partie de son quotidien. Yannick se dit « gaouri » car c’est comme ça qu’il se sent défini par lesMarocains. Il expliqueque ne comprenant pas l’arabe il sait très bien quand on parle de lui dans uneboutiquedèsqu’ilentendcemot.Eneffet,«gaouri»estun termearabeutilisépourdésignerl’Européens,etpluslargementl’Occidentaletle Chrétien. Le classement typologique de Yannick comme un Voyageur solitairerappellelepeud’attachesqu’ilaaveclaFrance,etcelajustified’autantpluslafaçondontilsedéfinit,autraversduregarddelapopulation Figure 4 : Synthèse des définitions personnelles des migrants : Comment se définissent-ils ? Réalisation : Lachaud E., 2014.
Chapitre iii - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoireLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
116 117
locale.L’expression«nepasreniersesorigines»employéeparEliseesttrèsprésentedanslediscoursdesEuropéens.ToutensesentantmieuxauMaroc que dans leur pays d’origine, après avoir pratiqué une migration synonyme de fuite, ils souhaitent se justifier et préciser qu’ils restenttoutefois reliés à leur nationalité d’origine. Ce rattachement aux pays européens leur est peut-être rappelé tout au long de leur vie quotidienne, de part leurs pratiques marquées par leurs origines, et de part le regard des Marocains évoquant constamment le continent dont ils sont originaires.
- Le troisième axe ne concerne pas le rattachement à un pays, mais plutôt àunstatut.Sequalifiercommerésident,visiteuroutouristedémontreledegré du sentiment d’intégration ou d’adaptation dans le pays. Les propos dePeterillustrentl’ambivalencedustatutdewinterbird.Ilsesentchezlui,auMaroc,durantlapériodehivernale,etn’hésiteainsipasàsedéfinircomme un Marocain. Mais ces propos soulignent le décalage présent entre le discours du migrant et la réalité. Il se sent Marocain alors que ses allers-retours annuels entre deux pays ne peuvent pas lui permettre une réelle intégration au Maroc. Ses pratiques quotidiennes sont très proches de celles des touristes de longue durée, il existe donc une ambiguïté dans ses propos. Le fait de se sentir Marocain est probablement lié aux rapports chaleureux qu’il entretient avec la population locale. Mais il ne semble pas réaliser que ces relations sont principalement fondées sur l’image véhiculée par l’Occidental et sur une considération différente envers les migrants venus de l’Occident, et ceux venus du continent africain. Les termes d’ « Occidentale dans un pays musulman » employés par Anne, soulignent son sentiment d’étrangère au Maroc de part sa différence culturelleetreligieuse.Ellesembleréaliserquesonstatutd’Occidentalelaplacedansunepositionparticulièrementdifficilepourréussiràsefondredanslapopulationmarocaine.Ellenepeutdoncpassedéfinirautrementque par ces termes rappelant l’image d’un intrus dans un pays musulman.
- Le quatrième axe présentelesdéfinitionsdonnéespardespersonnestrès attachées au Maroc car ce sont des Anciens gadiris, des Couples interculturels, ou des personnes se projetant à long terme dans le pays, comme Louise. Carine explique qu’elle est toujours française, mais elle sous-entend qu’avec le temps elle pourrait se définir autrement. Il y adonc un attachement très fort à la fois pour le Maroc, lieu de résidence par adoption et le pays d’origine. Cela illustre également le souhait de ne pas sedéfinirpar l’attachementàunpaysspécifique. Ilspréfèrentêtredansl’entre-deux, ou ne pas se poser la question. Ils se sentent chez eux au Maroc, mais ne peuvent pas oublier leurs origines qui restent très présentes dans leurs pratiques quotidiennes et les valeurs qu’ils défendent.
- Enfin, le dernier axe se rapproche du précédent concernant les Anciens gadiris, mais avec la définition reconnue de « Gadiris ». Cetattachement fort n’est pas seulement éprouvé pour le pays, mais plus particulièrement pour Agadir et son histoire, car le migrant est lié à cette ville par le passé.
Cettedéfinitiondesoiparlesmigrants,estrévélatricedeleurniveaud’adaptation au Maroc, mais également du degré d’attachement qu’ils portent à leurs origines. Le fait de quitter son pays pour un autre permet-il deréaliserl’importancedesavantagesqueprésentelepaysd’origine?Ouà l’inverse, cela permet-il de prendre du recul et de réaliser grâce aux atouts du Maroc, la baisse d’un attachement à leur terre natale ? Lesmigrants issus d’une double nationalité, ou d’une famille culturellement diversifiéesontlespremiersàsemontrermoinsattachésaupayseuropéenqu’ils ont quitté. Des personnes comme Hervé ont quitté leur pays pour se donner les moyens d’une meilleure qualité de vie. Sa migration a été un succès car il a obtenu ce qu’il souhaitait. Il témoigne de son attachement de plus en plus faible pour la France car « elle se dégrade, la mentalité se dégrade, ici il y a un meilleur accueil ». Ce type de discours est courant chez les migrants qui recherchent un quotidien plus agréable au Maroc. La fuite de leur pays d’origine et les sentiments qui l’entourent, nécessitent un rattachement au pays d’accueil et à ce qu’il est capable d’offrir à ces migrants. Laura appartient à une famille qui s’est beaucoup déplacée en France, elle explique le peu d’attachement qu’elle porte à ses lieux de vie. Pour elle l’inverse s’est produit en résidant au Maroc : « Le sentiment de fiertén’estpasarrivé.Aprèst’esfrançaiset’esfrançaise.Maisàêtreicit’en a plus honte que d’être fière. » Ce témoignage fait référence aucomportement des autres migrants européens. Le continent d’origine est le point commun de tous ces migrants, et l’attitude de chacun d’entre eux est commelerefletdel’imagedetous.Lauraexprimedelahontevis-à-visdecertains de ces migrants supposés représenter son pays d’origine. Ellereproche leur manque de discrétion, la façon dont ils imposent leur manière de voir les choses, et le peu d’ouverture qu’ils ont lors de leur arrivée au Maroc.CecomportementestsouventliéàlasupérioritéquelesEuropéensressentent lorsqu’ils arrivent au Maroc. Ils ont ainsi besoin de l’exprimer, de défendre leurs valeurs comme celles que tout le monde devrait avoir. Leur migration se nourrit de cette différence de statut, leur venue au Maroc augmente leur pouvoir d’achat, mais également leur importance. Alors qu’ilsn’étaientpasreconnusenEurope,ilsseplaisentàdevenirlecentredel’attentionauMaroc.VivreàAgadir,aainsiravivélesentimentdefiertéd’une partie des migrants concernant leur pays d’origine. Pour certains Français(surtoutoriginairesdelarégionparisienne),cettefiertéestissuede l’importante offre culturelle de leur pays. Ils réalisent ce fait par le manque qu’ils ressentent dans l’absence de cinémas et de théâtres à Agadir. Pour d’autres, la migration leur offre un nouveau regard, plus ouvert, et ils comprennent l’importance des valeurs qu’ils ont cultivées dans leur pays. Plusieurs Français témoignent que cette migration leur a permis de réaliser combien ils sont chanceux d’être nés dans un pays qui prône la liberté d’expression. Carine explique ainsi l’admiration qu’elle porte aux générations passées et le besoin de citoyenneté française qu’elle ressent
119
Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
118
depuis qu’elle vit au Maroc : « Quand tu vis au quotidien ici, c’est là que tu mesures l’effort des générations précédentes pour en arriver au stade où on est. J’ai toujours été une femme très engagée citoyennement, et j’ai toujours cette notion, mais là vraiment, j’ai le manque. » Le fait d’être loin de son pays peut également raviver un patriotisme chez des personnes qui le pensaient disparu. Depuis qu’elle s’est installée à Agadir, Carlynn porte plusd’intérêtàl’actualitédanssonpays,etelleestgagnéeparlafierté:«Itmakesyoumorepatriotic.Idon’tknowwhy.ItmakesyoumuchmoreinterestedinEngland.Iwasneverhugelylisteningtothenews,IsupposeIneverhadtime.ItconnectyouwithyourfriendsinEngland.IthinkitmakesyoumuchmorepridetobeBritishinaway.Itdoessoundssilly,butit’s true. »21 Les personnes comme Catherine, pour lesquelles cette migration au Maroc est perçue comme un échec, ont tendance à se rattacher à des éléments de leur pays d’origine auxquels ils n’avaient jamais prêté attention. Cette expérience migratoire leur révèle un confort de vie, à la fois culturel et social, qu’ils souhaitent retrouver le plus rapidement possibleunefoisrevenusenEurope.
L’attachement du migrant pour ses origines varie donc beaucoup en fonction des objectifs de la migration, de leur succès, et de la personnalité de chaque migrant. Cela peut amener à un rejet progressif de la culture d’origine et un besoin de prendre du recul face à l’actualité du pays. A l’inverse, la distance peut raviver un besoin patriotique et citoyen, encourageant le migrant à s’informer sur son pays, et échanger avec des personnes de même nationalité. L’identité culturelle des migrants peut être renforcée lorsqu’ils exercent une importante vie communautaire à Agadir. Les réunions amicales des personnes de même origine sont l’occasion de fêter des évènements propres aux traditions de chaque pays et donc de renforcerunlienculturelavecl’Europe.
Les pratiques socio-spatiales des résidents européens traduisent leur conception de ce style de migration. Souhaitent-ils conserver leur image d’Européen,ouàl’inverseseconfondreaveclapopulationlocale?Leurrapport de force lié au différentiel économique et au symbolemystifiéde l’Occident influence leurquotidien. Ilsprofitentde lahaussede leurpouvoir d’achat. Certains apprécient ce changement de niveau de vie et se comportent en conséquence. Des groupes de migrants se forment en fonction de leur ressenti, et de leur volonté ou non de se mélanger entre Européens. Une forte critique interagit entre ces groupes et pourraits’expliquer par le malaise de chacun face à leur migration et à la fracture Nord/Sudexistanteentrelesdeuxpays.Ilstententdejustifierleurvenueense distinguant « des autres », dont le comportement n’est pas exemplaire. Dans le cadre des lifestyles migrations, à la recherche d’une meilleure qualité de vie, l’intégration des résidents européens est peu probable, car les raisons économiques qui les poussent à venir au Maroc marquent un différentiel et donc une rupture avec la population locale.
21. Traduction :
« Ça te rend plus patriotique. Je ne sais pas pourquoi. Ça t’incite à t’intéresser d’avantage à l’Angleterre. Je n’écoutais jamais beaucoup les informations, je suppose que je n’avais jamais le temps. Ici ça te permet d’être connecté avec tes amis en Angleterre. Je pense que dans un sens, ça te rend beaucoupplusfièred’être britannique. Ça semble absurde, mais c’est vrai. »
Conclusion
ConClusion
121
Les migrants européens à Agadir constituent une population hétérogène avec toutefois des facteurs communs identifiables. La dimensionéconomique est omniprésente dans leur parcours. Le choix d’un pays économiquement plus abordable dicte leursmotivations, influe sur leurdurée de séjour, et encadre leur perception tout en limitant leur degré d’adaptation. Le pouvoir économique avec lequel les migrants arrivent auMarocdéfinitfortementleurspratiquessocio-spatiales.Cefacteurestsous-entendudanslesdiscoursdesEuropéens,maisilestrarementreconnuouvertement.Est-ceparpeurd’admettreleursupérioritééconomique,ouparhonted’avouerleurprincipalmotifdevenue?
Une double fragmentation socio-spatiale se traduit entre les migrants et la population locale, et au sein même de la communauté européenne. Les migrants ne se regroupent pas nécessairement par nationalité, mais plutôt en fonction de la langue natale ou pratiquée, et de leur mode de vie. Une forte critique mutuelle existe entre chaque groupe de migrants. Leur relation ambiguë avec le passé colonial du pays les incite à comparer leur comportementàceluidesautresEuropéens.Cescritiquesnesont-ellespasunmoyendedéfendreetjustifierleurvenueauMarocauxyeuxdeleursamisetfamillerestésenEurope?Unefragmentationsocialeexisteaussientre lesmigrants et lapopulation locale.Elle est engrandepartie liéeaux différentiels économiques et symboliques présents dans les rapports humains. L’image qui entoure les Occidentaux crée une mystificationautour de la venue des migrants et déséquilibre leurs relations avec la population locale. Ils viennent également avec de nombreux préjugés et sont plus ou moins conscients de leur rapport de force : la rencontre de cespopulationsdedeuxculturesdifférentesestfortementinfluencéeparla fracture Nord/Sud, elle détermine une relation inégale due aux facteurs économiques et humains. Le morcellement du territoire est présent au sein même des lieux d’échanges lorsque les migrants se regroupent entre eux. Ilestaccentuéparunegentrificationponctuelledesquartiers.Celle-cisedéveloppe par la création d’un réseau de relations entre les migrants et par la présence de quartiers à la morphologie plus européanisée.
La perception des Européens est ambivalente : ils considèrent leurmigration comme positive pour le pays, économiquement et culturellement. Mais ils ne souhaitent pas voir le phénomène s’étendre. Cela pourrait-il avoirpourconséquencelapertedeleur«statutprivilégié»?CediscoursdesEuropéenssouligneundécalageentreleurperceptionetlaréalité.Aucours du récit de différentes anecdotes, les marqueurs de la fracture Nord/Sud apparaissent. Les migrants ne sont-ils pas conscients de ce différentiel, ou à l’inverse, souhaitent-ils s’enfermer volontairement dans une illusion afindeseprotégerdelaréalitéd’unefractureprésenteauquotidien?Celase reflète dans la difficile reconnaissance de la sincérité d’un mariageintergénérationnel et binational. La vision symbolique et économique de la supériorité de l’homme blanc est accentuée par l’aveuglement ou la volontédeprofiterdecetteimagepourtenteruneaventureamoureuseau
ConClusionLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
122 123
Maroc. Ces tensions sont complétées par les idées reçues de chacune des communautés, provoquant un passage de l’état d’illusion à la découverte delaréalitéparfoisdifficilementacceptable.Auxtensionssociologiquess’ajoutent les tensions économiques et spatiales qui se forment autour de l’hébergement touristique informel et des vagues hivernales de camping-cars nécessitant un contrôle plus important.
Les résidents européens d’Agadir présentent des particularités dans leurs pratiques socio-spatiales et leurs motivations de départ. Ils se différencientdesétudesmenéesàMarrackech,CasablancaetEssaouiracar ils ne sont pas animés par des motivations culturelles et patrimoniales. L’absence de médina à Agadir est compensée par un ensoleillement plus constant et la présence du bord de mer. Il existe toutefois des éléments généralisables à l’échelle nationale.
L’augmentation de ces migrations à destination du Maroc a été possible grâce à la révolution des transports et au développement d’Internet. La simplification et la rapidité des réseaux de communication favorisentl’implantation des Européens qui sont ainsi moins isolés de leur paysd’origine.En2004,lalibéralisationdel’espaceaériens’étendauMarocetpermetl’ouverturedesvolslowcost.Cettebaisseduprixdestransportsa accéléré les migrations des Occidentaux vers le sud de la Méditerranée. Ce sujet de recherche présente donc un cas concret de l’impact local des phénomènes globaux de la mondialisation.
La fracture Nord/Sud est très importante dans le cadre de ces migrations.Elles’exprimeparundifférentielhumainliéaupouvoirquepossèdent les personnes venues du « Nord ». Le regard que les Marocains portent sur les Occidentaux participe au « mythe de l’Homme blanc ». Les Européenssont-ilsconscientsdecequ’ilsreprésententpourlapopulationlocale?LesréactionsetproposdesmigrantssemblenttraduireleurprisedeconsciencedecettefractureNord/Sud.Elleinfluesurleurmodedevie,maisaussisurleursmotivationsdedépart.Eneffet,beaucoupd’Européensse réjouissent de l’accueil chaleureux qu’ils reçoivent au Maroc. Mais cela est-il vrai pour les migrants venus d’autres parties du monde, tels quelesSubsahariens?LesEuropéensnefont-ilspasl’objetd’unegrandeconsidération uniquement parce qu’ils sont venus du « Nord » dans une positiondominante?
Le discours de beaucoup demigrants européens justifie leur visionpositive du Maroc par le différentiel qu’il leur donne. En effet, ladimension économique est omniprésente dans les pratiques socio-spatiales desmigrants.EnemménageantauMaroc, ils sedotentd’unplusgrandpouvoird’achatqu’enEuropeetpeuventainsis’offrirdenombreuxloisirsetextras.Cetélémentinfluenceégalementleregarddelapopulationlocale,qui perçoit les nouveaux venus comme une opportunité économique. Bien que les Européens ne l’expriment pas ouvertement, ce différentiel neconstitue-t-ilpasunemotivationmajeuredevenueauMaroc?Cettenotion
dedécalageduniveaudeviepermetdequalifierlavenuedelamajoritéde ces Européens par le concept de lifestyle migration. La recherche d’une meilleure qualité de vie s’effectue grâce à un climat favorable et à un dépaysement culturel, mais elle est essentiellement réalisable grâce au différentiel économique existant entre le pays d’origine et le pays d’accueil.LarelationentrelesEuropéensetlapopulationlocaleestdoncguidée par un rapport de force économique et complétée par des visions symboliques vis-à-vis de chacune des deux communautés.
Ce mémoire ouvre de nouvelles pistes de recherche sur une étude quantitative et qualitative plus approfondie des Retraités en camping-car et des Jeunes surfeurs. Leur comparaison avec les pratiques socio-spatiales des autres résidents européens ne révèlerait-elle pas un différentiel du niveau devieentrelesmigrants?L’étudedesinterrelationsentrelesEuropéensetle territoire implique de s’intéresser de façon plus approfondie aux points de vue des populations locales. La perception des Marocains concernant les migrations « Nord-Sud » dans leur ville, pourrait remettre en question le discours des résidents européens, et ainsi soulever d’avantage le décalage existant entre perception et réalité.
BiBliographie
127
BibliographieAggoun A., (2009) : Enquêter auprès des migrants : le chercheur et son terrain.
L’Harmattan, Paris, 160 p.Albet-MAs A., gArciA-rAMon M. D., nogué-Font J., AnD riuDor-gorgAs l., (1995) :
Géographie, aménagement du territoire et colonialisme espagnol au Maroc. Cahiers de géographie du Québec, 39, 43-59.
AlDhuy J., (2008) : Au-delàduterritoire,laterritorialité?Géodoc, 55, 35-42.AttiAs-DonFut c., (2004) : Nouveaux profils migratoires et transmigration. Les
migrations dans la perspective du parcours de vie. Caisse nationale d’assurance vieillesse, Association internationale de la Sécurité Sociale, 17 p.
ben Attou M., (2003) : Agadir gestion urbaine, stratégies d’acteurs et rôle de la société civile:urbanismeopérationnelouurbanismede fait? Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, 37-58.
bAlenghien A., (2013) : Les sociétés du Sud de la Méditerranée face à l’étranger. Le cas marocain. Etudes et Essais du CJB, Vol. 15 of Etudes et Essais, Méditerranée Sud,leretourducosmopolitisme?Mobilités,altéritésetreconstructionsidentitairessur la rive Sud de la Méditerranée, Rabat, Maroc, Centre Jacques Berque, 1-13. http://www.cjb.ma/images/2013/Collections_CJB/Balenghien_EE15.pdf. (AccessedNovember 16, 2013)
beck s., (2010) : Un exemple de migration Nord-Sud : l’expatriation des enseignants Français au Maroc, dans la zone de Rabat-Kenitra. Université Pierre-Mendes France, Grenoble 2, 86 p.
bensiMon J., (2012) : Agadir, un paradis dérobé. L’Harmattan, 220 p.benson M., AnD k. o’reilly, (2009) : Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations
and Experiences. Ashgate Publishing, 182 p.berriAne M., (2002) : Les Nouvelles Tendances du Développement du Tourisme au
Maroc. 13ème Festival International de Géographie St Dié.http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes/actes_2002/berriane/article.htm(AccessedJune20,2014).
berriAne M., (2009) : Mobilités nouvelles autour du Maroc à travers le cas de la ville de Fès.Equipederecherchesurlarégionetlarégionalisation,InternationalMigrationInstitute, University of Oxford, Fès, 50 p.
berriAne M., AnD nAkhli s., (2012) : En marge des grands chantiers touristiquesmondialisés, l’émergence de territoires touristiques « informels » et leur connexion directe avec le système monde. Méditerranée,n°116,115-122.
berriAne M., ADerghAl M., JAnAti M. i., AnD berriAne J., (2010) : L’immigration vers Fès. Le sens des nouvelles dynamiques du système migratoire euro-africain.Equipede recherche sur la région et la régionalisation, International Migration Institute, University of Oxford, Dakar, 23 p.
bonneMAison J., cAMbrézy l., AnD Quinty-bourgeois l., (1999) : Le territoire, lien ou frontière ? L’Harmattan, Paris-Montréal, 315 p.
bourDeAu P., MArtin n., AnD DAller J.-F., (2012) : Les migrations d’agrément : du tourisme à l’habiter. L’Harmattan, 412 p.
boyle M., (2009) : Migration. International Encyclopaedia of Human Geography, 7, 96-107.brunet r., théry h., AnD FerrAs r., (1993) : Les mots de la géographie : dictionnaire
critique.RECLUS,Montpellier,France,518p.
BiBliographieLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
128 129
costA-lAscoux J., (2006) : L’intégration « à la française » : une philosophie à l’épreuve des réalités. Revue européenne des migrations internationales, 22, 105-126.
DAlle i., (2010) : Maroc : Histoire, société, culture. La découverte poche, 224 p. Desse M., (2010) : Mobilités touristiques et recompositions socio spatiales dans la région
d’Agadir. Norois,n°214,55-65.el FAssi A., (2010) : Décretn°2-09-607du15rabiiII1431(1eravril2010)prispour
l’applicationdelaloin°02-03relativeàl’entréeetauséjourdesétrangersauRoyaumedu Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulière. Bulletin Officiel n°3836.
elMADMAD k., (2004) : La nouvelle loi marocaine du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, et à l’émigration et l’immigration irrégulières. Institut universitaire européen, Casablanca. http://www.carim.org/Publications/CARIM-AS04_01-Elmadmad.pdf(AccessedNovember25,2013).
elMADMAD k., (2008) : Migration circulaire et droit des migrants. Le cas du Maroc. Robert Schuman Centre for advanced studies, San Domenico di Fiesole (FI) : Institut universitaire européen, 28 p.
elMADMAD k., (2010) : LaMigration qualifiée auMaroc.Une étude socio-juridique.CARIM-AS, 1-19.
ernst i., (2012) : LamédinadeMarrakechdans le contextede sagentrification:unjeu virtuel et paradoxal. Médinas immuables? Gentrification et changement dans les villes historiques marocaines (1996-2010),E.Coslado,J.McGuinness,andC.Miller,Eds., Description du Maghreb, Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc, 161-188. http://cjb.revues.org/324 (Accessed November 16, 2013).
escher A., AnD PeterMAnn s., (2012) : Dujet-setterauretraité:parcoursetprofilsdeshabitantsétrangersdesmédinasdeMarrakechetd’Essaouira.Médinas immuables? Gentrification et changement dans les villes historiques marocaines (1996-2010), E.Coslado, J.McGuinness, andC.Miller, Eds.,Description du Maghreb, Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc, 189-214. http://cjb.revues.org/325 (Accessed November 16, 2013).
eveno b., AnD gArnier y., (1998) : Nouveau Larousse encyclopédique : dictionnaire en 2 volumes. Larousse, Paris, 1702 p.
Fechter A.-M., AnD WAlsh k., (2010) : Examining “Expatriate” Continuities:Postcolonial Approaches to Mobile Professionals. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36, 1197-1210.
Forget c., (2010) : “Floribec” : le patrimoine culturel québécois en Floride. Ethnologie française, 40, 459-468.
Fournier P., (2006) : Le sexe et l’âge de l’ethnographe : éclairants pour l’enquêté, contraignants pour l’enquêteur. ethnographiques.org. http://ethnographiques.org/2006/Fournier (Accessed December 16, 2013).
geiger M., AnD PécouD A., (2013) : Migration, Development and the “Migration and Development Nexus.” Population, Space and Place, 19, 369-374.
gieDinger s., (2011) : L’eldorado marocain. Dernières Nouvelles d’Alsace, December 29, Presse Régionale, DNA. http://www.dyarshemsi.com/presse/Eldorado_marocaine.pdf.(Accessed December 18, 2013).
gregory D., Johnston r., PrAtt g., WAtts M., AnD WhAtMore s., (2011) : The Dictionary of Human Geography. JohnWiley&Sons,1072p.
grouPe D’étuDes et De recherches sur le suD MArocAin, (1997) : La Ville d’Agadir : reconstruction et politique urbaine : actes du colloque international. Royaume du
Maroc, Université Ibn Zohr, Faculté des lettres et des sciences humaines, Agadir, 228 p.
guibert c., (2008) : Le surf au Maroc. Les déterminants d’une ressource politique incertaine. Sciences sociales et sport, 115-146.
hAut coMMissAriAt Au PlAn, (2008) : Tourisme 2030 : Quelles ambitions pour le Maroc?Prospectives Maroc 2030.
huete r., AnD MAntecon A., (2011) : Residential tourism or lifestyle migration: social problems linked to the non-definition of the situation. Controversies in tourism, CABI, 160-173.
JAnoschkA M., AnD hAAs h., (2013) : Contested Spatialities, Lifestyle Migration and Residential Tourism. Routledge, 238 p.
khrouz n., (2013) : “Politiques” publiques et présence des étrangers au Maroc. Blog Farzyat Inégalités. http://farzyat.cjb.ma/politiques-publiques-et-presence-des-etrangers-au-maroc (Accessed December 12, 2013).
king r., (2012) : Geography and migration studies: retrospect and prospect. Population, Space and Place, 134-153.
knAFou r., (2011) : Libres propos. Vivre sa retraite au soleil : représentations idéales, pratiques réelles. Gérontologie Société,n°139,179-186.
kurzAc-souAli A.-c., (2010) : Représentations et usages renouvelés des médinas gentrifiéesduMaroc.http://www.mursmurs.org/documents/etats-generaux/colloque-textes/1-3-Souali.pdf (Accessed November 25, 2013).
kurzAc-souAli A.-c., (2012) : Marrakech, insertion mondiale et dynamiques socio-spatiales locales. Méditerranée,n°116,123-132.
lAcoste y., 2003 : De la géopolitique aux paysages: dictionnaire de la géographie. A. Colin, Paris, 413 p.
le bigot b., (2013) : “Touriste ou résident ?” Réflexion sur des lieux et pratiques en convergence. Repenser les dichotomies structurantes des sciences sociales au regard de l’objet tourisme, Cité Internationale Universitaire de Paris, 19 p.
levitt P., AnD JAWorsky b. n., (2007) : Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends. Annual Review of Sociology, 33, 129-156.
lévy J., AnD lussAult M., (2003) : Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Belin, Paris, 1033 p.
Mcguinness J., (2012) : 16. La gentrification et la défense du patrimoineurbain de Casablanca. Collections électroniques du Centre Jacques-Berque. Maktabat al-Maghreb, E. Coslado, J. McGuinness, and C. Miller, Eds., CentreJacques Berque pour les études en sciences humaines et sociales, 369-375. http://cjb.revues.org/308 (Accessed November 25, 2013).
Di Méo g., (2001) : Géographie sociale et territoires. Nathan Université, Paris, 317 p.MissAoui l., AnD tArrius A., (2006) : Villes et migrants, du lieu-monde au lieu-passage.
Revue européenne des migrations internationales, 22, 43-65.noin D., (1960) : Le séisme d’Agadir. Annales de Géographie, 69, 329-331.nuDrAli o., (2007) : TheexperiencesofBritish citizens inDidim, a coastal town in
Turkey: a case of lifestyle migration. The graduate school of social sciences of middle east technical university, 222 p. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12608244/index.pdf (Accessed April 24, 2014).
nuDrAli o., AnD o’reilly k., (2009) : Taking the risk: the British in Didim, Turkey. Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences, Ashgate Publishing,
Sitographie
131
Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
130
137-152.ono M., (2009) : Japanese Lifestyle Migration/Tourism in Southeast Asia. Japanese
Review of Cultural Anthropology, 10, 43-52.ouDDir s., (2014) : Mouvement migratoire des étrangers au Maroc : Cas des Seniors
Français dans la Ville d’Agadir. Université Ibn zohr, 120 p.PicoD A., (2008) : L’émigration européenne post-coloniale : le cas des Français au
Maroc. Recherches sur un modèle d’adaptation socioculturelle. Université Paris-Descartes, 448 p.
rAFFestin c., (1982) : Remarques sur les notions d’espace, de territoire et de territorialité. Espaces et sociétés, 167-171.
rAFFestin c., (1986) : Territorialité:ConceptouParadigmedelagéographiesociale?Geographica Helvetica, 91-96.
sAïD e. W., (2005) : L’orientalisme, L’Orient créé par l’Occident. Seuil. 456 p. sAPst, (2012) : Station touristique Taghazout Bay.sAyAD A., (2006) : L’immigration ou Les paradoxes de l’altérite.Editionsraisonsd’agir,
Paris, 218 p.stevenson A., AnD WAite M., (2011) : Concise Oxford English Dictionary. Oxford
University Press. Oxford, 1728 p.therrien c., (2009) : Des repères à la construction d’un chez-soi : trajectoires de mixité
conjugale au Maroc. Université de Montréal, 344 p.toPMiller M., conWAy F. J., AnD gerber J., (2011) : US migration to Mexico: Numbers,
issues, and scenarios. Mexican Studies, 27, 45-71.torkington k., (2012) : Place and Lifestyle Migration: The Discursive Construction of
“Glocal” Place-Identity. Mobilities, 7, 71-92.trunDle c., (2009) : Romance tourists, foreignwivesor retirementmigrants?Cross-
cultural marriage in Florence, Italy. Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences, Ashgate Publishing, 51-68.
tuAn y.-F., (2001) : Space and Place. The University of Minnesota Press. The University of Minnesota Press, 248 p.
union régionAle De lA cgeM souss MAssA DrâA, (2010) : Monographie de la région du Souss Massa Drâa, 63 p.
vAnier M., (2009) : Territoires, territorialité, territorialisation: controverses et perspectives. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 228 p.
verQuin b., (2001) : Les Français à l’étranger. D’un “modèle migratoire colonial” à la circulation des élites. Hommes & Migrations, 1233, 28-43.
Viallon P., (2012) : Retiredsnowbirds.Annals of Tourism Research, 39, 2073-2091.zunino h., hiDAlgo r., AnD zebryte i., (2013) : Utopian lifestyle migrants in Pucón,
Chile: innovating social life and challenging capitalism. Contested Spatialities, Lifestyle Migration and Residential Tourism, Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility, Routledge, 96-107.
Sitographie
• Sites officiels
conseil coMMunAl D’AgADir, (2010) : Monographie par quartiers, Plan Communal de Développementdelavilled’Agadir.http://www.pcd-agadir.com/diagnostic/etat-des-lieux-2010/monographie-par-quartiers/ (Accessed August 13, 2014).
consulAt générAl De FrAnce Au MAroc, (2011) : Fiscalité marocaine pour les résidents retraités français. Consulat Général de France. http://consulfrance-ma.org/Fiscalite-marocaine-pour-les (Accessed June 27, 2014).
Direction De lA stAtistiQue, (2009) : Les Résidents étrangers au Maroc : Profil démographique et socio-économique. Haut-Commissariat au Plan, Royaume du Maroc, Rabat, Maroc. http://www.hcp.ma/region-drda/Les-Residants-etrangers-au-Maroc_a43.html(AccessedNovember16,2013).
• Blogs et sites Internet de particuliers
DArtois M.-F., (2011) : Agadir avant le tremblement de terre de 1960. http://mfd.agadir.free.fr/ (Accessed June 18, 2014).
DAWiD, (2013) : Soleil et vie moins chère : la tentation de l’étranger. La Nouvelle République.fr. http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Dialogue/n/Contenus/Articles/2013/01/15/Soleil-et-vie-moins-chere-la-tentation-de-l-etranger-1292726 (Accessed June 27, 2014).
exPAt-blog : Vivre àAgadir, partir àAgadir, expatriéAgadir. http://www.expat-blog.com/fr/destination/afrique/maroc/agadir/ (Accessed June 17, 2014).
gAucher P., (2011) : Agadir 1960. http://www.agadir1960.com/forum/index.php(Accessed July 7, 2014).
voyAge ForuM : Forum sur le Maroc. http://voyageforum.com/forum/maroc/ (Accessed May 10, 2014).
• Emissions télévisées
leMAire J.-M., AnD MAthlouti r., (2012) : Crise : ces jeunes Français qui tentent leur chance au Maroc. France24. http://www.france24.com/fr/20120802-reporters-maroc-expatriation-francaisexpatries-retraite-crise-economique-chomage (Accessed November 14, 2013).
Pellerin n., le goïc F., AnD leMAître P., (2010) : Le journal de 13h - Agadir, Eldorado des retraités français. Agadir. http://videos.tf1.fr/jt-13h/2010/agadir-eldorado-des-retraites-francais-5791018.html (Accessed June 27, 2014).
133
Annexe 1 : Tableau synoptique .................................................................................................................................................................... 134Annexe 2 : Journal de bord ............................................................................................................................................................................. 136Annexe 3 : Grille d’entretien semi directif ................................................................................................................................. 150Annexe 4 : Profildespersonnesinterviewées ......................................................................................................................... 153Annexe5:Extraitdubulletinofficieln°5831 ......................................................................................................................... 156Annexe 6 : Extraitd’unarticleduJournalHebdosurlaprostitutionàAgadir ............................. 158
Table des annexes
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
134 135
Annexe 1
%$
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
136 137
Journal de bord
Lundi 10 févrierMe voici en transit pendant 4h à l’aéroport de Casablanca. J’observe
aveccuriositétoutcequim’entoureafindem’imprégnerdel’ambiancemarocaine, toute nouvelle pour moi. Quelques voyageurs sont assis autour des tables d’un café. Le reste de la salle de transit pour les vols nationaux est vide. L’animation se limite aux femmes de ménage poussant leurs chariots et à la petite musique qui tourne en boucle sur les haut-parleurs. Mais voici que juste une heure avant mon vol la salle de transit fourmille d’activité, il semble que des vols provenant de Paris et Marseille soient arrivés. Une voix annonce en quatre langues différentes l’ouverture descheck-inpourAgadiretMarrakech.Deux longuesfilesd’attente semettentenplace, jesuissurprisepar lenombred’Européens.Tourisme,bi résidence pour l’hiver, renouvellement du visa touristique, toutes ces raisons se bousculent dans ma tête, et déjà me voici au cœur de mon sujet de mémoire.
Mardi 11 févrierPremière journée au Maroc. Je prends mes marques dans la chambre
que je loue au dernier étage de la maison de Sophie, une Française expatriée au Maroc depuis cinq ans. Je fais la connaissance de son amie Michelle, retraitée et venue passer l’hiver à Agadir. Quand je leur explique mon sujet de mémoire, Sophie plaisante en me disant que je vais les étudier comme des rats de laboratoire. Je sais qu’elle ne le pense pas, mais cela me fait réaliserqu’ilneserapastoujoursfaciledejustifiermonsujetderecherchefaceauxEuropéensvivantàAgadir.
Après un copieux petit-déjeuner marocain, nous partons toutes les trois faire un tour dans le quartier des Amicales. Je me réjouis de loger dans ce quartier assez populaire et non loin du centre-ville. Michelle et Sophie meproposentensuited’allermangeruntajinedepoissonausoukElHad.C’est l’occasion pour moi de faire mes premiers pas dans Agadir. Le souk, pourtant l’un des plus grand du Maroc, n’est pas comme je l’imaginais. Les allées sont assez larges et de temps en temps une petite place laisse percer le soleil. J’apprends que de récents travaux ont permis de changer le revêtement des allées tout en améliorant l’assainissement. Le calme de midi et vite remplacé par un brouhaha. De nombreuses personnes se bousculent devant les différentes boutiques. Des « Bonjour, c’est pas cher ! » fusent de tous côtés. Sophie est contente de me montrer ses marchands habituels et les secteurs du souk. Les yeux aux aguets, j’observe avidement toute cette vie qui s’agite autour de moi. Au retour j’achète une recharge pour clé 3G et une carte SIM, me voici prête à travailler.
Annexe 2
J’appelle Monsieur Charef pour me présenter de vive voix. Tout juste rentré d’un voyage, il me dit qu’il me re-contactera le lendemain pourfixerunrendez-vous.JedécidealorsdecontacterHamid.Etudiantde géographie, nous sommes en contact depuis plusieurs semaines, et Monsieur Charef lui a demandé de me guider dans mes recherches. Nous nous rencontrons dès le soir même, avec un premier aperçu de la corniche d’Agadir et de sa nouvelle Marina. Je me sens bien loin de l’ambiance du souk,icitoutmeparaittrèsoccidentalisé.Entrelesenseignesdesboutiqueset les restaurants accueillant des clients assis autour de tables, il semble que je sois retournée en France. Nous faisons connaissance autour d’un café, Hamidvientdefinirsonmémoiredemasteràproposdel’islamophobieen France et il projette de se lancer dans un doctorat. Je suis contente de pouvoir parler de mon sujet de recherche, cela me permet d’y voir plus clair.
Mercredi 12 févrierDe nombreuses questions se bousculent dans ma tête. Par où commencer
mon travail ?Que faire ces prochains jours ? Commentm’organiser ?Hamid m’appelle pour me proposer de venir attendre Monsieur Charef à la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) dont il est le président. Après plusieurs heures de travail et d’attente je décide de rentrer. C’est ainsi que je remonte toute l’avenue des Forces de l’Armée Royale(FAR).Jesuissurpriseparlafindecetteavenueavecdesrangéesd’immeubles blancs, neufs pour certains, inachevés pour d’autres. Plus je monte et plus la vie disparaît. Des commerces inexistants, des immeubles vides, cela me donne un étrange sentiment, pourtant ce n’est pas la dernière fois que je me retrouve au milieu d’une « ville fantôme ».
Jeudi 13 févrierLors de ces premiers jours à Agadir je ne cesse de comparer le Maroc
avec mes deux précédents voyages en Afrique. Mais je réalise très vite que peu de choses ici ressemblent au Cameroun ou au Burkina Faso.
Marcher dans la ville sans but précis me permet de découvrir de nouveaux quartiers, d’apprendre à me repérer, et d’observer. C’est ainsi que je remarque le nombre incroyable de camping-cars, ils sont omniprésents, dans tous les quartiers sans exceptions, même si certains sont préférés à d’autres. Je commence à élaborer une grille d’entretien afin de la fairerelire par Monsieur Charef et Monsieur Bensaad. C’est une première pour moi.
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
138 139
Samedi 15 févrierA 9h30 je retrouve Hamid au café Tafarnout de la fontaine. Je remarque
la grande fréquentation de ce café, autant par des Occidentaux (qu’ils soient touristes ou non) que par des marocains. A 11h je rencontre pour la première fois Monsieur Charef. Nous convenons ensemble que mon terrains’étendraauGrandAgadir,afinde traiter lecasdeTaghazoutetainsi d’aborder le thème des surfeurs et camping caristes très présents dans cette petite ville durant l’hiver. Je pars ensuite avec Hamid en direction du souk pour situer sur une carte le Grand Agadir, mais nous ne trouvons que des cartes touristiques ou des plans de la ville. Je passe l’après-midi avec Michelle qui me montre les endroits qu’elle fréquente habituellement. Ce moment me permet d’en apprendre plus sur les raisons de sa venue à Agadir. Le soleil, mais surtout le coût peu élevé de la vie semblent être les deux motivations principales.
Lundi 17 févrierDes doutes m’envahissent par moment. Pour un premier travail de
recherche ilm’estdifficiledemesituer,desavoir si je suisefficace. Jecomprends petit à petit que mon travail doit suivre son propre chemin, à son rythme. Si je m’égare, je le réaliserai en tout cas tôt ou tard. Je me décide à mettre des annonces sur les sites Internet très fréquentés par les expatriés,telqueExpatblogetvoyage-forum.Maisjenereçoisquedeuxréponsespositivesàmesannoncesafindeprendrerendez-vouspourunentretien. Je pars ensuite visiter les quartiers de Taddart et Charaf qui, selon Sophie,sonttrèsprivilégiésparlesEuropéensvenuss’installeràAgadir.Le premier se caractérise par son calme résidentiel et le manque d’activités. Le second prend forme autour de petites allées étroites, perpendiculaires à larouteprincipaleetbordéeparlesjardinsfleurisdesmaisons.
Mardi 18 févrierJerencontreSaraà lafac.Etudianteenmasterdegéographie,ellea
fait son mémoire sur les étrangers au Maroc avec une enquête auprès des seniors français résidant à Agadir. C’est l’occasion pour moi d’échanger sur le sujet et de prendre des contacts. Il me semble important que nos travaux soient complémentaires. L’après-midi je fais mon premier entretien avec Sophie. Comme elle a auparavant travaillé dans un institut de sondage elle medonnequelquesconseils.Celamepermetdeprendreconfianceenmoi.Je me rends compte que la grille d’entretien n’est qu’une base et ne peut pas être suivie dans un ordre précis parce qu’il faut sans cesse rebondir sur cequemeditl’interviewé.
Mercredi 19 févrierCe matin je pars en quête de données statistiques auprès des instances
officielles.JecommenceparleConsulatdeFrance.Aprèsunbonaccueilon me fait attendre, cela me permet de rencontrer directement Monsieur le Consul et une employée au service des affaires sociales. Après deux heures passées au Consulat français, je continue dans ma lancée pour demander unrendez-vousauConsulatd’Espagnesituéàquelquespas.Lasécuritéme semble plus élevée dans ce second bureau, je dois laisser mon sac dans uncasierà l’entrée.S’ensuituneviréeauCommissariatCentralafindeme renseigner sur les mesures à entreprendre pour obtenir des ressources statistiques sur les cartes de résidant délivrées aux étrangers. Contente de pouvoir enchaîner ces démarches en une journée, je continue avec le Centre Régional d’Investissement (CRI). Je m’y rends à pied, en passant par le Palais Royal puis le quartier Founty. Malgré les indications des policiers je ne parviens pas à trouver le CRI. Je reviendrai plus tard avec de meilleures indications.
Je découvre ainsi le quartier Founty et ses nombreuses constructions en cours qui émergent au milieu des hôtels de luxe et des bâtiments administratifs. Je poursuis jusqu’au supermarché Marjane, dont on m’a souvent parlé comme étant un des plus cher mais aussi des plus apprécié par les Occidentaux. Quelle surprise quand j’arrive sur un parking envahi par les camping-cars ! Un coup d’œil sur les différentes plaques d’immatriculation m’apprend que seuls quelques Allemands sont présents au milieu de cette vague de Français. Je prends le temps d’observer et me promets de revenir une autre fois pour discuter avec les gens. Je dois vite rentrer dans le centre pour mener un second entretien.
Jeudi 20 févrierEnroutepourlafacultédelettrejefaisunetrèsbellerencontreavecune
Marocaineetsafille.Cesquelquesinstantspartagésensembledonnentuneétincelle à ma journée. Un échange de sourires et quelques gestes pour nous comprendresuffisentàmerendreheureuse.JeretrouveSaraquim’apporteune thèse et un mémoire en lien avec mon sujet. Puis nous nous rendons à labibliothèquedeMadameBahijaafind’emprunterdesdocumentssurlesmigrations.Delonguesheuresdelecturem’attendentpourleweek-end.Jeprends un taxi sans compteur qui me conduit directement au souk, j’aime m’y balader et regarder les nombreux produits et saveurs auxquels il est difficilederésister.
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
140 141
Vendredi 21 févrierCe matin je pars en direction du quartier Suisse et du centre urbain pour
mefamiliariseravecceslieux.EnpassanttoutprèsducampingjeremarquequejesuisdevantlaDélégationRégionaleduTourisme.J’enprofitepourm’y rendre et après plusieurs intermédiaires je rencontre le chargé de l’encadrement de l’activité touristique. Ayant lui-même fait une thèse, c’est avec plaisir qu’il m’accorde un moment de son temps. C’est ainsi qu’il medonnelescontactsdequelquesEuropéensdirigeantdesrésidencesouagences de voyages. Puis je retourne au Commissariat Central pour fournir les documents nécessaires pour la demande de données statistiques. Cette fois-ci je rencontre Monsieur le Commissaire qui m’apprend qu’il ne peut rien me donner sans l’autorisation de la Direction Générale de la Sûreté Nationale à Rabat. Je dois donc leur envoyer une demande rédigée par Monsieur Charef.
A 16h je me rends à la première réunion des doctorants de géographie à laquelle m’a convié Monsieur Charef. Cela me permet de rencontrer des professeurs de l’université et des étudiants aux projets de thèse tous plus intéressants les uns que les autres. Hamid, Hassan et Hicham partent le soir même pour se rendre au salon du livre de Casablanca et présenter le CRDH. Ils me raccompagnent chez moi, ce qui nous permet d’échanger dans une ambiance détendue. Hicham m’apprend qu’il a passé la journée à une commission de régularisation des immigrés vivant dans la région mise en place par le ministère depuis le début de l’année 2014. Il m’apprend que parmi les nombreux subsahariens et syriens présents, il y avait également quelquesEuropéens.
Dimanche 23 février Je prends mon temps à la maison, ça fait du bien de ne pas courir à droite
et à gauche comme je l’ai fait toute cette semaine. Je prends beaucoup de plaisir à lire une thèse de sociologie sur les Français au Maroc. Les notions d’intégration et d’adaptation sont abordées sans détour, et de nombreux témoignages passionnants sont retranscrits.
Lundi 24 févrierJ’entame ma troisième semaine au Maroc, bientôt la moitié de mon
travail de terrain, de quoi me mettre la pression pour la suite du séjour. La journée commence par une visite au camping. Après un long contrôle de mes papiers d’identité et de la véracité de mes propos sur le sujet de mon mémoire, le directeur du camping m’autorise à aller rencontrer les retraités camping caristes. De par mon âge je ne passe pas inaperçue dans ces allées où certains retraités résident pendant plusieurs mois. A 16h je me rends à la Jardinerie du Souss où se tient la permanence de l’Union des Français de l’étranger (UFE). L’accueil n’est pas celui auquel jem’attendais, et
on me demande de repasser lors de la permanence du mercredi. Un peu découragée, je rencontre par hasard Hamid qui sort du CRDH. Cela tombe plutôt bien. Nous passons la soirée à marcher et débattre sur des sujets culturels et politiques.
Mercredi 26 févrierJe retourne au Jardin du Souss en espérant pouvoir faire quelques
entretiensaveclesmembresdel’UFE.Jemeréjouisquel’und’entreeuxprenne le temps de discuter avec moi. Puis je me rends dans une agence de voyages et une résidence tenues par une Anglaise et des Français. Ils veulent me re-contacter plus tard pour un rendez-vous, mais je devrais sûrement les relancer.
Jeudi 27 févrierJe propose à Sophie d’aller manger un tajine dans le quartier de Talborjt.
J’apprécie ces moments où nous pouvons échanger de choses et d’autres. Je peux également lui parler de l’avancée de mon travail, elle est toujours prête à m’aider et me donner des indications.
Les personnes que j’ai rencontrées jusqu’ici ne souhaitent pas fréquenter tropd’Européens,cequinem’apaspermisd’obtenirbeaucoupdecontactspour d’autres entretiens. C’est ainsi que j’ai également décidé d’aborder les gens dans la rue, de préférence en terrasse d’un café car ils sont souvent plus disponibles. J’enchaîne donc trois entretiens dans l’après-midi. Je pense déjà au long travail de retranscription des enregistrements qui m’attend pour le soir.
Vendredi 28 févrierJe goûte mon premier couscous marocain avec Hamid, sur la place
Lahcen Tamri près du marché de Talborjt. Les clients attablés aux terrasses des restaurants sont en grande majorité occidentaux. Cela me donne une idée des principaux lieux de la ville fréquentés par les Européens. Jereviendrai sûrement pour faire quelques entretiens. Nous nous rendons ensuite à la poissonnerie dont nous avait parlé Monsieur Charef, qui est tenue par un couple de français. Un très long entretien s’ensuit.
Lundi 3 mars Un air de printemps commence à arriver sur Agadir. Les fleures
d’orangers répandent leurs parfums dans les rues, et les températures se font plus chaudes. Il me semble que les touristes sont de plus en plus nombreux dans la ville, ce qui ne facilitera pas ma tâche pour aborder les gens dans la rue. Partie à pied des Amicales en direction de l’est de la ville, je déambule dans le quartier Najah. Ses très belles et spacieuses demeures
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
142 143
contrastent avec des immeubles bas inachevés mais déjà habités. Je ne sais pas si ces travaux ont lieu dans Najah ou si je me situe déjà sur les hauteurs du quartier Industriel. Je prends ensuite un taxi pour rendre les livres à la bibliothèque de la fac. Puis je décide d’aller voir la Kasbah en haut de la colline qui domine la baie d’Agadir. Une très belle vue s’offre à moi et j’aperçois au loin les tout nouveaux immeubles du quartier Hay Mohammadi, construits lors d’une grande opération de lutte contre les bidonvilles. Après avoir pris le temps d’apprécier cette vue je redescends au moment où sept grands cars de touristes débarquent en même temps, suivis d’une foule de taxis. Dans une grande cacophonie de klaxons et d’embouteillages auxquels les dromadaires participent, je m’étonne que les agences d’excursions ne se soient pas mieux organisées pour arriver à différents moments de la journée.
Mercredi 5 marsHier j’ai passé l’après-midi à me documenter à la bibliothèque de
l’Institut Français. Il est fréquenté par beaucoup de Marocains désireux de s’instruire en français, ou de pouvoir consulter les différents services tel que l’accès à Internet. A 17h je me rends à mon premier entretien avec des Européensautresquefrançais.CecoupledeBelgesretraitésaveclequelSophie m’a mis en contact m’accueille à bras ouverts. L’entretien dure un long moment, puis je rencontre leur voisin québécois résidant à Charaf depuis une quinzaine d’années car il ne supportait plus le froid glacial de l’hiver canadien. Je suis invitée à rester pour le dîner, ce qui nous permet d’échanger un peu plus sur leur vécu à Agadir. Ils me proposent de parler de moi à leurs voisins, une bonne occasion de faire de nouveaux entretiens.
Jeudi 6 marsJ’avais un entretien prévu pour ce matin, mais je reste sans nouvelles
duFrançaisquejedevaisrencontrer.J’enprofitepourfaireunbilandesdifférentes démarches qu’il me reste à faire à Agadir. Je rassemble mes notes, regroupe toutes les questions que je me suis posées depuis mon arrivée,etjeréfléchisàdenouvellespossibilitésdecontactpoureffectuerdes entretiens.
Samedi 8 marsJemeréveilleausonduventquisifflesurlaterrasse.Ilfaitunechaleur
étouffante et le vent du sud-est ramène du sable de partout. Je me plais à l’idée de penser que le Sahara vient jusqu’au pas de ma porte ! J’emprunte un taxi collectif à destination de Taghazout. Cela me rappelle mes nombreuses virées camerounaises en taxi-brousse. Quelques kilomètres avant d’arriver à Taghazout, le chauffeur nous montre les chantiers en cours du grand
projet de construction de la nouvelle station touristique Taghazout Bay. Je ne comprends pas tout ce qu’il se dit, mais les passagers du taxi s’agitent et semblent révoltés à l’idée de ce projet qui va entièrement changer le front de mer. Il semblerait que le projet futur du gouvernement soit de construire des hôtels le long de la mer sur les vingt kilomètres qui séparent le nord d’Agadir et de Taghazout. Je suis effectivement impressionnée par ces chantiers dont j’avais entendu parler. Mais je ne réalisais pas l’ampleur des travaux. Une ambiance très différente règne dans Taghazout. Une atmosphère qui se veut « cool », détendue, aux airs un peu hippies. C’est tout un ensemble. La plupart des touristes sont anglais, jeunes, et surfeurs. Ici tous les vendeurs m’abordent en parlant anglais, même quand je m’adresse à eux en français. Taghazout est un petit village, aux maisons colorées qui surplombent la petite crique. Je longe la côte pour me rendre à la longue plage au sud du village. J’aperçois d’abord les surfeurs dans l’eau, puis les quelques touristes sur la plage. Deux quads passent à toute allure entre les vendeurs ambulants et les dromadaires. Sur les hauteurs, un grand nombre de camping- cars sont garés avec vue sur la mer. Ce n’est pourtant pas le camping-caravaning de Taghazout. Au loin, un nuage de poussière se dégage, laissant imaginer les futurs aménagements touristiques.
Lundi 10 marsJ’entame cette cinquième semaine avec l’objectif de mener deux
entretiens par jours afin d’avoir suffisamment de données lorsquemonterrain touchera à son terme. Je suis probablement arrivée à Agadir avec de nombreux préjugés, mais je pensais qu’il serait plus évident de rencontrer desEuropéensvolontairespour faireunentretien. Je réalisemaintenantqu’il n’en est rien. Certaines personnes manifestent un très grand intérêt pour mon travail, ils me demandent de les tenir au courant des résultats de l’enquête. Cependant la grande majorité est réticente à l’idée de discuter. Parfoisméfiants, ilsmedemandentsi je travaillepour legouvernementMarocain ou pour le Consulat. D’autres semblent peu ouverts à l’idée de partager leur vécu dans le cadre d’un entretien plutôt que d’un questionnaire. Il est vrai que l’entretien peu représenter une enquête plus personnelle et plus intime. Je suis donc régulièrement confrontée à des personnes méfiantesquinesouhaitentpasmedévoilerleurparcoursmigratoireetleurvécu à Agadir. Je pense également que quelques personnes sont réticentes du fait de leur statut qui n’est pas en règle, tel que par exemple ceux qui fuientlesimpôtsennesedéclarantrésidentsniauMarocetnienEurope.
J’enchaîne donc deux entretiens aujourd’hui. Les personnes rencontrées s’opposententoutpointdansleurparcoursetleurdiscours.Celaconfirmemon idée de la richesse de cette méthode d’enquête, permettant à l’interviewédes’exprimerplusouvertementquelorsd’unquestionnaire.
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
144 145
Mardi 11 marsJ’airendez-vouscematinavecMonsieurleConsuld’Espagne.Après
un moment d’attente il me rencontre et me parle de la communauté espagnole du Grand Agadir. Je continue ensuite la journée avec deux entretiens auprès de personnes abordées dans la rue ou en terrasse de café. Ceci m’est facilité par le fait que certains cafés sont tout particulièrement appréciésparlesEuropéens.Jeprendségalementdenouveauxcontacts,notamment auprès d’une agence de voyages tenue par des Anglais.
Mercredi 12 marsJe me rends dans le centre-ville pour rencontrer deux expatriés
Français qui ont vécu toute leur jeunesse au Maroc. Cet entretien fut très enrichissant, j’ai ainsi pu mieux imaginer comment était la ville d’Agadir avant le tremblement de terre. A l’heure actuelle, seules quelques maisons existent encore. La vie dans le quartier de Talborjt semblait animée et empreinte de tolérance.
Le midi je suis invitée chez un couple d’expatriés interviewés lasemaine dernière. Ceci n’est pas un entretien, mais je reste à l’écoute, et les conversationséveillentenmoidenouvellesquestionsetautresréflexions.
Jeudi 13 marsAprès une heure et demie d’entretien avec un expatrié Suédois, je me
rends dans le quartier de la Cité Suisse. Je ne m’étonne plus du nom quand j’aperçois les immenses villas, toutes plus imposantes les unes que les autres. Les portiques sécurisés dominent les trottoirs et les petits cabanons desgardiens.EndéambulantdanslequartierdeTalborjt,j’interpelleuneretraitéeafindeluiproposerdefaireunentretien.D’abordsurladéfensive,ellefinitparaccepteretm’invitemêmeaurestaurant.Lesdeuxrencontresdecejeudimeconfirmentlapossibilitéd’établirunetypologieparmilesexpatriés européens. Certains mènent une vie d’expatrié très différente de d’autres. La fréquentation des différents quartiers et lieux appréciés varie selon ce facteur. Mais ils se retrouvent généralement entre eux, en accord avec leurs convictions et leur mode de vie.
Vendredi 14 marsJ’ai rendez-vous avec une native d’Agadir revenue après avoir fait
sesétudesenFrance.Ellemeparledumaldupays,etdeladifficultédes’adapteràlaviefrançaisequandonestnéfrançaisauMaroc.Elleévoquenotammentladifficultédetrouversapropreidentitéquandonestàchevalentre deux pays. Cette rencontre très intéressante a précédée un entretien avec deux retraités résidant à Agadir pendant 6 mois tous les ans.
Lundi 17 marsCe matin j’avance pas mal dans la lecture d’articles universitaires et
d’un mémoire de sociologie à propos des Français installés au Maroc. Aucun entretien n’est prévu pour aujourd’hui, je relance donc certains contacts par téléphone. Puis je me rends au quartier Hay Mohammadi, je suis curieuse de voir à quoi il ressemble de près. Une fois encore je suis surprise de la façon dont sont réalisés les projets d’aménagement et d’extension de la commune. Ce quartier est très étendu, mais la moitié est inachevée. Le plus surprenant repose dans le fait qu’un appartement sur deux est encore en construction. Les grandes artères sont bordées par des petites allées perpendiculaires rappelant un ancien terrain vague. De tempsàautreungroupementd’immeublesflambantneufs sedistingue.Il me rappelle le type d’habitat que l’on peut trouver dans les brochures d’annonces pour future résidence : des petites allées verdoyantes et agréables où rien ne dépasse. Dans le reste des rues il y a de l’animation et je croise pas mal de monde. Mais cela me fait une étrange impression en pensant à tous ces gens qui vivent dans un quartier encore complètement en chantier.
Mardi 18 marsJepars tôtafind’allervoir leportdepêchedont je saisêtre leplus
grand port sardinier du Maroc. Je repense à une Française exportatrice de poissonquej’airencontréequelquessemainesauparavant.Ellemedisaitcombienilavaitétédifficileaudébutdefairesaplacedansledomainedelapêche, qui est essentiellement un monde d’hommes. A l’entrée du port il y a un contrôle par les douanes. Je pense que c’est également pour empêcher des personnes de monter clandestinement sur les bateaux dans l’espoir demigrervers l’Europe.Jenecroiseeffectivementquedeshommesautravail. Le port fourmille de partout, entre la réparation de bateaux, la criée, les déchargements des caisses de poissons etc. Je m’étonne à voir ce très grand nombre de bateaux de pêche. La plupart sont bien rouillés, témoignant ainsi de leur long vécu en mer. Un Marocain me désigne du doigt les plus gros d’entre eux et m’explique que ce sont des bateaux qui passent trois mois en mer. Je réalise la dureté de la vie des marins, et le probable manque d’hygiène à bord de ces embarcations plus que rouillées.
Enrepartant jeprendsplaisiràobserver le réveilde lavilledans lesecteur touristique. Le long de la promenade de bord de mer, les touristes se mélangent aux résidents européens et aux marocains. Certains courent, d’autresmarchentouprennentletempsdeflâneràlaterrassed’uncafé.Jeme rends à la Chambre du commerce et de l’industrie. Je suis bien reçue, maisilspossèdentpeud’informationsconcernantlesEuropéens.Jepoursuismes démarches au Centre régional d’investissement situé dans la Cité du Founty. Je ressors malheureusement bredouille, car c’est seulement depuis une réforme administrative datant de quelques mois qu’ils différencient les
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
146 147
investissementsfaitsparlesEuropéens,lesMarocainsàl’étranger,oulesMarocains locaux.
Comme je suis dans le coin je retourne au supermarché Marjane. La route n’est pas des plus agréable car ce quartier est lui aussi en pleine expansion. Quelques hôtels semblent avoir poussé au beau milieu des terrainsvagues.Enregardantdeplusprès,j’aperçoisleslonguesbanderolespublicitaires annonçant très prochainement la construction d’Agadir Bay. Par rapport à ma dernière visite il y a beaucoup moins de camping-cars sur leparking.Celaannoncelafindel’hiveretleretourenEurope.Ilestvraique plusieurs personnes rencontrées la semaine dernière m’avouaient avec regretqu’ilsseraientbientôtsurlecheminduretour.Enrentrantdanslesupermarché, je réalise combien la clientèle est aux trois quarts occidentale. Je me demande si cela ne se ressent pas dans le chiffre d’affaires entre l’été et l’hiver. Je remarque que l’alcool est présent dans la plupart des caddies. Lors de mes entretiens certains disaient aller à Marjane surtout pour le grand choix de vins. Ce rayon est cependant isolé et caché à une extrémité de la grande surface. Un tel supermarché me rappelle le contraste entre les petits commerces marocains et notre société occidentale envahie par les grandes surfaces.
Jeudi 20 marsCematinjerencontredesmembresdeTerredesEnfants.J’enapprends
ainsi plus sur cette association qui lutte contre l’analphabétisation en soutenant les enfants issus demilieux défavorisés. Elle aide égalementles jeunes femmes en situation de précarité pour favoriser leur réinsertion sociale. L’une des bénévoles française accepte de fixer un rendez-vouspour un entretien la semaine prochaine.
J’ai ensuite rendez-vous avec un couple de retraités Suédois dans le quartier de Charaf. S’ensuit un très long entretien de plus de deux heures en anglais. Mon enregistreur tombe en panne de piles au beau milieu, c’est vraiment un manque de chance pour un entretien aussi riche. Je suis très heureuse d’avoir rencontré ces gens forts sympathiques. Ils m’ont raconté de nombreuses anecdotes, notamment l’histoire de leur coup de cœur pour le Maroc. Le contact se fait très facilement. Je reste encore une ou deux heures à discuter avec eux suite à l’entretien. Il y a ainsi des jours où je prends beaucoup de plaisir à mener mes entretiens. C’est une occasion de rencontrer des personnes qui ont beaucoup à apporter de par leur expérience et leur savoir. Ce monsieur, ayant travaillé dans le milieu universitaire, est très respectueux de mon travail et fait tout pour m’aider. Je repars donc avec une liste de contacts, qu’ils soient suédois, anglais, français ou allemand. Aprèsavoireudenombreusesdifficultésàtrouverdesentretiensjusqu’ici,me voici par le hasard des rencontres avec un programme qui s’annonce bien chargé pour ma dernière semaine au Maroc.
Vendredi 21 marsLa ville se réveille assez tard, avant 9h tout est calme. Puis les étals
de fruits et légumes se remplissent abondamment, les premières clientes arrivent, et les rues prennent vie. De nombreuses mobylettes chargées d’une caisse de poisson reviennent du port pour livrer dans toute la ville. Je continue ma route jusqu’à la Résidence Azour de Talborjt. J’ai rendez-vous avec un retraité suédois et un Norvégien. L’échange se fait en anglais car leur français se résume à quelques mots. Cela prend du temps, nous ne nouscomprenonspastoujoursbien.Jepasseensuiteplusieurscoupsdefilafindeprogrammerdesrendez-vouspourlasemaineprochaine.
Samedi 22 marsPourmonavantdernierweek-endauMarocjedécidedepartirvisiter
larégionafindedécouvrirautrechosequelavilled’Agadir.J’emprunteuntaxi Mercedes blanche pour me rendre à Tiznit, puis une Mercedes verte àdestinationdeTafraouteetOumesnat.Leweek-end,lesvoyageurssontmoins nombreux et il me faut attendre deux longues heures pour que le taxi se remplisse. Cette virée dans l’Anti-Atlas marocain est brève, mais je suiscontentededécouvrircesmagnifiquespaysages.Celamedonnel’envie de revenir une autre fois pour faire de plus longues randonnées. Sur la route je remarque de nombreuses constructions en cours dans les villages traversés. On m’explique que ce sont pour la plupart des Berbères de la ville revenus pour construire une maison secondaire ou préparer leur retraite. Le regard entre les voisins incite à avoir la plus grande et belle maison du village. Non sans surprise, nous croisons beaucoup de camping-cars, français, mais aussi allemands. Le camping de Tafraoute est concurrencé par les grands espaces disponibles aux abords de la ville pour le camping sauvage.
Mardi 25 marsCe début de semaine est chargé en entretiens. Hier j’ai pu rencontrer
trois personnes, notamment à la résidence Tifaouine située dans le quartier industriel. Je remarque que certaines résidences comme celles-ci sont particulièrement appréciées par les Européens. Dans l’après-midije rencontre deux Françaises, toutes deux retraitées, l’une d’elle est une ancienne native d’Agadir. Je reçois un mail de Brenda, une doctorante française ayant obtenu mon contact par une personne que j’avais moi-même interviewée.Cela tombe plutôt bien car nos sujets sont trèscomplémentaires.
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
148 149
Mercredi 26 marsAprès une matinée de retranscription d’entretien je retrouve Brenda
dans Talborjt pour le déjeuner. C’est une très bonne occasion pour nous d’échanger sur nos expériences de terrain. Brenda vient juste d’arriver à Agadir pour réaliser une partie de son terrain de thèse portant sur les mobilités internationales de longues durées. Je peux ainsi lui faire part de mes premières impressions et résultats, et lui donner quelques pistes de contact. Je réalise que d’échanger ainsi sur mon terrain me permet en même temps de faire le point et de mettre des mots sur mes différentes observations. Je suis très intéressée par le travail de Brenda qui va approfondir le cas des campings caristes européens, chose que je n’ai pas pu faire faute de temps. Ses résultats m’intéresseront beaucoup. Petit à petit naît le projet d’écrire un article ensemble, permettant ainsi de croiser les résultats de nos deux terrains. Je suis très enthousiaste à cette idée, ce serait une première pour moi, et un enrichissement de nos travaux de recherche.
Je me rends ensuite au café-restaurant Les Blancs situé à la Marina. J’espère pouvoir rencontrer les gérants espagnols, mais un employé m’informequesespatronssontactuellementenEurope.
Vendredi 28 marsPremier vrai jour de pluie au Maroc. Dans cette ville moderne la pluie
medonnel’impressiond’êtreenEurope.Quelluxemonterrainauraété!Un temps chaud et du soleil, l’idéal pour faire des entretiens dans la bonne humeur. Je me rends à Charaf pour rencontrer une Anglaise installée à Agadir depuis plusieurs années. Je suis toujours étonnée de ces quelques personnesquim’ontconfiéleurprojetderestertouteleurvieàAgadir.
Samedi 29 mars Pourcedernierweek-endauMarocj’aifaitlepointsurmontravailde
terrain. Même en sept semaines à Agadir, j’ai le sentiment de ne pas avoir pu faire tout ce que je voulais pour mon mémoire. J’aurai souhaité me rendreàAouriretTamraghtcardenombreuxEuropéenschoisissentcescommunes pour y séjourner durant l’hiver. Faute de transport et de temps je n’ai également pas pu me rendre à la résidence fermée, l’Orangeraie, spécialement conçue pour les Français, située à mi-chemin entre Agadir et Taroudant. Je fais part de tout cela à Brenda qui pourra me faire un retour de son terrain sur ces mêmes lieux. Je suis contente du nombre d’entretiens que j’ai pu effectuer. Mais une limite se pose par rapport à la représentativité desnationalitéseuropéennesdespersonnesinterviewées.Jen’aieneffetrencontré aucuns Espagnols à l’exception de Monsieur le Consul. Jepense que cela est révélateur d’une différence de mode de vie et de cercle de relations. Excepté les tenants d’un commerce, parmi les Européens
rencontrés,personneneconnaîtetnefréquentedesEspagnols.Ilsétaienttous surpris en apprenant qu’environ 400 d’entre eux vivent dans le Grand Agadir. J’ai fait l’erreur de réaliser ceci trop tard. Si j’avais quelques jours deplus jecontacteraidessociétésEspagnoles,principalementprésentesdans le domainede la pêche et de l’agriculture, afinde confronter leurmodedevieàceluidesautresEuropéens.
Après un dernier tour au souk El Had je retrouve une Françaisetravaillant dans une agence immobilière. Celame permet de confirmerles observations que j’avais faites sur les quartiers privilégiés par les Européens.
Dimanche 30 marsJe fais mon trentième entretien ce matin, j’ai atteint l’objectif que je
m’étaisfixé.Enfind’après-midiHamidmefaitsavoirqueMonsieurCharefsouhaite me rencontrer. Je me rends ainsi à la Commission régionale des droits de l’Homme. Nous faisons un petit bilan, en présence de trois de ses collègues.
Lundi 31 marsJequitteAgadirsanstropréaliserquemontravaildeterrainprendfin.
Mon transit à l’aéroport de Casablanca me donne le sentiment de revenir sept semaines en arrière. La même musique est diffusée en continue sur les haut-parleurs.Cettefois-ci,lafiled’attentepourlecheck-inregroupedesvoyageurs de nombreuses nationalités différentes. Marocains, Français, Anglais, mais aussi pas mal de personnes venant de Guinée-Bissau, dont je distingue la nationalité sur leur passeport vert. Nous passons par plusieurs contrôles d’identité, beaucoup plus que pour mon voyage aller. Une plus grande sévérité du contrôle est exercée sur les habitants de Guinée-Bissau. Cela dure plus longtemps, et il leur est demandé de regarder droit dans les yeux de l’agent de sécurité. De mon côté, c’est à peine si la photo demonpasseportestvérifiée.Celamedonnelesentimentd’unegrandeinjustice. J’imagine ce que doivent ressentir ces personnes qui sont toutes suspectées, et rabaissées dans leur amour-propre.
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
150 151
Grille d’entretien semi-directif
- Lieu de l’entretien :chezlespersonnesinterviewées(noterlequartier+ observer le logement : situation, si aménagé dans un style marocain ou à l’occidentale) ou dans un autre lieu de leur choix.
- Durée annoncée : une vingtaine de minutes- Contact : demander adresse mail ou téléphone (pour recontacter si
besoin, et envoyer les résultats de l’enquête). - Echantillon : Méthode non probabiliste de l’échantillonnage par «bouledeneige».Différentsréseauxsontabordésafindediversifierles profils des personnes enquêtées. Les destinataires sont lesEuropéensrésidantplusdetroismoisàAgadir.
I - Profil : -Nationalité?- Age / Tranche d’âge-Enfantsàcharge?Sioui,quelâge.Habitent-ilsàAgadir?-Etes-vous : marié, divorcé, en concubinage, en cohabitation, célibataire, veuf?Quelleestl’originedevotreconjoint(e)?-CSP(siretraité,quelleprofessionavant?)
Remarques-SiemployéàAgadir,évoquerlesmesuresdel’ANAPEC(celaa-t-ilposéunecontraintepourtrouveruntravail?).
-Siretraité,commentvousestverséevotreretraite?(suruncomptemarocainoueuropéen?)
II - Parcours, vécu, motivations :
Racontez-moi votre venue ici, et comment vous avez choisi Agadir ? -Depuiscombiendetempsrésidez-vousàAgadir?-Avantcettedate,avez-vousdéjàvécuàl’étranger?-QuellesontétévosmotivationspourvenirauMaroc?(ConnaissanceduMaroc ou d’un pays duMaghreb auparavant ?Avez-vous unmembredelafamilleouunamiàAgadir?)
-Pourquoiavez-vousprivilégiéAgadiràuneautrevillemarocaine?-Commentavez-vousentenduparlerd’Agadir?- Pensez-vous que la présence importante d’expatriés européens à Agadiraitinfluencéevotrechoix?
Annexe 3
Parlez-moi de vos projets, de retours ou d’installation ? -Quelleest lafréquencedevosretoursdansvotrepaysd’origine?(Raisons?)
-Avez-vousleprojetdequitterAgadirdanslesprochainesannées?(Pouralleroù?)
- Vos enfants viennent-ils à Agadir, ou retournez-vous dans votre pays d’originepourvoirvosenfants?
III - Statut / Situation :
Quelle est votre situation actuelle au Maroc ? -Possédez-vousunecartederésidents?Etes-vousinscritauConsulat?- Pouvez-vous me décrire votre « parcours résidentiel » au sein d’Agadir ? (changement de résidence, de quartier etc.) Etes-vouspropriétaireoulocataire?
-Possédez-vousunrevenu(autrequelesalaireoularetraite)?(Chambred’hôte, location etc., ou investissement / création d’entreprise).
-Employez-vous une personne en tant que personne d’entretien,cuisinier, jardinier, chauffeur etc. ? (Est-ellemarocaine ?) Si oui,pensez-vous que vous auriez pu employer ces personnes si vous n’habitiezpasauMaroc?
IV - Mode de vie / pratiques spatiales quotidiennes :
Que pensez-vous de votre quartier ? - Des motivations particulières vous ont-elles poussés à habiter dans ce quartier?(êtredansunquartierhabitésparbeaucoupd’expatriés,ouàl’inverseunquartieravecuneimportantepopulationmarocaine?Volontédemixité?Proximitéducentre,oudulycéefrançais,delameretc.?)
Pouvez-vous me parler de vos habitudes dans la ville, de vos déplacements, et des lieux que vous fréquentez ?
-Commentvousdéplacez-vousdanslaville?(pourfairedescourses,aller voir des amis, travailler etc.)
-Quels lieuxavez-vous l’habitudedefréquenterdans laville?(lessupermarchés,lespetitscommercesetc.?)
- Participez-vous à des évènements organisés par des associations d’expatriés (ex : UFE) ou des établissements culturels en lienavecvotrepaysd’origine(ex:Institutfrançais)?Sioui,dansquelbut?(unlienaveclepaysd’origine,permetderencontrerd’autresexpatriésetc.?)
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
152 153
V - Perception :
Que pensez-vous de votre mode de vie à Agadir ? - Selon vous, quels sont les aspects positifs de votre vie à Agadir, et quellessontlescontraintesetlimites?
-Vous sentez-vous intégrédans la ville ? (Auprès de la populationlocalemarocaine,auseindesautresexpatriés?Parlez-vousarabe?)
-Avez-vousparfoislesentimentd’êtreisolé?Pourquoi?(différenceculturelle, religieuse etc.)
- Quel sentiment pensez-vous que les marocains ont vis-à-vis de vous?
Comment percevez-vous la présence de nombreux Européens à Agadir ? -Pensez-vousquelaprésencedebeaucoupd’EuropéensàAgadirestfavorableaudéveloppementlocal?Pourquoi?
-Al’inverse,pensez-vousquecegrandnombred’EuropéensvivantàAgadirpuisseprésenterunecontrainte/limite?Pourquoi?
Pouvez-vous me dire, selon vous, comment vous vous définissez ? -Comment vous définissez-vous en tant qu’Européens vivant auMaroc?(expatrié,immigré,étranger,résidant,Gadiri,touristeetc.)
- Le fait d’être au Maroc, vous incite-t-il à vous rattacher à un sentimentcommund’identité/d’appartenanceàunemêmeorigine?(Pays,Europe,Occidentetc.)
Profil des personnes interviewées
1. Sylvie : Française. 53 ans. Séparée. Active (Chef d’entreprise au Maroc). Résidente à l’année depuis 5 ans. Quartier Les Amicales (Propriétaire). Voyageur solitaire.22
2. Yannick : Français. 43 ans. Célibataire. Actif (travail à son domicile). Résident à l’année depuis 5 mois. Quartier Charaf (Locataire). Voyageur solitaire.
3. René : Français. La soixantaine. Marié. Retraité. Winter bird de décembre à mars. Camping d’Agadir (logement en camping-car). Retraité en camping-car.
Jean-Claude : Français. La soixantaine. Marié. Retraité. Winter bird de octobre à mars. Camping d’Agadir (logement en camping-car). Retraité en camping-car.
Gaston : Français. La soixantaine. Séparé. Retraité. Winter bird de novembre à mars/avril. Camping d’Agadir (logement en camping-car). Retraité en camping-car.
4. Jean-Pierre : Français. 70 ans. Marié. Retraité. Résident à l’année depuis 2006. Quartier Ryad Salaam (Propriétaire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
5. Catherine : Française. 60 ans. Divorcée. Retraitée. Résidente à l’année depuis 1 ans.QuartierHayMohammadi (Locataire). « Entrepreneurmotivée ».
6. Elise : Française. 65 ans. Concubinage. Active (co-gérante d’une boutique de produits français à Agadir). Résidente à l’année depuis 2007.QuartierCitéSuisse(Locataire).«Entrepreneurmotivée».
7. Michelle : Française. 85 ans. Mariée. Retraitée. Winter bird tous les ans depuis 21 ans. Quartier Taddart (Locataire). « Retraitée en forme fauchée ».
8. Carine : Française. 47 ans. Mariée (une enfant scolarisée au Maroc). Active (Gérante d’une société d’import/export et d’une poissonnerie). Résidente à l’année depuis 2009. Quartier Charaf. « Entrepreneurmotivée ».
9. Anne et Paul : Belges. 62 ans et la soixantaine. Mariés. Retraités. Bi-résidents depuis 8 ans. Quartier Charaf (Propriétaires). « Retraités en forme au repos bien mérité ».
22. Numéro de l’entretien. Nom : nationalité, âge, statut conjugal (et enfants si au Maroc), activité principale, durée de résidence, quartier actuel de résidence, classement typologique.
Annexe 4
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
154 155
10. Pascal : Français. 57 ans. Marié. Retraité. Résident à l’année depuis janvier. Quartier Centre-ville (Locataire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
11. Eric : Français. La soixantaine. Concubinage. Actif (Gérant d’une résidence touristique). Résident à l’année depuis plus de 10 ans. Secteur touristique (Propriétaire). Ancien gadiri.
12. Loïc : Français. La quarantaine. Concubinage (deux enfants scolarisés à Agadir). Actif (Gérant d’un magasin de soin de beauté avec sa compagne). Résident à l’année depuis 6 ans. Quartier Centre-ville. Couple interculturel.
13. Hervé : Français. 74 ans. Marié. Retraité. Résident à l’année depuis 3 ans (Auparavant à Casablanca pendant 4 ans). Quartier Charaf (Propriétaire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
Philippe : Français. 66 ans. Marié. Retraité. Bi-résident depuis 2010. Quartier Ihchach (Propriétaire). Famille interculturelle.
14. Nathalie et François : Français. 67 et 72 ans. Mariés. Retraités. Résidents à l’année depuis 2008. Quartier Dakhla (Propriétaires). Anciens gadiris.
15. Boris : Suédois. 75 ans. Marié. Retraité. Bi-résident depuis 1990 (au début deux mois par an, aujourd’hui entre 6 et 8 mois). Quartier Charaf (Propriétaire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
16. Monique : Française. 53 ans. Célibataire. Retraitée. Bi-résidente (alternance de 3 mois en France et 3 mois au Maroc). Quartier des Banques (Locataire). « Retraitée en forme au repos bien mérité ».
17. Marie : Française. 65 ans. Mariée. Retraitée. Résidente à l’année depuis 1977. Quartier Centre-ville. Anciens gadiris.
18. Yves et Gisèle : Français. La soixantaine. Mariés. Retraités. Winter bird depuis 2000. Commune de Tamraght (Locataires). « Retraités en forme au repos bien mérité ».
19. Jens et Ada : Suédois. 70 ans. Mariés. Retraités. Bi-résidents depuis 2001. Quartier Charaf (Propriétaires). « Retraités en forme au repos bien mérité ».
20. Peter : Suédois. 85 ans. Veuf. Retraité. Winter bird depuis 11 ans. Quartier Talborjt (Locataire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
21. Bror : Norvégien. 74 ans. Célibataire. Retraité. Winter bird depuis 1998. Quartier Talborjt (Locataire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
22. Bengt : Suédois. 68 ans. Marié. Retraité. Bi-résident depuis 4 ans. Quartier Industriel (Propriétaire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
23. Jack : Français. 75 ans. Séparé. Retraité. Bi-résident depuis 5 ans. Quartier Industriel (Propriétaire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
24. Torsten : Suédois. 71 ans. Marié. Retraité. Winter bird depuis 1989. Quartier des banques (Locataire). « Retraité en forme au repos bien mérité ».
25. Louise : Française. 67 ans. Divorcée. Retraitée. Résidente à l’année depuis 2009. Quartier Ihchach (Propriétaire). « Retraitée en forme au repos bien mérité ».
26. Jean et Lucie : Français. 39 ans. Mariés. Retraités. Bi-résidents depuis 2005. Quartier Centre-ville (Propriétaires). Anciens gadiris.
27. Edith : Allemande. 36 ans. Divorcée. Active (Gérante d’un restaurant). Résidente à l’année depuis 17 ans. Quartier Talborjt. Couple interculturel.
28. Carlynn : Anglaise. 57 ans. Célibataire. Retraitée. Résidente à l’année depuis 2006. Quartier Charaf (Propriétaire). « Retraitée en forme fauchée ».
29. Laura : Française. 30 ans. Célibataire. Active (Agent immobilier). Résidenteàl’annéedepuis2004.QuartierCentre-ville.«Entrepreneurmotivée ».
30. Duncan : Anglais. 49 ans. Pacsé. Actuellement retraité, mais à la recherche d’un nouvel emploi. Résident à l’année depuis 2007. Quartier Charaf (Propriétaire). Travailleur expatrié.
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
156 157
Annexe 5
AnnexesLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
158 159
Extrait d’un article du Journal Hebdo sur la prostitution à Agadir
Alami, Y., A. Rahmouni, Y. Zizi, N. Hachimi Alaoui, A. D’haeyer, and F. Iraqi, 2005: Lejournal-hebdon°196.http://web.archive.org/web/20050225083558/http://www.lejournal-hebdo.com/article.php3?id_article=3363(AccessedJuly10,2014).
Un plaisir nommé Agadir
A Agadir, pour les tarifs, c’est à la tête du client, comme pour bon nombre de commerces. Si le touriste rougeaud ne doit pas s’étonner de payer le prix de nuit en plein jour pour le taxi, il ne s’inquiètera pas plus de débourser le double du tarif habituel pour une passe. De toute façon, ici, les meilleurs clients paient en pétrodollars, pas en euros...
« Les plus chères, ce sont les filles du Mac-Do », assure Hicham, tenancier d’hôtel. Le lieu est stratégique : c’est juste en face de l’hôtel Sahara où débarquent les types du Golfe. « À partir d’une certaine heure, quand les familles sont parties, les filles commencent à débarquer dans le fast-food. Ce sont les plus jeunes, les plus belles et elles se négocient autour de 1000 dirhams la nuit », poursuit notre connaisseur.
Amin, chauffeur de car, assure que certains crachent parfois jusqu’à 4000 Dh pour quelques heures de plaisir... Vers 23h, justement, les taxis déposent les premières donzelles. Bottes à talons hauts, jeans moulants et maquillage outrageux, elles viennent juste siroter un cola à la paille en attendant le chaland... Devant la porte, le mac de ces demoiselles joue du portable pour arranger les rendez-vous galants.
Louer les chambres au 1/4 h
Les filles de la nuit ne font pas que remplir les poches des macs. Les taxis jouent à l’occasion les entremetteurs. « Comme ils conduisent les filles des boîtes aux hôtels et des hôtels aux boîtes, ils connaissent leurs numéros. Pour les filles, c’est plus sûr de garder le même taxi pour les courses de nuit. Elles ont donc un tarif spécial : que le compteur indique 10 ou 20 balles, elles en paient 50 », poursuit Hicham. Quant aux gardiens dans les hôtels, ce commerce arrondit joliment leurs fins de mois : « Un de mes amis, gardien de nuit, s’est fait pincer récemment par son patron. En moyenne, il se faisait 1000 dirhams de plus par nuit en louant des chambres au quart d’heure ou à la demi-heure ». Sans compter que les filles viennent d’autres régions, de Casa ou de Rabat et qu’elles prennent des chambres, bien souvent au mois, dans des petits hôtels qu’elles n’occupent
Annexe 6qu’occasionnellement en journée. Et pour les fauchés ? « Il y a le coin de la gare des grands taxis. Là, c’est 100 Dh la passe, mais tu te fais chaque fois avoir parce qu’elles veulent manger avant. Donc, tu dois d’abord leur payer un poulet-frites à 20 Dh avant de les emmener... », commente un habitué des lieux.
Talborjt, centre névralgique
La prostitution masculine est plus difficile à cerner. Elle se concentre du côté du quartier Talborjt,de la rue Hassan II et de la place de l’Espérance. Là,des jeunes hommes attendent assis sur des bancs, jambes écartées, regard baissé.
Le client lambda est quinqua, voire plus, français ou allemand. Il scrute, fait son tour avant de se décider. Prix de la passe ? Difficile à savoir. Probablement autour de 200 Dh. Mais le commerce parallèle profite moins : « Ils ont plus de facilités que les filles parce qu’ils ont leur appart. Certains clients viennent aussi avec leur caravane, ça évite de passer par l’hôtel, toujours risqué », poursuit Hicham. À la morte-saison, on ne compte plus ces couples improbables, essayant de trouver un sujet de conversation entre la salade et le tagine... Sur la plage désertée, un quadra maniéré joue au foot avec un ado pas trop à l’aise, fuyant les regards des passants. Combien a-t-il payé pour quelques passes de ballon ? »
Table des maTièresLe Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
160 161
Table des matières
Introduction ................................................................................................................................................................................................................. 7
Chapitre I - Les Européens au Maroc : démarche et concepts du mémoire .. 11
1. Méthodologie ............................................................................................................................................................................................................ 121.1 Population étudiée .............................................................................................................................................................................. 131.2 Observation ................................................................................................................................................................................................. 141.3Entretiensindividuels .................................................................................................................................................................... 151.4 Méthodes employées pour répondre à chaque question de recherche ................................ 171.5 Bilan critique de la méthodologie adoptée et retour sur le terrain ........................................ 19
2. Concepts et choix des termes ................................................................................................................................................................ 212.1 La migration, un concept majeur en géographie ........................................................................................ 212.2 Le territoire, un concept polysémique très discuté ................................................................................... 222.3Expatrié,immigréoumigrant:quellesdistinctions? .......................................................................... 24
3. Lifestyle migration .............................................................................................................................................................................................. 263.1 Une migration privilégiée en quête d’un meilleur mode de vie ............................................... 263.2 Des recherches centrées sur le migrant et sa mobilité au sein de son cycle de vie 273.3 Un type de migration encouragé par les pays d’accueil ..................................................................... 293.4Unconceptsubjectifdésignantdenombreuxprofilsdemigrants ......................................... 30
4.LesEuropéensauMaroc:cadragestatistique,juridiqueetlittéraire ................................................ 324.1 Particularités européennes de la population étrangère au Maroc ........................................... 324.2EtreeuropéenauMaroc:Réglementationsetcadrejuridique .................................................. 364.3UnelittératurescientifiqueaxéesurlesEuropéensdanslesmédinas .............................. 38
Chapitre II - Un essai typologique des Européens résidant dans le Grand Agadir ................................................................................................................................................................................... 43
1.Entretourismeetrésidence,unterritoireauxparticularitésbienencrées .................................... 441.1Agadir,desacréationàaujourd’hui:unevillemoderneetdiversifiée .......................... 441.2 Lieux de tourisme balnéaire et de migrations saisonnières, Agadir et Taghazout
commedestinationspharesdesEuropéens ........................................................................................................ 472. Les raisons de migrer : un facteur typologique essentiel ................................................................................... 49
2.1QuellesmotivationspourunprojetdemigrationauMaroc? ...................................................... 492.2LeGrandAgadir:unchoixdedestinationbiendéfini ........................................................................ 562.3 Des motivations de départ semblables à celles des lifestyle migrations ........................ 59
3.Deladiversitédesmigrantsàl’établissementdehuitprofilstypologiques .............................. 623.1 Une typologie établie selon six facteurs ................................................................................................................. 623.2 Le statut des migrants, entre carte de résident et inscription au Consulat ................... 643.3Partir,rester,seprojeter:quellesduréesdeséjoursdesmigrantsauMaroc?........ 663.4 Classement typologique des migrants européens dans le Grand Agadir ....................... 70
4. Des migrations à l’origine de tensions socio-spatiales sur le territoire ............................................ 774.1 Des migrants encourageant le développement du marché touristique informel .. 774.2 Des tensions socio-culturelles liées aux mariages mixtes intergénérationnels
et à la prostitution ............................................................................................................................................................................... 784.3 Des tensions spatiales dues aux vagues hivernales de camping-cars ................................ 80
Chapitre III - Une relation plurielle à l’espace urbain d’Agadir, de la perception des migrants à leur traduction socio-spatiale sur le territoire ............................................... 85
1.LarelationdesEuropéensavecl’espaceurbaind’Agadir:entreparcoursrésidentiel et lieux de vie quotidienne ........................................................................................................................................................................ 86
1.1 Le parcours résidentiel des migrants .......................................................................................................................... 861.2 Les lieux de vie quotidienne : des espaces de loisirs et de convivialité ......................... 91
2.LaperceptionetsocialisationdesEuropéensàproposdeleurmigrationàAgadir ......... 1002.1QuelleperceptionlesEuropéensont-ilsdeleurpropremigration? ............................................... 1002.2 Le sentiment des migrants concernant le regard que les Marocains
portent sur leur venue .................................................................................................................................................................... 1022.3 La formation de groupes distincts au sein de la communauté européenne :
entre isolement et recherche d’une vie sociale avec les autres migrants ...................... 103
3. Une migration dans un pays culturellement très différent : adaptation, attachement, etdéfinitiondesoi ............................................................................................................................................................................................... 107
3.1Intégrationouadaptation,quelstatutpourlesétrangerseuropéens? .............................. 1073.2 Perception et ressenti des migrants concernant leur adaptation
à un nouveau mode de vie ....................................................................................................................................................... 1093.3Desdéfinitionspersonnellesdesmigrants,àleurattachementpourleurculture
et leur pays d’origine .................................................................................................................................................................... 114
Conclusion ...................................................................................................................................................................................................................... 119
Bibliographie .................................................................................................................................................................................................................... 127Sitographie ........................................................................................................................................................................................................................... 131
Table des annexes ....................................................................................................................................................................................................... 133Annexe 1 : Tableau synoptique ..................................................................................................................................................... 134Annexe 2 : Journal de bord ................................................................................................................................................................ 136Annexe 3 : Grille d’entretien semi directif .................................................................................................................... 150Annexe 4 : Profildespersonnesinterviewées............................................................................................................ 153Annexe5:Extraitdubulletinofficieln°5831 ............................................................................................................ 156Annexe 6 : Extraitd’unarticleduJournalHebdosurlaprostitutionàAgadir ................ 158
Table des illustrations ............................................................................................................................................................................................ 162
Table des illusTraTions
163
Le Grand Agadir comme lieu de résidence pour les migrants européens au Maroc
162
Table des illustrations
Cartes
Carte 1 : Le Grand Agadir. Réalisation:LachaudE.,2014 ................................................................................ 12Carte 2 : Répartition des Français par province et préfecture. ExtraitdelaDirectiondelaStatistique,2009 ............................................................................................... 33Carte3: RépartitiondesEspagnolsparprovinceetpréfecture. Extrait de la Direction de la Statistique, 2009 .............................................................................................. 35Carte 4 : Agadir-ville : l’habitat sature l’espace. Réalisation : Troin, 2002 .................................. 46Carte 5 : Répartition des Français dans la ville d’Agadir par quartier de résidence en 2011. RéalisationLachaudE.,2014,d’après Ouddir S., 2014 ......... 87Carte 6 : Principaux lieux de vie quotidienne fréquentés par les résidents européens dans la ville d’Agadir. Réalisation:LachaudE.,2014 .................................. 92
Figures
Figure 1 : La répartition des étrangers (15 ans et plus) selon le type d’activité et le groupe de nationalités. ExtraitdelaDirectiondelaStatistique,2009 ............ 34Figure 2 : La retraite des Français au soleil. Source : David, 2013 ......................................................... 53Figure 3 : Classement typologique des migrants européens résidant dans le Grand Agadir. Réalisation:LachaudE.,2014 ................................................................... 70Figure4: Synthèsedesdéfinitionspersonnellesdesmigrants: Commentsedéfinissent-ils?Réalisation:LachaudE.,2014 .............................................. 115
Tableaux
Tableau 1 : Tableau de synthèse des entretiens semi-dirigés. Réalisation:LachaudE.,2014 ..................................................................................................................................... 17Tableau2: TypologiedesEuropéensinstallésdanslesmédinasdeMarrakech etEssaouira. Réalisation:LachaudE.,2014 ............................................................................................. 41Tableau3: Catégoriesd’analysedesEuropéensinstallésdanslamédinadeFès. Réalisation:LachaudE.,2014 ..................................................................................................................................... 41Tableau 4 : La construction d’une destination en opposition au pays d’origine. Réalisation:LachaudE.,2014 ................................................................................................................................... 60Tableau 5 : Tableau récapitulatif des six facteurs typologiques. Réalisation:LachaudE.,2014 ..................................................................................................................................... 62
Photographies
Photo 1 : Taghazout, lieu d’attraction des surfeurs et camping-caristes. Cliché:LachaudE.,mars2014 ................................................................................................................ 48
Photo 2 : Le port de la Marina. Cliché:LachaudE.,février2014 ........................................... 57Photos3et4: Deuxtypesd’habitatsprivilégiésparlesrésidentsEuropéens.
Quartier Les amicales, et la résidence Tifaouine. Cliché:LachaudE.,mars2014 ............................................................................................................... 63
Photo 5 : Aéroport Al Massira, des camping-caristes partis dans l’urgence. Cliché:LachaudE.,mars2014 ................................................................................................................. 75
Photos 6 à 10 : Taghazout, un village dont l’économie est organisée autour de la communauté de surfeurs. Clichés:LachaudE.,mars2004 .................. 76
Photo 11 : Panneau d’interdiction rue Mokhtar Soussi. Cliché:LachaudE.,février2014 ............................................................................................................ 80
Photo 12 : Le parking du supermarché Marjane (quartier Founty). Cliché:LachaudE.,février2014 ............................................................................................................ 81
Photo 13 : Un camping improvisé dans le centre d’Agadir : parking de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, Secteur touristique. Cliché:LachaudE.,février2014 ................................................. 82
Photos 14 à 19 : Les quartiers centraux d’Agadir, à proximité de la côte. La photographie de situation a été prise sur les hauteurs, depuis la Kasbah. Clichés:LachaudE.,févrieretmars2014 .............................. 89
Photos 20 à 27 : Les quartiers résidentiels d’Agadir, situés dans l’intérieur des terres. Clichés:LachaudE.,févrieretmars2014 ............................... 89
Photos 28 et 29 : La baie d’Agadir, un espace de promenade et de loisirs sur la plage. Clichés:LachaudE.,février2014 .................................................................... 93
Photos 30 et 31 : Deux bars et restaurants très fréquentés par les résidents européens. Clichés:LachaudE.,mars2014 ............................ 94
Photos 32 à 34 : La place près du Marché de Talborjt, un lieu de regroupement pour les résidents européens. Cliché:LachaudE.,mars2014 .......................... 96
Photos35et36: LesoukElHadetlesdeuxsupermarchésdeTalborjt. Clichés:LachaudE.,mars2014 .............................................................................................................. 97
Photos37et38: DescommercestenuspardesrésidentsEuropéens, dans le quartier de Talborjt et du Centre-ville. Clichés:LachaudE., mars 2014 .............................................................................................................. 98