"Autour de Saint Bernard. Chronologie et implications spatiales du culte des reliques à Clairvaux"
Transcript of "Autour de Saint Bernard. Chronologie et implications spatiales du culte des reliques à Clairvaux"
Cîteaux – Commentarii cistercienses, t. 64, fasc. 1-2 (2013)
AUTOUR DE SAINT BERNARD. CHRONOLOGIE ET IMPLICATIONS SPATIALES
DU CULTE DES RELIQUES à CLAIRVAUX*
Eduardo Carrero Santamaría
L’abbaye de Clairvaux, et particulièrement son église, représente un ensemble crucial pour l’histoire de l’architecture cistercienne médiévale. Parmi les églises abbatiales construites et transformées entre la fondation en 1115 et la destruction au xviiie siècle, nous nous intéresserons ici au chevet absidal semi-circulaire avec déambulatoire et neuf chapelles rayonnantes érigé au milieu du xiie siècle à l’em-placement d’un chevet plus ancien dont la forme est inconnue. Certains auteurs appellent ce nouveau chevet Clairvaux III et le distinguent de l’église Clairvaux II dont la nef et le transept coexistèrent toutefois avec le nouveau chevet1. Dans l’axe du sanctuaire, entre les colonnes de l’abside et le déambulatoire, se trouvaient deux reliquaires consacrés respectivement à saint Bernard et à saint Malachie d’Armagh, et un troisième contenant les restes des martyrs Eutrope, Zosyme et Bonose, d’un autre martyr non identifié à cette époque, des vierges Ubalde, Christance, Pétro-nille et Domitille, les crânes de deux saints inconnus, et les reliques de plusieurs autres saints (fig. 1). L’aménagement liturgique situé dans le prolongement de la chapelle axiale accordait une place d’honneur à Malachie, le grand ami et inspira-teur de Bernard, dont le corps avait été transféré depuis le lieu où il avait été inhumé en 1148 dans l’église antérieure, Clairvaux II2. Les reliques des martyrs furent ramenées d’Italie vers 1226 par Conrad d’Urach, cardinal de Porto et de Sainte-Rufine. Il demanda lui-même à être enterré près d’elles à sa mort en 12273. Ce fut sans doute seulement à ce moment-là que le troisième reliquaire fut installé. Le transept était également d’un type peu courant car chaque bras possé-dait des chapelles du côté oriental et du côté occidental, multipliant ainsi, avec ceux des chapelles rayonnantes, le nombre d’autels utilisables pour les nombreuses
1 Anselme Dimier, Recueil de plans d’églises cisterciennes (Commission d’histoire de l’ordre de Cîteaux, 1), Grignan-Paris, 1949, pl. 83 et 84. Clairvaux I correspond à l’église en bois érigée par les premiers moines dans le Val d’Absinthe.
2 Chrisogonus WaDDell, « The Two Saint Malachy Offices from Clairvaux », dans Bernard of Clairvaux : Studies presented to Dom Jean Leclercq, éd. M. Basil Pennington, Washington 1973, p. 123-159, en particulier les p. 130-131, et Alexandra gajeWSki, « Burial, Cult, and Construction at the Abbey Church of Clairvaux (Clairvaux III) », Cîteaux – Comm. cist., 56 (2005), p. 47-84.
3 Avant de devenir cardinal, Conrad d’Urach avait été abbé de Villers, de Clairvaux (1214-1217) et de Cîteaux. Falco neininger, Konrad von Urach (+1227) : Zähringer, Zisterzienser, Kardinallegat (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 17), Paderborn 1994. Également : Philippe guignarD, « Lettre à M. le comte de Montalembert sur les reliques de saint Bernard et de saint Malachie, et sur le premier emplacement de Clairvaux », PL, t. 185, cols. 1661-1714 (ici col. 1687).
188 COMMUnICATIOnES
messes privées des moines prêtres. Les Ecclesiastica Officia du xiie siècle prescri-vaient qu’elles devraient être chantées à titre personnel par un prêtre et un acolyte pendant la lecture et après l’offertoire de la messe conventuelle4.
Cet article se propose de reprendre l’analyse de la construction du chevet de Clairvaux III en s’appuyant sur des sources écrites qui n’ont pas encore été exploi-tées par l’histoire de l’art. nous verrons que la chronologie doit être reculée, comme cela avait déjà été indiqué par les voix les plus critiques à l’égard des
4 Danièle ChoiSSelet et Placide vernet, Les ‘Ecclesiastica Officia’ cisterciens du xiie siècle. Texte latin selon les manuscrits édités de Trente 1711, Ljubljana 31 et Dijon 114. Version française, annexe liturgique, notes, index et tables, Reiningue 1989, p. 180-185.
Fig. 1. Reconstitution topographique du chœur de Clairvaux. 1-Reliquaire de Bernard ; 2-Reliquaire des martyrs ; 3-Reliquaire de saint Malachie ; 4-Chapelle arrière et structure de séparation ; 5-Maître-autel dédié à la Vierge.
COMMUnICATIOnES 189
positions traditionnelles. Cette datation plus précoce induit que le chevet à déam-bulatoire n’a pas été construit pour le culte de saint Bernard. Les sources per-mettent également de restituer l’aspect de l’ensemble funéraire et de l’aménage-ment liturgique de la chapelle axiale.
I. État de la questIon et nouvelles sources
En 1990, Terryl Kinder attirait l’attention sur la documentation écrite et icono-graphique relative à Clairvaux III, en partie inédite et peu étudiée5. Depuis, quelques travaux ont commencé à combler cette lacune grâce à de nouvelles approches de la question. Peter Fergusson, Jacques Henriet, Matthias Untermann et Alexandra Gajewski ont relancé, au sujet de l’église de Clairvaux, un débat dépassant les digressions concernant l’adoption du trop fameux « plan bernardin », la répercussion qu’elle eut sur ce modèle et son évolution, ou encore les différents choix architecturaux des abbayes de Cîteaux et de Clairvaux6.
Peter Fergusson a tout d’abord proposé une chronologie des principales phases des travaux de l’abside. Selon lui, ils débutèrent après la mort de Bernard en 1153. La première chapelle du déambulatoire fut consacrée en 1157 et la chapelle axiale en 1166. Une première translation des restes du saint eut lieu vers 1174, puis ceux-ci furent définitivement installés juste derrière le maître-autel en 1178, date qui correspondrait à l’achèvement du chevet. L’aspect de l’ensemble archi-tectural et son organisation liturgique l’ont amené à juger que l’on avait employé pour le chevet de Clairvaux III une architecture de prestige censée rappeler un plan central, dont la symbolique mémorielle et funéraire remontait à l’Antiquité classique. L’utilisation de colonnes doubles entre le chœur et le déambulatoire ainsi que l’emplacement du reliquaire contenant le corps de Bernard étaieraient cette hypothèse7.
La critique la plus importante des dates traditionnelles de Clairvaux III vient de l’interprétation livrée par Matthias Untermann de plusieurs passages des Vitae de Bernard, rapportée à la logique de construction de l’ensemble. Pour lui, les travaux du chevet commencèrent entre 1148 et 1154, cette dernière date étant celle à laquelle on rassembla des fonds pour sa construction. L’augmentation du nombre
5 Terryl n. kinDer, « Les églises médiévales de Clairvaux. Probabilités et fiction », dans Histoire de Clairvaux. Actes du colloque de Bar-sur-Aube et Clairvaux, 22 et 23 juin 1990, Bar-sur-Aube 1991, p. 204-229.
6 Anselme Dimier, « Origine des déambulatoires à chapelles rayonnantes », Bulletin monumental, 115 (1957), p. 23-33, et id., « En marge du centenaire bernardin. L’église de Clairvaux », dans Studi su S. Bernardi di Chiaravalle nell’ottavo centenario della canonizzazione, Rome, 1975, p. 317-325. Du point de vue de la théorie de l’évolution exclusive des formes architecturales : Pierre héliot, « Les déambulatoires dotés de niches rayonnantes », Cahiers de civilisation médiévale, 15 (1961), p. 303-322.
7 Peter FerguSSon, « Programmatic Factors in the East Extension of Clairvaux », Arte medievale, II-VIII/1 (1994), p. 87-101.
190 COMMUnICATIOnES
de moines prêtres avait rendu cette reconstruction nécessaire, et on profita de la monumentalité du lieu à la mort de Bernard pour y placer sa sépulture8.
De son côté, Jacques Henriet a réalisé un important travail d’érudition sur les transformations de l’abbatiale de Clairvaux du xiiie au début du xviiie siècle, lorsque disparut vraisemblablement une grande partie de sa topographie médiévale – comme ce fut le cas par ailleurs dans beaucoup de bâtiments religieux en France9. Henriet n’aborde pas la question de la chronologie de la construction de l’église au xiie siècle et n’utilise d’ailleurs pas la nomenclature Clairvaux II et III.
Enfin, Alexandra Gajewski a insisté sur la singularité du chevet de Clairvaux III, qu’elle qualifie de « non-Cistercian architecture » à cause de sa monumentalité et de son éloignement du plan bernardin10. Dans un second travail fondé sur l’analyse de sources claravalliennes moins utilisées, Gajewski a proposé une restitution de la topographie sacrée de l’église, en attirant l’attention sur la spécificité du culte de saint Malachie, sur les trois reliquaires du chevet – dédiés à Bernard, à Malachie d’Armagh et aux huit martyrs – et sur l’utilisation funéraire de Clairvaux par les membres de la haute aristocratie européenne à partir de ce moment-là, qui marquait une rupture avec la politique d’austérité de l’Ordre en matière de sépultures11.
La découverte récente par Marvin L. Colker d’une copie des Liber altarium et Liber sepulchrorum du monastère, jusque-là perdus, a bouleversé notre connais-sance de l’abbatiale de Clairvaux et en particulier des dates de construction du chevet de Clairvaux III12. Le début du Livre des Autels est sans ambiguïté :
L’année de l’Incarnation du Seigneur de 1157, quatre ans après la mort de notre révérend père Bernard et la cinquième année après le début [des travaux] de l’église, huit autels furent consacrés dans la zone orientale de la dite église, près du maître-autel13.
8 Matthias untermann, Forma Ordinis. Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser, Munich 2001, p. 129-144 et 427.
9 Jacques henriet, « notes sur quelques travaux réalisés à l’abbaye de Clairvaux du xiiie au xviiie siècle », dans Architektur und Monumentalskulptur des 12.-14. Jahrhunderts. Produktion und Rezeption. Festschrift für Peter Kurmann zum 65. Geburtstag / Architecture et sculpture monumentale du 12e au 14 e siècle. Production et réception. Mélanges offerts à Peter Kurmann à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, éd. Stephan gaSSer, Christian Freigang et Bruno Boerner, Berne 2006, p. 17-30.
10 Alexandra gajeWSki, « The Architecture of the Choir at Clairvaux Abbey : Saint Bernard and the Cistercian Principle of Conspicuous Poverty », dans Perspectives for an Architecture of Solitude. Essays on Cistercians, Art and Architecture in Honour of Peter Fergusson, éd. Terryl n. kinDer, Turn-hout 2004, p. 71-80.
11 Alexandra gajeWSki, « Burial, Cult, and Construction… ». Il faut garder à l’esprit les informa-tions sur les sépultures et leurs transformations fournies par Jacques henriet, « notes sur quelques travaux… », voir notes 2 et 9.
12 Marvin L. Colker, « Discovery of a Manuscript of the Liber Altarium and Liber Sepulchrorum of Clairvaux », Scriptorium, 51 (1997), p. 68-76, et Id., « The Liber Altarium and Liber Sepulchrorum of Clairvaux », Sacris Erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity 41 (2002), p. 391-466.
13 Anno ab incarnatione domini millesimo cº lviiº, a transitu uero reuerentissimi patris nostri domni Bernardi anno iiiiº, ab inchoatione autem ecclesie anno quinto, consecrata sunt octo altaria in orien-tali parte eiusdem ecclesie circa maius altare (Colker, « The Liber Altarium and Liber Sepulchro-rum… », ibid., p. 399).
COMMUnICATIOnES 191
La chronologie traditionnelle comportait une information correcte : 1157 fut en effet une année de consécration, mais celle de la consécration de huit des neuf chapelles rayonnantes de l’abside et non d’une seule ; la dernière fut consacrée l’année suivante. Plus important, les travaux avaient débuté plus tôt que ce que l’on pensait, en 1152, c’est-à-dire une année avant la mort de Bernard, une date qui coïncide partiellement avec l’interprétation de Matthias Untermann. Ils avan-cèrent donc rapidement, puisque les autels de l’abside et du transept, qui abritaient des reliques très nombreuses et variées, furent tous consacrés entre 1157 et 116114. La dédicace du maître-autel dut attendre 1174, date qui marque vraisemblablement l’achèvement du chevet. Les autres autels, au nombre de trente dans l’église et dans la sacristie, furent consacrés entre 1174 et 117615. Enfin, la mise en place du tombeau de saint Bernard en 1178 conclut l’aménagement intérieur de l’église16.
II. la chapelle dÉdIÉe à Bernard derrIère le maître-autel de claIrvaux III
Curieusement, jusqu’à la publication des travaux susmentionnés, la disposition liturgique du chœur de l’abbatiale de Clairvaux n’avait pas attiré l’attention des historiens de l’art médiéval. La disparition de tout vestige matériel visible et l’im-possibilité d’en fouiller l’emplacement peuvent contribuer à l’expliquer. Comme l’a signalé Terryl Kinder, le plus surprenant est que la documentation, qui décrivait en détail le sanctuaire de l’abbatiale et ses tombeaux, était en grande partie éditée. Le fameux plan dressé par dom Milley en 1708 (Troyes, Bibl. mun. Carteron I ; BnF, Estampes, Va 10, t. 5), à l’évidence antérieur aux transformations opérées au xviiie siècle sous l’abbatiat de Robert Gassot du Défens (1718-1740), constitue une source majeure (fig. 2)17. Le plan détaillé de l’église représente clairement l’entrecolonnement à doubles bases situé entre l’abside et le déambulatoire, et sur-tout la disposition radiale des trois reliquaires.
En 1517, la reine de Sicile, accompagnée par les comtes de Guise, visita l’ab-baye et le récit de sa visite nous laissa la première description moderne des reli-quaires monumentaux, dont il sera question plus loin18. En 1623, Chrisóstomo Henríquez (1594-1632) fit l’inventaire des mentions épigraphiques funéraires et liturgiques de l’abbatiale en se fondant sur le Liber sepulchrorum susmentionné, une œuvre qui semble remonter aux années 1160 et dont la copie complète en meilleur état, datant du xve siècle, est aujourd’hui conservée à Dublin, reliée avec
14 Ibid., p. 400-410. 15 Colker, « The Liber Altarium and Liber Sepulchrorum… », ibid., p. 410-416. 16 Chrysogonus WaDDell, « Le culte et les reliques de saint Bernard de Clairvaux », dans Saint
Bernard et le monde cistercien, éd. Léon PreSSouyre et Terryl n. kinDer, Paris 1992, p. 141-148, et FerguSSon, « Programmatic Factors in the East Extension… », p. 89-91.
17 kinDer, « Les églises médiévales de Clairvaux… » voir note 1, p. 223-224 ; henriet, « Travaux réalisés à l’abbaye de Clairvaux… », voir note 4, p. 28 et fig. 9.
18 Le texte a été transcrit et publié dans : Henri miChelant et Jules QuiCherat, « Un grand monastère au xvie siècle », Annales Archéologiques 3 (1845), p. 223-239.
192 COMMUnICATIOnES
Fig. 2. Plan de l’église de Clairvaux réalisé par dom Milley en 1708. (Bibliothèque nationale de France)
COMMUnICATIOnES 193
le Liber altarium de l’abbaye19. Au début du xviiie siècle, les moines bénédictins Edmond Martène et Ursin Durand décrivirent Clairvaux à l’occasion du voyage qui leur permit entre 1709 et 1718 de réunir une large collection de sources et d’informations liturgiques dans divers établissements religieux20. nous disposons également des inventaires du xixe siècle relatifs à la dispersion du patrimoine liturgique, artistique et bibliographique du monastère ; ils mentionnent notamment le transfert à la cathédrale de Troyes des bustes reliquaires contenant les crânes de saint Bernard et de saint Malachie21. Ils avaient été réalisés au xive siècle sur l’ordre de l’abbé Jean d’Aizainville (1330-1345) et furent conservés dans la sacristie de Clairvaux jusqu’à la Révolution22. Ces deux reliquaires étaient vrai-semblablement utilisés lors de processions. Leur description dans l’inventaire de la sacristie de 1504, publié par l’archiviste Philippe Guignard, étaye cette hypo-thèse :
…un reliquaire d’argent doré dans lequel repose la tête de notre très saint père, l’abbé saint Bernard, avec un diadème émaillé, à l’arrière duquel se trouvent deux anges d’argent, et à l’avant duquel deux effigies représentent Jean d’Aizainville, abbé de Clairvaux, administrateur de ce reliquaire, et son père, à l’époque duquel il a été réalisé. Il faut aussi noter que la poitrine de ce petit reliquaire est ornée d’un gros saphir de très grand prix, sous lequel se trouve un autre saphir de moindre taille, mais également de grand prix ; et il est supporté par quatre lions en argent doré à l’avant et deux autres à l’arrière23.
On n’a semble-t-il pas envisagé la possibilité que les tombeaux de Bernard, de Malachie et des martyrs n’aient pas été conçus comme des sépultures mais comme de véritables reliquaires. Cela expliquerait pourquoi ils étaient surélevés sur des colonnes et dotés de leur propre autel, comme l’indique le Liber altarium. Au centre se trouvait le monument de marbre dédié à saint Bernard, derrière l’autel de
19 Chrisóstomo henríQuez, « Monumenta sacrae Claraevallensis abbatiae et epitaphia sanctorum et virorum illustrium qui ibidem sepulti sunt », dans PL, t. 185, Paris 1855, cols. 1549-1562. En ce qui concerne le Liber sepulchrorum, Colker, « The Liber Altarium and Liber Sepulchrorum… », voir note 12, avec les notes sur la bibliographie antérieure.
20 Edmond martène et Ursin DuranD, Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la con-grégation de Saint Maur, 2 vols., Paris 1717-1724 (rééd. anast., Farnborough 1969), I, p. 99-105.
21 Philippe guignarD, « Lettre à M. le comte de Montalembert… », voir note 3 ; Charles lalore, Le Trésor de Clairvaux du xiie au xviiie siècle, Troyes, 1875, p. 170-182 ; Id., Reliques des trois tombeaux saints de Clairvaux, de saint Bernard, de saint Malachie, de saint Eutrope et autres martyrs, reconnues et transférées solennellement à Ville-sous-la-Ferté (Aube), Troyes 1877 ; Jules Joseph vernier, « Inven-taire du trésor et de la sacristie de l’abbaye de Clairvaux de 1640 », Bibliothèque de l’École des Chartes 63 (1902), p. 599-677.
22 guignarD, « Lettre à M. le comte de Montalembert… », voir note 3, col. 1664. 23 Ibid. : Vas argenteum et deauratum in quo requiescit caput sanctissimi Patris nostri, beati
Bernardi abbatis, cum diademate esmaltato, habente duos angelos argenteos a parte posteriori, et a parte anteriori duas imagines repraesentantes domnum Johannem de Aizanvilla abbatem Clarevallis, actorem hujus vasis, et patrem ejusdem, cujus tempore hoc vas factum est. Et notandum quod in pectore dicti vasculi continetur unus magnus saphirus valde preciosus, sub quo continetur alius saphirus mino-ris quantitatis, etiam multum preciosus ; et sustentatur a parte anteriori quatuor leonibus argenteis et deauratis, et a parte posteriori duobus similibus.[1]
194 COMMUnICATIOnES
la Vierge – in tabernaculo marmoreo retro altare beate Marie uirginis – d’après la notice de sa canonisation24. Celui des saints Eutrope, Zosyme, Bonose et des autres martyrs se trouvait à sa droite, celui de saint Malachie à sa gauche25.
L’ensemble constitué par les tombeaux et le maître-autel resta en l’état jusqu’au xviie siècle, lorsque l’abbé Claude Largentier (1624-1653) fit blanchir les murs de l’abbatiale et renouvela une partie du mobilier liturgique. L’ampleur des transfor-mations nous échappe, mais elles s’accompagnèrent de la rénovation du maître-autel en 1642, comme l’a montré Jacques Henriet26. Le plan de dom Milley décrit toutefois l’état des lieux en 1708, quelques décennies après cette transformation, et doit donc être utilisé avec précaution en ce qui concerne le sanctuaire. Le maître-autel décrit en 1709 par les liturgistes bénédictins Edmond Martène et Ursin Durand était donc l’autel modifié en 1642, même s’ils célébrèrent la messe avec les calices de saint Bernard et de saint Malachie, exemples d’objets-reliques fré-quemment associés au culte des saints27.
Une source plus ancienne décrit avec précision l’aménagement liturgique de la grande chapelle et aide à résoudre les problèmes d’interprétation posés par le plan de dom Milley. Il s’agit du récit déjà évoqué de la visite à Clairvaux de la reine de Sicile et de sa suite en 151728. D’après ce texte, le maître-autel était occupé par une représentation de la Vierge, paré d’un devant d’autel remarquablement ouvragé et entouré par les quatre colonnes habituelles, surmontées par des anges, entre lesquelles on tendait les draps et les tapisseries qui le protégeaient et le cachaient à certains moments du déroulement de la liturgie. Ces éléments ne figurant plus sur le plan de dom Milley, on peut en déduire qu’ils avaient été retirés lors des transformations de 1642.
En ce qui concerne les autels-reliquaires, la description la plus intéressante se rapporte à celui de Bernard car, comme l’indique le chroniqueur, les deux autres avaient été faits à son image :
24 Colker, « The Liber Altarium and Liber Sepulchrorum… », voir note 12, p. 424. 25 Tria sunt altaria circa maius altare consecrate. Medium enim locum obtinet altare beatissimi
patris nostri Bernardi. Ad dexteram autem eius est altare sanctorum martirum Eutropii, Zozime, et Bonose, et aliorum martirum in tomba eidem contigua contentorum. In alia uero parte est altare sancti Malachie episcopi et confessoris Hybernieque primatis (Colker, « The Liber Altarium and Liber Sepulchrorum… », voir note 12, p. 414-415).
26 henriet, « Travaux réalisés à l’abbaye de Clairvaux… », voir note 4, p. 21. 27 « Le tombeau de Saint Bernard, celui de Saint Malachie & celui de quelques Saints martyrs qui
reposent à Clairvaux, sont derrière le grand autel. On a érigé des autels sur ces tombeaux, & nous eûmes l’honneur d’y dire la sainte Messe avec le calice de saint Bernard & avec celui de saint Malachie. Ils sont tous deux si petits, qu’ils n’ont pas un demi pied de hauteur ; mais la coupe est fort large & peu profonde » (martène et DuranD, Voyage littéraire…, I, p. 99).
28 En icelle église y a trente chappelle ou autel, dont le principal et le plus beau est le grant autel. Sur lequel pose une belle et dévote ymaige de Notre-Dame, et au dessus ung chappiteau bien richement doré avec les bencillons paincts très richement ; ledict ayant de sept à huict piedz de haulteur. La table basse dudict haultel est à belles ymaiges de cuyvre, dorées de lin or. A l’environ y a qualtre grandes columpnes de cuyvre, et sur icelles qualtre anges de trois à qualtre piedz de haulteur ; ledict aultel bien aorné et encourliné de drap d’or et de soye (miChelant et QuiCherat, « Un grand monastère… », p. 226).
COMMUnICATIOnES 195
Derrière icelluy grand aultel y a trois beaulx et riches aultelz d’albattre, dont celluy du millieu est l’autel monseigneur sainct Bernard, sur lequel est son ymaige, fait sur le vif incontinant après son trespas, et avoit le visaige, à veoir ladicte imaige, maigre et contemplatif. Ledict autel est couvert d’un tabernacle de pier à quatre pilliers, dont les deux premiers son à costé dudict autel, servans de collonnes, el les deux aullres, derière iceluy autel, faisant ledit tabernacle couverture audit autel, el semblablement au vasseau où sont les ossemens de sainct Bernard qui est derier ledict aultel. Icelluy vasseau estant de pierre, dont la couverture est de couleur de pourphire, et de costé el d’autre dudict vasseau ou fierté l’on se peut mettre à genoul pour saluer le sainct, en disant son oroison, qui est en des petis tableaux de chacun costé. Item. A costé dextre du choeur, auprès dudit autel sainct Bernard, est l’autel où est le corps de monseigneur sainct Eutroppe et de sept autres sainctz et sainctes en ung vasseau et à fierte, tout ainsy et pareillement que celluy de sainct Bernard en chappiteaux et autre chose. Item. A coté senestre est l’autel et le corps de monseigneur sainct Malachie, archevesque d’Hybernie, que pour l’amour de sainct Bernard voulust morir et estre inhumé audict lieu de Clervaulx ; les osse-mens duquel sont toul ainsy que ceulx de monseigneur sainct Bernard et sainct Eutroppe, et ledict chappiteau pareillement comme est cy-dessus déclaré29.
Selon ce texte, l’autel-reliquaire principal comportait une représentation du saint réalisée probablement d’après un masque mortuaire, où son visage avait un aspect « maigre et contemplatif ». Il s’agit de la célèbre statue perdue qui entraîna une partie du procès sur la vera effigies du saint30. L’autel était surmonté d’un balda-quin ou ciborium de pierre reposant sur quatre bases, et le reliquaire en pierre conservant les os de Bernard se trouvait derrière, avec son couvercle de couleur porphyre. Le tombeau était conçu pour que l’on y entrât à genoux afin de lire la prière qui était inscrite sur de petits panneaux situés de part et d’autre du reli-quaire.
En fin de compte, une installation liturgique monumentale destinée au culte d’un saint se trouvait à Clairvaux quelques décennies à peine après la mort de Bernard. Afin de pouvoir en restituer l’aspect, le récit de la visite de la reine de Sicile en 1517 doit être lu attentivement. La mention des colonnes autour du maître-autel dédié à la Vierge et de la représentation mariale qui y trônait indiquent clairement que celui-ci était indépendant des trois reliquaires situés derrière lui. L’allusion aux colonnes soutenant les baldaquins de chacun des trois monuments, à la représentation sculptée de Bernard au milieu de son autel et aux tombes-reli-quaires conçues pour permettre le passage des pèlerins montrent qu’il existait en réalité à Clairvaux une chapelle située derrière le maître-autel et conçue pour abri-ter un corps saint, conformément à une tradition bien attestée et documentée dans toute l’Europe. Il devait exister entre le maître-autel et ces monuments sacrés une
29 miChelant et QuiCherat, « Un grand monastère… », p. 226. 30 Pierre Quarré, « L’iconographie de saint Bernard à Clairvaux et les origines de la vera effigies »,
dans Mélanges saint Bernard. XXIVe Congrès de l’Association bourguignonne des Sociétés savantes (8e centenaire de la mort de saint Bernard), Dijon 1953, Dijon 1954, p. 342-349 ; James FranCe, Medi-eval Images of Saint Bernard of Clairvaux, Kalamazoo 2007, p. 11-19.
196 COMMUnICATIOnES
sorte de cloison, de séparation, qui disparut au xviie siècle lors de la rénovation du sanctuaire. Cette rénovation fit certainement reculer de quelques mètres le maître-autel jusqu’à la position dans laquelle le dessina dom Milley en 1708.
Avec ses trois grands reliquaires entre les bases de l’entrecolonnement de l’ab-side, couverts par leurs ciboriums portés par des colonnes, précédés par un autel derrière lequel était placée l’arche contenant les reliques, cette chapelle arrière devait avoir un aspect monumental. Elle était conçue pour recevoir la visite de pèlerins et permettre une paraliturgie du contact avec le corps saint grâce au pas-sage d’un côté à l’autre du sarcophage.
Fergusson et Henriet ont suggéré que le chevet absidal de Clairvaux avait été conçu pour exalter la mémoire de Bernard et favoriser le pèlerinage vers son monument. La disposition même des chapelles environnantes aurait été pensée comme une structure symétrique encadrant le tombeau de Bernard, situé entre Malachie et les martyrs : le maître-autel était consacré à la Vierge, la chapelle axiale de l’abside – qui abritait dans un tombeau de pierre noire le corps de la mère de Bernard – au Sauveur, la couronne de chapelles rayonnantes aux apôtres, aux prophètes et à quelques martyrs31. Cette mise en scène spectaculaire était-elle toutefois l’objectif originel du chevet absidal de Clairvaux III ?
Ajoutons une remarque avant de replacer la chapelle arrière de Clairvaux dans son contexte liturgique et architectural. D’après le témoignage du Liber altarium, la chronologie du début des travaux de l’église doit être reculée jusqu’en 1152. Certes, la santé de Bernard une année avant sa mort devait être fragile et, comme cela arriva pour d’autres réformateurs, ses compagnons auraient pu entreprendre la construction d’un chevet monumental sans l’accord explicite du futur saint. Cette hypothèse semble toutefois peu crédible. Une construction de cette importance devait avoir été discutée et préparée pendant plusieurs années avant le début des travaux en 1152. La conception des plans, la collecte des fonds, la préparation des matériaux, etc., ne laissaient pas de place à l’improvisation32. Par ailleurs, la rela-tion de Bernard avec la communauté de Clairvaux ne fut pas, loin s’en faut, un long fleuve tranquille. Les dissensions entre l’abbé et sa communauté résultant de ses nombreuses absences du monastères furent édulcorées par les rédacteurs de la Vita prima afin d’obtenir la canonisation souhaitée33. Il est peu vraisemblable qu’un grand projet architectural ait été envisagé du vivant de Bernard afin d’ac-cueillir son tombeau et de favoriser un pèlerinage.
31 Voir le plan des autels avec leur invocation et des enterrements reconstitué par gajeWSki, « Burial, Cult, and Construction… », note 2, p. 48-49.
32 Robert Branner, « Fabrica, Opus and the Dating of Medieval Monuments », Gesta, 15 (1977), p. 27-80.
33 Adriaan H. BreDero, « The Canonization of Saint Bernard and the Rewriting of his Life », dans Cistercian Ideals and Reality, éd. John R. SommerFelDt, Kalamazoo 1978, p. 80-105, et André louF, « El Císter de San Bernardo », dans Actas del II Congreso internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal. IX Centenario de la Orden cisterciense, Orense 1998, t. 4, p. 1591-1634 (ici p. 1618-1620).
COMMUnICATIOnES 197
Lorsque, vers 1150, se posa la question de la transformation du chevet de Clair-vaux II, qui venait à peine d’être terminé, les Cisterciens avaient augmenté de manière considérable les effectifs de leurs communautés et leurs besoins litur-giques, ce qui imposait un plus grand nombre d’autels pour les moines ordonnés et leurs messes privées quotidiennes. Ce n’était pas la première fois que se posait cette question. Les ordres monastiques (y compris Cîteaux) imaginèrent différentes solutions : dédoublement de l’abside, création de déambulatoires rectangulaires ou circulaires avec des chapelles rayonnantes, multiplication de chapelles dans les transepts, voire exceptionnellement des transepts, comme à Cluny III, ou dévelop-pement de « rétro-chœurs »34.
conclusIon
La troisième église abbatiale de Clairvaux, étape fondamentale d’une série d’expérimentations et de solutions apportées au culte des reliques, opta pour la solution du « rétro-chœur » : il fut alors décidé que le corps de Bernard serait ins-tallé dans la chapelle située derrière le maître-autel, entourée par l’abside, dans le chœur du chevet gothique. Cette solution architectonique répondait clairement à la nécessité de multiplier les autels qui avaient déjà envahi les côtés orientaux et occidentaux des bras du transept, ainsi que les bas-côtés, et qui demandaient un cadre monumental plus vaste que le chevet original de l’abbatiale. Le projet et le début de la construction du nouveau chevet s’étant produits du vivant de Bernard, il est avéré que l’intention fonctionnelle initiale n’avait pas été de construire un grand mausolée destiné à accueillir le corps du futur saint et à permettre son culte. Au contraire, ce fut la monumentalité du nouveau chevet à déambulatoire et cha-pelles radiales – même si leur élévation reste inconnue –, qui conduisit les moines de Clairvaux à installer les corps de Bernard, de Malachie et des martyrs dans une chapelle située au revers du maître-autel, suivant une solution utilisée pour le culte des saints dans toute l’Europe depuis plus d’un siècle. Ainsi la motivation initiale, l’extension de l’espace liturgique dans l’abbatiale, se doubla dès lors d’une fonc-tion très noble mais improvisée : abriter le mausolée du grand réformateur.
Universitat Autònoma de Barcelona Eduardo Carrero Santamaría
Departament d’Art i MusicologiaFacultat de LletresEdifici BE - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona
34 untermann, Forma Ordinis…, note 8.


















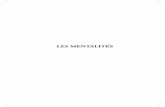

![Virtus des saints, images et reliques dans les miracles de guérison ou d’autres bienfaits en Italie du VIIIe au XVe siècle [2013]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314494c5cba183dbf077f44/virtus-des-saints-images-et-reliques-dans-les-miracles-de-guerison-ou-dautres.jpg)







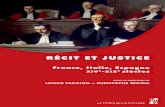


![Hagiographie, liturgie et musique : autour du culte de sainte Enimie, Revue du Gévaudan, n°238, 2014, p. 67-80 [première partie]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632242d163847156ac068a50/hagiographie-liturgie-et-musique-autour-du-culte-de-sainte-enimie-revue-du-gevaudan.jpg)

