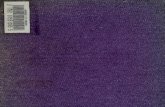Les sermons sur les reliques de la passion au XIIIe siècle
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les sermons sur les reliques de la passion au XIIIe siècle
Prêcher sur les reliques de la Passion
à l’époque de saint Louis
par Franco Morenzoni et Alexis Charansonnet
[dans La Sainte-Chapelle de Paris. Royaume de France ou Jérusalemcéleste ? Actes du colloque (Paris, Collège de France, 2001), C.Heidger (éd.), Turnhout, Brepols (Culture et société
médiévale, 10), 2007, p. 61-99]
Dans son recueil de documents pour servir à l’étude des
translations de reliques de l’Orient vers l’Occident – dont les
deux tomes ont paru à Genève en 1876 et 1878 – le comte Riant
avait déjà souligné l’importance pour l’étude de ce sujet de la
littérature parénétique, tout en déclarant avoir laissé de côté
ce type de documents à cause du travail de dépouillement trop
considérable qu’il aurait fallu mettre en œuvre pour les
repérer1. Notre travail n’a pas l’ambition de pallier cette
lacune, mais uniquement de tenter de mieux comprendre quels
pouvaient être les thèmes abordés dans les sermons prononcés
lors de la fête de la Sainte Couronne et de celle des Reliques
et d’examiner quelle était la place que les prédicateurs
réservaient au thème de la royauté. Pour l’essentiel, nous
avons privilégiés les sermons qui datent d’avant 1274 et qui
ont été prononcés à Paris, à la Sainte-Chapelle ou ailleurs ;1 P. É. D. Riant, Exuviae sacrae costantinopolotanae. Fasciculus documentorum minorum, adexuvias sacras constantinopolitanas in occidentem saec. XIII translatas, spectantium, et Historiamquarti belli sacri imperijque gallo-graeci illustrantium, Genève, 2 vol., 1876 et 1878. Letroisième volume, dû à F. de Mély, a paru à Paris en 1904.
1
nous avons cependant choisi d’examiner également deux sermons
prononcés pendant la première croisade de Louis IX ainsi que
quelques autres sermons sur la Couronne d’épines prêchés en
dehors du royaume de France.
Il est certain qu’à l’occasion des cérémonies organisées
pour fêter la translation de la Sainte Couronne en 1239 et des
autres reliques en 1241-42, plusieurs sermons ont été
prononcés. D’après le récit de l’archevêque de Sens Gautier
Cornut, il semblerait qu’un sermon ait été prononcé à la
cathédrale Saint-Étienne le jour même de l’arrivée de la
Couronne d’épines, soit le 11 août 12392. Quelques jours plus
tard, le 19 août, lorsque la relique est arrivée à proximité de
Paris, on sait que près de l’église Saint-Antoine on avait
construit une estrade, un « eminens pulpitum », afin que
l’assistance puisse l’admirer et qu’un sermon avait été
prononcé devant une foule de fidèles très nombreuse3.
Lors de la réception de la Vraie Croix en septembre 1241 et,
peu après, sans doute en août 12424, de la Croix de Victoire,2 « Defertur in ecclesiam protho-martyris Stephani, populis detegitur, ettante cause iocunditatis aperitur » (G. Cornut, Historia susceptionis corone spinee,éd. P. É. D. Riant, p. 55).3 « Octava die extra muros, iuxta ecclesiam B. Anthonij, in campi planitie,construitur eminens pulpitum, astantibus pluribus prelatis, ecclesiarumconventus indutis sericis, exhibitis sanctorum pignoribus, in tantapopulorum frequentia quanta unquam Parisius exierit ; monstratur loculus expulpito, diei felicitas et causa gaudij predicatur » (ibid. p. 55). L’auteuranonyme de la Translatio sancte corone Domini nostri Ihesu Christi évoque lui aussi laprésence d’une foule immense. Le récit anonyme de la translation a étéédité par E. Miller dans le premier des deux articles qu’il a consacrés àl’ouvrage de Riant parus dans le Journal des Savants de mai et juillet 1878 ;l’édition se trouve aux p. 295-302 et le passage sur la foule nombreuse àla p. 296 ; le récit a été réédité la même année par N. de Wailly, « Récitdu treizième siècle sur les translations faites en 1239 et en 1241 dessaintes reliques de la Passion », in Bibliothèque de l’École des Chartes, 39 (1878),p. 408-415.4 Pour la datation des différentes translations, cf. A. Frolow, La relique de lavraie Croix, recherches sur le développement d’un culte, Paris, 1961, p. 427-30 ; Cl.Billot, « Le message spirituel et politique de la Sainte-Chapelle de
2
de la Sainte Lance, de l’Éponge et de quelques autres reliques,
des cérémonies analogues avaient été organisées aux portes de
Paris, au cours desquelles deux sermons avaient été prononcés5.
D’après ce que rapporte le chroniqueur Albéric de Trois-
Fontaines, le sermon donné le 19 août 1239 près de Saint-
Antoine, aurait porté sur les grands privilèges que le royaume
de France avait déjà obtenu de Dieu et souligné l’importance de
celui qu’il venait de recevoir, tout en précisant que des
fragments de la Couronne d’épines étaient déjà conservés à
Saint-Denis et à Sens. Selon la relation anonyme de la
translation de la Couronne, qui qualifie Louis IX de « notre
David » et précise que le roi était venu en toute humilité pour
transporter la relique « quasi archam Domini » dans sa ville de
Paris, le peuple n’aurait eu droit à cette occasion qu’à un
bref sermon exhortant à la pénitence et à la nécessité de
s’abstenir de tout péché dans le futur, pour éviter que selon
la prophétie de Tobie ‘les jours de sa fête ne se transforment
en jours de deuil’6. Autrement dit, le sermon aurait insisté
sur l’idée que le nouveau privilège qui venait d’être concédé
au royaume entraînait aussi une plus grande responsabilité de
chacun vis-à-vis de Dieu. Aucune source ne permet en revanche
de savoir quels ont été les thèmes abordés par les sermons
prononcés lors de l’arrivée de la Vraie Croix et de la Croix de
Victoire, ni d’ailleurs d’identifier les prédicateurs qui ont
pris la parole lors de ces différentes cérémonies.
Paris », in Revue Mabillon, n. s., 2 (63), p. 120.5 Cf. Translatio sancte corone…, éd. E. Miller, p. 297 et p. 301.6 « Congregatisque omnibus ad locum predicte ostensioni paratum, fitexortatio predicationis ad populum, in qua breviter ammonetur commissorumsordes detergere peccatorum et a commitendis precavere in posterum, nejuxta propheticum sermonem ‘dies festi sui convertantur in luctum’ » (ibid.p. 297).
3
L’archevêque Gautier Cornut qui faisait partie, comme on le
sait, de l’entourage très proche de Blanche de Castille et de
Louis IX, a sans doute pris la parole lors de l’arrivée de la
Couronne à Sens7. Mais il est peu probable que le sermon qu’il
a prononcé à cette occasion soit celui qu’on trouve au début du
traité qu’il a écrit sur demande du roi pour relater les
circonstances de l’achat et du transport de la relique. Il est
plus vraisemblable que le sermon, qui exhorte à célébrer la
fête du jour, ait été rédigé pour le premier anniversaire de
l’arrivée de la Sainte Couronne dans sa ville. Aucun élément ne
permet d’ailleurs de dire que le sermon a été donné en présence
de la nouvelle relique et, puisque l’archevêque est décédé en
avril 1241, il paraît raisonnable de penser que ce texte a été
proposé aux fidèles à Sens le 11 août 12408.
Sans entrer dans les détails, l’archevêque invite tout
d’abord à rendre grâce à Dieu pour le cadeau qu’il a consenti
« à notre peuple et à notre royaume », dit-il, et souligne que
toute l’église gallicane et le peuple des Francs doivent se
réjouir d’avoir été choisis pour être le lieu de conservation
de la Sainte Couronne. Grâce à Louis et à sa mère Blanche,
ajoute-t-il, le Seigneur a voulu en quelque sorte couronner le
royaume de France et, de même qu’il avait choisi la Terre de la
7 Sur Gautier Cornut, cf. J. Richard, Saint Louis, Paris, 1983, en particulierp. 43 et p. 84-86, J. Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996, passim ; sur le rôlede l’archevêque lors du brûlement du Talmud voir en dernier lieu A.Tuilier, « La condamnation du Talmud par les maîtres universitairesparisiens, ses causes et ses conséquences politiques et idéologiques », inLe brûlement du Talmud à Paris, 1242-1244, éd. G. Dahan, Paris, 1999, p. 63-65, quimentionne aussi un exemplum de Thomas de Cantimpré qui met en scènel’archevêque de Sens.8 Cf. N. de Wailly, « Récit du treizième siècle… », p. 406. Contrairement àce qu’écrit N. de Wailly, il nous semble que le début de l’opuscule n’estpas un simple exorde, mais un véritable sermon qui aurait été utilisé enquelque sorte comme introduction à la partie plus proprement historique durécit.
4
Promesse pour manifester les mystères de la Rédemption, de même
il a choisi « notre Gaule » pour que le triomphe de sa Passion
soit vénéré avec une plus grande dévotion9. Cette comparaison
est proposée de manière plus explicite également par l’auteur
anonyme de la translation qui remarque que, grâce à l’arrivée
de la Croix de Victoire, la ville de Paris est devenue presque
une autre Jérusalem et que les reliques y sont désormais
conservées « pour la gloire de Dieu et la protection du
royaume », signe que ce texte a été rédigé lorsque les reliques
étaient désormais à la Sainte-Chapelle10, dont l’auteur relève
d’ailleurs au passage le plan somptueux11.
L’arrivée de la Couronne d’épines et des autres reliques de
la Passion a entraîné l’institution d’au moins deux fêtes :
celles de la Sainte Couronne, qui à Paris avait été fixée au 11
août, et celle dite des reliques, fixée au 30 septembre.
Ailleurs, la fête de la Couronne était cependant célébrée à
d’autres moments de l’année liturgique : ainsi, par exemple, le
lectionnaire conservé aux Archives Générales de l’Ordre des
Prêcheurs à Rome, et qui peut être daté d’environ 1256,
explique que les dominicains célébraient la fête de la Couronne
le jour qui suivait l’Invention de la Croix car le 11 août
était l’octave de la Saint-Dominique12. Au couvent dominicain
de Vicence de la Sacra Corona, la fête avait été fixée au
premier dimanche après l’octave de l’Ascension. D’après la9 G. Cornut, Historia susceptionis corone spinee, éd. P. É. D. Riant., p. 45-47 ; lepassage a été traduit en français par J. Le Goff, Saint Louis, p. 141-142.10 Cf. Translatio sancte corone…, éd. E. Miller, p. 301. L’auteur qualifie aussiLouis IX de « David noster » et précise qu’il est venu accueillir la vraieCroix « non precioso et eminente equo subvectus » (ibid., p. 296).11 « …ubi in edificata non multo post per eundem regem basilica, pretiososcemate constructa, honorifice reservatur » (ibid., 297).12 Cf. F. Lomastro Tognato, I « Monumenta reliquiarum » di S. Corona di Vicenza, Padova,1992, p. 8, n. 2 et p. 10.
5
relation anonyme de la translation, à Paris la fête de la
Sainte Couronne aurait été instituée par Louis IX après
l’arrivée de la Croix de Victoire, et donc vraisemblablement
après août 1242, sur conseil et avec l’assentiment de l’évêque
de Paris, c’est-à-dire de Guillaume d’Auvergne13.
S’il est probable qu’à Paris, aussi bien pour la fête du
mois d’août que pour celle du mois de septembre, on prêchait à
plusieurs endroits de la ville, et bien sûr à la Sainte-
Chapelle, les sermons qui nous sont parvenus et qui peuvent
être datés du règne de saint Louis ou des toutes premières
années qui ont suivi sa mort, sont relativement peu nombreux.
C’est principalement dans les collections de sermons léguées
par Robert de Sorbon avant 1274 à la bibliothèque du collège
qu’il avait fondée, qu’on trouve une dizaine de sermons qui
permettent de se faire une idée des thèmes qui étaient abordés
à cette occasion par les prédicateurs14. Les collections ont
conservé environ 2400 sermons, dont la plupart sont des sermons
pour ainsi dire ‘parisiens’ ou rédigés par des prédicateurs qui
ont séjourné pendant des périodes assez longues à Paris. Les
manuscrits ont été selon toute vraisemblance copiés à Notre-
Dame ou dans des milieux proches du chapitre. On y trouve la
presque totalité des sermons connus de Guillaume d’Auvergne13 « Quia vero melius memorie commendatur quod frequentius iteratur, deconsilio et assensu dyocesani episcopus, dictus rex statuit et decrevit utannis sibi succedentibus iiio idus augusti a Parisiensi populo sollempniterobservetur… », (Translatio sancte corone…, éd. E. Miller, p. 301-302). Guillaumed’Auvergne n’est pratiquement jamais mentionné en relation avec lesreliques de la Passion et, pour des raisons que nous ignorons, n’était pasprésent à la Dédicace de la Sainte-Chapelle.14 Il s’agit des manuscrits Paris, BnF lat. 15959, 15955, 15964, 16471,15951 et 15954. Les trois premiers volumes de la collection contiennent dessermons de tempore, alors que les trois autres des sermons de sanctis et decommuni sanctorum. Un septième volume, contenant des sermons ad status, ne nousest pas parvenu (cf. N. Bériou, « La prédication synodale au XIIIe siècled’après l’exemple cambrésien », in Le clerc séculier au moyen âge, Paris, 1993, p.232, n. 13).
6
ainsi que quelques dizaines voire quelques centaines de sermons
de Philippe le Chancelier, de Guiard de Laon, d’Eudes de
Châteauroux, etc15.
C’est dans le deuxième volume de la collection consacré au
sanctoral qu’on trouve deux cahiers dans lesquels ont été
copiés dix sermons que les rubriques désignent comme étant « De
sancta corona » ou dont elles précisent qu’ils ont été donnés
« In festo reliquiarum »16. Il est certain que ce petit corpus
a été réuni en fonction de la fête du 11 août, car il se trouve
immédiatement après les sermons prévus pour la saint Laurent et
avant ceux pour l’Assomption de la Vierge. Le recueil ne
comporte en revanche aucun sermon pour la fête du 30 septembre,
ce qui pourrait suggérer qu’à cette époque on attachait
davantage d’importance à la célébration du mois d’août17.
Les dix sermons ont été copiés par cinq copistes
différents : le premier copiste a copié les deux sermons
attribués explicitement à Guiard de Laon, ainsi qu’un troisième
qu’on peut également rendre à l’évêque de Cambrai18 ; le
15 La liste des incipit, avec quelques oublis et imperfections, a étéétablie par J. B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für dieZeit von 1150-1350, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie desMittelalters. Texte und Untersuchungen, Bd 43, 11 vol., Münster, 1969-1990,(dorénavant RLS), t. 5, p. 230-312, sous ‘Robertus de Sorbonio’. La plupartdes sermons datent vraisemblablement d’une période qu’on peut situer entre1220 et la mort de Robert de Sorbon.16 Paris, BnF lat. 15951, f. 115r-129bis.17 Cela pourrait être vrai uniquement pour le milieu où ont étéconfectionnés les manuscrits, car on sait grâce à Guillaume de Saint-Pathusque Louis IX essayait d’être à Paris pour la célébration du 30 septembre(« …et lors chevaucha jusques a Paris, pour estre a la feste des saintesreliques ; car lendemain de la saint Michiel il avoit acoustumé a fere lacelebracion et la feste des saintes reliques a Paris », Vie de Saint Louis par leconfesseur de la reine Marguerite, éd. H.-F. Delaborde, RHF, t. 20, p. 75). Lessermons d’Eudes de Châteauroux en particulier ne paraissent pascorrespondre à la date du 11 août, voir ci-dessous.18 RLS, t. 5, n. 1818 et n. 1819 ; RLS t. 3, n. 325 et n. 326 ; P. C.Boeren, La vie et les œuvres de Guiard de Laon, 1170 env. – 1248, La Haye, 1956, p. 271-272, n. 107, p. 286, n. 234. Le sermon qui se trouve au f. 115vb-116ra n’aété répertorié ni par J.-B. Schneyer ni par P. C. Boeren.
7
deuxième un sermon de Nicolas de Biard19, le troisième trois
sermons d’Eudes de Châteauroux20 et les deux derniers copistes
respectivement un et deux sermons anonymes21. L’étude de ce
petit corpus n’est pas exempte de difficultés. Quelques sermons
ne peuvent pas être attribués et la datation de la plupart
demeure incertaine. De même, pour plusieurs sermons il est
impossible d’établir le lieu où ils ont été donnés et pour
d’autres il faut se contenter d’hypothèses difficiles à
confirmer.
Le premier cahier s’ouvre par un sermon qui est attribué à
Guiard de Laon, personnage assez bien connu qui a été chanoine
de Notre-Dame à partir de 1221, est devenu chancelier de
l’université en 1237 et évêque de Cambrai à partir de 1238
jusqu’à sa mort survenue en 1248. La rubrique qualifie le
sermon ‘De sancta corona’, mais, à la lecture, on s’aperçoit
que Guiard traite surtout de l’épine, ou d’une des épines, de
la Couronne, et qu’il prêche presque certainement en présence
de celle-ci.
Le sermon porte sur les quatre raisons pour lesquelles Dieu
à voulu léguer cette épine aux hommes22 : afin qu’ils
l’utilisent comme un cure-dent pour débarrasser les dents des
19 RLS, t. 5, n. 1820 ; t. 4, n. 16320 RLS, t. 5, n. 1821 et n. 1822 ; t. 4, n. 856-858.21 RLS, t. 5, n. 1823-1825.22 « Huius corone habemus spinam nobis missam multiplici de causa. Primaratio est quoniam Dominus mittit nobis illam ad dentes nostros furgandos etmundandos […]. Secunda ratio est ad pungendum cor quasi clibano adeuacuandum saniem peccatorum et timorem superbie […].Tercia ratio est quiahac spina nos pungit et inclauat pedem affectus currentis ad peccatum. VndeProu. I : pedes eorum ad malum currunt et festinant ut effundant sanguinem[…]. Item alia ratione est quoniam hac spina coniungitur duo ad inuicem uelampliora ; unde precepit Dominus fieri quinquaginta fibulas ad complandumcortinas templi ad inuicem » (Paris, BnF lat 15951, f. 115rb-va).
8
péchés de langue ; afin qu’ils piquent leur cœur pour le purger
de tout péché ; pour l’enfoncer dans le pied de ceux qui
veulent courir vers le péché et faire en sorte qu’à cause de la
douleur ils soient obligés de revenir en arrière23 ; et, enfin,
pour qu’ils puissent se servir de l’épine comme d’une broche,
par exemple celles que les moniales utilisent pour retenir le
voile de l’humilité, etc. Le sermon ne fait aucune allusion à
la Sainte Couronne et paraît avoir été donné par Guiard de Laon
à Saint-Denis, alors qu’il occupait encore la fonction de
chancelier. Il confirme tout de même qu’avant l’arrivée de la
Couronne il y avait déjà une certaine tradition, à Paris et
ailleurs, de prêcher sur les reliques de la Passion, et
qu’après la translation on a estimé que le réemploi de ces
sermons était tout à fait envisageable.
Le deuxième sermon attribué explicitement à l’évêque de
Cambrai reprend presque la totalité des thèmes développés dans
le premier. Plus que d’un véritable sermon, il s’agit en
réalité d’une esquisse de sermon, tout au moins dans sa partie
initiale, qui n’est en fait qu’une liste de citations
bibliques. Les vingt premières ont été réunies autour du mot
« épine », celles qui suivent autour du mot « couronne » ou
« diadème », alors que les dernières semblent avoir été
retenues car elles comportent le mot ou l’idée d’époux ou
d’épouse. Ce qui est plus intéressant, c’est que les citations
sont présentées dans l’ordre des livres de la Vulgate et que23 Cette idée est illustrée l’exemplum suivant : « Similiter quando quisimpeditur ne possit libere currere ad peccatum, configitur a Domino hacspina, sicut fabri ythalici faciunt palefridos romipetarum ; inclauant, etpost unam dietam emunt illos. Quod faber ille facit per maliciam, hoc idemDominus per misericordiam, quoniam propter infirmitates quas inmittithominem iuuenem et lasciuum conuertit ad penitentiam et peccata dimitterefacit, et cet. » (ibid., f. 115va).
9
leur place à l’intérieur des chapitres est indiquée grâce au
système A-G, c’est-à-dire grâce au système utilisé par les
concordances bibliques réalisées par l’équipe de dominicains
dirigée par Hugues de Saint-Cher24. Puisqu’on estime
généralement que c’est vers 1239 que les premières concordances
bibliques ont été terminées, il semblerait que ce sermon ait
été prononcé par Guiard de Laon, sans doute à Saint-Denis,
alors qu’il était déjà évêque de Cambrai.
Entre ces deux sermons figure un sermon anonyme, mais qui
peut être rendu au même Guiard, qui comporte un passage qui
semble faire référence à la Couronne d’épines : reprenant en
partie les versets 12 et 13 du Psaume 64, le sermon invite le
public à regarder comment le Seigneur a couronné l’année de ce
bienfait, comment les champs du Seigneur sont pleins de
richesses, voyez, ajoute-t-il, la couronne de la victoire,
l’abondance des vertus ; déjà les pacages du désert deviennent
gras ; dans l’Eglise, le Christ est ceint avec la couronne des
croyants25. L’instance sur l’idée que la couronne apporte
désormais de grands bienfaits pourrait suggérer que le sermon a
été prononcé l’année même de l’arrivée de la sainte relique,
dans un endroit que rien ne permet d’identifier mais peut-être
en présence d’un auditoire féminin26.
24 Voici le début de la liste : « Priusquam intellegerent spine et cet.,Psalmus LVII f. ; Item 117 ; Exarserunt sicut ignis in spinis de spina,Psalmus XXXI b ; Dum configitur spina, Cant. II a ; Sicut lilium interspinas, Ecclesiastici XXVIII g » (ibid., f. 116rb).25 « Corona nobis est incarnatio, non contumelia. Videte iam quomodobenedixit corone anni benignitatis huius, quomodo campi eius repleti suntubertate, uidete coronam uictorie, uirtutum copiam ; iam pinguescuntspeciosa deserti credentium, corona Christus in ecclesia cingitur » (ibid.,f. 115vb-116ra).26 Le début du sermon paraît en effet s’adresser à des moniales : « Non ergode Syon eas uocat quas ad uidendum Deum uocat ; uel non ad uisionem Dei,sed ad uidendum Salomonem in dyademate eas uocat. Si concluse estis, noliteegredi donec uos Christus inuitet » (ibid., f. 115vb).
10
Le sermon suivant, dû à Nicolas de Biard, a été donné selon
la rubrique le jour de la fête des reliques27. Nicolas de Biard
est un personnage assez difficile à cerner. On sait qu’il était
un frère mendiant, mais on ne sait toujours pas s’il était
dominicain ou franciscain. Auteur de deux collections de
sermons qui ont connu une diffusion assez importante, ainsi que
d’un recueil de Distinctiones et de la Summa de abstinentia, Nicolas
de Biard paraît avoir prêché surtout à Paris. Le sermon pour
les reliques ne fait pas partie des deux collections, mais il a
été conservé par au moins un autre manuscrit28.
Sans entrer dans les détails, on peut remarquer que le
sermon, qui a pour thema le verset 37 du Psaume 36, « Garde
l’innocence et considère l’équité, car les reliques
appartiennent à l’homme pacifique », a été prononcé en présence
d’un auditoire qui comprenait des personnages importants29.
Après avoir montré comment et pourquoi il faut garder
l’innocence, le sermon développe la deuxième partie du verset
thématique en distinguant trois types de reliques : celles
d’Adam et d’Ève (le péché original), celles du diable (les
péchés mineurs, que parfois la pénitence ne permet pas
27 « In festo Reliquiarum, frater .N. de byart » (ibid., f. 117rb, margeinférieure).28 Il s’agit du manuscrit Paris, BnF lat. 18081, f. 136vb-138rb. Dans cemanuscrit, la rubrique indique qu’il a été donné pour la fête des Innocents(« In festo sanctorum innocentium »).29 C’est du moins ce que laisse supposer le passage suivant : « Proptercommoditatem, ut ita fructuose predicet quod omnes tangat nec alicui magnoparcat, uel paruo, ut non sit sicut miluus qui non audet uolare ad gallinasuel capones, sed ubi uidet pullos ibi salit, ibi uolat. Sic cum pauperculisuetulis predicamus ibi salimus, ibi aperte hanc uel illam tangimus, sed cumpredicamus magnatibus, prelatis uel aliis non audemus eos tangere, nec adeos accedere […].Non debet ergo predicator alicui parcere licet magnus sit,nec celare ueritatem. Debet tamen obseruare modum docendi, tempus et loco.Ideo dicebat Dauid : non abscondi ueritatem tuam a consilio multo, quasidiceret : licet multi prelati sint congregati in concilio multo, inpalliamento non abscondi ueritatem ab eis » (Paris, BnF lat. 15951, f.117va-vb).
11
d’éliminer et grâce auxquels le diable essaye de réintroduire
les péchés les plus graves) et enfin les reliques de Dieu. Sans
faire preuve d’une très grande originalité, Nicolas de Biard
insiste sur l’idée que la mémoire de la Passion doit inciter à
la conversion, et que c’est grâce à celle-ci qu’il est possible
de se libérer des vices les plus dangereux, tels que l’avarice,
la luxure ou l’orgueil. C’est dans ce contexte que le
prédicateur précise que dans ce monde Dieu a toujours servi et
prêché la paix et que ceux qui aiment la paix et essayent de
toutes leurs forces de la promouvoir, peuvent être appelés fils
de Dieu. Et il ajoute : « si je voulais louer .N., et s’il
était convenable de louer un homme en sa présence, je pourrai
dire, puisqu’il s’agit d’un homme de paix, que ces saintes
reliques de Dieu, qui sont ici présentes, lui ont été confiées
car les reliques appartiennent à l’homme pacifique »30. S’il ne
fait pas de doute que Nicolas de Biard prêche en présence des
reliques de la Passion – il précise un peu plus loin qu’il
n’est pas étonnant que notre visage se transforme à la vue de
ces reliques, car même le soleil a retiré sa lumière au moment
de la mort du Christ31 – rien ne permet de savoir si le sermon
30 « Et hoc est quod dicitur Mathei V : Beati pacifici quoniam filii Deiuocabuntur. Si uellem laudare .N. et fas esset hominem laudare in eiuspresentia, possem dicere, cum sit homo pacis, quod hee sunt reliquie sancteDei, que hic presentes sunt, sibi sunt commisse quoniam sunt reliquie<homini pacifico> (suppl. om. cod.), sicut dicit presens auctoritas » (ibid. f.119ra).31 « Quia debent semper esse in cogitatione nostra que Deus pro nobissustinuit, quot confusiones, quot molestie ei facte sunt. Que, si beneconsiderentur, non est uultus hominis qui inde non mutaretur, ut uultus quiante erat letus, respiciens has reliquias, debet esse tristis etlacrimosus. Similiter, qui ante erat pinguis et rubicondus, debet posteapallidus et macillentus esse. Et in hiis debet esse preparatio siue ornatusuultus nostri. Nec est mirum si mutatur uultus noster in considerationeharum reliquiarum, quia inde sol mutauit faciem suam, quia obscuratus fuitin morte Domini ; et licet pro amore solis non fuerit Christus passus,tamen, quia eum fecerat, mutauit faciem suam et retraxit lumen suum » (ibid.f. 119ra-rb).
12
a été donné à Saint-Denis ou déjà à la Sainte-Chapelle, ni
d’ailleurs d’identifier avec certitude en Louis IX l’homme de
paix auquel il fait référence32.
Tout comme ceux donnés par Guiard de Laon sur l’épine de
Saint-Denis, les deux sermons qui pourraient avoir été
prononcés lorsque les reliques de la Passion étaient déjà à
Paris proposent un enseignement qui est pour l’essentiel une
invitation à la conversion et à la pénitence. On n’y trouve
ainsi aucune allusion à l’un ou à l’autre des thèmes qui
auraient été évoqués lors de la réception des reliques, ni
d’ailleurs une quelconque allusion au plus grand prestige que
la royauté capétienne aurait acquis grâce à l’achat de celles-
ci.
Les trois sermons suivants permettent d’en savoir un peu
plus sur les circonstances précises dans lesquelles les
Chrétiens du temps de Louis IX ont pu assister aux célébrations
liturgiques liées aux reliques de la Passion, et entendre les
prédicateurs en commenter le sens. Car les trois discours
qu’Eudes de Châteauroux (1190 ?-1273) a consacrés à cette fête
offrent une particularité, par comparaison avec le reste du
corpus ici examiné: s’ils ont bien été copiés dans les recueils
de Robert de Sorbon, ce dernier les a repris des propres
collections que l’orateur, devenu cardinal, a fait réaliser à
la Curie, et dont il supervise l’édition à compter de 1260
32 Si la Sainte Couronne se trouvait encore à Saint-Denis, en admettant quec’est à Saint-Denis qu’on l’a déposée pendant la construction de la SainteChapelle, l’homme de paix auquel fait référence Nicolas de Biard pourraitêtre également l’abbé.
13
environ33. Leur attribution ne fait ainsi aucun doute; mieux,
les renseignements procurés par la tradition manuscrite de ces
collections d’auteur permettent d’avancer pour chacun une date
où ce discours a été donné, de proposer des hypothèses
concernant le public qui l’aura entendu, bref de contextualiser
ces trois textes au plus près. Le mot « texte » doit être
stricto sensu conservé à leur égard, car il est évident que le
cardinal Eudes de Châteauroux a retravaillé pour l’édition ses
performances orales; on peut cependant démontrer assez aisément
que tous les sermons de ces collections qui se rapportent à des
événements précis, et que l’orateur réunit généralement sous
l’appellation de sermons de circonstances (« De casibus »),
correspondent à une parole réelle. La carrière d’Eudes de
Châteauroux et les mentions des chroniqueurs attestent
suffisamment qu’il a effectivement prêché, et même que dans ce
33 Sur Eudes de Châteauroux et son œuvre homilétique, voir F. Iozzelli, Ododa Châteauroux. Politica e religione nei sermoni inediti, Padoue, 1994. Je me permetsd’autre part de renvoyer à A. Charansonnet, « L’évolution de la prédicationdu cardinal Eudes de Châteauroux (1190 ?-1273) : une approchestatistique », dans J. Hamesse (éd.), De l’homélie au sermon. Histoire de la prédicationmédiévale, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 103-142 ; Idem, « Du Berry en Curie. Lacarrière du cardinal Eudes de Châteauroux (1190 ?-1273) et son reflet danssa prédication », dans Revue d’histoire de l’Eglise de France, t. LXXXVI (2000), p. 5-37. Tout cela repris dans Idem, L’université, l’Eglise, l’Etat dans les sermons du cardinalEudes de Châteauroux (1190 ?-1273) , Thèse dactylographiée de Doctorat d’histoiresoutenue à l’université Lumière Lyon 2, octobre 2001, dir. N. Bériou. On ytrouvera, volume 1 tome 2, les détails relatifs à la tradition manuscrite(p. 579-590), ainsi que, volume 2, le texte des trois sermons, éditésd’après les manuscrits d’Orléans, Bibl. Mun. 203 (désormais cité O) etArras, Bibl. Mun. 876 (désormais cité A), respectivement aux p. 729-732(RLS n° 856 : f. 284va-285va dans O ; f. 80ra-81ra dans A) ; 742-744 (RLSn° 857 : f. 285va-286vb dans O ; f. 81ra-82rb dans A) ; 762-766 (RLSn° 858 : f. 286vb-288ra dans O ; f. 82rb-83va dans A). A la lecture desversions qui figurent dans les collections de Robert de Sorbon (dont lemanuscrit contenant les trois sermons, Paris BnF lat. 15951, sera désormaiscité P), il est apparu évident que ce dernier ou ses copistes ont eu sousles yeux la première édition des sermons du cardinal, envoyée à Paris« avant la mort d’Alexandre IV » (survenue le 25. 05. 1261) aux dires mêmesde l’orateur, et dont le manuscrit d’Orléans représente probablement toutce qui subsiste.
14
domaine, il a atteint une indéniable notoriété, dont le siècle
suivant au moins devait conserver la mémoire34.
Le premier sermon a été selon toute vraisemblance prononcé à
l’occasion de la consécration, le 26 avril 1248, de la chapelle
haute du monument-écrin voulu par le roi pour abriter les
saintes reliques du Sauveur. Toutes les sources concordent pour
affirmer que le cardinal, devenu entre-temps légat pour la
France de la croisade de Louis IX, a présidé cette cérémonie de
dédicace, entouré des plus grands prélats du royaume et même de
certains venus de l’étranger (l’archevêque de Tolède par
exemple). La localisation de ce premier sermon à la Sainte-
Chapelle demeure toutefois une hypothèse très probable, non une
certitude, dans la mesure où le texte mentionne, parmi les
reliques dont on célèbre la fête, les clous ayant servi à
crucifier le Christ35. Or on sait qu’un saint clou, déposé à la
basilique royale de Saint-Denis, était possédé par les
Capétiens antérieurement aux reliques acquises par
l’intermédiaire de l’empereur latin de Constantinople Baudouin,
la tradition dionysienne faisant remonter cette acquisition et
ce don au Carolingien Charles le Chauve. Quelques années avant
34 Sur les mentions par divers écrivains contemporains de la prédicationd’Eudes de Châteauroux, cf. A. Charansonnet, L’université… thèse citée, p. 112note 64 et p. 113 note 66; et sur le souvenir qu’il a laissé, voirl’édition (Saint Louis roi de France, textes de F. Avril et M.-T. Gousset, préf.J. Richard, Paris, 1990, éd. du Chêne) du manuscrit enluminé intitulé Livredes faits de Monseigneur saint Louis, BnF fr. 2829, datant du XIVe siècle, oùplusieurs miniatures représentent le cardinal en train de prêcher: d’aprèsles p. 94-95, où sont identifiées les scènes peintes, Eudes de Châteaurouxest repérable aux f. 21, 36v, 43, etc.35 Le texte dit : « De numero horum testimoniorum sunt hee [c’est moi quisouligne] sacre reliquie : sancta corona, crux, clavi, sudarium,sepulchrum, spongia, ferrum lancee et alia, sicut xii lapides quod filiiIsrael de Iordane traxerunt testimonium perhibent quod ipsi Iordanem siccovestigio transierunt » (éd. cit. A. Charansonnet, p. 731, lignes 56-58 ; f.120rb, P ; f. 285rb, O ; f. 80vb, A) : est-ce à dire que les auditeurs ont« ces » reliques sous les yeux ? Une telle interprétation appuierait ladate et les circonstances ici proposées.
15
l’arrivée des reliques constantinopolitaines, en 1233, le roi
Louis IX avait témoigné de sa vénération à l’égard du saint
clou de Saint-Denis, volé puis miraculeusement réapparu36.
Philippe-Auguste avait lui aussi fait don de reliques du
Sauveur à Saint-Denis37. Il n’est donc pas exclu que le premier
sermon sur les reliques de la Sainte-Chapelle d’Eudes de
Châteauroux, maître en théologie et orateur actif à Paris au
plus tard en 1229, ait été prononcé dans la basilique
dionysienne à une date et dans des circonstances différentes de
celles ici proposées38. La tradition manuscrite des collections
de l’auteur, si précieuse soit-elle, ne permet pas de trancher
définitivement sur ce point, puisque les trois discours
qu’Eudes de Châteauroux a donnés sur les saintes reliques sont
déjà copiés dans la première édition produite par le scriptorium
cardinalice, parue fin 1260-début 1261, et qui regroupe
l’activité homilétique de l’orateur depuis au moins 1229, sinon
plus tôt. Divers détails toutefois, qui seront évoqués plus
loin, et surtout le contenu théologique d’ensemble de ce
premier sermon, font cependant nettement pencher la balance en
faveur de l’hypothèse d’abord évoquée, qu’il correspondrait à
la circonstance, si importante pour le royaume de Louis IX, et
de très peu antérieure au départ de son armée pour la croisade,
où fut dédicacée la Sainte-Chapelle. Il était tout à fait
logique qu’un prédicateur de la trempe du cardinal, qui s’était
36 Cf. Dom M. Félibien, Histoire de l’abbaye royale de Saint-Denys en France, Paris,réédition de 1973, p. 97 (don de Charles le chauve) ; p. 228-232 (vol etréapparition miraculeuse du saint clou). J. Le Goff, Saint Louis, donne p.124-127 la traduction du récit de l’épisode par Guillaume de Nangis.37 Dom M. Félibien, Histoire de l’abbaye royale… cit., p. 215-216.38 Il faudrait alors songer à une fourchette chronologique entre 1242, oùl’ensemble des reliques christiques acquises par Louis IX, précisémenténumérées par le sermon d’Eudes, sont à Paris, et 1248, où la Sainte-Chapelle est achevée.
16
d’abord fait connaître du souverain comme maître en théologie
de l’université de Paris, et lui devait probablement son
ascension à la pourpre ainsi que sa première légation, tout
juste renouvelée par Innocent IV pour qu’il guidât
spirituellement les croisés outremer, que ce prédicateur ait
aussi été choisi par le roi pour présider une telle cérémonie
et lui conférer tout son sens religieux.
Les deux autres sermons posent moins de problèmes: c’est
presque certainement durant l’expédition elle-même qu’ils ont
été donnés, respectivement à Damiette en Egypte, où l’armée
chrétienne venait de débarquer, le 30 septembre 1249, puis le
30 septembre 1251 en Terre sainte proprement dite, où les
croisés s’étaient transportés après la défaite et la captivité
du roi en Egypte. Ils prouveraient ainsi que la mémoire des
précieuses reliques n’a cessé d’accompagner les combattants et
de donner à l’expédition son sens spirituel fondamental. Cette
date du 30 septembre se déduit de la rubrique figurant dans les
manuscrits du cardinal, valable pour les trois sermons : « in
festo reliquiarum sancte capelle regis Francie », désignant
ainsi la fête de ce nom célébrée en leur honneur par le palais
capétien39. Quant aux années proposées, 1249 pour le second et
1251 pour le dernier des trois sermons ainsi rubriqués, leur
très forte probabilité s’appuie sur des allusions textuelles,
sur lesquelles on reviendra le moment venu.
39 Voir supra notes 4 et 12 pour les différentes fêtes des saintes reliqueset leurs dates. Eudes de Châteauroux est toujours très précis dans larubrication de ses manuscrits, mais procède lui aussi, comme Robert deSorbon dans ses cahiers, à des regroupements de sermons prêchés àdifférentes dates, lorsqu’il les édite (tout cela amplement discuté dansA . Charansonnet, L’université… thèse citée, passim). De plus, entre les années1240 et 1260, l’accent mis sur la principale fête célébrée à la Sainte-Chapelle a pu se déplacer, voir supra note 17.
17
Trois discours sur le même sujet, mais trois contextes fort
différents, donnent ainsi sa saveur spécifique à la
contribution du cardinal-légat, dans le cadre plus général de
la prédication parisienne suscitée par la présence, depuis
1239, de la sainte couronne puis des autres reliques
christiques dans la capitale capétienne et ses alentours.
Revenons au premier sermon de la série, qui pose on l’a vu
un problème de localisation, donc de datation. Les raisons
principales qui conduisent à préférer malgré tout la Sainte-
Chapelle comme lieu, plus précisément sa consécration le 26
avril 1248, tiennent au contexte global dans lequel il
s’inscrit. Eudes de Châteauroux en effet n’en est pas alors au
premier de ses discours visant à faire prendre la croix aux
combattants, puis à les conforter dans leur choix. De tous les
prédicateurs de croisade, il est même celui qui offre la plus
belle série du genre à l’historien. L’ensemble des années 1245-
1248, celles de sa première légation confiée par le pape au
concile de Lyon, fait alterner sermons de croisade à proprement
parler, et sermons de circonstances, liés à cette expédition et
son organisation40. De ce point de vue, et d’autres sources
l’attestent, l’événement de la fin d’avril 1248 symbolise,
outre l’aboutissement d’un grand projet, l’unité retrouvée du
royaume derrière son souverain, après la très dure année 1247
où Louis IX et son légat, malgré une familiarité ancienne et
une sympathie mutuelle évidente, se sont trouvés en porte-à-
faux. La cause majeure de ce malaise passager entre Regnum et40 L’ensemble de ces textes est édité par A . Charansonnet, L’université… thèsecitée, volume 2 ; on en lira le commentaire Ibidem, volume 1 tome 1, p. 97-271. Une partie de ces sermons, ceux consacrés stricto sensu à la croisade,sont édités et traduits par C. Maier, Crusade propaganda and ideology. ModelSermons for the Preaching of the Cross, Cambridge, 2000.
18
Sacerdotium fut constituée par la révolte des barons français
contre la fiscalité pontificale, révolte appuyée fermement,
avec un sens aigü du réalisme politique, par le Capétien,
quelque prix religieux qu’il ait accordé au grand pélerinage
guerrier de sanctification qu’il mettait sur pied, quelque
révérence qu’il ait eue pour le successeur de l’apôtre Pierre
et son représentant en France41.
Eudes de Châteauroux dresse lui-même la liste, dans ce
premier discours, des reliques qui protègent le royaume
capétien et l’expédition proche de son départ: on y trouve bien
sûr la sainte couronne, entrée le 19 août 1239 à la chapelle
Saint-Nicolas du Palais-Royal, portée par les deux Princes
capétiens aînés, le roi et son frère Robert d’Artois; s’y
ajoutent les autres reliques christiques venues ensuite, par le
même canal, grossir le trésor: la vraie croix, les clous, le
saint suaire, un fragment de la pierre du saint sépulcre, la
sainte éponge, le fer de la sainte lance « et d’autres »42.
C’est à l’arrivée de la seconde série que le roi dut, pensent
les historiens, concevoir le projet de la Sainte-Chapelle43,
véritable reliquaire dont le programme iconographique trouve sa
clef dans la verrière dite précisément « des reliques »44. Les41 Un moment fort de cette unité retrouvée, presque contemporain de laconsécration de la chapelle reliquaire, est la condamnation du Talmud enmai 1248, objectif poursuivi avec acharnement par Eudes de Châteauroux,alors simple maître en théologie et chancelier de l’université parisienne,dès 1244. La très bonne connaissance de la liturgie juive dont témoignentses trois sermons sur les saintes reliques a évidemment partie liée avec cefait. Sur le contexte d’ensemble des années 1247-1248, cf. A .Charansonnet, L’université… thèse citée, p. 153-169.42 Cf. supra note 35.43 Cf. J. Le Goff, Saint Louis, p. 146-148 ; J.-M. Leniaud et F. Perrot, LaSainte-Chapelle, Paris, 1991, p. 53 et p. 81-117.44 Cf. J.-M. Leniaud et F. Perrot, La Sainte-Chapelle, p. 181 ; voir aussi p.184 où les auteurs, après avoir montré que la « bande dessinée » en vitrailconstituée par les 1113 panneaux figurés se répartit selon deux grandscycles, historique et spirituel, selon le schème exégétique chrétientraditionnel, insistent sur la différence qui existe pourtant entre ce
19
motifs politiques de Louis IX sont désormais bien éclairés: au
modèle de roi thaumaturge et sacralisé dont il hérite45, et que
symbolise, aux plans architectural comme historiographique, le
sanctuaire dionysien traditionnel, le souverain ajoute celui du
roi représentant laïc du Christ, conforme à sa spiritualité
personnelle et bien accordé à la dévotion dolente du XIIIe
siècle, notamment celle des Ordres mendiants, pour l’humanité
souffrante et humble du Sauveur; une nouvelle chapelle royale,
à l’image de ce que Charlemagne a fait construire à Aix,
s’avère nécessaire46.
programme et ceux alors connus, des XIIe et début du XIIIe siècles, parexemple ceux préconisés par Suger pour Saint-Denis. Selon eux, ce quifrappe est l’importance accordée à l’Ancien Testament et le caractèrehistorique accentué de la narration, presqu’entièrement linéaire et centréesur la royauté, phénomène qu’ils relient aux conceptions du souverain en lamatière, surtout p. 192-193 ; ils qualifient l’ensemble p. 187 de « vastemise en image de la théologie de l’histoire où le roi régnant trouve toutnaturellement sa place ». On discutera plus loin cette appréciation.45 M. Bloch, Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissanceroyale particulièrement en France et en Angleterre, Paris, 19832, demeure fondamental.Les historiens postérieurs ont logiquement nuancé les dates et analysesqu’il propose, notamment J. Le Goff qui a voulu reculer le processus desacralisation de la royauté capétienne, lequel connaît selon lui unachèvement tardif sous sa forme pleine et originale, en gros durant lerègne de Louis IX précisément (voir en dernier lieu son texte dans J. L. LeGoff, E. Palazzo, J.-C. Bonne, M.-N. Colette, Le sacre royal à l’époque de SaintLouis… , Paris, 2001, p. 19-35) : je demeure convaincu avec M. Bloch (op. cit.,p. 29-30) et le témoignage de Guibert de Nogent que l’essentiel est jouédès le XIIe siècle Si une restriction s’impose, c’est plutôt que, depuis etsous l’impulsion d’Innocent III, les papes, qu’Eudes de Châteaurouxreprésente, ont stimulé une tendance concurrente, au moins aussi forte, àla désacralisation du pouvoir laïc, cf. R. Folz, « Le sacre impérial et sonévolution (VIe-XIIIe siècle) », dans Le sacre des rois. Actes du colloque internationald’histoire sur les sacres et couronnements royaux (Reims, 1975), Paris, 1985, p. 89-100.46 Sur la culture historique et la spiritualité du roi, voir en particulierJ. Le Goff, Saint Louis, p. 141 et p. 858-886 ; J.-M. Leniaud et F. Perrot, LaSainte-Chapelle, p. 188-191. Ces derniers citent la lettre d’Innocent IV du 24mai 1244 où le pape écrit au roi que c’est le Christ lui-même qui lecouronne à l’occasion de cette translation (éd. P. E. D. Riant, Exuviae… ,p. 128-129) : « …nec immerito reputamus, quod te Dominus in sua Coronaspinea, cuius custodiam ineffabili dispositione tue commisit excellentie,coronauit » ; il faut ici faire la part de la rhétorique propre à lachancellerie pontificale, surtout lorsqu’on connaît les positionsthéocratique de ce pape ; et celles des circonstances, puisqu’Innocent IV,qui séjourne alors à Lyon pour préparer le concile devant déposer FrédéricII, ne peut se passer de l’appui du Capétien (cf . A. Melloni, Innocenzo IV. Laconcezione e l’esperienza della cristianità comme regimen unius personae, Gênes, 1990,p. 80-131).
20
La disposition du programme iconographique des vitraux ne
doit donc rien au hasard47. Au nord et au sud, du côté de la
nef48, figurent les scènes historiques de la Vulgate49, car
c’est là que se tient le public laïc présent aux cérémonies50;
le sens en est limpide: inscrire la royauté capétienne dans la
continuité historique des rois oints de la Bible, ce qui
explique la présence côté sud, en conclusion de ces vitraux, de
scènes d’histoire contemporaine51. A l’est, du côté du chœur où
se déroule la célébration liturgique, les scènes figurent, de
part et d’autre de la Passion du Christ, les prophètes et les
apôtres: même ici, le Nouveau Testament tient beaucoup moins de
place que l’Ancien, les deux Jean, le Baptiste et
l’Evangéliste, étant présentés davantage comme prophètes que
comme saints52. Si le côté sud ne suit pas, contrairement aux
verrières du nord, l’ordre des livres bibliques53, c’est que le
concept que le commanditaire a voulu exprimer est celui de la
persona mixta du souverain, à la fois roi et prêtre sur le modèle
de Melchisedek54 et du Christ: ce dernier guide Louis IX, qui
47 On suit ici l’analyse détaillée de J.-M. Leniaud et F. Perrot, La Sainte-Chapelle, p. 131-181, quitte à revenir ensuite sur leur interprétationd’ensemble.48 Voir Ibidem, p. 124, le plan qui permet de suivre le commentaire.49 L’ordre suit celui des livres de la Bible au nord, mais non au sud, voirles explications ci-dessous.50 Ibidem, p. 184. 51 Ibidem, p. 192 ; la verrière est celle dite « des reliques », où figureLouis IX avec les instruments de la Passion.52 Ibidem, p. 184.53 Dans l’ordre, des scènes de Tobie, Judith et Esther précèdent celles desLivres des Rois, juste avant la verrière des reliques.54 Ibidem, p. 192-193. Sur la figure de Melchisedek, cf. G. Wuttke,Melchisedech der Priesterkönig von Salem : eine Studie zur Geschichte der Exegese, Giessen,1927 ; J. Funkenstein, « Malkizedek in der Staatslehre », dans Archiv fürRechts- und Sozialphilosophie, t. XLI (1954), p. 32-36; R. E. Lerner, « Joachim ofFiore as a Link between St. Bernard and Innocent III on the FiguralSignificance of Melchisedech », dans Mediaeval Studies, t. XLII (1980), p. 471-476 (trad. Italienne, « Gioacchino da Fiore comme legame fra san Bernardo eInnocenzo III sul significato simbolico di Melchisedech », dans Idem,Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medievale, Rome, 1995, p. 137-143).
21
lui-même conduit son peuple au salut; cet aspect est
particulièrement net en face de ces dernières scènes, dans la
verrière des Nombres située juste au-dessus de la niche où le
roi prenait place: scènes d’onction et évocations sacerdotales,
associant Moïse et Aaron, signifient sans équivoque cette
mixité de la personne du souverain55. La fonction
eschatologique du Capétien, guidant son peuple vers le
Jugement, achève de trouver son expression dans la rosace de
l’Apocalypse à l’ouest, redoublée à l’extérieur du bâtiment par
la représentation du Jugement dernier sur le tympan. C’est bien
l’Histoire, et à travers elle l’influence du renouveau de
l’exégèse littérale à partir du second XIIe siècle, qui est au
centre de cette composition56; de ce point de vue la présence
des prophètes au milieu des scènes historiques ne constitue pas
une rupture: d’une part parce que l’histoire et la prophétie,
entendue dans son sens orthodoxe, ne sont pas de nature
fondamentalement différente au Moyen âge57; d’autre part parce
que l’exégèse, Eudes de Châteauroux en fournit moult exemples,
applique fréquemment les prophéties ou les actions de
55 Toutes ces analyses procèdent fondamentalement d’E. Kantorowicz , Les deuxcorps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen âge, Paris, 1989 (traduction de TheKing’s two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, 1957). Un belexemple de cette assimilation au type de Melchisedech figure dans uneenluminure du Psautier de saint Louis (manuscrit de Paris, BnF lat. 10525,f. 6v), reproduite dans J.-M. Leniaud et F. Perrot, La Sainte-Chapelle, p. 95. 56 C’est là le fil rouge de B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages,Oxford, 19842.57 Sur la nature de l’histoire et son apparentement à la prophétie, voir B.Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1980, surtout p.20s. En faveur de la prophétie qu’on peut qualifier d’ « orthodoxe », paropposition à une exégèse prophétique dissidente, voire hérétique, le plussouvent à usage politique elle aussi, Eudes de Châteauroux devait s’engagertrès fortement quelques années plus tard, lors de la sévère bataillethéologico-politique qu’il eut à mener pour défendre l’orthodoxie, contrel’Introduction à l’Evangile éternel du Franciscain Gérard de Borgo San Donnino,s’inspirant lui-même de Joachim de Fiore, puis contre les partisansimpériaux et leurs manifestes prophétiques attribués à Joachim, dans lecadre de la conquête du royaume de Naples par Charles d’Anjou, frère deLouis IX (voir A . Charansonnet, L’université… thèse citée, p. 279-384).
22
personnages historiques de l’Ancien Testament aux circonstances
contemporaines. Cette notion de la continuité historique entre
royauté d’Israël et royauté capétienne ouvre le texte des
indulgences que les prélats présents à la consécration, six
archevêques et onze évêques, concèdent aux visiteurs en avril
124858. Il est clair que la croisade n’a pu que conforter et
accélérer la réalisation d’un tel programme, puisqu’elle
constitue la première étape de cette marche vers le Royaume.
Cette vision de l’Histoire et du sens précis de la croisade
semblent largement partagée par le légat, à lire le sermon pour
la fête des saintes reliques qu’il délivre, selon l’hypothèse
proposée, le 26 avril 1248, à l’occasion de la consécration
officielle de la Sainte-Chapelle, et qui apparaît à beaucoup
d’égards comme un exposé théologico-historique des vitraux que
les présents ont sous les yeux59. Le texte en est très proche
par l’esprit de celui des indulgences qu’il concède le 27 mai
1248, où il rappelle sa consécration et adopte un ton très
personnel60. Mais il souligne dans son discours, avec beaucoup58 Ed. J. de Laborde, Layettes du Trésor des chartes, t. III, Paris, 1875, p. 26,n° 3652 : « Si populus Israel, qui sub legis umbra viuebat, frequenteraccedens oraturus ad locum quem elegit Dominus ut ibi poneret nomen suum,vota et denaria plurima offerebat, multo fortius populus christianus…tenetur ecclesias… congruis honoribus frequentare… Sane, cum capellaillustrissimi Regis Francorum… fuerit a reuerendo patre Odone, Dei gratiaTusaculanensi episcopo, legato sedis apostolice, nobis eidem assistentibus,dedicata…”.59 Pour en finir avec les problèmes de datation de ce sermon, si la find’avril 1248 paraît hors de doute, on ne peut affirmer que le discours aété donné le jour même de la consécration, car si le rôle majeur d’Eudes deChâteauroux lors de cette cérémonie est assuré (voir note précédente),aucune source ne mentionne explicitement un sermon de sa part le jour de ladédicace. De plus, l’orateur dans l’édition de ses sermons en a regroupé uncertain nombre sous la rubrique des dédicaces d’églises ; or les troissermons pour la fête des saintes reliques forment un groupe distinct de cetautre pour les dédicaces, au sein même des sermons « de circonstances »(« De casibus » dans les manuscrits).60 Cf. l’éd. P. E. D. Riant, Exuviae…, p. 136-137 : « … unde noster animus,in quadam magna extasi pre ammiratione suspensus, quodam modo expauescit,quia non potest tanta Dei magnalia dignis attollere laudibus, vel debitahonorificencia resonare, licet assurgamus ad quas possumus gratiarumactions multiplices exsoluendas; nos volentes ut eadem capella, quam in
23
plus de netteté que ne semblent le faire les vitraux, du moins
si l’on s’en tient à l’analyse du monument proposée ci-dessus,
la nature fondamentalement différente de la Nouvelle Alliance
inaugurée par le Sauveur, notamment la supériorité des rites et
des reliques chrétiens sur ceux dont a hérité le Judaïsme; le
contexte contemporain de la condamnation du Talmud interdit de
négliger ce contraste.
Un autre sermon de croisade, de peu antérieur, exaltait le
bois de la croix61; celui-ci illustre la même réflexion
théologique sur la Passion du Christ, attribuée sans doute trop
unilatéralement à l’influence du cercle mendiant royal. Au-delà
des vitraux à strictement parler, l’ensemble de la chapelle-
reliquaire où il est prononcé constitue un hymne à ce mystère
central de l’économie du salut chrétien, puisque quatre
éléments structurent le message religieux de l’édifice62: la
châsse contenant les reliques, où sont représentées la
Crucifixion, la Flagellation et la Résurrection; les vitraux;
la retombée des arcs, où figurent les apôtres, rarement
présents dans les chapelles palatines existant
antérieurement63; des scènes de martyre dans des médaillons
peints. Or tout le sermon d’Eudes de Châteauroux, chef
spirituel de la croisade, à la Sainte-Chapelle, est centré sur
la succession Passion-Résurrection-Rédemption, exactement comme
honore sante Corone ac victoriossime cruces prefatis consecrauimus, inoctauis Resurrectionis dominice…”.61 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition du texte p. 697-699 ;commentaire p. 115-119.62 Cf. J.-M. Leniaud et F. Perrot, La Sainte-Chapelle, p. 94-96.63 Ibidem, p. 96 ; les auteurs lisent à juste titre dans cette innovation lavolonté d’insister sur le compagnonnage terrestre du Christ et la valeur desymbole ecclésiologique du collège apostolique.
24
la châsse contenant les reliques64. Sa valeur n’en est que
soulignée.
Le caractère unique de la venue sur terre du Sauveur
structure en deux parties le discours, en considérant dans un
double sens littéral un verset des Psaumes, livre biblique cher
au roi65: « Merveilleux sont tes témoignages, aussi mon âme les
scrute » ; c’est au sens strict du terme la littera, entendue
comme l’étude grammaticale du sens des phrases, qui détermine
les deux significations possibles de la citation: « tes
merveilles, c’est à dire ce qui témoigne de toi » , ou bien:
« tes merveilles, c’est à dire ce dont tu portes toi-même
témoignage »66. La suite du texte traite sans les distinguer
explicitement ces deux catégories de témoignages; on s’aperçoit
cependant que les opera du Seigneur se rapportent à la première
catégorie, et ses verba à la seconde, de sorte que l’orateur
suit en fait deux pistes: la première interprétation mène à
contempler la création, la seconde à considérer la rédemption
que le sacrifice du Christ a procuré aux hommes; l’introduction
appuie ces deux interprétations par quatre citations de
64 Cf. R. Branner, « The Grande Châsse of the Sainte-Chapelle », dans Gazettedes Beaux-Arts, t. LXXVII (1971), p. 5-18, surtout p. 15s., où l’auteurdémontre que la châsse n’est pas uniquement un reliquaire, réalisantl’équation politique couronne royale = couronne d’épines, mais aussi unmanifeste exaltant le dogme de la Rédemption : « C’était plutôt le thème dela rédemption, Christ comme source de grâce à travers lequel l’humanitéserait rachetée, Christ le prêtre-victime, médiateur des activitésrédemptrices de Dieu… » ; voir aussi la conclusion de l’auteur p. 16 sur lasignification globale de la décoration de la châsse. Compléter, pour laposition de la Grande Châsse à l’intérieur du sanctuaire, par C. Reynoldset J. Stratford, « Le manuscrit dit ‘Le pontifical de Poitiers’ », dansRevue de l’Art, t. LXXXIV (1989), p. 61-80.65 Et qui réside à la base de l’éducation religieuse, puisque c’est là queles enfants chrétiens apprenaient à lire, cf. D. Alexandre-Bidon et D.Lett, Les enfants au Moyen âge, Ve-XVe siècles, Paris, 1997, p. 85-86.66 Sur la « littera », cf. G. Dahan, L’exégèse chrétienne de la Bible en Occidentmédiéval, XIIe-XIVe siècle, Paris, 1999, p. 242-262.
25
l’Evangile de Jean67: on ne peut établir plus clairement le
lien entre ancienne et nouvelle lois, entre Ancien et Nouveau
Testaments68. Le premier point du sermon consiste en une
réflexion théologique sur la création, reprenant la conception
augustinienne que l’apparence des créatures donne une idée du
Créateur, qui en disposant tout en ordre, en poids et en
mesure, a montré sa puissance, sa sagesse et sa bonté; de même
Il a montré son éternité en créant tout sans que le principe de
sa création puisse être compris des hommes, ainsi que son
unicité, en étant au principe de tout le créé69. Le second
point aborde les oeuvres de la « recréation »70 et compte au
nombre de ces œuvres les saintes reliques énumérées: la sainte
couronne, la croix, les clous, le suaire, le sépulcre,
l’éponge, le fer de la lance, et d’autres encore; le caractère
67 A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 729 : « Hoc duobus modispoteste intelligi. Mirabilia testimonia tua (Ps. 118, 129), id est que de tetestantur, vel ea que tu ipse testaris. Testimonia enim que de ipso Dominotestantur mirabilia sunt et ideo perscrutanda. Testantur enim de Domino nontantummodo verba, immo opera, que sunt testimonia valde credibilia ; immotalia que homo non potest non credere, et quibus humana ratio aliquamtergiversacionem non potest contradicere. Unde Iohanne v° : Opera que ego faciotestimonium perhibent de me (Io. 5, 36). Et in eodem : Scrutamini scripturas inquibus putatis vitam eternam habere, ille sunt que testimonium perhibent de me (Io. 5, 39).Et in eodem : Qui misit me Pater perhibet de me (Io. 5, 37). Et in eodem : Vosmisistis ad Iohannem et ipse testimonium perhibuit veritati (Io. 5, 33) ».68 Ici comme ailleurs, Eudes de Châteauroux aborde le sens littéral d’unpoint de vue englobant, très caractéristique de l’évolution del’herméneutique biblique à partir d’Hugues de Saint-Victor ; à strictementparler en effet, le Nouveau Testament n’est pas susceptibled’interprétation historique au sens traditionnel de l’expression, c’est àdire comme annonçant les événements à venir, s’accomplissant dans unerévélation, puisqu’il est lui-même la Révélation. Il ne peut que narrer lavie et les paroles du Christ venu sauver les hommes ; à moins de s’engagerdans la direction, potentiellement dangereuse, d’une lecture prophétique decette partie de la Bible et plus particulièrement de l’Apocalypse, commes’y sont risqués divers exégètes, mais particulièrement Joachim de Fiore àla fin du XIIe siècle.69 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 730 : « Ostenditenim se esse eternum, quia illud per quod facta sunt omnia non potestintelligi esse factum. Similiter, per quod omnia sumpserunt exordium,exordium habere non potuit. Et quia omnis numerus ab unitate incipit,oportuit ut ille a quo omnia [sunt] sit unicus. Sic ergo opera creationisquedam testimonia sunt Domini ».70 Ibidem, édition p. 731 : « Opera vero recreationis sunt testimoniamirabilia Domini, quod nos diligat… ».
26
de preuves matérielles que ces reliques revêtent est souligné
par un parallèle avec l’Ancien Testament: dans Josué (4, 1 s.),
les fils d’Israël ont extrait douze pierres du Jourdain pour
prouver qu’il l’avaient effectivement traversé à pied sec71. La
proximité du départ en croisade comme de la condamnation
définitive, à peu près contemporaine, du Talmud, se devinent
quand l’orateur affirme avec habileté que « C’est là l’œuvre de
rédemption, un témoignage d’amour du Seigneur si violent que
les Juifs, les Sarrasins et les autres infidèles ne peuvent
croire que Dieu ait aimé les hommes à ce point »72. La
comparaison de la même croisade avec l’Exode est implicite et
assimile le peuple de France aux Hébreux; avec toutefois un
avantage aux Chrétiens, car après l’évocation des grandes
étapes de la fuite d’Egypte et de la traversée du désert, où
Dieu a nourri Israël et ouvert devant elle la Mer Rouge,
l’auteur conclut que « Les fils d’Israël tenaient en grande
vénération ces témoignages, la manne, la verge, les tables et
le deutéronome; en beaucoup plus grande vénération devons-nous
tenir ces témoignages que nous avons sous la main..., car ils
sont de bien plus de valeur que ceux-là, eux qui témoignent de
71 Cf. supra note 35.72 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 731 : « Hoc est opusredempcionis, quod est adeo violentum testimonium amoris Domini, quodIudei, Sarraceni et alii infideles credere non possunt quod Deus hominestantum dilexerit ». On notera ici la mise sur le même plan des Juifs et desSarrasins, éloquente : c’est bien la preuve que l’affaire du Talmud aprofondément ébranlé la vision que l’auteur se fait de la Synagogue et deson rôle historique, cela d’autant plus que les développements qui suiventenchaînent les parallèles avec l’histoire du peuple hébreu et destémoignages de sa foi, qui préfigurent ceux du Christ. Du point de vuethéologique toutefois, le rapprochement entre Juifs et Sarrasins n’apparaîtpas comme purement polémique : ce que ces deux peuples rivaux monothéistesrefusent d’admettre, nous dit l’auteur, c’est l’Incarnation. Les Chrétiens,on le sait, avaient bien conscience que Judaïsme et Islam convergeaientpour dénoncer leur « faux » monothéisme, cf. N. Daniel, Islam et Occident,Paris, 1993, en particulier p. 237-259.
27
notre rédemption et de l’amour ineffable dont Dieu nous a
aimés »73.
Le principal mérite de cette comparaison des deux
Testaments ne consiste donc pas simplement à situer la royauté
capétienne dans le droit fil de la royauté biblique, ce qui
minorerait la signification théologique du sacrifice du Christ;
sa valeur, rappelée dans les menus détails concrets que chaque
relique signifie, marque un degré supérieur par rapport à
l’amour que le Dieu de l’Ancien Testament avait montré pour son
peuple, en le soutenant dans les épreuves et en l’instruisant.
Ce saut qualitatif d’un Testament à l’autre est bien l’exact
correspondant du « saut herméneutique » accompli par l’exégète
lorsqu’il interprète spirituellement la Bible. Un public en
large part laïc se voit ainsi invité à retrouver, sous une
forme renouvelée car beaucoup plus concrète, matérialisée,
celle des instruments de la Passion, le sens de la Bible
conduisant à la compréhension du mystère divin: par là le
Chrétien s’identifie au Christ qui l’a créé puis recréé74.
On ne saurait sous-estimer la densité du commentaire et du
message, inscrit dans la tradition de la méditation de la
Passion, mais renouvelé des tendances historicisantes de
l’exégèse comme de la spiritualité doloriste du XIIIe siècle75;
73 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 731 : « In magnaveneracione habebant filii Israel ista testimonia, Mahu scilicet, virgam ettabulas et Deuteronomium. In multo maiori debemus habere ista testimoniaque pre manibus habemus, sanctam coronam scilicet et crucem etc., quiamulto maioris rei sunt hec testimonia quam illa, scilicet redempcionisnostre et tam ineffabilis dielctionis qua Deus dilexit nos ».74 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 732 : « Et ideo istatestimonia valde sunt mirabilia. Et ideo ea debemus corde intentissimoperscrutari et ea habere pre oculis ut nos inflamment ad amorem Dei etinducant nos et stimulent ut ei vicem pro nostro modulo repandamus, ut illequi nos creauit et recreauit nos glorificet Ihesus Christus… ». .75 Voir dans ce sens B. Smalley, The Study…op. cit., p. 284s., sur le désird’imitation « aussi littérale que possible » du Christ par François
28
synthèse qui donne sa pleine dimension eschatologique à la
croisade.
Le second sermon doit être placé dans un contexte très
différent du précédent. L’armée chrétienne vient de débarquer à
Damiette, choisie comme tête de pont, puisque l’objectif est de
mettre à la merci les Egyptiens en marchant sur Le Caire ou
Alexandrie. Heureux présage, quasi miracle, la ville est tombée
sans presque de résistance76; par contre, avant de poursuivre
son expédition, le roi attend le renfort de son frère Alphonse
de Poitiers, qui tarde. Début octobre 1249, sur le conseil de
Joinville qui a vu un autre prélat pratiquer ainsi avec succès,
alors que le navire où le sénéchal se trouvait était égaré en
mer, Eudes de Châteauroux fait « crier » trois processions
trois samedis de suite, pour hâter la venue du comte et
protéger son voyage77. Le chroniqueur précise que les deux
premiers samedis, le légat donne un sermon devant le roi et les
barons, à qui il accorde une indulgence plénière78.
Il serait tentant de faire correspondre le second sermon
conservé dans les manuscrits avec l’un des deux discours du
légat évoqués par Joinville. La rubrique, « in festo sanctorum
d’Assise.76 Cf. pour les sources chrétiennes J. Richard, « La fondation d’une égliselatine en Orient par saint Louis : Damiette », dans Bibliothèque de l’Ecole desChartes, t. CXX (1962), p. 39-54 ; J. Monfrin, « Joinville et la prise deDamiette (1249) », dans Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres(1976), p. 268-285 ; pour le point de vue consonnant des sourcesmusulmanes, A.-M. Eddé, « Saint Louis et la Septième croisade vus par lesauteurs arabes », dans Cahiers de recherches médiévales, t. I (1996), p. 65-92,article repris dans F. Micheau (art. réunis par), Les relations des pays d’Islam avecle monde latin du milieu du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle, Paris, 2000, p. 72-111.77 Cf. Joinville, Vie de saint Louis, éd. J. Monfrin, Paris, 1995, § 180 ; ladate fournie par le chroniqueur est : « après la Saint-Rémi », fêtée lepremier octobre. Les samedis qu’il évoque pourraient en toute hypothèsetomber les 9, 16 et 23 octobre 1249, puique le 24, le comte de Poitiers estarrivé à Damiette, Ibidem, § 182.78 Ibidem, § 181.
29
reliquiarum », ne concorde cependant ni avec le 9 octobre ni
avec le 16, mais suggère que la date la plus probable pour ce
sermon est le 30 septembre 1249. Qu’il s’agisse d’un sermon
donné durant la croisade, ce sont les termes mêmes de l’orateur
qui le suggèrent, car il apostrophe ainsi les croisés: « Ainsi
le Seigneur a-t-il ces temps-ci enivré le roi de France, ses
frères, ses soldats et le peuple de ce même royaume afin de
faire d’eux sa volonté; si en effet ils n’avaient pas été
enivrés, ils n’auraient pas pris la croix »79. Une autre
allusion, déjà évoquée, prouve que le sermon est prononcé très
probablement en Egypte, devant Damiette à peine conquise, car
Eudes de Châteauroux, évoquant le débarquement des croisés,
s’exclame: « Quelle plus grande audace peut exister, que
d’attaquer le paganisme là où sa puissance était la plus grande
? »80; outre que ce passage confirme le caractère stratégique
d’une attaque contre le sultanat ayyubide d’Egypte, on note
l’usage du passé (« là où sa puissance était la plus grande »),
signe que le débarquement devant Damiette a déjà eu lieu. La
date du 30 septembre proposée pour ce sermon a déjà été79 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 745 : « Sic Dominusinebriauit hiis temporibus regem Francie, fratres eius, militiam et populumeiusdem regni ut de eis faciat voluntatem. Nisi enim fuissent inebriati,crucem non assumpsissent ». On notera une autre allusion, qui confirme quenous ne sommes plus en France : à la fin du texte, l’orateur, pourillustrer les bienfaits spéciaux que Dieu a accordé aux Chrétiens, se donnelui-même en exemple ; il déclare : « Il [Dieu] m’a donné de faire desétudes, alors que mes concitoyens, qui possédaient davantage de moyens quemoi pour payer un séjour aux écoles, ne l’ont pas fait ; il m’a donnéd’entendre l’Ecriture sacrée ; de fréquenter une agréable société, d’êtrepromu prêtre, de devenir par sa volonté son prédicateur et d’être conduitici avec vous [c’est moi qui souligne] ; il m’a fait votre pasteur » (éd. cit.p. 746 : « Et ut de aliis taceam, de me possum ponere exemplum. Dedit michiDominus ut essem in studio, quod non est datum conuicaneis meis qui plurahabebant de quibus in scolis poterant habundantius sustentari. Dedit michiut audirem sacram scripturam, quod fui in bona societate , quod promouit mein sacerdotem, quod voluit et fecit me predicatorem suum, quod adduxit mehic vobiscum. Fecit me pastorem vestrum »).80 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 745 : « Item vinumaudaces facit. Que maior audacia quam aggredi paganismum ex illa parte inqua erat amplior fortitudo ? »
30
justifiée d’après la rubrique: seule la fête de cette date,
parmi les nombreuses solennités liturgiques dont la venue des
reliques du Christ en France avait donné l’occasion, porte
exactement ce nom81. Insistons: l’armée chrétienne, durant son
séjour à Damiette, doute malgré ses succès initiaux, dans la
mesure où les renforts que doit conduire Alphonse de Poitiers,
frère du roi, n’arrivent pas; le ton du sermon, qui cherche
visiblement à réconforter les croisés, correspondrait bien à un
tel climat, fin septembre 1249. Pour expliquer la discordance
entre ces déductions et les dates procurées par Joinville, on
peut songer à une erreur de mémoire du chroniqueur, qui écrit
longtemps après les faits, ou encore à un respect dans
l’esprit, mais non à la lettre, du temps de la liturgie par
lui.
Quoi qu’il en soit, Joinville se rappelle que durant cette
période, à la veille du départ pour les terres inconnues du sud
égyptien, le légat a prêché, et il n’est pas indifférent que le
sermon de croisade qui paraît se rapprocher le mieux de ces
dates soit consacré aux plus saintes reliques que possède le
royaume capétien, celles du Seigneur, dont une partie au moins
a été transportée avec l’expédition si l’on se fie aux
chroniqueurs82.81 Cf. C. Billot, « Le message spirituel… », p . 126 pour les trois fêtesfondées par Louis IX en 1244-1246 (et supra note 4) : le 11 août, lasusception de la Sainte Couronne ; le 30 septembre, la fête dite des« saintes reliques », correspondant à l’arrivée d’un grand fragment de lavraie croix avec d’autres reliques ; le 3 août, la fête de la Croix de laVictoire, correspondant à son arrivée le 3 août 1242 avec la sainte Lanceet la sainte Eponge ; à quoi il faut ajouter les deux fêtes traditionnellesde l’invention (3 mai) et de l’exaltation (14 septembre) de la croix, ainsique la fête de la dédicace du 26 avril.82 L’orateur évoque ces reliques comme si une partie d’entre elles au moinsétaient sous les yeux des auditeurs (cf. A . Charansonnet, L’université… thèsecitée, édition p. 744): « Has [c’est moi qui souligne] sanctas reliquias :crucem, sanctam coronam… ». Les chroniqueurs décrivent effectivement lelégat, lors de l’entrée dans Damiette, portant la sainte Croix, cf. Ibidem,
31
Le début du sermon est très différent de celui prononcé pour
la dédicace de la chapelle haute en 1248: ce dernier était
introduit, de la façon la plus classique, par les deux modes,
c’est à dire les deux sens de l’Ecriture, selon lesquels le
thème biblique du sermon était à entendre; ici, Eudes de
Châteauroux part bien du thème biblique qu’il a choisi, tiré
d’Osée, mais pour interpeller ses auditeurs: « Vous savez, très
chers, qu’aujourd’hui, nous célébrons la fête des saintes
reliques que le Seigneur nous a léguées comme une sorte de
mémorial de ce qu’il a réalisé et accompli pour nous... »83;
tout le premier paragraphe du texte insiste sur cette fonction
mémoriale des reliques christiques, joliment comparées au début
du premier point du développement au cadeau que l’ami nous fait
pour que nous conservions son souvenir84. Signe que les croisés
sont enfin parvenus au terme de leur quête, la reconquête des
lieux où le Christ a vécu, l’exégèse du verset biblique choisi
volume 1 tome 1, p. 221 note 140. Par ailleurs, cette énumération pose unproblème : O et P donnent la même liste de reliques, respectivement aux f.286ra et 121ra (« … crucem, sanctam coronam, peplum eiusdem et pannosinfancie saluatoris et alia pignora ») ; A, plus tardif, qui reprend lessermons de O mais en ajoute de nouveaux, complète ainsi la liste (f. 81va):«… crucem, sanctam coronam, ferrum lancee, pallium, sanguinem, arundinem,syndonem, lac virginis gloriose, peplum eiusdem et pannos infanciesaluatoris et alia pignora ». La différence principale pourrait êtreconstituée par l’absence du saint Sang dans la première version, alors qu’àcette époque (années 1240-1250), une polémique sur l’authenticité de cetterelique sévit dans le milieu des théologiens, polémique qui a débutélorsque le roi d’Angleterre Henri III, dans une volonté quasi explicite defaire pièce au trésor amassé par Louis IX à la Sainte-Chapelle, a fait donen 1247 d’une relique de ce type, à lui offerte par le patriarche deJérusalem, aux moines de Westminster (voir en dernier lieu N. Vincent, TheHoly Blood. King Henry III and the Westminster Blood Relic, Cambridge, 2001).83 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 742 : « ScitisKarissimi quod hodie celebramus festiuitatem sanctarum reliquiarum quasDominus nobis reliquit quasi quoddam memoriale eorum que pro nobis pertulitatque gessit ».84 Les mots précis de l’orateur sont imprégnés de l’univers mental féodal :« Il est habituel de donner à son ami de temps à autre un anneau ou unemédaille ou autre chose de la sorte, afin que le bénéficiaire conserve lesouvenir du donneur » (Ibidem, édition p. 742-743 : « Consuetudo enim estdare amico suo aliquando anulum vel cisum vel aliquid huiusmodi, utrecipiens memoriam habeat conferentis »).
32
comme thème est entièrement littérale: sans aucun doute
possible pour sa première partie (« memoriale eius »); exégèse
littérale de fait pour la seconde partie, car l’interprétation
du ‘vin du Liban’ n’est pas allégorique au sens exact, mais
métaphorique (ces reliques comme le vin du Liban doivent nous
enivrer), incluse à ce titre dans le sens littéral tel que le
mouvement exégétique du XIIIe siècle l’a redéfini en
l’élargissant85. Le texte est entièrement structuré sur la
fonction de mémoire: alors que le sermon de 1248 à Paris
fonctionnait sur la scansion création-rédemption, en plein
accord avec l’iconographie du lieu où il prenait place, la
Sainte-Chapelle, celui-ci ne dit rien de la création, mais
divise en deux parties ce qui, dans le discours parisien, n’en
faisait qu’un et constituait le second point du développement:
ici, pour souligner davantage, sur les lieux mêmes où prennent
place quelques-uns des grands événements bibliques, notamment
l’Exode du peuple élu de l’Ancien Testament, le parallèle entre
l’Ancienne et la Nouvelle Alliances, l’auteur consacre un
premier point aux bienfaits octroyés par le Seigneur à Israël
pour éviter que son peuple ne l’oublie, bienfaits dont les
principales fêtes juives commémorent, au sens exact,
l’institution, et dont les grandes reliques placées dans
l’arche d’Alliance, la manne, la verge, les tables et le
Deutéronome, rappellent le souvenir86; le second point démontre85 Sur la métaphore comme partie intégrante de l’exégèse littérale au XIIIe
siècle, voir en dernier lieu G. Dahan, L’exégèse chrétienne… op. cit., p. 426-435.86 Le parallèle Juifs d’hier – Chrétiens d’aujourd’hui est particulièrementexpressif dans le commentaire d’un passage du Deutéronome : « De même, dansle Deutéronome viii, après que le Seigneur a énuméré les bienfaits qu’il adonnés à son peuple en le conduisant hors d’Egypte, en le menant par ledésert et en l’introduisant en terre promise, il ajoute… » (suit lacitation de Dt. 8, 11-14, qui se termine par une mention de l’Egypte) ; latraduction ne peut malheureusement rendre la travail de l’auteur sur lalangue, son vocabulaire et ses sons (cf. A . Charansonnet, L’université… thèse
33
toutefois que tout cela n’est rien en comparaison de ce que le
Christ a fait pour les Chrétiens, dont le mémorial culmine sous
la forme des saintes reliques, mais qui se traduit aussi dans
l’institution des six grandes fêtes christiques,
l’Annonciation, la Nativité, la Circoncision, le Baptême, la
Passion et la Résurrection87. Le mélange de notations
spirituelles et de comparaisons triviales88, caractéristique
citée, édition p. 743 : « Similiter in Deuteronomio viii°, postquamenumerauit Dominus bona que fecerat populo suo educendo eum de Egipto etdeducendo per desertum et inducendo in terram promissionis… »). La mêmevolonté de serrer de près le parallèle entre Ancienne et NouvelleAlliances, reposant in fine sur les conceptions herméneutiques del’orateur, se traduit par le fait que le premier point du sermon useexclusivement de citations vétéro-testamentaires, surtout extraites desLivres prophétiques, tandis que le second introduit, commentant la valeurdu sacrifice christique, des citations néo-testamentaires (par exemple, éd.cit. p. 744 : « O quomodo gauderet quis si certus esset quod imperator velrex eum diligeret ! Io. Iii° : Sic Deus dilexit mundum ut unigenitum suum daret [Io.3, 16] ; immo Filius seipsum dedit et tradidit semetipsum, redempcionem promultis. Quod attendens apostolus dicit ad Galatos ultimo : Michi autem absitgloriari nisi in cruce Domini nostri Ihesu Christi » [Gal. 6, 14]). Dans le même ordred’idées, se situe la mention quasi exhaustive des principales fêtes juives.Sont citées d’une part les trois plus anciennes, qui marquent la rythme dessaisons (éd. cit . p ; 743 : « Propter hoc, ne ipsi obliuiscerentur beneficiaDomini antedicta, instituta fuerunt festa : Pascha, Penthecostes,Cenophegia. Propter hoc etiam reposita fuerunt in archa mahu, virga ettabule et deuteronomius. Et ideo etiam tabernaculum illud tabernaculumtestimonii dicebatur… »), à savoir : au printemps, le fêtes des Azymes,très tôt liée avec la solemnité de la Pâque ; en été, la fête de lamoisson, dite la fêtes des Semaines ou Pentecôte ; en automne, la fête dela récolte, devenue la fêtes des Huttes (ou, dans les textes grecs, desTentes, terme rendu en latin par tabernacula). D’autre part, les fêtes plusrécentes ne sont pas négligées (éd. cit. p. 743-744 : « Sic et in Hesterfestum Phurim, id est Sortium, fuit institutum, ut Iudei in memoriahaberent quomodo Dominus populum suum liberauerat ab excidio quod ei Amanprocurauerat. Similiter temporibus Machabeorum festum enciniorum institutumfuit, ut in memoria haberent quomodo Deux eis restituerat templum »): celledes Sorts ou Pourim, et celle de la Dédicace ou Hanoukka. Sur ces fêtes voirA.-M. Gérard, Dictionnaire de la Bible, Paris, 1989 (coll. « Bouquins », éd. R.Laffont), articles « Fête » et « Fête des Huttes », p. 396, « Dédicace(fête de la) », p. 256 ; G. Wigoder (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la Bible,Paris, 1996 (coll. « Bouquins », éd. R. Laffont), article « Fête », p. 365.87 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 744 : « Hec autemomnia predicta beneficia parua fuerunt immo quasi nulla, in comparacioneeorum beneficiorum que Dominus nobis contulit et que pro nobis sustinuitatque gessit. Et ideo ad reuocandum ea ad memoriam instituta sunt festa inEccleisa Dei : Annunciationis, Natiuitatis, Circumcisionis, Baptismi,Passionis et Resurrectionis, ut nullus possit hec ignorare nec possit seexcusare si hoc ignoret ».88 Ainsi par exemple : « Nous aimons les chiens car ils nous témoignent dessignes d’amitié » (Ibidem, p. 745 : « Diligimus canes quia nobis signaamicitie ostendunt »), constat qui suit de près un paragraphe de hautetenue sur la valeur rédemptrice du sacrifice du Christ : « Qu’est-ce quidoit autant réjouir le cœur de l’homme, que la pensée que le Seigneur l’a
34
d’une prédication qui s’adresse largement aux laïcs, fournit de
nombreux arguments en vue de crédibiliser un objectif
essentiel: vous les croisés qui, enivrés et fous de Dieu, avez
quitté tout ce qui vous était cher pour suivre le Christ, vous
constituez le nouveau peuple élu89; d’où l’apostrophe qui suit:
« Ainsi le Seigneur a enivré ces temps-ci le roi de France, ses
frères, les guerriers et le peuple de ce même royaume pour
faire d’eux sa volonté; car s’ils n’avaient point été ivres,
ils n’auraient pas pris la croix. Cela, c’est ce mémorial de la
Passion du Seigneur qui l’a accompli, semblable au vin, mieux,
supérieur au vin du Liban ». Présent aussi ce qui constitue, si
l’on peut dire, la marque d’authenticité des sermons d’Eudes de
Châteauroux, à savoir l’engagement personnel de l’auteur dans
l’entreprise et sa pleine confiance dans la protection divine:
il nous livre ainsi le seul passage d’où l’on peut, prudemment,
tirer quelques renseignements sur ses origines sociales et
culturelles, passage où s’entend une véritable action de grâce
à l’intention du créateur, moment d’effusion qui rappelle
l’étonnement d’un saint François devant les bienfaits du
Christ, ainsi qu’un manifeste clair des fonctions essentielles
aimé au point de se sacrifier soi-même pour lui ? » (Ibidem, p. 744 : « Quidita debet letificare cor hominis, sicut quando recogitat quod Dominus eumtantum dilexit quod seipsum pro eo dedit ? »).89 Voir en particulier Ibidem, p. 745, aux lignes 71-87, tout le passage surle thème de la folie sage, qui sauve les hommes qu’elle paraissait devoirperdre, avec à l’appui de nombreux exemples. Parmi ceux vétéro-testamentaires, on en trouve deux, sans doute point par hasard, quimentionnent des rois, David et Jéhu, ce dernier oint par un discipled’Hélisée, que les conseillers royaux jugent fou : allusion au choix deLouis IX de débarquer en Egypte, que certains des Grands quil’accompagnaient auraient critiqué ? L’exemple néo-testamentaire mentionne,là encore intentionnellement, la furie du Christ décrite par Marc :implicitement, on retrouve toujours les deux modèles proposés à Louis IX,celui de la royauté biblique et de la royauté du Christ, ainsi qu’uneprobable allusion à ses décisions stratégiques.
35
du prêtre chrétien, la prédication et la sollicitude pastorale
pour le troupeau confié à ses soins90.
Le troisième sermon aborde les mêmes thèmes dans un contexte
encore renouvelé, puisque l’expédition de croisade, du point de
vue de ses objectifs majeurs, a échoué. Ce n’est pas sans
amertume que le légat tente alors un bilan explicatif,
évidemment indispensable pour convaincre l’armée que le choix
de Louis IX de demeurer en Orient est malgré tout justifié.
Ce dernier sermon de la série consacrée par Eudes de
Châteauroux à la fête des saintes reliques paraît devoir être
daté du 30 septembre 1251, c’est à dire peu après l’arrivée en
terre sainte, à cause d’une allusion, en tout début du sermon,
permise par l’exégèse du verset choisi comme thema du discours.
Pour justifier le choix du thema, l’orateur s’appuie en effet
sur une citation du Livre de l’Exode (16, 32), où Dieu rappelle
aux Israëlites le pain dont il les a nourris dans le désert,
lorsqu’il les a fait sortir du pays d’Egypte. Sortir d’Egypte,
c’est précisément ce qui vient d’arriver aux croisés91. Il y a
90 Cf. supra note 79.91 L’allusion à l ‘Egypte, à l’origine de la proposition de datation dusermon, se lit au tout début (Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée,édition p. 763): « Hec precepit Dominus Moysi ut esset in memoriale filiisIsrael beneficii quod Dominus eis contulerat cibando eos tali cibo,scilicet mahu, et in tali loco, in deserto, et tanto tempore, scilicetquadraginta annis et quousque ipsi gustauerunt fructus terre Chanaan. Undeibidem preponitur : Iste est sermo quem precepit Dominus : Imple Gomor ex ea et custodiaturin futuras generationes ut nouerint panem quo alui eos in solitudine quando educti estis de terraEgipti » (Ex. 16, 32). L’orateur reprend ici, en citant le versetimmédiatement antérieur à celui qu’il a choisi pour thème biblique, leparallèle strictement observé dans les deux premiers sermons sur lesreliques, montrant que les actions de Dieu en faveur d’Israël préfigurentcelles en faveur des Chrétiens dans le Nouveau Testament. On peut proposerune seconde raison, moins convaincante, de privilégier la date de 1251 :des trois sermons qu’on trouve dans les manuscrits, relatifs à la fête dessaintes reliques, celui-ci vient en dernier ; on peut supposer que cetordre correspond à celui de la prédication réelle (mais on possède desexemples contraires, où l’ordre dans les manuscrits du cardinal n’est pascelui qu’imposerait la chronologie). Trois dates demeurent possibles : 30septembre, 1251, 1252 ou 1253 (le roi embarque à Acre pour la France le 25avril 1254).
36
toutes les raisons de penser, lorsqu’on a fréquenté un peu
longuement la prédication du cardinal et qu’on connaît ses
méthodes d’exégèse biblique, que le thema n’a pas été choisi au
hasard et comporte d’abord une signification littérale: nous
sommes en Terre sainte, et c’est aux vaincus de la première
partie de l’expédition que l’orateur, à l’occasion de cette
fête chère, veut redonner espoir, tout en essayant, exercice
difficile auquel s’était déjà livré saint Bernard par exemple,
d’expliquer les raisons d’une défaite92.
Avec ce discours, c’est très probablement la prédication de
croisade du légat qui prend fin; il récapitule donc, en les
condensant, des thèmes présents dans à peu près tous les
sermons antérieurs, et procure un bon résumé de la façon dont,
mentalement, des hommes tels Eudes de Châteauroux, Joinville ou
Louis IX ont vécu l’expédition. A cet égard, le texte reflète
intensément la dévotion, par ailleurs bien documentée, du roi
pour la croix et les reliques93.
Le premier point du sermon, selon une méthode éprouvée,
contextualise le verset thématique choisi dans l’Exode: « Moïse
dit à Aaron: prends un vase, mets-y la manne, un plein gomor,
et place-le devant le Seigneur, afin de le préserver pour vos
générations »94; en remontant un peu en arrière dans le
chapitre biblique, jusqu’à la sortie d’Egypte, l’orateur met
92 Cf. E. Siberry, Criticism of crusading (1095-1274), Oxford, 1985.93 Cf. supra note 17 pour le témoignage de Guillaume de Saint-Pathus ; etIbidem, dans le sixième chapitre, tout le § intitulé « De sa devocion a lavraie croiz aorer ». Voir aussi les extraits du § 36 de Geoffroy deBeaulieu (trad. L.-Carolus Barré, Le procès de canonisation de saint Louis (1272-1297).Essai de reconstitution, Rome, 1994), qui débutent ainsi : « En outre, ayant unvéritable culte pour la croix, il montrait une telle révérence pour lesigne de la sainte croix… ».94 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 763 : « Dixitque MoysesAaron : sume vas unum et immite mahu quantum potest capere gomor et repone coram Domino adseruandum generationes vestras » (Ex. 16, 33).
37
plus pertinemment en valeur le parallélisme des situations. La
trame substantielle du sermon est la suivante: la manne, donnée
miraculeusement par Dieu aux Israëlites dans le désert,
correspond aux reliques que le Christ a laissées en mémoire de
lui; sans doute parce que cette idée a déjà été développée,
sous des formes proches, dans le précédent sermon consacré aux
reliques, mais plus sûrement parce que les croisés se sont
désormais transportés sur les lieux mêmes où vécut le Christ,
Eudes de Châteauroux ne prend pas même la peine de justifier
cette typologie. Le thème de la commémoration, à travers
l’institution de la messe, est très fort chez les Chrétiens,
puisqu’il évoque les mots mêmes de la consécration
eucharistique95; significativement, lorsque Guillaume de Saint-
Pathus évoque la dévotion du roi pour la croix, il entrelace
cette évocation de mentions de son comportement durant la
messe, dont cette dévotion est indissociable, juste avant de
passer à la dévotion du souverain pour les reliques96. De cette
façon, le sermon porte autant sur la Passion que sur ce qui
conserve sa trace, comme l’énonce clairement le passage
suivant: « Ainsi le Seigneur a voulu que ses saintes reliques
fussent conservées et non perdues, parmi tant d’adversités qui
sont survenues à la Chrétienté, afin que nous nous souvînssions
du bienfait que le Seigneur nous a apporté par sa Passion;
c’est ainsi que nous le fêtons, pour rappeler par cette fête
95 Voir J.-A. Jungmann, Missarum sollemnia. Explication génétique de la messe romaine, t.I, Paris, 1950, p. 30s. pour le commentaire du récit évangélique, surtoutp. 32 pour la commémoration, et passim. R. Cabié, Histoire de la messe des origines ànos jours, Paris, 1990, p. 14s. en particulier, sur la transformation trèsprécoce de l’eucharistie (ce que l’auteur nomme le passage de la Cène à laMesse, entre le Ier et le IIIe siècle), marquée par l’apparition de laMémoire ou Anamnèse, et celle du Récit de l’Institution.96 Cf. supra note 93.
38
cet événement à notre mémoire »97. L’auteur poursuit son propos
en esquissant, non plus seulement un rappel des malheurs
d’Israël, comme il l’a déjà fait ailleurs - par exemple dans un
autre sermon de croisade, pour l’anniversaire de la mort de
Robert d’Artois, l’aîné des frères du roi, piégé comme on sait
lors de la victoire à la Pyrrhus de la Mansourah98 -, mais une
mise en parallèle alternée d’événements vétéro- et néo-
testamentaires, série inaugurée par l’évocation de
l’institution du sabbat. Il conclut ce premier point en
énumérant avec précision, comme dans les deux sermons
précédents sur ce thème, les reliques: mais ici, il lie chaque
relique au moment précis de la Passion qu’elle rappelle; et
revient à son verset thématique, en en confirmant l’exégèse
typologique, par l’interprétation suivante de sa première
partie: l’injonction de Moïse a été adressée à Aaron, ce qui
signifie que les prêtres, et tout particulièrement les prélats,
le pape, les patriarches et les archevêques, ont une
responsabilité particulière dans la commémoration de la
Passion; ils doivent avoir « devant les yeux le Seigneur
suspendu à la croix »99. Il semble qu’on puisse difficilement
mieux exprimer le sentiment de l’importance des fonctions
pastorales du sacerdoce, plus particulièrement concernant la
hiérarchie ecclésiastique.
97 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 763 : « Sic Dominusvoluit ut iste sancte reliquie inter tot aduersa que Christianitatiacciderunt seruarentur et non amitterentur, ut memores essemus beneficiiquod nobis contulit Dominus in sua Passione. Et ideo etiam festum de hiisagimus, ut per festum hoc ad memoriam reuocemus ». On note icil’assimilation implicite de la Chrétienté au royaume capétien qui détientces reliques.98 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition du sermon p. 750-756.99 Ibidem, p. 763 : « Unde et Dominus papa, patriarche et archiespiscopicrucem deferunt ante se ut semper habeant pre oculis Dominum suspensum incruce ».
39
Le second point met en garde, selon une idée fréquente chez
l’auteur, contre la perte de vue spirituelle, intérieure, de la
valeur des processions où l’on porte la croix: ce qui compte
n’est pas la pompe que revêtent parfois ces cérémonies, leur
ostentation luxueuse, mais le cœur de l’homme qui y participe.
Sur la base de cette opposition entre apparence extérieure et
vérité intérieure, face à un public sans doute composé en
partie de guerriers, Eudes de Châteauroux propose alors un
parallèle entre littérature profane et histoire sacrée
commémorée par la liturgie: dans la liturgie, le cœur du
célébrant comme celui des participants doivent prendre part à
la cérémonie; lorsqu’on entend la chanson de Roland, la mort du
héros ne touche pas le cœur de celui qui la chante, mais
seulement de ceux qui l’écoutent, et encore, parfois
seulement100. La différence entre le statut, purement
interprétatif, du jongleur, et celui qu’on peut nommer
« mémorial » ou « réitératif », du célébrant liturgique, n’est
pas de trop pour solenniser et sacraliser davantage la
cérémonie aux yeux des laïcs. Ces derniers sont ensuite
comparés à des rapaces qui oublient l’oiseleur sitôt qu’il les
a nourris101.
Les points suivants du sermon suivent pas à pas les
fragments syncopés du thème, selon l’une des méthodes du sermon
universitaire dont l’auteur use finalement assez rarement, même
100 Ibidem, p. 764 : « Verecundum etiam est ne ista memoria tota sit deforis, ita quod non tangit cor, sicut tangebat cor illius qui dicebat,Tren . iii° : Memoria memor ero et tabescet in me anima mea (Lam. 3, 20). Sicutmemoria mortis Rotholandi non tangit cor eius qui de eo cantat, sed tangitaliquando corda eorum qui audiunt ».101 Ibidem, p. 764 : « Ipsa enim beneficia faciunt eos obliuisci. Succedentibusenim prosperis, obliuiscuntur sui interpretis, Gen. xl° (Gn. 40, 23), sicutancipiter obliuiscitur eius qui pauit eum et satietas generat in eo hancobliuionem ».
40
s’il la maîtrise parfaitement et l’emploie lorsqu’il l’estime
adaptée. Sa théologie témoigne d’un sens humain profond, au
cœur des réflexions et expériences chrétiennes de ce siècle102:
« Ainsi le cœur de l’homme fut formé par Dieu à son image et à sa
ressemblance, non par quelque artifice »103. Un peu plus loin, son
interprétation de la Passion appuie sur l’écart entre le sort
terrestre du Christ aux différents moments de son calvaire, et
l’incompréhensible sagesse dont par cet acte il voulut
témoigner104; non sans noter que, peut-être à la faveur des
événements survenus en Egypte, l’incrédulité a gagné certains
rangs chrétiens: « Les sots et les incrédules ont la nausée de
ce sacrifice et ne peuvent supporter une telle douceur »105.
Des précisions érudites sur la capacité de l’unité de mesure
des Hébreux, le gomor, fournissent une ultime métaphore filée
sur les deux dernières séquences du verset thématique et
aboutissent logiquement à l’idée que la mémoire de la Passion
conduira les fidèles de cœur à voir Dieu le Père face à face.
Cette longue méditation sur la Passion, en point d’orgue
d’une croisade « ratée », est un indice supplémentaire, si
besoin était, de la valeur avant tout religieuse que revêtent,
chez Eudes de Châteauroux comme semble-t-il chez les autres
prédicateurs ici examinés, la sainte couronne et les autres
reliques christiques. Bien sûr, les circonstances politiques et102 Cf. A. Vauchez, La spiritualité du Moyen âge occidental, Paris, 19942 (coll.« Points Histoire », éd. Le Seuil), p. 131s.103 Cf. A . Charansonnet, L’université… thèse citée, édition p. 765 : « Sic corhominis a Deo formatum est ad ymaginem et similitudinem ipsius (Gn. 5, 3), nonaliquo artificio ».104 Ibidem, édition p. 766 : « Que maior humilitas quam inter latronessuspendi ? Ibi fuit incomprehensibilis sapientia, unde Ia ad Cor. i° : Quodstultum est Dei, sapientius est omnibus hominibus (1. Cor. 1, 25). In hoc dedit nobisexemplum constantie et patientie ».105 Ibidem, édition p. 766 : « Sed stulti et increduli nauseant super hoc necpossunt tantam dulcedinem sustinere ».
41
militaires précises qui encadrent ces trois discours ne peuvent
être ignorées. Mais tout indique que le roi lui-même partageait
cette vision, unissant Passion, reliques et avènement du
Royaume. Signe de cette connivence spirituelle, le légat
prédicateur a rapporté de Terre sainte de nouvelles reliques
christiques dont on lui avait fait présent, et qu’il distribue,
en 1257, successivement au sanctuaire de Neuvy-Saint-Sépulcre
dans son Berry natal, puis à son frère Hugues, alors trésorier
de l’Eglise de Tours et futur évêque de Poitiers106; à cela
s’ajoute, à la veille de sa mort, le legs aux Dominicains
d’Orvieto, chez qui il a choisi de reposer, d’une épine de la
couronne du Christ, elle-même don de Louis IX; cette épine
accompagne le legs des manuscrits de la seconde édition de ses
sermons; l’association du témoignage de l’humanité du Christ et
d’une vie de prédication de sa Parole est hautement
significative107. Louis IX de la même façon a largement fait
profiter ses amis spirituels du trésor de reliques qu’il avait
accumulé108.
106 Ibidem, volume 1 tome 1, p. 23-24 (note 21) et p. 266-267.107 Une note figure en tête du manuscrit de Rome, AGOP XIV, 34, l’un descinq volumes de sermons légués par le cardinal au couvent fes Frèresprêcheurs d’Orvieto, et a d’abord été transcrite par J.-B.Pitra, Analectanovissima spicilegii solesmensis. Altera continuatio, t. II : Tusculana, Frascati, 1888, p.xxvii, note 1. Son contenu indique qu’elle n’est pas de la main d’Eudes deChâteauroux., ce que confirme E. Panella, « Autografi di Bartolomeo diTebaldo da Orvieto », dans Archivum Fratrum Praedicatorum, t. LXII (1992), p.135-174, qui juge p. 157-158 (note 55) qu’il s’agit d’une écriture de lafin du XIVe siècle ; il donne une meilleure transcription de la note p. 158,dont voici un extrait : « Nota quod iste venerabilis pater et magister insacra theologia dedit conuentui urbeuetano unum calicem totum aureum etcrucem etiam ex toto de auro <de ?> spina de corona Domini nostri IesuChristi, quam spinam donauit beatus Ludouicus rex Francie predicto dominocardinali… » (c’est moi qui souligne).108 Voir le recensement de ces dons dans C. Billot, « Le messagespirituel… », p. 139 ; outre Eude de Châteauroux, on notera deuxrécipiendaires particulièrement intéressants pour notre propos : lemétropolitain de Tolède en 1248 ; l’évêque de Vicence, le prédicateurdomnicain Bartolomeo da Breganza, évoqué sous peu. Sur le culte desreliques christiques au XIIIe siècle, l’ouvrage cité supra, note 82 , deNicholas Vincent, est désormais indispensable.
42
Passé le témoignage très circonstancié d’Eudes de
Châteauroux, on retombe dans l’anonymat avec trois sermons
contenus dans le second cahier de la série rassemblée par
Robert de Sorbon. Il est certain que le premier sermon a été
prononcé pour la fête de la Sainte Couronne et en présence de
celle-ci, et donc très probablement à la Sainte-Chapelle109.
Rien ne permet cependant d’affirmer qu’il a été donné devant le
roi ni d’ailleurs qu’il a été prononcé avant 1270. Le sermon,
rédigé dans un style plutôt recherché et nettement plus long
que tous les autres, a pour thema le verset 25 du Psaume 135
(Qui dat escam omni carni), un verset très rarement choisi par les
prédicateurs, à tel point que parmi les quelques dizaines de
milliers de sermons du répertoire de J.-B. Schneyer, il est le
seul à proposer ce verset thématique.
Après avoir rappelé dans le prothème la nécessité de méditer
attentivement sur chacune des étapes de la Passion, le
prédicateur anonyme explique qu’il ne faut pas s’étonner du
caractère joyeux de fête de la Couronne, car si la Parascève
est un jour de tristesse pendant lequel il faut remémorer les
souffrances du Christ, la fête du mois d’août est celle qui
doit célébrer la récolte abondante née des saintes épines110. Le109 « Preciosa sit et graciosa nobis hec corona, licet fuerit spinosa, quiaspine iste saluti nostre sunt fructuose et sterilis non est in eis » (ibid.f. 123rb). 110 « Non miretur ergo uel indignetur ortodoxorum quispiam si iocunda coronedominice sollempnitatis paucos dies nunc expendat in laudibus redemptoris.Quia etsi hec corona capiti saluatoris ad penam et ludibrium in dieparasceues fuerit applicata, tamen, quia dies illa non est gaudii sedmeroris, quando membra compatiuntur capiti et musica in luctu sitimportuna, narratio differtur interim hec gratulabunda festiuitas, in quarecolligimus salutis nostre messem de spinarum semine propagatam. Illa diemeroris euntes ibant fideles et flebant quando salutis sue seminametebantur, uenientes autem nunc ueniunt cum exultatione portantesmanipulos uite sue… » (ibid., f. 123rb-va). Un peu plus loin, le sermonsouligne l’importance du mois d’août : « Pulchre autem in augusto sanctarum
43
sermon développe par la suite un enseignement assez savant qui
traite des quatre couronnes qui ont été ou seront portées par
le Christ : la couronne de l’humanité, celle de la Passion, de
la justice et de la gloire.
C’est bien sûr dans le ventre de la Vierge que le Christ a
reçu la couronne de l’Incarnation : en choisissant comme
ornement la chair humaine, Dieu a voulu parer ce qui n’a aucune
valeur par ce qui est précieux, ce qui est humble par ce qui
est excellent, ce qui est transitoire par ce qui est éternel,
et accomplir ainsi son plus grand miracle, car ‘c’est un plus
grand miracle d’avoir triomphé dans la chair fragile de toutes
les iniquités spirituelles que d’avoir créé le ciel et la
terre’111.
Dans le long passage consacré à la couronne de la Passion,
le sermon développe d’abord quelques réflexions à caractère
ecclésiologique pour ensuite mentionner quelques-uns des
devoirs des rois. Le sermon explique ainsi que de la tête
couronnée d’épines du Christ est sorti le baume qui doit
descendre à travers la barbe d’Aaron jusqu’à l’extrémité du
vêtement, c’est-à-dire la grâce qui doit se répandre par le
biais du sermon des prédicateurs jusqu’aux extrémités de
l’Église112. Reprenant l’idée augustinienne que la tête est le
spinarum iocundam messem recolligimus, quando quasi in augusto specialisacre benedictionis augmentum ex copiosis diuine largitatis beneficiisconfidentius expectamus… » (ibid., f. 123va).111 « Quomodo dicimus Deum carne adornari preciosum uili, excellentemhumili, eternum temporali ? Sed ideo caro humana potest dici ornamentumDei, quia Deus in ea maius miraculum fecit quam per se prius fecerat. Maiusest enim in carne fragili omnes spirituales nequicias triumphasse, quamcelum et terram fabricasse. Miranda magis uictoria est per carnem omnimiserie naturaliter obnoxiam hominem redemisse, quam Deum quicquid uultpotentem hominem plasmauisse » (ibid. f. 123vb-124ra).112 « Pios igitur huiusmodi corone aspiciamus apices, medicum nostrumpropter necessitatem honorantes ; unguentum in capite descendat in barbam,id est barbam Aaron, et inde descendat in oram uestimenti eius. Vnguentum
44
siège de tous les sens et que c’est dans le sommet de la tête
que réside celui qui doit présider à la monarchie de tout le
corps, à savoir le tact, il explique que c’est pour ce motif
que le diadème est également le signe de la dignité royale113.
La forme circulaire de la couronne doit rappeler à ceux qui
régissent les autres qu’ils doivent exercer leur fonction avec
circonspection, constat qui fournit l’occasion de rappeler que
les rois doivent exercer la justice en se faisant assister par
la sagesse et la miséricorde, qu’ils ne doivent jamais agir de
manière précipitée et toujours faire l’effort de prévoir ce qui
est utile et équilibré ; qu’ils ne doivent jamais
s’enorgueillir et dévier du chemin du droit pour faire une
faveur aux amis ou par amour pour quelque chose de familier, et
enfin qu’ils ne doivent jamais quitter la voie du Seigneur en
succombant à la colère, en recherchant la vindicte ou en
privant les ennemis de justice114.
medicinalis misericordie descendat a capite Ihesu spinis pro nobis coronatiin barbam, hoc est in sermonem predicantium fortiter et laudantium, quomentes audientium purgantur et compurgantur. Et sic ad extremos ecclesiedescendat unguentum gratie saluatoris » (ibid. f. 124ra-rb).113 « In uertice enim capitis solus tactus uiget, qui in omnibus sensibusquasi rex principatur. Vnde, cum totius corporis monarchie presideatprinceps omnium sensuum loco et potestate sublimior, dignitatis regiesignum non indigne possidet dyadema. Ideo etiam congrue corona cultus estcapitis, eo quod in capite est domestica camera sensuum et cellulerationis, operationibus inuentioni, discretioni et memorie deputate » (ibid.,f. 124va).114 « Nec uacat a misterio quod figura corone capite regis circularitercircumcingit, ut qui regulariter uult preesse et prodesse pro se et prosuis, cautus sit et in omnibus circonspectus […] Retro sit corona, ne quipreest retro cadat, sed posteriorum oblitus ad anteriora se extendat. Retrosit corona ut qui mittit manum ad aratrum, retro non aspiciat ne regno Deiineptus fiat. Ante sit corona, ne nimis sit iniustus, sed iusticie suesapientiam et misericordiam habeat assistrices. Ante sit corona, ne inpreceps ruat, sed studeat moderata et utilia in posterum prouidere. Adextris sit corona, ne in elationem animi uirtutes eum et successusprosperitatis ad uanitatem extolant. A dextris sit corona, ne amicorumfauore uel rei familiaris amore a iuris tramite ad iniurie deuia seflectat. A sinistris sit corona, ne delinquendo uiam Domini derelinquat, neper iram ultionem querat, ne inimicis suis iniuste differat uel auferatiusticie complementum » (ibid. f. 124va-vb).
45
Dans une longue digression, le prédicateur anonyme évoque
également la Passion et plus précisément le rôle de la Couronne
d’épines utilisée à la fois pour dérider le Christ, mais sans
que la tête du Sauveur souffre, et pour indiquer à ceux qui ne
pouvaient pas lire la raison de la crucifixion115. Objet sans
aucune valeur, que même les soldats n’ont voulu se partager, la
Couronne a par la suite acquis une valeur inestimable grâce à
la volonté divine116.
La fin du sermon est consacrée à la couronne de justice et à
celle de gloire. Elle propose une réflexion assez compliquée
qui vise en quelque sorte à mettre en évidence le caractère à
la fois éternel et historique de ces deux couronnes, en
distinguant par exemple trois couronnes de gloire : celle de la
gloire éternelle des trois personnes de la Trinité qui est là
depuis toujours, celle de la double nature du Christ et enfin
celle que le Christ possédera pleinement après le Jugement
lorsqu’il sera au milieu des élus. Les quatre couronnes
‘principales’ sont à nouveau présentées dans la conclusion par
le biais de l’explication de ce que le prédicateur appelle la
115 « Licet autem inter preludia passionis dominicie ab illudentibus adludibrium et punctionum aculeum fuerit imposita capiti innocenti spineacorona, pie tamen et sobrie credi potest in ipso crucifixionis articulo eamminime defuisse, et pendente corpore et membris confossis solum caput apena tunc uacuum exstitisse » (ibid. f. 124vb) ; « Pretenderant enim Iudeicausam crucifixionis Christi quod se regem faciebat, dicentes Pilato : sihunc dimittis non es amicus Cesaris. Omnis enim qui se regem facitcontradicit Cesari. Propter hoc imposuerunt super caput eius causam ipsiusscriptam : hic est Ihesus nazarenus rex Iudeorum. Forsitan intentionesimili signum cause mortis eius coronam capiti impositam, omnibus etiamlitteras nescientibus ostendebant » (ibid. f. 125ra).116 « Hinc est quod contumelia crucis et spinei dyademati uersa sunt indecus sacramenti. Merito itaque omnipotens nominatur, ad cuius nutum omnisres ita permutatur. Mirabilis igitur omnium artifex sapientia noua etinaudite inuentrix alquimie, non de argento aurum mutatis substantiisfaciendo, sed super aurum ditando spinas inimicorum in suas speciesremanentes. Sic enim ignobilia et contemtibilia elegit Deus et ea que nonsunt, ut ea que sunt destrueret et iuncorum paupertas inestimabili preciouinceret aurum, argentum et lapidem preciosum » (ibid. , f. 125rb).
46
‘prophétie mystique’ de Zacharie 6,14, verset qui évoque la
couronne qui devait servir de mémorial dans le Temple du
Seigneur, et qui permet donc aussi, tout au moins
implicitement, de rappeler la présence physique de la Couronne
d’épines.
Ce très long sermon anonyme paraît avoir été prévu pour une
assistance cultivée, capable de suivre le parcours somme toute
plutôt compliqué proposé par le prédicateur et de saisir le jeu
subtil des correspondances établies entre les différentes
couronnes mentionnées par le texte biblique, tout comme de
comprendre l’idée de fond du sermon qui est celle de montrer
comment la Couronne d’épines participe à des temporalités
différentes et représente une invitation qui s’adresse à tout
chrétien pour l’encourager à tout mettre en œuvre pour mériter
celle qui sera donnée aux élus. Dans cette perspective, au-delà
des réflexions sur les devoirs du roi, le sermon est avant tout
une exhortation à la pénitence et au combat contre le péché.
L’avant dernier sermon est le seul qui consacre un
développement au thème de la royauté du Christ ou, plus
précisément, explique de manière assez détaillée les trois
caractéristiques qui rendent celle-ci incomparablement
supérieure à la royauté terrestre117. Cette supériorité est
manifeste tout d’abord du point de vue de la majesté du
royaume : alors que les autres rois sont particuliers, le
Christ est le roi universel ; elle est également supérieure
117 « Primo ergo notatur regalis dignitas cum dicit regem. Iste est rex adpresens et excellit alios reges in tribus. Primo in excellentia maiestatisregie. Secundo in aliorum regum institutione. Tercio in ipsius regniinexterminata potestate » (ibid., f. 128rb). Sur la royauté du Christ letravail essentiel demeure celui de J. Leclercq, L’idée de la royauté du Christ aumoyen Âge, Paris, 1959.
47
parce que ce roi est le seul à pouvoir instituer les autres
rois : c’est en effet le Christ qui a institué les rois et leur
a conféré un certain nombre de droits ; lorsque les rois
agissent de manière injuste, par exemple en opprimant les
pauvres ou en profitant de leur fonction pour promouvoir au
sein de l’Église leurs proches ignorants à la place des clercs
bons et cultivés, ils ne règnent cependant plus avec
l’approbation du Christ mais uniquement avec sa permission.
Enfin, la royauté du Christ est supérieure du point de vue de
la puissance, car les rois, même s’ils vivent longtemps,
finissent toujours par devoir abandonner leur royaume quand ils
meurent : par conséquent, précise le sermon, ils sont comme les
rois de la fève qui ne règnent qu’un court moment. De plus,
même les rois les plus puissants, comme par exemple Alexandre
le Grand, ne peuvent transmettre à leurs enfants qu’une partie
de leur royaume, alors que le Christ donne à chacun
l’intégralité du sien118. En opposant systématiquement un roi à
des rois, le singulier au pluriel, le sermon développe une
réflexion qui vise à mettre en évidence surtout ce qui
différencie les deux types de royauté et à rappeler que celle
118 « Alii reges sunt particulares, iste uniuersalis, quia rex omnium regumet regnorum […]. Item excellit in aliorum regum institutione. Vnde ipseinstituit et reges et iura ipsorum, Prou. VIII : per me reges regnant etlegum conditores iura decreuunt et cet. Cum iniquas leges condunt non est aDeo sed a se ipsis […], Ysaie X : ue qui condunt leges iniquas ut opprimantin iudicio pauperes, sicut qui illos opprimunt quibus posset esse profectusin ecclesia Dei ut bonas et litteratas personas et suos ignorantes cognatospromouent et etiam qui eis aliquando in officio seruierunt. De talibusdicit Dominus per prophetam : ipsi (ipse cod.) regnauerunt, sed non ex me,scilicet approbante, sed ex me permittente. Item excellit in exterminataregni potestate. Alii reges etsi aliquamdiu uiuant tandem dimittunt regnumper mortem. Sed potestas eius potestas eterna, et regni eius non erit finis[…]. Alii reges sunt reges fabe qui regnant per breuem horam. Eccli. IX :rex est hodie et cras morietur. Item reges terreni dant parua dona, quiaaliquando partem regni, sicut legitur in libro Mathei I de Alexandro magnorege, cum deberet mori, dimisit pueris scilicet regnum illum, et cet. Sedrex noster cuilibet dat totum regnum suum […] » (ibid. 128rb-va).
48
qui est exercée sur terre par des hommes n’a en définitive pas
grand-chose de comparable avec la royauté du Christ.
Quant au dernier sermon, peut-être de Robert de Sorbon119, il
développe l’idée que la fête de la Couronne est une invitation
à méditer la passion du Christ et les deux formes de douleur
qu’il a supportées120. Assez habilement, le prédicateur
distingue entre la douleur physique du Christ causée par les
péchés charnels – à laquelle il faut penser surtout pendant la
période de Carême – et la douleur intérieure provoquée par les
péchés spirituels, sujet de réflexion auquel incite plus
spécifiquement la fête du mois d’août121.
L’échantillon offert par la collection de Robert de Sorbon
permet avant tout de constater que les thèmes abordés par les
prédicateurs lors des deux fêtes consacrées aux reliques de la
Passion étaient somme toute assez variés. À l’exception tout à
fait notable d’Eudes de Châteauroux, les clercs qui ont pris la
parole à la Sainte-Chapelle ou ailleurs ne semblent cependant
pas avoir fait preuve d’une très grande originalité. Leur
discours reste pour l’essentiel centré autour de la Passion et
de la nécessité de la pénitence et, comme nous l’avons vu, les
119 Pour chaque occasion liturgique, les copistes des recueils ont utiliséun ou plusieurs cahiers. Assez souvent, quelques sermons de Robert deSorbon, toujours anonymes, ont été copiés à la fin du dernier cahierutilisé. L’attribution de celui-ci à Robert de Sorbon, très hypothétique,est suggérée à la suite d’une citation attribuée explicitement à Guiart deLaon que Robert de Sorbon tenait comme un des meilleurs prédicateurs de sontemps (« Et dicitur ibi in Euuangelio quod assumpsit Christus Ihesusdiscipulos suos secreto, id est ad priuatum et secretum consilium. Sicexponit dominus Guiardus Camerancensis » ( ibid. f. 129vb). 120 « Nunc est tempus flendi et non ridendi, compatiendo scilicet saluatorinostro hodie pro nobis passo. Et tempus loquendi, non tacendi, adexhortandos nos muto ad compassionem et fletum » (ibid., f. 129ra).121 « Et propter hunc duplicem dolorem eius, bis in anno fit mencio de eiuspassione, scilicet nunc et dominica tertia in quadragesima. Nunc pro doloreinteriori, tunc pro exteriori, eo quod illis tribus diebus plus solitomultiplicantur cause illius doloris per gulam, per luxuriam […] » (ibid., f.129vb).
49
allusions au thème du pouvoir royal visent avant tout à
souligner la condition inexorablement humaine de la
souveraineté terrestre.
Ce constat est confirmé par les deux122 sermons donnés à la
Sainte-Chapelle en 1272-73 conservés par le recueil de Pierre
de Limoges qui vient d’être magistralement étudié par Nicole
Bériou123. Le premier a été prononcé pour l’anniversaire de la
Dédicace de la Sainte-Chapelle par Jean d’Orléans, chancelier
de l’université. Le deuxième par Jean de Samois, gardien du
couvent des franciscains, pour la fête des reliques.
Jean d’Orléans, qui a choisi comme verset thématique le
passage du deuxième livre des Chroniques qui décrit la Dédicace
du Temple par Salomon et son peuple, constate d’emblée que ce
passage peut aussi s’appliquer à Louis IX et à son peuple124,
mais développe par la suite son sermon autour de l’idée que
chacun doit être le roi et l’évêque de son propre temple, thème
courant dans les sermons pour la Dédicace125. Quant à Jean de
Samois, dans un sermon qui s’ouvre par le rappel des
souffrances infligées au Christ et développe par la suite,
assez subtilement, un enseignement à caractère moral destiné
122 Nous laissons de côté un troisième sermon, donné par le dominicain Jeande Troyes pour la fête de la Sainte Couronne en présence du roi et del’archevêque Eudes Rigaud qui n’a été conservé que de manière fragmentaire.Le sermon développe le thème des cinq couronnes qui ont été portées par leSeigneur (Paris, BnF lat. 16482, f. 17va-vb et 130vb).123 L’avènement des maîtres de la Parole. La prédication à Paris au XIIIe siècle, Paris, 2 vol.,1998.124 « [Dedicatio]. Cancellarius parisiensis in capella regis. Dedicauerunttemplum Domini rex et filii Israel. Quod dicitur de rege Salomone et filiisIsrael potest dici de rege Francie bone memorie et de populo » (ibid., f.28ra). Un prédicateur anonyme évoque l’accueil festif que Saint Louis aréservé à la Sainte Croix (cf. N. Bériou, L’avènement des maîtres…, t. 1, p.301, n. 53).125 « Rex et episcopus debet esse quilibet nostrum se dedicans Deo. Quilibetenim uir et similiter mulier habet non modicum regnum regere, scilicetcorpus et animam, que ualde periculosa sunt ad regendum » (ibid. f. 28ra).
50
aux puissants, il fait référence au vitrail de la Passion pour
expliquer l’idée que chaque péché commis par un chrétien blesse
à nouveau le Christ, idée, dit-il, qui est confirmée ad litteram
par Zacharie 13,6 (« J’ai reçu ces blessures dans la maison de
ceux qui m’aimaient »), mais qui, ajoute-t-il, dans cette
chapelle peut être confirmée par la vue126. Il souligne plus
loin que les saintes reliques ont toujours été auprès des
savants, d’abord en Grèce, où le clergé était autrefois
florissant, et maintenant à Paris, où se trouve, dit-il, la
source de toute la sagesse127. Si Jean de Samois s’empresse de
bénir l’action de celui qui a fait venir les reliques et les a
installées aussi honorablement – bénédiction qu’il élargit à
celui qui poursuivra ce qui a été commencé, allusion à Philippe
III qui est présent au sermon – il n’insiste guère sur cet
aspect128.
C’est paradoxalement dans les sermons pour la fête de la
Couronne d’épines prononcés en Italie, et plus précisément à
Vicence, que la famille royale et Paris font l’objet de
remarques qui mettent davantage en évidence leur rôle. Évêque
de Limassol et plus tard de Vicence, en 1259 le dominicain
Barthélemy de Breganze a reçu à Paris de Louis IX, à côté de
qui il avait séjourné en Palestine, une des épines de la Sainte
Couronne et un morceau de la Vraie Croix, qu’il avait ramenés
126 « Hiis ergo plagatus, et cet. Hiis est demonstratiuum ad litteram hic,sed in hac capella potest esse demonstratiuum ad oculum » (ibid. f. 131va).127 « Vnde semper fuerunt iste reliquie apud sapientes. Primo in Grecia, ubiuigebat tunc clerus, nunc autem Parisius, ubi est fons totius sapientie »(ibid. f. 131va).128 « Benedictus qui istas [reliquias] apportauit et tam honorificecollocauit, et qui continuabit inchoatum » (ibid. f. 131va-vb). Le reste dusermon propose une longue description des blessures infligées par le péchéau corps social qui est, comme l’écrit N. Bériou, « au service d’une miseen garde à l’adresse des hommes de pouvoir » (L’avènement des maîtres…, t. 1, p.344).
51
en Italie en passant le col du Simplon enneigé. En 1260,
Barthélemy avait remis les reliques à l’église de la Sacra
Corona du couvent des dominicains de Vicence. Trois des sermons
qu’il a donnés pour la fête de la Couronne entre 1264 et 1270
ont été conservés129. Ils permettent de constater que l’évêque
de Vicence n’hésitait pas, quand il prêchait sur la Couronne, à
magnifier le roi de France et sa mère. Ainsi, pour n’évoquer
qu’un seul exemple, dans un sermon il compare ouvertement
Blanche de Castille à Hélène, à qui on doit l’invention de la
Croix de Victoire, et son père Constantin, qualifié de
conservateur des saintes reliques, au très dévot roi Louis,
tout en soulignant que si la couronne avait été transférée dans
un premier temps de Jérusalem à Byzance, elle avait dû par la
suite quitter cette ville à cause de la perfidie de celle-ci,
et que désormais c’était Paris qu’elle couronnait de gloire et
d’honneur130.
Quelques remarques en guise de conclusion. Si l’on juge
d’après les sermons qui ont été conservés par les recueils de
Robert de Sorbon et de Pierre de Limoges, il semble bien que
les prédicateurs qui ont pris la parole lors de la fête de la
Couronne et des Saintes Reliques ont abordé assez rarement le
thème de la royauté. Lorsqu’ils l’ont fait, ce n’était
certainement pas pour amener leur contribution à l’élaboration
d’une idéologie au service de la glorification du pouvoir royal
ou de la personne du roi, mais plutôt pour rappeler le129 L’ensemble du dossier a été publié et étudié par F. Lomastro Tognato, I« Monumenta reliquiarum » di S. Corona di Vicenza, Padova, 1992. Les trois sermons surla Couronne d’épines de l’évêque de Vicence ont été édités aux pages 149-156.130 Ibid. p. 153.
52
caractère transitoire et limité du pouvoir des rois et pour
exprimer, comme l’écrit Nicole Bériou à propos des sermons
donnés devant le roi, ‘une conception de la royauté
ministérielle, et subordonnée à celle du Christ’131. Les thèmes
présents dans les deux relations de la translation, tout comme
celui suggéré en 1244 par Innocent IV du Christ qui aurait lui-
même couronné Saint Louis, ne semblent guère avoir inspiré nos
prédicateurs. Certes, ce constat repose sur un nombre limité de
sermons qui datent tous d’avant 1273-74, et il est possible que
le recours à des textes d’autre nature132 ou l’examen des
sermons prononcés à d’autres occasions – notamment les sermons
donnés pour l’Exaltation de la Croix (14 septembre) – ou
postérieurs aux limites chronologiques que nous nous sommes
fixées, permettrait de repérer des attitudes différentes. On
peut néanmoins noter que Boniface VIII, dans le deuxième sermon
sur la canonisation de Saint Louis qu’il a prononcé à Orvieto
le 11 août 1297, le jour donc où à Paris on fêtait la
susception de la Couronne, ne fait aucune allusion à celle-
ci133.
Le témoignage d’Eudes de Châteauroux, sans doute le plus
‘engagé’ politiquement de tous les orateurs ici évoqués, incite
lui aussi à nuancer les interprétations trop schématiques des
historiens de la Sainte-Chapelle concernant les reliques du
Christ, qui concluent un peu vite à l’exaltation sans frein de
la royauté élue des Capétiens. C’est oublier qu’un conseil
131 L’avènement des maîtres…, t. 1, p. 311. Sur ces aspects cf. J. Krynen,L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XIVe siècles, Paris, 1993.132 Voir par exemple le passage de la Chronique anonyme des rois de Francefinissant en l’an 1286 cité par Cl. Billot, « Le message spirituel… », p.138.133 Le sermon a été publié dans RHF, t. 23, p. 152-153.
53
clérical éclaire le Prince et que l’exégèse chrétienne
traditionnelle, si attachée qu’elle soit à la lettre de
l’Écriture, en vise l’Esprit. En ce sens, la seule vraie
royauté dont les reliques léguées par le Sauveur à son peuple
puissent témoigner, c’est de la Sienne, Eudes de Châteauroux
s’emploie quelques années plus tard à le démontrer contre le
frère de Louis IX, Charles d’Anjou. Au plan théologique, à
l’issue du Jugement dernier, tous les bons chrétiens seront
rois avec et dans le Christ vu « facie ad faciem », c’est l’une
des doxologies préférées du cardinal. Il revient dans ce cadre
au souverain temporel de montrer l’exemple, ce que le futur
saint Louis a fait avec brio. Les combattants de la Septième
croisade, à défaut d’entendre un programme de propagande
capétienne, ont écouté un guide spirituel, s’adressant d’abord
à leur foi, pour la conforter dans la gloire comme l’adversité.
Si le message présente moins d’originalité qu’on ne le voudrait
, il confirme sur un point la spécificité profonde du
Christianisme médiéval : les deux pouvoirs, le spirituel et le
temporel, s’y exposent d’emblée et très longtemps à la fois
comme distincts et indissociables.
C’est surtout dès le XIVe siècle qu’on trouve un certain
nombre de textes qui utilisent amplement le thème de la
présence des reliques à Paris pour souligner la supériorité de
la royauté française. C’est le cas, par exemple, du discours
construit comme un véritable sermon prononcé peut-être en 1365
par le conseiller de Charles V Anseau Choquart devant le pape
Urbain V, discours qui avait pour objectif de convaincre le
pape à ne pas quitter Avignon pour rentrer à Rome. Anseau
54
Choquart insiste sur l’idée que les reliques sont en France par
la volonté de Dieu, que désormais la sainteté de la France est
plus grande que celle de la Terre Sainte et que les reliques de
la Sainte-Chapelle sont bien plus précieuses que celles qui
étaient conservées dans l’arche, ce qui l’amène à observer que
saint Louis, par l’engagement dont il a fait preuve pour
obtenir les reliques, a acquis la dignité du premier ordre et
ses successeurs le titre de gardiens spirituels des saintes
reliques, reliques qu’ils ont été chargés par le Seigneur de
conserver jusqu’au jour du Jugement dernier134. Le thème de la
translatio reliquiarum est par ailleurs associé à celui de la
translatio studii135, mais contrairement à Jean de Samois qui n’avait
que suggéré de manière rapide cette association, Anseau
Choquart y consacre un long développement, afin bien entendu de
prouver la supériorité de Paris sur Rome et l’élection des rois
de France et de leur peuple.
Alexis CHARANSONNET (Université de Lyon 2)134 « Et uerisimiliter credendum est, quod eedem reliquie sancte que adesseuerisimiliter creduntur in die iudicii, […] ab ipso saluatore et angeliseisdem assistentibus continuo conseruentur, et quod eisdem assistat diuinapresentia cum multiplici angelorum comitiua, quasi precipuus Dominithesaurus in terris, cuius thesauri Christus cum suis angelis spiritualibus[…] et filius uester christianissimus rex Francie custos existitspiritualis […]. Ipse est enim qui contemplatione meritorum in prouinciasmaritimas strenuissimo milite pro fide et hiis sanctissimis reliquisobtinendis primi ordinis dignitatem fuit consecutus ; ideoque altissimarumdignitatum honoribus subiungatur […]. Rex iste et suus populus prepositisigno et uexillo pretiosissimo imperatoris nostri, scilicet saluatorisnostri, qui per hoc signum triumphauit diuino iudicio, ad idem suntpromoti ; ideoque inter electos, id est inter alios principes et populos aChristo electos, clarissimi sunt et ampliori prerogatiua digni, quos diuinilateris, id est signorum diuinorum comitatus illustrat » (Paris, BnF lat.14644, f. 6v). L’édition de C.-E. Du Boulay (Historia universitatis parisiensis,Paris, 1665-1673, t. 4, p. 396-412) est très fautive. Une nouvelle éditionde ce texte est en préparation.135 Sur cet aspect, cf. C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985, p.300-303.
55