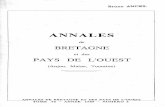Les agriculteurs devriendront-ils les jardiniers du paysage ?
-
Upload
ecole-paysage -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Les agriculteurs devriendront-ils les jardiniers du paysage ?
Master 2 Théories et démarches du projet de paysage
M10 "Projet de mémoire"
Clémence Bardaine. 2014-2015
Les agriculteurs deviennent-ils les jardiniers du paysage ? Etude de l’appropriation des savoirs agroforestiers par les agriculteurs en Ile de France Le contexte scientifique : De tous temps, l'agriculture a façonné le paysage en fonction des besoins en production et de l'évolution de la technicité appliquée. Depuis 1950, avec l'avènement de la mécanisation, le remembrement, ainsi que la spécialisation des filières, la fonction commerciale, sociale et environnementale de l'arbre est progressivement tombée en désuétude dans un contexte où l'énergie était peu onéreuse. Dans le nouveau projet agro-écologique porté par le ministère de l’agriculture, l’agroforesterie est aujourd’hui définie comme « l’intégration des arbres et de la sylviculture dans le paysage rural »1. S'il y avait des arbres dans les champs autrefois dans le bocage ou les prés vergers, c'est parce que ces arbres rendaient des services qu'ils ne rendent plus aujourd’hui (clôture, fourrage d'appoint, bois de chauffe, productions de petits fruits). Les services que l'on attend aujourd’hui de l'arbre en agroforesterie sont d'une nature assez différente (fertilisation, régulation hydrique et climatique, contribution aux corridors écologiques, etc.). Il semble donc clair que certaines caractéristiques intrinsèques de l’agroforesterie peuvent représenter des pistes de réponse aux attentes actuelles de la société. Pour s’en rendre compte, il suffit de regarder les différents objectifs nationaux ou internationaux, prescrivant des modifications du fonctionnement et de l’organisation du modèle agricole actuel (paquet Energie Climat de l’union européenne, Objectif Terre 2020, Stratégie Européenne pour la biodiversité, Convention Européenne du paysage, plan Ecophyto 2018, Directives cadres européennes sur l’eau ou sur les sols, etc.) L’agriculture, les pratiques agricoles et les systèmes alimentaires sont fortement 1 Définition officielle du Ministère de l’agriculture
concernés – en tant qu’influenceurs et influencés - par la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, pour le GIEC2, 13,5 % des émissions de gaz à effets de serre sont directement liées aux activités agricoles, incluant les pratiques agricoles. Notre agriculture et nos paysages auront donc à affronter les conséquences du changement climatique, des sécheresses et des écarts de température plus prononcés, des tempêtes plus violentes. Elle devra être donc plus résiliente. Cela suppose une approche écosystémique de l’agriculture, au sein de laquelle l’arbre - avec ses multiples effets sur le sol sur le cycle de l’eau, sur le climat - occupe un rôle de premier plan. L’une des clés d’un modèle agricole à la fois performant et respectueux de l’environnement est de maximiser, tout au long de l’année, la couverture végétale des sols, en jouant non seulement sur la complémentarité horizontale (association d’espèces au sein d’une même strate) mais aussi verticale (superposition de strates herbacées, arbustives et arborées). Les paysages agroécologiques du futur devront donc assurer des fonctions nouvelles, à la fois écologiques et productives. Comme le souligne Michel Griffon, « On comprendra donc aisément que cette agriculture et cet élevage ne sont pas simplement intensifs en termes de fonctionnalités écologiques, mais qu’ils seront aussi très intensifs en connaissances techniques et en gestion des interactions entre les différents utilisateurs des écosystèmes.» 3 Cette nouvelle agriculture, pour être résiliente, devra donc être fondée sur l’écologie scientifique. Aussi, le débat sur l’agriculture durable dépasse le clivage entre pratiques biologiques et conventionnelles. Il se fonde sur une reconsidération des mécanismes qui régissent la fertilité organo-biologique des sols et leur réappropriation par les agriculteurs. La problématique : Les expérimentations de systèmes agroforestiers se multiplient, en France comme en Europe, bien que cette pratique soit encore loin de se généraliser. En Ile de France par exemple, seuls quelques pionniers se sont lancés dans les plantations d’arbres agroforestiers. Ces agriculteurs sont isolés car ils sont largement minoritaires dans la région. J’ai choisi, à travers ce mémoire, d’analyser la nature de la relation entre ces agriculteurs et l’arbre agroforestier dans le bassin parisien (Ile de France). Pour quelles raisons, quelles croyances les agriculteurs introduisent-ils l’arbre agroforestier dans leurs champs ? 2 Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 3 Michel Griffon, Pour des agricultures écologiquement intensives, Broché, 2014
La question principale que je soulève est de savoir si ces agriculteurs – ont un rapport uniquement utilitariste envers l’arbre et donc insensible à une approche écosystémique de l’agriculture. Quel imaginaire ou système de croyances sous-tendent leurs choix ? Révèlent-ils d’autres modes de domestication de la nature, garants à la fois de productivité et de durabilité ? Mon hypothèse principale est que ces agriculteurs possèdent bien une sensibilité agroécologique qui leur est propre et qu’il est permis de la considérer comme une éthique. Je vais donc rechercher, en m’appuyant sur des entretiens, comment peut s’exprimer chez les agriculteurs cette relation au génie naturel. Comment changent-ils une méthode de travail qui a fait ses preuves et qui leur a permis - à eux et à leurs parents - de tirer un revenu tout en améliorant leurs conditions de travail? Sont-ils mus, dans leur conversion, par la volonté de sortir d’une situation délicate ? Ou bien est-ce leur éthique - professionnelle et personnelle – qui les faits tendre vers la technique agroforestière? A terme, ces agriculteurs souhaitent-ils devenir les gestionnaires à la fois de la production et des écosystèmes ? Comme le souligne Philippe Descola, à la genèse d’un changement « Ce n’est pas le progrès technique en soi qui transforme les rapports que les humains entretiennent entre eux et avec le monde, ce sont plutôt les modifications parfois tenus de ces rapports qui rendent possibles un type d’action jugé auparavant irréalisable sur ou avec une certaine catégories d’existants. Car toute technique est avant tout une relation médiate ou immédiate entre un agent intentionnel et de la matière inorganique ou vivante, y compris lui-même. Pour qu’une technique nouvelle apparaisse ou soit empruntée avec quelque chance de succès, il faut donc assurément qu’elle présente une utilité réelle ou imaginaire et qu’elle soit compatible avec les autres caractéristiques du système ou elle prends place. »4 Dès lors, la question n’est pas de savoir qui porte l’innovation agroécologique, mais de comprendre quels modèles spatiaux et sociaux sont créer et projeter par ces agriculteurs. Car les usages productifs sont aussi des représentations. Quels sont donc les attachements que ces représentations engagent ? Tenter d’apporter des pistes de réponse à ces questions, en donnant la parole aux agriculteurs et en analysant leur perception et leur appropriation de l’agroforesterie, est le but de cette étude. Ce travail doit permettre de mieux comprendre les motivations de certains agriculteurs dans leur choix. 4 Philippe Descola, Par-‐delà nature et culture. Ed Gallimard, 2005, p 525
Le site d’étude
Les terres agricoles aux marges d’une métropole ���s’imposent aujourd’hui comme un enjeu de société. Le mitage de l’espace agricole et l’étalement urbain sont des phénomènes particulièrement fort en Ile-de-France. Il constitue également une forme de consommation des terres agricoles, moins visible que celle résultant de l’urbanisation en nappe, mais tout aussi déstructurant. Il semble donc intéressant d’étudier comment le monde agricole est en capacité d’innover et de ce rendre indispensable. C’est pourquoi, cette étude se déploie sur les exploitations agroforesteries de certains agriculteurs de la région île de France qui nécessairement se projettent sur le long terme. Il s’agit de cerner la dynamique et les systèmes de valeurs de ces laboratoires disséminés sur le territoire.
Sur le plan géomorphologique, le bassin parisien est une large cuvette de terrains secondaires et tertiaires qui se redressent vers ses marges, les massifs anciens des Ardennes, des Vosges, du Morvan, du nord du Massif central et de la Bretagne. Le paysage agricole de l’île de France est en grande majorité simplifié en raison des monocultures de céréales et/ou d’oléagineux associées et des pratiques culturales intensives fortement dépendantes d’intrants. L’Île-de- France bénéficie d’un type de sols favorable à la fertilité des cultures (argileux ou limoneux). En revanche, le mode d'occupation du sol l'est beaucoup moins. L’agriculture biologique reste peu développée (1,4% de la SAU5 francilienne en 2012). Ainsi, de nombreuses communes font face à un problème de ruissellement et d’érosion des sols. Pour amorcer un changement de cap, le programme de développement rural d’île de France 2014-2020 indique « De nouveaux systèmes de cultures basés sur des pratiques innovantes peuvent apporter des réponses à plusieurs filières, comme l'agroforesterie par exemple qui répond à la fois à la prise en compte de critères environnementaux (réduction du lessivage des nitrates, contribution aux continuités écologiques, restructuration du sol, par exemple) et à la fois au développement de la filière bois. » Pourtant, l’agroforesterie et ses plus‐values sont à l’heure actuelle méconnues en Ile-de-France. Le caractère quelque peu "exceptionnel" des exploitations enquêtées questionne la place que pourrait prendre l'agroforesterie dans les grandes exploitations céréalières (qui représentent l'essentiel de l'agriculture francilienne). Or celle-ci se heurte aujourd'hui à une question d'ordre foncier. Dès lors, le cadre juridique du code rural devra nécessairement évoluer pour développer l’agroforesterie. Il n’en reste pas moins, qu’elle fédère aujourd’hui quelques agriculteurs, certainement curieux et soucieux de remettre en question leurs techniques et leurs actes professionnels. C’est dans ce contexte et avec l’idée que « le paysage est un moyen de connaissance de l'activité agricole » (Desfontaines, 1996) que s’inscrit ce projet de recherche, le profil et les motivations de ces nouveaux agriculteurs étant à étudier. 5 SAU : Surface agricole utile
Le projet de recherche : Notre projet de recherche s’intéresse plus particulièrement à l’agroforesterie de plein champ, aux paysages produits et aux acteurs-agriculteurs d’Ile de France qui décident de s’engager dans la mise en œuvre de cet agrosystème. Comment les agriculteurs perçoivent-ils cette technique et pourquoi ? Comment intègrent-ils les savoirs, les techniques de production pour parvenir, sur le long terme, à la multifonctionnalité des structures agro-forestières ? Le but de ce mémoire est d’analyser sur un territoire précis - l’Ile de France en l’occurrence - ce qui peut pousser les agriculteurs à se tourner vers ce modèle. Il s’agit de comprendre comment des modèles de relation et de comportement peuvent orienter les pratiques.
Les études qui examinent les atouts agronomiques, économiques ou écologiques de l’agroforesterie sont nombreuses. Cela nous conforte dans l’idée que l’analyse de cette pratique récente - par une approche anthropologique et ethno paysagère des pratiques agricoles et des valeurs défendues par ces agriculteurs - peut s’avérer nécessaire. Quels sont leurs profils ? Ont ils des traits communs et peut-on établir une typologie ? Il s’agit d’en dresser les « portraits » pour mieux les connaitre. Nous nous attacherons à analyser les origines de leurs motivations, pour bien comprendre les incitations personnelles ou collectives qui les poussent dans cet engagement. Nous allons faire appel au concept des représentations sociales, afin de comprendre certaines réactions, visions, présentes chez les agriculteurs d’Ile de France. Nous tenterons d’expliquer les positions et les discours qu’ils peuvent avoir sur ces « nouvelles » techniques agricoles, dont l’agroforesterie (mais aussi la culture biologique actuelle ou les techniques de travail du sol simplifiées), afin de faire ressortir les valeurs actuelles des agriculteurs, ce qu’ils entendent et perçoivent de leur biotope et de leur rapport sociaux internes mais aussi avec le reste de la société. Le travail de recherche propose donc de s’intéresser et d’interroger leurs trajectoires de vie professionnelle, leurs parcours de formation, leurs pratiques sociales et territoriales. La mise en évidence des systèmes de valeurs et de représentations devrait clarifier et expliquer la part paysagère dans les différents choix - engagement, techniques, etc. - de l’action agroforestière. Nous situons cette recherche dans le sillage des réflexions engagées par le géo-agronome Jean-Pierre Desfontaines, qui s’intéresse à l’inscription des pratiques des agriculteurs dans l’espace. Articulant les dimensions techniques et humaines, il développe une approche des activités agricoles dans le territoire, qui interroge la façon dont les agriculteurs pensent, conçoivent et construisent leurs territoires d’exploitation et donc contribuent à la production d’un bien commun : le paysage. Notre étude s’attache à dessiner les contours des postures de ces nouveaux paysans de l’arbre de la productivité au patrimoine, et de la biodiversité au carbone. Ces nouvelles pratiques agricoles donneront–elles jour à une production sociale du paysage ? La fertilité renouvelée de nos sols sera–t–elle perceptible à l’œil ? L’arbre deviendra-t-il un nouveau marqueur de nos paysages alimentaires ? Nous tenterons enfin d'identifier les limites et les contraintes de l'agroforesterie contemporaine.
Ce travail se fixe comme objectifs : - de mettre en lumière et en évidence la diversité des perceptions et représentations des agriculteurs sur les arbres, les haies et le sol dans les paysages de grandes cultures en île de France. - de recueillir les paroles des agriculteurs sur ce sujet par des temps de rencontre et d’échange. La matière visuelle et sonore ainsi récoltée est un support d’analyse, puis pourra ensuite devenir un support de discussions lors de rencontres, débats sur la question. - d’observer les dynamiques d’évolution des paysages sous l’effet de dynamiques agricoles, par la constitution d’un fond de photographies documentaires. Méthode : Ce travail convoque plusieurs disciplines croisées : la sociologie, l’anthropologie, la géographie, et l’audiovisuel. L’approche mêle l’observation, le récit, l’implication des agriculteurs et le recueil des données avec la photographie et la bande sonore. Les rencontres avec plusieurs agriculteurs sont la base de notre mode d’enquête, pour échanger et témoigner autour de l’association « homme/arbre/sol ». Les notions de production et de paysage sont ici croisées pour conduire à une meilleure appréhension et compréhension des réalités physiques et humaines des paysages agroforestiers. Nous mettrons l'accent sur les pratiques agroforestières récentes, et leurs appropriations par les acteurs. Pour réaliser ce travail, j’ai décidé d’utiliser l’étude qualitative avec des entretiens semi-directifs en profondeur et de visu. Ce type d’entretien s’appuie sur un guide d’entretien et permet un réel dialogue en contenant beaucoup de questions ouvertes. Le but est d’obtenir la vision, les attitudes, le positionnement de l’interviewé de façon la plus spontanée possible et sans en altérer les convictions. L’échantillonnage est composé principalement d’agriculteurs de Seine et Marne et des Yvelines. Guide d’entretien (annexe 1) : Nous souhaitons étudier les parcours professionnels et personnels d’un groupe d’agriculteurs en lien avec le questionnement qui nous préoccupe sur le sens et la mise en application d’une démarche d’agroforesterie dans la création d’un bien commun paysager. Concernant notre étude, le guide d’entretien est composé de onze parties. Tout au long de ces parties, des questions ciblent la position de l’agriculteur par rapport à différents sujets relevant de l’agroécologie mais aussi son comportement dans les pratiques d’agroforesterie en cours, afin de mieux cerner son discours. En donnant la parole aux agriculteurs, on va pouvoir connaitre quelles peuvent être leurs réactions face à de nouvelles techniques dont l’évaluation est multicritère (production, paysage, durabilité ́, prise en compte des enjeux environnementaux locaux et globaux...) et la définition de leurs priorités.
La transcription des entretiens se fait en trois étapes : 1. La prise de notes durant l’entretien 2. Le tableau synthétique 3. L’ajustement lors de l’écoute des enregistrements. L’échantillonnage des agriculteurs (en annexe 2) Afin de déterminer un fil conducteur, ce travail s’articule autour des projets d’exploitation en agroforesterie en Ile de France. En lien avec l’association française d’agroforesterie, une dizaine d’agriculteurs sont donc sélectionnés dans la région, en s’efforçant de choisir une large diversité de profils, de localisations géographiques, d’activités etc. Deux ou trois agriculteurs qui ne souhaitent pas avoir recourent à l’agroforesterie seront aussi enquêter pour comprendre leurs points de vues. Une fois les agriculteurs contactés, des dates de visites seront fixées pour ceux qui acceptent de participer à cette étude. Le projet se dessine autour de 12 rencontres potentielles. Démarche de recherche sur le terrain : Chaque visite chez un agriculteur est archivée sous la forme d’un entretien semi-directif, enregistré et photographié. La rencontre se déroule sur une demi-journée en suivant l’agriculteur dans ses tâches quotidiennes, tout en le questionnant. Nous commencerons par un entretien en salle puis un entretien en marchant dans l’exploitation. L’ordre des questions n’est pas systématique et varie en fonction de nombreux paramètres tels que le lieu, les conditions, la sensibilité ou la disponibilité de l’interlocuteur. Dans un second temps individuel, le dessin sera l’outil privilégié pour traduire les relations observées entre les actions de l’agriculteur et les formes visibles du paysage. Démarche de recherche dans mon projet personnel :
Issue moi même, d’une famille d’agriculteurs bretons, qui a subi la main mise du lobby agroalimentaire sur leur production, je suis consciente du travail nécessaire de médiation, pour une gestion écologique de nos cultures et de nos paysages.
Ce travail de recherche en paysage, est une continuité de ma recherche en tant qu’artiste car il questionne l’ensemble du dispositif de médiation - technique, social, politique - par lequel les projets de paysage prennent sens. Les changements de mentalités et de regard sont pour moi les leviers les plus efficients pour asseoir des projets dans le long terme. Cette approche sociologique, que j’envisage de développer dans ce mémoire, permet d’envisager le(s) paysage(s), façonné(s) par les activités humaines - et les façonnant en retour - en excédant les formes strictement esthétiques de leurs représentations.
Calendrier de projet : Mars : Recherches documentaires, colloque, réunions afac, association française d’agroforesterie, entretiens préparatoires, rencontre avec A. Sourriseau (paysagiste et animatrice du groupe agroforesterie (Graaf Ile de France) pour constituer un panorama des agriculteurs agroforestiers de la région. Avril-Mai : Rencontres avec les agriculteurs, selon leurs disponibilités et leur réceptivité Juin : Analyse des matériaux récoltés : lien entre les exploitations, prise de recul sur le contenu des rencontres, questionnements, croisements des témoignages et questionnement des points de convergences, des liens, des dissonances. Archivage et montage des images et bandes sonores, Juillet –Août: élaboration d’un plan de rédaction, rédaction du mémoire,
Septembre : soutenance orale à l’Ensp Versailles en vue de l’obtention du master 2 TDPP Annexe 1. Le Guide d’entretien PREMIERE PHASE : ENQUÊTE CHEZ L’AGRICULTEUR 1. Activité professionnelle 2. Comportement vis-à-vis de l’exploitation 3. Comportement vis-à-vis des pratiques agroécologiques 4. Comportement vis-à-vis des enjeux environnementaux et des sols 5. Perceptions autour de l’arbre 6. Comportement vis-à-vis de l’agroforesterie 7. Comportement vis-à-vis du paysage 8. Valeurs 1. Activité professionnelle - Depuis quand exercez vous votre activité d’agriculteur ?
- Quelle a été votre formation ? - Pouvez vous nous expliquer, décrire votre activité professionnelle (mission, projets collaboration)?
- Avez-vous d’autres responsabilités professionnelles ? (Syndicat, coopérative, groupement d’agriculteurs, association) ���
2. Comportement vis à vis de l’exploitation
- Quelle est l’histoire de l’exploitation ? (Principales étapes et chiffres clés) /
- Vous est-il arrivé d’abandonner des pratiques ou des ateliers ? Avez-vous toujours eu les mêmes productions sur l’exploitation ? Quels ont été les moteurs des différents changements ?
- Etes vous propriétaire ou bailleur ? Si, oui quel type de bail avez vous signé?
- Avez vous un projet de diversification ?
- Avez vous un successeur ou un repreneur ?
- A quelle échelle de temps raisonnez vous ? - (Avez vous des photos d’archive de l’exploitation ?) 3. Comportement vis-à-vis des pratiques agroécologiques - Quel est votre type de conduite (biologique, conventionnelle, de conservation, raisonnée certifiée...) ?
- Que pensez vous de l’agriculture agroécologique ?
- Si, c’est le cas, combien de temps a duré la conversion ?
- Comment vos méthodes de travail ont été modifiées? - Quels sont les avantages et les inconvénients de votre choix? - Quelle est selon vous l’image renvoyée par l’agriculture agroécologiue ? ���
- Selon vous, comment votre pratique de l’agriculture est-elle liée à la qualité de l’eau, de l’air et du sol ? 4. Comportement vis-à-vis des enjeux environnementaux et des sols - Au cours de ces dernières décennies, avez-vous constaté une évolution des ressources naturelles environnantes ? ���
- Avez-vous une parcelle sur laquelle une contrainte environnementale fait que vos pratiques sont différentes? (captage d’eau potable, ZICO, ZNIEFF, Natura 2000...) ���
- Avez vous des problèmes de ruissellement sur vos parcelles?
- Quel est l’enjeu qui vous parle le plus ? (l’eau, l’air, l’érosion, la biodiversité, sanitaire)
Sols
- Quelle est la nature générale de vos sols ?
- Quel travail du sol effectuez-vous ? Avec quelles machines ?
- Avez-vous modifié ces techniques depuis vos débuts ?
- Connaissez-vous les taux de matière organique présents dans vos parcelles ?
- Pratiquer vous les TCS ou le semi directs ?
6. Comportement vis à vis de l’agroforesterie - Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à mettre en place votre projet agroforestier ? - Vos projets récents de plantation sont-ils motivés par l’amélioration de votre cadre de vie, de votre système de production, ou de l’image de la profession agricole ? - A qui avez vous fait appel pour la plantation des parcelles ? Avez vous eu des financements ? Si-oui lequel ? Sous quelles conditions ? - Pour quels types de productions ? (Bois d’œuvre, bois fourrage, trogne, fruitiers) - Les espèces sont-elles locales ? Il y a t-il des essences mellifères ? - Qui s’occupe de la gestion des arbres ? Qui vous a légué ces savoirs faire ? Allez vous faire une formation (taille/broyage/entretien)
- Prévoyez vous d’autres plantations, dans quel but ?
- A qui souhaitez vous transmettre ces arbres ? Et pourquoi ? - Quels sont selon vous les freins à la mise en place d’une parcelle agroforestière ?
- Au niveau juridique, comment sont envisagés vos droits sur ces arbres dans votre bail ? 5. Comportement vis à vis de l’arbre - Raconter moi l’histoire des arbres de votre exploitation? - Il y avait-il des arbres, des haies qui ont été arrachés au moment du remembrement ? Avez-vous vous même arraché des arbres ? En avez vous replanté ?
- Comment percevez vous l’arbre et la haie champêtre ? (Représentations, techniques, culturelles, paysagères, symboliques)
- Quels sont pour vous les avantages écologiques de l’arbre ? (Ruissellement/érosion, vent, biodiversité, résilience/équilibre de l’écosystème, qualité de l’eau, enrichissement des sols) - Quels sont les avantages socio-économiques de l’arbre ? (Paysage, ombre, microclimat, délimite les parcelles, patrimoine, stabilise les sols, stock le carbone, gibier, valorisation du bois, auxiliaires des cultures, biomasse) - Quels sont les inconvénients à la présence de l’arbre ? (Concurrence avec les cultures (lumière/eau), temps de travail, gène la mécanisation, connaissance sur les arbres, perte de rendement près des arbres) 7. Comportement vis à vis du paysage - Quels sont les éléments fixes du paysage, éléments naturels, semi-naturels bosquets (composition/localisation), arbre isolé (localisation/essence, mode de conduite), bandes enherbées, haies (longueur, fréquence), IAE, (les infrastructures agro-écologiques) ? - Comment vous imaginez vous les limites de votre exploitation? - Comment percevez vous l’évolution de ce paysage entre hier, aujourd’hui et demain ? 8. Valeurs - Quelles valeurs vous semble-t-il nécessaire de prendre en compte dans votre activité professionnelle ? - Ces valeurs ont-elles évolué depuis le début de votre activité professionnelle ? -Vous sentez vous autonome dans l’exercice de votre profession? - Avez-vous remarqué de grands changements concernant les techniques ces dernières années ? Concernant les mentalités ?
- Selon vous, d’où viendront les solutions pour l’agriculture de demain?
DEUXIEME PHASE : PARCOURS DU TERRITOIRE Proposition d’une visite du paysage de son exploitation, lui demander de nous montrer notamment :
- Les arbres isolés, les haies et les arbres intra-parcellaires. - Le sol en faisant une carotte de terre (en lui demandant nous pouvons en
garder un échantillon)
L’enquêté déterminera lui même le trajet de la visite, le moyen de transport, les différentes étapes du parcours.
Nous lui demandons de décrire ce qu’il nous montre et qu’il nomme le type de relation qu’il entretient avec ces éléments du paysage.
Annexes 2
Liste des sites d’étude choisis - Echantillonnage des agriculteurs ayant un projet en agroforesterie (échantillonnageen cours d’élaboration)
Alain Stevenel, Vicq (78)
• surface de la principale parcelle en agroforesterie (en m²): 2.7 ha • année de mise en place des premiers fruitiers (passée ou à venir): ligneux en 1993 • activité principale de l'exploitant: agriculteur • adresse électronique: alain(at)equitaf-safran.fr • site internet: www.equitaf-safran.fr
Gaec Maurice de Poincy (77) décembre 2014
• Site internet : https://www.mauricedepoincy.fr/cgv.html Rémi Seingier, Terre de Liens, Lumigny (77),
• Parcelles agroforestières : Première plantation, décembre 2014 • Deuxième phase de plantation. Janvier 2015
Isabelle Godard, Claye-Souilly (77)
• Projet agroforestier en attente de financement participatif • http://lespotiront.e-monsite.com/pages/producteurs/la-ferme-d-isabelle-godard.html • [email protected]
Pierre Godard, Claye-Souilly (77),
• Parcelle agroforestière: plantation janvier 2015 Charles Monville, Plateau de Saclay, Bièvres, Essonne, Ferme Favreuse
• Productions de volailles en plein air, AB, sur 4 hc • Plantation de fruitiers et arbustes : novembre 2014 • Circuit court : AMAP Les Jardins de Cérès
Valentine de Ganay, Domaine de Courances (Seine-et-Marne, Essonne),
• Plantations janvier 2015
Ste ́phane Morel, Seine-et-Marne (77) a ̀ Bernay-Vilbert
• Polyculteur produisant selon les principes de l’agriculture de conservation (réduction du travail du sol, rotations culturales, utilisation de couvert végétal
Bibliographies : Descola P, Par-delà Nature et Culture, Gallimard, Paris, 2005 Depardon R. La terre des paysans, ed Seuil, 2008
Burel F., Baudry J., Ecologie du paysage, Concepts, méthodes et applications, ed Tec & Doc, Paris, 1999
Michon G., Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde, Agroforesteries Vernaculaires, Actes Sud et l’IRD, 2014
Griffon M., Pour des agricultures écologiquement intensives, Broché, 2014
Mazoyer M., Roudart L., 1997 : Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine. Le Seuil. Note de lecture de Jean-Claude Tirel dans Economie rurale, 1998. En ligne sur Persée.fr. Dupraz C., Capillon A., L'agroforesterie: une voie de diversification écologique de l'agriculture européenne?, Cahier d'étude DEMETER - Economie et stratégies agricoles, Paris, 2005 Magnaghi A, La biorégion urbaine, Petit Traité sur le Territoire Bien Commun, 2014 Magnaghi A, Le projet local, Architecture + Recherches, Edition, Mardaga, 2000 Michelin Y et Candau.J, le paysage, outil de médiation, Apport, 2009 Nougarède O, “paysans et forestiers”, dans la forêt, les savoirs et le citoyen: regards croisés sur les acteurs, leurs pratiques et les représentations, op.cit Torquebiau E., L’agroforesterie, des arbres et des champs, L’Harmattan Bories O., Desiree A., Hewison N., Agroforesterie et paysage. L’exemple d’une exploitation agro forestière dans le Volvestre , Revue Forêt Privée Française, 2014 Deffontaines JP., Géoagronomie, paysage et projets de territoire, sur les traces de, éditions Quae Convention européenne du paysage : www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/ default_fr.asp
L’agriculteur, l’architecte et le paysage, in revue D’Architectures, n° 188, février 2010 ���
Vision paysagée, vision partagée, plaquette et CD sur la vallée de la Bruche 2013 www.visionpaysagée.org • Dessine–moi un paysage bio, http://vimeo.com/42195561
http://vimeo.com/42195561, film de Lamia
Otthofer, Arroyo N., Goupil L., Bergerie Nationale, 2012.
AFAHC , L’arbre champêtre dans la nouvelle PAC, 2011 http://www.afahc.fr/ fichiers%20pdf/PAC/Arbre%20champetre%20et%20PAC%202013%20V2.pdf
Calame M., Territoire agricole : après l’industrie ? le jardin !, Les Cahiers de l’Ecole de Blois n°9, Paris, Editions de la Villette, 2011.
Le paysage clé d’entrée pour un développement durable des territoires, fiches actions présentées lors des rencontres du collectif paysage(s) 2010 http://www.collectifpaysages.org/SUR_LE_ TERRAIN_%7C.html
Bonneaud F., Schmutz T., Paysage et aménagement foncier, agricole et forestier, guide méthodologique de 72 pages publié par le Ministère de l’agriculture, décembre 2010.
Agriculture et Paysage, présentation des outils APPORT 8 plaquettes, 4 cours ppt... 2009, www. agriculture–et–paysage.fr
Les entretiens du Pradel, 2009, http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Revue_AES/ AES_vol1_n1/AES_Vol1_n1_14_Papy_debat_HVE.pdf
Principes d’Aménagement et de gestion des Exploitations par des Structures paysagères Arborées 2009, www.afahc.fr/fichiers%20pdf/pagesa/PAGESA.pdf ���
Le manifeste des paysages in www.collectifpaysages.org 2007 ���
Cabanel J., Pays et Paysages de France, Editions du Rouergue. ���
Toublanc M., Paysages en Herbe, le paysage et la formation à l’agriculture durable, Educagri– éditions, 2004. ���
L’agriculture et la forêt dans le paysage, ministère de l’agriculture, 2002, http://www. mairieconseilspaysage.net/documents/Agriculture–foret–paysage.pdf
Filmographie : Depardon R. Profils paysans, l’approche (2001), le quotidien (2005), la vie moderne (2008) Marchais D. Le temps des grâces, Capricci Films, 2009