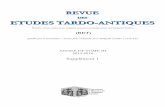Ils mangèrent tous de la manne
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Ils mangèrent tous de la manne
UdeM on mange (aussi) comme on croit GRASExode 16 : Ils mangèrent tous également la manne
1. Premières réactions
• Ce pain qui tombe du ciel pourrit s’il n’est pas partagé parmi
les membres de la communauté.
• Le peuple nomme sa nourriture par une question: « qu’est-ce ? ».
Quelle est la manne dans le désert de notre modernité
postindustrielle ?
• Jusqu’à quand refuserons-nous d’écouter les lois simples de
Dieu ?
2. Lecture du texte
2.1. Indications pour la lecture
2,7,8,9,12 וווו luwn
« Marmoner et insister » : Luwn évoque une rumeur à voix basse. Lorsque les
traducteurs choisissent le verbe « murmurer », l’insatisfaction
n’est pas aussi présente que s’ils traduisaient par «se plaindre». En
fait, les membres de la communauté ronchonnent contre leurs mauvaises
conditions de vie.
Groupe de recherche sur l’alimentation et de la spiritualité - Directeur: Olivier BauerFaculté de théologie et de sciences des religions - Université de Montréal
C.P. 6128 Succ. Centre ville - Montréal QC H3C 3J7 - [email protected] - Téléphone: (++ 1) 514 343 6861 - Télécopie: (++ 1) 514 343 5738
3,4,8,12,15,22,29,32 ווו lechem
«Ce qui nourrit» ou «pain» : Quand Moïse parle de pain descendu du ciel, il
parle d’une matière comestible nourrissante.
4,5,16,17,18,21,22,26,27 laqat וווו
« Ramasser» : La majorité des traductions françaises parlent de
« recueillir » la manne, ce qui soustrait les idées de « ramasser »
ou de « regrouper ». En utilisant laqat à neuf reprises, l’auteur
oriente le lecteur vers des particules de mannes éparpillées qu’il
faut ramasser et regrouper, plutôt que vers un fruit ou une
nourriture végétale qu'il faudrait récolter.
14 ווווו וו וווו chacpac dac kephowr
« Flocons fins et givrés » : La manne n'est pas la croute fine, le givre
cassant des traductions françaises, mais des particules (des
«écailles» dans la nouvelle traduction Bayard) givrées ou
cristallisées comme du sucre ou du sel par exemple.
15,31,33,35 וו man
« Qu’est-ce ? » : La manne est une question. Moïse dit que c’est du pain,
mais les membres de la communauté persistent à nommer cette
nourriture de la question que son mystère soulève.
Nancy LABONTE GRAS 2
31 ווווו וווווו וווו ta'am tsappiychith dbash
« le goût du gâteau avec miel » : Dans la bouche, les particules de manne
révèlent un goût de gâteau au miel, de gaufrettes au miel ou de
beignets imbibés de miel.
2.2. Le texte dans son contexte
Le livre de l’Exode tel que nous le connaissons est la compilation
d'une tradition orale réécrite plusieurs fois. Le livre aurait été
rédigé au retour en Judée, après l’exil à Babylone, plus de 800 ans
après que les aventures qu’il décrit se sont éventuellement
déroulées. L’intrigue du livre de l’Exode représente-t-elle une
allégorie, répétant l’Histoire qui se répète ?
Exode forme un livre parce que ses quarante chapitres composent la
narration d’un peuple asservi qui réussit à se libérer de la
domination d’un roi et à s’enfuir en terre nouvelle sous la
protection d’un Seigneur Dieu. Le récit peut être divisée en trois
parties : i) la communauté d’Israël se multiplie et lutte contre le
joug de l’empire égyptien (1 – 15), ii) la libération amène les
épreuves dans les contrées sauvages du désert, mais elle offre aussi
l’occasion de connaitre le Seigneur Dieu (15 – 19) et iii) le
Seigneur Dieu institue une convention avec le peuple d’Israël (20 –
40). Exode 16 appartient à la seconde partie. Israël s'y plaint de la
soif et de la faim.
Nancy LABONTE GRAS 3
2.3. Structure du texte
Exode 16 peut être fragmenté selon quatre temps dans le récit. Au
début (1-10), Moïse et Aaron, son frère ainé qui est un sage,
entendent les plaintes de la communauté et reçoivent le plan de Dieu.
Ensuite (11-21), la communauté apprend à recueillir la manne selon
des règles de partage. Puis (22-31), la communauté reçoit les règles
relatives à la manière dont la manne doit être recueillie le sixième
jour, veille d’un jour de repos, ce qui donne lieu à l’institution du
Sabbat. Finalement (v.32-36), Aaron est chargé de créer un mémorial
de la manne devant la charte donnée par Dieu à Moïse tandis que sont
précisées la période de consommation de la manne – durant quarante
années – et les unités de mesure – « L'omer est un dixième d'épha »
(v.36).
2.4. Commentaire
Afin de relever les pratiques entourant la consommation de manne,
nous choisissons d’utiliser pour le commentaire l'un des outils de la
praxéologie pastorale, cette méthode de théologie pratique développée
à la Faculté de théologie et de sciences des religions de
l’Université de Montréal dans les années 1970. L’outil vise à dégager
les cinq fonctions d’élaborations, pour faire apparaître les valeurs
d'une pratique. L’élaboration des pratiques s’appuie sur les réalités
matérielles, les devenirs personnels et collectifs, les enjeux
éthiques et les relations à l’Ultime, au Seigneur Dieu, ou à quelques
principes cardinaux qui soient.
Nancy LABONTE GRAS 4
a) Réalités matérielles
Pour la communauté d’Israël, la réalité se compose premièrement de
ses murmures, qui sont en fait des plaintes, ensuite de la couche de
rosée, de la manne et des cailles. Nous savons aussi que les membres
sont regroupés par tentes. Les murmures et les tentes feront partie
des sections suivantes, respectivement, de la relation à l’Ultime et
des devenirs collectifs. Pour l’instant, examinons les réalités
matérielles que sont la rosée, la manne et les cailles.
Nancy LABONTE GRAS 5
La manne ne ressemble pas à de la nourriture ou à du pain comme Moïse
persiste à le dire (15), et les flocons fins et givrés (chacpac dac
kephowr) soulèvent la question « Qu’est-ce ? » (man). La manne est une
question, et la question de ce qu’elle est n’est toujours pas
résolue, même si une myriade de théories ont vu le jour : ce serait
des rayons de miel, l’exsudation d’un arbuste, des microalgues
tombant avec les vents du sud-est, des insectes aquatiques, des œufs
d’insecte, etc. Le verset 14 décrit la manne dans son aspect visuel,
tactile et peut-être sonore – ce que complète la description du
verset 31. Nous savons donc que cela tombait du ciel, était
floconneux et ’d’environ 4 mm, était blanc et on pouvait la cuire, le
bouillir ou le panifier. Cela goûtait le miel, fondait à midi, même
les rations supplémentaires pourrissaient, sauf le sixième jour où
les rations quotidiennes doublaient et pouvaient être consommées
pendant le jour du repos de Dieu. Moïse nomme cela du pain, ce qui
signifie que c’est de la nourriture (lechem) et il parle aussi des
cailles comme de la viande plutôt que du lechem – Israël ne semble
pas manger de viande dans ce chapitre, la manne suffisait-elle à
leurs besoins? Les cailles sont envoyées sur le camp le soir de la
plainte des enfants d'Israël, nostalgiques des pots de viande en
Égypte. Le Dieu de l’Exode répond à la demande.
b) Devenirs personnels
Exode 16 met en scène deux protagonistes individuels et un
protagoniste collectif (la communauté des fils ou des enfants
Nancy LABONTE GRAS 6
d’Israël) dont nous aborderons le devenir dans la section suivante.
Les protagonistes individuels sont Moïse et Aaron.
• Moïse réalise sa mission de représentant : devant Dieu, il
devient le « vous » qui représente la communauté, mais devant la
communauté, il représente la loi divine. Cependant, on le voit
irrité devant les plaintes de la communauté et lorsque certains
membres n’écoutent pas les consignes. Il n’existe que pour
servir d’interface entre son peuple et son Seigneur. Ce Seigneur
ne s’adresse qu’à lui – il est peut-être privilégié, ou
suffisamment éveillé pour l’entendre et l’écouter.
• Aaron agit comme un serviteur du Seigneur. Il est intéressant de
noter qu’Aaron est le frère ainé de Moïse et qu’ils ont tous
deux plus de 80 ans. Aaron est perçu dans les exégèses
rabbiniques comme un personnage lumineux et spirituel qui
s’exprime plus aisément devant la communauté. Exode 16 présente
Aaron au service de son cadet qui porte la parole de Dieu et,
par la même occasion, il déploie une pratique de service
cultuel.
Nancy LABONTE GRAS 7
c) Devenir collectif
La communauté est composée des fils d’Israël (ben). Les filles
d’Israël (bath) sont absentes du récit. Peut-être qu’il n’y avait pas
de filles, ou sinon, les fils préfigurent les enfants d’Israël. Pour
contourner cette difficulté, nous choisissons ici de parler de la
communauté d’Israël. Cependant, au verset 31, les fils ou les enfants
d’Israël deviennent la maison d’Israël (bayith). Pourquoi ? Afin de
mieux comprendre, voyons ce que cette «maison» met en action : elle
donne à la nourriture que Moïse nomme « du pain » le nom de
« manne ». La maison d’Israël devient une communauté autonome, et non
plus un regroupement de plusieurs enfants (ou fils), à partir du
moment où elle nomme sa nourriture.
La communauté est divisée par tente ce qui devient l’échelle des
sous-ensembles du large groupe. Chaque tente est sous la
responsabilité d'un chef qui ramasse le qu’est-ce et le rapporte à sa
tente pour le répartir entre chaque membre. Il y en a assez pour tout
le monde et tous ont exactement ce qu’ils ont besoin de manger
quotidiennement.
d) Enjeux éthiques
Du côté de Moïse, la pratique de ramasser le pain de Dieu s’élabore
avec des ordres stricts qu’il communique aux fils d’Israël, mais
certains n’en font qu’à leur tête, ce qui l’irrite particulièrement
(20). « Que personne n’en garde jusqu’au matin » (19) et voilà que
certains tentent de faire des provisions, malgré ses ordres ! Soit on
Nancy LABONTE GRAS 8
ne l’écoute pas, soit on ne l’entend pas, soit il ne s’exprime pas
bien. L’éthique de Moïse consiste à respecter les ordres du Seigneur.
Nancy LABONTE GRAS 9
Le Seigneur de son côté organise cette distribution d'aliments pour
démontrer sa fidélité envers la communauté en observant une éthique
de justice sociale. Mais, sa fidélité qui consiste à répondre « aux
murmures » ne vient pas sans contreparties ! Il attend, en échange,
que le peuple marche selon sa loi. La provision quotidienne qu'il
fournit est aussi une mise à l’épreuve. L'épreuve pourrait être celle
du respect de la loi du Sabbat – dans ce cas, l’éthique du Seigneur
dans Exode 16 résiderait dans une alliance assurant le bien-être du
peuple s’il marche selon ses lois – et quand on sait qu’une des lois
stipule de se reposer toute une journée, on trouverait là une éthique
hygiéniste.
Il est intéressant d’observer que la production et la consommation se
séparent au début du Sabbat. En Exode 16, les enfants d’Israël
apprennent une éthique de production et de consommation alimentaire
qui implique le respect des lois de Dieu. Durant le Sabbat, le jour
du repos du Seigneur, la communauté mange, mais ne recueille pas et
ne cuisine pas. La nourriture est offerte par grâce la veille.
Travailler et cuisiner sont des activités profanes, tandis que manger
s’inscrit dans les activités permises lors d’un jour sacré.
e) Relations à l’Ultime
Nancy LABONTE GRAS 10
La première partie d’Exode 16 expose un peuple mécontent de Moïse et
Aaron qui l’ont amené en exode dans le désert, loin du confort
alimentaire dont il bénéficiait en Égypte. Cependant, les deux frères
transfèrent la faute des plaintes sur Dieu en minimisant leur rôle :
ils ne sont que les médiateurs des relations à l’Ultime. Pour que les
fils arrêtent de marmonner, Moïse ordonne de recueillir la manne
selon des règles précise et Aaron attire l’attention de la communauté
sur la gloire de Dieu dans la nuée du matin.
De son côté, le Seigneur aborde la relation avec les Israélites comme
une épreuve qui dure quarante ans et pour laquelle le calendrier
d’Israël sera désormais marqué. Quarante ans pour dire que l’errance
dans le désert a duré longtemps, le temps qu’ils comprennent
l’épreuve du partage et du sabbat. D'un sabbat qui correspond au jour
du repos du Seigneur : on mangera les restes de la veille prévus pour
ça, afin qu’il ne travaille pas ce jour-là. Suivre ce principe
démontre la réussite de la relation entre Dieu et Israël, et établit
un ordre social qui libère et assure la protection de Dieu. La
relation mutuelle entre le peuple et le Seigneur, pourvu qu’elle soit
réussie, est bienveillante.
Nancy LABONTE GRAS 11
3. Enjeux théologiques
a) Le goût de la prière
Le Seigneur Dieu entend les murmures de la communauté d'Israël. Il
donne alors des consignes à Moïse qui visent à tester la foi du
peuple. Les écrits rabbiniques du Midrash racontent que Dieu conteste
les plaintes incessantes des enfants d’Israël qui errent dans les
contrées sauvages du désert. Le Seigneur de l'Exode suggère de
réfléchir à notre demande et de prier simplement un murmure qu’il
écoutera. Dans cet épisode, l’épreuve consiste à tester l’obéissance.
Combien de temps cela prendra-t-il pour que les enfants écoutent les
instructions du Seigneur sur le partage et le sabbat ? Quarante ans ?
Au quotidien, recueillir la manne c’est aussi prendre le temps de
faire le silence afin de « se » recueillir et d’écouter ce que Dieu
nous demande – notre manne peut aussi être nos dons personnels à
partager avec la communauté.
b) La prière du goût
Les écrits rabbiniques du Midrash racontent aussi que ceux qui
mangèrent la manne y trouvaient le goût qui leur plaisait : du pain
ou des gâteaux avec du miel. Le Seigneur de l'Exode donne la
possibilité de cuisiner le goût que l'on aime. Il y a une
transmission de vie par la manne et cette vie s’agrémente de miel.
Israël arrive à manger de la manne aussi longtemps sans se plaindre
Nancy LABONTE GRAS 12
parce que la joie émane enfin du partage qui fait que tous en ont à
leur faim et à leur goût.
Leur appartenance culturelle et religieuse est liée à cette
expérience vécue. Ensemble, ils voient la gloire de Dieu dans la nuée
du matin, ensemble, ils ramassent le qu’est-ce, ensemble, ils nomment
cette nourriture surnaturelle, ensemble, ils goûtent la douceur des
gâteaux avec du miel, ensemble ils en gardent une portion dans une
jarre pour témoigner de la grâce du Seigneur auprès de leurs
descendants.
Nancy LABONTE GRAS 13
c) L’apprentissage de la bienveillance mutuelle
Le livre de l’Exode compile une série de contes où Dieu établit une
relation particulière avec Israël. Celle-ci découle de la promesse
d’un accompagnement bienveillant, doublé de l’exigence d’être fidèles
et d'obéir aux lois de Dieu. Obéir n’est peut-être pas le mot le plus
approprié. Dans la perspective de Moïse, il y a prescription et
commandement, mais dans celle de Dieu, il y a curiosité et intérêt.
Il veut voir si le peuple va « marcher » tel qu’il le suggère (4),
c'est-à-dire qu’il s’attend à un fonctionnement communautaire
particulier : la maison d'Israël sortira chaque matin ramasser sa
ration du jour et le sixième jour, elle préparera une double ration
en prévision du septième jour où il sera inutile de sortir pour en
ramasser. Ce septième jour, le Seigneur se reposera et on respectera
son repos en mangeant les restes de la veille. Ils sont prévus pour
ça. En pratique, tous en auront pour leur faim parce que les chefs de
chaque tente en ramasseront suffisamment pour ceux de leur tente,
parce qu'ils procèderont à une répartition équitable. En écoutant
Dieu, la communauté d’Israël restera vivante même dans l’adversité du
désert. L’écoute mutuelle se doublera de bienveillance mutuelle et se
répercutera dans la vie de la communauté.
4. Entendre ce texte aujourd’hui
Nancy LABONTE GRAS 14
L’éthique proposée dans le projet de Dieu consiste à travailler pour
assurer sa survie, mais aussi de prendre le temps de se reposer et de
partager les dons de Dieu avec bienveillance au sein d’une
communauté, de produire et de consommer seulement ce qui est
nécessaire, de ne pas tenter d’en profiter, de ne pas gaspiller et de
se souvenir de la grâce de Dieu.
a) Les justes règles d'un partage équitable
Nous apprenons dans Exode 16 que le travail et le repos doivent être
équilibrés, que la consommation peut être simplifiée, que le partage
des richesses s’inscrit dans une histoire de communauté de partage et
que nous devons être responsables dans l’utilisation des ressources
extraites de la terre. Par analogie, il faudrait transposer ce récit
aux principes et aux normes qui influencent le travail, la
consommation, le partage des richesses et la protection de
l’environnement. La nourriture abondante doit être partagée afin que
tous et toutes reçoivent autant qu'ils peuvent manger (18). Et même
si la surexploitation conduit plus à la désertification qu'à la
pourriture, la communauté humaine entière est visée par ce conte.
Nancy LABONTE GRAS 15
L’économie actuelle est basée sur l’exploitation des humains et des
monocultures potagères, au lieu de se fonder sur les droits de la
personne, sur l’équité et la solidarité. Une nouvelle économie
inspirée de la justice sociale illustrée dans Exode 16 implique de
partager les biens communs, la propriété. Elle requiert une
participation volontaire pour le bien-être de la communauté. Or, que
sont ces biens communs ? Dans un fascicule du Conseil œcuménique des
Églises, on emploie une méthodologie qui lie la pauvreté, la richesse
et l’écologie. Ainsi les biens communs sont essentiels pour élever la
personne dans une relation de respect de la dignité des personnes qui
vivent dans une communauté de partage et qui participent
démocratiquement aux décisions affectant leurs groupes. Les biens
communs n’incluent pas la nourriture, mais ce qui permet de la
produire et de la partager – certaines terres pour lesquelles on paie
des taxes, l’eau, l’éducation, les savoirs, la solidarité, la liberté
– et ce qu'elle garantit – la santé.
b) La culture de la manne
Nancy LABONTE GRAS 16
La sécurité alimentaire est une idée ancienne avec un nom nouveau
pour dire que tous et toutes devraient recevoir autant qu'ils peuvent
manger (18). Récemment, cette notion s’est assortie d’une vision
locale des écosystèmes qui s’incarne dans des pratiques de jardinage
de proximité, de jardinage urbain et même de partage gratuit des
récoltes. Sans être religieuses, ces initiatives collectives engagent
les personnes dans le respect mutuel, l’acte de servir, le rejet de
la violence et de la faim ainsi que la communauté de biens à travers
des activités collectives d’agriculture maraîchère. Quelle part de la
culture juive avons-nous retenue dans nos pratiques laïques : la
coutume du sabbat ou la culture locale d'aliments qui surgissent au
sol chaque matin et qu’on ramasse chacun pour tous ceux de sa
« tente » ? Cette nourriture mystérieuse, ce qu’est-ce, serait-elle une
semence à cultiver et à perpétuer pour les descendants ? Lire Exode
16 aujourd’hui, c’est lire un texte ancien en 2014, année déclarée
par l’Organisation des Nations Unies : Année internationale de l’agriculture
familiale. Une belle occasion de repenser à notre rapport à la
nourriture et à la consommation. Écouter Dieu aujourd’hui, c’est voir
les mouvements d’espérance s’organiser en faveur de la protection de
l’environnement et de la production alimentaire en lien avec les
enjeux de justice sociale.
5. Propositions pour la prédication
a) Culture de prière participative
Objectif : Activer la prière en participant à réaliser ce qu’on demande.
Nancy LABONTE GRAS 17
Une grande proportion de la population mondiale ne mange pas chaque
jour. Plus localement, les banques alimentaires voient leurs réserves
diminuer. Même avec les meilleures technologies, notre manne nous
pourrit entre les mains… Elle fond au soleil dans les poubelles des
pays du nord. La globalisation ne doit pas avoir raison du don
gratuit à la source de la communauté ni des initiatives collectives
qui permettent de cultiver les déserts contemporains que sont nos
villes. Mais surtout, nous devons participer aux solutions qui vont
dans le sens d’un partage équitable de la manne moderne. Plus que
jamais, il faut repenser la demande qu’on murmure à Dieu. Car aurons-
nous encore de la manne à manger en contexte de désastre
environnemental ? La prière, plus que jamais, doit participer
activement à faire des choix différents. Réduire notre consommation
et éviter le gaspillage, manger local et participer à un marché
équitable peuvent constituer une prière participative d’espoir.
Pourquoi ne pas espérer que tous puissent conquérir leur nourriture
quotidienne et participer à cultiver la nouvelle manne du monde?
Famines et désertification représentent les conséquences les plus
visibles des industries agroalimentaires aliénantes. La santé
mondiale dépend pourtant des petites exploitations agricoles à
l’échelle humaine. Ce n’est pas en se plaignant de ses malheurs que
l'on peut espérer recevoir une réponse agréable à nos prières.
Incarner le peuple de Dieu signifie vivre dans un monde différent où
Dieu règne et commande la nature pour nourrir ceux qui s’y engagent.
La prière devient alors un geste humble de participation et de don.
b) Prédication en action
Nancy LABONTE GRAS 18
Objectif : Cultiver collectivement autour du lieu de culte et offrir gratuitement les récoltes.
Nombre de nos églises pourraient troquer leur gazon bien tondu pour
des jardins comestibles. Nous pourrions penser à une prédication en
action qui animerait la communauté dans la culture de son jardin
collectif. De plus, nous perdons nos savoirs paysans. Une activité de
jardinage collectif sur le terrain de l’église permettrait
d’apprendre à cultiver ensemble. Les récoltes pourraient être
offertes à des organismes visant à assurer la sécurité alimentaire de
notre région. Sinon, on pourrait pratiquer le don simple à ceux qui
le demandent, sans juger le bien-fondé de leur demande, comme l’a
fait Dieu dans Exode 16, dans une dynamique de bienveillance
mutuelle.
Afin de conclure les activités de jardinage, une pratique de service
cultuel en mémoire du geste d’Aaron pourraient se répéter chaque
année à la fin de l’hiver et prévoir un rituel de partage de
semences.
c) Ré-établir la relation entre les personnes et Dieu
Objectif : Actualiser la règle du Sabbat en respectant le repos sacré nécessaire au bien-être.
Raconter le chapitre 16 en mettant l’emphase sur la simplicité des
activités de distribution et de consommation de la manne. Il est
primordial d’avoir une hygiène de vie : dans ce chapitre, on collecte
le matin et on cuisine de manière élaborée l’avant-dernier jour de la
semaine pour se réserver un jour de repos. Au contraire, nous
Nancy LABONTE GRAS 19
travaillons n’importe quand, nous sommes fatigués, plusieurs se
voient épuisés… tandis qu’au Sud, les travailleurs sont forcés. Et si
le repos devenait sacré ? Et si l’humanité décidait d’aller moins
vite et d’accorder du repos à tous au lieu de toujours vouloir
produire plus ? Et si on organisait la distribution pour éviter le
gaspillage ? Il semble aussi que le bien-être implique de préserver
le repos de Dieu avec bienveillance.
6. Ouvrages utilisés
Meyer, L. (1983). The Message of Exodus: A Theological Commentary. Augsburg
Publishing House.
Vorster, J. M. (2011). “Go out and gather each day ...”: implications
of the ethics of Exodus 16 for modern consumerism. Koers - Bulletin for
Christian Scholarship, 76(1), 171–192. doi:10.4102/koers.v76i1.12
World Council of Churches Commission of the Churches on International
Affairs Working Group on Social Justice and Common Goods. (2011).
Social Justice and Common Goods. The Ecumenical Review, 63(3), 330–343.
doi:10.1111/j.1758-6623.2011.00125.x
Wotton, R. S. (2010). What was Manna? Opticon1826, (9). Retrieved from
http://www.ucl.ac.uk/opticon1826/currentissue/articles/LS_Wotton.pdf
Nancy LABONTÉ
Nancy LABONTE GRAS 20