Du fascicule processuel à la création d’un culte. Le cas de la Madone des Miracles de Lonigo
Transcript of Du fascicule processuel à la création d’un culte. Le cas de la Madone des Miracles de Lonigo
LE TEMPS DE L’HISTOIRE
RÉCIT ET JUSTICE
France, Italie, Espagnexive-xixe siècles
SOUS LA DIRECTION DE
LUCIEN FAGGION ET CHRISTOPHE REGINA
Récit et justice
France, Italie, Espagne xive-xixe siècles
sous la direction de
lucien Faggion & christophe regina
2014
Presses Universitaires de Provence
collection
le temps de l’histoire
RecitetJustice25112014.indd 3 25/11/2014 15:36:54
© Presses Universitaires de ProvenceAix Marseille Université
29, avenue Robert-Schuman - F - 13621 Aix-en-Provence cedex 1Tél. 33 (0)4 13 55 31 91
[email protected] – Catalogue complet sur www.univ-provence.fr/w3pup
diFFusion LiBrairies : aFPu diFFusion – distriBution sodis
RecitetJustice25112014.indd 4 25/11/2014 15:36:54
177
Du fascicule processuel à la création d’un culteLe cas de la Madone des Miracles de Lonigo
Giovanni FlorioUniversité Ca’ Foscari de Venise
Prologue
L’après-midi du 30 avril 1486, deux cordonniers, Gianantonio et Guglielmo, quittent Vérone pour se rendre à Lonigo 1, dans la basse plaine du Vicentin. Avec eux se trouve aussi Giampietro, leur collègue et ami, auquel, lors du déjeuner, ils laissent entrevoir la possibilité de faire de bonnes affaires au marché de Lonigo et le persuadent de partir avec eux. En réalité, les deux songeaient à l’assassiner sur le chemin du retour pour lui dérober les cinquante ducats qu’ils savaient être en sa possession.
Le lundi après-midi 1er mai 1486, à une lieue de Lonigo, à la hauteur de la petite église de campagne de saint Pierre in Lamentese, aux confins du territoire de Vicence, près de la province de Vérone, Guglielmo se précipite sur Giampietro, tandis que Gianantonio, en blasphémant, l’achève à coups de poing. Une fois l’argent subtilisé, les assassins se réfugient dans l’église de saint Pierre, alors abandonnée, et commencent à se partager le bien pris malhonnêtement. Guglielmo, à ce point, a une nouvelle réflexion : il dit regretter avoir commis l’acte criminel et ne pas vouloir procéder à la distribution de l’argent dans ce lieu sacré, encore moins sous les yeux de la Vierge Marie peinte à fresque sur l’autel de la petite église. En guise de réponse, Gianantonio met la main au poignard et commence à balafrer le visage de Marie, en blasphémant et en disant qu’il eût également poignardé la Madone, si cela avait été néces-saire. C’est alors que la route des complices se sépare : Gianantonio fait perdre ses traces et Guglielmo, qui a enfin accepté l’argent, retourne à Vérone pour chercher asile dans l’abbaye de saint Zeno où, cinq jours après, il est arrêté par les hommes du podestat vénitien Giacomo Miani. Le délit et l’acte sacrilège étaient désormais devenus de notoriété publique, de fama publica. Déjà, au
* Traduit de l’italien par Lucien Faggion.1 Sur une description de Lonigo à la fin du xve siècle, voir Marino Sanudo, Itinerario di Marin Sanuto
per la Terraferma Veneziana nell’anno 1483, éd. R. Brown, Padoue, Tipografia del Seminario, 1847 (réédition, Milan, Syntesis Press, 1981), p. 107.
*
RecitetJustice25112014.indd 177 25/11/2014 15:37:04
Giovanni Florio
178
cours de l’après-midi du 1er mai, quelques paysans de Lonigo avaient informé les autorités vénitiennes de l’existence du cadavre de Giampietro et dénoncé ses compagnons. Toutefois, davantage que le cadavre, ce fut la fresque de Marie qui les avait frappés : la Madone avait changé de traits, en portant une main sur le visage, afin d’alléger les blessures reçues, déchirures desquelles jaillis-sait du sang.
Au début du mois de mai 1486, avant d’apprendre la nouvelle de l’arres-tation et de l’exécution du meurtrier (homicidiale) Guglielmo, à travers la plaine vicentine courait le bruit que le Divin avait voulu se manifester dans les environs de Lonigo.
Assez vite, les premiers grands pèlerinages commencent et, avec eux, ces guérisons prodigieuses, saint Pierre in Lamentese étant devenu, en peu de temps, sainte Marie des Miracles de Lonigo. Ce qui était autrefois des ruines abandonnées et sans aucune valeur devint ainsi le motif d’une contestation entre les moines olivétains de sainte Marie in Organo de Vérone 2 – les proprié-taires de son bénéfice –, d’autres hauts prélats – leurs commendataires – et la communauté de Lonigo, près duquel émerge l’édifice. Les inévitables opposi-tions judiciaires virent comme vainqueurs les Olivétains qui, en ayant envoyé à Lonigo leur propre communauté, lancèrent les travaux de construction de l’actuel sanctuaire marial.
Deux actes marginaux – un homicide et un sacrilège – commis par des personnages marginaux comme peuvent l’être deux cordonniers sont donc à l’origine de la construction d’un sanctuaire et d’un culte destinés à modifier la dévotion, la culture religieuse et artistique, ainsi que les assises territoriales et économiques du bas Vicentin à l’époque moderne.
Don Gian Domenico Bertani, historien et Olivétain
Le récit de ces événements, après une première diffusion orale et icono-graphique 3, se fixe sous forme écrite en 1605, lorsque le moine olivétain Gian Domenico Bertani, sacristain de sainte Marie des Miracles, décide de
2 L’abbaye de sainte Marie in Organo de Vérone avait été la maison mère de la natio veronensis, insérée dans la province olivétaine de la Terre Ferme vénitienne. Pour un cadre général de l’organisation provinciale olivétaine à l’époque moderne, voir Secondo Lancellotti, Istoria Olivetana dei suoi tempi : libri xii (1300-1593), introduction, transcription et insertion sous la direction de G. F. Fiori, Badia di Rodengo (Brescia), L’Ulivo, 1989, p. 11-13.
3 L’abbaye olivétaine de Rodengo Saiano, dans la province de Brescia, conserve une fresque de 1533 représentant la Madone des Miracles de Lonigo. Comme l’a souligné Simona Tozzo, la particularité de cette copie est la présence aux côtés de la Vierge de deux malfaiteurs, Giovan Antonio et Guglielmo, l’un avec le poignard en main, l’autre avec la sacoche pleine d’argent (A. Lora et alii, Le tavolette votive della Madonna dei Miracoli di Lonigo. Catalogo e ricerche, Vicence, Parrocchia di S. Maria in Madonna dei Miracoli, 2005, p. 20). Le choix iconographique, unique dans les représentations de la Madone de Lonigo, témoignerait d’une diffusion précoce du récit des trois cordonniers à partir, comme nous le verrons, de documents de type processuel.
RecitetJustice25112014.indd 178 25/11/2014 15:37:04
Du fascicule processuel à la création d’un culte
179
faire imprimer l’Historia della gloriosa immagine della Madonna di Lonigo, posta nella chiesa altre volte nominata San Pietro in Lamentese 4.
Conçu comme un ex-voto 5, le livre s’intègre dans un climat de renouvelle-ment général du genre hagiographique 6 qui se vérifie dans l’espace italien à l’époque de la Contre-réforme : l’hagiographe ne se contente plus de rapporter des événements miraculeux ou édifiants, mais de les prouver à travers une approche philologique, historiographique des sources, dont le rayon d’action inclut des témoignages oraux, des preuves archéologiques et, naturellement, de la documentation d’archives 7.
En l’occurrence, le moine qui, en sa qualité de sacristain 8, avait le libre accès aux archives de sainte Marie de Lonigo et de sainte Marie in Organo de Vérone, lut aussi bien les copies du procès pénal de 1486 instruit par la cour prétorienne de Vérone contre Guglielmo que celles du procès canonique ouvert en 1491 dans l’intention de reconnaître le premier miracle marial. L’Olivétain ne se limite pas à nous offrir une simple réélaboration narrative de ces fascicules, mais il donne une nouvelle proposition de larges extraits avec de nombreux renvois d’archives 9 : la prose de Bertani dépasse les
4 Gian Domenico Bertani, Historia della gloriosa imagine della Madonna di Lonico, posta nella chiesa altre volte nominata San Pietro in Lamentese, Vérone, Tamo 1605 (à nouveau éditée en 1666 par G. B. Merlo à Vérone, puis éditée par « Il Centro del Collezionista di Quirino Ferron », Lonigo, 1986). Sur le Véronais Don Gian Domenico Bertani, nous ne connaissons que ces données autobiographiques qu’il a lui-même voulu inclure dans son ouvrage. Son activité littéraire se situe dans une période particulièrement féconde pour les études sur la Congrégation de Monte Oliveto comme en témoigne l’ouvrage de Secondo Lancellotti, Historiae Olivetanae, Venise, Ex Typographia Gueriliana, 1623. Lancellotti s’occupa aussi de sainte Marie de Lonigo, d’après l’écrit du confrère Bertani, ibid., p. 304-307.
5 Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 9. La dévotion très personnelle de l’auteur à la Vierge est favorisée par son appartenance à l’Ordre olivétain, de laquelle elle était la patronne, Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, Alessandria, L’Ulivo, 1952, passim.
6 L’ouvrage de Bertani présente des tournures de style propres à une littérature hagiographique destinée à la sacralisation du territoire à travers la redécouverte de son patrimoine de sanctuaires, reliques, événements miraculeux. Sur ces sujets, Tommaso Caliò et Raimondo Michetti, « Un’agiografia per l’Italia. Santi e identità territoriali », dans Sofia Boesch Gajano et Raimondo Michetti, dir., Europa sacra. Raccolte agiografiche e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età moderna, Rome, Carocci, 2002, p. 147-180.
7 Cf. Brenda Dunn-Lardeau, « Le conseguenze dell’Umanesimo e del Concilio di Trento sulla scrittura agiografica », dans Gennaro Luongo, dir., Erudizione e devozione. Le raccolte di Vite di santi in età moderna e contemporanea, Rome, Viella, 2000 ; Tommaso Caliò et Raimondo Michetti, « Un’agiografia... », p. 147-180 ; S. Carribo, « Locale, nazionale, sovranazionale. Qualche riflessione sulle raccolte agiografiche in età moderna », dans Sofia Boesch Gajano et Raimondo Michetti, dir., op. cit., p. 397-402 ; Miguel Gotor, Chiesa e Santità nell’Italia moderna, Rome-Bari, Laterza, 2004, p. 103-110.
8 Bertani écrit avoir été à sainte Marie de Lonigo nel tempo di anni tre, période durant laquelle il avait servita quella chiesa per sacristano (Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 9). Sur les tâches du sacristain (sacrista), cf. Enrico Mariani, Costituzioni olivetane manoscritte (1392, 1445-1540, 1542), Monte Oliveto Maggiore (Si), L’Ulivo, 2003, passim.
9 Bertani utilisa en particulier le procès pénal instruit contre Guglielmo et celui ecclésiastique pour la reconnaissance du miracle, conservés en copie dans le sanctuaire au moins jusqu’au xixe siècle, Domenico Luigi Toffanin, Della Madonna di Lonigo. Memorie storiche, Lonigo (Vicence), Gaspari, 1887.
RecitetJustice25112014.indd 179 25/11/2014 15:37:04
Giovanni Florio
180
intentions narratives déclarées, sacrifiant la fluidité du récit pour aboutir à un style et à une méthode, proche de l’écriture, quoique celle-ci se soit pliée à des exigences strictement apologétiques.
Aussi le moine accorde-t-il une grande importance aux sentences 10 qui parent d’autorité et de crédibilité le traité, même s’il semble préférer les parties de la procédure caractérisées par une plus grande dialectique, comme peuvent l’être les témoignages et les relations. En d’autres mots, Bertani utilise les récits contenus à l’intérieur des fascicules processuels pour former une sorte de scénario sur lequel il peut construire l’Historia della Madonna di Lonigo. Une trame qui, si elle est parfois mise en lumière, comme dans le cas des citations d’archives, reste le plus souvent et délibérément cachée : à titre d’exemple, le plus frappant, derrière la troisième personne avec laquelle Bertani nous raconte l’homicide de Giampietro 11, il est facile de dégager la première personne employée par Guglielmo qui répond aux questions pressantes du juge du Maléfice, enregistrées avec précision dans le fascicule processuel. Soustraire la narration de l’homicide à son protagoniste pour le confier à un narrateur ascétique et omniscient est un artifice rhétorique qui répond à l’exigence de proposer comme neutre une source qui, à l’instar de toutes les sources, ne peut être que partielle : la déposition est rendue sous la torture par un accusé qui tente, par tous les moyens, d’alléguer des circonstances atténuantes qui lui épargnent la vie. Ainsi, lorsque, dans l’Historia della Madonna di Lonigo, on lit le récit du repentir de Guglielmo ou, attribués au seul Gianantonio, la paternité du plan, sa réalisation et enfin le sacrilège, on écoute en réalité la défense radicale, filtrée par Bertani, prononcée par Guglielmo le 5 mai 1486 devant la cour prétorienne de Vérone.
Si, comme nous l’avons vu, les circonstances atténuantes exposées par Guglielmo valent peu pour le tribunal vénitien, il n’en est pas de même pour la mémoire historique locale qui, également grâce à l’ouvrage de Bertani, commence précocement à voir en Guglielmo – assassin, repenti, dévoué à la Madone, qui cherche dans l’église l’abri de la justice – une sorte de nouveau « bon larron 12 » : la transposition littéraire du fascicule proces-suel a contribué à légitimer cette version et à la rendre durable. Un opuscule anonyme publié à Venise en 1800, reproposé en 1886 par Arturo Pomello dans sa Storia di Lonigo 13, qui raconte le miracle de la Madone de Lonigo 14, se réfère
10 L’emploi d’un lexique spécifique aux sentences est évident dans le passage où Bertani décrit l’exécution de Guglielmo, dans Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 24 ; ou lorsqu’il renvoie au bannissement de Giovan Antonio, ibid. ; ou, encore, comme j’aurai l’occasion de le montrer, quand il décrit la mise en marche de la procédure canonique sur les miracles.
11 Ibid., p. 21.12 Dans cette attitude, avec la bourse d’argent dans une main et l’autre qui indique avec
crainte la Vierge Marie, est représenté Guglielmo dans la Madonna dei Miracoli de l’abbaye de Saint Nicolas à Rodengo Saiano (1533).
13 Arturo Pomello, Storia di Lonigo con cenni storici sui comuni del distretto, Lonigo (Vicence), Gaspari, 1885, republié et édité par le Circolo Filatelico Numismatico de Lonigo (Vicence), Officina Stocchiero, 1974.
14 Le récit est une recomposition du texte de Bertani dans une version mélodramatique.
RecitetJustice25112014.indd 180 25/11/2014 15:37:04
Du fascicule processuel à la création d’un culte
181
à une singulière tradition populaire de Lonigo : un pantin en paille, muni d’un masque, un chapeau et un poignard, représentant le perfide Giovanantonio, avait été pendu dans la voûte du sanctuaire, à la fin du xve siècle, en mémoire perpétuelle du sacrilège. Ce supplice-rituel ultérieur avait été en revanche épargné à Guglielmo, déjà puni par la justice des hommes. Le pantin fut enlevé seulement en 1791, lorsque ce macabre simulacre qui devait « exciter la dévote curiosité », jugé de mauvais goût, fut brûlé et remplacé par une Madone en lame d’or flanquée des deux figures des « assassins infâmes » en lame noire 15. Guglielmo réapparaît dans cette représentation, même s’il est désormais pardonné par la mémoire populaire, à la différence de Giovanantonio dont, encore au début du xixe siècle, la population de Lonigo – le volgo – le voulait voir enlevé par le démon 16.
Le procès ecclésiastique
Si, sur la base du procès contre Guglielmo, Bertani a réussi à donner une forme canonique aux nombreuses versions circulant sur l’homicide de Giampietro, les aspects miraculeux de cette histoire restent encore à être prouvés, à commencer par le saignement de la fresque mariale. Comme il l’avait anticipé, l’Olivétain se pose comme objectif de traiter le procès canonique instruit en 1491-92 par l’évêché de Vicence sur l’instance conjuguée de la commu-nauté de Lonigo et de l’abbé de sainte Marie in Organo 17. Le procès s’ouvrait à cinq années de distance du miracle, avec le culte de la Madone de Lonigo et la présence olivétaine désormais fortement consolidés dans le bas Vicentin : Pietro Bruto 18, évêque suffragant de Vicence, avait compris que ce laps de temps pouvait poser de sérieuses hypothèques sur la qualité de l’enquête, partant, dans la confiance à accorder aux trois juges la très diligente inquisi-tion (diligentissima inquisizione) et leur recommanda d’établir avec sûreté les traits de l’image mariale avant et après la balafre, et surtout avant et après les restaurations engagées par les Olivétains 19. La disposition jetait une lumière inquiétante sur la véridicité des miracles de la Madone de Lonigo et sur la bonne foi des Olivétains, leurs gardiens. Toutefois, Bertani, qui pouvait tranquillement censurer cette dangereuse information, décide au contraire de la faire ressortir : en exaltant la rigueur de l’évêque Bruto et la diligence des juges inquisiteurs, le moine renforce la valeur de la sentence de reconnais-sance des miracles de la Madone de Lonigo.
15 Arturo Pomello, op. cit., p. 112-113.16 Ibid.17 Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 31.18 Sur Pietro Bruti dans le cadre de l’histoire du clergé vicentin à l’époque moderne,
cf. Renato Zironda, « Aspetti del clero secolare e regolare della chiesa vicentina dal 1404 al 1563 », dans Franco Barbieri et Paolo Preto, dir., Storia di Vicenza. L’età della Repubblica Veneta (1404-1797), Vicence, N. Pozza, 1990, t. I , p. 170-171.
19 Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 31.
RecitetJustice25112014.indd 181 25/11/2014 15:37:04
Giovanni Florio
182
En réalité, Bertani, clerc de l’âge de la Contre-réforme, dans son étude du procès épiscopal du xve siècle, cerne immédiatement les lacunes, les insuffi-santes, les manques de légitimité d’une procédure canonique définitivement cassée par la norme post-tridentine 20 et, en conséquence, il s’efforce de trouver des éléments à sa charge. Du reste, écrire un livre sur un culte thaumaturgique et local au début du xviie siècle, en plein débat sur la compétence juridictionnelle pour la nomination des saints et des béats, sur le concept même de sainteté, ainsi que sur la validité des reliques et des images miraculeuses, s’avérait une opération qui exigeait toutes les prudences démontrées par Bertani, lorsqu’il affronte le sujet. L’Église qui sortait de Trente avait répondu aux accusations des protestants – et des humanistes – contre la pratique du culte des saints et la vénération des images en rappelant avec fermeté leur validité 21 : toute-fois, en acceptation partielle de ces critiques, à partir de la seconde moitié du xvie siècle, le contrôle de telles pratiques dévotionnelles s’était exacerbé, à commencer par l’adoption de nouvelles et plus sévères procédures pour leur reconnaissance. L’effet fut celui de déplacer toujours plus vers la Curie romaine et les nouvelles Congrégations cardinalices – en particulier l’Inqui-sition (1542), la Congrégation des Rites (1588) et celle des Béats (1602) –, la compétence en matière de sanctifications, reconnaissance des miracles et contrôle des pratiques cultuelles, avec une substantielle réduction des préro-gatives épiscopales en faveur de la papauté 22.
Bertani écrit donc en une période où la redécouverte d’anciens cultes et de dévotions locales, témoignée par la grande floraison hagiographique du xviie siècle 23, correspond à une défaveur générale des hiérarchies ecclé-siastiques à en recevoir de nouveaux 24. Une méfiance évidente est également perceptible dans le cadre étroitement vicentin : en 1596 et encore en 1605, des apparitions mariales, déclarées respectivement à Cologna Veneta 25 et à Orgiano 26, sont réglées par les juges canoniques de l’évêché de Vicence comme étant le fruit de l’imagination. Les procédures avaient ainsi changé.
20 Voir Miguel Gotor, I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna, Florence, Olschki, 2002 ; Id., Chiesa e santità, op. cit.
21 Cf. Hubert Jedin, « Genesi e portata del decreto tridentino sulla venerazione delle immagini », dans Hubert Jedin, Chiesa della fede, Chiesa della storia, Brescia, Morcelliana, 1972, p. 340-390.
22 Cf. Miguel Gotor, I beati del papa, op. cit. ; Id., Chiesa e santità, op. cit. ; Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Turin, Einaudi, 1996, p. 431-464.
23 Voir Sofia Boesch Gajano et Raimondo Michetti, dir., op. cit., passim ; ou, encore, Gennaro Luongo, dir., op. cit.
24 Sur l’évolution du lien entre sainteté et miracle à l’époque moderne, voir Miguel Gotor, Chiesa e santità, op. cit., p. 107, et Marilena Modica, « Il miracolo come oggetto di indagine storica », dans Sofia Boesch Gajano et Marilena Modica, dir., Miracoli. Dai segni alla storia, Rome, Viella, 2000, p. 23.
25 Voir Guerrino Maccagnan, La Madonna dello “Spasimo” di Cologna Veneta, Cologna Veneta (Vérone), Ambrosini, 1995.
26 L’église paroissiale d’Orgiano était dirigée, durant cette période, par un confrère de Bertani, don Ludovico Oddi, olivétain du monastère de sainte Hélène de Venise, voir Claudio Povolo, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, Cierre, 1997, p. 374-378.
RecitetJustice25112014.indd 182 25/11/2014 15:37:04
Du fascicule processuel à la création d’un culte
183
Si, en 1605, ce fut un collège de théologiens de la cathédrale de Vicence qui enquêtât sur la Madone de la Douleur de Cologna Veneta, et 36 témoins furent appelés à déposer, en 1491, « les pouvoirs certifiant l’authenticité du miracle 27 » de la Madone de Lonigo furent délégués à trois juges nommés ad hoc, chargés d’interroger seulement sept témoins. Ces juges n’étaient même pas des professionnels de ce sujet, ni des personnalités étrangères à l’espace de l’enquête : deux d’entre eux étaient des ecclésiastiques impor-tants de Lonigo 28 ; le troisième, un laïc, Bernardino Tagliapietra, le podestat vénitien de Lonigo, et ce fut son bureau qui fut tenu de s’occuper à enregistrer les dépositions qu’il fallait envoyer à l’évêché de Vicence 29.
En affrontant le récit du procès canonique, Bertani se rend donc compte qu’il ne peut pas insister sur des aspects procéduraux et théologiques sans prendre le risque de s’exposer à des critiques et à des méfiances sur le carac-tère miraculeux de la Madone de Lonigo : il décide, partant, de se rapporter aux phases du procès seulement pour les chapitres les plus importants, en arrivant au paradoxe de censurer la sentence des miracles et en préférant attirer l’attention du lecteur sur la déposition des témoins. Présentés comme un récit à une seule voix 30, ces témoignages sont des preuves encore plus utiles qu’une ancienne sentence épiscopale destinée à démontrer, au moins au lecteur dévot, la véridicité et la légitimité du culte de la Madone de Lonigo.
Les censures de don Bertani
Mais il existe probablement d’autres doutes que Bertani veut distiller auprès du lecteur en préparant un dispositif argumentatif aussi articulé, des doutes qui ne sont pas diffusés de Rome ou de l’évêché de Vicence, qui ne présentent même pas un caractère théologique, mais qui proviennent en réalité de quelques lieues de distance, du palais de la communauté de Lonigo, et tendent à délégitimer la présence et les droits exercés par les Olivétains dans leurs compétences. Au cours de l’époque moderne, les habitants de Lonigo regardent avec dévotion la Madone des Miracles, mais avec méfiance leurs gardiens, les moines olivétains. Véronais assignés à la dépendance de Lonigo par leur ordre, selon des critères dans lesquels la communauté locale ne peut pas
27 J’utilise à dessein une expression de Miguel Gotor, Chiesa e santità, op. cit., p. 109.28 L’archiprêtre de la paroisse de Lonigo et le prieur de l’église de saint Fermo, Gian Domenico
Bertani, op. cit., p. 31. 29 En l’occurrence, les actes processuels furent enregistrés par Giovan Battista de Orti notaio
di Verona, et cancelliero del detto Clarissimo Podestà di Lonigo, alors que Bartolomeo quondam Giovan Giacomo d’Aniano notaio vicentino, et cancelliero del vescovato di Vicenza, fut l’auteur de la copie conforme en possession du monastère de sainte Marie de Lonigo. Un troisième notaire, Pre Giorgio notaio di Cornalli quondam Giacomo da Lonigo, parut, en revanche, parmi sept témoins, comme s’il fallait donner une autorité supplémentaire aux dépositions, ibid., p. 32-33.
30 Les témoins, desquels Bertani nous fournit une liste, con suo giuramento deposero come detta Immagine era avanti il commesso homicidio dipinta in modo di Assonta, con le mani giunte e gli occhi rivolti al Cielo, con un libro in un braccio, ibidem.
RecitetJustice25112014.indd 183 25/11/2014 15:37:04
Giovanni Florio
184
s’ingérer, les Olivétains sont perçus par la société de Lonigo comme un corps étranger 31. Des « crises de rejet » surgissent à plusieurs reprises au xvie et au xviie siècle, en laissant des témoignages importants dans les archives du sanctuaire 32, comme dans celles de la communauté de Lonigo 33, mais non dans l’Historia della Madonna di Lonigo, dans laquelle Bertani effectue seule-ment quelques renvois.
L’auteur raconte, par exemple, comment, au mois de mai 1486, immédia-tement après le miracle, deux obstacles séparèrent l’abbé de sainte Marie in Organo de la pleine jouissance du bénéfice de saint Pierre in Lamentese : d’un côté, don Antonio Pavini, « docteur et auditeur du Sacré Palais Apostolique », détenteur de la commende de la petite église 34 ; de l’autre, la commu-nauté de Lonigo qui prétendait contrôler la gestion des legs à la Madone des Miracles 35. Pavini « se trouvait à Rome, et avait peu d’esprit et peu de soin pour cette église 36 » et, partant, il fut facile de le convaincre d’y renoncer : l’accord fut scellé le 24 mai 1486 à Padoue, dans le monastère olivétain de saint Benedetto Novello 37. Le jour suivant, l’abbé Francesco Lisca clôturait le contentieux même avec la communauté de Lonigo qui, avec un « applau-dissement universel », saluait l’arrivée des Olivétains dans sa terre 38. Ou, au moins, c’est ce que veut souligner Bertani, lequel ne cache pas, par ailleurs, plus loin que, seulement trois années plus tard, en vertu d’une lettre du doge Agostino Barbarigo qui confirma à l’abbé de sainte Marie in Organo la possession temporelle de sainte Marie des Miracles, le podestat de Lonigo Filippo Sagredo avait été contraint d’obliger quiconque, sous peine pécuniaire, de ne pas molester les Olivétains dans leur « possession pacifique » (pacifico
31 Sur le rapport entre ordres religieux, états territoriaux et communautés, voir Massimo Carlo Giannini, « Note sul problema del controllo politico degli Ordini religiosi nell’Italia della prima metà del Seicento », dans C. J. Hernando Sánchez, éd., Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Madrid, SEACEX, 2007, vol. I , p. 551-576 ; Carlo Fantappiè, Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato. Il caso toscano (xvi-xix sec.), Florence, Olschki, 1993 ; Fiorenzo Landi, Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna, Rome, Carocci, 1996 ; Sara Fasoli, « Il convento di S. Pietro Martire punto di riferimento della società vigevanese », dans Giorgio Chittolini, dir., Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo, Milan, Unicopli, 1997, p. 111-132 et, avec un renvoi à l’ordre olivétain, Elena Brambilla, « Politica, chiesa e comunità locale in Lombardia: l’abbazia di Civate nella prima età moderna (1500- 1700) », Nuova Rivista Storica, 1987, p. 71- 114.
32 Archivio di Stato de Vicence (désormais : ASVi), Corporazioni Religiose Soppresse da Venezia (désormais : CRS), S. Maria dei Miracoli di Lonigo.
33 Archivio storico de la Commune de Lonigo (désormais : ASCL), Archivio Antico.34 Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 14.35 Ibid., p. 25.36 Ibid., p. 14.37 Ibid., p. 25.38 Comme témoignage de cette pacification, Gian Domenico Bertani signale un papier du même
Lisca conservé dans les archives du monastère de sainte Marie de Lonigo, ibid. Il manque, par ailleurs, une quelconque référence au développement et au contenu de la tractation.
RecitetJustice25112014.indd 184 25/11/2014 15:37:04
Du fascicule processuel à la création d’un culte
185
possesso) et, en particulier, dans la jouissance des aumônes 39. Mais, à part ces exceptions, les rapports entre les Olivétains et la communauté nous paraissent, dans le texte de Bertani, marqués par la collaboration la plus amicale et profi-table dans la diffusion du culte de leur Madone, comme le prouve l’action conjointe de 1491 pour l’ouverture du procès canonique.
Cependant, cette idylle ne trouve pas de réponse dans les archives de sainte Marie de Lonigo : des documents délibérément exclus de l’Historia della Madonna di Lonigo nous racontent que le 23 novembre 1497, suite à une nouvelle supplique rédigée par les Olivétains, le doge Barbarigo fut contraint de confier au podestat de Vicence, Pietro Cappello, l’enquête sur l’énième interférence de la communauté de Lonigo dans l’administration économique du sanctuaire 40. Durant le contentieux, conclu en 1499 en faveur des religieux 41, la communauté proposait la possibilité que les Olivétains ne fussent pas les propriétaires légitimes du bénéfice de saint Pierre in Lamentese. À plusieurs reprises, on rappela au podestat que l’édifice, avant le miracle, avait été à l’abandon, destiné à abriter les animaux et qu’il fût ainsi resté si la communauté n’avait pas invité les Olivétains à s’en réapproprier, en refusant les offres d’autres ordres religieux 42. La réponse des moines consista à produire des documents, très récents, comme la renonciation de Pavini, aux plus anciens, comme la bulle de 1177, par laquelle Alexandre III unissait saint Pierre in Lamentese à sainte Marie in Organo 43. De son côté, la commu-nauté fit observer que, en mai 1486, la petite église miraculeuse avait été assignée, par un bref pontifical, à un troisième prélat, Federico Ormaneti de Padoue 44.
Plus d’un siècle plus tard, dans l’intention probable de répondre impli-citement à ces accusations, Bertani relance le débat : après avoir recueilli une légende populaire selon laquelle saint Pierre in Lamentese était surgi pour apaiser l’âme des chrétiens trucidés par Attila en ces mêmes lieux 45,
39 Ibid., p. 29-30. Les archives du sanctuaire conservent la supplique et la ducale citées par Bertani, mais non la lettre du podestat vénitien Sagredo. ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo, c. 425, fo 1 intitulé « GG », folio non numéroté, 21 octobre 1489.
40 Le procès se trouve aux ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo, c. 424, liasse XVI, fo 3ro-93ro.41 La sentence prononcée par le podestat de Vicence, le 4 janvier 1499, est conservée aux ASVi,
CRS, S. Maria di Lonigo, c. 424, liasse XVI, fo 93ro.42 Les arguments sont exprimés dans l’Oppositio comunis leonici contra litteras ducatorum
du 14 décembre 1497, ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo, c. 424, liasse XVI, fo 5vo-7ro.43 Pour la liste complète, ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo, c. 424, liasse XVI, fo 9.44 Témoignage d’Antonio Palton, syndic de la communauté, ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo,
c. 424, liasse XVI, fo 12ro.45 Selon Bertani, la légende trouverait une réponse dans un document rédigé par un des Olivétains
appartenant au premier noyau monastique envoyé de Vérone en 1486. L’écrit, alors conservé dans les archives du monastère, rapporte que, au cours des travaux d’agrandissement du sanctuaire, ils mirent souvent au jour des restes humains dans les dégagements (Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 9). D’après Bertani, les découvertes continuent au début du xviie siècle : dans les champs d’Attilio Pellizari, un important notaire de Lonigo (ASVi, Atti dei notai, Fermo Pellizzari fu Giuseppe, cartons 8867-8868) et membre d’une famille
RecitetJustice25112014.indd 185 25/11/2014 15:37:04
Giovanni Florio
186
il rassemble – en plus des documents allégués par les religieux dans la cause 46 – une grande partie des actes de la concession du bénéfice de Lonigo stipulés dans les siècles passés par les abbés de sainte Marie in Organo et, avec eux, il construit une histoire de la petite église campagnarde qui s’étend de 1177 à 1486 47. Dans un autre passage, il introduit en revanche la mémoire documentaire de la renonciation de Federico Ormaneti en faveur de l’abbé olivétain par une disposition pontificale du 3 avril 1487 48. À nouveau, Bertani transforme les sources d’origine processuelle en un texte narratif, sans par ailleurs le vider de sa fonction apologétique. Quoiqu’ils soient dé-contex-tualisés et insérés dans un texte hagiographique, les documents répondent à l’exigence de démontrer la légitimité de la présence olivétaine dans les terres de Lonigo, en coupant court aux argumentations de ceux qui, encore au début du xviie siècle, s’y opposent obstinément.
Au cours du xvie siècle, la communauté de Lonigo, une fois reconnue l’impossibilité de faire perdre aux Olivétains leur possession, avait peu à peu déplacé ses attaques contre leurs privilèges : Bertani ne dit pas comment, dès les premières années du xvie siècle, les moines avaient commencé à préparer trois foires en fonction des plus grandes festivités mariales. Tout comme il ne dit rien sur ou comment, entre 1541 et 1545, la lutte pour leur possession avait à nouveau divisé la communauté et les religieux 49 dans un violent contentieux judiciaire, au terme duquel un accord de pacification digne de Salomon avait équitablement réparti les revenus et la gestion des foires entre les deux adversaires 50, finissant par légitimer l’énième ingérence communale dans les activités économiques du monastère. Loin d’être résolue, la question explosa à nouveau vingt ans plus tard avec la publication de l’Historia : en 1629, ces mêmes habitants honorés de l’ancien et illustre château de Lonigo (honorati habitatori dell’antico et illustre castello di Lonigo) – auxquels Bertani consacrait son ouvrage, avaient ré-ouvert la question en jetant les bases du futur monopole communal sur les foires de la Madone 51.
qui exerçait une hégémonie au sein du Conseil citadin (voir les registres des élections de la communauté de Lonigo, ASCL, Archivio Antico, Leggi e consigli, c. 23, fasc. 3, « Leggi e consigli ») fut mise au jour une sépulture avec un cheval, Gian Domenico Bertani, op. cit., p. 14.
46 Gian Domenico Bertani cite, par exemple, la bulle pontificale de 1177, ibid., p. 14.47 Pour chaque contrat, l’auteur rapporte son emplacement archivistique, ibid., p. 15. 48 La référence suit l’accord avec la communauté de 1486, ibid., p. 26-27. Le bref par lequel
Innocent VIII confirmait la renonciation d’Ormaneti est conservé (ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo, c. 425, folio 1 intitulé « GG », non folioté, 3 avril 1487) tout comme l’entière correspondance de 1487 pour la renonciation de Federico Ormaneti, ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo, c. 425, folio 1 intitulé « GG », fasc. intitulé « Unione della Chiesa della Beata Vergine Maria all’Abbazia di S. Maria in Organo ».
49 Voir ASVi, CRS, S. Maria di Lonigo, c. 423, liasse XIV, fasc. D ; AACL, Archivio antico, Leggi e consigli, c. 22, fasc. 1, « Leggi e consigli incipit 1415 finis eius 1588 ».
50 ASVi, Atti dei notai, Ottolino Guglielmazzi fu Andrea, c. 500, fascicule intitulé « Quinternetti di Registri interrotti e mancanti 1543-1546, alle volte anche registrati senza ordine », folios non numérotés, 12 novembre 1545.
51 À cet égard, voir Domenico Giarolo, Memoria sulla Fiera della Madonna di Lonigo con notizie storiche sulla fiera di San Giacomo e sui mercati, Lonigo (Vicence), Gaspari, 1906.
RecitetJustice25112014.indd 186 25/11/2014 15:37:04
Du fascicule processuel à la création d’un culte
187
Épilogue : la politique du culte des saints
Les motivations des notables de Lonigo, lesquels rendent compte de leur hostilité envers les Olivétains, sont différentes : la communauté, étranglée par le système fiscal vénitien qui prévoyait une substantielle délégation des compétences de la répartition et de la perception fiscale aux villes chefs-lieux – en l’occurrence Vicence 52 –, avait certainement entrevu, dans la propriété du récent sanctuaire et de ses foires, une source possible de recettes. Il ne convenait pas, par ailleurs, de sous-estimer sa haute valeur symbolique : la tentative de se réserver la propriété exclusive du sanctuaire correspondait à l’exigence des élites locales de proposer – aux habitants de Lonigo – un symbole identitaire nouveau et – au territoire vicentin – une alternative au temple citadin et au culte de la Madone de Monte Berico de Vicence 53. Le conflit existant entre les institutions citadines et les institutions rurales en Terre Ferme vénitienne au xve et au xvie siècle doit être saisi dans les tenants et les aboutissants de la tentative de Lonigo d’installer à Vicence le monopole du culte marial et dans la conflictualité existant entre Lonigo et Vicence 54, qui n’était du reste pas nouvelle dans l’emploi politique du culte des saints. En 1404, alors que les Vicentins se donnaient spontanément à la Sérénissime en faisant de leur cité l’aînée de Venise 55, Lonigo s’offrait de la même manière par un pacte séparé, dans lequel, parmi les innombrables demandes, elle soutenait la création d’un district de Lonigo indépendant et l’accord vénitien à l’expropriation d’un palais que l’évêque de Vicence possédait dans leur château : à cet emplacement, la communauté proposait la construction d’une église consacrée à saint Marc 56. Une proposition qui se complique si l’on considère le refus contemporain de Vicence d’introduire dans le chef-lieu le culte étatique de l’évangéliste Marc 57 : Vicence élevait ainsi
52 Sur les effets de la fiscalité vénitienne à Vicence, cf. James S. Grubb, Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1988 ; Michael Knapton, « Il Territorio vicentino nello Stato veneto del ‘500 e primo ‘600: nuovi equilibri politici e fiscali », dans Giorgio Cracco et Michael Knapton, dir., Dentro lo “Stado Italico”. Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento, Trente, Gruppo Culturale Civis, 1984, p. 33-114 ; Id., « L’organizzazione fiscale di base nello stato veneziano: estimi e obblighi fiscali a Lisiera tra ‘500 e ‘600 », dans Claudio Povolo, dir., Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi, Lisiera (Vicence), Paroisse de Lisiera, 1981, p. 377-418.
53 Sur la Madone de Monte Berico en tant que culte civique, voir Renato Zironda, « Aspetti del clero... », dans Franco Barbieri et Paolo Preto, dir., op. cit., p. 158-159, et James S. Grubb, op. cit., p. 132.
54 Pour un cadre complet du conflit entre Lonigo et Vicence au xve siècle, ibid., p. 68-69.55 Sur la deditio et sur les privilèges concédés à la cité de Vicence en 1404-1406, voir
Antonio Menniti Ippolito, « La fedeltà vicentina e Venezia », dans Franco Barbieri et Paolo Preto, dir., Storia di Vicenza. L’età della Repubblica Veneta (1404-1797), Vicence, N. Pozza, 1989, t. III /1, p. 29-43.
56 Les chapitres de la deditio de Lonigo à Venise sont publiés et traduits dans Egidio Mazzadi, Lonigo nella storia, vol. I , Dalle origini alla fine del Trecento, Lonigo (Vicence), Cartografica Veneta, 1989, p. 512-521.
57 James S. Grubb, op. cit., p. 132.
RecitetJustice25112014.indd 187 25/11/2014 15:37:04
Giovanni Florio
188
dans le culte des saints la frustration pour l’abandon de n’importe quelle velléité de souveraineté, en dépit de la nouvelle assise territoriale, fruit d’une conquête négociée qui garantît l’hégémonie traditionnelle de la ville sur le contado 58. En vertu de ce principe, les demandes formulées par Lonigo ne trouvèrent pas d’accueil. Face à la concession du rang de podestariat 59 et de quelques exemptions fiscales importantes, la petite cité continua donc à être subordonnée à Vicence, à la grande déception de la notabilité locale, les hommes de la commune – les uomini di commun 60.
Toutefois, en échange, le projet de construction d’une église dédiée à saint Marc ne fut pas abandonné : d’abord mis de côté, il réapparut à la fin du xve siècle, juste quand les interventions pontificales et ducales avaient désormais révélé l’impossibilité de faire du sanctuaire de la Madone des Miracles une église civique, de propriété communale exclusive, sur le modèle de celui que la basilique de Monte Berico pouvait être pour Vicence. Le rôle d’édifice-symbole de l’identité de Lonigo fut définitivement confié à l’élévation de saint Marc, où pouvaient être accueillies les chapelles des confréries professionnelles et dévotionnelles, ainsi que les assemblées de la communauté (convicinia) et du conseil de Lonigo. Ce n’est pas un hasard si saint Marc, en qualité d’église de la communauté, fut très tôt préféré à l’église paroissiale pour l’accueil des podestats : dans ce lieu qui se situe entre le sacré et le profane, le patricien, à peine arrivé de Venise, était en mesure d’embrasser idéalement d’un seul regard tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et religieuse de la terre de Lonigo 61.
58 Les accords de dédition, quoiqu’ils aient été conclus par Venise dans une position privilégiée – ce n’est pas un hasard s’ils furent compris comme une « grâce » concédée par la Dominante après que l’adversaire se fût formellement rendu –, permettaient aux réalités sujettes d’expliquer un certain pouvoir contractuel dans la négociation des obligations et des privilèges de l’annexion. Angelo Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Milan, Unicopli, 1993 [1re éd. 1964], p. 39-47.
59 Pour un cadre général de la division administrative de la Terre Ferme vénitienne, voir Amelio Tagliaferri, « Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma », dans Amelio Tagliaferri, dir., Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori, Milan, Giuffrè, 1981, p. 15-43.
60 De la très riche bibliographie sur les communautés rurales de Vénétie, voir Sergio Zamperetti, « Per una storia delle istituzioni rurali nella terraferma veneta : il contado vicentino nei secoli xvi-xvii », dans Gaetano Cozzi, dir., Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. xv-xviii), Rome, Jouvence, 1985, vol. II , p. 59-132 ; Claudio Povolo, L’intrigo dell’Onore, op. cit., p. 63-68 ; Id., « La piccola comunità e le sue consuetudini », dans Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, Catanzaro, Rubettino, 2008, t. II , p. 591-642.
61 Sur l’église de saint Marc de Lonigo, Egidio Mazzadi, op. cit., ii, p. 322-330.
RecitetJustice25112014.indd 188 25/11/2014 15:37:04
Du fascicule processuel à la création d’un culte
189
RésuméLe 1er mai 1486, l’église démolie de saint Pierre in Lamentese, située non loin de Lonigo, dans le district de Vicence, fut le théâtre d’un fait de sang et de blasphème. Deux cordonniers de Vérone assassinèrent un de leurs compagnons, le spolièrent et se séparèrent dans la petite église pour se répartir le butin. En outre, un des assassins balafra le visage de la Madone peinte à l’intérieur de l’église : selon la tradition, l’image de la Vierge aurait changé sa place et secrété du sang. Suite au miracle, les moines olivétains, propriétaires de l’église de saint Pierre, envoyèrent à Lonigo une de leurs communautés avec la tâche de reconstruire l’édifice et d’en faire un sanctuaire marial avec le titre de sainte Marie des Miracles de Lonigo. La construction du sanctuaire eut un impact considérable sur l’histoire, les arts, la dévotion et l’économie du Bas-Vicentin. En 1605, l’olivétain Giovan Domenico Bertani fit imprimer une Historia de la Madone de Lonigo. Ayant l’intention de rappeler la validité du prodige dans un climat culturel fondamentalement hostile aux formes de miracles populaires, Bertani choisit de construire sa narration hagiographique en se fondant sur des documents d’archives (procès). L’ouvrage de Bertani contribua à conférer une forme canonique au récit du prodige de 1486 et de la genèse du sanctuaire de sainte Marie des Miracles de Lonigo.
RiassuntoDal fascicolo del processo alla creazione di un cultoIl caso della Madonna dei Miracoli di Lonigo
Il 1o maggio 1486 la chiesa diroccata di San Pietro in Lamentese posta poco fuori Lonigo nel distretto di Vicenza, fu teatro di un fatto di sangue e di bestemmia. Due ciabattini di Verona assassinarono un loro compagno, lo rapinarono e si ripararono nella chiessetta per spartirsi la refurtiva. Inoltre, uno degli assassini sfregiò il volto di una Madonna dipinta all’interno della chiesa: secondo la tradizione l’immagine della Vergine avrebbe mutato la sua posizione e stillato sangue. In seguito al prodigio, i monaci olivetani, proprietari della chiesa di san Pietro, avrebbero destinato a Lonigo una propria comunità con il compito di ricostruire l’edificio e farne un santuario mariano con il titolo di santa Maria dei Miracoli di Lonigo. La costruzione del santuario ebbe un notevole impatto sulla vicenda storica, artistica, devozionale e economica del Basso Vicentino. Nel 1605, l’olivetano Giovan Domenico Bertani diede alle stampe una Historia della Madonna di Lonigo. Intenzionato a ribadire la validità del prodigio in una temperie culturale tendenzialmente ostile nei confronti del miracolismo popolare, Bertani scelse di costruire la sua narrazione agiografica sulla base di documentazione archivistica di natura processuale. L’opera di Bertani contribuì a conferire una forma canonica al racconto del prodigio del 1486 e della genesi del santuario di S. Maria dei Miracoli di Lonigo.
RecitetJustice25112014.indd 189 25/11/2014 15:37:04
Table des matières
Lucien Faggion et Christophe ReginaAvant-propos 5
Antoine GaraponPréface 9
La justice et les usages du récit
Laure VerdonLes usages du récit dans l’archive judiciaire médiévale 17
Lucien Faggion et Christophe ReginaLe droit, la loi et l’écriture de la justice 25
Les pratiques politiques du récit judiciaire
Lucien Faggion et Christophe ReginaIntroduction 49
Vincent ChalletLa lèse-majesté ou l’impossible récit 53
Cecilia NubolaL’ennemi politique 67
Olivier CaporossiRodrigo Calderón, Miguel de Molina, Rodrigo de Silva 87
Cristina SettiAvocats, procureurs, juges 105
Mathieu SoulaLes voies de l’exemplarité 121
RecitetJustice25112014.indd 381 25/11/2014 15:37:14
Du singulier au pluriel :récit de soi, récit des autres en justice
Lucien Faggion et Christophe ReginaIntroduction 139
Michel NassietLe récit de crime rémissible au xvie siècle 143
Claudio PovoloUne peinture en plein air 161
Giovanni FlorioDu fascicule processuel à la création d’un culte 177
Antoine-Marie GrazianiQuelques personnages en quête d’auteur 191
Alessandro BoarinDes mots de la prison 203
Le récit, les émotions et la mémoire des corps
Lucien Faggion et Christophe ReginaIntroduction 219
Thierry PastorelloEntrepreneurs de morale et homosexualité à Paris au xviiie siècle 223
Alfredo ViggianoPassions déréglées 243
Agnès WalchLes récits d’amour dans les factums du xixe siècle 261
Le récit judiciaire et l’espace public
Lucien Faggion et Christophe ReginaIntroduction 281
Jean BartLes plaidoyers pédants du procureur Bouchin 283
Gabriele Vickermann-RibémontDu mémoire judiciaire comme relais entre le droit et la fiction littéraire 301
Laura TalamanteUne héroïne inattendue 323
Lucien Faggion et Christophe ReginaConclusion 345
Sources et bibliographie 351
RecitetJustice25112014.indd 382 25/11/2014 15:37:14
le temps de l’histoire
récit et justice
France, italie, espagnexive-xixe siècles
sous la direction de
lucien faggion et christophe regina
récit et justicefrance, italie, espagne xive-xixe siècles
le temps de l’histoire
apporteun éclairage scientifiquesur tous les passés, privilégiantla longue durée, en territoire méditerranéen et au-delà.
En couverture :
Eugène Pascau, les juges© Droits réservés, Musée Bonnat, Bayonne Photo © RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda
aujourd’hui, la presse écrite et télévisuelle, au même titre que le cinéma, ne cessent d’exposer dans l’espace public l’importance et la richesse des informations livrées par la justice, le fait judiciaire et l’écrit. fondée sur une solide et ancienne tradition rhétorique, la manière de dire et de raconter un événement, filtré par la justice, rend singulière et originale la perception des faits décrits, met au jour la construction d’images (négatives et positives) et soulève l’ambiguïté du récit lui-même, entre ce qui repose sur la vérité et ce qui relève de la fiction. ce volume, qui a privilégié une démarche pluridisciplinaire, à la fois synchronique et diachronique, est composé de dix-huit articles dont l’objectif a été de saisir le lien existant entre la justice et le récit en france, en italie et en espagne du xive siècle au xixe siècle. l’intérêt a été prêté aux usages de la justice et de l’écriture, en passant du récit judiciaire au récit fictionnel, de l’espace privé à l’espace public, le tribunal étant l’espace où la parole se trouve finalement libérée.
Lucien Faggion est maître de conférences en histoire moderne à l’université d’Aix-Marseille.Christophe Regina est docteur en histoire moderne et professeur-formateur au sein de l’ESPE de l’université Jean Jaurès de Toulouse.Ils font partie du laboratoire Telemme (MMSH).
32 €
réc
it e
t ju
stic
e fr
an
ce,
ita
lie,
esp
ag
ne,
xiv
e -xix
e siè
cle
s
CouvRecitjustice06112014.indd 1 06/11/14 09:36




















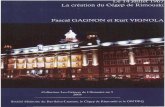













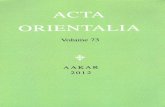

![Hagiographie, liturgie et musique : autour du culte de sainte Enimie, Revue du Gévaudan, n°238, 2014, p. 67-80 [première partie]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632242d163847156ac068a50/hagiographie-liturgie-et-musique-autour-du-culte-de-sainte-enimie-revue-du-gevaudan.jpg)



