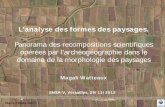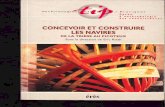Efficacité des différents traitements orthophoniques dans la ...
« Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Eglise : essai de...
Transcript of « Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Eglise : essai de...
JOSÉ COSTA1
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église : un essai de comparaison
La comparaison du corpus des rabbins de l’Antiquité et de celui des Pères ne date pas d’aujourd’hui. Elle a été initiée par les savants de la « Science du judaïsme » (Wissenschaft des Judentums). L’une des œuvres les plus marquantes, réalisée dans la continuité de cette mouvance intellectuelle, est celle de Louis Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenvätern2. Les raisons qui ont stimulé cette entreprise de comparaison sont évidentes. Les Pères et les rabbins ont vécu et enseigné à la même époque et souvent dans les mêmes lieux : des contacts entre les uns et les autres sont historiquement attestés. Les juifs étaient un centre d’intérêt explicite des Pères, même si c’est souvent sous un angle polémique. Leur exégèse a exercé une influence notable sur celle des Pères, comme en témoignent les écrits de Clément d’Alexandrie, d’Origène ou encore de Jérôme.
La recherche actuelle continue à s’intéresser aux rapports entre les rabbins et les Pères, même si elle est plus exigeante que les savants de la « Science du judaïsme » dans le choix des critères qui permettent dans tel cas concret de parler d’influence des rabbins ou des juifs sur les Pères ou vice-versa3. Elle se fait aussi dans le cadre de nouveaux paradigmes. La séparation entre judaïsme et christianisme est de plus
1 Université Paris III, Sorbonne nouvelle, F-75005. 2 L. GINZBERG, Die Haggada bei den Kirchenvätern, 2. vol., Amsterdam-Berlin,
Calvary, 1899-1900. 3 Cf. sur ce point G. STEMBERGER, « Exegetical Contacts between Christians and
Jews in the Roman Empire », dans G. STEMBERGER (éd.), Judaica Minora. Teil I : Biblische Traditionen im rabbinischen Judentum, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, pp. 434-435.
14 José Costa
en plus considérée comme tardive : elle aurait eu lieu au IVe voire au Ve siècle et non en 135 de notre ère, comme le soutenait l’historiographie traditionnelle. Dans le cadre de cette hypothèse, la littérature des rabbins et celle des Pères sont encore partie prenante d’un même ensemble culturel, que Daniel Boyarin appelle « judéo-christianisme » et où les idées et les textes circulent dans les deux sens4. J. Neusner estime pour sa part que la rédaction des Midrashim aggadiques les plus anciens doit être comprise dans le cadre de la montée et de l’institutionnalisation du christianisme. Elle est une réponse aux prétentions du christianisme, exprimées dans la théologie des Pères5. L’autre point essentiel est celui de la nature du judaïsme postérieur à la destruction du Second Temple, que l’on a longtemps réduit au seul judaïsme rabbinique. Le judaïsme d’après 70 reste fondamentalement pluriel. Il comporte notamment une forte compo-sante hellénisée, en diaspora mais aussi en terre d’Israël, et c’est au sein de cette composante que l’on trouve certainement une bonne part des interlocuteurs juifs des Pères.
Les études qui comparent les Pères et les rabbins, anciennes ou plus récentes, n’ont généralement pas un caractère synthétique ou systéma-tique. Il est vrai qu’une approche de ce type n’est pas simple à mener, car ni les Pères, ni les rabbins n’ont vraiment l’esprit de système. Leurs textes, notamment ceux qui relèvent de l’exégèse, sont par définition morcelés et analytiques. La pluralité est enfin de mise dans chacun des groupes : les rabbins de Palestine diffèrent de ceux de Babylonie, les Pères latins des Pères grecs ou syriaques. On trouvera pourtant ici une étude synthétique, consacrée au thème de la création et où l’on tente de
4 D. BOYARIN, La partition du judaïsme et du christianisme, Paris, Cerf, 2011. 5 J. NEUSNER, Comparative Midrash. The Plan and Program of Genesis Rabbah
and Leviticus Rabbah, Atlanta, Scholars Press, 1986 ; Judaism and Christianity in the Age of Constantine, Chicago, University of Chicago Press, 1987 ; Questions and Answers. Intellectual Foundations of Judaism, Peabody, Hendrickson, 2005, pp. 80-82 et 220-224.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 15
cerner les tendances majeures des commentaires patristiques et rabbiniques sur ce sujet, de manière à pouvoir les comparer6.
Aperçu général
Les rabbins s’interrogent d’abord sur les modalités de la création. L’idée de la création ex nihilo est loin d’aller de soi et les traditions rabbiniques accordent manifestement une place substantielle à d’autres modèles eschatologiques comme celui de la création à partir d’une matière première ou de l’émanation7. À la suite de Gn 1, les rabbins insistent sur le pouvoir créateur du verbe divin, comme en témoigne l’expression « celui qui parla et le monde fut », inspirée de Ps 32, 9 (« il parla et il fut »). Dans sa liste des choses qui se comptent par dix, le traité Abot cite les dix paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde8. L’amora babylonien Rab (220-250) donne les noms de ces dix paroles
6 En plus des sources elles-mêmes, nous avons sollicité quelques études où l’on
trouve déjà des tentatives de synthèse sur la création. Il s’agit principalement pour la littérature rabbinique d’E. URBACH, Les Sages d’Israël. Conceptions et croyances des maîtres du Talmud, Paris/Lagrasse, Cerf/Verdier, 1996, qui comporte deux chapitres sur la création (« Celui qui parla et le monde fut », pp. 193-223, « L’homme », pp. 225-265) et pour les Pères de l’Église de M.-A. VANNIER, La création chez les Pères, Bern et al., Peter Lang, 2011 et d’A. ORBE, Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles, trad. de J. M. Lopez de Castro, revue et complétée par A. Bastit et J.-M. Roessli, 1er vol., Paris, Cerf, 2012, pp. 147-176 « De la conception à la génération du verbe » ; pp. 221-242 « La création du monde » ; pp. 243-260 « Création ex nihilo » ; pp. 261-288 « Ab aeterno ou dans le temps ? » ; pp. 289-304 « Création libre ou nécessaire ? » ; pp. 305-320 « L’homme, centre de la création » ; pp. 321-341 « Hexaemeron » ; pp. 343-368 « Création de l’homme ».
7 Cf. G. SCHOLEM, « La création à partir du néant et l’autocontraction de Dieu », dans G. SCHOLEM, De la création du monde jusqu’à Varsovie, Paris, Cerf, 1990, pp. 37-38.
8 Mishna, Abot, 5, 1.
16 José Costa
ainsi que les versets des Psaumes, des Proverbes et de Job qui s’y rapportent9. Selon M. Idel, ces paroles de Rab sont dotées d’une certaine autonomie, puisque chacune d’entre elles est associée à un domaine spécifique de l’univers, ce qui contribue à les individualiser. Elles constitueraient une préfiguration de la liste des dix sefirot de la kabbale médiévale10. Le moyen de la création est parfois identifié à la Tora ou aux lettres de l’alphabet hébraïque (combinées ou non)11. Pourquoi enfin Dieu a-t-il éprouvé le besoin de créer le monde en six jours ? Plusieurs traditions soulignent que Dieu a tout créé le premier jour en un seul acte créateur et que les autres jours n’ont été qu’une période d’installation des choses déjà créées12.
Les rabbins accordent ensuite une importance particulière au motif de la création de l’homme. Leur exégèse se montre particulièrement inspirée par Gn 2, 7 et le verbe wa-yi er, « et il a formé », qui est écrit avec deux yodin, c’est-à-dire avec deux « y », ce qui est une anomalie. Ces deux « y » feraient allusion à deux formations (ye irot), par exemple celle du penchant au bien et du penchant au mal13. Ps 139, 5 évoquerait la création et peut être compris au moins de deux manières. La lecture « Derrière et devant, tu m’as formé » se réfère à l’Adam androgyne14. Une autre lecture, qui donne plutôt un sens temporel aux deux premiers mots du verset, « Après et avant, tu m’as formé », situe la création de l’âme d’Adam le premier jour et celle du corps le dernier : elle insiste sur le fait que l’homme est à la fois la première et la dernière chose créée et qu’il est donc l’élément le plus important de la création15. Les aggadot reviennent à plusieurs reprises sur le gigantisme originel
9 Talmud Babli, agiga, 12a. 10 M. IDEL, La cabale. Nouvelles perspectives, Paris, Cerf, 1998, pp. 231-233. 11 Sur la Tora, cf. Mishna, Abot, 3, 14 ; Sifre Debarim, 48 ; Be-reshit Rabba, 1, 1.
Sur les lettres de l’alphabet, cf. Be-reshit Rabba, 12, 10 (le monde présent a été créé par he et le monde futur par yod) et le Sefer ye ira.
12 Be-reshit Rabba, 1, 14 et 12, 4. 13 Be-reshit Rabba, 14, 4. 14 Be-reshit Rabba, 8, 1. 15 Be-reshit Rabba, 8, 1 et 12, 4.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 17
d’Adam, qui aurait vu sa taille diminué après la faute16. L’idée selon laquelle Israël ou l’homme juste est la finalité de la création ne manque pas d’être rappelée sous différentes formes17.
Certains rabbins semblent enfin donner au récit de la création une place à part dans le reste de la Tora. Dans un passage de la Mishna, le « récit de la création » (lit. : “du commencement”) (c’est-à-dire Gn 1 et 2), comme la liste des interdits sexuels de Lv 18 et le « (récit du) char » (c’est-à-dire Ez 1), ont un statut clairement ésotérique. Le « récit de la création » ne peut être enseigné qu’à une seule personne18. Cette limitation est quelque peu surprenante, quand on considère le très grand nombre de midrashim consacrés au récit de la création et le fait que la lecture synagogale de Gn 1 et 2 devait s’accompagner d’une homélie, qui par définition commentait le texte de la parasha. E. Urbach soutient que le statut ésotérique de la création aurait caractérisé surtout l’époque tannaïtique et qu’il aurait décliné à l’époque des amora’im. Les nombreuses traditions attribuées à l’amora babylonien Rab, qui commentent la Genèse sous un angle nettement mythologique, seraient là pour en témoigner19.
16 Talmud Babli, agiga, 12a. 17 Be-reshit Rabba, 1, 4 et parallèles (création en vue d’Israël) et les nombreux
commentaires du verset : « Le juste est le fondement du monde » (Pr 10, 25). 18 Mishna, agiga, 2, 1. 19 E. URBACH, Les Sages d’Israël, op. cit., pp. 202-203. La Tosefta (Megilla, 3, 28)
évoque ceux qui exposent publiquement le récit du char dans un cadre synagogal. De manière plus générale, elle semble moins restrictive que le passage de Mishna,
agiga, 2, 1. Le Talmud Yerushalmi ( agiga, 2, 1) attribue cette mishna à Rabbi ‘Aqiba et comme certains des sujets ésotériques qu’elle mentionne ont été enseignés de manière publique par des amora’im (les interdits sexuels par Rabbi Ammi, le récit de la création par Rabbi Yehuda ben Pazi), il en déduit que la halakha est fixée conformément à l’avis de Rabbi Yishma‘el. La même séquence du Talmud Yerushalmi et surtout sa correspondante dans le Talmud Babli ( agiga, 11b-16a) contiennent de nombreuses traditions cosmologiques, même si elles soulignent çà et là le danger que comportent certaines spéculations (par exemple dans l’histoire de Ben Zoma qui réfléchit sur la distance entre les eaux d’en haut et les eaux d’en bas). Sur tous ces points, cf. P. SCHÄFER, The Origins of Jewish Mysticism, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, pp. 175-242.
18 José Costa
Si certains textes donnent au récit de la création un statut spécifique, d’autres ne semblent pas lui accorder une importance particulière. Dans un texte célèbre de la Mishna, le premier recueil des lois rabbiniques, compilé en 200 de notre ère, apparaissent plusieurs principes de foi, dont la remise en question par un juif est sanctionnée par son exclusion du monde futur. Ces principes sont au nombre de trois : la résurrection des morts, l’origine divine de la Tora et la providence20. La création n’apparaît pas dans cette liste, si ce n’est de manière indirecte, la résurrection pouvant être conçue comme une nouvelle création21. Les commentaires de Gn 1 ne mentionnent cependant guère la résurrection des morts et les textes sur la résurrection font assez peu souvent des parallèles avec la création. Un midrash est révélateur du peu d’importance que certains rabbins accordent au récit de Gn 1. Il commence par la question de Rabbi Lévi (290-320) : Pourquoi avoir commencé la Tora par un récit des origines et non par « ce mois sera pour vous le premier des mois » (Ex 12, 1) ? Si l’on identifie la Tora à la loi révélée à Moïse, le récit de la création paraît en effet dénué d’utilité. Selon Rabbi Lévi, il répond à un autre objectif : montrer que Dieu est le propriétaire du monde et qu’il avait donc le droit de priver les Cananéens de leur terre et de la donner à Israël22. On est loin de la création telle que la conçoit le rabbin médiéval Na manide, principe de la foi et fondement de la Tora23.
L’exégèse rabbinique du récit de la création, dont nous venons de présenter les principaux thèmes, comporte aussi ce qu’on pourrait appeler des contraintes internes et externes. Les contraintes internes consistent dans les difficultés inhérentes au texte même de Gn 1 et 2.
20 Mishna, Sanhedrin, 10, 1. 21 Cf. par exemple la parabole de l’artisan qui travaille à partir de l’eau et de l’artisan
qui travaille à partir de l’argile ainsi que la parabole du roi qui demande à ses serviteurs de lui construire des palais là où il n’y a ni eau ni poussière (Talmud Babli, Sanhedrin, 90b-91a). Ces paraboles comparent la création à la résurrection, mais le texte n’est pas assez explicite pour savoir s’il s’agit de la création de l’embryon ou de celle du monde.
22 Be-reshit Rabba, 1, 2. 23 Na manide, Commentaire de la Tora sur Gn 1, 1.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 19
Le Ga’on de Vilna, un grand commentateur de la Bible et du Talmud, qui a vécu en Lithuanie au XVIIIe siècle (Rabbi Eliyyahu ben Shelomo Zalman, 1720-1797), a relevé trente-deux difficultés dans le récit de la création de Gn 124. Les contraintes externes résident dans le caractère intertextuel et éventuellement polémique de certaines traditions rabbiniques sur la création. Sur des thèmes comme la notion de projet divin, la pré-existence de la Tora ou encore l’émanation de la lumière primordiale, les assertions des rabbins présentent de nettes affinités avec celles de Philon25. Les rabbins avaient-ils connaissance de l’œuvre de Philon ou puisent-ils comme Philon à des sources communes ? Rabbi Hosha‘ya aurait-il subi l’influence de Philon par l’intermédiaire d’Origène, comme le pensent certains26 ? D’autres éléments de la culture hellénistique semblent avoir frayé leur voie dans la littérature aggadique (les mondes antérieurs des stoïciens, l’androgyne du Banquet de Platon…), mais en perdant dans une large mesure leur caractère mythologique27. Certaines thèses, comme le motif philonien des deux hommes ou des deux créations, sont manifestement rejetées28. Le commentaire se déploie aussi sur un arrière-plan polémique à l’égard de la lecture gnostique du récit de la création. Les rabbins s’opposent à l’idée que la création soit issue du travail de plusieurs dieux ou de plusieurs anges ou que le monde créé soit mauvais ou encore que l’Adam originel soit divin29. E. Urbach affirme cependant que certains éléments gnostiques ont été empruntés par les rabbins, d’où le statut
24 Adderet Eliyyahu, Jérusalem, 1975, p. 1a. 25 Cf. E. URBACH, Les Sages d’Israël, op. cit., pp. 196-197, 208-209 et 218-219. 26 Cf. D. BARTHÉLEMY, « Est-ce Hoshaya Rabba qui censura le Commentaire
allégorique ? », dans Philon d’Alexandrie, Lyon, 11-15 septembre 1966 : colloques nationaux du CNRS, Paris, 1967, pp. 45-79. Pour M. NIEHOFF, c’est la cosmologie même d’Origène qui aurait influencé directement Rabbi Hosha‘ya (« Creatio ex nihilo Theology in Genesis Rabbah in Light of Christian Exegesis », dans The Harvard Theological Review, 99, 2006, pp. 60-64).
27 Cf. E. URBACH, Les Sages d’Israël, op. cit., pp. 220-221 et 239. 28 Ibid., p. 238. 29 Ibid., pp. 194 et 222 (plusieurs dieux), 205 et 210-212 (monde créé mauvais), 213-
215 (plusieurs anges) et 240-242 (Adam originel divin).
20 José Costa
ésotérique qu’ils donnent au motif de la création30. Tous les textes considérés comme anti-gnostiques ne le sont pas nécessairement. Certaines traditions rabbiniques critiquent l’idée que la création proviendrait de la collaboration de plusieurs dieux : or la gnose insiste plutôt sur l’antagonisme entre deux divinités. Ces traditions manifes-teraient donc l’hostilité des rabbins à l’égard d’un bithéisme juif, qui ne se limite pas au judaïsme de tendance chrétienne. Philon avec le logos, qualifié de deuteros theos, « deuxième dieu » et le Targum avec le memra, terme araméen signifiant « parole » comme logos, prouvent, entre autres attestations, l’existence d’un bithéisme juif antérieur et aussi postérieur à celui qui s’exprime dans le Prologue du Verbe de l’Évangile de Jean31.
À première vue, les Pères et les rabbins ont des préoccupations fort semblables dans leur commentaire de Gn 1 et 2. Quand on entre dans le détail de chacun des thèmes concernés, l’identité des deux discours est cependant beaucoup moins nette. Sur la question des modalités de la création, les Pères sont plus clairs que les rabbins dans leurs choix : ils rejettent unanimement la création à partir d’une matière première préexistante et défendent de manière très explicite la création ex nihilo32. Le motif de la parole créatrice est également présent, mais avec une inflexion particulière : l’identification de cette parole avec le fils de Dieu, qui est aussi le Messie. De manière générale, cette lecture de la création fait intervenir des conceptions binitaires puis trinitaires, qui 30 Ibid., p. 193. Cf. aussi la formation d’une gnose juive qui aurait porté le nom de
ma‘ase be-reshit : A. ALTMANN, « Gnostic Themes in Rabbinic Cosmology », dans I. EPSTEIN, E. LEVINE et C. ROTH (éd.), Essays in Honour of the Very Rev. Dr. J. H. Hertz, London, E. Goldston, 1942, pp. 19-32 et G. SCHOLEM, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition, New York, The Jewish Theological Seminary, 1960.
31 Cf. D. BOYARIN, « The Gospel of the Memra : Jewish Binitarianism and the Prologue to John », dans The Harvard Theological Review, 94, 2001, pp. 243-284.
32 Cf. H. A. WOLFSON, « The Meaning of Ex nihilo in the Church Fathers, Arabic and Hebrew Philosophy, and St. Thomas », dans I. TWERSKY et G. H. WILLIAMS (éd.), Studies in the History of Philosophy and Religion, Cambridge, Harvard University Press, 1973, p. 207.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 21
éloignent à première vue les Pères des rabbins. Là où les « chrétiens » donnent au Verbe un statut hypostatique et l’identifient à la personne du Messie, les « juifs » en resteraient à l’idée simple que Dieu a créé sans effort, en parlant. En réalité, la question est plus complexe, puisque la conception « chrétienne » du Verbe peut être qualifiée de bithéiste et le bithéisme était très répandu dans le judaïsme des premiers siècles, y compris au sein du mouvement rabbinique qui l’a vigoureusement critiqué33. Les racines juives des spéculations trinitaires ont été mises en évidence par plusieurs chercheurs34.
On retrouve chez les Pères l’idée que Dieu aurait tout créé le premier jour, mais elle ne découle pas des mêmes considérations textuelles. Les rabbins, qui partent du texte hébreu de la Bible, tirent parti de la double présence dans Gn 1, 1 de la particule et, qui sert à introduire le complément d’objet et qui signifie aussi « avec ». Ils comprennent donc : « (Au commencement, Dieu créa) » et ha-shamayim, le ciel et tout ce qu’il contient, we-et ha-are , la terre et tout ce qu’elle contient35. Pour les Pères qui commentent la Bible en grec, la même idée est fondée sur Gn 1, 5, où il est dit hêmera mia, « jour un » et non hêmera prôtê, « premier jour » : c’est le jour où Dieu a tout fait en une fois36. Dans la traduction grecque d’Aquila, l’expression be-reshit, « au commencement » (rosh : la tête), est traduite par kephalaion, « résumé » (kephalê : la tête), c’est-à-dire que le premier acte créateur concentre en lui tous les aspects de la création37. 33 Cf. D. BOYARIN, La partition du judaïsme et du christianisme, op. cit., pp. 171-
272. 34 Cf. sur ce point J. COSTA, « Hypostase, émanation et bithéisme dans le judaïsme
antique : des catégories entre théologie et mystique » (à paraître dans les actes du colloque « Mystique et philosophie », Troyes, 2011).
35 Be-reshit Rabba, 1, 14 et 12, 4. 36 PROCOPE DE GAZA, Commentarium in Genesim, PG 87 (I), 60D-61D (la première
interprétation). Cf. aussi les remarques de M. ALEXANDRE sur la tradition alexandrine (Clément, Origène, Didyme), qui s’enracine dans les commentaires de Philon (De opificio mundi, 13, 14), Le commencement du livre, Genèse I-V. La version grecque de la Septante et sa réception, Paris, 1988, p. 99.
37 BASILE LE GRAND, Homiliae in hexaemeron, I, 6 ; GRÉGOIRE DE NYSSE, Hexaemeron, PG 44, 72A.
22 José Costa
Même s’ils n’ignorent pas ce motif, les rabbins insistent beaucoup moins que les Pères sur le fait que les six jours de la création représentent les six millénaires de l’histoire de l’humanité et de sa spiritualisation et divinisation progressive38.
Le motif de la création de l’homme occupe également une place de choix chez les Pères et le caractère anthropocentrique de la création est peut-être plus encore marqué chez eux. Ils se singularisent cependant par une approche plus dualiste que celle des rabbins et par une préférence pour les versets de Gn 1, 26-2739. L’idée d’un Adam originellement gigantesque est a priori absente de la littérature des Pères, sauf dans le cadre métaphorique du couple microcosme/ macrocosme40. Elle était en revanche partagée par certains gnostiques41. La finalité de la création n’est plus l’homme juif mais l’homme chrétien, comme le souligne L. Ginzberg42.
À l’inverse des rabbins, les Pères accordent à la création une place centrale dans leur théologie :
Comme il leur revenait d’annoncer la nouveauté du christianisme dans le monde gréco-romain […], les Pères ont très vite mis en évidence la place centrale de la création, qui exprime le projet d’amour de Dieu pour l’humanité et l’alliance qu’il
38 A. ORBE, Introduction…, op. cit, pp. 324-341. Pour les rabbins, cf. Talmud Babli,
Sanhedrin, 97a-b. 39 A. ORBE, Introduction…, op. cit., pp. 343-368. 40 Cf. le De hominis opificio de GRÉGOIRE DE NYSSE et le commentaire qu’en fait
E. CORSINI dans « L’harmonie du monde et l’homme microcosme dans le De hominis opificio », dans J. FONTAINE et C. KANNENGIESSER (éd.), Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou, Paris, Beauchesne, 1972, pp. 455-462. Les Pères (à commencer par Grégoire de Nysse) prennent cependant leurs distances avec la conception stoïcienne de l’homme microcosme. Sur l’utilisation rabbinique du motif, cf. E. URBACH, Les Sages d’Israël, op. cit., pp. 243-244.
41 IRÉNÉE DE LYON, Adversus haereses, V, 22, 2 et HIPPOLYTE, Philosophumena, 5, 2 et 8, 16.
42 CYPRIEN, Epistola ad Donatum, 1, 14 ; JUSTIN, 2 Apologia, 7 ; L. GINZBERG, Les Légendes des Juifs, t. 1, Paris, Cerf, 1997, p. 192.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 23
lui propose, d’où les divers traités ou homélies patristiques qui sont parvenus jusqu’à nous43.
L’antagonisme des Pères avec la gnose les a retenus de donner au récit de la création une dimension ésotérique trop marquée44.
Sur le plan des contraintes internes et externes, déjà mentionnées, les rabbins et les Pères présentent un profil assez similaire. Ainsi, vingt-cinq des trente-deux difficultés que le Ga’on de Vilna a pointées dans le récit de la création sont toujours présentes dans la version grecque de la Septante. Certaines de ces difficultés ont donc disparu, comme l’expression « il en fut ainsi », placée dans le texte massorétique après la création du firmament (Gn 1, 7) et que la Septante a déplacée avant cette création, conformément à ce qui est le cas dans les autres choses créées. La traduction de la Septante peut à son tour poser de nouvelles difficultés, comme la traduction de tohu par aoratos, « invisible ». Concernant les contraintes externes, il est évident que la lutte contre la gnose ou la place occupée par les éléments philoniens est encore plus importante chez les Pères que chez les rabbins.
Deux points distinguent cependant des Pères plus hellénisés que les rabbins : l’usage de l’allégorie et les préoccupations philosophiques. Les Pères mènent souvent une exégèse de la création à deux niveaux, celui du sens littéral et celui du sens allégorique. Dans cette dernière perspective, le soleil, la lune et les étoiles du quatrième jour de la création sont identifiés à Dieu, à l’homme et aux prophètes ou les monstres marins de Gn 1, 21 au diable et aux anges déchus ou aux
43 M.-A. VANNIER, « Avant-propos », dans M.-A. VANNIER (éd.), La création chez
les Pères, op. cit., p. 1. 44 G. STROUMSA, dans son ouvrage Hidden Wisdom (Esoteric Traditions and the
Roots of Christian Mysticism, (Leiden/New York/Köln, Brill, 1996), a montré que des doctrines chrétiennes ésotériques ont existé dès le début et pendant les premiers siècles. Elles provenaient plus de la mystique juive que des mystères grecs. Elles ont été adoptées et développées par les groupes gnostiques comme base de leur mythologie. Ces représentations ésotériques sont donc combattues dès le IIe siècle par les Pères. Leur terminologie a en revanche marqué de manière plus durable la mystique chrétienne.
24 José Costa
pensées impures45. Cette dimension allégorique est peu présente dans le commentaire des rabbins, même si elle peut être plus prégnante dans l’explication de certains versets, par exemple celle du couple initial de la lumière et des ténèbres46. Les passages d’ordre philosophique, déployant des arguments contre la matière première incréée ou spéculant sur les notions de temps et d’éternité sont absents du discours des rabbins47.
Trois motifs : la création ex nihilo, le couple création/émanation, la création de l’homme
La croyance en la création ex nihilo comme le couple création/émanation se retrouvent chez les Pères comme chez les rabbins, mais ils ne se présentent pas d’une manière semblable dans les deux corpus. Chez les Pères, la création et l’émanation occupent des fonctions clairement distinctes : le monde est créé par Dieu, le Verbe est émané de Dieu (« engendré non pas créé48 »). L’identification de la création ex nihilo avec l’émanation est peu fréquente49. Ainsi, chez Athanase, le monde est créé « à partir du non-existant » (ex ouk ontôn), 45 ORIGÈNE, Commentarium in Joannem, I, XVII, 96 et Homiliae in Genesim, I, 8-
10 ; DIDYME L’AVEUGLE, Commentarii in Genesim, I, 45. 46 Il s’agit cependant pour les rabbins d’une synthèse allégorique de l’histoire sainte
(A. TZVETKOVA-GLASER, Pentateuchauslegung bei Origenes und den frühen Rabbinen, Frankfurt am Main et al., Peter Lang, 2010, p. 76) qu’A. Orbe qualifierait plutôt d’exégèse littérale (Introduction…, op. cit., p. 324).
47 Sur ces aspects philosophiques, cf. par exemple Y. MEESSEN, « De l’usage du double concept aristotélicien matière-forme dans la pensée augustinienne de la création », dans M.-A. VANNIER (éd.), La création chez les Pères, op. cit., pp. 133-145.
48 Cf. H. A. WOLFSON, « The Meaning of Ex nihilo... », art. cit., pp. 208-209. 49 Cf. par exemple H. A. WOLFSON, « The Identification of Ex nihilo with Emanation
in Gregory of Nissa », dans The Harvard Theological Review, 63, 1970, pp. 53-60.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 25
alors que le Fils provient de l’essence du Père (tês ousias tou patros)50. L’expression ouk ontôn, qu’emploie Athanase, a une longue histoire : on la trouvait déjà dans 2 Ma 7, 28, où il est difficile de dire si elle désigne le néant pur et simple ou une matière première incréé. Selon H. Wolfson, chez les Pères, cette ambiguïté est levée et le principe de la création ex nihilo est toujours énoncé avec une grande clarté. Ses doctrines rivales (création à partir d’une matière première préexistante, éternité du monde) sont rejetées de la manière la plus explicite.
Certains auteurs chrétiens du milieu du IIe siècle semblaient cependant croire en la création à partir d’une matière première51. Il a fallu attendre la deuxième moitié du IIe siècle pour trouver dans la littérature chrétienne des affirmations explicites de la création ex nihilo. Selon G. May, ce changement est dû à une prise de conscience chez les auteurs chrétiens : seule la croyance en la création ex nihilo constitue une base suffisamment solide pour contrer la conception gnostique de la création et réaffirmer les principes de l’unité, de la souveraineté et de la toute-puissance divines52. J. A. Goldstein critique cette explication : les premiers auteurs chrétiens qui mentionnent la création ex nihilo (Tatien, Théophile d’Antioche, Irénée et Tertullien) cherchent surtout à justifier la doctrine de la résurrection corporelle53. Le point de vue de G. May est par ailleurs plus subtil, puisque l’idée même de création ex nihilo proviendrait des chrétiens gnostiques. Basilide est le premier auteur chrétien à parler de création ex nihilo (Hippolyte, Elenchos, VII, 2)54. Origène, dans la première moitié du IIIe siècle, bataille encore
50 ATHANASE, Orationes contra Arianos, 635. 51 Il s’agit de Justin, de l’auteur du De resurrectione et d’Athenagoras, cf. G. MAY,
Schöpfung aus dem Nichts. Die Entstehung der Lehre von den creatio ex nihilo, Berlin-New York, W. de Gruyter, 1978, pp. 122-142.
52 G. MAY, Schöpfung aus dem Nichts, op. cit., pp. 25-26 et 183. 53 J. A. GOLDSTEIN, « The Origins of the Doctrine of Creation Ex nihilo », dans
Journal of Jewish Studies, 35, 1984, pp. 132-133. 54 Le rapport que les chrétiens « orthodoxes » entretiennent avec la gnose est
complexe, comme l’est aussi celui des rabbins.
26 José Costa
contre des chrétiens partisans de la création à partir d’une matière première55.
Les rabbins présentent une situation exactement inverse à celle des Pères : le principe de la création ex nihilo n’est pas énoncé de manière nette et l’émanation peut jouer un rôle dans la création du monde. La création ex nihilo a une présence plus que discrète dans la littérature rabbinique ancienne et E. Urbach en parle à peine dans le chapitre des Sages d’Israël qu’il consacre à la création du monde. On la trouve certes dans le fameux dialogue opposant un philosophe à Rabban Gamliel (80-110). Le philosophe lui dit que l’œuvre créatrice de son Dieu est impressionnante (il est « un grand peintre »), mais qu’il a eu de bons assistants (« de bonnes couleurs ») : le tohu wa-bohu, les ténèbres, les eaux, le vent (rua ) et l’abîme. Le récit de la Genèse n’emploie pas en effet le verbe « créer » pour tous ces éléments, qui constituent donc aux yeux du philosophe, vraisemblablement d’obédience platonicienne, les matériaux préexistants qui ont permis au Dieu-démiurge de créer le monde. Rabban Gamliel lui démontre que cette absence du verbe créer n’est qu’apparente et qu’un examen approfondi des Écritures confirme le caractère créé de tous ces éléments. Rab (220-250) raisonne de manière semblable, en montrant à partir de l’Écriture que Dieu a créé dix choses le premier jour56. Les deux traditions de Rabban Gamliel et de Rab restent cependant isolées dans le corpus rabbinique. Ainsi, de nombreux Midrashim parlent de la création de X à partir de Y, sans préciser si le matériau Y a été lui aussi créé ou pas57. Certes, Bar 55 Cf. Praeparatio Evangelica, 7, 20 et A. TZVETKOVA-GLASER,
Pentateuchauslegung bei Origenes…, op. cit., p. 61. 56 Talmud Babli, agiga, 12a. 57 Cf. Talmud Yerushalmi, agiga, 2, 1 et un monde initial qui était uniquement
« eaux sur eaux », Be-reshit Rabba, 2, 4 et le commentaire qu’en fait E. URBACH (Les Sages d’Israël, op. cit., p. 199 : les eaux seraient une matière première éternelle pour Ben Zoma), Be-reshit Rabba, 12, 11 (selon Rabbi Eliezer, tout ce qui est dans les cieux a été créé à partir des cieux, tout ce qui est sur la terre à partir de la terre, pour son contradicteur Rabbi Yehoshua‘ tout a été créé à partir des cieux), Be-reshit Rabba, 1, 5 (Bar Qappara : « “Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre”, d’où ont-ils (été créés) ? “Et la terre était tohu wa-bohu” » ; la parabole des immondices de Rab), les traditions sur les choses antérieures à la
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 27
Qappara (200-220) et Rab (220-250) voient dans la création du monde « à partir du tohu wa-bohu » une chose impensable ou insultante à l’égard de Dieu. On pourrait donc estimer qu’ils soutiennent indirec-tement l’un et l’autre la création ex nihilo. Dans le cas de Rab, ce serait même une confirmation de son opinion sur les dix choses créées le premier jour58. Mais cette conclusion n’est pas pleinement convain-cante, car la création « à partir du tohu wa-bohu » a beau être pour Bar Qappara et Rab impensable ou insultante, elle n’en est pas moins un fait, dont la réalité n’est pas contestée ou contestable. Tout ce que l’homme juif peut faire est de s’en étonner ou de ne pas en parler59.
création du monde (par exemple Be-reshit Rabba, 1, 4), Be-reshit Rabba, 10, 3 (Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Ya‘aqob : la création n’a été possible qu’après le déracinement du tohu wa-bohu ; Rabbi Yo anan : le monde a été créé en entrelaçant deux pelotes, une de feu et une de neige), Talmud Babli, Shabbat, 88a (où Dieu menace de faire revenir le monde au tohu wa-bohu et non au néant).
58 Be-reshit Rabba, 1, 5. Bar Qappara: « Si la chose n’était pas écrite, il serait impossible de le dire. » Pour M. NIEHOFF (« Creatio ex nihilo Theology in Genesis Rabbah in Light of Christian Exegesis », art. cit., p. 57), cette déclaration fait allusion à Mishna, agiga, 2, 1 et ses restrictions concernant le « récit de la création ». Si l’Écriture ne parlait pas elle-même du tohu wa-bohu, on ne pourrait pas le faire, car ce serait étudier un sujet interdit par la Mishna, c’est-à-dire ce qu’il y avait avant la création du monde. Cette lecture de M. Niehoff n’est pas la seule possible : on peut aussi penser qu’aux yeux de Bar Qappara, la création ex nihilo serait la croyance la plus conforme à l’essence de la divinité, mais que le verset de Gn 1, 2 nous oblige à penser les choses autrement, ce qui est fort perturbant.
59 Selon M. NIEHOFF (ibid., pp. 55-60), Bar Qappara est partisan de la création à partir d’une matière première et c’est le rédacteur de Be-reshit Rabba, qui a juxtaposé son opinion avec celle de Rab, de manière à l’orienter dans le sens de cette dernière, c’est-à-dire celui de la création ex nihilo. Cette interprétation ne nous semble pas refléter la complexité des deux textes, qui reconnaissent l’un et l’autre la création à partir d’une matière première, tout en manifestant un certain malaise à l’égard de cette croyance. Une parabole assez semblable à celle de Rab est citée dans Talmud Yerushalmi, agiga, 2, 1 et Talmud Babli, agiga, 16a, mais elle est attribuée à d’autres amora’im (Rabbi Yo anan et Rabbi Eleazar dans le Talmud Babli, Rabbi Eleazar seul dans le Talmud Yerushalmi), ce dont M. Niehoff ne tient pas compte dans son raisonnement.
28 José Costa
Les traditions sur la création de la lumière sont particulièrement ambiguës :
Rabbi Shim‘on ben Yeho adaq interrogea Rabbi Shemu’el bar Na mani, en lui disant : Parce que j’ai entendu sur toi que tu es un maître dans la aggada, (dis-moi) d’où la lumière a été créée ? Il lui répondit : (Cela nous) enseigne que le Saint, béni soit-Il, s’est enveloppé en elle comme dans un manteau et il a fait briller (hibhiq) l’éclat de sa splendeur (ziw hadaro) d’une extrémité du monde à l’autre60.
La question de Rabbi Shim‘on ben Yeho adaq : « d’où la lumière a-t-elle été créée ? » n’a pas de parallèle dans les textes tannaïtiques. Elle suggère que la création de la lumière ne s’est pas faite à partir du néant, mais à partir d’une matière première, alors que Gn 1, 3 va plutôt dans le sens de la première hypothèse. La réponse de Rabbi Shemu’el bar Na mani (290-320) est curieuse. Loin de nous préciser à partir de quoi la lumière a été créée, Rabbi Shemu’el bar Na mani décrit la lumière comme une chose déjà existante : « Le Saint, béni soit-il, s’est enveloppé en elle… », c’est-à-dire dans une lumière qui est déjà là. Comme l’ont proposé V. Aptowitzer et A. Altmann, il expose un autre modèle cosmologique, celui de l’émanation. Il faut vraisemblablement comprendre :
Le Saint, béni soit-il, s’est enveloppé en elle (= une lumière préexistante, issue d’une émanation précédente ?) comme dans un manteau et il a fait briller l’éclat de sa splendeur (= une deuxième lumière émanée de la première) d’une extrémité du monde à l’autre.
Les versions les plus tardives de cette tradition présentent cette lumière émanée comme une sorte de matière première, qui sert de base à la création du monde. Sur tous ces points, la lumière du manteau divin a des affinités frappantes avec le logos de Philon (même si chez Philon le
60 Be-reshit Rabba, 3, 4, ms Vatican 60.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 29
logos est immatériel), ce qui montre que le lien entre émanation et Verbe n’est pas totalement inconnu de certains rabbins61.
Faut-il comprendre de ce rapide aperçu que la création ex nihilo était minoritaire chez les rabbins de l’Antiquité ? Il serait trop simple en effet de supposer qu’elle est implicitement admise dans un grand nombre de traditions : la centralité de la croyance en la création ex nihilo dans la théologie juive médiévale n’implique pas qu’elle avait un statut semblable chez les rabbins de l’Antiquité. Ainsi, selon D. Winston, cette croyance est absente du judaïsme hellénisé et peu représentée dans le judaïsme rabbinique où elle n’apparaît que dans un contexte polémique avec la gnose. La position la plus commune chez les rabbins est la création à partir d’une matière première62. D’autres commenta-teurs sont plus nuancés et trouvent dans la littérature judéo-hellénistique comme dans la littérature rabbinique plusieurs courants cosmologiques, parmi lesquels celui de la création ex nihilo63. J. A. Goldstein estime que certains juifs au moins adhéraient à cette conception, ceux qui croyaient en la résurrection corporelle, notamment dans sa forme la plus extrême, celle de la résurrection à l’identique. C’est le cas de l’auteur de 2 Macchabées et de Rabban Gamliel64. Les juifs qui adhèrent à l’immortalité de l’âme (dans le judaïsme hellénisé)
61 Cf. sur ce point J. COSTA, « Émanation et création : le motif du manteau de lumière
revisité », dans Journal for the Study of Judaism, 42, 2011, pp. 218-252. 62 D. WINSTON, « The Book of Wisdom’s Theory of Cosmogony », dans History of
Religion, 11, 1971, pp. 185-202. Le principal exemple cité par D. Winston est le dialogue entre Rabban Gamliel et le philosophe dans Be-reshit Rabba, 1, 9. Or, même ce texte n’est pas une affirmation explicite de la création ex nihilo et peut être interprété autrement (op. cit., p. 191, n. 20).
63 A. ALTMANN, « A Note on the Rabbinic Doctrine of Creation », dans A. ALTMANN, Studies in Religious Philosophy and Mysticism, Ithaca, Cornell Université Press, 1969, pp. 128-129 (l’auteur cite 2 Ma 7, 28, II Hénoch, 24, 2, IV Esdras, 4, 38-54 et Be-reshit Rabba, 1, 9). M. Kister voit dans Jubilés, 2, 1-2 la plus ancienne attestation de la création ex nihilo (cf. la critique de M. NIEHOFF, « Creatio ex nihilo Theology in Genesis Rabbah in Light of Christian Exegesis », art. cit., p. 44, n. 35).
64 A. TZVETKOVA-GLASER raisonne de même pour Rabban Gamliel (Pentateuchauslegung bei Origenes…, op. cit., p. 68).
30 José Costa
ou à une conception moins extrême de la résurrection (essentiellement chez les rabbins) inclinent à défendre la création à partir d’une matière première65. D. Lemler propose une hypothèse audacieuse : la doctrine de la création ex nihilo serait majoritaire chez les rabbins de l’Antiquité. Si les aggadot tendent à évoquer des éléments ou un matériau d’avant la création, c’est qu’elles ne peuvent procéder autrement : la création ex nihilo ne peut être racontée, et pour la rendre intelligible, il faut faire appel à l’expérience empirique où un être provient toujours d’un autre être. Les textes où intervient une matière première de la création seraient donc des preuves indirectes d’une croyance en la création ex nihilo. Ceux qui interdisent de spéculer sur le temps des origines et qui imposent d’importantes contraintes à l’enseignement du récit de la création seraient conscients des inconvénients du mode d’exposition ou de réflexion aggadique : la seule manière de témoigner directement de la création ex nihilo est justement de renoncer au discours sur la création66.
On pourrait donc soutenir que les juifs (du moins ceux du courant rabbinique) et les chrétiens se distinguent nettement sur la question de la création : les chrétiens adhèrent à la création ex nihilo alors que celle-ci serait presque absente chez les juifs67. Même dans l’hypothèse où la création ex nihilo occupe une certaine place dans la littérature rabbinique ancienne, il reste à expliquer pourquoi elle n’apparaît pas plus nettement dans les textes. Plusieurs facteurs justifieraient le flou qui caractérise la cosmologie des rabbins. Leur théologie (en admettant
65 J. A. GOLDSTEIN, « The Origins of the Doctrine of Creation Ex nihilo », art. cit.,
pp. 129-131 et 135. L’hypothèse de J. A. Goldstein mériterait une discussion approfondie qu’il n’est pas possible de mener dans le cadre limité de cette étude. Nous nous contenterons de noter, pour ce qui relève de la littérature rabbinique, qu’il surestime l’étroitesse du lien entre résurrection et création et qu’il sous-estime le nombre de ceux qui adhèrent à la résurrection à l’identique.
66 D. LEMLER, « La distinction entre cosmogonie et cosmologie comme matrice du traitement rabbinique de l’origine du monde » (article inédit, nous remercions l’auteur de nous avoir permis d’accéder à son texte).
67 Cf. le constat de JULIEN L’APOSTAT (Contra Galilaeos, 49D), qui contraste l’enseignement des chrétiens et celui de Moïse sur la création.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 31
que le terme puisse être employé dans ce contexte) est elle-même assez floue et sommaire. Leur outillage linguistique est peut-être insuffisant : l’hébreu ancien, biblique comme rabbinique, ne dispose pas vraiment de termes pour exprimer les idées d’être et de néant ainsi que l’acte de créer à partir du néant (et par conséquent la distinction entre « création à partir de l’être » et « création à partir du néant »). Les rabbins partisans de la création ex nihilo, comme semblent l’être Rabban Gamliel et Rab, en sont réduits à exprimer leur conviction de manière indirecte, en rejetant l’idée que Dieu ait pu disposer de matériaux préexistants le premier jour de la création68. La création a aussi une importance moindre dans la théologie rabbinique, alors qu’elle est centrale dans le discours des Pères : or, un concept secondaire n’a pas besoin d’être parfaitement clarifié. Les Pères avaient enfin un conflit plus fort et plus explicite avec l’hellénisme, ce qui entraîne une volonté affirmée de se différencier de la cosmologie platonicienne (alors que de nombreux juifs semblaient s’en accommoder fort bien).
L’hypothèse d’un flou qui n’est pas volontaire de la part des rabbins s’impose a priori au terme du paragraphe précédent, mais tous les arguments antérieurs ne sont pas sans faille. L’argument linguistique reste notamment d’une valeur toute relative. Quand les rabbins médiévaux ont éprouvé le besoin d’exprimer leur croyance en la création ex nihilo, ils n’ont eu aucun mal à mobiliser les ressources de l’hébreu ancien et ont utilisé les mots yesh pour « être », ayin pour « néant » et bara pour l’acte de créer à partir du néant, ya ar et ‘asa renvoyant désormais à la création à partir d’un matériau préexistant. Les textes déjà cités de Bar Qappara et Rab suggèrent que certains rabbins adhéraient à la création à partir d’une manière première (le tohu
68 Chez les Pères, la formule de la création ex nihilo a existé avant la doctrine
(cf. G. MAY, Schöpfung aus dem Nichts, op. cit, p. 21 : « la formule a précédé la pensée »), les rabbins étaient peut-être dans le cas inverse. On peut aussi arguer qu’une fois son existence acquise, la terminologie comportait des ambiguïtés chez les uns comme chez les autres (il n’est pas sûr, par exemple, que le Sefer ye ira [2, 6 ou 9], qui est le premier ouvrage juif à employer le couple yesh/ayin pour parler de la création, identifie bien ayin avec le néant, puisqu’il le met en parallèle avec le tohu).
32 José Costa
wa-bohu), tout en étant conscients des difficultés inhérentes à cette croyance. De telles difficultés auraient pu les inciter à maintenir un flou volontaire dans l’expression de leur opinion.
Une question difficile est celle de l’origine de la création ex nihilo chez les juifs et les chrétiens, puisqu’elle n’est pas présente explici-tement dans l’Écriture. Une solution « naïve » du problème consisterait à voir dans cette croyance un héritage que le christianisme a reçu du judaïsme, même s’il resterait dans ce cas à expliquer pourquoi le judaïsme a éprouvé à un moment donné le besoin de penser la question de la création en ces termes. Notre propos antérieur rend cependant très problématique cette explication génétique : comment un judaïsme (hellénisé comme rabbinique) si peu disert et explicite sur la création ex nihilo aurait-il pu transmettre un quelconque héritage en la matière ? Certains ont envisagé une explication génétique inverse : la doctrine serait apparue dans un premier temps dans le christianisme et n’aurait gagné le judaïsme que dans un deuxième temps, sous l’influence du christianisme et aussi de l’islam69. Un article récent de M. Niehoff propose un argument de poids en faveur de cette hypothèse : le texte où Rabban Gamliel défend la création ex nihilo serait en fait d’époque amoraïque et reflèterait l’influence du Contre Hermogène de Tertullien70. Sans nier complètement un lien génétique, on peut aussi insister sur le fait que des causes semblables auraient joué dans les deux groupes. Ainsi, selon J. A. Goldstein, ce sont les partisans juifs et chrétiens de la résurrection à l’identique qui en viennent à défendre la création ex nihilo. Le rôle de la philosophie grecque dans l’émergence de cette croyance est quelque peu ambivalent. D’un côté, la création ex nihilo s’oppose aux conceptions cosmologiques de Platon et d’Aristote, de l’autre, elle n’est pas concevable sans un minimum de concepts philosophiques, à commencer par celui du « néant », qui est une notion très abstraite. La création ex nihilo donne l’impression d’être une
69 C’est par exemple la thèse de D. WINSTON, « The Book of Wisdom’s Theory of
Cosmogony », art. cit., pp. 191-192 et 199. 70 M. NIEHOFF, « Creatio ex nihilo Theology in Genesis Rabbah in Light of Christian
Exegesis », art. cit., pp. 37-64.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 33
réaction qui se produit dans le monothéisme quand il dépasse un certain seuil d’exposition à la philosophie grecque. Ce seuil aurait été franchi par le christianisme dès l’Antiquité et par le judaïsme à une date plus tardive, au cours de l’époque médiévale.
Concernant la création de l’homme à l’image et à la ressemblance de Dieu, évoquée dans Gn 1, 26-27, elle est centrale chez les Pères. Comme le note A. Orbe, « elle a eu, aux premiers siècles du christianisme, une importance exceptionnelle71 ». Sur le terme « image », la lecture la plus répandue est celle que l’on trouve chez Origène : l’image de Dieu en l’homme est l’intellect. Gn 1, 26-27 traitent de l’homme spirituel (= l’intellect) et Gn 2, 7 de l’homme sensible (= le corps)72 : c’est la doctrine des deux hommes ou des deux créations, en grande partie héritée de Philon73. Irénée identifie au contraire « l’image » au corps de l’homme74. Tertullien va même jusqu’à dire : « Qui niera que Dieu n’ait un corps, quoique Dieu soit esprit75 ? » La notion d’image est parfois interprétée conformément à la suite de Gn 1, 26, qui mentionne la domination de l’homme sur la création. L’homme serait à l’image de Dieu, dans la mesure où, comme lui, il exerce sa souveraineté sur le monde76. Certains Pères syriaques comprennent cette domination comme un lien unifiant toute la création
71 A. ORBE, Introduction…, op. cit., p. 364. 72 Cf. Peri Archôn, I, 1, 7 ; III, 1, 13 ; IV, 4, 10 ; H. CROUZEL, Théologie de l’image
de Dieu chez Origène, Paris, Éd. Montaigne, 1958 ; G. STROUMSA, « L’incorporéité de Dieu : contexte et implications de la doctrine d’Origène », dans G. STROUMSA, Savoir et salut, Paris, Cerf, 1992, pp. 183-197.
73 PHILON, Legum allegoriae, I, 93 et ss. 74 IRÉNÉE DE LYON, Epideixis tou apostolikou kêrugmatos, 11 (cf. Adversus
haereses, V, 12, 2). 75 TERTULLIEN, Adversus Praxean, 7, 8. Sur le rapport de cette déclaration avec le
stoïcisme et le moyen platonisme, cf. A. ORBE, Introduction…, op. cit., pp. 354-355.
76 Dans le corpus chrétien, cette interprétation remonte au moins à Chrysostome et elle concorde bien avec certaines représentations égyptiennes et mésopotamiennes (S. D. MOORE, « Gigantic God : Yahweh’s Body », dans Journal for the Study of the Old Testament, 70, 1996, p. 93, n. 18).
34 José Costa
dans l’amour et comme une forme de partenariat avec Dieu77. L’exégèse des Pères est également très attentive à distinguer le sens du mot « image » de celui du mot « ressemblance », chacun de ces concepts pouvant à son tour manifester plusieurs facettes78. La tendance dominante est d’identifier l’image de Dieu au Fils (ou Verbe) et sa ressemblance à l’Esprit (ou Sagesse)79. Comme le suggère le texte de la Septante (« Faisons l’homme selon notre image et selon notre ressemblance »), il faut comprendre : « Faisons l’homme conformément à celui qui est notre image (le Fils) et conformément à celui qui est notre ressemblance (l’Esprit)80. » La ressemblance est généralement conçue comme un concept plus dynamique (= le fait de devenir progressi-vement semblable à Dieu) et elle est pour cela souvent identifiée à la force active de l’Esprit81.
Sur presque tous ces points, les traditions rabbiniques forment un net contraste avec celles des Pères, au point qu’on peut se demander si les deux exégèses n’ont pas cherché à se différencier l’une de l’autre. Elles commentent assez peu Gn 1, 26-27 et quand elles le font, elles négligent la plupart du temps les termes « image » et « ressemblance »82. Quand ces derniers sont commentés, ils désignent le corps de l’homme, conformément à la thèse majoritaire chez les rabbins de l’Antiquité
77 Cf. C. PASQUET, « L’homme créé à l’image de Dieu chez les Pères syriaques »,
dans M.-A. VANNIER (éd.), La création chez les Pères, op. cit., pp. 161-174. 78 Cf. les trois images (plastique, naturelle, personnelle) et les trois ressemblances
(l’assimilation [omoiôsis], la similitude [omoiotês] et le fait d’être semblable [omoios]) dans A. ORBE, Introduction…, op. cit., pp. 353-354 et 356.
79 Cf. par exemple THÉOPHILE D’ANTIOCHE, Ad autolycum, II, 18 et IRÉNÉE DE LYON, Adversus haereses, IV, 20, 1.
80 Cf. A. ORBE, Introduction…, op. cit., pp. 361 et 363. 81 Cette assimilation à Dieu peut être conçue sur la longue durée pendant les six jours
de la création, c’est-à-dire les six mille ans de l’histoire : cf. A. ORBE, Introduction…, op. cit., pp. 329 et 339.
82 Le verset de Gn 9, 6 est en revanche plus fréquemment commenté. A. GOSHEN GOTTSTEIN explique cet intérêt plus soutenu des rabbins par le fait que le verset a un contenu pratique, dont Gn 1, 26-27 est dépourvu (« The Body as Image of God in Rabbinic Literature », dans The Harvard Theological Review, 87, 1994, p. 189, n. 57).
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 35
d’un Dieu corporel, point sur lequel ils divergent de figures éminentes de l’époque médiévale comme Maïmonide et de tout le judaïsme ultérieur83. Le lien entre l’image et la domination de l’homme sur la création n’apparaît qu’à l’époque médiévale84. Les rabbins n’établissent enfin aucune différence entre l’image et la ressemblance, considérant les deux termes comme des synonymes. Ils ont d’ailleurs la même attitude à l’égard des verbes utilisés en Gn 1 et 2 pour exprimer l’idée de création : bara, ya ar ou encore ‘asa signifient fondamentalement la même chose85. Peu stimulée par Gn 1, 26-27, leur exégèse se montre beaucoup plus inspirée par Gn 2, 7, qui ferait allusion à deux formations (ye irot), celle du penchant au bien et du penchant au mal, celle du monde présent et du monde futur ou encore celle des deux faces, masculine et féminine, d’un homme originellement androgyne86. La dévalorisation de Gn 2, 7, que l’on trouve chez certains Pères de l’Église (création de l’homme sensible/du corps de l’homme), est-elle l’un des facteurs qui expliquent l’intérêt que les rabbins manifestent pour ce verset ?
83 Cf. J. COSTA « Le corps de Dieu dans le judaïsme rabbinique ancien. Problèmes
d’interprétation », dans Revue de l’histoire des religions, 227, 2010, pp. 283-316. 84 Cf. le commentaire de SA‘ADYA GA’ON sur Gn 1, 26-27 (Perushe Rabbenu
Sa‘adya Ga’on ‘al ha-tora, Jérusalem, éd. Y. Kafih, 1963, pp. 12-13). 85 Genèse 1, 26-27 enchaîne le verbe ‘asa et le verbe bara pour la création de
l’homme. Be-reshit Rabba, 14, 3, dans son commentaire de Gn 2, 7 (qui emploie le verbe ya ar) évoque les quatre créations (beriyyot) à partir de l’en-haut et les quatre créations (beriyyot) à partir de l’en-bas. Midrash Tehillim sur Ps 8, 2 commente Gn 1, 25 (qui emploie le verbe ‘asa) de la manière suivante : « car il les a créés (she-bera’an) ». Il en est de même pour les termes rua , neshama et nefesh, à quelques exceptions près que nous abordons dans L’au-delà et la résurrection dans la littérature rabbinique ancienne, Paris-Louvain, 2004, pp. 551-568. Cette indifférence est curieuse quand on songe au caractère minutieux de l’herméneutique rabbinique et elle est peut-être calculée.
86 Be-reshit Rabba, 14, 4-5 et Talmud Babli, Berakhot, 61a.
36 José Costa
Le motif de la création dans un judaïsme pluriel et les Pères
On a souvent objecté à ceux qui cherchent à mettre en évidence une circulation des idées et des textes entre les Pères et les rabbins le fait que leurs deux corpus ne sont pas rédigés dans la même langue (hébreu et araméen pour les rabbins, latin et grec pour les Pères), ce qui n’est que partiellement exact, puisque les Pères de Syrie sont également araméophones. Dans le cas du grec, l’obstacle est cependant très relatif, car nous savons aujourd’hui que les rabbins étaient beaucoup plus hellénisés qu’on ne l’a longtemps pensé87. Nous appellerons donc hellénistes les juifs dont le grec est la langue dominante, avant et après la destruction du Second Temple, afin de les distinguer des rabbins qui sont simplement hellénisés. De manière plus générale, la population juive de Palestine était souvent bilingue (araméen, grec). Même si les rabbins commentent la Bible en hébreu et la plupart des Pères en grec et en latin, leur exégèse part fréquemment des mêmes difficultés textuelles. Dans son Dialogue avec Tryphon, écrit en grec, Justin évoque plusieurs explications juives de l’emploi du pluriel dans Gn 1, 26 : « Faisons l’homme à notre image… » : Dieu s’adresserait à lui-même ou aux éléments ou aux anges. Or, on retrouve ces explications dans Be-reshit Rabba, un Midrash sur la Genèse, composé au Ve siècle, en hébreu et en araméen88.
87 Cf. les travaux pionniers de S. LIEBERMAN, Greek in Jewish Palestine, New York,
the Jewish Theological Seminary, 1942 et Hellenism in Jewish Palestine, New York, the Jewish Theological Seminary, 1950 et la synthèse récente de L. LEVINE, Judaism and Hellenism in Antiquity. Conflict or Confluence, Seattle, University of Washington Press, 1998.
88 JUSTIN DE NAPLOUSE, Pros Truphona Ioudaion dialogos, 62, 1-2 et Be-reshit Rabba, 8, 3-5.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 37
Pros Truphona Ioudaion dialogos (Justin)89
Be-reshit Rabba90
1. Pour que vous n’alliez point, détournant les paroles que je viens de citer, dire ces choses que disent vos didascales – ou bien que Dieu s’est à lui-même dit (pros heauton elegen) : « Faisons » (Gn 1, 26), comme nous, lorsque nous sommes sur le point de faire quelque chose, nous nous disons souvent : « Faisons »
1. Auprès de qui a-t-il pris conseil ?
2. ou bien c’est aux éléments (pros ta stoicheia), c’est-à-dire à la terre ainsi qu’aux autres choses dont nous savons que l’homme a été fait, que Dieu a dit : « Faisons. »
2. Rabbi Yehoshua‘ ben Lévi (220-250) a dit : C’est auprès de l’œuvre des cieux et de la terre qu’il a pris conseil/Rabbi Shemu’el bar Na man (290-320) a dit : C’est auprès de l’œuvre de chaque jour qu’il a pris conseil (= Justin 2). (…)
3. Je vous rapporterai encore les paroles prononcées par Moïse lui-même, grâce auxquelles nous pouvons reconnaître que sans nul doute celui auquel il s’adresse est autre numériquement, et de nature verbale. Voici ces paroles : « Et Dieu dit : Voici Adam est devenu comme l’un de nous pour connaître le bien et le mal » (Gn 3, 22). Ainsi donc, en disant « comme l’un de nous », il in-dique un nombre d’êtres qui sont réunis les uns avec les autres, et au moins deux.
3. Rabbi Ammi (290-320) a dit : C’est auprès de son cœur qu’il a pris conseil (= Justin 1). (…)
4. Car je ne saurais prétendre vraie la doctrine qu’enseigne ce que vous appelez « secte » (par humin legomenê hairesis), ou que ses didascales puissent démontrer qu’il s’adressait à des anges,
4. Rabbi anina (220-250) n’a pas parlé ainsi91, mais : Au moment où il est venu pour créer le premier homme, il a pris conseil auprès des anges du service (le dire de Rabbi anina est suivi de trois autres traditions qui développent une idée similaire) (= Justin 4).
89 JUSTIN MARTYR, Dialogue avec Tryphon, éd. P. Bobichon, Fribourg, Academic
Press, 2003, pp. 350-351. 90 Be-reshit Rabba, 8, 3-5, éd. Theodor-Albeck, T. I, pp. 58-61. 91 Il est en désaccord avec l’interprétation de Ps 1, 6 que Rabbi Berekhya a donnée
juste avant.
38 José Costa
5. ou encore que le corps humain est l’œuvre d’anges.
5. Rabbi Yehoshua‘ de Sikhnin au nom de Rabbi Lévi (290-320) : C’est auprès des âmes des justes qu’il a pris conseil…
Justin affirme que l’interprétation qui associe Gn 1, 26 aux anges est enseignée par « ce que vous (humin) appelez secte (lit. : ce qui est appelé par vous secte) », c’est-à-dire par un groupe que les juifs considèrent comme une « hérésie », le terme hairesis ayant déjà acquis son sens péjoratif dans le Dialogue avec Tryphon92. Une variante évoque cependant « ce que nous (hêmin) appelons secte » (lit. : ce qui est appelé par nous secte), le groupe devenant alors une hérésie chrétienne. L’ambiguïté de ce texte est emblématique d’une période où se construisent les frontières identitaires entre juifs et chrétiens et où ce qui est « nôtre » et « vôtre » n’est pas encore très clair. Les commen-tateurs modernes qui se sont intéressés au passage ont tenté d’identifier la secte à un groupe gnostique (juif ou chrétien) ou à des juifs qui, comme Philon, attribuent à des auxiliaires (les anges) la création de la part mauvaise de l’homme93. Il semble qu’un texte rabbinique, où s’exprime le tanna Rabbi ‘Aqiba, considère bien cette opinion sur le rôle des anges comme blâmable, ce qui recoupe l’affirmation de Justin sur l’hérésie94.
À l’évidence, la situation n’est plus identique dans Be-reshit Rabba, où la participation des anges à la création, même si elle est essentiellement limitée à une consultation, apparaît comme une
92 Justin témoignerait du fait que le judaïsme est également entré dans une nouvelle
ère idéologique, différente de celle du Second Temple et articulée autour du couple orthodoxie et hérésie : cf. D. BOYARIN, La partition du judaïsme et du christianisme, op. cit., p. 81.
93 Cf. PHILON, De opificio mundi, 75 ; De fuga et inventione, 69-70 ; De confusione linguarum, 181. Pour d’autres textes juifs non rabbiniques soulignant le rôle des anges dans la création, cf. II Hénoch, 30, 2 et les Homélies pseudo-clémentines, XVI, 6. E. URBACH penche pour l’hypothèse gnostique (Les Sages d’Israël, op. cit., p. 216). Pour un aperçu des différentes opinions, cf. JUSTIN MARTYR, op. cit., t. II, pp. 950-951.
94 Cf. Mekhilta de-rabbi Yishma‘el, Wa-yehi, 6 et D. BOYARIN, La partition du judaïsme et du christianisme, op. cit., pp. 82-83.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 39
croyance parfaitement légitime, défendue par plusieurs amora’im palestiniens, au point d’être l’interprétation de Gn 1, 26 la plus développée du recueil. Il est possible qu’entre le IIe siècle et l’époque de Be-reshit Rabba (IIIe et IVe siècles pour les rabbins cités, Ve siècle pour la rédaction finale), la situation ait évolué et que de la priorité du combat contre les gnostiques les rabbins soient passés à une nouvelle priorité : celle du combat contre les chrétiens et leur lecture trinitaire de Gn 1, 26. Dans ce cadre, l’ancienne conception hérétique de la partici-pation des anges, défendue originellement par les gnostiques, serait devenue une arme idéale dans les mains des rabbins pour contrer la lecture dominante des chrétiens. Il est probable que cette évolution des rabbins a été notée par les Pères eux-mêmes : Irénée présente la participation des anges à la création comme un motif gnostique, alors que Tertullien et Basile voient dans le même motif une doctrine défendue par les juifs95. Certains Pères auraient eu une démarche similaire aux rabbins, du moins si l’on suit l’interprétation suivante d’E. Urbach :
Les Pères de l’Église Théophile d’Antioche et Irénée écartèrent l’idée gnostique de l’association des anges à la formation de l’homme et se rangèrent à l’interprétation juive (nous soulignons) d’un dialogue de Dieu avec Lui-même, en son cœur, ou, selon leur terminologie, avec sa Sophia, son Logos96…
Les rabbins auraient donc repris contre les chrétiens une idée gnostique (participation des anges à la création) en la « rabbinisant » (sous la forme atténuée de la consultation des anges). Les chrétiens auraient repris contre les gnostiques une idée juive (le dialogue de Dieu avec lui-même) en la christianisant (dialogue de Dieu avec la sophia et le logos)97. 95 IRÉNÉE DE LYON, Adversus haereses, I, 24, 1 (cf. IV, 20, 1) ; TERTULLIEN,
Adversus praxean, 12, 1-2; BASILE, Homiliae IX in Hexaemeron, 6. La mention de Tertullien laisse penser que le basculement se serait produit au début du IIIe siècle.
96 E. URBACH, Les Sages d’Israël, op. cit., pp. 216-217. 97 Pour une autre interprétation que celle d’E. Urbach, cf. M. KISTER, « “Let Us
Make a Man”. Observations on the Dynamics of Monotheism » (en hébreu), dans
40 José Costa
Le texte de Justin et tous les matériaux que nous avons mobilisés dans son commentaire illustrent bien la porosité des frontières entre judaïsme rabbinique, judaïsme helléniste et christianisme des Pères. Les éléments que les rabbins ont en commun avec Philon (cités dans notre première partie) vont également dans le même sens. Si le point de vue de D. Winston sur la création ex nihilo est exact, les deux judaïsmes, rabbinique et helléniste, ne se distinguaient guère par leur cosmologie, adhérant l’un et l’autre à la création à partir d’une matière première. Seuls les chrétiens auraient rompu le consensus à partir du milieu du IIe siècle.
Les autres hypothèses envisagées sur la création ex nihilo vont cependant dans le sens contraire, celle d’une différence entre judaïsme helléniste et judaïsme rabbinique. Pour J. A. Goldstein, la conception de la création qu’a un juif (ou un chrétien) dépend directement de ses croyances eschatologiques : un juif partisan de l’immortalité de l’âme soutient la création à partir d’une matière première, un juif partisan de la résurrection à l’identique la création ex nihilo, les juifs croyant en une résurrection/transformation étant moins prévisibles. Un point est clair : les partisans de la résurrection étaient plus nombreux chez les rabbins que chez les juifs de l’époque du Second Temple, notamment ceux de langue et de culture grecque. Les textes juifs les plus explicites sur la création à partir d’une matière première se trouvent dans la littérature judéo-hellénistique, ceux des rabbins étant toujours moins affirmatifs98.
Le philosophe qui débat avec Rabban Gamliel serait selon D. Winston un gnostique et selon M. Niehoff un équivalent du chrétien platonisant Hermogène avec qui débat Tertullien. Pour M. Niehoff, ce philosophe n’est pas un juif, puisqu’il dit à Rabban Gamliel : « votre
Issues in Talmudic Research. Conference Commemorating the Fifth Anniversary of the Passing of Ephraim E. Urbach, 2 December 1996, Jérusalem, Israel Acad. of Sciences and Humanities, 2001, pp. 42-46 : l’idée que Dieu a pris conseil auprès de ses anges serait une atténuation de l’interprétation de Justin, selon laquelle Dieu s’adresse au logos. Cette dernière opinion serait plus directement présente dans l’interprétation de Rabbi Ammi où Dieu prend conseil auprès de son cœur.
98 Pour un exemple d’affirmation explicite, cf. Sg, 11, 17.
Le récit de la création dans l’exégèse des rabbins et des Pères de l’Église 41
Dieu »99. Ce dernier argument est peu convaincant, les rabbins n’hésitant pas parfois à présenter les juifs déviants, non rabbiniques, comme des non-juifs100. L’hypothèse que le philosophe soit un juif helléniste n’est donc pas à écarter d’emblée101. Dans ce cas, le texte confronte un juif helléniste partisan de la création à partir d’une matière première (le philosophe) à un juif rabbinique partisan de la création ex nihilo.
Dans un ouvrage récent, S. C. Mimouni distingue trois judaïsmes dans la période de la fin de l’Antiquité en terre d’Israël : le judaïsme rabbinique, le judaïsme chrétien et le judaïsme synagogal102. Cette distinction est-elle valable pour le thème de la création ? Le judaïsme rabbinique accorde à la création une place importante, mais qui n’est pas centrale dans son dispositif théologique. La création ne fait pas partie des principes de foi que défend la Mishna103. Ce n’est qu’à l’époque médiévale que la création, explicitement conçue comme ex nihilo, apparaît comme un pilier de la foi juive. Le caractère plutôt secondaire de la création chez les rabbins de l’Antiquité explique peut-être en partie pourquoi ils n’ont pas éprouvé le besoin de formuler de manière nette et univoque le principe de la création ex nihilo.
Dans le judaïsme chrétien, la création est un motif beaucoup plus central. Le Nouveau Testament en témoigne avec le Prologue du Verbe de l’Évangile de Jean. La tonalité fortement messianique du mouve-ment chrétien valorise aussi la notion de création nouvelle au niveau 99 D. WINSTON, « The Book of Wisdom’s Theory of Cosmogony », art. cit., pp. 189-
190 et M. NIEHOFF, « Creatio ex nihilo Theology in Genesis Rabbah in Light of Christian Exegesis », art. cit., pp. 46 et 51-54.
100 C’est le cas par exemple des minim : cf. S. STERN, Jewish Identity in Early Rabbinic Writings, Leiden/New York/Köln, E. J. Brill, 1994, p. 112.
101 C’est l’opinion de J. A. GOLDSTEIN (« The Origins of the Doctrine of Creation Ex nihilo », art. cit., p. 131), d’E. URBACH (Les Sages d’Israël, op. cit., p. 197). G. SCHOLEM parle d’un philosophe païen (« La création à partir du néant et l’autocontraction de Dieu », op. cit., p. 37).
102 S. C. MIMOUNI, Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère : des prêtres aux rabbins, Paris, Presses universitaires de France, 2012, pp. 536-563.
103 Mishna, Sanhedrin, 10, 1.
42 José Costa
individuel et au niveau cosmique104. Comme son nom l’indique, le judaïsme synagogal se déploie dans le cadre des synagogues, qui ne sont pas, à l’époque, contrôlées par les rabbins. Il comporte une composante de langue grecque (qui recoupe en grande partie ce que nous avons appelé judaïsme helléniste) et une composante de langue araméenne (qui s’exprimerait notamment dans les versions originelles des Targumim). Dans la continuité de Philon, ce judaïsme aurait accordé une importance majeure aux notions d’émanation et d’hypostase ainsi qu’aux représentations bithéistes105. Il est le parte-naire idéal des Pères, pas uniquement à travers les textes de Philon, mais aussi par des rencontres directes avec des « représentants » de ce judaïsme et des échanges de vue en langue grecque. C’est une théologie juive de l’émanation et de l’hypostase qui aurait influencé le néo-platonisme et nourri directement ou indirectement les spéculations chrétiennes bithéistes et trithéistes, au fondement du dogme de La Trinité106.
104 Cf. Jn 3, 5 ; 2 Co 5, 17 ; Ap 21, 1. 105 Sur la continuité avec Philon, cf. E. GOODENOUGH, Jewish Symbols in the Greco-
Roman Period, 13 vol., Princeton, University of Princeton, 1953-1968. Sur le bithéisme et ses liens avec le judaïsme synagogal, cf. D. BOYARIN, La partition entre le judaïsme et le christianisme, op. cit., pp. 171-272. Sur l’émanation chez Philon et dans le judaïsme synagogal, cf. J. COSTA, « Émanation et création : le motif du manteau de lumière revisité », art. cit. : les traditions rabbiniques sur le manteau de lumière sont vraisemblablement de provenance synagogale. Le terme hupostasis est employé par Philon d’Alexandrie, ainsi que par la Septante, Flavius Josèphe et le Nouveau Testament (cf. H. KÖSTER, « Hupostasis », dans Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 8, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1969, pp. 571-588), mais par hypostase nous entendons surtout la notion philonienne de logos.
106 Cf. J. COSTA, « Hypostase, émanation et bithéisme dans le judaïsme antique : des catégories entre théologie et mystique », art. cit.