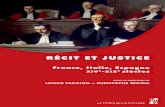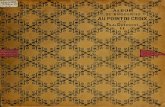Culte de la croix en Asie mineure
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Culte de la croix en Asie mineure
- 12 -
QUELQUES REMARQUES SUR LE CULTE DE LA CROIXEN ASIE MINEURE AU Xe SIÈCLE
Sous Constantin le christianisme triompha et devint, avec l’héritage de la ro-manité, le second fondement du nouvel Empire. La croix par laquelle le premier empereur, avant même sa conversion, l’avait emporté sur son rival, Maxence, de-vint l’emblème de l’armée chrétienne, le fameux labarum, et les formules quasi identiques ejn touvtw/ nika' et ∆Ihsou'" Cristo;" nika' se répandirent, notamment sur les inscriptions de cette époque, soulignant avec force l’essor de la religion devenue impériale�.
Il semblerait donc qu’il n’y ait pas d’enseignement à tirer de l’emploi de cette formule nicéphore, ∆Ihsou'" Cristo;" nika', tant elle serait banale. Cependant, une analyse plus fine montre que son usage n’est pas si fréquent après le viie siècle, à l’époque médio-byzantine. Nous laissons de côté les exemples de l’époque des Paléologues ou postérieurs à la chute de l’Empire, ainsi que ceux trouvés dans des régions qui appartinrent à l’espace byzantin, mais devinrent indépendantes, telle la Serbie�. Il est bien connu que la formule nicéphore qui est, en principe, inscrite dans les cantons d’une croix latine, est liée au culte de la Croix. Or on constate que ce type de croix, ainsi cantonnée, apparaît sur des documents à caractère officiel tels que les monnaies, les sceaux impériaux ou ceux de fonctionnaires, parfois sur des inscriptions rédigées au nom du souverain. D’autres inscriptions, commandées par des personnages privés, apparaissent, la plupart du temps, dans des églises.
Ce constat invite à poser deux questions : dans quelle mesure le choix de ces croix cantonnées reflète-t-il les intentions de ceux qui les ont adoptées, notamment les empereurs, et peut-on déterminer si un groupe social précis y fut particulière-ment attaché ?
La première monnaie à porter une croix comportant la formule nicéphore fut le miliarèsion, pièce d’argent créée par Léon III l’Isaurien qui fut l’initiateur de l’iconoclasme�.
�. Sur la signification de ces formules, voir. A. Frolow, 6I5S|6X5S|NI|KA, ByzSl. XVII, �956, p. 98-���.
�. G. Babiç, Les croix à cryptogrammes, peintes dans les églises serbes des xiiie et xive siècles, dans Byzance et les Slaves, Mélanges Dujcev, Paris �979.
�. Voir par exemple, C. Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Natio-nale. I, D’Anastase I à Justinien II (491-711) ; II, De Philippicus à Alexis III (711-1204), Paris �970, p. 450-45�. Le rôle de Léon III n’a été que récemment reconnu, car les premiers miliarèsia avaient été attribués auparavant à Constantin V.
JEAN-CLAUDE CHEYNET�76
Miliarèsion de Léon III (��0 %)
Il est également remarquable que Léon III ait été confronté au dernier assaut des musulmans contre Constantinople, dangereux au point de menacer la survie de l’Empire, et qu’il ait su repousser l’ennemi. D’ailleurs, la formule apparaît pour la première fois sur les remparts de Constantinople en 740-74�4. Il s’agit bien d’affirmer la victoire des armées chrétiennes face à un Islam qui subit un coup d’arrêt décisif en 7�8, confirmé par la victoire d’Akroïnon, dans le thème des Anatoliques, en 7405. Léon III, fondateur de la dynastie isaurienne, était origi-naire de Germanicée (Marash), ville située à la frontière orientale, et il fut stratège des Anatoliques avant de prendre le pouvoir avec le concours de l’armée de ce thème. Les mêmes soldats accueillirent avec ferveur son fils Constantin V à Amo-rion, forteresse du thème des Anatoliques. Léon V occupa lui aussi la charge de stratège des Anatoliques et son successeur, Michel II, fondateur de la dynastie amorienne, était originaire de ce même thème6.
Sous les empereurs macédoniens, « aimés du Christ »7, le péril arabo-musulman avait sensiblement reculé, cependant Léon VI et son frère Alexandre gravèrent sur une partie de leurs sceaux l’invocation au Christ victorieux.
Sceau de Léon VI et Alexandre
[Zacos - Veglery, no 60 ; Zacos (BnF) 50��] (��0 %)
4. Frolow, op. cit., p. �6. Tout du moins s’agit-il de la première qui nous ait été conservée.5. Cécile Morrisson avance l’hypothèse que la création du miliarèsion pourrait être une réplique à
la création du dirhem, quelques décennies auparavant, par le calife Abd el-Malik (B.N.C., p 450).6. Le rétablissement des Images en 84� n’eut aucune conséquence dynastique et n’entraîna pas
de modification des types monétaires. La monnaie en effet ne constitua pas un enjeu de la querelle des Images, voir A. Grabar, L’iconoclasme byzantin. Le dossier archéologique, Paris �957, p. ��7.
7. Ce qualificatif de philochristos despotès se rencontre presque exclusivement sur des sceaux contemporains de la dynastie macédonienne.
QUELQUES REMARQUES SUR LE CULTE DE LA CROIX �77
Or les sceaux, nous le savons, sont moins soumis que les monnaies à la néces-sité de conserver la tradition ; il s’agit donc là d’un choix délibéré de ces empereurs8. Léon VI, qui ne mena jamais la moindre armée au combat, se préoccupait néanmoins de la défense des frontières orientales de l’Empire, notamment sous l’influence d’un général, Nicéphore Phocas – dit l’Ancien, pour le distinguer de son petit-fils homonyme, l’empereur Nicéphore II – un Cappadocien9 que l’em-pereur appréciait au point de l’appeler, dans les taktika qu’il nous a laissés, « son général ». La pensée de l’empereur, en effet, se perçoit bien à travers les écrits militaires où il s’efforce de comprendre les raisons du dynamisme des musulmans qui, au nom du djihad, continuaient à mener des razzias quasi annuelles dans l’Empire. Or, selon lui, les Arabes bénéficiaient, grâce à cette arme du djihad, d’un avantage psychologique et militaire sur « le peuple chrétien », c’est-à-dire les Byzantins, car ils pouvaient mobiliser dans tous les pays musulmans de nombreux soldats attirés par la perspective du butin, mais aussi par l’assurance que s’ils tombaient face à l’infidèle, ils iraient au paradis. Léon VI, pour donner du cou-rage aux soldats qui combattaient au nom du peuple chrétien, aurait souhaité que les morts à la guerre aient bénéficié d’une liturgie qui ne fût plus celle des morts ordinaires�0.
Ce n’est pas son entourage constantinopolitain qui a pu inspirer à Léon VI de telles pensées. On sait bien en effet que l’Église byzantine, si elle reconnaissait la notion d’une guerre juste, condamnait toute effusion de sang et le soldat qui tuait son ennemi devait une pénitence en raison de cet acte. On est donc conduit à supposer que cette notion de djihad chrétien lui vint de la fréquentation des militaires auprès desquels il prenait ses informations pour écrire ses taktika. Au premier rang de ceux-ci figuraient, nous l’avons dit, Nicéphore Phocas l’Ancien, représentatif du milieu dont il était issu, l’aristocratie cappadocienne qui, depuis deux siècles, se chargeait de contrer les raids musulmans��.
Constantin VII, qui s’était débarrassé d’un co-empereur, Romain Lécapène, grâce à l’appui, entre autres, des Phocas, resta dans le fil de la pensée de son père, Léon VI. La relique de la Croix conservée dans la staurothèque de Limbourg est dite par la dédicace, source de victoire « nikopoiov" », qui abat l’orgueil des Barbares��.
8. Cette invocation fut auparavant gravée sur le sceau de l’empereur Michel II qui eut fort à faire avec la révolte de Thomas dit le Slave et eut grand besoin de la protection divine pour ses armées (Seibt, Bleisiegel I, no �7).
9. Nous ne considérons pas la Cappadoce dans son sens restreint de thème, mais comme la région qui comprend tout le centre de l’Asie Mineure.
�0. La tentative par Léon VI de promouvoir une guerre sainte chrétienne a été analysée en dernier lieu par G. Dagron, Byzance et le modèle islamique au xe siècle. À propos des Constitutions tactiques de l’empereur Léon VI, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris �98�, p. ��9-�4�.
��. Le premier Phocas à jouer un rôle notable fut un compagnon de Basile Ier qui assura sa fortune (cf infra, p. 000). La lignée est donc récente, mais d’autres familles d’Anatolie sont connues depuis le viiie siècle, tels les Mélissènoi.
��. Sur Constantin VII, le nouveau Constantin, voir A. Schminck, « In hoc signo vinces » – Aspects du « césaropapisme » à l’époque de Constantin VII Porphyrogénète, dans Constantin VII et son temps, Athènes �989, p. �0�-��6. Sur la staurothèque, voir infra n. ��.
JEAN-CLAUDE CHEYNET�78
Dans le même esprit, l’empereur s’adressant à l’armée d’Orient, alors que Bardas Phocas en était le chef, exhortait les soldats qui partaient combattre l’émir d’Alep, le fameux Sayf ad-Dawla, à risquer leur vie au nom des Chrétiens et du Christ et leur assurait que la Croix les protégerait au combat��. Depuis toujours, au moment du choc, les troupes s’élançaient au cri de « la Croix est victorieuse ». Une inscrip-tion officielle, commémorant le renforcement des murailles d’Antalya, datée de 9�5-9�6, est particulièrement intéressante car elle souligne ce même souci de défense du christianisme : ce nouveau mur sauvera la ville pour la gloire du Christ, l’éclat des Romains et l’abaissement des Arabes impies�4. Or les marins d’Antalya étaient réputés pour leurs opérations menées contre les navires musulmans. Ils partageaient leur butin avec l’empereur qui levait une taxe sur le produit de la vente des prisonniers, sur les marchandises et sur les navires�5.
Lorsque le petit-fils de Nicéphore l’Ancien parvint au pouvoir, il accentua la tendance à glorifier les soldats tués au combat, au point de vouloir les honorer à l’égal des martyrs. La peinture cappadocienne pourrait refléter cet état d’esprit par la représentation fréquente des Quarante martyrs de Sébaste et des Cinq martyrs de Perse. Les premiers symboliseraient des soldats ayant accédé au statut de martyr, lequel ne serait donc pas incompatible avec l’état de soldat. Quant aux seconds, ils évoqueraient la résistance aux ennemis orientaux, car les Byzantins considérèrent les Arabes, puis ultérieurement les Turcs, comme les successeurs des Perses, au point que les auteurs archaïsants parlent parfois de Perses au lieu d’Arabes ou de Turcs. Nicéphore échoua finalement, face à l’opposition de l’aristocratie civile et de l’Église.
Le successeur de Nicéphore Phocas, son neveu Jean Tzimiskès, mettant à profit la supériorité militaire des Byzantins au Proche-Orient, conduisit l’armée impériale jusqu’en Palestine et approcha même de Jérusalem, sans toutefois pren-dre le risque de l’attaquer car il était parvenu trop loin de ses bases de ravitaille-ment. Le compte rendu de campagne que l’empereur adressa à cette occasion, en particulier au prince arménien Achot III qui lui avait fourni des contingents, glorifie la marche des chrétiens vers la ville sainte avec une ferveur qui annonce à certains égards l’exaltation des premiers croisés à la vue de cette ville tant convoitée, moment très particulier de l’histoire byzantine puisque l’idée même de croisade est tout à fait étrangère à l’Empire. À la mort de Jean Tzimiskès, les empereurs Basile II et Constantin VIII, trop jeunes pour régner, furent placés sous la tutelle de leur oncle le parakoimomène Basile. Mais l’influence de l’aristocratie micrasia-tique, notamment des Phocas, resta forte durant les premières années du règne des jeunes empereurs jusqu’à ce que les révoltes de Bardas Sklèros en 989 et surtout de Bardas Phocas aient mis fin à la prépondérance des Orientaux à la cour impériale. Les empereurs Macédoniens et leurs associés furent tous liés à l’aristocratie micra-
��. H. Ahrweiler, Un discours inédit de Constantin VII Porphyrogénète, TM �, �967, p. �98.�4. H. Grégoire, Recueil des Inscriptions grecques chrétiennes d’Asie Mineure, fasc. �, Paris �9��,
no �0�. Une seconde inscription d’Antalya (no �06), d’ordre privé, comporte l’invocation à la victoire du Christ, datée du xie siècle, indice sans doute que les habitants de la ville restaient sensibles à la signi-fication de ce texte.
�5. Voir un texte de Ibn Hauqal, cité dans Vasiliev - Canard, Byzance et les Arabes), �e partie, p. 4�4.
QUELQUES REMARQUES SUR LE CULTE DE LA CROIX �79
siatique, soit personnellement, tels Nicéphore Phocas et Jean Tzimiskès, soit par l’intermédiaire de leurs conseillers, ainsi Léon VI, Constantin VII et Basile II dans ses premières années.
Le miliarèsion, comme toute monnaie, constituait un instrument de propa-gande. Plus encore que la monnaie d’or qui circulait largement hors des frontières de l’Empire, il était destiné aux populations locales et visait à leur faire partager le militantisme impérial. Le miliarèsion, apparu au temps de Léon III, cessa de porter l’invocation à la victoire du Christ, précisément lorsque l’influence de l’aristocratie micrasiatique ne s’exerça plus avec la même intensité, la dernière émission étant datée de 977�6. Il nous faut également rechercher les indices supplémentaires qui manifesteraient l’attachement de l’aristocratie micrasiatique à la formule nicéphore et au culte de la Croix qui lui est nécessairement associé.
De nombreux historiens de l’art ont depuis longtemps analysé l’importance de ce culte aux yeux de l’aristocratie cappadocienne, en se fondant sur l’étude de l’iconographie des monuments religieux cappadociens�7. L’état de conservation des fresques et des inscriptions qui les accompagnent est souvent fort dégradé et nous a donc privé d’une bonne partie de la documentation. Toutefois ces églises ont été depuis longtemps répertoriées et un ouvrage récemment paru, qui prend en compte les études antérieures, en recense environ cent cinquante�8. Cinq égli-ses sont décorées de la croix cantonnée par l’inscription nicéphore. Quatre d’entre elles sont situées près de Çavuhin et Göreme, au cœur même de la zone d’in-fluence des Phocas�9 : l’église no 4 de Zelve, celle d’Haçli Kilise et celle d’Akkoy�0, avec la croix dans l’abside et une autre église, située également à Zelve, avec la croix hors de l’abside��. La cinquième, à croix absidiale, se trouve dans le Hasan Dagi, toujours en Cappadoce, mais près d’Aksaray��. Ces cinq monuments date-raient tous de la seconde moitié du ixe siècle ou du début du xe siècle, et seraient donc contemporains des premiers empereurs de la dynastie macédonienne��.
�6. Grierson, DOC III, p. 6�7.�7. L’exposé le plus complet est celui de N. Thierry, Le culte de la croix dans l’empire byzantin
du viie siècle au xe siècle dans ses rapports avec la guerre contre l’infidèle. Nouveaux témoignages archéologiques, Rivista di Studi Bizantini e Slavi I, �98�, p. �05-��8.
�8. Jolivet-Levy, Églises de Cappadoce.�9. À Çavuhin, l’église dite du Grand Pigeonnier contient les portraits de Nicéphore Phocas, en
compagnie de son épouse, Théophanô, de son père Bardas et de son frère Léon, ainsi que les effigies de son neveu et successeur, Jean Tzimiskès, et de Mélias, chef de l’armée ; sur ce monument, voir N. Thierry, Une image du triomphe impérial dans une église de Cappadoce, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, �985, p. �8-�5. Les commanditaires de la « Nouvelle Église de Tokali » à Göreme appartenaient très probablement à la famille Phocas, voir N. Thierry, La pein-ture de Cappadoce au xe siècle. Recherches sur les commanditaires de la Nouvelle Église de Tokali et d’autres monuments, dans Constantin VII Porphyrogénète et son temps, Athènes �989, p. ��7-�46.
�0. Jolivet-Levy, Églises de Cappadoce, p. 7 et 5�, �48. La dernière est située dans le Hasan Dag, au sud-est d’Aksaray (p. ��7).
��. G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce. Une nouvelle province de l’art byzantin, Paris �9�5-�94�, I, p. 574.
��. Jolivet-Levy, op. cit., p. ��7.��. La datation de certains d’entre eux est encore sujet à controverse. En effet, postérieurement
à l’iconoclasme, de grandes croix étendant leurs bras sur les voûtes et les plafonds ornaient encore certaines églises, voir A. Wharton-Epstein, The “iconoclast” Churches of Cappadocia, dans Icono-clasm. IX symposium of Byzantine Studies, éd. A. Bryer et J. Herrin, Birmingham �977, p. �0�-���.
JEAN-CLAUDE CHEYNET�80
Ce nombre de cinq occurrences dans une zone restreinte ne peut acquérir de signi-fication que par rapport à ce que nous savons des autres provinces, c’est-à-dire, en règle générale, peu de chose. L’absence de corpus des inscriptions de l’époque méso-byzantine interdit toute comparaison statistique entre les différentes provin-ces de l’Empire. Toutefois, si l’on fait une enquête dans une province européenne bien documentée comme le Péloponnèse, on ne relève aucun exemple de la citation cherchée�4 ; dès lors on est fondé, me semble-t-il, à estimer que la présence de cinq inscriptions en Cappadoce révèle une préférence. Puisque ces inscriptions se trou-vent dans une région que nous savons acquise aux Phocas, c’est qu’ils ne furent pas étrangers à sa diffusion.
Nous nous tournons en dernier lieu vers la sigillographie qui a été, à l’excep-tion des sceaux impériaux, fort négligée par l’immense littérature sur l’iconoclasme et ses suites. En effet, à l’époque iconoclaste prédomina, au droit des sceaux, un motif appelé monogramme cruciforme. Ce nom même indique clairement que cette représentation évoquait par sa forme une croix. Il n’est donc pas surprenant que les iconoclastes, si attachés à son culte, aient utilisé ce motif à l’exclusion de tout autre. La victoire des Images provoqua le retour des saints et surtout de la Vierge au droit des sceaux, mais ils restèrent minoritaires. En effet, à partir du milieu du ixe siècle jusqu’au milieu du siècle suivant, la croix patriarcale devint le motif prédominant, acceptable à la fois aux iconodoules et à ceux qui seraient éventuellement restés partisans de l’iconoclasme. Nul n’ignore que cette même époque marque la prépondérance de l’aristocratie micrasiatique, notamment au sein de l’armée, et qu’elle a pu influencer cette prédilection pour la croix patriar-cale, en raison de son attachement au culte de la Croix, que nous avons déjà noté. À la même date, nous rencontrons aussi un petit nombre de sceaux qui ont conser-vé le monogramme cruciforme si caractéristique de l’époque précédente. Il s’agit nécessairement d’un choix délibéré de la part des propriétaires de ces plombs, qu’il nous faut donc identifier dans la mesure du possible, tâche difficile parce que les patronymes sont encore rarement mentionnés au xe siècle. Pour mener cette re-cherche, il faut que le prénom ne soit pas trop banal pour diminuer les risques d’homonymie, que la fonction exercée et la dignité qui l’accompagne soient très élevées et ainsi conférées à un très petit nombre de personnages et enfin que ces derniers aient été mentionnés dans d’autres sources contemporaines pour les situer socialement et géographiquement.
Sur les quelques dizaines de plombs au type du monogramme tardif, nous n’avons trouvé que les sceaux suivants qui répondent à ces critères :- Bardas, patrice et stratège des Anatoliques�5,- Léon, magistre et domestique des Scholes d’Occident�6,
�4. D. Feissel, A. Philippidis-Braat, Inventaire en vue d’un recueil des inscriptions histori-ques de Byzance. III. Inscriptions du Péloponnèse (à l’exception de Mistra), TM 9, �985, p. �67-�95. Il y a quelques exemples parmi les graffiti d’époque byzantine et post-byzantine gravés sur le Parthé-non, mais leur datation ne peut être précisée.
�5 . Zacos II, no �06�. Cf. l’Appendice sur les Phocas, p. 000.�6. Ibid., no �077. Cf. l’Appendice sur les Phocas, p. 000.
QUELQUES REMARQUES SUR LE CULTE DE LA CROIX �8�
- Nicétas, ostiaire impérial et catépan des domaines (c’est-à-dire leur intendant) de Léon, curopalate et logothète du drome�7,- Basile Lécapène, proèdre du Sénat�8,
Laurent, Vatican, no �86
- Pierre, protospathaire et domestique des Scholes d’Occident�9,
Jordanov, Corpus I, no �6a
- Maléïnos, ostiaire et primicier des notaires�0,
Seibt, Bleisiegel I, no 5�
�7. Ibid., no �08�. Cf. l’Appendice sur les Phocas, p. 000.�8. Laurent, Orghidan, nos �86 et�87.�9. Jordanov, Domestiques, p. �0�-�04. Pierre a utilisé plusieurs types de sceaux, notamment
lorsqu’il obtint la dignité supérieure de patrice. Au droit de l’un d’eux, à la place du monogramme, Pierre fit graver une croix patriarcale ornée de grands fleurons et fit inscrire, dans les cantons de la croix, la formule nicéphore.
�0. Seibt, Bleisiegel I, no 5�.
JEAN-CLAUDE CHEYNET�8�
- Théophile, anthypatos, patrice, questeur��,
Zacos II, no �084
- Théophane, patrice et parakoimomène��.
Zacos II, no �088
Bardas Phocas était le fils de Nicéphore l’Ancien et le père de Nicéphore l’em-pereur. Léon, fils de Bardas, était donc le frère de Nicéphore. Nicétas gérait les biens du même Léon Phocas, seul curopalate de son époque. Basile Lécapène, originaire d’Orient, fut le compagnon d’armes de Jean Tzimiskès contre les Musulmans et Nicéphore Phocas le nomma proèdre du Sénat en raison de son soutien politique. Basile est fameux par le reliquaire qu’il commanda pour abriter, entre autres, un morceau de la vraie Croix��. Pierre, appelé dans les sources oJ tou' Fwvka'", c’est-à-dire le serviteur de Phocas et non, comme on l’a parfois interprété, le fils de Phocas, fut l’un des meilleurs généraux de l’Empire�4. Les Maléïnoi furent les plus proches alliés par le sang des Phocas, puisque la mère de l’empereur Nicéphore était elle-même issue de la famille Maléinos�5. Théophile, questeur
��. Zacos II, no �088.��. Zacos II, nos �084-�086 et Oikonomides, Dated Seals, nos 59, 6�, 64 ; l’éditeur suggère que
la référence à la croix dans l’inscription pourrait être mise en relation avec la brillante victoire de Théophane sur les Russes, en 94�.
��. Cette précieuse staurothèque, emportée par un Latin après la prise de Constantinople en ��04, se trouve aujourd’hui à Limbourg.
�4. Sur les Phocas, voir en dernier lieu, Cheynet, Phocas, p. �89-��5 (infra, p. 000).�5. Le rapport exact du Maléïnos du sceau avec la famille homonyme n’est pas clair. La qualité
d’eunuque impliquée par la fonction d’ostiaire ne sied guère, a priori, au rejeton d’une telle lignée.
QUELQUES REMARQUES SUR LE CULTE DE LA CROIX �8�
sous le règne personnel de Constantin VII, lui-même alors sous l’influence des Phocas, appartenait à la famille Érôtikos, qui se rattachait à l’entourage de ces mêmes Phocas�6.
Le dernier personnage, Théophane, ne peut être rattaché à ce groupe, puisqu’il servit l’empereur Romain Lécapène, lui aussi d’origine orientale, mais adversaire des Phocas. Il ne faudrait pas conclure que ces derniers étaient seuls attachés au culte de la Croix en Asie Mineure, car nous possédons d’assez nombreux sceaux à monogramme tardif dont le signataire n’est pas connu par ailleurs. Il est probable que si l’identification était possible, il se dégagerait une nette majorité de person-nages originaires de l’Asie Mineure�7.
La préférence pour les monogrammes n’implique pas nécessairement un refus du culte des saints ou de la Vierge, comme au temps de l’iconoclasme. Nicéphore Phocas, le futur empereur, alors qu’il n’était encore que stratège des Anatoliques, s’était placé sous la protection de Théodore�8, saint particulièrement vénéré en Cappadoce�9. De plus, dans l’église construite en son honneur, sur ses terres de Cappadoce, à Çavuhin, sont représentés saint Germain et saint Taraise, deux patriarches de Constantinople, ardents défenseurs des Images, que l’on retrouve également à Tokali Kilise40, autre église élevée à l’instigation de ses parents. C’est bien pour l’image de la Croix que le monogramme a été choisi par un certain nombre de Phocas ou de proches.
En conclusion, la formule ∆Ihsou'" Cristo;" nika' nous paraît souligner l’importance du culte de la Croix, symbole de la résistance à l’Islam4�. C’est tout naturellement en Asie Mineure, singulièrement en Cappadoce, qu’une telle mentalité s’est développée. Les Phocas et leur entourage, qui regroupent le clan le plus puissant de l’aristocratie micrasiatique, furent donc les héritiers d’une vieille tradition qui remonte au moins à Léon III, et qui ne s’affadit pas après le triomphe des Images4�, sans qu’elle ait toutefois impliqué l’adoption des idées iconoclastes. Ils s’en firent les propagandistes jusqu’au plus haut niveau, puisqu’ils parvinrent à en faire partager le bien fondé aux empereurs de la dynastie macédonienne jusqu’à Basile II. Le xe siècle marque un temps de forte influence provinciale à Constanti-nople, même si la capitale a, par ailleurs, exporté en Cappadoce des modèles artis-tiques. Nous croyons voir un signe de leur succès dans certains ouvrages de Léon VI et de Constantin VII, mais aussi dans l’adoption de la formule nicéphore
�6. Cheynet, Pouvoir, p. ��8.�7. Ainsi, par exemple, nous ne savons rien d’un juge de Thessalonique appelé Samônas, sinon
que son sceau comportait un monogramme (Oikonomides, Dated Seals, nos 60 et 6�). Le nom suffit à indiquer une origine orientale, car il fut porté par un Arabe au service de Léon VI.
�8. Zacos II, no 864.�9. Jolivet-Levy, Églises de Cappadoce, index, s.v. Théodore.40. Jolivet-Levy, Églises de Cappadoce, p. �7, �0�, �05.4�. II est remarquable que sous les Paléologues de telles inscriptions soient à nouveau placées sur
les murailles des forteresses, alors que la menace turque se précisait.4�. Jean Tzimiskès, dans sa lettre à Achot III, s’enorgueillit que « la domination de la Sainte
Croix ait été étendue au loin ». Dans l’église de Çavuhin dédiée aux Phocas, Nicéphore, Léon et peut-être Bardas tenaient une croix. Nicole Thierry estime, sûrement à juste titre, qu’il s’agit des croix reprises sur les Arabes de Tarse qui s’en étaient emparés un siècle plus tôt (Le culte de la croix [comme n. �7], p. ��4-��5). Mais une telle représentation souligne aussi le prix extraordinaire ac-cordé à de telles reliques qui furent déposées à Sainte-Sophie.
JEAN-CLAUDE CHEYNET�84
sur des sceaux du premier nommé, qui fut, de tous les Macédoniens, le plus sensible à leur influence, et de son frère Alexandre, ainsi que dans son maintien systématique sur les monnaies d’argent jusqu’à la mort de Jean Tzimiskès. Basi-le II, successeur de ce dernier, une fois maître de son destin, dirigea les ambitions impériales en Europe contre les Bulgares.