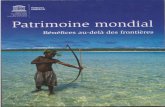Le rôle et les implications du Comité International de la Croix-Rouge lors de la guerre d'Algérie...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Le rôle et les implications du Comité International de la Croix-Rouge lors de la guerre d'Algérie...
Nicolas Baltus
« Le rôle et les implications du Comité International de la Croix-Rouge lors de la guerre d’Algérie (1954 – 1962) »
Professeur : Amine Ait-Chaalal Cours : Politique étrangère et Action Humanitaire (LHUMA2210)
Juin 2014
Page 2 sur 23
TABLE DES MATIERES
1. Introduction .............................................................................................................................. 3
2. Contexte ...................................................................................................................................... 4 2.1. La guerre d’Algérie (1954 – 1962) ........................................................................................... 4 2.1.1. Les causes de la guerre ........................................................................................................................... 4 2.1.2. Le déroulement de la guerre ................................................................................................................ 6 2.1.3. Les conséquences du conflit .............................................................................................................. 11
3. Le CICR dans la guerre d’Algérie ..................................................................................... 13 3.1. De la possibilité d’agir sur les prisonniers algériens ...................................................... 13 3.2. Les relations entre les forces algériennes et le CICR ....................................................... 14 3.3. Aide apportée aux refugies et deplaces algeriens ............................................................ 15 3.4. La clef de voûte de l’action du CICR : la visite des prisonniers ..................................... 16 3.5. L’instrumentalisation du CICR par la presse en ce qui concerne le débat sur la torture ......................................................................................................................................................... 17 3.6. Participation à l’application du droit humanitaire .......................................................... 17 3.7. La recherche des familles comme première action post-‐conflit du CICR ................. 18
4. Conclusion .............................................................................................................................. 20
5. Bibliographie ......................................................................................................................... 21 5.1. ouvrages ......................................................................................................................................... 21 5.2. Articles scientifiques .................................................................................................................. 21 5.3. articles non-‐scientifiques ......................................................................................................... 21 5.4. Rapports et études ...................................................................................................................... 22 5.5. Mémoires et thèses ..................................................................................................................... 22 5.6. Textes de loi ................................................................................................................................... 22 5.7. Documents officiels ..................................................................................................................... 23 5.8. Syllabus ........................................................................................................................................... 23 5.9. Documents vidéos ....................................................................................................................... 23
Page 3 sur 23
1. INTRODUCTION
L’Algérie acquit son indépendance en 1962 après un conflit qui dura près de huit ans. Entre 1954 et 1962, celui-ci, dénommé « la Guerre d’Algérie » fit de nombreuses victimes dans les camps algériens et français. Ce conflit, conséquence des conditions dans lesquelles ont été contraintes les populations nord-africaines autochtones, apparaît dans la mouvance des mouvements de décolonisation s’étant développés à travers le monde à partir de la deuxième moitié du 20ème siècle. Il est caractérisé par une utilisation accrue de la torture du côté du gouvernement français, justifié par un besoin d’investigation poussé du fait du nombre impressionnant d’attentats de la part des indépendantistes algériens.
Le Comité International de la Croix-Rouge est une organisation humanitaire internationale caractérisée par son indépendance légendaire. Née un siècle avant le début du conflit algérien, elle occupa un rôle prépondérant dans la protection des prisonniers de guerre ainsi que dans la lutte contre l’utilisation de la torture comme méthode d’investigation à l’égard des prisonniers tout au long de son existence. C’est pourquoi, cette malheureuse réalité du conflit algérien la rend particulièrement indispensable.
Le travail qui va suivre aura comme objet le rôle et l’action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre d’Algérie, et plus précisément l’instrumentalisation politique et médiatique dont elle a été victime malgré elle. L’organisation humanitaire a en effet été utilisée par les forces nationalistes algériennes pour tenter de légitimer une revendication d’indépendance et de reconnaissance d’un conflit international. D’autre part, les médias et la société dans son ensemble ont utilisé l’organisation comme catalyseur au débat sur l’utilisation de la torture, qui prenait place à cette époque dans la France suivant la libération nazie.
Dans un premier temps, nous passerons en revue les éléments historico-politiques de la guerre d’Algérie. Nous étudierons tout d’abord les causes ayant menés la France et son ancienne colonie à cette situation. Ensuite, nous parcourrons les grands événements du conflit pour enfin déterminer quelles ont été les conséquences concrètes de celui-ci.
Dans un deuxième temps, nous analyserons le rôle du Comité International de la Croix-Rouge au sein de ce conflit. Ses différentes fonctions, ses relations avec les acteurs du conflit ainsi que la manière dont celui-ci a fait pour implanter son action seront passés en revue.
Page 4 sur 23
2. CONTEXTE
2.1. LA GUERRE D’ALGERIE (1954 – 1962)
2.1.1. LES CAUSES DE LA GUERRE
En 1954, l’Algérie fait partie intégrante de l’Etat français. Composée de trois départements souverains depuis le 19ème siècle, ce territoire dispose d’une administration à l’égal de la métropole où les habitants sont des sujets de la France mais ne sont cependant pas réellement traités comme tels. 1 En effet, les Algériens souffrent de discriminations constantes et croissantes de la puissance colonisatrice, ce qui a pour effet de créer une société fragmentée et fortement inégalitaire, comme l’atteste le tableau ci-dessous2.
Les deux communautés en 1954 Algériens Pieds Noirs Part de chaque communauté dans
la population locale 90,1% 9,9%
Cadres supérieurs 7% 93% Techniciens 17% 83%
Fonctionnaires 14% 86% Manœuvres 95% 5%
Ouvriers spécialisés 68% 32% Moyenne du revenu individuel
annuel 3354€ 119.000€
Pourcentage de la population vivant en ville
19% 95%
Scolarisation des élèves dans le primaire
18% 98%
Pour illustrer ces chiffres, le plus représentatif est de mentionner le statut organique algérien voté en 1947, qui crée une « Assemblée algérienne ». Les membres de celle-ci sont divisés en deux groupes de nombres égaux, les représentants des pieds noirs, citoyens français ayant émigré en Algérie, et ceux des autochtones, les « indigènes ». Cependant, leur représentation est totalement inégalitaire. En effet, une moitié de cet organe est élu « par un collège de 522 000 citoyens français, et l'autre moitié par un collège de 1 200 000 musulmans non citoyens »3. En considérant de surcroît les trucages électoraux du collège autochtone, on peut aisément affirmer qu’un véritable système d’imposition envers les algériens s’est mis en place au fil des années dans l’Algérie prérévolutionnaire. Cette situation sera une des grandes causes de l’éclatement de la guerre du milieu du 20ème siècle.
De plus, au sortir de la deuxième guerre mondiale, les Algériens ne comprennent pas pourquoi ils ne sont toujours pas considérés comme des citoyens à l’égalité des pieds noirs ou des Français de la métropole. En effet, considérés comme des citoyens de seconde zone, restreints sous le statut d’indigène, ils ont combattu sous
1 Les départements d’Algérie, http://splaf.free.fr/algerie.html, dernière consultation le 14 juin 2014. 2 YACONO Xavier, Résultats statistiques du dénombrement de la population effectué le 31 octobre 1948, Alger : Service de statistique générale, 1953, 3 volumes, 394 p.
3 Guerre d’Algérie (1954 – 1962), Paris : Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Algérie/104808, dernière consultation le 15 juin 2014.
Page 5 sur 23
le blason de la France tels de vrais patriotes et sont connus dans l’Histoire pour leur bravoure sous différentes dénominations tel que « zouave » ou encore « tirailleur ». Cependant, la possibilité d’une égalité de traitement et de statut avec les algériens colonisés est une réelle angoisse pour les pieds noirs et les Français en général.
Cette pérennisation inégalitaire du statut quo envers les autochtones mènera à la guerre d’Algérie qui selon certains débuta à Sétif. En effet, alors que l’Europe fête la victoire des alliés sur le nazisme le 8 mai 1945, des émeutes éclatent dans cette ville située à trois cents kilomètres de la capitale. La réponse de la police française est disproportionnée et exprime le malaise de la société, persuadant ainsi « nombre de leaders algériens que l’égalité des droits, promise par la France, était un leurre et qu’il n’y avait d’autres issues que l’indépendance de leur patrie »4. Voilà pourquoi, il est dès lors aisé de statuer que la violence de la guerre en Algérie « commence lorsque les policiers veulent se saisir du drapeau du Parti du Peuple Algérien (PPA), devenu depuis le drapeau algérien, et des banderoles réclamant […] l’indépendance »5.
Au même moment, sous l’influence de la défaite de la France dans la guerre d’Indochine, les mouvements indépendantistes algériens profitent de la faiblesse et de la fenêtre d’opportunité que laisse ainsi transparaître la puissance colonisatrice. L’Algérie voit alors apparaître la plus emblématique des organisations nationalistes algériennes : le Front de Libération Nationale (FLN). Ce dernier, réunit avec d’autres au sein d’un Comité Révolutionnaire d’Union et d’Action (CRUA), va arriver à canaliser « les troubles à l’ordre public [qui] se sont multipliés en Algérie [et qui jusque là] n’ont eut qu’un caractère localisé et indépendant les uns des autres »6, et va ainsi « choisir la date du 1er novembre [1954] pour déclencher l’insurrection [en organisant] une trentaine d’attentats » 7 sur des objectifs militaires ou de la police, représentants les intérêts de la France. Ces incidents, surnommés ceux de la « Toussaint Rouge », marquent le début officiel de la guerre d’Algérie.
4 PERRET Françoise, BUGNION François, « Entre insurrection et gouvernement : l’action du Comité international de la Croix-Rouge durant la guerre d’Algérie (1954 – 1962) », Revue Internationale de la Croix-Rouge, 2011, vol. XCIII, n°2, p. 298-299
5 HARBI Mohammed, La guerre d’Algérie commence à Sétif, Paris : Le Monde Diplomatique, publié en mai 2005, http://www.monde-diplomatique.fr/2005/05/HARBI/12191, dernière consultation le 14 juin 2014.
6 MÉDARD Frédéric, « Les débuts de la guerre d’Algérie : errements et contradictions d’un engagement », Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. IV, n°240, p. 83
7 SAVÈS Joseph, 1er novembre 1954 : « Toussaint rouge » en Algérie, Paris : Herodote.net, http://www.herodote.net/1er_novembre_1954-evenement-19541101.php, dernière consultation le 14 juin 2014.
© Fra
nce
Télé
visions
Page 6 sur 23
2.1.2. LE DEROULEMENT DE LA GUERRE
2.1.2.1. L’ESCALADE DE LA VIOLENCE
Les événements de la Toussaint Rouge sont peu perçus par la société française en métropole car ils sont décrits par les autorités « comme l’œuvre de bandits isolés ou, au pire, d’une poignée d’exaltés manipulés par l’étranger » 8 . En réalité, les autorités elle-même ne mesurent pas, à l’époque, la puissance du sentiment nationaliste et indépendantiste grandissant au sein des plus extrémistes de la société algérienne.
Un an plus tard, François Mitterrand, Ministre de l’Intérieur français de l’époque, présente un programme de réformes pour l’Algérie, qui a comme conséquence un attisement des tensions. En effet, celui-ci reçoit une opinion fortement défavorable d’une part de plus en plus grande de la population, se ralliant ainsi aux idées du FLN. L’état d’urgence est instauré par les autorités françaises qui en profitent pour déplacer dans des « centres de regroupement » tous les individus ayant un lien soupçonné avec l’organisation de libération nationale. On estime qu’à la fin de la guerre plus d’un million de personnes auraient été ainsi déplacées.9
En réponse, les membres du FLN assassinent les Algériens favorables aux idées françaises d’intégration de l’Algérie au territoire national. Cependant, cette stratégie barbare ne plaît pas à l’opinion locale. Les membres du FLN décident alors d’attaquer les colons français directement, plus seulement par le biais de cibles matérielles.
En ce qui concerne les violences commises « entre Algériens », il est important de noter que celles-ci sont tout autant atroces et inhumaines que celles commises par les Français à l’égard des Algériens. L’histoire raconte trop souvent le récit de la guerre de manière manichéenne en oubliant que le FLN et l’ALN (Armée de Libération Nationale, bras armé du FLN, créé en même temps que le CRUA) se sont aussi « livrés à des exactions dirigées […] de manière aveugle contre l’ensemble de la population – l’instauration de ce climat de terreur ayant pour but avoué de précipiter le départ des Français »10.
8 MÉDAR Frédéric, op. cit., p. 84
9 SAVÈS Joseph, La guerre d’indépendance, Paris : Herodote.net, http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=1774&ID_dossier=9, dernière consultation le 15 juin 2014.
10 FOLSCH Arnaud, Guerre d’Algérie : les derniers secrets, Alger : Bab el Oued Story, http://babelouedstory.com/thema_les/disparus/2053/2053.html, dernière consultation le 15 juin 2014.
© Le
Parisie
n, 2 nove
mb
re 1954
Page 7 sur 23
Le point de non-retour de la violence de chacune des parties est atteint lors du tragique événement du 20 août 1955, connu sous le nom du Massacre de Philippeville. A cette date, les forces du FLN prennent comme prétexte la commémoration du deuxième anniversaire de la déposition du Sultan marocain, en d’autres mots l’indépendance du Maroc, pour organiser des manifestations violentes. La réelle
cible de celles-ci, organisées à Philippeville mais aussi dans trente-six autres localités du pays, sont les européens. En représailles, la réponse française est disproportionnée et cause un nombre beaucoup plus important de victimes algériennes que françaises. Cet événement « coupe de façon irréductible le lien entre les deux communautés »11.
Les années qui suivent marquent une forte intensification du conflit. Les attentats du FLN se font de plus en plus nombreux et fréquents, l’organisation se dote d’une structure politique établie et les stratégies de torture des français, pour faire parler les personnes susceptibles de disposer d’informations sur de potentiels attentats, se mettent tout doucement en place.12
Face à cette vague d’attentats du FLN visant des civils, les pieds noirs en organisent à leur tour, ce qui crée un cycle de violence sans précédent. La lutte armée se déroule sur tout le territoire, villes à majorité européenne comprises, et le commandement militaire devient de plus en plus important.13
En effet, la baisse de la confiance dans le pouvoir civil des Européens en Algérie fait se dévier celle-ci vers les instances militaires. Ces dernières peuvent être illustrées par le général Massu (photo ci-contre), fortement populaire auprès de la population pieds noirs pour son désir de protection de l’Algérie française, qui est chargé de rétablir l’ordre dans la ville d’Alger. Il y parvient mais les conséquences sont désastreuses. En effet, celui-ci avoue quelques années plus tard avoir torturé un
11 Guerre d’Algérie (1954 – 1962), Paris : Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Algérie/104808, dernière consultation le 15 juin 2014.
12 WONG Naiad N., Frayed Memories and Incomplete Identities: The Impact of The Algerian War on The Pieds Noirs, Algerian Women and The Algerian State, Thesis submitted to the graduate division of the Master of Arts in History, Hilo : University of Hawai’i, May 2005, p. 9
13 Guerre d’Algérie (1954 – 1962), Paris : Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Algérie/104808, dernière consultation le 15 juin 2014.
© L
'Éc
ho d
'Alg
er,
21-2
2 a
oût
195
5
© A
rchive
s milita
ires d
e Fra
nce
Page 8 sur 23
grand nombre de militants du FLN dans l’optique d’obtenir des informations cruciales14 et mettre l’organisation « exsangue et guère en état de poursuivre ses opérations terroristes »15. L’armée parvient alors au fur et à mesure à reprendre le contrôle de tout le territoire algérien, grâce à son système de camps de regroupement, isolant les éléments perturbateurs.
2.1.2.2. LA STRATEGIE DU FLN DE MOBILISATION DE L’OPINION PUBLIQUE INTERNATIONALE
Quelques mois après l’accession de De Gaulle à la présidence française, le « Gouvernement Provisoire de la République algérienne » (GPRA) est constitué par le FLN, ayant comme « double perspective : le référendum et le débat à l’ONU »16.
Il faut à cet égard noter que pour le FLN, le meilleur moyen d’obtenir de la visibilité et de plaider sa cause outre frontière est d’internationaliser le conflit. En effet, le but de l’organisation depuis le début de celui-ci est « d’émanciper des départements considérés comme français par la France et de transformer une affaire intérieure en une affaire qui concerne l’humanité toute entière »17. La participation du FLN à la Conférence de Bandoeng de 1995, qui rassemble l’ensemble des pays non-alignés du tiers monde et cherche à remettre en question la logique des grandes puissances18, va dans ce sens. Celle-ci reconnaitra d’ailleurs le droit au peuple algérien de disposer de lui-même, d’imposer ses droits et obligations sur son territoire, estimé dès lors comme légitime pour y construire une nation algérienne indépendante.
En réalité, les actes posés par le gouvernement français tout au long du conflit n’ont eu comme effet que de favoriser l’écho international de la volonté d’émancipation du FLN. Par exemple, bien que le gouvernement français entreprenne des relations clandestines avec les autorités du FLN au Maroc, celui-ci détourne un avion en provenance de Rabat, qui était occupé par les cinq figures historiques de l’organisation, afin de les incarcérer en France. Cette situation suscite dès lors de vives émotions à travers le monde et n’empêche pas les dirigeants arrêtés du FLN
14 7 janvier 1957 – Début de la bataille d’Alger, Paris : Herodote.net, http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19570107&get_all=1#reac, dernière consultation le 15 juin 2014.
15 MASSU Jacques (Général), Bataille d’Alger : Massu parle, Genève : TSR, « Temps Présent », 4 novembre 1971.
16 HERREMAN Philippe, Le « gouvernement provisoire de la République algérienne » dix mois après sa constitution, Paris : Le Monde Diplomatique, publié en juillet 1959, http://www.monde-diplomatique.fr/1959/07/HERREMAN/23128, dernière consultation le 15 juin 2014.
17 FRANK Robert, PAS Niek, THÉNAULT Sylvie, CONNELLY Matthew, « L’arme secrète du FLN. Comment De Gaulle a perdu la guerre d’Algérie, de Matthew Connelly », Monde(s), 2012, vol. I, n°1, p. 161
18 SANTANDER Sébastian, Introduction aux relations internationales, Notes de cours, Sart-Tilman : Université de Liège, 2010, p. 26
© H
ero
do
te
Page 9 sur 23
d’engendrer un processus de médiatisation mondiale de leur message. 19 La tentative de neutralisation des têtes dirigeantes du FLN par le gouvernement français devient dès lors la maladresse de la France.
Quelques jours plus tard, le FLN conforte le soutien du Président égyptien Nasser à l’idéologie indépendantiste algérienne au moment où ce dernier décide de nationaliser le Canal de Suez. En effet, cet acte, perçu comme anticolonialiste à l’encontre des intérêts franco-britanniques concernant l’approvisionnement de pétrole, provoque l’apparition d’une crise diplomatique aiguë. Israël, la France et le Royaume-Uni se lancent alors dans l’opération de Suez, chacun pour des motifs différents.20 La France, elle, « entend surtout priver le FLN de son principal appui extérieur en renversant le Président Nasser, perçu comme la figure de proue du nationalisme arabe et comme le principal soutien de l’insurrection algérienne »21. Etant donné l’issue de cette opération, qui se solde par un échec retentissant pour les forces colonisatrices compte tenu des pressions diplomatiques exercées par les Etats-Unis et l’URSS, le FLN peut compter sur le soutien important du Président Nasser dans la lutte vers l’indépendance du peuple algérien.
L’isolement de la France sur le plan international est de plus en plus grand à tel point que les deux grandes puissances de la guerre froide, citées ci-dessus, ont condamné « la politique française au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais pour des intérêts contraires »22, ne laissant presque pas le choix à De Gaulle de glisser vers l’acceptation de l’émancipation algérienne. En effet, pour les Etats-Unis, « les objectifs assignés et les moyens employés en Algérie, risque de détériorer gravement l’image de l’Occident auprès des pays du Tiers-Monde et de favoriser d’une façon décisive la politique de séduction que les Soviétiques déploient auprès de ces derniers »23 tandis qu’ils voient, eux, un moyen efficace d’implanter leur influence au Maghreb.
Pionnier dans ce que certains appellent la révolution diplomatique, le FLN innove dans ses techniques d’interpellation de la communauté internationale civile et politique. Il entretient des relations diplomatiques intenses avec bons nombres d’Etats de la planète, et obtient le soutien de certains d’entre eux, il se rend fréquemment à la tribune de l’ONU pour plaider sa cause, il interpelle les médias pour toucher l’opinion publique, il rallie diverses ONG à sa cause…En d’autres termes, les nationalistes algériens engendrent un vrai mouvement de contestation « transnational [qui] se place sur le terrain des droits de l’homme, des droits à l’indépendance, afin de légitimer sa guerre aux yeux du monde et de délégitimer celle de l’ennemi »24.
19 PERRET Françoise, BUGNION François, op. cit., p. 299-300 20 LIÉGEOIS Michel, Géopolitique de l’action humanitaire, Notes de cours, Louvain-La-Neuve : Université Catholique de Louvain, 2013, p. 21 21 PERRET Françoise, « L’action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre d’Algérie (1954 – 1962) », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Avril 2010, vol. LXXXVI, n°856, p. 919 22 Guerre d’Algérie (1954 – 1962), Paris : Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Algérie/104808, dernière consultation le 16 juin 2014. 23 FRANK Robert, PAS Niek, THÉNAULT Sylvie, CONNELLY Matthew, op. cit., p. 162 24 FRANK Robert, PAS Niek, THÉNAULT Sylvie, CONNELLY Matthew, op. cit., p. 163
Page 10 sur 23
2.1.2.3. EVOLUTION VERS LES ACCORDS DE PAIX
En quelques années, l’opinion publique change de camp pour finalement favoriser une issue rapide de la guerre. En effet, les attentats du FLN ne touchent plus seulement les terres africaines mais sont désormais nombreux en métropole. De plus, et cela est mis en exergue particulièrement par le Parti Communiste Française (PCF), qui mobilise ainsi une grande partie des intellectuels du pays, « le coût économique de la guerre ébranle une partie de la classe politique et les milieux d'affaires, qui voient avec inquiétude les pays concurrents se moderniser et connaître une forte croissance »25 tandis que la France s’est enlisée, elle, dans un conflit où les valeurs de respects républicaines semblent de plus en plus être mises de côté. Cependant, le 13 mai 1958, un coup d’Etat militaire à Alger, soutenu par une partie des pieds noirs, provoque la chute de la IVème République. De Gaulle arrive au pouvoir et très rapidement, il ouvre les négociations avec le FLN.
Le Président de Gaulle présente alors en 1959 son plan pour la « la paix des braves », fondée sur l’illusion d’une victoire militaire française sur les forces du FLN, celle-ci est en fait négociée en secret avec ce dernier. De Gaulle demande alors « aux rebels de déposer les armes dans l’honneur »26 afin d’engager des pourparlers de paix avec le FLN.
Le Président de Gaulle organise le 8 janvier 1961, un référendum sur l’autodétermination de l’Algérie qui est approuvée par les français. Le résultat est inattendu pour beaucoup. En effet, « malgré l’appel du FLN à boycotter le scrutin, une proportion massive d’Algériens, hommes et femmes, […] tout comme Européens »27, représentant 75% des 4.412.000 électeurs inscrits, ont voté « oui » au référendum, allant donc dans le sens d’une future indépendance algérienne. Les pieds noirs, ainsi qu’une partie de l’armée française, se sentent trahis. Les plus radicaux d’entre eux créent l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS). Alors que le processus de paix s’est assurément mis en place entre les deux Etats pour aboutir en 1962 aux accords d’Evian, entérinant ainsi l’Algérie en tant qu’Etat indépendant, cette organisation, par une multitude d’attentats en Algérie et France
25 Guerre d’Algérie (1954 – 1962), Paris : Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Algérie/104808, dernière consultation le 16 juin 2014.
26 SIMON Jacques, Algérie : l’abandon sans la défaite, 1958-1962, Paris : L’Harmattan, 2009, 279 p.
27 NOUSCHI André, « De Gaulle et la fin de la guerre d’Algérie », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013, vol. III, n°251, p. 165
© A
rchive
s Larb
or
Page 11 sur 23
métropolitaine, cherche « à relancer la guerre pour faire capoter le cessez-le-feu, pour empêcher l’organisation et la tenue du scrutin programmé »28.
Malgré la violence des actes et de leurs actions, rien n’y change, la guerre prend fin avec les accords d’Evian signés entre le gouvernement français et le GPRA le 18 mars 1962. Ces accords entérinent la souveraineté de l’Algérie sur son propre territoire ainsi qu’une coopération économique entre les deux pays 29 compte tenu du désir de la France de préserver ses intérêts économiques dans la région, notamment en ce qui concerne le pétrole saharien. En fait, « les
accords d’Evian donnent au pétrole une importance que personne ne pouvait soupçonner »30 mais qui a certainement été un des facteurs de plus ayant entrainé de Gaulle à engager très tôt une transition pacifique vers l’indépendance.
L’indépendance de l’Algérie, proclamée le 18 juillet, se fait dans la douleur et dans le sang. Entre le printemps et l’automne 1962, près de 800.000 pieds noirs quittent l’ancienne colonie dans un contexte d’extrême violence. L’OAS multiplie les attentats, des Européens sont assassinés ou portés disparus tandis que ces harkis, ces Algériens qui ont combattu dans les rangs de l’armée française, se font massacrer.
2.1.3. LES CONSEQUENCES DU CONFLIT
Premièrement, les conséquences du conflit algérien s’étant déroulé entre 1954 et 1962 concernent le coût humain de celui-ci. En effet, on dénombre plus de 35.000 morts du côté français et plus de 250.000 morts du côté algérien.31 Á côté de ces personnes mortes, il existe un nombre encore officiellement inconnu des personnes disparues liées aux tortures de l’armée française et assassinats commis par le FLN.
Ensuite, l’esprit anti-français est pendant longtemps resté imprégné dans l’inconscient collectif du peuple algérien ainsi que dans les relations diplomatiques du pays. En effet, cette logique fut entretenue car le FLN est resté pendant longtemps après l’indépendance influente du pouvoir, celui du Parti unique. Cependant, la transition vers la démocratie, qu’a connu l’Algérie à partir des années 1980, et la remise en question des autorités françaises sur les exactions commises pendant la guerre d’Algérie au début du 21ème siècle, ont eu comme effet d’apaiser les relations entre les peuples et les politiques des deux pays.32
28 THÉNAULT Sylvie, « “L’OAS à Alger en 1962“ Histoire d’une violence terroriste et de ses agents », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008, vol. LXIII, n°5, p. 977
29 « Accord de cessez-le-feu en Algérie », Journal officiel de la République française, 20 mars 1962, p. 3021
30 NOUSCHI André, op. cit., p. 166
31 LAVISSE Ernest, CASALI Dimitri, Histoire de France de la Gaule à nos jours, Paris : Armand Colin, 2013, 216 et s.
32 Guerre d’Algérie (1954 – 1962), Paris : Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Algérie/104808, dernière consultation le 16 juin 2014.
© L
e F
iga
ro, 1
9 m
ars
196
2
Page 12 sur 23
Troisièmement, la guerre d’Algérie eut comme conséquence le retour de 90% des Français d’Algérie, les pieds noirs. En effet, ces derniers ont quitté un environnement particulièrement hostile en ce qui les concerne pour revenir dans un pays où la population moyenne n’avait pas de grandes préoccupations à leur égard. De plus, les autorités françaises ne prévirent rien pour les accueillir. Ces Français d’un genre à part ont donc quitté un pays qui était, aussi, le leur, pour débarquer dans un autre leur étant finalement inconnu où ils étaient en plus considérés comme des étrangers.33
Enfin, une des conséquences les plus dramatiques fut en ce qui concerne les harkis, ces algériens ayant choisi le camp français lors de la guerre. A la fin de celle-ci, un grand nombre d’entre eux est parti se réfugier dans le Sud de la France, on les estime à presque 100.000, craignant les représailles du FLN qui les considéraient comme des traitres. Cependant, « la grande majorité est restée en Algérie et des dizaines de milliers [d’entre eux] ont été assassinés » 34 . Pour Mohamed Korso, professeur d’histoire à l’université de Bouzaréah, à Alger, « l’histoire des harkis reste douloureuse et les blessures de la guerre sont toujours présentes dans la mémoire du pays […]. Malgré les cinquante années qui se sont écoulées depuis l’indépendance […], certains algériens pensent que les harkis se montraient même plus violents envers leurs compatriotes que les soldats français »35, démontrant ainsi la profondeur du traumatisme dans la population. Le gouvernement français reconnut, lui, en 2012, par l’intermédiaire de Nicolas Sarkozy, « la responsabilité historique de la France dans “l’abandon“ des harkis après la fin de la guerre d’Algérie »36.
33 Qui étaient-ils ?, Exode 1962, publié le 10 septembre 2010, http://exode1962.fr/exode1962/qui-etaient-ils/qui-etaient-ils.html, dernière consultation le 16 juin 2014.
34 Harkis… Les oubliés, Paris : France 24, http://webdoc.france24.com/harkis-les-oublies/, dernière consultation le 16 juin 2014.
35 Ibid.
36 AFP, Sarkozy reconnaît la responsabilité de la France dans l’abandon des harkis, Paris : France 24, publié le 14 avril 2012, http://www.france24.com/fr/20120414-nicolas-sarkozy-responsabilite-historique-france-abandon-harkis-guerre-algerie-histoire/, dernière consultation le 16 juin 2014.
Page 13 sur 23
3. LE CICR DANS LA GUERRE D’ALGERIE
Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) est un organisme indépendant fondé en 1863 par Henri Dunant après la Bataille de Solferino (1859).
Première organisation humanitaire au monde, le CICR centre ses actions autour de sept principes fondamentaux37 :
- l’humanité signifiant que son but est de faire appliquer le respect de la personne humaine ;
- l’impartialité signifiant qu’elle ne fait aucune distinction entre les personnes dont elle a la charge ;
- la neutralité signifie qu’elle ne prend pas part aux débats militaires, politiques, raciaux, religieux ou encore philosophiques autour des affaires qui la préoccupent ;
- l’indépendance signifiant qu’elle n’est liée à aucune décision, aucune personne ou autre organisation, elle est libre de faire ses choix en toute liberté de conscience ;
- l’unité signifiant qu’il n’existe qu’une seule société de la Croix-Rouge et qu’elle doit être accessible à tous, à tout moment, partout dans le monde ;
- l’universalité signifiant qu’en son sein les droits et obligations sont les mêmes pour tous le monde sans exception ;
- le volontariat signifiant qu’elle est une organisation basée sur le secours volontaire et désintéressé.
3.1. DE LA POSSIBILITE D’AGIR SUR LES PRISONNIERS ALGERIENS
La décision du CICR d’intervenir en Algérie est intervenue dès le début du conflit. Cependant, le problème est que ce dernier ne peut pas exiger l’application des Conventions de Genève car il ne s’agit pas d’un conflit international et que la France ne reconnaît de plus pas la réalité d’un conflit dans ces départements algériens.
Une histoire filiale permettra en fait à l’institution d’agir. En effet, le Président du Conseil des ministres français, Pierre Mendès France, n’est autre que le beau-frère de William Michel, délégué du CICR à Paris.38 Celui-ci, soutenu par le Président du Conseil, propose alors au gouvernement français les services et modalités d’actions, du CICR, soulignant par la même occasion le bénéfice qu’elles pourraient leur apporter, garanties « dans un but strictement humanitaire »39. Ainsi, le CICR souhaite :
- recevoir la liste nominative des personnes arrêtées ;
37 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève : CICR, 1986.
38 HAROUEL-BURELOUP Véronique, L’action du CICR lors de la guerre d’Algérie, Paris : Grotius International, publié le 2 octobre 2010, http://www.grotius.fr/laction-du-cicr-lors-de-la-guerre-dalgerie/, dernière consultation le 17 juin 2014. 39 PERRET Françoise, BUGNION François, op. cit., p. 299-300
Page 14 sur 23
- obtenir l’autorisation de visiter tous les lieux d’internement et de s’entretenir sans témoins avec les captifs ;
- assurer l’échange de correspondance entre les détenus et leurs familles.
Début 1955, Pierre Mendès France pousse le Conseil à accepter ainsi les offres de services de l’organisation genevoise pour agir en Algérie.
Au début, celui-ci n’est pas favorable à l’intervention du CICR, craignant l’internationalisation du conflit qui profiterait de cette manière au FLN. Cependant, l’organisation obtient un accord écrit de Pierre Mendès France qui stipule ce que le CICR est autorisé à faire. En fait, le Conseil avait accepté toutes les propositions du CICR sauf la première, la communication des listes de captifs. Ce choix s’est justifié par la non-utilité de ces dernières, compte tenu de la forte variation et du flux des prisonniers arrêtés par les forces françaises. En revanche, l’accès et les visites dans les lieux de détention ainsi que les entretiens sans témoins avec les captifs ont été autorisé et cela fut l’élément clef de l’intervention du CICR en Algérie.
3.2. LES RELATIONS ENTRE LES FORCES ALGERIENNES ET LE CICR
Le CICR se pose très vite la question des contacts avec les forces rebelles algériennes. En effet, le fait de trouver des canaux de communication avec ceux-ci n’est pas simple. S’agissant d’une organisation clandestine, il a fallu beaucoup de temps pour arriver à obtenir un contact apte à la négociation.
Ainsi, au début de l’année 1956, le CICR parvient à établir le contact avec la direction du FLN établie au Caire. David de Traz, délégué régional du CICR au Proche et Moyen-Orient, rencontre les membres du FLN et les informe « des activités du CICR en Algérie et il insiste auprès d’eux pour qu’ils fassent respecter par leurs partisans les principes des Conventions de Genève de 1949, en particulier les dispositions de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève »40 . Ces derniers s’y engagent à la seule condition d’une réciprocité dans le camp français. En fait, en agissant de la sorte et agissant ainsi sur cette réserve, les nationalistes algériens « veulent que la France reconnaisse implicitement qu’elle est confrontée à un conflit de nature internationale »41.
En 1957, le FLN annonce la création d’un Croissant-Rouge algérien. Par cette occasion, « Ferhat Abbas, membre du Conseil national de la révolution algérienne, se présente au siège du CICR à Genève pour y accréditer le docteur Ben Tami en tant qu’agent de liaison du Croissant-Rouge algérien auprès du CICR » 42 . Cependant, les conditions pour reconnaître officiellement le Croissant-Rouge algérien ne sont à cette époque pas encore réunie, ce qui ne changera dans les faits rien aux relations entre le CICR, l’organisation et son action.43 De plus, cette démarche d’adhésion officielle à la famille de la société de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut être aisément associée à une tentative implicite de « reconnaissance implicite de l’indépendance de l’Algérie par le biais de sa Charte
40 PERRET Françoise, op. cit., p. 926 41 HAROUEL-BURELOUP Véronique, op. cit. 42 PERRET Françoise, BUGNION François, op.cit., p. 314 43 BEN AHMED Mohammed, Guerre d’Algérie : mémoires d’un délégué du CICR, Genève : CICR, publié le 19 mai 2011, http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/algeria-history-al-insani-2011-04-01.htm, dernière consultation le 17 juin 2014.
Page 15 sur 23
de la Croix-Rouge, laquelle ne reconnaît l’existence d’un Société nationale que dans un Etat indépendant »44.
En ce qui concerne les prisonniers français, ils ne sont pas gardés en Algérie par le FLN. Au contraire, ceux-ci sont évacués soit au Maroc, soit en Tunisie étant donné « les conditions dans lesquelles les hommes du FLN se battent en Algérie – absence de positions de repli et obligation de se déplacer sans cesse à la recherche d’abris de fortune ».
Le CICR demande alors, par le biais du docteur Ben Tami, à pouvoir voir ces prisonniers incarcérés dans les pays voisins. La démarche, délicate compte tenu du fait que ces deux pays, vis-à-vis du gouvernement français, ne pouvaient pas détenir des citoyens français prisonniers sur leurs territoires, du être plus rusée. En effet, l’alternative trouvée tenait en une procédure particulière. Celle-ci consiste à ce que, dès que les prisonniers français sont capturés et ont passé la frontière, le FLN prévient le CICR qui vient sur place, à Rabat ou à Tunis, les libérer.
Il est cependant important de noter que le nombre de prisonniers français et algériens pendant cette guerre fut extrêmement disproportionné. Toutefois, l’intervention du CICR au niveau des soldats français permettait de justifier leur action auprès des généraux français.
Si le CICR parvient à obtenir la libération de prisonniers, il échouera par contre à rompre le cycle de représailles entre le FLN et l’armée française. Aux condamnations à mort de militants FLN pour terrorisme répond les exécutions de soldats français prisonniers.
Les opérations militaires affectent bien entendu également les populations civiles. Ainsi, pour couper la guérilla de ses soutiens populaires, l’armée française évacue des villages entiers et crée, comme expliqué plus haut, des centres de regroupement. Selon les estimations, ces centres ont regroupés entre 1,5 et 1,6 millions d’Algériens.
3.3. AIDE APPORTEE AUX REFUGIES ET DEPLACES ALGERIENS
Par crainte d’être internés dans ces camps, une grande partie de la population fuit se réfugier dans les pays voisins. Ainsi, « au printemps 1957, les délégués du CICR évaluent à environ 40.000 le nombre de ces réfugiés disséminés tout au long de la frontière algéro-marocaine »45.
Le CICR parvient à soutenir ses populations en soutenant l’action de secours organisée par la Croix-Rouge française. En effet, cette dernière, avec l’accord des autorités en question, distribue moyens de subsistance et nécessaire de vies à ces populations en détresse. De plus, malgré une attaque aérienne de l’armée française sur un des villages frontaliers tunisiens, alors que « des délégués de la Croix-Rouge internationale étaient venus distribuer des vêtements à des adolescents, en principe
44 HAROUEL-BURELOUP Véronique, op. cit. 45 PERRET Françoise, BUGNION François, op.cit., p. 315
Page 16 sur 23
enfants d’Algériens » 46 et qu’un camion du CICR a été endommagé, l’action continuera tout au long du conflit.
Aussi, l’aide humanitaire est autorisée par les forces algériennes à l’égard des déplacés internes algériens, ayant des besoins grandissant. En effet, la problématique devient de plus en plus importante au fil de la guerre étant donné l’évolution spectaculaire du nombre de déplacés, qui sont plus de deux millions à la fin de la guerre, « en majorité des femmes et des enfants, répartis dans quelques 2000 centres »47 à travers le pays.
3.4. LA CLEF DE VOUTE DE L’ACTION DU CICR : LA VISITE DES PRISONNIERS
La principale action du CICR pendant toute la guerre reste la visite des détenus algériens. Depuis la première guerre mondiale, l’organisation suit une procédure en ce qui concerne cette pratique. En effet, le CICR établit tout d’abord une liste des lieux à visiter et leurs modalités de déplacement avec le gouvernement en question. Ensuite, à l’arrivée dans le lieu de détention, les délégués du CICR « s’entretiennent avec le commandant, […] visitent les installations […] et s’entretiennent sans témoin avec les détenus de leur choix »48. A la fin de la visite, les membres du Comité font part au commandant de leurs remarques et éventuelles recommandations. Enfin, un rapport est adressé sur la visite du camp qui est envoyé par les délégués à Genève qui se charge de le transmettre au gouvernement en charge des camps « en attirant l’attention sur les améliorations qu’il conviendrait d’apporter au régime de détention, et, le cas échéant, sur les cas de mauvais traitement constatés par ses délégués »49.
De 1955 à 1962, les délégués du CICR effectuent dix missions temporaires où ils visitent 490 lieux de détention. 96 visites sont également effectuées en France, notamment auprès des chefs historiques du FLN capturé au début de la guerre.
L’armée française a toujours bien reçu les membres du CICR compte tenu du fait que tous les cadres importants avaient eut affaire à l’organisation pendant la seconde guerre mondiale. Pour eux, la Croix-Rouge était connue et ils voyaient là la réplique de ce qui avait été fait en Allemagne pour eux.
Le but premier du CICR était d’améliorer le traitement des prisonniers et de faire reculer la torture. A chaque visite de camps de prisonniers, la partie la plus importante était l’entretien sans témoin à la fin du tour des installations des prisonniers choisis par les délégués eux-mêmes. C’est à ce moment que le CICR a pu constater, grâce aussi à la participation d’un médecin à l’examen clinique, de la gravité et de la fréquence de l’utilisation la torture ainsi que les séquelles objectives de sévices.
46 VALETTE Jacques, « Le bombardement de Sakiet Sidi Youssef en 1958 et la complexité de la guerre d’Algérie », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2009, vol. I, n°233, p. 48
47 PERRET Françoise, BUGNION François, op.cit., p. 317 48 PERRET Françoise, BUGNION François, op.cit., p. 305 49 Idem, p. 306
Page 17 sur 23
Le CICR tenta ainsi de convaincre les officiers français de cesser de torture les détenus et l’influence la plus importante a été effectuée auprès du gouvernement central à Paris. Cependant, ce dernier était semble-t-il désarmé vis-à-vis de l’armée. Les militaires s’étaient en effet affranchis des directives gouvernementales. Dès lors, le CICR participa ainsi un tant soit peu à faire reculer l’utilisation de la torture, alors que celle-ci ne s’est jamais vraiment éradiquée.50
3.5. L’INSTRUMENTALISATION DU CICR PAR LA PRESSE EN CE QUI CONCERNE LE DEBAT SUR LA TORTURE
Depuis le début de la guerre, l’opinion publique est partagée en ce qui concerne l’utilisation de méthodes de tortures pour faire parler les prisonniers capturés. En effet, une grande majorité d’entre elle refuse « que la police ou l’armée française eussent recours à des méthodes d’interrogatoire inspirées de celles de la Gestapo, contre lesquelles ils s’étaient insurgés […] à peine quinze ans auparavant »51.
Le 5 janvier 1960, un article du journal Le Monde publie trois pages d’un rapport de visites du CICR dans des camps de détentions déplorant l’utilisation généralisée de la torture. Cet article est perçu comme une bombe au sein des équipes du CICR qui ont peur pour l’avenir de leur action, en France, en Algérie, mais aussi dans tout autre endroit où l’organisation pourrait être amenée à intervenir, craignant de ne plus obtenir la confiance des gouvernements étant donné que leurs actions sont basées sur la confidentialité.52
Cependant, bien que le CICR dû renégocier ses visites dans les camps pendant près d’une année, cette révélation a permis de « mettre un minimum d’ordre dans le système de détention mis en place en Algérie, en particulier, dans les méthodes de détention »53.
3.6. PARTICIPATION A L’APPLICATION DU DROIT HUMANITAIRE
A plusieurs reprises, le CICR est intervenu pour faire appliquer le droit humanitaire par différentes parties impliquées lors du conflit en Algérie.
Ainsi, le 28 mai 1958, suite à des exécutions sommaires effectuées de la part du FLN sur des soldats français ainsi qu’une situation s’aggravant au niveau des violations du droit de la guerre, le CICR rédige un mémorandum, soumis aux deux parties de manière égale, qui contient les éléments auxquels il leur demande de soumettre leur engagement. C’est-à-dire54 :
- le respect de l’intégralité de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
50 JEANENNOT Edwige, MARBEAU Lucile, JOLI Frédéric, 1954-1962 : Le CICR et la guerre d’Algérie, Paris : Délégation du CICR en France, « Une Histoire d’Humanité », n°11, 2013.
51 PERRET Françoise, BUGNION François, op.cit., p. 323 52 BEN AHMED Mohammed, op. cit. 53 Idem, p. 324
54 Mémorandum du CICR, Genève : Comité International de la Croix-Rouge, 28 mai 1958.
Page 18 sur 23
- Si des prisonniers sont capturés par le camp adverse, ces derniers : o ne feront pas l’objet de poursuites pénales pour seul objet d’avoir
porté les armes ; o bénéficieront d’un traitement digne et humain et de toutes les
garanties essentielles accordées aux prisonniers de guerre ; o auront la possibilité d’avoir des contacts avec leurs familles ; o auront la possibilité de recevoir la visite des équipes du CICR et de
s’entretenir sans témoin avec ces derniers. - Si pour une raison ou l’autre un prisonnier est jugé coupable de peine de
mort, l’exécution sera repoussée jusqu’à la fin des hostilités, permettant ainsi au CICR de suivre la procédure et de faciliter leur défense ;
- Aucune raison ne pourra être invoquée pour justifier des mesures de représailles.
En conséquence, le CICR arrive à obtenir des avancées en la matière dans les deux camps.
En ce qui concerne le gouvernement français, une directive aboutit. Celle-ci concerne le traitement des militaires pris les armes à la main – non des prisonniers de guerre, selon la typologie des Conventions de Genève dont l’applicabilité officielle n’est pas reconnue officiellement étant donné la vision française du caractère non-international du confit, en accord au respect du mémorandum du 28 mai 1958.55 De cette manière, « les camps militaires d’internés devaient “être soumis à la discipline militaire, avec le souci de proscrire tout geste et toute parole qui pourraient être interprétés comme atteinte à la dignité des prisonniers »56.
En ce qui concerne le camp algérien, il adhère, le 11 juin 1960, à l’application des Conventions de Genève, sans formellement « se prononcer sur la portée juridique de cette adhésion, le CICR l’enregistre comme une réponse positive à son mémorandum du 28 mai 1958 »57. Il est cependant important de noter qu’étant donné le fait que le FLN s’est dotée d’une structure gouvernementale provisoire, de surcroit reconnue internationalement, le GPRA ne peut reconnaître officiellement les prérogatives du mémorandum du CICR. En effet, ce dernier se base sur l’article 3 commun aux Convention de Genève, qui concerne les conflits armés non-internationaux, alors que les autorités algériennes revendiquent elles être dans une situation de conflit internationale classique, tombant donc sous l’application des Conventions de Genève dans leur ensemble.
3.7. LA RECHERCHE DES FAMILLES COMME PREMIERE ACTION POST-CONFLIT DU CICR
Après la survenue des accords d’Evian, l’organisation est surtout impliquée dans ce qu’on appelle « la recherche des familles ». C’est-à-dire l’action qui vise à rechercher les disparus de la guerre, la France ayant émis une liste de civils et de militaires qui avaient disparus pendant le conflit.
55 BEN AHMED Mohammed, op. cit. 56 PERRET Françoise, BUGNION François, op.cit., p. 312 57 Idem, p. 321
Page 19 sur 23
En effet, l’une des missions essentielles du CICR est de répondre à l’attente et l’anxiété des familles qui attendent la moindre nouvelle de personnes disparues, civiles ou militaires, à un moment ou un autre du conflit.
Les recherches effectuées, dans les lieux de détention et par des appels à la radio, ne remportent aucun succès. De même, les démarches en faveur des harkis n’aboutissent pas. En effet, aux yeux des nouvelles autorités algériennes, l’affaire des harkis est une affaire interne purement algérienne dont le CICR n’a pas à s’occuper.
Page 20 sur 23
4. CONCLUSION
Par son action en Algérie, le CICR a totalement innové. L’organisation est ainsi parvenue à s’infiltrer là où personne n’a jamais réussi à aller avant elle : dans la politique interne d’un Etat. En effet, même s’il s’agit d’un conflit lié à la décolonisation, à l’époque, cela ne l’est pas – en tout cas dans les consciences occidentales. Le gouvernement n’accepte pas le terme de « conflit » mais préfère utiliser celui de « trouble » pour qualifier la situation algérienne, rendant ainsi la situation juridiquement encore plus complexe pour le CICR.
Dès lors, malgré ses limites, l’action du CICR pendant la guerre d’Algérie constitue un réel précédent pour l’institution. Elle est parvenue à faire appliquer dans un conflit interne certaines règles des conventions de Genève jusque là limitée aux conflits internationaux. L’organisation a basée toute son action sur l’article 3 commun aux Conventions de Genève alors qu’on sait que les conditions d’application de cet article sont très strictes. Elle a su jouer de son talent et de sa reconnaissance pour faire accepter ses principes. L’expérience algérienne a été déterminante à une époque où se multiplient les guerres asymétriques liées au processus de décolonisation et à la guerre froide. En effet, les protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 intégreront le résultat obtenu sur le terrain en Algérie, le conflit étant devenu vingt ans plus tard un système de référence.
Le CICR est parvenu à sensiblement intervenir sur les conditions de détentions et l’utilisation de méthodes de tortures, principalement au niveau de la France. Il a aussi pu faire évoluer le débat à cet égard dans la société et en devenir le canalisateur de référence.
Cependant, les raisons de non-possibilité d’intervenir dans les lieux de détention en Algérie n’a jamais pu être vérifié et l’action n’a pu être cantonnée qu’aux prisonniers détenus dans les pays voisins. Aussi, le CICR a échoué dans la protection des harkis après la survenue des accords d’Evian. De trop peu nombreuses améliorations sont visibles au sein d’une partie de la société algérienne en ce qui concerne ces derniers, ils continuent d’être parfois aujourd’hui encore ostracisés. La France a récemment reconnu son implication dans l’abandon des harkis et le drame les concernant qui a suivi la fin de la guerre, permettant ainsi l’émergence d’un processus de réconciliation avec le peuple français, et dans une moindre mesure, algérien.
Aujourd’hui, le CICR est toujours présent en Algérie où il effectue des visites dans les centres de détention et remet des rapports aux autorités gouvernementales sur, le cas échéant, les points à améliorer. De plus, il participe au renforcement du Croissant-Rouge algérien dans ses différentes actions, principalement dans les domaines des premiers secours et de la recherche des familles. Il est à noter que l’Algérie a effectué de grandes avancées en ce qui concerne la prise en compte du droit international humanitaire dans la législation nationale, dans la formation des forces de sécurité ainsi que la diffusion de ce droit comme universel.
Page 21 sur 23
5. BIBLIOGRAPHIE
5.1. OUVRAGES
• SIMON Jacques, Algérie : l’abandon sans la défaite, 1958-1962, Paris : L’Harmattan, 2009, 279 p.
• LAVISSE Ernest, CASALI Dimitri, Histoire de France de la Gaule à nos jours, Paris : Armand Colin, 2013, 247 p.
5.2. ARTICLES SCIENTIFIQUES
• MÉDARD Frédéric, « Les débuts de la guerre d’Algérie : errements et contradictions d’un engagement », Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. IV, n°240, p. 81-100.
• PERRET Françoise, « L’action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre d’Algérie (1954 – 1962) », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Avril 2010, vol. LXXXVI, n°856, p. 917-951.
• FRANK Robert, PAS Niek, THÉNAULT Sylvie, CONNELLY Matthew, « L’arme secrète du FLN. Comment De Gaulle a perdu la guerre d’Algérie, de Matthew Connelly », Monde(s), 2012, vol. I, n°1, p. 159-174.
• NOUSCHI André, « De Gaulle et la fin de la guerre d’Algérie », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013, vol. III, n°251, p. 163-170.
• THÉNAULT Sylvie, « “L’OAS à Alger en 1962“ Histoire d’une violence terroriste et de ses agents », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008, vol. LXIII, n°5, p. 977-1001.
• VALETTE Jacques, « Le bombardement de Sakiet Sidi Youssef en 1958 et la complexité de la guerre d’Algérie », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2009, vol. I, n°233, p. 37-52.
• BRANCHE Raphaëlle, « Entre droit humanitaire et intérêts politiques : les missions algériennes du CICR », La Revue historique, 1999, vol. II, n°609, p. 101-125.
5.3. ARTICLES NON-SCIENTIFIQUES
• Les départements d’Algérie, http://splaf.free.fr/algerie.html, dernière consultation le 14 juin 2014.
• Guerre d’Algérie (1954 – 1962), Paris : Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Algérie/104808, dernière consultation le 14 juin 2014.
• HARBI Mohammed, La guerre d’Algérie commence à Sétif, Paris : Le Monde Diplomatique, publié en mai 2005, http://www.monde-diplomatique.fr/2005/05/HARBI/12191, dernière consultation le 14 juin 2014.
• HERREMAN Philippe, Le « gouvernement provisoire de la République algérienne » dix mois après sa constitution, Paris : Le Monde Diplomatique, publié en juillet 1959, http://www.monde-diplomatique.fr/1959/07/HERREMAN/23128, dernière consultation le 15 juin 2014.
• SAVÈS Joseph, 1er novembre 1954 : « Toussaint rouge » en Algérie, Paris : Herodote.net, http://www.herodote.net/1er_novembre_1954-evenement-19541101.php, dernière consultation le 14 juin 2014.
Page 22 sur 23
• SAVÈS Joseph, La guerre d’indépendance, Paris : Herodote.net, http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=1774&ID_dossier=9, dernière consultation le 15 juin 2014.
• 7 janvier 1957 – Début de la bataille d’Alger, Paris : Herodote.net, http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19570107&get_all=1#reac, dernière consultation le 15 juin 2014.
• FOLSCH Arnaud, Guerre d’Algérie : les derniers secrets, Alger : Bab el Oued Story, http://babelouedstory.com/thema_les/disparus/2053/2053.html, dernière consultation le 15 juin 2014.
• Qui étaient-ils ?, Exode 1962, publié le 10 septembre 2010, http://exode1962.fr/exode1962/qui-etaient-ils/qui-etaient-ils.html, dernière consultation le 16 juin 2014.
• AFP, Sarkozy reconnaît la responsabilité de la France dans l’abandon des harkis, Paris : France 24, publié le 14 avril 2012, http://www.france24.com/fr/20120414-nicolas-sarkozy-responsabilite-historique-france-abandon-harkis-guerre-algerie-histoire/, dernière consultation le 16 juin 2014.
• Harkis… Les oubliés, Paris : France 24, http://webdoc.france24.com/harkis-les-oublies/, dernière consultation le 16 juin 2014.
• Le CICR en Algérie, Genève : CICR, publié le 30 mai 2013, http://www.icrc.org/fre/where-we-work/africa/algeria/overview-algeria.htm#, dernière consultation le 16 juin 2014.
• BEN AHMED Mohammed, Guerre d’Algérie : mémoires d’un délégué du CICR, Genève : CICR, publié le 19 mai 2011, http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/algeria-history-al-insani-2011-04-01.htm, dernière consultation le 17 juin 2014.
• HAROUEL-BURELOUP Véronique, L’action du CICR lors de la guerre d’Algérie, Paris : Grotius International, publié le 2 octobre 2010, http://www.grotius.fr/laction-du-cicr-lors-de-la-guerre-dalgerie/, dernière consultation le 17 juin 2014.
5.4. RAPPORTS ET ETUDES
• YACONO Xavier, Résultats statistiques du dénombrement de la population effectué le 31 octobre 1948, Alger : Service de statistique générale, 1953, 3 volumes, 394 p.
5.5. MEMOIRES ET THESES
• WONG Naiad N., Frayed Memories and Incomplete Identities: The Impact of The Algerian War on The Pieds Noirs, Algerian Women and The Algerian State, Thesis submitted to the graduate division of the Master of Arts in History, Hilo : University of Hawai’i, May 2005, 133 p.
5.6. TEXTES DE LOI
• « Accord de cessez-le-feu en Algérie », Journal officiel de la République française, 20 mars 1962, p. 3019-3032.
Page 23 sur 23
5.7. DOCUMENTS OFFICIELS
• Mémorandum du CICR, Genève : Comité International de la Croix-Rouge, 28 mai 1958.
• Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève : CICR, 1986.
5.8. SYLLABUS • LIÉGEOIS Michel, Géopolitique de l’action humanitaire, Notes de cours,
Louvain-La-Neuve : Université Catholique de Louvain, 2013, 49 p. • SANTANDER Sébastian, Introduction aux relations internationales, Notes de
cours, Sart-Tilman : Université de Liège, 2010, 72 p.
5.9. DOCUMENTS VIDEOS
• MASSU Jacques (Général), Bataille d’Alger : Massu parle, Genève : TSR, « Temps Présent », 4 novembre 1971.
• JEANENNOT Edwige, MARBEAU Lucile, JOLI Frédéric, 1954-1962 : Le CICR et la guerre d’Algérie, Paris : Délégation du CICR en France, « Une Histoire d’Humanité », n°11, 2013.