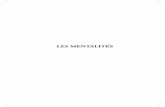Les relations islamo-chrétiennes au miroir de la caricature religieuse en Indonésie
Les croix de la ville de Bucarest. Problèmes de sociologie religieuse
-
Upload
socio-comunicare -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les croix de la ville de Bucarest. Problèmes de sociologie religieuse
A N N A L E SA N N A L E SA N N A L E SA N N A L E S U N I V E R S I T A T I SU N I V E R S I T A T I SU N I V E R S I T A T I SU N I V E R S I T A T I S
A P U L E N S I SA P U L E N S I SA P U L E N S I SA P U L E N S I S
SERIES HISTORICASERIES HISTORICASERIES HISTORICASERIES HISTORICA
Special IssueSpecial IssueSpecial IssueSpecial Issue
Dying and Death in Dying and Death in Dying and Death in Dying and Death in 18181818thththth----21212121stststst Century Europe Century Europe Century Europe Century Europe International Conference, Third Edition, Alba Iulia, Romania,
September 3-5, 2010
Editura Accent Cluj-Napoca
2010
National AuthoritNational AuthoritNational AuthoritNational Authority of Scientific Research, ANCS y of Scientific Research, ANCS y of Scientific Research, ANCS y of Scientific Research, ANCS –––– Romania Romania Romania Romania granted some of the funds for editing these papers through the programme: AcAcAcAcţiuni suport:ţiuni suport:ţiuni suport:ţiuni suport: m m m manifestări ştiinţificeanifestări ştiinţificeanifestări ştiinţificeanifestări ştiinţifice – Dying and Death in Dying and Death in Dying and Death in Dying and Death in the the the the 18181818thththth----21212121stststst CenturyCenturyCenturyCentury Europe: Refiguring Death Rites in Europe: Refiguring Death Rites in Europe: Refiguring Death Rites in Europe: Refiguring Death Rites in EuropeEuropeEuropeEurope, contract no. 104/26.07.2010, program manager Marius Rotar, PhD.
These papers also were edited by the support of Alba CountyAlba CountyAlba CountyAlba County Direction Direction Direction Direction for for for for CultureCultureCultureCulture and National Heritage and National Heritage and National Heritage and National Heritage, and The Centre for Thanatology, Radboud The Centre for Thanatology, Radboud The Centre for Thanatology, Radboud The Centre for Thanatology, Radboud University of NijmegenUniversity of NijmegenUniversity of NijmegenUniversity of Nijmegen (T(T(T(The Netherlandshe Netherlandshe Netherlandshe Netherlands)))). COLEGIUL EDITORIALCOLEGIUL EDITORIALCOLEGIUL EDITORIALCOLEGIUL EDITORIAL
Barbara Deppert-Lippitz (Deutsches Archäologisches Institut Frankfurt am Main)
Radu Ardevan (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca)
Florin Draşovean (Muzeul Banatului, Timişoara)
Eva Mârza (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia)
Keith Hitchins (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Ernst Christoph Suttner (Universität Wien)
Acad. Alexandru Zub (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi)
COLEGIUL DE REDACŢIECOLEGIUL DE REDACŢIECOLEGIUL DE REDACŢIECOLEGIUL DE REDACŢIE
Iacob Mârza (redactor şef) Marius Rotar, Eric Venbrux, Marina Sozzi, Victor-Tudor Roşu (redactori responsabili) Ileana Burnichioiu, Daniel Dumitran, Mihai Gligor, Valer Moga Sorin Arhire (secretar de redacţie) Cosmin Popa-Gorjanu (webmaster) On the first coverOn the first coverOn the first coverOn the first cover: Enrique Simonet Lombardo, Anatomia del corazón, 1890
Copyright © 2010, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Str. N. Iorga, nr. 11-13 Tel.: +40-258-811412; Fax: +40-258-806260
E-mail: [email protected] Web: http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/auash_prezentare.html
ISSN 1453-9314
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2010, p. 387-411
LES CROIX DE LA VILLE DE BUCAREST. PROBLÈMES DE SOCIOLOGIE RELIGIEUSE
IRINA STAHL
Introduction Dans les années qui ont suivi les événements de 1989, nous avons pu
assister en Roumanie à un retour aux valeurs traditionnelles, et notamment religieuses. Réduite au silence pendant presque cinquante ans par le régime communiste, la religion refaite surface et rentre dans l’espace public. A Bucarest, la capitale du pays, les clochers des églises sonnent à nouveau, les prêtres et les hauts dignitaires religieux reviennent au centre de la vie sociale et politique, les fêtes religieuses sont à nouveau ouvertement célébrées, les pèlerinages sont repris. Après des années d’interdiction, les constructions d’églises sont relancées. On voit leurs silhouettes apparaître un peu partout. Dans les quartiers d’habitations au visage terni qui entoure le centre, mais également auprès des hôpitaux et, chose impensable quelques années auparavant, auprès des unités militaires. En attendant le début des travaux, des grandes croix marquent le futur emplacement des autels.
Dans une société encore bouleversée par les récents événements politiques qu’elle n’arrive pas encore tout a fait à expliquer, un sujet sensible reste celui des victimes. Montrer sa compassion envers ceux-ci devient vite un devoir pour tous les acteurs politiques qui veulent s’attirer la sympathie de la population. Et quel meilleur moyen de le faire que par le biais de la foi ? Peu à peu la ville tout entière est submergée par une multitude des croix, et pour cause : les associations des victimes de la révolution du 1989 érigent des croix à la mémoire de ceux qui y ont trouvé la mort. De leur coté, les officiels locaux, érigent des monuments et des statues plus ou moins abstrait, ayant le même leitmotiv de la croix. Chaque unité militaire ayant enregistré des pertes parmi ses soldats érige son propre monument à la mémoire des « héros de la Révolution ». À l’exception des noms qui y figurent, leur aspect est quasiment identique. Au sein des paroisses, grand nombre d’églises érigent elles-aussi des croix à la mémoire des héros, de ’89 ou autres. A chaque anniversaire, on assiste en directe ou par les biais des médias, au déroulement des cérémonies commémoratives pendant lesquels ces monuments sont bénis et submergés de gerbes de fleurs et de bougies.
C’est dans ce contexte que, parallèlement aux autres, des monuments plus discrets, font leur apparition dans l’espace public. Des petits croix bricolées, dans la grand majorité en fer, érigées par les familles des victimes, à l’endroit
IRINA STAHL
388
précis où leurs proches ont trouvé la mort, passent presque inaperçues auprès des passants. On les retrouve dans les endroits où ont eus lieu des confrontations, au centre-ville mais aussi bien à l’Ouest, groupées auprès de l’ancien siège du Ministère de la Défense Nationale.
Au fils des années le nombre de ces monuments public à caractère personnel n’a cessé de croître. A ceux dédiées aux morts de ’89 se sont vite ajouté d’autres, érigées aux noms des autres morts qui sont partis d’une manière précipitée et inattendue. Tous marquent l’endroit approximatif où l’âme a quitté le corps.
Dans les lignes qui suivent, je me propose de regarder de plus près ce phénomène qui, depuis les vingt dernières années, a pris une ampleur considérable, tout en apportant des explications possibles. Dans ce but, entre 2000 et 2010, j’ai répertorié un nombre de 204 monuments, dans leur grande majorité des croix,1 j’ai interrogé les personnes qui les ont érigées, des prêtres qui les ont bénies, mais aussi d’autres habitants de la ville. Le travail est loin d’être terminé, car la complexité du sujet et ses multiples implications exigent des travaux supplémentaires. C’est pourquoi dans la présente étude je me contenterai de tracer quelques lignes générales de ce phénomène peu connu et étudié jusqu’à présent, tout en apportant mes propres explications et hypothèses qui seront confirmées par la suite.
Les croix de la ville Dans leur grande majorité, les croix dont il est question se retrouvent
dans la proximité d’une route (fait pour lequel on pourrait aussi bien les appeler des croix routières). L’association des deux, croix et route, est vite devenue signe d’accident de la circulation, à tel point, que depuis quelques années elle est une des images fortes choisies par la Police routière dans ses campagnes de prévention.2 Mais, malgré le fait que grand nombre des victimes soit réellement dues aux accidents de la route, il faut tout de même insister sur le fait que ce n’est pas toujours le cas. On y rencontre des victimes d’accidents de voies ferrées, d’infarctus ou autre mort subite due à une maladie, de chutes, d’électrocutions, d’agressions ou de suicides et bien-entendu, des victimes d’événements politiques (de 1989, lors du changement du régime et même de 1991, lors des affrontements entre les miniers et la population de la ville) ; la proximité de la route peut pour cela être recherchée aussi ailleurs. Car la route est un lieu de passage et de haute fréquentation où la mort peut frapper à tout moment. En même temps, la proximité de la route assure une bonne visibilité, faisant en sorte que les textes qui y sont inscrits soient accessibles au plus grand
1 Des 204 exemplaires, 200 sont des croix, 3 sont des plaques et 1 est un simple réverbère. 2 Voir http://bpr.b.politiaromana.ro/index.php/educatie-rutiera.html, accessed on 23 May 2010.
Les croix de la ville de Bucarest
389
nombre de personnes. La douleur ressentie par les proches des disparus peut ainsi être transmise aux autres, dont la compassion, même si anonyme, apporte du soulagement et du réconfort. Ce n’est pas rare de voir des gens s’arrêtant devant une croix, le temps de lire ce qu’il y est inscrit, et de faire le signe de la croix, tout en ajoutant quelques mots en guise de prière pour l’âme du disparu, avant de reprendre aussitôt la route.
A présent, Bucarest tout entière est parsemée de croix. Il faut juste regarder d’un oeil attentif autour de soi pour les voir. Elle existe aussi bien auprès des grands boulevards, que des plus petites ruelles, ou même des sentiers qui traversent les terrains vagues ; au plein centre-ville, comme aussi dans les quartiers périphériques ; au bord de la Dâmboviţa, la rivière qui traverse la ville de l’Ouest à l’Est ; au long de la voie du tramway ou celui du train, dans la Gare centrale ; dans les parcs ou tout près des lieux destinés aux enfants ; devant l’entrée des maisons et des immeubles, jusqu’à au-dessus des fenêtres. Il n’y a aucune restriction concernant leur emplacement car elles marquent l’endroit où la mort est arrivée précipitamment, donc par hasard.
Le phénomène prend de l’ampleur d’autant plus que la législation actuelle ne prévoit pas des sanctions ou de restrictions concernant cette pratique. Les autorités locales, interrogées, reconnaissent qu’il n’existe pas d’interdiction formelle à cette pratique, mais elles essaient tout de même de dissuader les gens de le faire, pour « ne pas transformer la ville toute entière en un grand cimetière ». L’avis de la population à cet égard est partagé. Il y a ceux qui les trouvent de mauvaise augure et même sinistre et ceux qui se montrent plus compréhensifs à l’encontre de ces pratiques religieuses et de la douleur des familles. D’une manière générale personne n’ose les toucher car il serai păcat, mot qui en roumain signifie à la fois « dommage » et « péché ». J’ai souvent été témoin de l’enlèvement temporaire de ces croix pour cause de travaux de voirie et j’ai pu constater à plusieurs reprises comment, une fois les travaux finis, les croix ont soigneusement été remises à leur emplacement initial par les ouvriers.
L’aspect des croix Dans la grande majorité des cas, les croix en question sont fabriquées par
des artisans spécialisés dans la création d’objets funèbres. C’est la raison pour laquelle on peut aisément remarquer une évidente similitude avec les croix que l’on retrouve dans les cimetières de la ville. En suivant l’évolution des formes dans le temps, on peut constater une plus grande diversité de formes chez les croix les plus anciennes. Plus on se rapproche du présent, plus les croix commencent à se ressembler et, chose relativement récente, à augmenter en hauteur. Dans les années 2000, on passe de petites croix discrètes de 50 à 60 cm de hauteur en moyenne, à des croix d’un mètre, voir plus.
IRINA STAHL
390
Croix située à la périphérie de l’est de la capitale, dans un des quartiers résidentiels (Photo : Irina
Stahl – 5 mai 2001) La plupart d’entre elles (195 cas) sont
confectionnées en métal, la matière la moins chère du marché. Le marbre et la pierre restent marginaux. Je ne les ai rencontrés qu’à cinq exemplaires, et elles mesurent jusqu’à 1,70 mètres de hauteur.3
Les matériaux utilisés dans la fabrication de ces monuments montrent clairement le désir de le faire perdurer dans le temps, tout le contraire par rapport aux signes éphémères, comme c’est le cas des bougies, des fleurs, des gerbes et autres objets mis sur le lieu d’un drame. C’est pourquoi on les soigne, on les peint (d’habitude en noir), et parfois on les remplace par d’autres, plus grandes, plus belles, plus durables.
On trouve souvent les croix simplement fichées dans la terre ou dans le bitume du trottoir ; auprès des arbres ou des poteaux d’éclairage public ou même fixés à ceux-ci ; appuyées sur des clôtures ou des murs. Un nombre considérable (73 cas) bénéficient d’un espace clôturé qui les protège et en même temps délimite les lieux. Dans ces cas précis, leur aspect se rapproche d’autant plus des lieux de repos des cimetières.
Toujours comme pour les croix de cimetière, des fleurs sont souvent destinées à orner les croix qu’on trouve dans la ville. On y met des fleurs en plastique ou des immortelles, mais aussi des fleurs naturelles et même des fleurs plantées dans le sol ou en pots, qui en été transforment les lieux en de vrais jardins. La décoration des croix se fait particulièrement remarquer pendant les fêtes, surtout à l’occasion des Pâques et de Noël. Année après année, je vois à Noël les mêmes croix ornées de couronnes ou de branches de sapin décorées de globes de verre, de fils colorés et de bonbons.
L’endroit marqué par les croix est un lieu de recueillement et de prière pour la famille et les proches du disparu. On y vient pour allumer des bougies et brûler de l’encens, tout en priant pour son âme. C’est la raison pour laquelle il n’est pas rare de trouver au pied des croix des réverbères, tout comme dans les cimetières.
3 Quant aux exceptions, les trois plaques sont fabriquées en marbre et le réverbère en métal.
Les croix de la ville de Bucarest
391
Pour qui sont érigées les croix ? A quelques exceptions près, dues surtout à la détérioration dans le
temps, les croix portent inscrites sur elles le nom et le prénom des disparus, leur date de naissance et celui de leur mort. Parfois on y rajoute des précisions (le lieu d’origine, le surnom, la cause de la mort etc.) ou des photos dans lesquelles des jeunes gens, parfois des enfants, sourient aux passants ; certains posent fièrement devant les engins qui leur ont coûté la vie. Moins souvent on inscrit des textes, plus ou moins longs, parfois même des poèmes. A travers eux, on entrevoit les personnes qui ont érigé les croix. Ces sont les parents, les époux, les enfants, les amis ou bien les collègues des disparus. Ils laissent ainsi échapper la douleur qu’ils ressentent, en s’adressant directement au défunt, ou bien aux passants. Quelques-uns sont même écrits comme de la part du défunt lui-même. Voici quelques exemples :
« Parmi les anges tu t’es envolé/ Oh, enfant tant aimé/ Nous ne pouvons que pleurer/ L’âme ternie et endeuillée. » « Peut-être que dans les cieux, dans un autre monde, nous nous reverrons. Ni la mort, ni la séparation, ni l’oubli, ne pourront effacer l’amour pour toi caché dans nos âmes. » « Ici est tombé sous les balles terroristes pendant la révolution de décembre 1989, notre héros… » « Près du trottoir tu as fini ta vie, mettant au monde ton si attendu enfant, par une césarienne effectuée trente minutes après ton décès inattendu. Tu es morte sur le trottoir, échappant ainsi aux mains de ton insensible mari qui ne s’est pas précipité pour t’amener à l’hôpital; et ton père, qui était parti à l’enterrement de ton grand-père, n’a pas pu te sauver. ». « Passager arrête-toi/ Et un peu regarde-moi/ Moi aussi je fus une fois/ Corps et âme semblable à toi/ Mais la mort est sans pitié/ D’un seul coup m’a enlevée,/ Et d’un groupe de forts jeunes hommes/ Je demeure tout seul ici. » « Sur cette croix froide/ Un nom à peine gravé/ Laissé comme souvenir/ Voudrait arrêter/ Pour un instant ton regard. »
Les six croix sur lesquelles figurent plus d’un nom sont des cas particuliers. Car elles sont dédiées à plusieurs personnes mortes en même temps, comme c’est parfois le cas dans les accidents de la route. Sur une croix en particulière, figure sept noms.
Les informations sommaires concernant les victimes sont loin d’être anodines. Tout le contraire, elles offrent bien des indices sur l’ensemble du phénomène. Voilà pourquoi on se propose de les regarder de plus près.
Selon les dates dont on dispose,4 des 204 croix, la grande majorité, soit 156 exemplaires, sont dédiées à des hommes (Fig. 1). Uniquement 43
4 Dans les statistiques qui suivent il faut tenir compte du fait que les données dont on dispose sont
IRINA STAHL
392
exemplaires sont dédiés à des femmes. Pour 19 d’entre elles l’information manque. Une explication possible consiste dans le fait que la cause de la mort la plus fréquente chez les victimes est due aux accidents de la route qui, on le sait, touche chaque année plus d’hommes que de femmes. Il est donc évident que ce fait a lourdement pesé sur les chiffres.
Fig. 1. Le nombre des personnes pour lesquelles
on a érigé des croix, selon leur genre
En ce qui concerne l’âge des disparus, on constate que le plus jeune a à peine 2 ans, tandis que le plus âgé en a 91 ans. Les plus nombreux (48 cas) sont des jeunes gens compris entre 20 et 29 ans (Fig. 2); suit le groupe d’âge compris entre 10 et 19 ans (avec 36 cas). Ce sont eux qui sont les plus exposés aux accidents mortels produits par de la violence, (comme c’est le cas pour les accidents de la route, les noyades, les chutes, les suicides, les évènements politiques, etc.).
Fig. 2. Le nombre des personnes pour lesquelles
on a érigé des croix selon leur âge
En ajoutant le genre à l’âge des disparus (Fig. 3) on constate que la catégorie des personnes pour lesquelles on érige les plus souvent des croix à Bucarest est formée par des hommes, compris entre 20 et 29 ans (41 cas).
parfois partielles ou même manquent, dû au passage du temps qui rendent parfois indéchiffrables les textes.
Les croix de la ville de Bucarest
393
Fig. 3. Le nombre des personnes pour lesquelles on a érigé des croix selon leur genre et leur âge
Depuis quand datent les croix ? La propagation rapide des croix à Bucarest après la chute du
communisme est aujourd’hui une évidence. La question qui se pose est cependant si cette pratique existait réellement aussi bien avant cela. Malgré l’interdiction officielle de toutes manifestations « visibles » de la religion, le régime n’a jamais vraiment réussi à mettre fin aux pratiques religieuses. Celles-ci continuèrent à être pratiquées, d’une manière plus discrète, loin des yeux des autorités du parti.
À l’exception de quelques exemples que j’ai pu suivre depuis leur installation, je ne dispose pas des informations exactes concernant la date de la mise en place des croix. Cependant, cette information peut facilement être apprise, en sachant que selon la coutume la croix qui marque l’endroit où quelqu’un a rendu l’âme s’installe l’année qui suit le décès. Tenant compte de ce fait j’ai utilisé l’année du décès de la victime comme indicateur de la date supposé d’installation de la croix (Fig. 4). C’est ainsi que j’ai pu constater que la croix censée être la plus ancienne parmi celles répertoriées date de 1974. Plus loin encore, 15 croix semblent dater des années précédant 1989, nombre tout de même considérable étant donné les interdictions de l’époque et la péremption naturelle due au passage du temps.
IRINA STAHL
394
Fig. 4. Le nombre des croix, selon l’année du décès des victimes Pour la période d’après 1989, les années qui ont connu le plus grand
nombre des croix sont censées être 1997 et 1999, avec 13 exemplaires chacun. Suivent de près 1994, 1998 et 2000, avec 11 exemplaires. Simplifiant les choses, on remarque le fait que le plus grand nombre des croix semble avoir été érigées dans les années ’90, 95 des cas, soit presque la moitié des exemplaires recensés (Fig. 5). Dans les années 2000 on assiste à une légère baise, avec 70 cas.
Fig. 5. Le nombre des croix selon la période de la supposée érection Pour mieux comprendre ces chiffres revenons pour un instant au
contexte social plus large dont il a été question au début de cette étude.
Les croix de la ville de Bucarest
395
Selon World Values Survey,5 en Roumanie la pratique religieuse a connu une évolution ascendante constante dans les dernières années. La fréquentation de l’église passe de 30% en 1993, à 48% en 2008. Plus encore, si en 1993, la fréquentation de l’église était plus élevée dans le milieu rural que dans le milieu urbain, en 2008 on assiste à une égalisation de la fréquentation de l’Eglise dans les deux milieux de résidence. En 2005, la Roumanie se situe en troisième position en Europe, après la Pologne et l’Italie, en ce qui concerne la fréquentation de l’église. Elle est à présent le pays orthodoxe avec la pratique religieuse la plus élevée de l’Europe. En ce qui concerne la croyance, elle connaît la même tendance ascendante. Le même sondage enregistre un saut considérable entre 1993 et 1999, date après laquelle on assiste à une relative stabilisation. En 2005, à la question « Quelle importance accordez-vous à Dieu dans votre vie ? », la Roumanie occupait la première position en Europe, avec des réponses indiquant une moyenne de 9.2 sur une échelle de 10.
L’essor considérable pris par la croyance religieuse des Roumains dans les années ’90 offre une bonne explication au grand nombre de croix mises en place dans ces années. Le fait est confirmé par la relative stabilité enregistrée par la suite dans les années 2000.
L’emplacement des croix dans la ville En regardant la distribution des croix dans l’espace de la ville, plusieurs
aspects attirent l’attention (Fig. 6). Pour le début, on se rend compte de l’ampleur du phénomène, qui s’est répandu partout. Par la suite, on constate l’alignement des croix au long des routes et surtout, par endroit, leur regroupement en grappe, les unes à coté des autres, dans un espace relativement restreint. Et finalement, un aspect plus inattendu : la concentration des croix dans la partie Ouest de la ville.
Evidemment, la question qui se pose est : Pourquoi cette distribution des croix dans l’espace ? A quoi est-elle due ? Les réponses que je propose ne sont pour l’instant que des hypothèses de travail, qui restent à être confirmées par la suite de la recherche. Mais, avant de les énoncer, voici quelle a été la succession des raisonnements qui m’ont amené à les entrevoir.
L’alignement des croix au long des routes m’a poussé, dans un premier temps, à vérifier s’il y a réellement une corrélation entre ce phénomène et les accidents mortels de la route. Voilà pourquoi j’ai inscrit sur le plan représentant la distribution des croix, les dix artères les plus meurtrières de la ville en termes d’accidents (Fig. 7). La distribution dans l’espace des croix et des artères
5 Cité par Newsletter. Valorile românilor, 2, février 2009, publié par le Groupe pour l’étude des valeurs sociales, Institut de Recherche sur la Qualité de la Vie, Académie Roumaine, http://www.iccv.ro/valori. Voir aussi le 1, de décembre 2008.
IRINA STAHL
396
marquées ne correspond pas entièrement. Surtout à l’Est de la ville, au long de plusieurs routes considérées comme particulièrement dangereuses, les croix manquent complètement.
Pour m’assurer de la véracité du constat, j’ai par la suite comparé le nombre de croix, considérées selon l’année présumée de leur installation, avec le nombre des morts dues aux accidents de la route, enregistrés les mêmes années (Fig. 8 et 9). Ni ces chiffres ne correspondent pas.
Fig. 6. La répartition actuelle des croix dans l’espace de la ville de Bucarest
Les croix de la ville de Bucarest
397
Fig. 7. La répartition actuelle des croix dans l’espace de la ville de Bucarest, rapporté à l’emplacement des dix artères ayant enregistré le plus des accidents de la route entre
2005 et 2009 (Sources internes à la Police Routière de la Capitale)
IRINA STAHL
398
Fig. 8. Le nombre de croix, selon l’année du décès des victimes
Fig. 9. Le nombre des morts dus aux accidents de la route à Bucarest entre 1992
et 2005 (Source : Police Routière de la Capitale, http://bpr.b.politiaromana.ro/ Activitate_2005/Activitatea_BPR_2005_files/slide0044)
Une fois la piste des accidents de la route écartée, je me suis retournée
vers l’évolution dans le temps du phénomène, pour y trouver des réponses à mes questions.
En situant les plus anciennes des croix, celles érigées avant 1989, sur le plan de la ville, j’ai pu constater que la plupart sont situées à la périphérie de la ville, surtout à l’Ouest (Fig. 10). Leur emplacement est très probablement dû au fait que dans la périphérie, elles passaient mieux inaperçues face aux autorités communistes de la ville ; la proximité des villages environnants où l’on peut
Les croix de la ville de Bucarest
399
supposer que la population pouvait manifester sa religion plus ouvertement que dans la capitale a peut-être elle-aussi joué un rôle sur la question.
Les croix dédiées aux victimes des événements de 1989 sont par la suite venues s’ajouter (Fig. 11). Elles sont situées dans les endroits où ont eu lieu des affrontements, aussi bien au cœur de la ville, comme aussi à l’Ouest, où se trouvait à l’époque le Ministère de la Défense Nationale.
Pendant les années ’90, les croix envahissent progressivement toute la surface de la ville (Fig. 12), ayant tout de même une plus forte concentration toujours dans la partie ouest de la ville. Par endroit, les croix sont situées en grappe, s’entassant les unes à coté des autres.
Les années 2000 ne font que densifier la masse des croix déjà existante (Fig. 13). Des nouvelles grappes apparaissent, pendant que les anciennes ne cessent de grandir. La concentration des croix à l’Ouest paraît maintenant encore plus évidente.
Fig. 10. Croix érigées avant 1989
IRINA STAHL
400
Fig. 11. Aux croix érigées avant 1989, viennent s’ajouter celles dédiées aux victimes de 1989
Fig. 12. Aux croix érigées avant 1989 et à celles dédiées aux victimes de 1989, s’ajoute des nombreuses croix dans les années 1990
Les croix de la ville de Bucarest
401
Fig. 13. Les croix érigées dans les années 2000 s’ajoutent aux nombreuses croix déjà existantes dans la ville
Dans le but d’expliquer ces particularités, je propose deux
interprétations possibles : 1) Dans l’installation des croix le mimétisme joue un rôle important. La
proximité des autres croix semble encourager les gens qui viennent de perdre un proche au même endroit, d’en faire autant. Cette affirmation semble être confirmée par les quelques interviews que j’ai pu réaliser jusqu’à présent ;
2) La concentration des croix dans la partie Ouest de la ville pourrait aussi en partie être due à la relative proximité géographique avec la région de la Petite Valachie (Oltenia), particulièrement riche en croyances et pratiques religieuses relatives à la mort. C’est ici qu’on érige le plus des croix pour les morts, autres que celles des cimetières ou celles qui marquent l’endroit où quelqu’un a rendu l’âme.6
6 De nos jours encore, dans cette région, la coutume exige qu’on érige des croix aux mort dans plusieurs endroit du village : à coté des puits ou des fontaines, aux carrefours, au long des routes, mais aussi devant la maison habitée de son vivant par le disparu. A voir Sărbători şi Obiceiuri, vol. I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 233-234.
IRINA STAHL
402
Les deux hypothèses sont pertinentes, mais en même temps seront difficile à confirmer. Des interviews que j’ai l’intention de mener par la suite apporteront, je l’espère, des confirmations.
L’histoire d’Eliza et de Gabi J’ai rencontré Smaranda Dobrin en novembre 2006. Nous avons fait
connaissance dans une salle d’exposition toute vide, lors d’une journée dédiée aux accidentés de la route et organisée par l’Association « Larmes routières ». C’était une femme de 52 ans, toute habillée de noir, comme l’était aussi sa fille qui l’accompagnait. Sur son visage vieilli avant l’âge et ravagé par la douleur, les yeux fatigués laissaient de temps en temps s’écouler des larmes. Au début, mon questionnement l’a surpris, mais au bout d’un moment elle s’est laissée emporter par la douleur et a commencé à me raconter son histoire.
Originaire de Baloteşti, village situé à 25 km au nord de Bucarest, elle avait récemment perdu sa fille, Eliza, emportée une soirée de décembre 2005, par un stupide accident de voiture. Sa petite fille de onze ans, Gabi, entrée dans le coma suite à l’impact, était morte quatre jours plus tard, la veille de Noël, à l’hôpital. Madame Dobrin et le reste de ses filles ont voulu marquer l’endroit de l’accident par une croix car pour elles c’était l’endroit où elle les avait perdues, « où son âme est sortie du corps et s’en est allée ». En même temps la famille a aussi voulu faire un exemple, indiquant aux gens « ce que la vitesse peut faire », car l’auteur du drame, un jeune d’une vingtaine d’années, sans permis, roulait avec plus de 90 km à l’heure lors de l’accident. Sur la croix figurent les noms des deux victimes car, même si en réalité la petite Gabi est morte à l’hôpital, pour la famille endeuillée, elle était partie au même endroit que sa mère.
La croix a été achetée dans une échoppe d’objet funéraire, au même moment que le cercueil d’Eliza. Avant de l’installer, la famille s’était renseignée auprès de la mairie, pour voir s’il y avait des restrictions à ce sujet. Même s’ils n’ont pas reçu des interdictions formelles, on a tout de même essayé de les dissuader de prendre une telle initiative.
Depuis le drame, Smaranda Dobrin a pris ses habitudes. Deux à trois fois par semaine, elle se rend sur les tombes de sa fille et sa petite-fille, dans le cimetière de Baloteşti. Durant sa route (qui prend trois à cinq heures selon la circulation), elle s’attarde à la croix située au bord du boulevard Dorobanţi, juste en face d’un lycée prestigieux de la ville. A chaque fois elle prend soin d’apporter des fleurs pour y mettre tout autour, comme elle en a vu tant de fois auprès de la croix d’un jeune garçon, située un peu plus loin, à la sortie de la ville. Elle raconte avec amertume comment on ne cesse de les voler, mais aussi que parfois elle découvre sur les lieux des fleurs apportées par des simples inconnus.
Les croix de la ville de Bucarest
403
Six mois après les enterrements, un vendredi, la famille a achevé les tombeaux en mettant en place deux croix en marbre. Le lendemain, samedi, a eu lieu le service religieux fait pour les défunts, le parastas, lors duquel les croix ont été bénies par le prêtre. La croix mise sur le boulevard n’a pas encore été bénie, même si cela aurait du être le cas, tient à préciser Smaranda Dobrin, qui a tout de même pris le soin de l’asperger de la même eau bénite, qu’elle avait mis soigneusement de coté.
La forte relation qu’Eliza entretenait de son vivant avec sa mère et ses sœurs semble se prolonger bien au-delà de la mort par le biais des rêves ; ces rencontres semblent rythmer tous les rituels pratiqués pour les disparues.
Très peu après l’accident, Eliza est apparu dans un rêve à une de ses sœurs. Elle se trouvait au bord de la route où a eu lieu l’accident et l’appelait avec insistance de venir la chercher de là, car apparemment elle n’arrivait pas à le faire toute seule. Dès le lendemain matin, sa mère est allé sur les lieux et a entouré la croix à plusieurs reprises avec de l’encens fumant. Elle a répété le geste peu de temps après, juste au cas où une seule fois n’aurait pas été suffisant.
Avant d’acheter les croix pour le cimetière, Smaranda Dobrin a rêvé de sa petite fille. Elle semblait essayer de lui dire quelque chose, sans pour autant arriver à le faire. Pour l’encourager, sa gand-mère lui avait alors dit de réciter ce qu’elle avait à transmettre, comme s’il s’agissait d’un poème. Ainsi, la petite lui a récité le texte suivant, qui par la suite on lui a fait graver sur la tombe :
« La mort se montre à nous/ Comme le destin dans la vie/ Le destin des enfants/ Dans les yeux des parents. »
Après que les croix furent mises en place et le parastas fait, une des sœurs a rêvé d’Eliza qui était toute heureuse d’avoir déménagé dans une nouvelle maison, avec un jardin. « Et nous venons de lui avoir achevé le tombeau », rajouta à demi-voix Smaranda Dobrin. Dans un autre rêve, Eliza leur demande de lui apporter une poule, pour que la petite puisse avoir un animal avec lequel jouer dans le jardin. Apparemment, lors de l’enterrement de cette dernière, on n’a pas pu trouver une poule pour la faire passer au-dessous du cercueil avant de l’offrir.
La femme endeuillée m’a par la suite racontée comment elle a organisé les aumônes, les pomana, de sa fille et petite fille, 3 jours après l’enterrement, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois et à 9 mois, mais également à l’occasion de leurs anniversaires, du jour de leur saint patron, et les jours de la célébration des morts. La petite pomana elle le fait partager à l’église, aux pauvres gens, et parfois aux parents qui sont dans le besoin. Lors de la grande pomana de 6 mois, quand elle a invité des gens à la maison, elle a rhabillé de haut en bas une fille ayant la même âge que sa petite fille et qui était
IRINA STAHL
404
aussi sa meilleure amie. Elle a également donné aux autres enfants sa bicyclette, ses rollers et son traîneau. Pour le prochaine grande pomana, celui d’un an, elle envisage d’acheter tout ce qu’il le faut pour une maison : un lit, des chaises, une table, et de les donner par la suite à quelqu’un qui en a besoin. Malgré le fait que le prêtre lui a dit qu’il n’est pas nécessaire de faire toutes ces dépenses, et de donner plutôt quelque chose plus près de ses moyens, elle insiste car, « Comment pourrais-je ne pas les faire, après que ma fille me raconte qu’elle a déménagé dans une maison toute neuve ?! ».
La croix d’Eliza et de sa fille, Gabi,
située sur un des grands boulevards de la capitale, Calea Dorobanţilor (Photo: Irina
Stahl – 18 janvier 2007) Le troublant récit de Smaranda
Dobrin rappelle les pratiques religieuses qui se déroulent autour des croix, mais également les anciennes croyances liées à la mort et à l’au-delà. Car la mise en place des croix dont il est question dans la présente étude fait partie intégrante d’un ensemble complexe de pratiques et de croyances. Le soustraire à ce contexte serait les priver de leur essence. Voilà pourquoi je tiens à présenter quelques aspects de ce sujet, tout en me limitant aux plus importants en raison des contraintes dûes à l’espace limité de la publication.
Pratiques et croyances relatives aux croix Contrairement à ce qu’on pourrait croire, marquer l’endroit où
quelqu’un a trouvé la mort par une croix n’est pas une pratique enseignée par l’Église. Pourtant elle est considérée comme une preuve de piété, surtout si accompagnée par un office religieux. Celui-ci ne l’est pas toujours demandé, mais pour certains, bénir la croix et les lieux est un geste inclus dans les devoirs qu’on a envers le disparu. Habituellement c’est auprès du prêtre de la paroisse dans laquelle se trouve la croix, qu’on fait la demande d’officier sur place.
Les livres qui décrivent le déroulement des offices religieux7 ne mentionnent rien à ce sujet, laissant aux prêtres la liberté d’agir comme bon leur
7 Molitfelnic, cuprinzând slujbe, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferite împrejurări din
Les croix de la ville de Bucarest
405
semblent. Ceux que j’ai pu interroger affirment qu’à de telles occasions ils pratiquent le même office que lors des enterrements, mais d’une manière abrégée (sans le requiem de la fin). L’office débute par des prières destinées au repos de l’âme du disparu et finit par une prière consacrée à la croix mise en place. Tout comme la croix érigée auprès du tombeau, celle-ci est supposée éloigner « tous les ennemis visibles ou invisibles, les agissements et tentations du diable », tout en constituant « une aide et un soutien dans la foi des croyants ». On invoque Dieu pour protéger tous ceux qui prieront devant elle, particulièrement ceux qui l’ont érigée par amour pour leur disparu, tout en leur accordant sa grâce.8
Pendant l’office, on brûle de l’encens et on asperge la croix et l’endroit tout autour d’eau bénite (aghiazmă).9 Ce geste les imprègne d’un caractère tout particulier qui justifierait, selon les prêtres, la présence des clôtures qui les entourent. Aussi grandes que celles qui entourent les tombes, par endroit, les clôtures sont censées protéger les lieux et la croix qui ont été bénis, contre touts endommagements et impuretés qui pourraient parvenir à les souiller par la suite.
Durant la cérémonie, on apporte des bougies qu’on allume, des petits pains bénis (prescure) et le gâteau traditionnel des morts, la colivă.10 La dernière est élevée au-dessus de l’endroit (comme auparavant au-dessus du tombeau), pendant que les participants à la cérémonie, guidés par le prêtre, la soutiennent et la balancent ; une prière spécifique est récitée et à la fin on l’asperge de vin rouge, le sang du Christ. La cérémonie peut se répéter aux dates auxquelles on commémore les morts.
Comme on a pu le constater à maintes reprises, il y a des fortes ressemblances entre les croix de la ville et celles des cimetières. Leurs apparences comme aussi les pratiques qui se déroulent auprès d’elles sont presque identiques. La seule différence qui subsiste concerne le fait que les premières marquent l’endroit où le corps a été quitté par son âme, pendant que les dernières marquent l’endroit ou le corps inanimé repose, en attenant le
viaţa creştinilor (III éd.), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1975; Tipic bisericesc cuprinzând rânduiala celor şapte laude, a sfintei liturghii, a sfintelor taine şi a ierurgiilor mai de seamă, precum şi alte îndrumări liturgice..., Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1976 ; Aghiasmatar, cuprinzând slujbe, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferite trebuinţe din viaţa creştinilor, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1984. 8 Molitfelnic, p. 281-283. Voir aussi p. 487-490. Aghiasmatar, p. 324-326. 9 C’est l’eau qui est bénie à l’occasion de la fête de l’Epiphanie. 10 Le gâteau est composé des grains de blé bouillis, sucrées et laissées pendant un certain temps à gonfler, auxquelles on ajoute des noix.
IRINA STAHL
406
retour de son âme, au moment de la Résurrection ; d’une part l’endroit où c’est produit le départ de l’âme et de l’autre, celui où se produira son retour ; l’endroit où une vie a pris fin sur terre et celui où se produira l’arrivée de la vie éternelle. Les deux lieux sont donc chargés d’une signification toute particulière, raison pour laquelle, on va le voir par la suite, l’âme qui y est liée viendra les visiter pendant ses pérégrinations sur terre.
Vers la fin du XIXe siècle, Simion Florea Marian, prêtre passionné de folklore, recueille les croyances et les pratiques des Roumains de toutes les régions. Selon lui, conformément à une coutume largement répandue, lorsque quelqu’un attire le malheur sur lui (s-a nenorocit), c’est-à-dire décède de manière inattendue, souvent par une mort violente,11 ces proches parents ou amis lui érigent une croix en bois ou en pierre à l’endroit où cela s’était produit. Le lieu est considéré comme impur (ce qui expliquerait l’arrivée du malheur), et si une croix n’est pas érigée à cet endroit précis, il continuera de l’être et le mort pourra nuire aux passants, surtout pendant la nuit, car l’âme des morts sans une bougie allumée erre longtemps dans ce monde avant de trouver la paix.12 En effet, mourir de cette façon est une chose terrible et tous ceux frappés par ce malheur sont profondément plaints par la communauté. Car la lumière écarte les mauvais esprits qui puissent détourner l’âme du droit chemin, de même que sans elle les âmes des disparus risqueraient de s’égarer et d’errer sans cesse, sans jamais trouver leur paix. Seuls les vivants peuvent encore leur venir en aide, en pratiquant certains rituels spécifiques.13
Un cas particulier est celui de ceux mort loin de chez eux, pour la plupart des soldats. La mort lointaine14 inquiète d’autant plus qu’elle présente un double danger : elle peut arriver sans que la bougie soit allumée à la tête du mourant et on n’a pas la certitude que le corps ait par la suite été enterré selon la tradition. Ni dans la première situation, ni dans la deuxième, l’âme du disparu n’arrive pas à trouver la paix. Dans ces conditions, la famille organise un enterrement symbolique, supposé ramener le disparu parmi les siens, pendant 11 Avant, dans le temps, c’était le cas pour ceux qui tombaient d’un chariot ou d’un arbre et mouraient sur le coup, ceux qui étaient tués par le foudre, par la chute d’un arbre, se noyaient ou étaient tués sans que cela soit de leur faute. 12 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române, 1892, p. 349. 13 Marian, Înmormântarea, p. 24-34 et 350. Pour les rituels courants en Moldavie, voir Ion H. Ciubotaru, Marea trecere, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 1999, p. 47-48. 14 Paul Henri Stahl, « Tumulus et pyramides de corps. Contribution à l’étude de la mort collective et lointaine en Europe Orientale », in Anthropos, 81 (1986), p. 600-601 ; Idem, « Le départ des morts. Quelques exemples roumains et balkaniques », in Études Rurales, 105-106 (1987), p. 229-230 ; Idem, « L’autre monde. Les signes de reconnaissance », in Buletinul Bibliotecii Române, X (XIV), (1983), p. 101-103.
Les croix de la ville de Bucarest
407
lequel tout se fait comme dans le cas d’un enterrement réel. On porte le deuil, organise des requiem et des aumônes. On érige même des croix à la mémoire du disparu, qu’on situe dans les endroits connus. Au Pays de Bihor, des petites croix votives (cénotaphes), vivement peints et avec des beaux ornements sont cloués à l’extérieur, sur les mûrs des églises. Chacun a inscrit sur elle le nom et l’année de la mort d’un villageois décédé loin, à la guerre. La pratique se retrouve, mais d’une manière moins intense, dans d’autres régions du pays.
De nous jour encore, la préoccupation pour ceux morts sans avoir reçu les soins nécessaires reste grande. J’ai moi-même pu le constater pour la ville de Bucarest quand, dans les listes des noms (acatiste) données au prêtre pour qu’il puisse prier pour leurs âmes, dans la partie dédiée aux mort, j’ai retrouvé de nombreuses mentions comme les suivantes : « mort sans dernière communion et sans confession », « mort sans dernière communion, sans confession et sans bougie », « mort sans bougie », « mort sans lumière », « mort à la guerre », « mort non préparé » ou plus précis encore « mort dans un accident de voiture, sans bougie et sans dernière communion ».15
Selon chaque région, les pratiques funéraires accomplies pour le salut de l’âme connaissent une grande variété. A part les pratiques locales, l’Eglise recommande aux proches des disparus de prier pour leurs âmes, d’accomplir des messes en leur mémoire et aussi de faire des dons (pomana) à leurs noms. Les moments sont précis, ils se situent à 3, 6, 9 jours après le décès, à 3, 6, 9 semaines, 3, 6, 9 mois et ensuite à un 1 an.16 Les plus importants sont les rituels faits aux troisième, neuvième et quarantième jour suivant le décès, car elles sont en relation avec le voyage de l’âme. Ainsi, aussitôt la mort survenue, l’âme, séparée de son corps, part dans la compagnie des anges visiter différents lieux sur terre. Les récits de ses pérégrinations varient selon la région. Néanmoins, dans toutes les variantes, deux lieux reviennent en récurrence : l’âme revient visiter la maison qu’il a habitée de son vivant et l’endroit où il a quitté son corps. Le troisième jour après le décès, pendant que le corps est descendu dans la tombe, l’âme monte vers les cieux pour rencontrer son Créateur et se soumettre au jugement divin. Les six jours qui suivent, on lui fait visiter le Paradis. Le neuvième jour, l’âme rencontre pour la deuxième fois son Créateur, pour ensuite être envoyée visiter l’Enfer. Le quarantième jour l’âme monte pour une troisième fois rencontrer son Créateur et se soumettre à son jugement. C’est
15 Les listes en question datent de 2002 et ont été mises à ma disposition par feu mon père, Ioan Stănculescu, ardant serviteur de l’Église pendant plus de 30 ans. 16 Père Mitrofan, Viaţa repausaţilor noştri şi viaţa noastră după moarte, Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1899, p. 24-31 ; Stahl, Le départ, p. 215-217.
IRINA STAHL
408
le moment du Jugement particulier, qui décidera de son sort jusqu’au moment du Jugement dernier.
Revenant sur les pérégrinations de l’âme sur terre, il faut mentionner le danger que représente son attardement dans les endroits qu’il visite. Les vivants doivent faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour l’empêcher d’y rester et le persuader de monter vers les cieux le troisième jour. Dans l’histoire d’Eliza, celui-ci demande par le biais du rêve17 l’aide de sa sœur qui doit l’aider à quitter le lieu où elle avait perdu la vie. Dès le lendemain, on est allé pratiquer les rituels supposés la libérer de cet endroit.
Pendant le temps passé sur terre, mais aussi dans l’au-delà, l’âme a des besoins, tout comme de son vivant. L’âme a soif ; c’est la raison pour laquelle par endroit, des croix dédiées aux défunts sont érigées auprès des puits et des sources d’eau et que « lorsqu’on puise de l’eau, il faut verser un peu sur le sol, pour apaiser la soif des morts qui peuvent se trouver à proximité ».18 L’âme a faim, raison pour laquelle on organise des banquets les jours de commémoration et on offre de la nourriture ; de même, sur sa tombe on met un arbre fruitier (de préférence pommier ou prunier), dont les fruits pourront le nourrir.19 Il faut à ce sujet remarquer le fait que les croix actuelles de Bucarest se trouvent souvent, elles aussi, à coté d’un arbre. L’âme a aussi besoin d’objets. Smaranda Dobrin fait dons de vêtements et de jouets et elle envisage même d’offrir tout ce qu’il faut pour meubler une maison (chaises, table, lit).20 Même si dans les textes de l’Eglise on parle des actes de charité faits aux noms des disparus, selon la croyance générale tout ce qui est ainsi offert arrivera chez les morts, dans l’au-delà.
Eriger des croix à Bucarest, une pratique ancienne Sur le fond de telles croyances, la ville de Bucarest était autrefois
parsemée de croix, comme cela était d’ailleurs le cas pour la Valachie tout entière et les autres territoires habités par les Roumains.21 Déjà au XVIIe siècle,
17 Le rêve apparaît constamment dans les récits comme étant la principale voie de communication entre les morts et les vivants. Voir Ştefan Dorondel, Apa şi moartea. Ritualuri funerare, simbolism acvatic şi structura lumii de dincolo în imaginarul ţărănesc, Bucureşti, Paideia, 2004, p. 210-215. 18 Paul Henri Stahl, « L’organisation magique du territoire villageois roumain », in L’Homme, XIII (1973), 3, p. 154. Voir aussi Stahl, Le départ, p. 217-219 ; Radu Drăgan, La répresentation de l’espace dans la société traditionnelle. Les mondes renversés, Paris-Montréal, L’Harmattan, 1999, p. 217-244 ; Dorondel, Apa şi moartea ; Sandal Larionescu, Apa în riturile legate de moarte, Bucureşti, Editura Univers. 19 L’arbre suggère en même temps l’arbre du paradis. Selon Stahl, L’autre monde, p. 91. 20 L’habitude d’offrir des meubles à cette occasion est rencontrée, encore de nos jours, dans la région de la Petite Valachie (Oltenia). Voir Sărbători, p. 206-211. 21 A ce sujet voir aussi Dana Popescu, Troiţe româneşti, Bucureşti, CESI, 2007, 132 p.
Les croix de la ville de Bucarest
409
les voyageurs de passage remarquent le phénomène.22 A cette époque les croix étaient pour la plupart fait en bois ou, moins souvent, en pierre. Leurs dimensions pouvaient parfois atteindre des hauteurs impressionnantes, en allant jusqu’à 3 mètres. On les rencontrait partout : au long des rues, aux carrefours, auprès des puits ou des églises et même tout autour de la ville.23 Leurs fonctions étaient multiples,24 mais la pluspart étaient en relation avec la mort.
L’endroit où des hauts personnages avaient trouvé la mort, dans des conditions exceptionnelles, était souvent marqué d’une croix en pierre. C’était surtout le cas des seigneurs ou des dignitaires tués en temps de guerre.25 Parfois on marquait également les endroits où ils avaient frôlé la mort,26 en signe de gratitude pour la grâce divine. Dans des cas exceptionnels, au lieu d’une croix, à l’endroit même ou le miracle s’était produit, on érigeait une chapelle ou une église. Le geste rappelle la pratique des ex-voto.
Il arrive que les croix soient parfois dédiées à un saint, dont le choix n’est pas anodin. Suite à une victoire au combat, par exemple, on invoque Saint Georges, le saint guerrier, qu’on remercie ainsi pour sa grâce.
Mais les croix n’étaient pas uniquement érigées suite à des événements hors du commun, bien au contraire. Les plus fréquentes étaient celles dédiées au salut de l’âme de ceux qui avaient pris cette pieuse initiative et de celui de leurs proches (aussi bien vivant, que passé en éternité). La formule fréquemment utilisée dans ce cas était : « pour son éternel souvenir et celui de ses parents et de tout son lignage », suivie par des longues listes de prénoms ; parfois cela se résumait à n’inscrire que les prénoms, en omettant le texte. Ces croix étaient pour la pluspart accompagnées des puits censés assurer l’eau nécessaire aux âmes des mentionnés.
Eriger une croix ou creuser un puits étaient des témoignages de la foi, tout comme la construction des églises, accessible qu’aux plus fortunés. Ce sont
22 Voir le témoignage de l’archevêque catholique Petr Bogdan Baksic, datant de 1646, dans Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru et Paul Cernovodeanu eds., Călători străini despre ţările române, vol. V, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 206. 23 N’ayant pas des murs d’enceinte, Bucarest s’est vite élargie tout au long du Moyen Age. Les premières mesures pour limiter cette extension sont prises pendant le premier règne d’Alexandru Vodă Ipsilanti (1774-1782), quand on décide de délimiter le domaine de la ville avec des grandes croix en bois. 24 Entre autres, celui de protection, raison pour laquelle on retrouve souvent des croix aux frontières entres les propriétés. 25 Un exemple dans ce sens est la croix érigée en 1713 par Constantin Brâncoveanu et qui c’est trouvait jusqu’à récemment devant le siège du Patriarchat, à Bucarest. Alexandru Elian réd., Inscripţiile medievale ale României. Oraşul, vol. I (1395-1800), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1965, p. 471, doc. 565. 26 Stahl, Tumulus, p. 591.
IRINA STAHL
410
des gestes par lesquels on essaye s’attirer la bienveillance de Dieu et incliner la balance dans sa faveur lors du Jugement particulier. Voici comme exemple, le texte inscrite sur la croix érigée par le grand commandant de la chevalerie, Matei Mogoş :
« A ta croix nous nous soumettons, Seigneur, et ta résurrection honorons. Croix gardienne du monde, croix joyau de l’Église, croix qui raffermit le règne des empereurs, croix qui consolide les croyants, croix qui rend honneur aux anges et qui blesse les diables. Vous les croyants qui passez par là et voyez la pure croix, fierté des croyants, ennemie des diables, voie suivie par Jésus, honorez-là avec grand amour car sur elle a été suspendu le donneur de vie. Priez-le d’éloigner le pays des dangers et qu’il ne lui arrive rien de mal. Et celui qui par sa dépense a élevé cette croix, le grand commandant de la chevalerie du pays Matei Mogoşescul, que Dieu lui accorde sa grâce et l’aide à gagner le royaume céleste. Année 7227 (1719). »27
On retrouve les longues listes des prénoms, en fait des obituaires (pomelnice), auprès des églises. Incrustées sur des croix ou des simples plaques en pierre, on les fixait sur les parois de l’église, tout près de l’entrée, à l’intérieur et même dans l’espace qui abrite l’autel. Le rapprochement avec l’espace sacré était supposé apporter à tous ceux dont les noms étaient ainsi mentionnés, la mise directe sous la protection divine. Cette pratique semble avoir disparue de nos jours, quand on rédige, sur des bouts de papier, des obituaires écrits à la main, qu’on remet par la suite au prêtre, censé les lire à haute voix à la fin de la messe pendant plusieurs jours ; c’est donc par l’intermédiaire de celui-ci que les personnes mentionnées attireront cette fois la grâce divine.
Malgré le fait qu’elles soient constamment entretenues par les habitants de la ville, les anciennes croix de Bucarest ont fini par disparaître les unes après les autres. De nos jours on peut encore en rencontrer quelques-unes dans les musées de la capitale ou auprès des églises, où elles sont toujours vénérées par des fidèles.
Conclusion Sans revenir sur ce qui a déjà été dit, quelques conclusions s’imposent. Tout d’abord il faut remarquer le fait que le phénomène décrit s’inscrit
dans un ensemble de pratiques et de croyances religieuses relatives à la mort, présentes de manière constante et ininterrompue chez les Roumains, malgré les décennies d’interdictions communistes.28
27 Elian réd., Inscripţiile, p. 292, doc. 215. 28 Voir la situation différente existante dans la République Tchèque, décrite par Olga Nešporovà dans le présent volume. A voir également les études de Mirjam Klaassens, sur le cas hollandais : M. Klaassens, M. et P. Groote, « The material culture of Dutch roadside memorials », communication présentée lors du Symposium International sur les mémoriaux situés au bord de la
Les croix de la ville de Bucarest
411
Ce qui le singularise est le fait qu’il concerne une mort brusque et soudaine, avant l’heure, souvent celle d’une jeune personne qui n’a pas pu aller au bout de sa vie. Tout comme dans le cas des enfants morts sans être baptisés, des morts au loin ou des morts des jeunes non mariés,29 c’est une situation dangereuse, aussi bien pour le disparu (dont l’âme risque ne pas trouver la paix), que pour ses proches (qui risquent d’être hantés par l’esprit errant du défunt). Cela demande un renforcement des pratiques, tout comme l’accomplissement des rituels spécifiques.
L’endroit où quelqu’un a rendu l’âme est marqué d’une croix, clôturé, aspergé d’eau bénie et enfumée d’encens. Les proches des disparus s’approprient ainsi peu à peu l’espace public et le transforme en un espace sacré, à forte signification personnelle. On y apporte des fleurs, on y allume des bougies, on vient pour y prier. On assiste en effet à un dédoublement de sépulture : il existe une tombe réelle, dans le cimetière et une tombe symbolique, dans la ville. Les deux endroits ont une signification à part pour l’âme du disparu, qui revient les visiter, tout comme le font ses proches. Ainsi, les craintes des autorités locales, que la ville soit transformée en un grand cimetière est en train de se produire. Bucarest (re)devient la ville de morts aussi bien que celle des vivants.
route: « Marking death in open places », 24 juin 2010, Dublin, Ireland ; M. Klaassens, P. Groote, et P.P.P. Huigen, « Roadside memorials from a geographical perspective », in Mortality, 14(2), (2009), p. 187-201. 29 Stahl, L’autre monde, p. 92-94, 101-103.






























![Vbi ecclesia? Basiliques chrétiennes et violence religieuse dans l'Afrique romaine tardive (In: FREU, C.; JANIARD, S. [éds.], Libera Curiositas. Mélanges en l'honneur de Jean-Michel](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63178df62b00f6ff4406a021/vbi-ecclesia-basiliques-chretiennes-et-violence-religieuse-dans-lafrique-romaine.jpg)