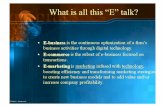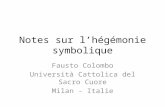Le café au carrefour des deux mondes. Exemple d’une acculturation volontaire dans la ville de...
-
Upload
socio-comunicare -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Le café au carrefour des deux mondes. Exemple d’une acculturation volontaire dans la ville de...
Southeast European(Post)Modernities
Part 1
Changing Practices and Patterns
of Social Life
edited by
Klaus Roth and Jutta Lauth Bacas
Ethnologia BalkanicaJournal for Southeast European Anthropology
Zeitschift fiir die Anthropologie Sildosteuropas
Journal d'anthropologie du sud-est europ6en
Volume 15/2011
LIT
Ethnologia Balkanica 15 (2011)
Le caf6 au croisement des deux mondesExemple d'une acculturation volontaire dans la ville de Bucarest
au XIX" si0cle
Irina Stahl, Bucarest
Abstract
Coffee Culture at the Crossroads of Two Worlds : An Example of VoluntaryAcculturation in l9h Century BucharestIn this article the author analyses the emergence and evolution of coffee drinking and
coffee houses in the urban setting of Bucharest, the capital of Wallachia, until the year
1900. Coffee culture in nineteenth-century Bucharest provides an example par excel-
lence ofvoluntary acculturation. In this important cultural and trading centre in South-
east Europe, located between the Orient and the Occident, people adopted aspects ofcoffee culture from both sides. Nathan Wachtel has urged fellow historians to study
processes of acculturation because a diachronic approach allows for an improved under-
standing ofevolution and change. A historical perspective on the phenomenon ofvolun-tary acculturation thus has an advantage over the predominantly synchronic approach toacculturation by ethnologists focussing on a moment in time. The dynamics of voluntaryacculturation are clearly shown by the twofold appropriations of the global commodityof coffee in the nineteenth century : these cultural expressions of coffee culture provide
a window on Bucharest society at the time. At first a luxury product used at the court,its conspicuous consumption (Veblen) served to underline the high social status of the
ruling ciass. Next, when prices dropped, the middle classes adopted the ritual ofcoffeedrinking, coffee houses becoming their most prominent places for social interaction. Inthis development coffee culture shifted from the private to the public space. Another dy:namic in the push for modernization of city life was the subsequent appropriation of bothoriental and occidental coffee culture, demonstrating the change in orientation over the
generations. In this process oriental coffee places became gradually marginalized bothin time and space. The article shows how the coffee house as an important urban institu-tion evolved as a voluntary acculturation at the crossroads of two worlds.
D'aprds Peter Burke (2010 : 72:76) le m6tropolis et la frontidre sont les lieux de
pr€dilection pour des rencontres et des 6changes entre peuples et cultures, des
zones de contact (Pratt 1991) par excellence. Dans cette optique, Bucarest ap-
parait, au XIX" sidcle, comme un endroit pr6destin6 d I'acculturation (cf. Spi-
cer 1972: 2l-27). En effet, la ville occupe une position particulidre dans le
Sud-Est de l'Europe : elle est I'une des plus grandes agglom6rations urbaines
64 Irina Stahl
de l'extr6mit6 occidentale de I'Empire Ottomane, un important nmud commer-cial et centre culturel d la fois. Sa particularit6, surprise i maintes reprises parles voyageurs dtrangers de passage,l consiste dans le fait d'€tre situ6e entredeux mondes, appel6es i l'6poque par les termes g€n€riques d'Orient et Occi-dent, sans pour autant se trouver ni dans I'un, ni dans l'autre. A I'Est comme dl'Ouest, la ville est regardde avec curiosit6 et dtonnement car, mdme si i certains€gards elle parait familidre, elle semble totalement insolite par d'autres. Bucarestapparait ainsi comme une ville 6trange, car hybride (Burke 2010), une bizarrerieen regard des autres villes.
Au XIX" sidcle, Bucarest se retrouve dans un profond processus de change-ment. Des 6l6ments culturels venus auparavant d'Istanbul sont peu i peu rempla-c6s par d'autres, importds cette fois de I'Ouest de I'Europe. On assiste i une ac-culturation volontaire, ddsir€e et mOme recherchde qui va changer, en quelquesddcennies seulement, la vie de ses habitants, mais aussi l'aspect de la ville toutentidre. Parmi les nouveaut€s, des v6tements, des meubles, des aliments et desplats, des langues, de la musique, des danses, des styles, des us et des coutumes.Tous ces changements sont I'apanage des classes ais6es de la ville, imit6es, plut6tmal que bien, par les classes moyennes. Les paysans, situds en bas de l'6chellesociale, sont les seuls I y rester apparemment insensibles (cf. Tarde 1890).
S'int6resser au processus d'acculturation qui traverse la ville et ses habitants,c'est souvent se pencher sur des 6l6ments de la vie courante a priori simplesmais dont I'histoire est complexe et charg6e de sens. " La sdmiotique de la vieurbaine - selon Clifford Geertz - n'est autre que l'interpritation de cette yieen termes d'expressions dans lesquelles elle fonctionne " (1989: 293). Dans cesens, le caf6 et toute la culture qui s'y d6veloppe autour de cette boisson i va-lences multiples,2 est certainement I'une de ces expressions. La presente 6tude sepropose d'explorer ces implications sociales, tout comme les forces sociales quila fagonnent. En prenant I'exemple du caf6, lui-m6me 6l6ment d'acculturation,on espdre apporter des nouveaux dclairages sur ce processus, car i travers leschangements que le caf6 a apporte dans la soci6t6 valaque, on voit se succ6deraux objets et pratiques venus de I'Orient ceux de I'Occident. Dans un contextemondial plus large, on s'apergoit qu'il s'agit en fait d'un processus de propaga-tion qui connait des va-et-vient successifs et au centre duquel se retrouve la villede Bucarest.
On mentionne les titres suggestifs de deux r6cits de voyages, publi6s i presque un sidcled'6cart: James Henry Skene : Zfte Frontier Lands of the Christian and the Turk (1853) etLucien Romier : Le Carrefour des empires morts. Du Danube au Dniester (lg3l).
" Le cafil Atuil au dCbut de la nouriture, ensuite du vin, une drogue, un rafraichissementdivotionnel pour finalement devenir une boisson ,', synthetise William H. Ukers l'dvolutiondes diffdrents emplois du caf9 (1922: XIX, cf. 693 ss.).
Le caf1 au croisement des deux mondes
Dans le but de mieux comprendre ce processus dans son ensemble, nous
avons choisi de le traiter dans une perspective historique, mdme si ce choix a
fait qug parfois nous nous 6loignerons du XIXd-" sidcle pour nous pencher sur
I'histoire plus ancienne de Bucarest. Cela s'est imposd d'autant plus que, d'aprds
I'affirrhation de Nathan Wachtel, " si les dtudes d'acculturation se sont ddvelop-
ptes sur le terrain de l'ethnologie, elles se situent d'emblde dans une perspec-
tive historique, orientde vers l'6tude de l'dvolution et du changement " (1974:
I24). Encourageant les historiens i y jeter un coup d'ail plus attentif sur la
notion, Wachtel leur recommande tout de m€me de restreindre, dans une pre-
midre 6tape, le champ des 6tudes d'acculturation )r la situation de type colo-
niale. .. Gdndratiser la notion d'acculturation au-deld du domaine oil elle a prisnaissance )), ne serait-ce que pour plus tard, considdre-t-il, o quand les 4tudes
concrAtes se seront accumul es, et auront permis de ddgager les 4ldments d'une
thdorie " (1974: 125). Or, voilh que se sont 6coul6es bientdt quatre d6cennies
depuis cette d6claration. Un premier pas vers la g6ndralisation de la notion a
dejiL eG franchi avec les 6tudes sur l'acculturation volontaire rencontr6e au Ja-
pon, qui se sont multiplides (Kozakai 1991, Westney 1987). Faisons le suivant,
avec l'6tude des pays roumains, et int6ressons-nous particulidrement d la villede Bucarest, lieu d'une acculturation d bien des 6gards tout aussi volontaire.
I-laccumulation des dtudes concrdtes, ouvrirait la voie aux comparaisons et ) lacr6ation d'une nouvelle th6orie sur I'acculturation, dans la direction montr6e par
Wachtel.Notre 6tude d6butera par une courte incursion dans l'histoire du caf6 de part
le monde, dans laquelle on insistera sur son introduction en Europe de I'Ouest,
pour ensuite se focaliser sur son 6mergence et ses usages dans les pays rou-
mains, notamment ir Bucarest. Seront abord€s la fagon de le pr6parer et de le
consommer et surtout les aspects li6s d son service car, le caf6 est une boisson
sociale par excellence. La sortie du caf6 dans l'espace public et I'apparition des
premiers caf6s dans la ville, avec toutes les cons6quences que cela a pu avoir
sera le dernier chapitre de notre histoire. Dans les conclusions nous reviendrons
sur quelques-uns des aspects essentiels pour les faits expos6s, pour enfin cl6tu-
rer par quelques questions susceptibles de susciter de nouvelles recherches.
Le caf6 dans le monde
Le cafd fait son apparition en tant que boisson dans les pays islamiques du
Moyen Orient vers la moiti6 du XV" sidcle, mais ce n'est que vers la fin du XVI"sibcle que I'Europe le d6couvrira, en tant que plante et boisson. On devra n6an-
moins attendre le milieu du XV[' sidcle pour que les navires de la Compagnie
anglaise des Indes Orientales et ceux de la Compagnie hollandaise l'acheminent
65
66 Irina Stahl
de manidre r6gulidre depuis le Y6men, par la route maritime du cap. En peu detemps, le commerce du caf6 semble avoir pris la place qu'occupait pr6c6dem-ment au Levant celui du poivre et des 6pices (Arendonk et chauduri l97g : 474),les marchands europ6ens et turcs se confrontant souvent d cause de cette grainetant d6sir6e. une autre route, emmenait le caf6 depuis le y6men vers I'Egypte,dbi elle 6tait achemin6e, par voie terrestre, jusqu'i Istanbul et de ld, plus loin,en passant par la Valachie, vers Vienne ou Venise.3
A I'origine, au Moyen orient, boire du caf6 6tait associd i la communaut6Sufi, car les membres en consommaient dans un but religieux (la boisson ing6-r6e leur permettait de prier plus longtemps et de prier). c'est grace i eux qu'ellefut d'abord apport6 i La Mecque, et par la suite au caire. vers le d6but du XVI"sidcle, le caf6 sort du cercle ferm6 des Sufis, pour faire son entr6e dans I'espacepublic de la ville oi I'on I'associe plutdt avec le plaisir, qu'avec la pi6t6 (Hat-tox 1996 : 30). Les premiers 6tablissements of I'on consommait du caf6 voientle jour au d6but du XVI" sidcle d'abord i La Mecque, puis au caire, enfin d Is-tanbul, or) en 1554-1555, deux Syriens ouvriront les premiers caf6s, dans le dis-trict de Tahtakale. c'est d'ici que le caf6 s'est rdpandu vers touts les coins deI'Empire, et mdme au-deld, dans les principaut6s roumaines de la valachie et laMoldavie, comme un phdnomdne 6minemment urbain (philo 2004 : 7).
En Europe, Londres fut parmi les premidres villes i connaitre le caf6, gracei la compagnie anglaise des Indes orientales, qui a 6t6 la seule d assurer I'im-portation r6gulidre du caf6 depuis le Y6men, avant 1690 (Arendonk et chauduri1978 : 474). Depuis I'ouverture du premier coffie house i Oxford, en 1650, dI'initiative d'un juif libanais nomm6 Jacob, le caf6 a connu une ascension fulgu-rante. A la fin du XVII' sidcle, Londres comptait environ trois mille caf6s, 6tantla ville europ6enne oi l'on buvait le plus de caf6 (stella 1996 : r90). Le suc-cds britannique du caf6 est dfi, selon Brian william cowan, i une combinaisonunique de circonstances, qui r6unit la curiositd intellectuelle des virtuoso,a les in-t6rots financiers des commergants et les inquidtudes de la soci6t6 civile confron-t6e i l'alcoolisme croissant dans les rangs de la population (cowan 2005).
En France, la boisson fait son entr6e vers le milieu du XVII" sidcle, apport6epar des voyageurss et des commergants de retour du Levant ou par des 6tran-gers, originaires de cette partie du monde ou de la M6diterrande (Desmet-Gr6-goire 1980 : 96). ville portuaire, Marseille fut la premidre d la connaitre. A
Voir la carte des routes dans Chabouis 1988 : 21.Groupe d'6lite de la soci6t6 britannique. guidd par une .6thique dela curiosit6, et orient6envers tout ce qui 6tait 6tranger, exotique, a fait connaitre le caf6 au grand public, et par lasuite a aid6 i le faire accepter par la communautd savante.Parmi ces voyageurs, il faut mentionner Jean de Th6venot qui, de retour i paris en 1662,prenait du plaisir i regaler ses h6tes avec une tasse de caf6 (Franklin lg93 : 34).
Le caf! au croisement des deux mondes
Paris elle rencontra plus de r6sistances. Aprds quelques tentatives 6chou6es, ce
n'est qu'aprds 1669, quand Soliman Aga, l'ambassadeur de Mahomet V auprds
de Louis XIV, s6journa pendant quelques mois dans la capitale frangaise, qu'elleconquit ddfinitivement le grand monde. D6sireux d'en apprendre plus sur la so-
ciete qu'il d6couvrait, l'envoy6 turc recevait dans son palais un grand nombrede gens de la haute soci6t6, surtout des dames, auxquels il offrait, selon la cou-tume de son pays, du caf6 noir. Le go0t amer du caf6 a d6plu au d6but, mais,
aprds lui avoir rajout6 du sucre, la boisson fini par plaire. Pour autant, c'est sur-
tout I'atmosphdre dans laquelle le cafd 6tait servi (la richesse du d6cor, le ser-
vice des esclaves, les nouveaux objets etc.) qui ir assur6 son succds fulgurant. Lemoment marque ainsi le d6but de la mode dite des turqueries en France (Stella
1996 : 50). Deux ans plus tard, en 167I, un Arm6nien, appel6 Pascal, ouvrait lepremier d6bit de caf6 d la Foire Saint-Germain. Mais ce n'est qu'en 1686, que
cette fois un Sicilien, Francesco Procopio dei Coltelli, ouvre le premier caf6 de
Paris, le fameux Procope, situ6 rue des Foss6s Saint-Germain. A deux pas de
la Com6die Frangaise, il est vite devenu le lieu de rendez-vous des comddiens,des 6crivains, des musiciens et des jeunes en g6n6ral. Son succds a encourag6I'ouverture d'autres 6tablissements similaires ; en 1720,la capitale frangaise en
comptait plus de trois cents (Stella 1996 : 157-158).Vienne s'entiche elle aussi de la mode des turqueries, et vit une exp6rience
similaire i la France. En fait, quatre ans avant la visite du premier ambassa-
deur turc d Paris, en 1665, le sultan Mehmet IV envoya le pacha Kara Mehmetcomme ambassadeur auprds de I'empereur L6opold. Dans sa nombreuse suite se
trouvaient 6galement deux cafetiers charg6s de la pr6paration et du service ducaf6. La nouvelle boisson connait un tel succds auprds des invit6s, qu'aprds le d6-part des Turcs, les habitants de la ville continuent h pr6parer eux-m€mes le caf6et i le consommer en priv6 (Stella 1996: 179). Le premier caf6 de la ville ou-
vrira presque vingt ans plus tard, dans des circonstances moins heureuses, suiteau sidge de 1683. En effet, parmi les objets abandonn6s par l'arm6e turque enretraite se trouvent 6galement quelques sacs remplis de grains de caf6. Le Polo-nais Kolschinsky, qui s'6tait illusff6 sur le champ de bataille, les regoit en guise
de r6compense. Il essaie d'en retirer profit et ouvre le premier caf6 de la ville.C'est toujours lui qui, voyant que les viennois n'appr6cient gudre le gofit amerde caf6 noir, d la turque, ajoute du miel et de la crEme, en inventant ainsile cafdviennois. De son c616, son voisin, le boulanger Peter Wendler, fabrique des pe-
tits pains en forme de croissant, pour se moquer des Tirrcs. Ces deux inventionsvont faire le tour du monde. Au XIX" sidcle, les 6tablissements viennois oi I'onpouvait consommer du caf€ 6taient d6jd devenus c6ldbres dans toute I'Europe.Leurs 6l6ments de d6cor et accessoires (tels les miroirs, les c6ldbres chaises enbois courb6, dessin6es par le frangais Michel Thonet, les porte-journaux - des
longues pinces en bois qui facilitaient la manipulation des journaux, tout en dis-
67
68 Irina Stahl
suadant de les emporter, et le billard) seront largement copi6s et imit6s dans tousles caf6s europdens i la mode (Srella 1996 : 180-181).
Suivre la voie du caf6 dans le monde s'avdre 6tre une histoire passionnante.Elle est parsemde d'anecdotes, de r6cits sur des rencontres entre des peuples auxcultures vari6es, par des d6couvertes dues au hasard, par des allers vers des nou-veaux mondes, mais aussi par des retours tout aussi spectaculaires. Au final, cequ'il faut retenir de toutes ces histoires, c'est l'impact que ce petit grain a eu surles soci6t6s qu'il a touch6es. car le caf6 apporta avec lui de nouveaux objets, denouvelles habitudes, de nouveaux gofits, de nouveaux m6tiers, de nouveaux es-paces. En un mot, il changera d tout jamais la vie sociale.
Nous allons ainsi mettre fin d notre bref incursion dans I'histoire du caf6de part le monde, pour nous focaliser maintenant sur le parcours qu,il a connudans les pays roumains et notamment dans la capitale de la valachii : Bucarest.
Le caf6 dans les pays roumains
I- histoire du cafd dans les pays habit6s par les Roumains commence par une 16-gende. Reprise par le chroniqueur Ion Neculce, elle nous raconte li r6ceptiond Istanbul du logothdteu (logofal r[utu, l'envoy6 du prince moldave BogdanlAveugle, au d6but du XVI" sidcle :7 " Aprds Afte devenu prince, Bogdan Vodd aenvoyd le logofuate Tdutu comme dmissaire chez les Turcs, lorsque le pays a dttsoumis aux Turcs. Et les gens disent que le vizir I'a fait s'asseoir sur un tapis,et il n'avait pas des mesteis attachis d ses pantalons ; et qu'enlevant ses bottesil resta chaussd qu'avec ses chaussettes. Et en lui offrant du cahfe, il ne savaitpas comment le boire. Et il a commenc4 par un vnu , Vive l,empereur et le vi_zir ! ,. g7 saluant, iI avala le contenu du febgiarf , comme s'il s'agissait d'uneautre boisson,, (1982: 169-169). Certains historiens se montrent sceptiques parrapport d la v6racit6 des faits relat6s, pass6s un demi-sidcle avant I'ouverture despremiers caf6s d Istanbul et transcrits plus d'un siOcle aprds qu'ils soient arriv6s(Decei 1972:' Pandrea 1989). N6anmoins, d pr6sent on sait qu'il y a bien eu uno cafd avant le caf4 " (Bacqu6-Grammont 2001 : 1g) et que le caf6 fut d,abordconsomm6 dans des cercles priv6s, des d6cennies avant I'ouverture des premiersdtablissements publics, et cela dans tous les pays qui ont connu le caf6 (Stella
6 Chancelier.7 Le rencontre doit avoir eu lieu entre 15o4,le d6but du rdgne de Bogdan lAveugle et 1511,
date de la mort du logothdte.8 Chaussures l6gdres, en peau fine, port€s par les hommes.e Du tnrc fincan, tasse i caf6, sans anse, mis d'habitude dans un zarf, support en metal
ouvragd.
Le caf€ au croisement des deux mondes
1996 : 150). La l6gende roumaine ne fait que confirmer I'usage du cafd I la courimp6riale d'Istanbul avant I'ouverture des caf6s dans Ia ville.t0 De mdme, elletdmoigne du fait que les premiers contacts que les Roumains ont eus avec cettenouvelle boisson se situent aux alenlours du XVI'sidcle, information particulid-rement int6ressante pour la pr6sente 6tude.
Avec I'arrivde des princes dits phanariotesrl dans la premidre partie duXVIII' sidcle, tout un cdr6monial, calqud sur celui r6serv6 au Sultan, va se
mettre en place autour du caf6, dans les cours princidres de Bucarest et d'Iassy.Mais le caf6 semble avoir 6t6 appr6ci€ bien avant cela par les 6lites locales, quiI'utilisaient semble-t-il pour leur usage personnel ou comrne cadeau offert auxpersonnages importants. Malgr6 la raret6 des sources, on arrive tout de rn6me d
retrouver quelques indices qui confirment cette affirmation. C'est ainsi que dansun registre de ddpenses de la tr6sorerie du prince valaque Constantin BrAnco-veanu, datant du 1696, parmi les mets reservds at " khan de I'arm€e >, on trouve,. 15 ocat2 de cafd de ckez lanachi le sommelier (clucer) ,, (Giurescu 1965 : 326).Plus tard, en 1716, on apprend que le m6tropolite Antim engage le prieur de sa
fondation d'amener, quatre fois par an, au m6tropolite du pays, une oca de caf6et uro oca de sucre ou sinon, des produits d'une valeur similaire (Potra 1990 :
387). I-entr6e du cafd sur les rnarch6s roumains est due d I'intensification des
relations commerciales avec I'Empire Ottoman, au courant du XVII" sidcle, dontla cause principale consiste dans la pression toujours plus grande exercde par LaPorte, en qu€te de vivres.. Les princes phanariotes nouvellement install6s apportent avec eux d'Istanbulla fonction de vel-cafegiu (grand-cafegiu) au cafegi-baSa. Celui qui d6tenaitcette fonction 6tait en charge du service du caf6 ir la Cour, principalement auprince, mais aussi de I'approvisionnement en caf6 et de tout ce qui concernaitI'entretien et l'acquisition des ustensiles ndcessaires dr la prdparation et au servicede cette boisson : des ibric,t3 des fiIigean,ta des zarfls et d'autres encore.
10 La consommation du caf6 parmi tres.6lites ottomanes est attest6e dds les premidres anndesdu rdgne de Soliman le Magnifique 0520-1566). Le Sultan lulmOme semble avoir appr6-ci6 la nouvelle boisson (Saraggil 1997 :2&-29\.
11 On appelle princes phanariofes, les princes impos6s par la Porte d Ia Valachie et la Mol-davie, i partir du 1711 et jusqu'en 1821. La majoritd 6tait des hauts dignitaires d'Istanbul,provenant des familles grecques habitant Phanar, un des quartiers riches de Ia ville.
t2 Unitd de mesure pour la masse, I oca : 1,27i kg en Valachie et 1,291kg en Moldavie.13 Cafetidre dans laquelle on fait bouillir de I'eau avant de rajouter la poudre du caf6 et que
Iion laisse encore bouillir quelques instants, tout en remuant.ta Oufelegean, tasse i caf6 turc, sans anse, fix6e dans un support de m6tal ; du turc fiIcdn.ls Support metallique dans lequel se fixe la tasse de cafd ou de thd ; du twc zaS .
69
70 Irina Stahl
Le m6decin Marc Filip zallonyl6 nous livre une description de la c6r6moniedu caft qui se d6roulait devant le prince: le signal 6tait tout d'abord donn6 parun ceausl,, qui se trouvait dans la salle, et qui poussait un grand cti: " ci?e !cafdzi-Bachi ! ". Le cafetier en chef de son Aliesse, ainsi iverti, s'empressaitd'apporter " une petite tasse pleine de cette liqueur et enrichie de diamants ,.Aprds le repas, vers une heure de l'aprds midi, un nouveau cri du ceaus deman-dait encore du caf6, tout en informant la cit6 tout entidre du fait o que son Al_tesse va prendre le caf6, et que I'instant qui va suivre est celui oi elk se livre ausommeil " (L824: 44-47).
outre leurs attributions envers le prince, les cafegi-basa 6taient prdsentlors de c6r6monies particulidres, comme dans le cas-dbvdnement en rang desboyards. Nicolae Filimon, l'auteur du roman historique Les anciens et lesnouveaux parvenus,ts ddcrit le d6roulement d'un tel 6vene-errt au d6but duXIX sidcle, pendant le regne du Ioan Gheorghe caragea : aprds la c6r6monietenue i la cour, le boyard, s'il 6tait de haut rang, recevait en cadeau un chevalorn6 de riches parures, qu'il montait sur le chemin de retour chez soi; il 6taitsuivi par le cortdge princier. une fois arriv6, le meterhaneale, sp6cialement en-voy6 du palais, le recevait avec des haut chants, pendant que les domestiques etles cafegii princiers le r6galaient avec de la confiture, du caf6 et des chibouquesde la meilleure qualit6, toujours de la part du prince. Tous ces services devai-91t
bien entendu 6tre gratifi6s d leur tour, par des pourboires sur mesure (1963 :83-84 notg.
A la fin du XVIII" sidcle, pendant le rdgne dAlexandre rpsilanti, celui quid6tenait la fonction de cafegi-basablnlficiaitdes revenus apport6s par tous les6tablissements i caf6 rre la ville de Bucarest (caf6s et -ugurio, de vente). Luiseul avait le privildge de tenir trois caf6s, y compris letr-tachmis2' et de jouirde leur plein profit. Toute autre personne voulant ouvrir une 6choppe ) caf6 de-vait en revanche demander d'abord la permission et par la suite p^ayer une taxe(Urechia l89l: rl4-Lr5). pour une brdve p6riode, pendant I'occupation autri-
16 Grec de naissance, Marc Filip zallony (1760 - aprox.1g2l) fut m6decin auprds de plusieursprinces phanariots et dignitaires turcs i la fin du xvIII, d6but du XIX sidcle. c,est de ses
._ qropres expdriences qu'il d6crit les habitudes et res mceurs des premiers.17 Grade inf€rieur dans l'administration.18 Nicolae Filimon (1819-1865) publie son roman en 1g62. En plus de l,intrigue, l,auteur livrei ses lecteurs une description criante de v6rit6 de la ville de Bucarest et de-ses habitant pen-
dant le rdgne de Ioan Caragea (1812-1818). Fonctionnaire des Archives de I'Etat, il s'estsouvent inspir6 des chroniques historiques de l'6poque qu,il a pu consulter (et qu'il cite sou_
.^ vent dans les notes explicatives du roman) mais aussi di ses propres souvenirs'd,enfance.le Lorchestre princier qui chantait de la musique turque, dans laquelle les tambours 6taientpr6dominants ; du turc mehterhane.
20 Endroit of 6tait torr6fi6 et moulu le caf6 ; terme d'origine arabe.
Le cafd au croisement des deux mondes
chienne (1789-179I), quand le prince avait quitt6 le pays, la fonction de vel ca'
fegi avaitcess6e d'exister ) la Cour. Les revenus qui en d6coulaient furent alors,
pour un temps, xccapat1 abusivement par l'Aga de la villdt, avant que le Divanordonne qu'ils soient destin6s aux pauvres et I la pr6vention des incendies (Ure-
chia 1892:336-337).Malgr6 certains avantages, le cafegiu de la Cour occupait un rang inf6rieur
dans la hi6rarchie des fonctions, fait qui se refldte dans la position qui lui reve-
nait dans les cortdges princiers. Ainsi, lors de I'entr6e dans la capitale du prince
Alexandru Ipsilanti, le 3 fdvrier 1775,le cortdge 6tait clos par le Cafegi-baSa,
)r cot6 des autres serviteurs de rang inf6rieur du prince. Il parait qu'i cette oc-
casion les tavernes et les caf6s de la ville grouillaient de monde (Ionnescu-Gion
2003:897).Produit d'importation ,le cafd retrouvd sur le march6 de Bucarest provient en
grande partie d'Istanbul (on il 6tait apport6 d'Egypte ou du Yemen), mais aus-
si d'ailleurs. Dans une liste de prix datant du 1793, on mentionne le " cafi du
Yemen, (Iemenu cafea), mais aussi \e " cafd frangais " (cafea sfranlozeascd),
moins cher. Pour se faire une id6e du prix du caf6 )r cette €poque, mentionnonsle fait qu'une oca de caf€ de Y6men, valait le prix de 8 jours et demi de tra-vail aux champs, pendant qu'une oca de caft de qualitd moins bonne, valait que
5 jours et demi (Urechia 1895 : 347,351).Les marchands se montrent attentifs d la qualit6 du produit qu'ils commer-
cialisent. Dans une lettre qu'il adresse en 1829 ir son collaborateur, le marchand
Stan C. Popovici de Sibiu se montre inquiet pour deux tonneaux (bute) de caf6
que le premier avait achet6 en son nom, et lui donne des indications i suivreen fonction de la qualit6 du produit : s'il n'arrive pas ) le vendre, et que le caf6
est de bonne qualit6 (, cafea faind ,)22, il vaudrait mieux I'envoyer d Sibiu ou
i Turnu-Ro$u ; si la marchandise s'avdre 6tre de moins bonne qualit6 (, marfdmai proastd "), alors le stocker en d6p6t, d I'abri d'humidit6 (Iorga 1925 : 198-199). Une troisidme categorie de caf6, de qualit6 moyenne (, cafea de mijloc ")est 6galement mentionn6e par les documents de l'6poque (Potra 1990 :220). Eten 1875, parmi les produits import6s, soumis aux droits d'accises, on retrouvemdme du < surogat de cafd " (Aurelian 1880 : 285).
Avec le temps, le prix du caf6 ne cesse de baisser. D'un produit de luxe,consomm6 exclusivement par la haute soci6t6, il devient peu ) peu accessible aux
habitants des classes moyennes de la ville. Ainsi, si en 1836, \ne oca de caf6 va-
lait le prix de cinqjours de travail dans les vignobles, en 1858 elle arrive i va-
21 Commandant de la police, charg6 de la s6curit6 de la ville.22 Le mot.fain en roumain provient de I'allemand/eln, signifiant " bon,
7l
72 Irina Stahl
loir un peu moins que le prix de trois jours et demi de travail (Sturdza-gcheeanu1907 :62-64, 188-190). -l
Lhabitude de boire du caft s'est vite rdpandue dans toutes les classes dela soci6t6, ot) on le consommait sans distinction ni de sexe ni d'dge. Le m6de-cin Constantin Caracag remarque l'attachement particulier envers cette bois-son, manifest6 au d6but du XIX" sidcle par les classes aisdes de la ville, oi on leconsommait amer et trds concentr6, plusieurs fois par jour chez soi et aussi lorsde chaque visite. Le m6me d6plore l'habitude malsaine de le faire consommerpar les enfants (Samarian 1937 : 103,96).
La pr6paration et le service du caf6
La pr6paration du caf6 semble avoir 6td la mdme partout dans le sud-est de l'Eu-rope, tout comme i Istanbul, prouvant une fois de plus la propagation de cettepratique depuis la capitale de I'Empire. Ce n'est pas par hasard si tous les us-tensiles n6cessaires i sa pr6paration et au service portent des noms emprunt6s ila langue turque. Ami Bou6 nous livre une description d6taill6e i ce sujet, des-cription qui correspond 6galement i la r6alit6 valaque '. ,, Le cafd ne se bait quenoir, et on en avale une partie du sddiment. 1...1 On prend le caf6, en gindral,sans sucre, en rdseryant ce dernier pour honorer quelqu'un. Le cafd se prhpareautrement qu'en Europe, en ce qu'il se pile dans des troncs creux (1. Dduyedjek,s. Stoupa, g. Kaiemas) avec de longs pilons de fer [...1. Le cafd ne se met dansl'eau que lorsqu'elle bout ; on ne I'y laisse que peu de temps, on ajoute quelquesgouttes d'eaufroide, et on le sert dans le pot de fer-blanc ou de caivre 6tamdnommd Kav6-Ibrik, et en albanais Gogome. D'apris la mantire de le.faire ou laqualitd du caf6, il est de fait que cette boisson est meilleure et plus aromatiqueen Turquie que gdndralement en Europe. Le meilleur cafe se boit dans le S.-8.et le S. de laTurquie, mais ony ernploie aussi plus de caf€ que dans nos cafe-tiires dfiltrer" (1840 :254-255). Un autre frangais, F6lix Pigeory, fait part deson profond m6contentement ) l'6gard de cette manidre de pr6paration. En se
rendant en 1850 chez le commissaire du sultan Achmet-Effendi, en poste i Bu-carest, il raconte : " [..J son Albanais allait de I'un d l'autre, offrant le chibouket le caf6, Palitesse superflue, pour moi du moins ; car d quoi bon le chibouk ?
je ne fume pas ; d quoi bon Ie cafd que j'adore, mais d la condition qu'il soitlimpide comme celui de Tortoni, et non saturd de marc comme Ie breuvage enhonneur chez les Orientaux ? " (1854 : 23). Cette rdaction prend tout son sens sion se rappelle qu'en France, dds le d6but du XVIII" sibcle, on avait pris l'habi-
Le caf6 au croisement des deux mondes
tude d'infuser le caf6 au lieu de le bouillir,23 d'oi le dicton : " caft bouillu, cafifoutu " (Stella 1996 : 152).,
Au contraire des pratiques en vogue h I'Ouest, dans le sud-est de l'Europe,ajouter du lait dans le caf6 est longtemps rest6 un geste inconnu (Ukers 1922 :
696). ,. Aucun de nos usages n'a cessd d'4tonner plus nos h6tes, pendant nos
voyages - raconte le m6me Ami Bou6 - que le milange du lait au cafi, et sur-tout lorsqu'il avait lieu sur une assiette, faute de iane. Mille fois nous avons en-
tendu les postillons avertir les aubergistes de la singulariti de leurs hdtes, quiavalaient le matin une livre de lait " (1840:254). Dans les principaut6s rou-maines, le caf1 sera consomm6 avec du lait vers le d6but du XIX" sidcle, sous
I'influence des nouvelles pratiques venues de Londres et de Vienne. Chez les
boyards de Iassy, cela semble 6tre d6jd une habitude i la fin du XVIII" sidcle(Lemeny 1990:62).
A part les sucreries, b Bucarest, comme ailleurs dans I'Empire Ottoman,2a
le caf6 6tait souvent accompagn6 par le tabac car, comme le dit un dicton turc,le cafd sans tabac est comme le sommeil sans couverture. Des chibouques,pipes qui pouvaient atteindre des longueurs consid6rables, 6taient d ce but dis-tribu6es aux invitds. Le comte de Sallaberry, nous fait par de son 6tonnementquand un jour, lors d'une visite, il apergut le Tr6sorier de la Cour au milieud'une pidce ; " fumant une longue pipe, dont le bout portait d tere, d quatre pas
de \ui1...7,, (1821: 36). Boire du caf6 et fumer de lapipe semble 6tre, enpre-nant les mots dAmi Bou6, u le cachet de cdrdmonie pour chaque visite " (1840 :
255), mais d'une visite entre hommes, on ajouterait, car i Bucarest, le tabac
semble 6tre d lEpoque encore I'apanage exclusif de la sociabilit6 masculine (cf.
Driessen 1983).
Dans le service du caf6, rien n'est laiss6 au hasard. Tout comme d Istanbul,I Bucarest la boisson 6tait servie par des esclaves dans le cadre d'un rituel pr6-
cis, pendant lequel les rangs et la hi6rarchie sociale des invit6s 6taient stricte-ment respect6s. Le nombre des domestiques pr6sents, leur allure et apparence,
la richesse des objets, tout comme la qualit6 des produits offerts 6taient en m6me
temps supposds indiquer le statut social du maitre des lieux.Une description vdridique de la c6r6monie mise en place autour du caf6 nous
est offerte par l'dcrivain Nicolae Filimon. Dans une des scdnes du roman d6jd
mentionn6, on voit comment le postelnic2s Andronache Tirzluc, un des person-
23 Opdration possible grdce i une cafetidre astucieuse, dot6e d'une poche en tissu qui retenait
le marc.2a Dans le Proche-Orient. boire et fumer vont ensemble ir tel point qu'en turc, comme aussi
en arabe, on utilise le mdme mot pour les d6signer : igmek en trrc, iaraba en arabe (Des-
met-Grdgoire 1991 : I3).25 Ministre des affaires 6trangdres.
73
74 Irina Stahl
nages, n'6pargne pas les moyens pour dpater ses hdtes. Tout sejoue dans les d6-tails: " Apris que les invitds se sont assis sur les deux lits, une tzigane bien ha-billde [...] se prisenta devant eux tenant un plateau plein de confitures de toutessortes ; apris elle venait une outre tzigane portant un plateau avec une multitudede petits verres avec de la vodka de mente et quelques plats avec des amandesddcortiqudes et des pois chiche torrifi4s. Tout de suite apras entra le cafegiudu boyard [...] [un jeune gargon trds beau et impeccablement habill1]. Il ve-nait avec un plateau d'argent dans ses mains, sur lequel 4taient mis, dans leurszarfs de filigrane, plusieurs feligens pleins de cafd dArabie 1cumeux et parfu-mi ; aprds fui entra le porteur de chibouques (ciubucciu) avec les chibouquesd'antet'6 et jasmin, avec leurs pipes remplies de tabac ameubli, de la meilleurequalit4, desquelles sortaient des nuages de fumde parfumde. L'entrde successivede ces domestiques constituait une reprdsentation pittoresque ; connaissant ffasbien les rDgles de la hi4rarchie, comme tous les servants des grandes maisons,ils commencirent d'abord avec beizadd costache, et continuirent par la suiteavec les autres, en remplissant leur devoir avec dl4gance et exactitude " (1963 :
I20-l2l). Le rituel du caf6 s'avdre ainsi 6tre une opportunit6 de plus pour ex-primer les diffdrences sociales, pour confirmer et renforcer la hi6rarchie socialeen place.
Lucy Garnett, une des rares occidentales d t6moigner sur la vie au sein desharems turcs, nous livre une description trcs similaire d la prdc6dente, bienque cette fois I'action se ddroule e Istanbul. on retrouve le mdme rituel et lesmdmes objets, d une diff6rence prds : le tabac, consomm6 ici par les femmes,sous la forme des cigarettes. on y montre le mome soin envers la hidrarchie so-ciale, strictement respect6e par la suite pendant le repas 2 " 1,...1 une kalfa ou ser-vante-en-chef, entre dans la pidce portant sur un plateau, ornd d'une servietterouge richement brodee, le versant d cafd, les petites tasses en porcelaine, etdes zarfs, comme on nomme les supports des tasses faites en or et argent. Elleest suivie par toute une troupe de jeunes esclaves, qui avancent une par une auplateau, remplissent une tasse de caf6, la mettent dans le zarf, et la pr1sententaux invitdes en conformitd avec leurs rangs, qui sont de leur devoir de ques-tionner par avance, ceux avec des rangs lgaux 6tant servis simultaniment. [...]Des cigarettes sont maintenant remises sur un plateau d chaque dame stpar6-ment, et apris qu'elle en a ajust4 une dans son embouchure, une autre esclaves'approche avec un tison de charbon rougit sur un petit ptat en laiton, afin depouvoir I'allumer. Apras que toutes les cigarettes sont allumtes, les esclaves seretirent vers la partie la plus basse de l'appartement oil, rang1es en ligne, ellesrestent ddbout avec les bras croisds sur la poitrine et avec les yeux modestement
26 Yari€tl de griottier avec le bois odorif6rant utilis6 dans la fabrication des chibouques.
Le caf1 au croisement des deux mondes
baisses vers le bas jusqa'au moment oi leurs services sont d nouveau deman-
dds pour enlever les tasses d caf6. Dans l'intervalle elles prennent, tout mAme,
de mani\re furtive des notes mentales sur les robes, les conversations et les ma-
niires des invities qui, [...] de leur cbt6, examinent d'une manidre uitique cette
galaxie de beautts [...] " (1909 :276277).Le rituel oriental du caf6, de la.. doultchaz, et du ,,chibouque > - pour
utiliser la transcription originale de Stanislas Bellanger (1846) -, apog6e des
bonnes manidres des classes ais6es de Bucarest pendant plus d'un sidcle, semble
s'6vanouir peu h peu dans la deuxidme moiti6 du XIX" sidcle. Ulysse de Mar-sillac, frangais dtabli d Bucarest, d6plore en1877 la disparition de toutes ces ha-
bitudes " originales " des Roumains, face aux autres, importdes depuis l'€tran-ger (1999 : 129).Il semble ainsi oublier qu'en fin de compte, elles-aussi 6taient
venues d'ailleurs.
Les caf6s i Bucarest
Avant la deuxidme moiti6 du XVll" sidcle, les seuls lieux de rencontre en dehors
du cadre priv6 6taient les bains publics et les tavernes.
Les quelques bains publics de Bucarest, situ6s surtout auprds des auberges,
des hdpitaux et des monastdres auxquels ils appartenaient, dtaient au d6but fr6-quent6s par des 6trangers, pour la plupart des commergants de passage. Ce n'est
que vers la deuxidme moiti6 du XVII" sidcle, quand la ville connait un grand
afflux d'6trangers d'origines diverses, qui s'6tablissent pour y ouvrir des com-
merces et des magasins, que fhabitude se r6pand parmi les autochtones. Les
boyards et les commergants valaques prennent vite le gott et commence )r s'y
rendre plut6t pour chasser l'ennui, que pour se soigner ou se laver (Potra 1990 :
264279).Quant aux tavernes et aux < celliers ", elles se trouvaient en grand nombre i
Bucarest, cons6quence directe des nombreux vignobles 6parpill6s partout dans
la ville. Les vignobles, de m€me que les dtablissements ot) I'on vendait les pro-
duits qui en 6taient issus, appartenaient aux princes, aux boyards ainsi qu'aux
monastdres, qui en tiraient de grands profits. Ayant la permission de rester ou-
verts une partie de la nuit,z1 les tavernes ne jouissaient pas d'une trds bonne 16-
putation auprds des habitants. On les accusait souvent d'entretenir des meursdouteuses, en raison des d6bordements dus )r I'alcool et de la pr6sence des fillesde joie.
75
27 Voir plus loin I'ordre donn6 par les autoritds locales de la ville au 3 novembre 1798.
76 Irina Stahl
Dans ce contexte, les premiers caf€s viennent combler une place rest6e videdans I'espace public de la ville : celui d'un 6t4blissement respectable, oi I'onpouvait se retrouver pour discuter et se distraire, tout en consommant des bois-sons non alcoolisees. Les cafds deviennent ainsi les premidres < tavernes sansvin ,, d'aprcs I'expression de Ralph Hattox (1996 :79). on ne dispose pas d'in-formations suffisantes pour indiquer avec certitude quelles 6taient les cat6goriessociales qui fr6quentaient ces premiers cafts. Ndanmoins, d'aprds les quelquessources qu'on a pu trouver, il semble qu'ils rassemblaient surtout des gens desclasses moyennes de la ville et des €trangers. c'est ici que venaient, pour pas-ser des moments agr6ables, tous ceux qui ne disposaient pas des moyens pour sepermettre d'organiser des rdunions plus cofiteuses chez eux. En ce qui concerneles habitants de la haute soci6t6, il est plut6t probable qu'ils pr6f6raient passerleur temps dans un cadre priv6, oi ils pouvaient disposer du luxe qu'exigeaitleur rang. Le caf€, avec tout le c6r6monial qui en d6coulait, s'6tait d'ailleurs viteimpos6 comme " le corollaire indispensable de I'hospitatit| " (Georgeon 1997 :
52), exhib6 d chaque visite - passe-temps favoris des boyards et des boyardes.La premidre attestation documentaire d'un caf6 (cahvenea)28 d Bucarest date
de 1667 ; pour autant, nous n'avons pas la certitude qu'il s'agit du premier 6ta-blissement de ce genre d avoir 6t6 ouvert. Le caf6 en question appartient e unTUrc, un certain Kara Hamie, ancien seimen2e auprds du palais imp6rial d'Is-tanbul (Ionnescu-Gion 2003 : 690). Aprds la mort de son propri6taire, et commecelui-ci n'avait pas laiss6 d'h6ritiers, l'dtablissement entra dans la possession deI'Empire ottoman. Il sera revendu par la suite d un autre Turc, nomm6 Kavazbaga, en d6cembre 1691 (Potra 1990 : 386).
En 1693, on apprend l'existence d'un autre caf6 encore appartenant i unTnrc, appel6 Ivaz (Potra L990:387).
A la m€me 6poque, un caf6 situ6 sur le pont du Bey (podul Beilicului), ruepar laquelle entrait dans la ville la procession princidre, chaque fois qu'un nou-veau prince 6tait install6 sur le tr6ne de la valachie, b6n6ficiait d'un statut privi-l6gi6. car comme sur la m€me rue se trouvait I'auberge oi 6taient h6berg6s lesenvoyes de La Porte, les beys, c'est en leur honneur que le caf6 qui s'y trouvaitn'6tait jamais ferm6, ni mdme en temps d'6pid6mie (Ionnescu-Gion2o}3 :397).
Dds le xvIII" sidcle les attestations de caf6s se multiplient (Georgescu et al.1960, Potra 1961, Potra 1975). En regardant de plus prds les noms de leurs pro-pri6taires, on constate que, tout comme cela a €t6,le cas dans d'autres pays euro-p6ens, les premiers cafts ) Bucarest ont 6t6 ouverts par des 6trangers. La plupart6taient des Turcs ou des Arm6niens venus de I'orient, oi de tels 6tablissements
28 Du turc kahvehhne.2e sous-division des yanicbres, soldats du corp d'61ite de I'ancienne infanterie turque.
Le caf€, au croisement des deux mondes
existaient d6jd depuis longtemps, en s'av6rant 6tre des affaires prospdres. Avecle temps, les Roumaini finissent par s'habituer au nouveau commerce et devien-nent d leur tour des cafegii.
Lieux de rencontre par excellence, les caf6s ont des le d6but 6t6 vus commeune menace par le pouvoir en place, et en consdquence mis sous surveillance parpeur des troubles et des discussions i tendances politiques. Des ordres stricts in-terdisaient de telles manifestations.
Dds que la grogne envers les fiscalit6s excessives exerc6es par les princescommengait i monter, des mesures rdpressives 6taient prises. Les caf6s de laville, of des discussions sur tels sujets pouvaient ais6ment s'enflammer, 6taientles premidres vis6es. C'est ainsi, qu'en 1782, le prince Nicolae Caragea ordonneh tous les propri6taires de caf6s de la ville de ddfendre dans leurs dtablissementstoutes discussions concernant le pouvoir local, La Grande Porte ou toute autrenouvelle, sous peine d'6tre eux-mdmes punis (Urechia I89I :245). Pour dissua-der de tels comportements, il fait savoir que des espions ont 6te envoy6s en ce
but.30 Les peurs du prince 6taient, parait-il bien fond6es, car il sera bientdt r6vo-qu6 de ses fonctions par La Porte.
Son successeur, Mihail $utu, ayant 6t6 regu dds son arrivde avec m6conten-tement dans le pays, donne I'ann6e suivant un ordre similaire, qui interdit tous<propos qui ne convient pas 'r. Par peur des r6voltes, il ordonne aux agents depolice (zapcii) d'aller en secret dans les caf6s afin de v6rifier si son ordre est res-pect6, et sinon de proc6der d des arrestations (Urechia 1891 : 307-308).
Sous l'occupation autrichienne, en 1790, les caf6s sont ferm6s pendant unmois. On invoque la peur des incendies : " le feu qui brfile dedans est un inces-sant motif de danger ", mais le vrai motif reste toujours le rassemblement desgens, < des dtrangers et des bons d. rien " (Urechia 1892: 356). En ao0t de lamdme ann6e, le Divan3l intervient auprds du principe de Saxe Cobourg pour de-mander I'ouverture des caf6s. On invoque le sort des propridtaires qui n'ont au-cune autre source de revenus. A leur tour, ces derniers se portent garant qu'iln'y aura pas de discussions (muSaverele) ou d'autres paroles contre les occupants(Urechia 1893 : 508).
Pour des raisons de s6curit6 publique, mais aussi pour 6viter toute activitequi pourrait porter atteinte h la morale, les autorit6s locales prennent soin de 16-
glementer les heures d'ouverture des caf6s. Par un ordre datant du 3 novembre1798, on oblige les caf6s et les bains publics h fermer leurs portes i quatre
30 Envoyer des espions dans des cafds de la ville 6tait une pratique courante e Istanbul, oi l'onraconte que parfois m€me certains sultans se rendaient d€guisds sur place pour ddcouvrirles sujets de m6contentements de la population (Georgeon 1997 : 4l).
3r Conseil d'6tat.
77
78 Irina Stahl
heures de I'aprds-midi,32 pendant qu'on permet aux tavernes et aux dpiceries derester ouvertes jusqu'h une heure et demi de la nirit (Urechia 1894 : 185, 485).Lexplication de cette mesure partielle se trouve probablement dans les gains im-portant apportes par la vente des vins dans les tavernes, que I'on n'avait aucunint6r6t d freiner.
Le RDglement pour la sftretd de la ville de Bucarest et des autres villes dupays, r6dig6 en 1820 (une ann6e avant la r6volution de 1821), ordonne la misesous surveillance des caf6s, dans le but de les emp€cher d'abriter des malfaiteurset de faiseurs de troubles (Potra 196I:741).
Une loi de 1867 stipule qu'aucun caf6 ne peut €tre ouvert sans l'accord pr6a-lable de la police municipale qui, dans ce but, demande d I'int6ress6 de fournirdes t6moignages de la part du pr6vdt de sa corporation, des voisins et des prdtresde sa paroisse, tout en faisant des investigations suppldmentaires pour savoir s'ilavait 6t6 condamn6 pr6c6demment ou mdl6 d des affaires douteuses. Les fillesde joies, les jeux de hasard et les r6unions tumultueuses sont fortement d6fen-dues, de m6me que de passer la nuit dans un caf6 aprds I'heure de fermeture d6-cid6e par la police de la ville (Bujoreanu 1873 : 816-818).
Le nombre des cafds d Bucarest augmente rapidement. En 1786, lAnglais Je-remy Bentham consid6rait qu'ils se trouvent en grand nombre (Cdldtori streini2000 : 7Il). A la mOme conclusion arrivera le prince Alexandru lpsilanti, quid6sapprouvant le ph6nomdne demande, en L797, qu'on lui r6dige une liste detous les caf6s de la ville, y compris les noms de leurs propridtaires. En quelquesjours seulemenl, Vel Aga de la ville va lui remettre les noms de quatorze ca-f6s, auxquels s'ajoute une demande d'ouverture d'un nouveau caf6. Prenant actedes faits, le prince interdit toute future ouverture de caf6 en consid6rant queI'augmentation du nombre de caf6s n'est d'aucune utilit6 pour la ville, bien aucontraire, la corrompt (Urechia 1894: I43). Il saisit l'occasion pour interdiretous jeux de cartes dans les caf6s, tavernes ou autres 6tablissements publics dela ville (Urechia 1894 : 143).
En 1816, lAutrichien Ludwig von Sttirmer note que les caf6s sont plus nom-breux encore que les tavernes, affirmation 6videmment exag6r6e (Cdl[toristrlini 2OO4 : 712). Plus vraisemblable parait le chiffre offert en 1832 par leLivre des brevets, qui indique un nombre de trente-huit cafegii, (parmi lesquelsseize 6taient d'origine arm6nienne, i en juger d'aprds leurs noms) (Giurescu1966 : 281). En 1906, Fr6d6ric Dam6, publiciste frangais dtablit lui aussi dans lacapitale roumaine, note dans sa monographie sur la ville de Bucarest, l'existence
32 A Istanbul, par contre, les caf€s restaient ouverts une partie de la nuit, en 6clairant avecleurs lampions la ville, avant I'introduction de I'dclairage public.
Le caf€ au croisement des deux mondes
de quatre-vingt-dix magasins de caf6 et de cent deux cafegii, cela pour une po-pulation estim6e e 300000 habitants (Dam6 2OO7 : 146, 149).
IJaugmentation du nombre de caf6s dans la ville pousse les propri6taires (ca-
fe7iil it s'organiser. Leur corporation, fond6e conjointement avec les marchands
de cigares et de tabac (tutungii et tabaccii), avait pour f0te le jour de la Sourcegu6risseuse, c6l6br1 chaque ann6e d l'6glise homonyme, 6rig6e en 1787 par Ni-colae Mavrogheni33 (Ionnescu-Gion 2003 : 7 45).
A partir du XIX" sidcle, dans les r6cits de voyage des dtrangers arriv6s d
Bucarest de I'ouest de I'Europe, on retrouve une distinction nette faite entre ce
qu'ils appellent les < cafi1s turcs >, ou << d la mode turque ", et les ,, cafds euro-pdens " de la ville. Il faut remarquer au passage que, d'aprds les sources localesqu'on a pu consulter, il est 6vident que les autorit6s locales et les habitants de laville eux-m€mes, ne se prdte pas )r une telle distinction. Car pour eux la diff6-rence qui s'opdre entre les 6tablissements est surtout celui entre ancien et nou-
veau et, comme on va la voir plus loin, quand il sera la question des diff6rentescat6gories de cafegii reconnus par la loi des patentes, ce qui compte est la nou-
veaut6 des services propos6s i la clientdle. Dans une soci6t6 qui cherche ) toutprix aller en avant, la nouveaut6 devient l'6quivalent de la qualit6 et du prestige.
Suite i son passage )r Bucarest en 1815, le frangais Frangois Recordon nous
livre une des rares descriptions des caf6s d la manidre turque de la capitale va-
laque: o Outre les cafds europdens, qui sont assez nombreux d Bucarest, on
y en trouve aussi plusieurs d la manidre turque, qui dffirent des ndtres en ce
qu'ils consistent seulement en une grande salle entourde d'un large banc gar-ni de nattes ou de tapis et de carreaux, sur lesquels on s'assied d la fagon des
Turcs pour y fumer, et y boire du cafd que I'on apporte aux personnes qui ontpris place dans un de ces endroits de rdunion, et sans qu'elles le demandent. Ily rAgne ordinairement un profond silence, quoique l'on y soit assez nombreux ;et s'il est quelquefois interrompu, ce n'est que par le bruit que font des ioueursde dames ou d'6checs, ou bien par la danse, le chant et la musique des tziganes,jongleurs et menAriers, dont les contorsions et les postures inddcentes divertis-sent beaucoup les spectateurs, qui sont le plus souvent des gens de basse condi-tion, car les personnes d'un certain rang ne frlquentent iamais ces caflls, unegrande-partie des seigneurs valaques ayant chez eux des billards, oil ils pas-
sent le temps qu'ils ne consacrent pas aux affaires ou d d'autres occupations "(1821 : 2526). I- int6rieur, comme celui des maisons priv6es de la ville, est peu
meubl6 : juste quelques divans ori I'on s'assoit ) la manidre turque, les jambes
crois6es, pour boire son caf6 et fumer sa pipe. Les distractions sont simples, car
33 L'6glise Mavrogheni existe encore de nous jours. Elle se trouve d I'intersection de la rue
Monet[riei et le boulevard Kisselef, non loin de la Place de la Victoire.
79
80 Irina Stahl
elles s'adressent ) une clientdle form6e en majorit6 d'illettr6s : des jeux de so-
ci6te (6chec, dames, trictrac), des jeux d'ombre,3a de la musique (interpr6te par
des tziganes), parfois des danses ou des spectacles de rue. On y discute, on ap-
prend les dernidres nouvelles, on s'informe. Ludwig von Stiirmer fait n6anmoins
remarquer le fait que ces caf6s <, ne jouissent pas d'une trds bonne rdputation "(Cdlltori str[ini 2004 : 7I2). Ses affirmations sont confirm6es par le m6decin
valaque Constantin Caracag qui tdmoigne du fait que seuls o les gens des classes
infdrieures les friquentenl ),, aussi bien que les 6trangers (Samarian 1937 : 118).
Il faut noter qu'ir part les 6tablissements qui lui 6taient d6di6s, le caf6 pou-
vait 6galement 6tre consomme dans les bains publics, qui disposaient des pidces
spdcialement amenag6es d cet effet.3s Un inventaire des objets utilis6s au bain si-
tu6 prds de lAncienne Cour et datant de 1826 en t6moigne. On y mentionne des
poples pour brfrler le caf6, moulin pour le broyer, tamis pour le tamiser, des ca-
fetidres (ibrik) en cuivre ou en fer-blanc pour la pr6paration, des filigene et des
Zarfs entombac et en argent pour le servir, des petites cuilldres pour le sucre et
la confiture, des petits plateaux en laiton pour le service du caf6, d'autres petits
plateaux pour servir les chibouques en bois de faux platane, avec les t6tes en
os et en ambre, des vases pour servir la confiture etc. (Potra 1975 : 90). LAn-glais James Edward Alexander, qui se trouve d Bucarest la m€me annde, nous
confirme les faits. Il nous livre une description d6taill6e sur la fagon dont lui-mOme et ses amis ont pass6 du temps dans ce qu'il appelle des " bains turcs >>,
oir ils se rendent aussitdt arriv6s. A la fin du bain, raconte-t-il, < nous avons
fumd des narghiles, bu du cafd et pris une cuillire pleine de confiture et un yerre
d'eau. La dernidre partie de ce procddd ldnbainl est bien mieux organisd qu'en
Perse , (Cdlitori strlini 2005 : 157).Il en est de m€me pour Gustav Adolf Ram-
say, lieutenant-colonel dans l'arm6e russe, qui nous raconte comment en 1829,
i Iassy, il b6n6ficie d'un traitement similaire, dont il gardera un agrdable sou-
venir (Cdlltori strlini 2005 : 390). Quelques anndes plus tard, Anatole de De-
midoff fait lui aussi I'experience des << excellents bains turcs " de Bucarest, qu'il
d6crit et conseille ir tout voyageur fatigu6 qui arrive dans la capitale valaque.
"1...f Aussi est-it bien d ddsirer que les usages de Vienne et de Paris, qui ten-
3a On peut supposer que les jeux d'ombre appel6s karagdz en turc, 6tait en vogue iL Bucarest
aussi, car la langue roumaine garde encore de nous jours le mot caraghios pour d6signer
quelque chose ou quelqu'un d'amusant, d'hilarant.35 MOme si on ne dispose pas d'informations suffisantes sur les bains destin6es aux femmes i
Bucarest, on ne peut s'emp€cher de rappeler I'expression " cafis des femmes ", employ| par
Lady Montague pour d6signer les bains qu'elle a pu visiter i Sofia (1981 : 134). Les caf6s
restent longtemps un espace exclusivement masculin. A Paris, aux XVII" sidcle, les femmes
qui voulaient boire un caf6, arretaient leur voiture en face du Cafi Procope, et demandait
qu'on leur apporte la boisson d6sirde.
Le cafd au croisement des deux mondes
dent d s'impatroniser de plus en plus d.ans cette capitale, y laissent subsister
les deux seules choses pefi-etre dont le Turc puisse se faire honneur, les seules
que I'Europe puisse encore aujourd'hui envier d la civilisation de l'Orient, d sa-
ioir : le batn et le caf6,,, s'exclame-t-il (1840 : 117). Reste encore d d6terminer
les raisons qui poussent ces voyageurs h appeler les bains publics qu'ils fr6quen-
tent dans lei grandes villes roumaines, des bains turcs, ne serait-ce que pour la
simple raison qu'on y servait du caf6 dL la manidre turque.
bCr tu fin du XVI[" sidcle, un concours de circonstances apporte un souffle
nouveau sur la soci6t6 bucarestoise. Le premier consulat russe voit le jour d
Bucarest en 1782;36 il est suivi par ceux des autres grandes puissances euro-
p6ennes, ce qui mettra la soci6t6 valaque en contact direct avec les mcurs et
ies coutumes u"n r"t de I'ouest de I'Europe. Les jeunes boyards envoy6s dtudier
dans les grandes universit6s de Paris, de Vienne ou d'autres capitales de I'Eu-
rope, ne iarderont pas e rentrer au pays, en apportant avec eux' outre de nou-
veaux vdtements, des nouvelles habitudes. Parmi celles-ci, la fr6quentation des
caf6s. Mais les 6tablissements qu'ils requidrent ltaient diff6rents de ceux d6jd en
place. c,est ainsi que les premiers < cafes europaens >, comme les nomment les
uoyug".r.r venus d;Europe, vont faire leur apparition d Bucarest. Ils vont fonc-
tionner ) c6t6 des anciens caf6s de la ville pendant plusieurs d6cennies, avant
que ces derniers ne commencent peu d peu d disparaitre'
Les nouveaux caf6s sont meubles de tables et de chaises, plus ad6quates pour
les nouveaux vetements portes par leur clientdle que les anciens divans. Sur les
murs sont suspendus des miroirs, qui 6claire et d6gage I'atmosphbre . Lapr'para-
tion du caf6 change, elle aussi. A part le caf6 noir, on offre 6galement du caf6 au
lait, d'aprds la mode de Londres et de Vienne. La boisson, autrefois servit dans
des ftligean avec des zarfs, esI maintenant apport6e dans des tasses de porce-
hinl, provenant dAllemagne ou de France. Outre le caf6 sont offerts du choco-
lat et du th6 mais aussi de la bidre. Les longues pipes sont remplac6es par des ci-
gares et les sucreries orientales par des pAtisseries frangaises et viennoises. Mais
ie qui fera la nouveautd des lieux, ce sont les journaux. En s'adressant ) une
clientdle lettree, familiarisde aux diff6rentes langues europ6ennes et " avide des
nouvelles du monde politique " (Demidoff 1840 : 144),les patrons des nouveaux
6tablissements mettent d sa disposition des sources d'informations fiables et va-
ri6es. A c6t6 des tout jeunes journaux valaques, on y retrouve plusieurs journaux
6trangers, des plus connus. Le temps du bouche-ir-oreille est d6sormais r6volu'
En matiere de jeux, une nouveaut6 apport6 de Vienne, le billard, fait son appa-
36 Il est la suite du trait6 de paix sign6 et 1774 d Kutchuk-Kainardji, entre les repr6sentants
de la Russie et de I'Empire Ottoman.
81
82 Irina Stahl
rition d la fin du XVIII" sidcle.37 Le m6me Ludwig von Sttirmer nous informesur sa rapide propagation dans la capitale valaque (Cdl[tori strlini 2004: 7L2).
Les nouveaux services propos6s apportent du prestige aux patrons d'6tablis-sements. Ainsi, la Loi des patentes de 1863 mentionne quatre catdgories de d6-tenteurs de cafds : dans la III" classe - cafegiu, << ayant igalement des articles deconfiserie [cofetlrie] de I'itranger ",'dans la IV" classe - cafegiu, oavec deuxbillards [bilarte] > ; dans la Ve classe - cafegiu, < avec un billard " et dans laVI" classe - cafegiu, " simple, sans billard,,38 (Bujoreanu L873: 1258,1272).
Un nomm6 Fialkowski, polonais d'origine, ouvre d l'automne 1856 uneconfiserie avec un caf6, dans la maison Trirok, rue CAmpineanu. Aussit6t il pu-blie une annonce dans unjournal local pour le faire connaitre aux habitants dela ville. Le texte, 6crit dans un roumain maladroit et d l'endroit incorrect, estparsemd de mots emprunt6s au frangais ou d I'anglais: o Dans ce nouvel ita-blissement, d€cord d'un luxe tout d fait parisien, se trouve fsicl des bonbons deParis de premiire qualit|; le carton le plus riche et le plus dl4gant ; des bon-bonniDres, des bottes pour le Nouyel An, corbillons de mariage et al. 1...1. Ony retrouve quotidiennement de h pAfisserie fratche, glteaux-montes, petit-pAt6set des stxprises en sucre des plus vartdes. Cet 1tablissement dispose d'un sa-lonfashionable, pareil d ceux que l'on retrouve d Paris, et qui est mis d la dis-position des consommateurs du caf6, du chocolat et du the. A partir du NouvelAn, les clients vont aussi pouvoir y retrouver les dffirents journaux frangais,allemands et roumains et passeront ainsi des heures agrdables [.. .] " (VestitorulRomdnesc 1856 : 2; cf. Potra 1990 : 392). Le caf6 6tait compos6 d'une pidceprincipale, avec des tables et deux billards, ainsi que d'une deuxidme pidce, pluspetite, oi lbn jouait au trictrac et au domino. Aprds 1870 surtout, il devient lelieu de rencontre privil€gi6 pour les politiciens, surtout lib6raux, mais aussi ce-lui des gens de lettres et de th€Atre.
Lann6e suivante, suite au succds qu'avait connu le caf6 de Fialkowski, Wil-helm Ungar, propri6taire de I'h6tel de Londres, situ€ sur le Pont de la Foiredu Dehors, d6cide d'ouvrir lui aussi un caf6, i I'int6rieur de son 6tablissement.Lannonce qu'il fait publier d cette occasion fait valoir_de la grande vari6t6 desjournaux qu'on puisse y retrouver : " Le soussign4, voyant que dans cette ca-pitale de la Roumanie il n'y a pas suffisamment de cafds qui correspondent auddsir et d la demande de l'honorable public, a I'honneur de vous annoncer di-
37 La premidre mention d'un billard date de 1786 et nous est apport6e par l'anglais JeremyBentham, qui dit avoir rencontr6 un vdnitien, Michel ou Michele, qui tenait un billard etune confiserie (cofetdrie) i Bucarest et qui fournissait le consulat rus de Bucarest en sucre-ries (CilItori strdini 2000 : 7l l).
38 La loi comprenait en tout huit cat6gories professionnelles, par rapport auxquelles un imp6tannuel €tait pergu.
Le caf6 au croisement des deux mondes
manche prochain, d l'Hdtel de Londres, I'ouverture d'un cafd qui, en mafiAred'6ldgance, peut rivaliser avec les plus grands d'Europe. Ce cafd, complDte-ment ddcord d neuf, dispose de deux billards apporft de Vienne, ainsi que d'unesalle de lecture, oit l'on retrouve des journaux roumains (Romhnul, AnuntrdtorulRomAfl, frangais (lournal de Francfort, Charry-Varry), allemands (Fremden-blatt, Pesther L'loyd, Telegraf, Ost. Novellen Zeitung, Leipziger llustite, Wan-derer, Bukurester Deutsche Zeitung), italiens (Oservatore Tiestino, Trovatore,Indicatore, La Pirata), grecs (Jurnalu\ 1...1" (RomAnul 1857:4; cf. Potra1990 :396).
Diff6rentes cat6gories socioprofessionnelles et ethniques arrivent i se re-grouper autour de certains caf6s. Ainsi, le caf6 Chez Brener, de la rue Stavro-poleos, devient le lieu de rencontre des propri6taires terriens et des fermiers, laplupart des grecs (Bacalbaga 1987 : 67). Le caf6 Bressol, situ6 dans le PassageRoumain et propri6t6 d'un frangais 6tabli e Bucarest, est le lieu de rencontre desfrangais. D'aprds L6on Hugonnet, qui visite l'6tablissement en L872, s'y trou-vaient: " [...] si,r billards, les journaux rdpublicains et lesfeuilles illustrdes deParis, les organes de la localitd et l'Indipendance belge " (1875 : 68). Les coll6-giens, les 6tudiants et les jeunes en g6n6ral se rencontrent au caf6 Fieschi delarue Selliers of ilsjouaient au billard (Bacalbaga 1987 : 66), etc.
Pendant les dernidres ddcennies du XIX" sidcle, le caf6 Fialkowski est en d6-clin ; il ferme en 1898, suite aux ddcds de son propri6taire (Bacalbaga 1987 :
65 note I94). A sa place, un autre caf6 impose son nom, un nom qui fera his-toire : caf6 CapSa. Son origine se trouve dans une affaire de famille, mont6e dds1852 par deux frdres, Anton et Vasile Capga, qui ouvriront une confiserie. En1881 (ann6e de proclamation du Royaume), I'affaire, situ6e sur la trds fr6quen-t6e voie de la Victoire, s'agrandit avec le caf6, I'h6tel et le restaurant du mdmenom. GrAce d son propridtaire de l'6poque, Grigore Capga, devenu membre duParti Conservateur, le caf6 CapSa s'attire vite une clientdle politique, qui passeson temps dans de vives et d'interminables discussions sur les grandes questionsdu pays, mettant au point les campagnes de presse, pr6parant des coups contreles adversaires ou mdme critiquant ouvertement La Couronne. Aux politiciens,pour la plupart membres de la haute soci6t6 roumaine, anciens boyards et grandspropri6taires terriens, vont s'ajouter de nombreuxjournalistes, en qudte des der-nidres nouvelles du monde politique, mais aussi d'autres cat6gories d'intellec-tuels (6crivains, podtes, publicistes, chroniqueurs, peintres et autres), de la bour-geoisie monrante (Potra 1990 :407-408).
Dans cet univers masculin, les femmes peinent d trouver leur place. Tenues) l'6cart des discussions et des d6bats, elles font pour autant partie des divertis-sements. Mais aux diners et soupers donnds dans les salons privds de l'6tablis-sement CapSa, seules les femmes aux mcurs l6gdres, com6diennes ou chan-teuses, sont invit6es. Quant aux autres, les femmes respectables, jamais elles
83
84 Irina Stahl
n'entreraient dans ce genre d'endroit. Les seuls liens qu'elles puissent avoir avecun caf6, ce sont les regards appuy6s des hommes assis en terrasse qui n,h6si-tent pas parfois i leur jouer des mauvaises tours lorsqu'elles passent devant eux(Bacalbaga 1987 : 88 ; Crutzescu 1987 : 130-133,2I0).
Les deux types de caf6s, d la turque et d l'europ €enne vont coexister pendantune grande partie du XIX" sidcle, jusqu'i ce que les premiers, de la m6me ma-nidre que le costume oriental, rejetds par la classe ais6e, soient repouss6s vers lap6riph€rie de la ville, oi ils continueront d'6tre fr6quent6s par les habitants decondition modeste. cela va s'ajouter i I'image d6jd contrast6e de Bucarest, et enfera sa particularit6. car, selon Ami Bou6, dans la premibre moiti6 du sidcle, leph6nomdne singularise la capitale valaque dans la r6gion du sud-est de l,Europeot, d l'exception de quelques villes serbes, les caf6s ,, d I'allemande r, oil,onpouvaitjouer au billard et boire de la bidre et des liqueurs, n'6taient pas encorearriv6s (1840:255).
Conclusions
Sans reprendre ce qui a 6G dit pr6c6demment, revenons sur quelques aspectsque nous trouvons essentiels pour la compr6hension de l'6mergence et la propa-gation des pratiques li6es au caf€ d Bucarest. Afin de mieux comprendre le pro-cessus, dans nos commentaires finaux, nous avons suivi les quatre principalesdirections de tout changement social, propos€es par Pitirim Sorokin, c'est-i-dire : quantitative, qualitative, temporale et spatiale (1937 : L53-194). Cepen-dant, pour des raisons qui d6coulent de la complexitd des faits, tout comme de lalogique de I'expos6, celles-ci ontete int6gr6es dans deux axes majeurs d'analyse,comme il est montr6 par la suite :
a) Axe d'analyse quantitative et qualitativeProduit rare, le caf6 est d ses d6buts implicitement un produit de luxe, achetd etconsommd par la haute soci6t6 et en g6n6ral par tous ceux qui disposaient desmoyens pour se le permettre. Les premiers d I'exhiber sont les princes. Les hautsdignitaires de la cour et les autres boyards ne font que prendre leur exemple, enimitant au plus prds leurs moindres faits et gestes. Les classes moyennes d leurtour imitent les boyards, avec les moyens dont elles disposent. Le processus a 6t6dans les moindres d6tails d6crit par Norbert Elias (1973-1976), dans son analysesur la soci6t6 frangaise. Au-deli du gofit, la consommation du caf6 prend l'aspectde ce que Thorstein veblen (1899) appelle vne consommation ostentatoire, desti-nde d t6moigner du statut social de la personne, de sa position dans la hi6rarchie
Le caf6 au croisement des deux mondes
sociale. Par le temps qu'on lui alloue, elle est aussi un loisir ostentatoire, marquede distinction pour ceux qui disposaient d6sormais du temps i lui consacrer.
Le moment or) le prix du caf6 commence i baisser, en le rendant plus ac-cessible aux autres catdgories sociales, ce n'est plus la consommation du pro-duit, mais la manidre dans laquelle cela se fait, la performance, qui apporte dela distinction d la personne. Le rituel du caf6 se ddveloppe, allantjusqu'i adop-ter des allures de c6r6msnie, oi chaque geste est cont6 et charg6, des sens. C'estun vrai spectacle qui se d6roule devant les yeux des invit6s, i la comprdhensionduquel la th6orie d'Erving Goffman (1959) sur la gestion de l'impressio,n, nouslivre une des clefs. En allant encore plus loin, on pourrait affirmer que le caf6h l'effet paradoxal de rassembler et en m€me temps de distancer les personnescar, pendant la c6r6monie qui s'y d6roule autour de la recherch€e boisson, lesdiff6rents statuts des personnes pr6sentes sont confirmds, fait qui renforce lahi6rarchie sociale en place.
Une fois la consommation du cafd d6plac6 depuis I'espace priv6 vers I'espacepublic, ces aspects tendent i s'estomper, laissant la place aux autres. Choisirl'6tablissement d fr6quenter prend aussit6t le dessus. Les premiers caf6s euro-p6ens, sont tout aussi recherchds par les classes ais6es de la ville, que la boissony 6tait b ses ddbuts. Mettant iL la disposition de leur clientdle des produits nou-veaux et rares, des produits de luxe, les fr6quenter d6montre bien une consom-mation ostentatoire, tout comme y passer des longues heures repr6sente un loi-sir ostentatoire. Mais au-deld des produits et des distractions qui s'y retrouvent,c'est < un vdritable choix de sociAti " qui s'exprime, pour reprendre l'expressionde Frangois Georgeon. " Situis au ceur du processus de modernisation, lescafds avaient fini par €tre, l..l des rdvdlateurs d'une mentatit| progressiste ouconservatrice. Dis-moi quel cafd tu frdquentes, je te dirai qui tu es ", r6sume lem€me auteur (1997 : 64). Udloignement vers la p6riph6rie des anciens caf6s, dla turque, avant leur disparition totale du paysage de la ville, devient ainsi l'ex-pression spatiale d'un changement beaucoup plus profond qui s'opdre au sein dela soci6t6 roumaine.
Llavdnement des caf6s europ€ens i Bucarest correspond d une pdriode degrands bouleversements politiques et sociaux. Cependant, c'est autour de laguerre d'ind6pendance (1877-1878), qu'ils s'imposeront en tant qu'espaces pri-vil6gi6s de discussions et de ddbats. Certains, comme le caf6 Fialkowski ou lecaf6 CapSa, seront les premiers espaces publics (Habermas 1989) de la capitaleroumaine ainsi que des instances marquantes del'opinion publique. Car, commeI'affirme un t6moin de l'6poque, au-deld des simples cafds, ils finiront par deve-nir des v€ritables institutions (Bacalbaga 1987 :66).
85
86 Irina Stahl
b) Axe d'analyse temporale et spatioleEn ce qui concerne le processus de propagation, on ne peut pas s'empOcherde remarquer le fait que le caf6 semble avoir 6t6 adopt6 ptur uit" i Buiarest,que dans les autres villes de l'Europe centrale et de I'ouest (d I'exception deLondres). Les raisons r6sident dans une multitude de facteurs qui concernentaussi bien sa proximit6 gdographique envers I'Empire ottoman, l,emplacementparticulier de la ville (situ6 aux carrefours des plusieurs routes commercialesimportantes qui assuraient la liaison entre I'orient et l,Europe centrale et deI'est), que la situation socio-politique particuliere que connait li valachie depuisle XVII" sidcle, quand elle fut mise sous la tutelle de La porte.
Ainsi, d6jd sensibilis6s aux nouvelles modes et habitudes venues d'Istanbul,les Valaques adoptent aussitdt la nouvelle boisson. Leur fagon de la pr6parer, dela consommer et mdme de la servir est presque d I'identique que chez les Turcs.Les premiers cafds de Bucarest sont ouverts par des Turcs ou des Arm6niens ve-nus d'Istanbul, qui ont repris le moddle des caf6s d6jd existants depuis plus d'unsidcle dans la capitale de I'Empire. sur la dur6e, on constate peul'innovationsi une exception prds : la musique, car les valaques semblent plut6t appr6cier lamusique locale, souvent interpr6t6e par les tarafs des tziganes, que ia musiqueturque, r6serv6e au prince et aux c6r6monies de la Cour.
Avec I'arrivde des princes phanariotes, qui reprennent i la lettre les c6r6mo-nies d'Istanbul, les habitudes ) la turque vis-i-vis du caf6 vont se stabiliser ets'enraciner dans la soci6t6 valaque. par une ironie du soft, ce sont les m6mesprinces qui vont contribuer d la propagation des nouvelles pratiques, venues del'ouest, en 6tant parmi les premiers d envoyer leurs fils 6tudier dans les grandescapitales europ6ennes.
En Europe, la culture du caf6 s'installe dans la deuxidme partie du XVII", oriil gagne peu ) peu du terrain. Mais, aprds une 6volution quantitative, suivra uneautre, qualitative et c'est toujours en Europe que, pendant le sidcle qui va suivre,la boisson originaire du Moyen orient va d6velopper des cultures diff6rentes, endonnant naissance ) des particularit6s locales et d des innovations.
Dans un processus de rebond ot de circularit| (Burke 20L0: 96-99), atd6but du XIX" sidcle, le caf6 revient vers I'orient, en bouleversant d nouveaules habitudes et en changeant encore les soci6t6s rencontr6es sur son passage.Mais ce qui particularise ce processus de retour est le fait qu'il ne ,'ugirr" plu,d'une culture du caft, mais des curtures du caf6. La ville de Brrcaresi subit cesinfluences multiples, qui vont aboutir i I'adoption des 6l6ments divers et va-ri6s, r6unis dans une sorte de m6lange h6t6roclite, i l,image m6me de la soci6-t6 qui I'habite. Des nouveaut6s venues aussi bien de paris, que de vienne et deLondres sont ainsi reprises. Tout comme les habitants qui changent leurs v6te-m€nts, la ville change ses caf6s. On y ouvre des caf6s o,uropinn, >> _ le motn'est pas choisi par hasard, car les nouveaux etablissementr nilont ni . f1n1-
Le caf1 au croisement des deux mondes
gais ", ni o autrichiens ", ni " anglais >, ni << italiens >, mais plut6t un m6lange de
tous les cafts d'Europe. Les nouveaux patrons, des Polonais, des Hongrois, des
Frangais, des Allemands, offrent d leur clientdle des bonbons de Paris, de la pl-tisserie viennoise, du caf6 au lait comme d Londres ou des expressos, commed Rome, servie dans des porcelaines de Saxe ou de Limoges, on met ) leur dis-position des billards apport6s de Vienne et des journaux 6crits dans plusieurslangues europ6ennes. Les innovations sont une fois de plus peu nombreuses. Enmatidre de caf6, une sp6cialit6 locale trds pris6e est le caf6 au rhum connu sous
le nom de son inventeur, marghiloman3e. N6anmoins, nous pourrons dire que
f innovation la plus significative consiste dans la vari6t6 et la diversit6 des pro-duits et des services qui s'y retrouvent, afin de satisfaire la clientdle cosmopo-lite de la grande ville qu'6tait devenue Bucarest, dans la synthdse de diff6rentescultures europ6ennes du caf6 qui s'y opdre.
A Istanbul aussi, les cafds subirent des transformations significatives: les
chaises sur lesquels on peut s'assoit d lafranque font leur apparition, aussi bienque les tables (Georgeon 1997 : 57-58). Mais ce n'est que quelques d6cenniesaprOs leur arriv6e ?r Bucarest, plus exactement au moment de la guerre de Cri-m6e (1854-1856), que les caf6s " europiens,, ou .. d lafranque " vont s'installeriL Galata et d Pera. Comme dans le cas de la capitale valaque, dans les nouveaux6tablissements, la clientdle consomme du caf6 au lait, qu'on sert ddsormais dansdes services de porcelaine de fabrication europ6enne,a0 des liqueurs, des pdtisse-ries viennoises ; les int6ress6s lisent les journaux d'Europe ou bien passent leurtemps en jouant au billard. Comme I'affirme Frangois Georgeon, le caf6 fait ain-si son retour au pays d'origine, mais ce retour se fait " sous une forme qui avait6volu6,, (1997 : 6l-62).
Se situant au ccur m€me du processus de propagation du caf6, Bucarest b6-n6ficie de son positionnement strategique entre les deux mondes, 6tant le pre-mier i adopter les nouvelles modes, qu'elles arrivent d'Orient ou d'Occident.Dans cette zone de contacte (Pratt 1991) par excellence se sont ainsi coudoy6espendant un si0cle, les diff6rentes cultures du caf6 venues d'Istanbul et des capi-tales europ6ennes, dans une synthdse originale, dans laquelle les gagnants se-
ront les derniers.Dans l'6tat actuel de notre recherche, nous n'avons pas d'autres choix que de
laisser nos conclusions ouvertes, tout en langant quelques questions. Sommes-nous, dans le cas de la soci6t6 bucarestoise, dans la logique de ce que le mdme
3e I1 s'agit de Mihail Marghiloman (1819- ?), connu surtout en tant que pr6fet (1860-1861,1863-1865) (Severeanu 2008 : 68).
a0 DEs le XVIII" sidcle, les porcelaines fabriqu6es en Europe, et trds pris6es par les Ttrrcs, fu-rent connus, peu importe leur origine, sous le nom g6n6rique de Saksunya, de Saxe (Des-met-Gr6goire 1989 :71 note 1).
87
88 Irina Stahl
Peter Burke appelle tradition d'appropriation ou tradition < ouvet"te, e0r0:70-:72), comme c'est le cas pour le Japon ? Sommes-nous dans la logique d'unemode pour l'4tranger (Burke 20L0 : 79-g2) ? Les deux facreurs qui lreoispose_raient Bucarest d I'acculturation, mentionn6s au d6but de notre 6iude, semblentdonner gain de cause i ces hypothdses. N6anmoins, un seul morceau de ptzzren'est pas suffisant pour apporter des r6ponses plus nettes. D,autres expressionsde la vie urbaine, comme le nomme clifford Geertz (19g9), devront 6ire analy-s6es, avant que nous arrivions i une image compldte du processus d'accultura-tion auquel la ville de Bucarest fut confrontde duiant le xIX" sidcle.
Bibliographie
Arendonk, c. van, K. N. chaudhuri 197g : Kahwa. Dans : Encyclop6die deI'Islam, tome IV. Leiden: E. J. Brill, paris : G. p. Maisonneuve et Larose,469-475.
Aurelian, P. s. 1880 [II" 6d] : Terra nostra. Schile economice asupra Romaniei[Terra nostra. Esquisses 6conomiques sur la Roumanie]. Bucuregti : Tip.Academiei RomAne.
BacalbaEa, constanrin 1987 [I* 6d,. Lg27l: Bucuregrii de alt[datr [Bucaresrd'autrefoisl, vol. I (1871-1877). Bucuregti : Eminescu.
Bacqu6-Grammont, Jean-Louis 2001 : Autour des premidres mentions du caf6dans les sources ottomanes. Dans : Michel ruchscherer (ed.), Le commercedu caf6. Avant l'dre des plantations coloniares : espaces, r6seaux, soci6t6s,xv"-xx" sidcle. Le caire : Institut frangais d'arch6ologie orientale. paris :diff. Impr. nationale.
Bellanger, Stanislas 1846: Le k6routza. voyage en Moldo-valachie. tome I,".Paris : Librairie Frangaise et Etrangdre.
Bou6, Ami L840 : La Tirrquie d'Europe, II" tome. paris : Arthus Bertrand.Bujoreanu, Ioan M. 1873 : collecliune de legiuirile Romaniei vechi gi nuoi cate
s'au promulgatu pdni la finele anului 1g70 [collection des anciennes et nou-velles lois de la Roumanie promulgu6es avant la fin de I'ann6e 1g701, vol. I.Bucuregti : Noua Typographie a Laboratoriloru RomAni.
Burke, Peter 2010 t20091: cultural Hybridity. cambridge : polity press.cil[tori striini 2000: cdlltori str[ini despre Jlrile Romane [Tdmoignages
des voyageurs dtrangers sur les pays roumains], Maria Holban, MariaAlexandrescu-Dresca Bulgaru, paul cernovodeanu (par les soins de), vor. X,I"'partie. Bucuregti : Editura Academiei Romdne.
cilitori striini 2004: cdldtori strrini despre Jdrile Romine in secolul alXIX-lea [Tdmoignages des voyageurs 6trangers sur les pays roumains auXIX" sidclel, Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, gerban Rldulescu-Zoner,
Le caf€, au croisement des deux mondes
Marian Stroia (par les soins de), nouvelle s6rie, vol. I (1801-1821). Bucuregti :
Editura Academiei Romnne.CilStori strdini 2005 : Cdldtori str6ini despre tr[rile romane in secolul al
XIX-lea, Paul Cernovodeanu, Daniela Bugd (sous la dir.), nouvelle s6rie,vol.II (1822-1830). Bucuregti : Editura Academiei Romdne.
Chabouis, Lucette 1988 : Le Livre du caf6. Paris : Bordas.Cowan, Brian William 2005 : The Social Life of Coffee. The Emergence of the
British Coffeehouse. New Haven : Yale University Press.Crutzescu, Gheorghe 1987 : Podul Mogogoaiei [Le pont de Mogogoaia].
Bucuregti : Meridiane.Dam6, Fr6d6ric 2007 lF' ed. 19071: Bucuregtiul in 1906 [Bucaresr en 1906].
Bucuregti : Paralela 45.Decei, Aurel L972 : Logofdtul T[utu nu a bdut cafea [Le logothdte T[utu n'a pas
bu du caf€1. Dans : Magazin istoric, Bucarest, VI, 6 (63) : 57-61.D6midoff, Anatole de 1840 : Voyage dans la Russie M6ridionale et la Crim6e,
par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie ex6cut6 en 1837. Paris : ErnestBourdin et Cie.
Desmet-Gr6goire, H6ldne 1980 : Une approche ethno-historique du caf6 : 6vo-lution des ustensiles servant d la fabrication et d la consommation du caf6.Dans Le Caf6 en M6diterran6e. Histoire, anthropologie, 6conomie XVI["-XX" sitcle (actes de la table ronde, Aix-en-Marseille, octobre 1980). Aix enProvence : Institut de recherches m6diterran6ennes, 93-114.
Desmet-Gr6goire, H6ldne 1989 : Les Objets du Caf6 dans les soci6t6s duProche-Orient et de la M6diterran6e. Paris : Presses du CNRS.
Desmet-Gr6goiren H6ldne 1997 : Introduction. Dans : H6tdne Desmet-Gr6-goire, Frangois Georgeon (sous la dir.), Caf6s d'Orient revisit6s. Paris : Ed.du CNRS, 13-23.
Driessen, Henk 1983 : Male Sociability and Rituals of Masculinity in Rural An-dalusia. Dans : Anthropological Quarterly 56,3 : 125-133.
Elias, Norbert 1973-1976 [I"'6d. allemande 1939] : Sur le processus de civilisa-tion, tomes 1-3 [tome 1 (La Civilisation des maurs), 1973 ; tome 2 (La So-ci6t6 de cotr), 1974; tome 3 (La Dynamique de I'Occident), 19761. Paris:Archives des Sciences Sociales.
Filimon, Nicolae 1963 : Ciocoii vechi gi noi, sau ce nagte din pisicl goariciminincd [Les anciens et les nouveaux parvenus, ou tout ce qui naitra d'unchat mangera des sourisl. Bucuregti : Editura pentru Literatur[.
Franklin, Alfred 1893 : La vie priv6e d'autrefois. Arts et m6tiers, modes,mcurs, usages des Parisiens, du XII" au XVIII' sidcle. Vol. XIII (Le caf6, leth6 et le chocolat). Paris : E. Plon, Nourrit.
Garnett, Lucy 1909 : The Turkish People, Their Social Life, Religious Beliefsand Institutions and Domestic Life. London: Methuen.
89
90 Irina Stahl
Geertz, clifford 1989 : Toutes Directions : Reading the Signs in an Urbansprawl. Dans : International Journal of Middle East Studies 2L, 3 : 291-306.
Georgeon, Franqois : 1997. Les cafds i Istanbul d la fin de I'Empire otto-man. Dans: H6ldne Desmet-Grdgoire, Frangois Georgeon (sous la dir.), Ca_f6s d'Orient revisit6s. Paris : fO. Ou CNRS, 3g-:Ig.
Georgescu, Florian, Paul cernovodeanu, Ioana cristache panait (6ds.) 1960 :
Documente privind istoria oragului Bucuregti [Documents sur I'histoire de laville de Bucarestl. Bucuregti : Muzeul de Istorie a oragului Bucuregti.
Giurescu, constantin c. 1966: Istoria Bucuregtilor din cele mai vechi timpuripin[ in zilele noastre [I- histoire de Bucarest depuis les plus anciens temps etjusqu'd nos joursl. Bucuregti : Editura pentru Literaturi.
Goffman, Erving 1959 : The Presentation of Self in Everyday Life, New york :
Doubleday.Irabermas, Jiirgen 1989 [I* 6d. allemande 196r]: The structural rransforma-
tion of the Public Sphere. Cambridge : polity press.Hattox, Ralph 1996 [I* ed. 1985] : coffee and coffeehouses. The origins of a
social Beverage in the Medieval Near East. seattle, London : university ofWashington Press.
Hugonette, L6on 1875 : Six mois en Roumanie. paris : Lechevalier.ronnescu-Gion, G. r. 2003 [I* 6d. 1g99] : Istoria Bucuregtilor. Iagi : Editura
Tehnopress.Iorga, Nicolae 1925 : Scrisori de negustori [Lettres des commergants]. Bucu-
re$ti : Tiparul AgezlmAntului tipografic " Datina RomAneascd,.Kozakai, Toshaki 1991 : Les japonais sont-ils des occidentaux? sociologie d'une
acculturation volontaire. Paris : l'Harmattan.Lemeny, gtefan 1990 : Sensibilitate gi istorie in secolul XVIII romdnesc [Sensi-
bilite et histoire dans le xvIII" sidcle roumainl. Bucuregti : Meridiane.Marsillac, Ulysse de 1999 : Bucuregtiul in veacul al XIXlea [Bucarest au XIX"
sidclel. Bucuregti : Meridiane.Montague, Lady Mary 1981 u* 6d. anglaise 17181 : L Islam au p6ril des femmes.
Une Anglaise en Turquie au XVIII" sidcle. paris : Frangois Maspero.Neculce, Ion 1982 : opere. Letopiseful fdrii Moldovei gi o samr de cuvinte
(Euvres. La chronique de la Moldavie et Des mots innombrablesl, 6ditioncritique et introduction par G. $trempel. Bucarest : Minerva.
Pandrea, Andrei 1989 : Identitatea hranei romdnilor llidentitd de la nourrituredes Roumainsl. Dans : Buletinul Bibliotecii Romane [Bulletin de la Biblio-thdque Roumainel, XV (XIX), Freibourg, nouvelle s&ie:315-347.
Philo, chris 2004 : of Public Spheres & coffee Houses. Department of Ge-ography & Geomatics, University of Glasgow. URL : http ://web.geog.gla.ac.uk/online_papers/cphilo0l 5.pdf.
Pigeory, F6lix 1854 : Les Pdlerins d'Orient. paris : E. Dentu.
Le caf6, au croisement des deux mondes
Potra, George 7961 : Documente privitoare la istoria oragului Bucuregti (L594-1821) [Documents sur l'histoire de la ville de Bucarest (1594-1g21)], vol. I.Bucuregti : Editura Academiei R. P. R.
Potra, George 1975: Documente privitoare la istoria oragului Bucuregti (lg2r-1848) [Documents sur l'histoire de la ville de Bucarest (1821-194g)], vol. II.Bucuregti : Editura Academiei R. P. R.
Potra, George 1990 : Din Bucuregtii de ieri [Bucarest de hier], vol. I. Bucuregti :
Editura gtiinlificd gi Enciclopedicd.Pratt, Mary Louise 1991 : Arts of the contactzone. Dans: profession 91. New
York: Modern Language Association, 33-40.Recordon, Frangois r82l : Lettres sur la valachie. paris : Lecointe et Durey.Rominul 1857 : Deschidere de cafenea nou6. Duminecdra r7 Noemvrie 1g57
[ouverture d'un nouvelle caf6. Dimanche, 17 novembre 1857]. Dans : Romd-nul [Le Roumain], Bucuregti, 29, 16 novembre 1857,4.
Romier, Lucien 1931 : Le carrefour des empires morts. Du Danube au Dnies-ter. Paris : Hachette.
sallaberry, Le comte de r82l: Essais sur la valachie et la Moldavie, thdatre deI'insurrection dite Ypsilanti. Paris : Simonot.
samarian, Pompei P. 1937 : o veche monografie sanitard a Munteniei : . To-pografia frrei Romanegti de Dr. constantin caracag (1s00-1g29) ' [Une an-cienne monographie sanitaire de la valachie par le Dr. constantin caracag(1800-1828)1. Bucuregti : Institutul de Arte Grafice * Bucovina n, I. E.Torouliu.
saraggil, Ayge 1997 : Iiintroduction du caf6 i Istanbul (xvI"-xvII" sidcles).Dans: H6ldne Desmet-Gr6goire, Frangois Georgeon (sous la dir.), Caf6sd'Orient revisit6s. paris : EO. Ou CNRS, 25-39.
severeanu, c. D. 2008 u* 6d. l92gl: Din amintirile mele (1g53-lgzg) [D'aprdsmes souvenirs (1853-1929)1. Bucuregti : Editura Fundatriei culturale Gheor-ghe Marin Speteanu.
skene, James Henry 1853 [II" 6d.] : The Frontier Lands of the christian and theTurk, 2 tomes. London : Richard Bentley.
sorokin, Pitirim 1937 : social and cultural Dynamics, vol. 1 : Fluctuation ofForms of Art. New York : American Book Company.
spicer, Edward H. 1972: Acculturation. Dans : David L. Sills (6d.), Interna-tional Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 1. New york : Macmillan,2L-27.
Stella, Alain 1996 : Le livre du caf6. Paris : Flammarion.sturdza-$cheeanu, D. c. Lgoi : Acte gi Legiuiri privitoare la chestia trrdneascr
[Documents et lois sur la question paysanne], I'" s6rie (Dela vasile Lupupin[ la 1866), vol. III. Bucuregti : Atelierele Grafice Socec & Co.
91
92 Irina Stahl
Tarde, Gabriel 1890 : Les Lois de I'imitation. Etude sociologique. paris :
F. Alcan.ukers, william H. 1922: All About coffee. New york : The Tea and coffee
Trade Journal Company.Urechia, v. A. 1891 : Istoria romdniloru [Histoire des Roumains], s6rie 1774-
1786, vol. I. Bucuresci : Lito-Tipografia Carol Gobl.Urechia, v. A. 1892 : Istoria romaniloru, s6rie 1774-1g00, vol. III. Bucuresci
Lito-Tipografia " Qulsn6srg " Joseph Gribl.Urechia, v. A. 1893 : Istoria romaniloru, s6rie 1774-rg00, vol. IV. Bucuresci
Lito-Tipografia " Qu1sn6.rg " Joseph Gtibl.urechia, v. A. 1894 : Istoria romaniloru, s6rie r774-rg00, vol. vII. Bucuresci
Tipografia gi Fonderia de litere Toma Basilescu.Urechia, v. A. 1895 : Istoria romaniloru, s6rie 1774-1g00, vol. v. Bucuresci
Tipografia gi Fonderia de Litere Thoma Basilescu.veblen, Thorstein 1899 : The Theory of the Leisure class. New york
Macmillan.vestitorul Romanesc 1856 : Schimbare de domililiu, Fialkovski gi comp., co-
fetari francezi, Pia[a Teatrului, casa Torok [changement de domicile, Fi-liakovski et comp., confisseur frangais, place du Th6atre, Maison Torokl.Dans vestitorul Romanesc [Le Messager Roumain], Bucuresci, 96, suppl6-ment, 22 d6cembre 1856, 2.
wachtel, Nathan 1974 : uacqtlturation. Dans : Jacques Le Goff et pierre Nora(direction), Faire de l'histoire. Nouveaux probldmes. paris : Editions Galli-mard,124-146.
westney, D. E. 1987 : Imitation and Innovation : The Transfer of western or-ganizational Patterns to Meiji Japan. cambridge, MA : Harvard universityPress.
zallony, Marc Filip 1824 : Essai sur les Fanariotes. Marseille : A. Ricard.