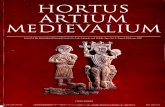Il santuario nuragico di Abini - Teti: i reperti di scavo delle campagne 2000-2002
CHIFFRER LES PROGRAMMES POLITIQUES LORS DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 2007 Heurs et malheurs d'un...
Transcript of CHIFFRER LES PROGRAMMES POLITIQUES LORS DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 2007 Heurs et malheurs d'un...
CHIFFRER LES PROGRAMMES POLITIQUESLORS DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 2007
Heurs et malheurs d’un instrument
BENJAMIN LEMOINE
En mars 1988, moins d’un mois avant le scrutin, Raymond Barre est le seul candidatse présentant à l’élection présidentielle à dévoiler publiquement une estimationchiffrée du coût de son programme pour les finances publiques. Affichant ses
« 130 milliards de francs » de dépenses publiques nouvelles sur 5 à 7 ans, il est taxé dansLe Monde 1 de candidat « original ». En 1995, ceux que la presse appelle « les expertsballaduriens » lancent une offensive contre Jacques Chirac et tentent de disqualifier lespropositions du rival de droite, en les décrivant comme irréalistes et irresponsables parceque trop coûteuses. L’écart entre les estimations des deux parties est conséquent : unefourchette comprise entre 500 et 680 milliards de francs pour les balladuriens, moins de100 milliards pour les chiraquiens. L’attaque est jugée, du côté chiraquien, « grossière »,« ubuesque » et « grotesque ». Dans la confusion, Jacques Baumel, rallié à Édouard Bal-ladur, en appelle à une commission d’experts indépendants pour arbitrer entre les deuxchiffrages et clore ainsi, par une évaluation impartiale, une controverse qui offre l’imaged’une droite déchirée. Au moment même où la droite s’étripe, Martine Aubry commu-nique sur la nécessité pour tout homme politique de faire un chiffrage sérieux et de nepas dire que « demain, on va raser gratis ». Après avoir annoncé la publication prochained’un chiffrage détaillé des mesures du candidat socialiste, elle est rappelée à l’ordre parDaniel Vaillant, le directeur de campagne de Lionel Jospin : le programme dans sa glo-balité n’est pas chiffrable, mais le candidat du parti socialiste donnera bientôt les « grandesorientations » budgétaires de ses propositions. Relatant ces duels, les journalistes décri-vent des estimations faites à la « va-vite », « sur un coin de table », « des extrapolations »et une « avalanche de chiffres surréalistes », révélatrices d’une « mauvaise foi »flagrante 2.
Ce rappel de précédents atteste du fait que chiffrer son propre programme commecelui de son adversaire ne constitue ni une contrainte systématique ni un impératif per-manent du professionnel de la politique. La nécessité d’une quantification des proposi-tions politiques n’a rien de « naturel », et la transformation de la variété des propositionscontenues dans un programme (du projet formalisé et bouclé aux simples slogans decampagne) en coûts pour les finances publiques dépend étroitement des exigences fluc-tuantes de la campagne électorale. Intervenant au terme d’usages sédimentés, la questiondu chiffrage des programmes politiques a pris au cours de la campagne présidentielle de2007 une tournure particulièrement vive. La controverse a mis aux prises non seulementles hommes politiques et les structures partisanes, mais aussi des économistes, des cellules
1. Le Monde, 31/03/1988.2. Libération, 4/03/1995, Le Monde et La Tribune, 6/03/1995.
403Revue française de science politique, vol. 58, no 3, juin 2008, p. 403-431.© 2008 Presses de Sciences Po.
de chiffrage concurrentes et des journalistes 1. L’un des enjeux de cette controverse a étéla possibilité d’un chiffrage budgétaire non partisan, extérieur aux partis politiques, quifonctionnerait comme une référence pour le débat public qui s’engage à cette occasion.
La polémique éclate suite au succès provisoire du site Internet Débat 2007, plate-forme d’accueil du chiffrage promu par l’Institut de l’entreprise (Ide) 2. La question aucœur de la dispute est la suivante : la mesure du coût pour les finances publiques desprogrammes politiques peut-elle transcender les perspectives politiques partisanes et sin-gulières ? Les mobilisations « pour » et « contre » l’installation pérenne d’instances dechiffrage indépendantes et extérieures aux acteurs de la confrontation politique (partispolitiques, candidats, écuries de campagne) rendent descriptibles les épreuves auxquellessont soumises les formes quantifiées. En effet, ou bien les chiffres avancés bénéficientd’un accord général, échappant ainsi à la critique et tendant à « l’indiscutabilité » 3, oubien, au contraire, ils sont « sujets à caution », et ne passent pas le cap de leur réductionà une position dans la compétition politique, ce qui les cantonne au registre de l’instru-mentalisation partisane. Les tentatives de l’Institut de l’entreprise pour se faire reconnaîtreun statut d’extériorité par rapport aux camps politiques en présence et s’imposer commeun tiers-chiffreur crédible – neutre, impartial et arbitre – constituent autant d’indicateursdu travail social requis pour rendre acceptable, par les acteurs du débat public, des chiffresindiscutables. Si, comme l’affirme Loïc Blondiaux, « la force de la forme statistique tientprécisément à cette parenté avec les énoncés scientifiques, à ce qu’elle paraît devoiréchapper dans un premier temps au débat politique et social pour mieux le circonscriredans un second temps et servir de référence indiscutable dans les controverses » 4, lacarrière instable du chiffrage non partisan, son succès provisoire et son échec final, expli-cite les modalités techniques, sociales et politiques qui font successivement tenir uneinstance productrice de calculs comme un instrument de référence du débat public, puiscontribuent ensuite à son effondrement en un dispositif partiel et partial, un outil politi-quement orienté.
Le degré de généralité d’un chiffre est tributaire des acteurs du débat public, quipeuvent contribuer, par les usages qu’ils en font, à effacer les traces sociales de l’instru-ment (pour le désingulariser) ou, à l’inverse, l’attacher à l’identité (sociale et politique)
1. L’analyse suit la dynamique de la controverse politique, médiatique et scientifique sur lechiffrage pendant la campagne présidentielle 2007. On s’appuie sur le dépouillement systématiquede la presse généraliste et spécialisée pour les campagnes présidentielles 1988, 1995, 2002 et 2007,ainsi que sur une étude approfondie du site Débat 2007 de l’Institut de l’entreprise (Ide). Lesentretiens cités ont été effectués entre mai 2007 et janvier 2008. Ils ont été réalisés auprès dejournalistes économiques, de membres de l’Institut de l’entreprise, d’économistes (OFCE et IRES),de députés et de conseillers techniques des professionnels de la politique (assistants parlementaireset cadres de partis politiques).
2. L’Institut de l’entreprise est une association (loi de 1901) créée en 1975 par une trentainede grands groupes, qui « réunit aujourd’hui plus de 120 adhérents, dont les activités couvrentl’ensemble des secteurs économiques, générant un chiffre d’affaires cumulé qui représente plus de20 % du PIB marchand de la France. L’Ide est piloté par un Conseil d’orientation composé d’unevingtaine de chefs d’entreprise ». Source : site internet de l’Ide.
3. Selon l’intensité des réseaux qui les soutiennent, les chiffrages peuvent tendre au statut defaits solides, difficilement discutables, « des choses qui tiennent ». On emprunte le terme « d’indis-cutabilité » à Alain Desrosières, « Discuter l’indiscutable, Raison statistique et espace public », dansAlain Cottereau, Paul Ladrière (dir.), « Pouvoir et légitimité. Figures de l’espace public », Raisonspratiques, 3, Paris, Éditions de l’EHESS, 1992, p. 131-154 ; « Comment faire des choses qui tien-nent : histoire sociale et statistique », Histoire et mesure, 4 (3-4), 1989, p. 225-242.
4. Loïc Blondiaux, « Le chiffre et la croyance, L’importation des sondages d’opinion enFrance ou les infortunes d’une opinion sans publics », Politix, 7 (25), 1994, p. 117-152, dont p. 117.
404
Benjamin Lemoine
de son producteur 1. L’objectivité du chiffrage est ainsi garantie selon les utilisations,c’est-à-dire localement et au cas par cas : en cela, la grandeur des nombres est indexéeà la manière dont s’articulent conjoncturellement les intérêts de ceux qui participent auxunivers politiques et journalistiques 2. En effet, la reconnaissance publique de la capacitéde l’instrument à produire des chiffres justes, « raisonnables » et « acceptables » dépendde l’intensité avec laquelle les professionnels de la politique acceptent de participer audispositif et, en particulier, de préciser la gamme de leurs propositions (les délais de miseen œuvre et la cible précise d’un projet de politique publique). Le degré de l’investisse-ment des candidats peut être plus ou moins relâché ou soutenu, car il est subordonné auxlogiques hétérogènes de la campagne électorale, faites d’inconstances, de réorientationsstratégiques et tournées vers un impératif d’efficacité.
UN CONTEXTE MARQUÉ PAR LE « PROBLÈME » DE LA DETTE PUBLIQUE
L’attention accordée aux chiffres n’est donc pas un invariant des arènes politiques.Jean-René Brunetière, président du conseil d’administration de Pénombre, une associationqui vise à « développer un espace public de réflexion et d’échange sur l’usage du nombredans les débats de société » 3, critique rétrospectivement le faible « recours » aux chiffresdans les programmes présidentiels pendant la campagne de 2002. Les questions écono-miques et sociales ne figurent pas au premier rang des préoccupations de campagne.
« Les promesses de tous les partis, formulées en termes littéraires, se gardaientbien des analyses chiffrées et encore plus des engagements quantifiés [...]. On estfrappé de la disparition dans les programmes des chiffrages du coût des mesures.Sans doute parce qu’il y a une perte de confiance totale dans ce genre de chiffres,qu’on a d’ailleurs bien du mal à comparer à quelque chose de commun, qui fasseimage. » 4
Un conseiller du parti socialiste, chargé rue de Solférino de rédiger des notes tech-niques, souligne la faible attention accordée à l’époque aux questions économiques, encomparaison des thématiques sécuritaires.
1. Pour une étude des contraintes relatives à la montée en généralité et à la construction desgrandeurs, cf. Luc Boltanski, « La dénonciation publique », dans L’amour et la justice comme com-pétence, Métailié, Paris, 1990, p. 255-233, et Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification.Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991, p. 10.
2. Plusieurs définitions de l’objectivité sont mobilisées dans la controverse sur le chiffrage.Elles correspondent aux attentes des acteurs du débat : d’une part, l’objectivité comme faisantdisparaître celui qui argumente et sa situation singulière et, d’autre part, l’objectivité au sens del’impartialité d’un juge et d’un arbitre. Sur cette question, cf. Allan Megill, « Four Senses of Objec-tivity », dans Allan Megill (ed.), Rethinking Objectivity, Durham, Duke University Press, 1994,p. 1-20 ; et Lorraine Daston, « Objectivity and the Escape from Perspective », Social Studies ofScience, 22 (4), 1992, p. 597-618.
3. Fondée en juin 1993, Pénombre regroupe à ce jour 450 adhérents de compétences profes-sionnelles très diverses, ayant en commun le souci d’améliorer le débat démocratique par uneutilisation raisonnée du nombre. Cf. « Pénombre, la vie publique du nombre », <http://www.penombre.org>.
4. « En revanche, d’autres chiffres envahissaient les médias : les chiffres des sondages, ceuxde la délinquance, de l’argent en politique, de la parité, nombre de nombres ont traversé les cam-pagnes, mais dans des usages éclatés » : Jean-René Brunetière, « Les nombres dans l’évaluationdémocratique vernaculaire », dans Jean-Claude Boual, Philippe Brachet (dir.), Évaluation et démo-cratie participative, acteurs ? méthodes ? buts ?, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 83-114, dont p. 110.
405
Chiffrer les programmes politiques
« Nous avions fait un exercice de chiffrage : à l’époque, les Français s’en foutaient.Il y avait eu une sortie du commissaire européen, à l’époque en charge des questionséconomiques et budgétaires, Pedro Solbes, qui avait dit que le projet de Chirac étaitintenable, bon... pour passer entre les gouttes du pépé d’Orléans qui s’était faittabasser. Tout le monde s’en foutait. On avait pas une campagne économique etsociale. » 1
Pour Jean-Damien Pô, l’animateur de la cellule de chiffrage Débat 2007, le précé-dent de 2002 laisse le souvenir d’une campagne qui serait passée à côté de l’essentiel.
« Ce qui était dramatique à nos yeux, c’était le précédent de 2002 où toute la cam-pagne s’était faite sur des problématiques sociétales : la sécurité, l’immigration, bonqui étaient des problématiques extrêmement importantes, qu’on ne méconnaît pas,mais en revanche il ne s’est à peu près rien dit sur l’économique et sur le social. » 2
La particularité de la campagne présidentielle de 2007 tient moins à la prévalenced’un cadrage économique qu’à la place étonnante qu’occupent les soucis d’ordre spéci-fiquement budgétaires. L’installation, en amont de la campagne électorale, d’un consensussur les finances publiques découle d’une série de conventions – matérialisées par lesnormes du Pacte de stabilité et de croissance (3 % de déficit et 60 % de dette publique/PIB) – qui se sont imposées comme des contraintes incontournables. La publication durapport de Michel Pébereau 3, en décembre 2005, et ses amples relais médiatiques etpolitiques imposent, parmi les professionnels de la politique, une interprétation maxima-liste du problème de la dette publique. Le succès du rapport consacre le ralliement autourd’un constat qui fait de la dette publique un enjeu majeur. L’état des lieux budgétairesse présente comme « un mur de faits » devant lequel les responsables politiques sontsommés de réagir. Les programmes des trois principaux candidats (Bayrou, Royal, Sar-kozy) sont marqués par cette nécessité et contiennent chacun des propositions sur lesmodalités de résorption de l’endettement et sa répartition temporelle. Dans l’émission« J’ai une question à vous poser », le « compteur analogique de la dette publique »,trouvaille télégénique qui fait défiler à grande vitesse et sur un écran vidéo les 13 chiffres,rappelle à chaque instant la menace qui plane sur la prestation du candidat à l’électionprésidentielle interrogé par l’animateur.
Dans cette version, la décision politique intervient en bout de course, alors que lacontroverse entre économistes s’est stabilisée autour d’une option technique, cristalliséeautour du rapport Pébereau. L’écart cognitif entre les différentes interprétations portesur le fait même de reconnaître la dette comme un « problème », ce qui ne semble plusfaire de doute dans les usages politiques pendant la campagne électorale. L’optionalternative qui consisterait à relativiser le problème de la dette publique et se refuseraità faire de la dette un fait isolé en la reliant à d’autres phénomènes économiques (commela croissance ou le chômage), est provisoirement cantonnée aux marges et à l’hétéro-doxie économique. Le consensus sur la reconnaissance d’un « problème » de la dettepublique fonde l’intérêt que l’on porte au chiffrage budgétaire des programmes. Eneffet, les propositions politiques en matière budgétaire, fiscale et économique sont
1. Entretien avec un cadre du parti socialiste, rendu anonyme.2. Entretien avec Jean-Damien Pô, directeur des études à l’Institut de l’entreprise et animateur
de la cellule de chiffrage Débat 2007.3. Michel Pébereau, Rompre avec la facilité de la dette publique, pour des finances publiques
au service de notre croissance et de notre cohésion sociale, rapport remis au ministre des FinancesThierry Breton le 14 décembre 2005, Paris, La Documentation française, 2005.
406
Benjamin Lemoine
évaluées par les journalistes en fonction de leur conformité aux préconisations et dia-gnostics de la commission Pébereau 1.
« L’opinion publique et les médias sont devenus très attentifs à la question desmarges de manœuvre budgétaires des gouvernements parce qu’ils ont été sensibilisésà l’enjeu de la dette publique. Le travail de Michel Pébereau là-dedans est détermi-nant. Et ce n’est pas pour rien que c’est lui qui a présidé l’Institut de l’entreprise(Ide) et que c’est l’Ide qui a fait ça [le chiffrage]. On est dans un prolongementidéologique si j’ose dire. Il y avait une attention et une attente de l’opinion publiqueet des médias sur ces sujets-là. » 2
L’explicitation des modalités de financement du programme devient un enjeu visible,qui donne lieu à une veille médiatique. En vertu des engagements tacites contractés enconsentant aux constats et recommandations du rapport alarmiste sur la dette de MichelPébereau 3, l’exposition publique d’un chiffrage cohérent par les partis politiques devientun gage de sincérité politique. Le cadrage macro-économique comme la traduction chif-frée des engagements financiers concomitante tendent à devenir le « préalable de tout ».
– « Le Figaro : Le projet législatif de l’UMP et les propositions qu’y ajoute NicolasSarkozy paraissent très coûteux. Que devient l’objectif d’assainir les financespubliques ?– Alain Lambert : Le projet présidentiel sera différent du programme législatif. Maisles deux s’inscrivent dans un même cadrage macroéconomique. Celui-ci est le préa-lable de tout.– Le Figaro : Comment ces mesures peuvent-elles être financées ?– A.L : Elles seront paramétrées pour être finançables. » 4
L’exercice de chiffrage s’inscrit ainsi dans le prolongement de l’orthodoxie récemmentétablie sur les finances publiques et la dette. La connexion entre le chiffrage et le risquede la dette est explicite pour la cellule de chiffrage intitulée Débat 2007 et émanation del’Institut de l’entreprise, cercle de pensée patronal présidé depuis 2005 par Michel Pébereau,président du conseil d’administration de BNP-Paribas et auteur du rapport sur la dette. Leprocédé qui vise à inciter les instances de la décision politique à penser, organiser et agencerses propositions politiques dans un cadre de financement limité – par les seuils de déficitet de dette publique – fonctionne comme une « boîte noire » renfermant une problémati-sation de la dette, en faisant disparaître le caractère discutable des conventions établies surles finances publiques. La nouveauté qui caractérise la campagne de 2007 est cette insertiondu chiffrage dans un cadrage verrouillé et non débattu sur les finances publiques et la dette.Le chiffrage opère comme la concrétisation (la matérialisation par un outil de calcul) dusouci de la dette. Les propos de Michel Pébereau, inaugurant la cellule de chiffrage lors
1. À titre d’exemple, les questions suivantes d’un journaliste du Figaro à l’Institut de l’entre-prise : « Comment jugez-vous ce chiffrage du projet de l’UMP ? Ce chiffrage de l’UMP respecte-t-illes préconisations du rapport Pébereau sur la dette ? Le rapport Pébereau insistait sur le désendet-tement. Qu’en est-il dans le programme de l’UMP ? » (Le Figaro, 6/12/2006).
2. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.3. L’acceptation d’un constat alarmiste sur la dette contraint en retour les responsables poli-
tiques à élaborer leurs programmes dans le cadre d’un chiffrage. En empruntant le concept à PhilippeZittoun, on pourrait parler d’une « dette politique » contractée de manière implicite par les candidatsvis-à-vis de l’expertise alarmiste (incarnée par Pébereau). Dette qui oblige le candidat, lorsqu’il sesert de la dette comme d’un argument, à faire suivre sa proposition d’un chiffrage. Cf. PhilippeZittoun, « Partis politiques et politiques du logement. Échange de ressources entre dons et dettespolitiques », Revue française de science politique, 51 (5), octobre 2001, p. 683-706.
4. Le Figaro Économie, 17/01/2007.
407
Chiffrer les programmes politiques
de la conférence de présentation aux journalistes, sont significatifs du principe d’autofi-nancement budgétaire censé prévaloir.
« Il est clair que tout responsable politique qui, aujourd’hui, propose une augmen-tation de la dépense devrait être immédiatement interrogé sur les dépenses qu’encontrepartie il va supprimer pour financer la dépense qu’il propose de créer. » 1
Toutefois, les principes qui sous-tendent le consensus sur les finances publiques nestructurent les comportements politiques que pour autant que les configurations de cam-pagne l’exigent. Dit autrement, le consensus est joué 2 : le bloc de conventions, le pactetacite sur les finances publiques qui lie le politique au chiffrage sera respecté lorsqu’ilapparaît trop coûteux politiquement de s’en éloigner ; mais à l’inverse, il pourra êtreenfreint dès lors qu’il est jugé trop coûteux de le respecter à la lettre.
LE CHIFFRAGE PARTISAN : UNE RESSOURCE POLITIQUE
Le projet du chiffrage apolitique de l’Institut de l’entreprise mise sur la propensiondes candidats et de leurs équipes de campagne à participer à une discussion ouverte,« cartes sur table », sur le financement des promesses électorales. Cette collaboration estloin d’aller de soi, puisqu’elle rompt avec l’usage routinier que les professionnels de lapolitique faisaient jusqu’ici du chiffrage, utilisation amplement tournée vers la poursuitede gains tactiques (de distinction et de démarcation) vis-à-vis des concurrents. Avantd’être une contrainte systématique, censée s’appliquer à tous, le chiffrage est une res-source du jeu politique. Comme on le soulignait en exposant les précédents du chiffrageen campagne électorale (1988 et 1995), l’activité de calcul des coûts budgétaires d’unprogramme a rarement échappé, avant 2007, à la maîtrise tactique des partis politiques.En l’absence d’une régulation ou contrainte tierce, les candidats et leur staff de campagnedécident (ou ne décident pas) de procéder au chiffrage de leurs propositions, mais contrô-lent aussi le tempo de sa publication. En outre, le chiffrage partisan permet de maintenirdes asymétries d’information qui remplissent une fonction tactique importante : le com-pétiteur politique se laisse la possibilité de changer le curseur de l’évaluation en jouantsur le rythme et l’ampleur d’une proposition de politique publique, autant de paramètrespouvant faire varier la mesure du financement. Ce faisant, le candidat s’assure des margesde manœuvre et de réponse aux éventuelles contre-attaques ou offensives du rival. Lefait d’arrêter son chiffrage global à un instant t, enregistré par la presse, revient à dévoilerson jeu et ses cartes 3 : s’il s’agit bien d’un coup censé participer au renforcement d’uneposition, cela peut également conduire à se rendre plus vulnérable parce que trop visible ;mal conçu le chiffrage prête le flanc à la critique, trop bien ficelé, il peut empêcher desrevirements (des réagencements internes au programme) opportuns.
1. Conférence de presse du 28/09/06. Source : site Débat 2007.2. On souscrit ici explicitement à la conclusion de Michel Dobry analysant les comportements
politiques dans les débats sur les forces nucléaires françaises. Pour ce qui est du cas de la campagne2007, le politique cale sa position vis-à-vis du consensus en réponse à des préoccupations immé-diatement politiques et non comme le remarque Michel Dobry, « sur le terrain exclusif des concep-tions ou convictions stratégiques » (Michel Dobry, « Le jeu du consensus », Pouvoirs, 38, 1986,p. 47-66, dont p. 66).
3. Comme c’est le cas au poker, rendre visible ses cartes (ses atouts et ses faiblesses) revientà renoncer à toute marge de jeu en dehors des cartes réellement possédées.
408
Benjamin Lemoine
LA LÉGITIMATION PAR LE CHIFFRAGE
Les utilisateurs du chiffrage partisan projettent dans l’outil leurs stratégies de fabri-cation d’une identité politique et d’obtention d’avantages dans le jeu politique. MichelDobry interprète dès 1986 « la tentative de chiffrage financier du programme commun »comme un des éléments « très significatifs » du « réaménagement symbolique » entreprisau sein du parti communiste en 1981 1. La première des vertus du chiffrage, escomptéespar ceux qui s’en servent, résiderait donc dans sa capacité à rendre légitime en politique.Saisie « aux confins » de l’échiquier politique, par les candidats qualifiés de « périphé-riques », l’opération ouvrirait la voie à la « normalisation » politique et pourrait trans-former des partis dits « non gouvernementaux » en « partis responsables ». C’est en cestermes qu’est interprété le chiffrage de Jean-Marie Le Pen pendant la campagne 2007 2.José Bové propose lui aussi un chiffrage de son programme, dont le coût est estimé à160 000 milliards d’euros 3. Selon Michel Husson, économiste à l’Institut de rechercheéconomiques et sociales, qui s’en est chargé, la quantification budgétaire est censée fournirune preuve de la faisabilité économique d’un projet de société 4. L’échafaudage numé-rique devrait permettre de suspendre l’accusation d’irréalisme et d’impossibilité tech-nique : l’ampleur du chiffre valant alors l’ampleur de l’ambition politique, le candidatBové démontre son engagement pour une vaste politique de redistribution des richesses.Pris dans les tactiques partisanes, le chiffrage est une ressource parmi d’autres dans lerépertoire d’action du professionnel de la politique. Le calcul est fait au sein des équipesde campagne qui décident d’utiliser cette arme du chiffre contre l’adversaire. Le chiffreest mis au service d’une stratégie de qualification de soi et de disqualification de l’autre :le politique se sert du chiffrage pour faire valoir la supériorité de sa candidature (plus« crédible », plus « réaliste ») par rapport à celle des autres candidats dont on dénonce,du même geste, l’inévitable gabegie sur les finances publiques à laquelle conduirait lamise en œuvre de leur programme. Les équipes de campagne livrent donc leur propreexpertise et utilisent la voie de la quantification budgétaire pour servir leur cause per-sonnelle et obtenir des avantages concurrentiels. Mais, réduits à ce caractère éminemmentpartisan, les chiffres produits ne peuvent pas prétendre au statut de preuve qui est pourtantsi recherché.
LA DÉMESURE DU CHIFFRAGE PARTISAN
Les opérations de chiffrage sont en effet rapidement épinglées par les journalistesqui les décryptent volontiers en termes stratégiques. Les chroniques de campagne mul-tiplient les métaphores dérivées de l’affrontement dual : on parle de « bataille », de
1. Tentative rapprochée de l’abandon doctrinal du principe de la « dictature du prolétariat »et de la conversion à la « “force de frappe” nucléaire » : Michel Dobry, art. cité, p. 52.
2. « Pour la première fois, le Front national s’essaie au chiffrage : un coût de 90,3 milliardsd’euros (54,3 milliards de dépenses et 36 milliards de recettes fiscales en moins) et un gain de91,4 milliards (70,9 milliards d’économies et 20,5 milliards de recettes supplémentaires) » : « LePen intensifie ses efforts de normalisation », Les Échos, 23/02/2007.
3. « Yves Salesse, président de la Fondation Copernic, et le coût des 125 propositions »,Marianne, 19/02/2007.
4. Le principe du chiffrage donne lieu au sein des partis à des discussions sur l’efficacitéd’une telle méthode militante. Il peut passer pour excessivement « techno » face à un travail militanttraditionnel dirigé vers la mobilisation sur le terrain.
409
Chiffrer les programmes politiques
« guerre » ou encore d’ « assaut ». Rarement dépourvu de pointes ironiques, le commen-taire journalistique souligne la démesure propre à une séquence de la vie politique devenuerituelle 1 : la « mauvaise foi » serait trop évidente et aucune confiance ne pourrait dès lorsêtre accordée aux données 2 « extravagantes » avancées par les écuries de campagne. Lesécarts entre les évaluations disponibles sont si proches du jugement a priori d’un partisur l’autre qu’ils apparaissent nécessairement « grossiers » et « invraisemblables » : lesadversaires majorent l’ennemi de « plus du double », du « simple au triple », à l’imagede Thierry Breton, alors ministre de l’Économie du gouvernement Raffarin, s’alarmant« des milliards et des milliards » 3 alignés sur le papier par les socialistes. Le soupçonest de rigueur et la mise à distance de chiffres dont les médias rappellent volontiers lemarquage politique constituerait un garant de la vigilance et de l’objectivité journalistique.
En 2007, les controverses sur le coût des programmes respectifs de la droite et dela gauche commencent dès juin 2006, soit près de 11 mois avant le scrutin et alorsqu’aucun des candidats ne s’est encore déclaré officiellement. Réunis en conventionnationale, les socialistes parachèvent leur programme pour les prochaines élections légis-latives. Le lendemain, Thierry Breton, ministre de l’Économie et des Finances en fonc-tion, en fait une évaluation chiffrée : 100 milliards d’euros, montant qualifié d’« astro-nomique » 4 puisque trois fois supérieur à celui avancé par François Hollande, pour quile coût serait de l’ordre de 34 milliards d’euros. À peine une semaine plus tard, par voiede presse, Jean-François Copé, ministre délégué au Budget, poursuit l’offensive etdénonce la « gabegie » à venir de la « gauche dépensophile » en ironisant sur les sommes« mirobolantes » et « d’une autre époque » qui seront dépensées par la gauche si elle estélue. Chiffrant le coût du projet socialiste à 115 milliards d’euros, soit un écart de 65milliards par rapport au chiffre de 50 milliards de dépenses « brutes » 5 avancé par ÉricBesson, en charge du chiffrage au sein du parti socialiste, Jean-François Copé, ministredu Budget, amorçe la polémique sur le réalisme budgétaire et la faisabilité économiquedes programmes. Calculs « grossiers », estimations « grotesques », la presse ne s’étonnepas de cet écart de chiffrage et de la démesure des attaques. La voie normale des combatspolitiques, en somme.
« Comme dans toutes les campagnes présidentielles, il y a eu le débat politiquehabituel : la droite disant “le PS vous ment”, le PS disant “l’UMP vous ment sur lechiffrage”. Ils ont chacun fait leur propre chiffrage et les adversaires font le chiffragepour eux. » 6
« Les chiffrages partisans n’étaient pas très convaincants parce qu’ils étaient notoi-rement assez surévalués quand il s’agissait de l’autre et sous-évalué quand il s’agis-sait de soi-même. » 7
À rebours de l’activation d’une grille de lecture routinière et stratégiste, la version
1. En annonçant le énième rituel combat : la « bataille sur les chiffres ne fait que commencer ».2. Le terme de « donnée » est dans ce cas précis intéressant : les chiffres sont effectivement
« donnés » et mis en circulation par les professionnels de la politique. Les journalistes les suspectentd’autant plus qu’ils sont témoins de la trop grande facilité avec laquelle ils sont communiqués parles officines partisanes pour dénoncer l’adversaire.
3. « Bataille autour du financement des programmes présidentiels », La Tribune, 13/02/2007.T. Breton estime le projet du PS à 100 milliards d’euros et F. Hollande à 34 milliards d’euros (LeFigaro Magazine, 17/06/2006).
4. « Projet du parti socialiste, l’addition sera lourde », Le Figaro, 10/06/2006.5. Brut signifie que les économies et recettes à venir ne sont pas déduites de ce calcul.6. Entretien avec Guillaume Delacroix, journaliste, Les Échos.7. Entretien avec Claire Guélaud, journaliste, Le Monde, pages économiques.
410
Benjamin Lemoine
2007 des chiffrages ne se caractérise pas tant par la virulence, la démesure habituelledes joutes oratoires que l’offre, proposée aux journalistes, d’une sophistication de lacritique. L’innovation, revendiquée non sans un certain succès (local et temporaire) parl’Institut de l’entreprise, consiste à s’immiscer dans le duel politique et à fournir uneinformation tierce, qui veut fonctionner comme une « technologie de mise à distance » 1
et qui est donc susceptible de dépasser la dispute binaire gauche-droite. Le dispositifde chiffrage budgétaire, Débat 2007, que l’Ide met en place en septembre 2006, a pourambition de s’affranchir du cadrage uniquement partisan sur les questions économiques,fiscales et budgétaires. On est ici au cœur de la tension car c’est cette sortie potentielledes duels chiffrés, autorégulés par les partis, qui pose problème aux compétiteurs de lavie politique. L’avènement d’un chiffrage systématique (qui s’applique à tous) et nonpartisan revient pour les partis politiques à tirer un trait sur les avantages qu’ils attendentdes opérations de chiffrage : la légitimation dans l’espace politique et la distinction parrapport aux concurrents. L’objectivité prêtée à l’instrument de mesure du coût desprogrammes dépend donc d’une part de l’intérêt que lui accordent les journalistes etd’autre part de la participation du politique qui consent à jouer le jeu d’un chiffrageextérieur modéré et régulé.
L’INVENTION D’UN CHIFFRAGE NON PARTISAN
Le dispositif de chiffrage de l’Ide installe une tension entre la voie normale descampagnes électorales, où des chiffrages partisans aux écarts élevés et invraisemblablessont échangés dans un corps à corps politique sans arbitre, et son ambition novatricecensée constituer une alternative. Le statut d’innovation conféré au site Débat 2007 sejoue sur un fil car il y a un risque que la démarche de chiffrage soit réduite, par lesjournalistes, à un classique exercice de lobbying politique. La carrière du dispositif nedépend pas exclusivement du talent de ses animateurs ; son sort est lié à sa capacité àimposer l’idée de la possibilité d’un chiffrage non partisan et, à ce titre, à la constanceet à l’intensité de l’intéressement des différents acteurs – journalistes et politiques – quicomposent l’environnement (l’espace public des débats politiques) dans lequel l’Instituts’insère.
EFFACER LE STIGMATE DU PRODUCTEUR
Le montage du dispositif est pensé comme une reproduction en miniature de laposture scientifique : la « cellule » se veut neutre et dégagée des intérêts singuliers. Jean-Damien Pô, l’animateur de la cellule de chiffrage et du site Internet, souhaite faire émergerdans l’espace public des faits objectifs, solides et incontestables. Il résume ses aspirationssous le concept de fact checking, littéralement « pointage des faits » : le but est « d’injecterde la rationalité » dans le débat et d’élaborer une « base factuelle à peu près partagée » 2.Ainsi, les productions de l’Ide se veulent diffusées sur le modèle de la transmission
1. L’expression est empruntée à Theodore M. Porter, Trust in Numbers. The Pursuit of Objec-tivity in Science and Public Life, Princeton, Princeton University Press, 1995.
2. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.
411
Chiffrer les programmes politiques
pédagogique froide, sans prendre parti 1. La tâche qui consiste à effacer les traces del’identité sociale de l’Institut de l’entreprise n’est pas aisée : les journalistes ne sont pasdupes de l’identité du producteur de chiffrage. « Le patronat entre en campagne », « lavitrine du patronat », « les chefs d’entreprise veulent chiffrer » 2 constituent autant delabels et stigmates qu’il faut provisoirement faire taire. Le risque est important pour lacellule de chiffrage d’être dévoilée comme le dispositif qui agit en faveur de l’un oul’autre des prétendants à la présidence de la République (le candidat le moins dépensier)et porteur d’options de politique économique qui répondent aux intérêts du patronat. Lesuccès du chiffrage dépend donc de la capacité à faire oublier ses racines pour n’êtrejugé que sur ses fruits qui doivent apparaître comme politiquement « vierges ». Les diri-geants ont conscience de la nécessaire neutralisation de l’identité de l’Institut de l’entre-prise. La présence des cercles patronaux engagés est un élément traditionnel des campa-gnes politiques. Comme le remarque Michel Offerlé, l’introduction du terme« entreprise » dans le champ politique a d’ailleurs permis la conversion lexicale d’unintérêt particulier, celui des patrons, en un intérêt général, celui de l’entreprise et del’activité économique 3. Mais, comme le révèle une comparaison avec le chiffrage concur-rent entrepris par l’institut Coe-Rexecode, les variations de la confiance accordée à unchiffrage ne peuvent pas s’expliquer uniquement par un statut, plus ou moins marqué,de son producteur. En effet, les deux instituts pourraient l’un comme l’autre être épingléscomme « des émanations du Medef ». De plus, Rexecode est un centre spécialementdédié à l’expertise économique alors que l’Institut de l’entreprise est un « think tank »,un club de pensée dont le cœur de métier n’est pas l’évaluation. Pourtant, la mise endoute de l’évaluation effectuée par l’institut Coe-Rexecode est unanime. En creux, cerejet renseigne sur les qualités d’expertise attendues par les journalistes. Or, ces attentesseront précisément comblées en partie l’Institut de l’entreprise.
« Rexecode est venu très tardivement dans le débat. C’était vraiment une sorte decaricature. C’était vraiment : “le meilleur, le plus solide, le plus crédible du pointde vue de la croissance, c’est Sarko”. C’était vraiment : “je vote Sarko”. Je penseque la note de présentation que [le président de l’institut] a faite était de nature àjeter le doute sur l’ensemble de la publication, alors que Pébereau a pas du tout faitcela, il a laissé sa cellule de chiffrage fonctionner en paix. » 4
« Il y a eu Rexecode qui s’y est mis, c’était encore plus grotesque. C’était vraimentcaricatural, et le patron Michel Didier assurant tout le monde de son indépendancealors qu’on sait très bien que les actionnaires, c’est le Medef et la Chambre decommerce et d’industrie de Paris. Donc, c’est vraiment le patronat, les patrons deParis. En plus, le fameux Michel Didier était le soir du premier tour salle Gaveau,
1. « Il ne s’agit pas de prendre parti dans le débat politique, ni de juger de l’opportunité detel ou tel programme, assure Michel Pébereau, président de l’Institut de l’entreprise. Nous nouscontentons d’évaluer leur coût. Aux candidats d’annoncer ce qu’ils prévoient pour financer cesdépenses » (dans « Les propositions des candidats chiffrées ! », Le Parisien, 29/09/2006).
2. Les Échos, 29/09/2006, Le Monde 5/10/2006.3. Le changement de sigle (de CNPF à Medef), « réclamé dès la fin des années 1970, par
des protagonistes qui voulaient gommer la charge négative du terme patron [...] correspondait àune volonté de neutraliser la fonction de chef d’entreprise et de faire des organisations patronalesdes groupements défendant et promouvant l’entreprise, entité incontestable et idéologiquementneutre, et non pas représentant des patrons » (Michel Offerlé, Les organisations patronales. Pro-blèmes politiques et sociaux, Paris, La Documentation française, juin 2007, p. 9).
4. Entretien avec journaliste X, rendu anonyme.
412
Benjamin Lemoine
au siège de l’UMP, pour fêter les 31 % du score de Sarkozy, donc ça va quoi...c’était un peu bizarre. Ségolène a vachement attaqué sur Rexecode en disant : “c’estle Medef”. Alors évidemment, on peut prendre les chiffres du Medef, mais pourquoion pourrait prendre les chiffres du Medef et pas ceux de la LCR. » 1
Entre les deux tours de l’élection présidentielle 2007, les deux adversaires du grandrendez-vous télévisuel ont croisé le fer, chiffres à l’appui.
– Nicolas Sarkozy : « Selon Rexecode, un organisme indépendant, mon projet crée230 000 emplois... »– Ségolène Royal : « C’est l’organisme du Medef ! »– Nicolas Sarkozy « Savez-vous par qui Rexecode est dirigé ? Par Michel Didier,l’un des économistes que Jospin avait nommé en 1998 dans son conseil d’experts. »À l’affirmation péremptoire de Ségolène Royal, qui assimile l’institut Rexecode
à une émanation directe du Medef, le quotidien Libération, énumérant les « petitesimprécisions et grosses erreurs du débat Royal-Sarkozy », conclura à un « ni vrai nifaux » de circonstance 2. Alors que les journalistes repèrent les « fautes » commisespar Rexecode, les chiffrages de l’Institut de l’entreprise échappent provisoirement àla critique. L’Ide soigne d’ailleurs sa présentation : la stratégie de construction d’unchiffrage d’intérêt général passe par une division du travail interne et la mise en scèned’un découplage entre la cellule de chiffrage et les activités ordinaires de lobbyingpublic de l’Institut. Si, en tant que cercle de pensée, l’Institut souhaite pousser dansl’agenda des messages politiques particuliers, son dirigeant Michel Pébereau va volon-tairement se mettre en retrait du dispositif de chiffrage. Connu comme un patron qui« mouille la chemise » et a du poids dans le débat public, l’ancien haut fonctionnaireet président de BNP-Paribas met ouvertement en scène la coupure avec la cellule dechiffrage. Au moment de la conférence de presse de présentation du dispositif dechiffrage, Jean-Pierre Boisivon et Michel Pébereau tiennent à assurer qu’il existe entrela cellule de chiffrage et le noyau dur de l’IDE une « muraille de Chine » 3, une façonde mettre en scène l’indépendance de la cellule de chiffrage par rapport aux person-nalités publiques politiquement marquées des dirigeants de l’Ide. À ce titre, Jean-Damien Pô, directeur des études à l’Institut, se voit confier la responsabilité intégraledu projet. L’âge aidant (34 ans), ce jeune normalien, bien au fait de la culture del’Internet, insuffle au mode de mobilisation du think tank un nouvel élan. Il présenteles élections 2007 comme un virage modernisateur pour la communication de l’Institutde l’entreprise en élaborant un site Internet et en développant une activité événemen-tielle. L’avantage de ce mode de communication est d’élargir et de varier l’audiencede l’Ide, dont les notes n’atteignent ordinairement qu’un public limité. D’une logiquede diffusion « confidentielle et restreinte » (« 2 000 exemplaires à des leaders d’opi-nion »), l’audience des thèmes de l’Ide passe à une tout autre échelle : « 200 000 visitesvolontaires » 4.
1. Entretien avec journaliste Y, rendu anonyme.2. « Rexecode libre mais proche du Medef », Libération, 4/05/2006.3. Jean-Pierre Boisivon, conférence de presse à l’Ide, 28/09/2006. Michel Pébereau fait part
de son souci de « ne pas prendre parti dans le débat politique » (interview dans La Tribune,29/09/2006).
4. Chiffres fournis par Jean-Damien Pô. Ce dernier organise des rencontres en ligne, lancedes invitations à des personnalités, organise des chats et régulièrement des podcast vidéos (Entretien,cité).
413
Chiffrer les programmes politiques
LA NEUTRALISATION CALCULÉE
Pour apparaître non partisan, l’Institut doit livrer des chiffres qui n’ont pas poureffet de disqualifier complètement l’un ou l’autre des candidats. Un tel manquementconduirait à rabattre l’innovation revendiquée par ses entrepreneurs comme une tradi-tionnelle attaque ou polémique. Paradoxalement, la réinvention du chiffrage, dans uneversion apolitique, naît du recyclage d’une initiative militante. C’est en discutant avecun ami administrateur à l’Insee, détaché à la direction du Budget et militant actif, queJ.-D. Pô décide de recenser chacune des promesses électorales des candidats afin d’enévaluer les coûts pour le budget de l’État. Cet ami militant avait eu lors de la campagne2002 une idée « simple et dévastatrice » 1 : pour démolir les adversaires, il dressait uneliste exhaustive des propositions du candidat du camp d’en face et accolait devant chacunede ces « facilités » de discours un coût de financement public, afin d’en souligner l’infai-sabilité, le tout « consigné sur un tableur Excel ». Le « déconomètre » 2, ou le « mirobo-lomètre » était né. Impressionné par l’originalité de la démarche, Jean-Damien Pô reprendà son compte cette idée, mais en la trahissant, c’est-à-dire en la rendant compatible avecles exigences de l’Institut de l’entreprise. Il faut garder l’intuition mais en changer lafinalité : le dispositif ne doit viser aucune cible politique adverse, mais au contraire tendreà « l’objectivité » 3.
La solution retenue pour compenser le marquage politique du « déconomètre »consiste à neutraliser ce caractère partisan des nombres en associant plusieurs sensibilitéspolitiques au dispositif. Jean-Damien Pô constitue autour de lui une équipe de trois « chif-freurs » 4, dont l’un identifié à gauche, l’autre à droite et un troisième qui est présentécomme « sans attaches ». Chacun des trois chiffreurs procède à son estimation des coûtsdes propositions avancées par les principaux candidats. Naturellement, comme le racontePô, les « chiffreurs de droite ont tendance à majorer les propositions du candidat degauche et vice versa ». Une fois que chacun des chiffreurs a envoyé son « équation » àPô, qui centralise les copies, l’animateur assure un travail de simplification et organisela réalisation d’un diagnostic commun.
Les trois chiffreurs sont des collaborateurs détachés de l’Ide. De son propre aveu,Pô a « nécessairement » dû puiser les compétences dont il avait besoin dans la hautefonction publique, pour des raisons d’asymétrie d’informations. Bien que les élémentsrecherchés soient publics, leur accès est souvent difficile à maîtriser pour un profane quin’est pas familier avec « la culture budgétaire de l’administration publique » 5. Pendantla campagne, les chiffreurs sont « protégés » et couverts par l’anonymat. Pourtant, unarticle de presse du Figaro annonçant l’avènement du dispositif, brosse le portrait dedeux chiffreurs en citant leurs noms, dans de brefs curriculum vitae.
« Une cellule de chiffrage va être mise en place avec deux contributeurs de sensi-bilité et de profils différents. Tous deux ont l’expérience de la “mécanique
1. Entretien avec Jean-Damien Pô, ibid.2. Le Monde, 21/04/2007.3. Entretien avec Jean-Damien Pô, ibid.4. Au pool de trois chercheurs s’ajoute, dans l’équipe Débat 2007, une personne chargée de
la communication, un stagiaire de Sciences Po Paris, qui s’occupera de l’entretien du site.5. En ce qui concerne les ressources administratives des chiffreurs : l’animateur du décono-
mètre devenu chiffreur « avait fait l’X et l’ENSAE, il était passé conseiller budgétaire dans uncabinet, il savait grosso modo, enfin très largement, à la louche, il était capable de dire combiença coûtait » (Entretien avec Jean-Damien Pô, ibid.).
414
Benjamin Lemoine
budgétaire” : Vincent Champain, polytechnicien, diplômé de l’ENSAE (école del’Insee), ancien membre de la direction du Budget du ministère des Finances etactuel directeur général des services de la commune de Lille, dont Martine Aubryest maire ; et Fabrice Heyriès, énarque, conseiller référendaire à la Cour des Comptes,directeur général adjoint des services de cette juridiction, dirigée par PhilippeSeguin. » 1
Les journalistes identifient de leur côté facilement au moins deux des trois chiffreurs.Vincent Champain, le chiffreur retenu pour son appartenance à la « gauche », en raisonde son activité passée au sein du cabinet de Martine Aubry et ses collaborations en tantqu’expert mobilisé par le pool économique du parti socialiste, est aujourd’hui directeurde cabinet d’Éric Besson. Un conseiller technique du parti socialiste indique comment leparti a été prévenu du choix du chiffreur du gauche, mais « mis devant le fait accompli ».
« Ça ne nous gênait pas. L’Ide nous a prévenu en amont, donc on le savait enjuin-juillet 2006. On a pas à dire si : “oui ou non on a un problème avec la personne”.On l’aurait dit, mais à l’époque Champain faisait parti du groupe d’experts du partisocialiste. Il a été retenu sur des questions budgétaires. C’est pas à nous de leurdire. » 2
Ainsi, l’« objectivité » du chiffrage, irrégulièrement attestée, n’est pas adossée à unehypothétique recherche de la « vérité », comme le rappelle la cellule dans l’exposé deses motifs, mais bien sur la pluralité politique de calculs divers dont on reconnaît larelativité de la perspective, mais dont la composition est supposée annuler les effets. Lerecrutement de chiffreurs partisans (à droite, à gauche et au centre) doit permettre d’appro-cher, par la moyennisation des trois évaluations partisanes, une forme d’objectivité duchiffre. Chacun des trois chiffreurs élabore ce qui est communément appelé dans lesarènes techniciennes (économistes et budgétaires) une « règle de 3 ». Le terme renvoieà une opération mathématique basique : on multiplie le coût y d’une mesure de politiquepublique (le montant chiffré d’une prestation) par le choix x d’une cible déterminée(nombre de personnes concernées par la politique publique, limites temporaires de sonapplication). Le caractère rudimentaire de « la règle de 3 » est compensé par la relativi-sation du résultat obtenu en l’encadrant systématiquement de deux scenarii, que l’onappelle hypothèse basse et hypothèse haute 3. Le calcul des hypothèses probables estréalisé par le compromis entre les propositions du chiffreur de droite qui a tendance àmajorer ou minorer selon les cas, et celles du chiffreur de gauche qui a tendance à majorerou minorer inversement de son côté, selon les cas.
« L’écart (entre le chiffreur de droite et de gauche) c’était dans les hypothèses, pasdans les chiffres retenus qui étaient généralement neutres et objectifs. En revanchela formulation des propositions des candidats pouvait donner lieu à des interpréta-tions, qui pouvaient être très significativement différentes et c’est vrai que sponta-nément le chiffreur de gauche avait tendance à minorer la proposition du candidatde gauche et vice versa. Il était plutôt pour une interprétation a minima de la pro-position, là où le chiffreur de droite, s’agissant du candidat de gauche était plutôtmaximaliste, c’est de bonne guerre... » 4
1. Le Figaro Économie, 28/08/2006.2. Entretien avec un cadre du parti socialiste, cité.3. Seule l’équipe de campagne de Bayrou utilise aussi une hypothèse haute et basse, ce qui
modère les calculs et rend les résultats obtenus voisins de ceux de l’Ide.4. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.
415
Chiffrer les programmes politiques
L’hypothèse probable du coût se situe donc entre « l’hypothèse haute » (majorée)et « l’hypothèse basse » (minorée). Mais elle doit surtout se situer au-dessus du seuil designificativité d’une mesure politique, ce qui signifie qu’elle doit être supérieure au rythmenaturel des évolutions économiques 1. La solution bricolée par l’Ide consiste donc àsimuler en interne les divergences partisanes d’estimation : les scenarii optimistes etpessimistes sont traduits en perspectives politiques singulières. La technique tient sonoriginalité de la modération : c’est en anticipant ce qu’est une attaque polémique, ensimulant en interne la controverse partisane avec les trois chiffreurs, que surgit un chiffrejuste, raisonnable, qui ne prête pas à polémique et qui pourra être repris comme unedonnée de référence et d’arbitrage par les journalistes.
INTÉRESSER LES JOURNALISTES
Une fois l’outil de chiffrage « dépolitisé », il s’agit de convaincre de son effectivité et,à cette fin, d’enrôler des alliés dans le monde des médias. Le flux continu de chiffres misà disposition par la cellule va être abondamment relayé par la presse. Ce qui va attirer lesjournalistes dans la démarche de l’Ide, c’est précisément la capacité de la cellule à désen-castrer les débats sur le chiffrage budgétaire du simple échange de coups politiques. Lesjournalistes ont l’habitude de compter les points entre hommes politiques, mais ne disposentpas pour cela d’un arbitrage neutre. L’Ide et les journalistes vont articuler leurs intérêtsrespectifs dans un ajustement mutuel. En livrant leurs chiffres en « temps réel », « instan-tanément », les mesures « à peine dévoilées aussitôt chiffrées » 2, l’équipe de Débat 2007répond à l’exigence de rapidité propre au travail journalistique : chaque promesse de cam-pagne, revirement ou hésitation donne lieu, dans un délai court, à une mise en chiffre. ClaireGuélaud, journaliste au Monde, se souvient de la frénésie qui a conduit la machine média-tique à s’emballer : « L’Ide n’a pas mesuré, et ils ne pouvaient pas le savoir, à quel pointça allait intéresser l’ensemble de la presse. Et on a tous foncé comme des malades – et ducoup ils ont été un peu désarçonnés ». Le chiffrage « apolitique » de l’Ide est saisi par lesjournalistes comme un moyen de distanciation par rapport aux hommes politiques. Il permetd’apporter la contradiction dans une interview, en s’appuyant sur une référence extérieure.
« Ça permet de nuancer, de comparer, ça permet surtout – le principal mérite estsurtout celui-là – c’est de ne pas s’en tenir au seul chiffrage officiel des partis, quepar définition il faut prendre avec des pincettes, quel que soit le parti d’ailleurs,mais là au moins, voilà, pour la première fois on avait – je sais pas si c’était un jugede paix – mais on avait une possibilité de comparaison “hors parti” et c’est vrai queça c’était bien. » 3
L’utilisation des chiffres de l’Institut de l’entreprise permet aux journalistes de conso-lider leurs analyses et d’évaluer, à l’aune de ce calcul « impartial », la qualité d’une prisede position (« cohérent/incohérent, sérieux/pas sérieux »). À côté des chiffrages élaborés ausein des cellules partisanes, les journalistes, en se saisissant des chiffrages de l’Ide, fontexister (localement et au cas par cas) dans l’espace public un référent, une mesure par rapportà laquelle le politique va être temporairement contraint de participer et de se situer.
1. L’exemple fréquemment employé pendant la campagne est celui de l’augmentation auto-matique et naturelle du SMIC sur 5 ans indexé sur l’inflation.
2. La Tribune, 29/09/2006.3. Entretien avec Claire Guélaud, cité.
416
Benjamin Lemoine
DES ALLIANCES QUI FONT L’« OBJECTIVITÉ » DU CHIFFRAGE
Le degré de confiance dont bénéficient les chiffres mis en circulation par l’Ide reposesur des alliances nouées au sein du milieu journalistique, qui lui prête des qualités d’arbitreimpartial. Mais pour être crédibles, les estimations de l’Ide doivent être précises ; et pourêtre précises, elles ont besoin d’être appuyées sur les informations émanant des partis etdes équipes de campagne comme, par exemple, des détails sur les délais de mise en œuvreou sur la cible concernée par la politique publique. Le succès du dispositif de chiffragedes programmes va dépendre de la manière dont l’Institut de l’entreprise parvient à gérerla tension entre son nécessaire détachement par rapport aux partis politiques – pourprouver en actes son indépendance – et l’indispensable attachement à ces mêmes partispolitiques. Il apparaît là une injonction contradictoire avec laquelle le dispositif doitcomposer au jour le jour : tenir compte simultanément d’un devoir de distanciation vis-à-vis du politique (pour intéresser les journalistes) et d’un besoin d’informations sur lateneur exacte d’un projet de mesure et de sa mise en œuvre (pour ajuster les calculs),informations qui ne peuvent être recueillies qu’auprès des politiques eux-mêmes. Il fautdès lors tisser des liens permanents avec les équipes de campagne afin de ne pas rendrepublic des estimations trop éloignées de celles fournies par les staffs de campagne eux-mêmes. Concrétiser l’objectif d’un chiffrage non partisan, mesuré et consensuel impliquede nouer des contacts avec les responsables économiques des partis (chiffreurs internes)et entamer un processus itératif. En effet, l’Ide ne peut se permettre d’avoir des écartstrop importants avec les montants énoncés par les partis eux-mêmes car la crédibilitéaccordée aux chiffres par les journalistes dépend de la justesse – du sens de la mesure –reconnue aux chiffres. Des écarts significatifs susciteraient chez les journalistes la mêmeméfiance que ces derniers manifestent vis-à-vis des chiffres en provenance des partis.
« C’est très incertain. On est toujours en mesure de se planter complètement d’unfacteur 10, parce qu’on ne sait pas tout. C’est possible, et de bonne foi en plus.Notre souci, c’était de faire en sorte qu’on prévienne ce type de danger en ayantune communication avec les états-majors avant. » 1
Le principal ennemi du chiffrage apolitique est donc l’incertitude, la marge deméconnaissance inhérente à la gestion stratégique de la campagne par les candidats, quine révèlent jamais l’intégralité de leurs calculs, qu’ils soient économiques, budgétairesou politiques.
« [C’était] parfois tellement flou qu’il était normal d’avoir des discussions au préa-lable, avant comme après la publication des chiffrages avec les responsables. Poursavoir un petit peu où on met les pieds. » 2
L’Ide va pousser les politiques à expliciter leurs hypothèses, à rendre public lesconditions précises (temporelles, financières) de la mise en œuvre de telle ou telle pro-position. La quête de l’impartialité est cependant à double tranchant : en ne voulantsatisfaire aucun parti, l’Institut risque de ne pas satisfaire la préoccupation immédiate dupolitique en campagne, à savoir surpasser l’adversaire.
La reconnaissance de la qualité non partisane du chiffrage Débat 2007 n’est jamaisacquise et est donc sans cesse soumise à de nouvelles épreuves d’authentification. Lesusages journalistiques des chiffres de l’Ide ne sont pas stabilisés. En effet, une controverse
1. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.2. Entretien avec Jean-Damien Pô, ibid.
417
Chiffrer les programmes politiques
interne éclate au sein des médias dès le début du projet de l’Ide, en septembre 2006.L’Institut, ne prévoyant pas son propre succès, lie alors à l’époque un partenariat avecLe Figaro. Cette exclusivité réservée au quotidien finit par « énerver » des journalistes,qui y décèlent un parti pris. On y lit le « choix naturel » du patronat pour un journal dedroite, faisant rejaillir ainsi le stigmate du producteur. Un engagement au boycottage estscellé et on érige même en principe de ne pas relayer les chiffres. Mais le mot d’ordren’est pas suivi à la lettre dans toutes les rédactions. Claire Guélaud, du Monde, assureque c’est volontairement qu’elle n’a pas respecté ce pacte, étant donné qu’elle était per-sonnellement convaincue de la « solidité » et du « sérieux » du dispositif. Elle est criti-quée en février 2007 par Daniel Schneidermann sur son blog.
« Dans Le Monde d’hier, journal de référence auquel je me reporte évidemment demanière pavlovienne, j’ai appris une chose : Royal est un peu plus dispendieuse (53milliards) que Sarkozy (50 milliards). Pas grand chose, trois petits milliards, maistout de même. Comme je suis curieux, je me suis demandé d’où venaient ces chiffres.Apparemment, la source est irréprochable. Le Monde semble s’en remettre à un site,Débat 2007, lui-même émanation de l’Institut de l’entreprise. Bien. Jusqu’ici, çasemble neutre, Débat 2007, Institut, entreprise, que du scientifique. [...] Mais tu necrois pas, Claire (on se tutoie, on était ensemble au CFJ), que ce serait plus honnête,en présentant Débat 2007, de dire “émanation de l’Institut de l’entreprise, lui-mêmeprésidé par Michel Pébereau, ancien collaborateur, etc., etc.” ? Ce n’est qu’une ques-tion de présentation, peut-être. Mais ça compte, la présentation. » 1
De manière générale, la question de savoir s’il fallait réduire le dispositif au« patronat », ou le traiter comme parvenant à une forme d’indépendance et donc d’objec-tivité trouve une réponse au cas par cas : c’est rédaction par rédaction, selon les chiffragesavancés et les choix opérés par les journalistes (parler de « chiffres patronaux » ou non ?)que les calculs de l’Ide peuvent prétendre à l’impartialité ou bien être rejetés dans leursingularité. Dans un tel contexte, l’Ide, qui n’a pas le droit à l’erreur, s’évertue ainsi àsymétriser le traitement réservé aux deux principaux partis (PS et UMP) 2. Si le traitementexhaustif doit permettre d’échapper au doute sur la duplicité des chiffrages, accomplirun tel travail d’enregistrement systématique ne va pas de soi. Publiés, mis en ligne etréutilisés par les journalistes, les choix de chiffrage ont un impact sur l’état de la relationentre l’institut et les partis politiques et peut compromettre ses entrées dans les équipesde campagne. Dès lors, les chiffreurs de la cellule, jamais assurée d’être reconnue dansle débat public comme une instance neutre, hésitent à appliquer systématiquement leurméthode de chiffrage.
« Il y a eu un moment qui à mon sens était plus délicat pour eux. Au moment oùl’UMP a rendu public son projet pour 2007, ils ont dit : “Ce projet-là, on va pas lechiffrer parce que le contrat de législature c’est pas stricto sensu le projet présiden-tiel” ; ça a duré assez peu de temps parce qu’ils se sont aperçus que c’était uneposition très difficile à tenir, d’autant que le tout est très inspiré par les convictionsde Sarkozy. Ils ont mis une dizaine de jours à rectifier le tir, c’était pas très adroit.Ça a jeté un doute sur leur sérieux parce qu’ils avaient chiffré autour de 53 milliards
1. Daniel Schneidermann critique Guélaud sur son blog « big bang blog » : « Le Monde et lacalculette indépendante de Débat 2007. Un joli faux nez dans la guerre des chiffrages », 14/02/2007.Claire Guélaud confie d’ailleurs avoir été attaquée par la « gauche antilibérale », et notamment lesite Internet d’observatoire critique des médias Acrimed (Entretien avec Claire Guélaud, cité).
2. L’Ide situe dans les mêmes fourchettes les programmes de l’UMP et du PS : « L’Ide chiffreà 50 milliards les deux projets présidentiels », La Tribune, 13/02/2007.
418
Benjamin Lemoine
le coût du programme de Ségolène de mémoire, et que le coût du contrat de légis-lature de l’UMP paraissait aussi comme ça assez élevé. On avait l’impression qu’ilsavaient aussi des réticences à le donner. Mais ils se sont très vite récupérés et ilsont redonné le chiffrage et après il me semble que, voilà, les choses sont rentréesdans l’ordre. » 1
L’Ide livre ses estimations pour la droite avec délicatesse, en évoquant même un« lapsus » 2 de Nicolas Sarkozy lorsque celui-ci annonce la possibilité d’un crédit d’impôtrecherche à 100 %, « une mesure très chère ». Mais à plusieurs reprises alors que lacampagne bat son plein, en février 2007, les chiffreurs de Débat 2007 ne donnent qu’un« quitus partiel » aux projets du candidat ou en soulignent les défaillances 3. La questionde la distinction entre le programme législatif et les promesses du candidat Sarkozy sepose. La ligne chiffrée du programme de l’UMP ayant été fixée, les cadres du partirefusent de modifier leur chiffrage, « sauf qu’au fil des meeting de campagne, en janvier,février, mars, Sarkozy a rajouté des promesses », explique Guillaume Delacroix, journa-liste aux Échos 4. Ce dernier interprète cette disjonction comme le signe de la « mauvaisefoi » de l’UMP. Il relate comment son journal et l’Ide ont continué à ajouter les promessesau compteur du parti, estimant que ce fait atteste de la déontologie des chiffreurs deDébat 2007 : « Ils [l’Ide] ont alourdi la facture totale, c’est logique, ils ont fait leurboulot pour le coup ». Ces commentaires sont significatifs des incertitudes attachées à laqualité d’arbitre revendiquée par l’Ide, et qui peut lui être reconnue ou bien mise en causeen fonction des chiffrages et des situations.
UN JEU À DOUBLE TRANCHANT
Le choix de traiter de manière symétrique la droite et la gauche l’emporte à l’Ide.Le candidat de l’UMP est à ce titre la première victime du chiffrage car la balance dufinancement de son programme penche fortement du côté des dépenses.
« Là où les résultats de l’évaluation de Rexecode étaient très fortement favorablesà Sarkozy, nous on s’est borné un peu bêtement à enregistrer le coût de ses pro-messes. Et comme Sarkozy a beaucoup promis... ça nous a conduit à faire gonflerson compteur, mais c’était de sa faute, pas de la nôtre. » 5
Le compteur de Nicolas Sarkozy « gonfle » alors que celui de Ségolène Royal restestable, celle-ci n’ayant pas encore déclaré toutes ses intentions. Dans la presse, suite àson discours prononcé à Saint-Étienne 6, se construit peu à peu l’image d’un Sarkozy prisdans les contradictions du financement du programme de l’UMP. Déclaré candidat àl’investiture de son parti, il multiplie les prestations médiatiques et oratoires devant les
1. Entretien avec Claire Guélaud, cité.2. « Ainsi lorsqu’il a évoqué la possibilité d’un crédit d’impôt recherche à 100 %, dans son
discours dimanche, Nicolas Sarkozy a “visiblement fait un lapsus”, selon Débat 2007. Son entourageconfirme en effet que le dispositif auquel il faisait référence est celui contenu dans le projet législatif,plus limité » (Sophie Fay, Le Figaro Économie, 17/01/2007).
3. L’Ide n’accorde pas « confiance à l’hypothèse de croissance de l’UMP », selon Le Figaro,11/12/06. Cf. aussi « Quand l’UMP refait ses comptes », Le Nouvel Observateur, 22/02/2007.
4. Entretien avec Guillaume Delacroix, cité.5. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.6. « Attaqué sur le manque de précision sur le chiffrage de son programme, Nicolas Sarkozy
est resté flou. Mais la vérité ne saurait tarder » (La Tribune, 1/12/2006).
419
Chiffrer les programmes politiques
militants et s’accorde des marges par rapport à la ligne du parti. Refusant de faire lesarbitrages qui rendraient ses promesses cohérentes 1, on le dit même atteint de « chira-quisme électoral » et de « ferveur dépensière » 2. À mesure que cette image s’amplifie,les relations entre l’Institut de l’entreprise et l’UMP se détériorent.
Le chiffrage non partisan est donc à double tranchant. D’une part, l’Ide doit gérerla tension entre attachement et détachement vis-à-vis des partis politiques : l’enregistre-ment systématique des propositions, quelle que soit leur forme (orale ou écrite) qui conduità la symétrisation du traitement (droite et gauche à la même enseigne), donne en effetlieu à des écarts d’estimations entre Débat 2007 et les lignes officielles de chiffrage desécuries partisanes. Ces divergences, rendues publiques, constituent autant de dissonancesde nature à ternir l’image publique des candidats et peuvent donc assombrir les relationsentre l’Ide et les équipes de campagne. D’autre part, les équipes de campagne en licepeuvent être tentées de vouloir tirer profit de la participation à un dispositif dont lesmédias tiennent compte et font grand cas : la perspective d’une homologation du chiffrageofficiel des partis politiques par le dispositif de l’Ide, introduit comme une référence parles journalistes, peut s’avérer attractive.
« La conférence de presse, on a marché sur l’eau. J’en ai jamais fait une aussi bonne.Quand on nous a dit : “Êtes-vous sûr de votre chiffrage ?” On a dit : “On est pas siloin, on est à 20 % près de l’Ide. Ce qui prouve qu’on s’est pas trompé”. » 3
Comme le suggère l’extrait ci-dessus, la position par rapport aux chiffrages del’Ide, bien qu’elle ne soit pas calée au millimètre, est considérée comme un élémentcertifiant la solidité du chiffrage du projet socialiste. Mais jouer le jeu du chiffrage,c’est aussi se plier aux contraintes de l’exercice et s’empêcher d’attaquer l’adversairesur ce terrain. La face contraignante du chiffrage se fait aussi sentir au PS. Ainsi,Ségolène Royal doit fréquemment faire face à des interrogations sur la cohérence dufinancement de son programme. Les remarques sur la gestion difficile du chiffrage parla candidate s’associent à des critiques sur son supposé « manque de compétence ». Sesdéfenseurs y voient des accusations sexistes. Jacques Julliard titre l’une de ses chroni-ques « La femme à abattre » 4. Il y souligne un acharnement sur la candidate qui passenotamment par le biais de reproches sur des supposées insuffisances dans le chiffragede son programme.
« Parce que Sarkozy est le plus sérieux ? Chansons ! Un candidat qui propose 50 mil-liards de dépenses supplémentaires, plus 68 milliards de réduction d’impôts, quitteà réduire ensuite son évaluation, quand la France est endettée jusqu’au cou, voustrouvez cela sérieux, vous ? On n’entend pourtant, venant du grand capital, que delégers toussotements. En revanche, dès que Ségolène propose la moindre réformesociale et là, le gang des bons apôtres et des économistes marrons de scander enchœur : le chiffrage ! le chiffrage ! » 5
En somme, ne pas chiffrer revient à prêter le flanc à une attaque de l’adversairesur cette question. La candidate est surnommée par Thierry Breton « Madame
1. La quadrature du cercle « improbable » de la baisse des impôts, de l’augmentation desdépenses et de la réduction des déficits rend l’équilibre de sa posture difficile.
2. « Quand Sarkozy copie Chirac », L’Express, 01/02/2007. Dans le même ordre d’idées, la« ferveur dépensière » du candidat est pointée par Alain Lambert qui doit convaincre, dans l’équipede campagne, Emmanuelle Mignon (L’Express, 14/12/2006).
3. Entretien avec un cadre du parti socialiste, cité.4. Jacques Julliard, « La femme à abattre », Nouvel Observateur, 22/02/2007.5. Jacques Julliard, ibid.
420
Benjamin Lemoine
On-verra-plus-tard » 1. Dans son « fait du jour », Le Parisien relate comment un téléspec-tateur, invité à questionner la candidate à la télévision, force le trait sur ses supposées« lacunes ».
« Antoine, restaurateur du Kremlin-Bicêtre, lui reproche de n’être pas venu au salondes entrepreneurs, contrairement à ses rivaux Nicolas Sarkozy et François Bayrou.“Je suis dans l’action, je m’intéresse aux petites entreprises”, se défend Royal, sansconvaincre son interlocuteur. Qui dénonce dans la foulée l’absence de “chiffrage”de son pacte présidentiel. “Il n’y a pas grand-chose là-dedans”, accuse Antoine. “Si,il y a beaucoup de choses”, maintient Royal. » 2
Les journalistes mettent en scène le désordre de sa campagne et les différents« couacs » au sein de l’équipe de campagne, notamment suite au départ fracassant de M.Besson.
« [Besson] a pété les plombs parce qu’il faisait un chiffrage le matin, le soir Ségolènefaisait un meeting, elle annonçait des tas de promesses et du coup derrière, lesjournalistes appelaient Besson en lui disant : “Mais dis donc ça coûte combien ça ?”Il était obligé de pipoter des estimations. Il était pas au courant des mesures, c’estune catastrophe. » 3
LE CHIFFRAGE IMPARTIAL DÉFAITPAR LA COMPÉTITION POLITIQUE
Portée par les journalistes, la nécessité de chiffrer devient une contrainte et pèse surles stratégies électorales des candidats. De manière croissante, les chiffrages apparaissentaux équipes de campagne de Royal et de Sarkozy comme des éléments nuisibles quiempêchent le déroulement « normal » de la campagne. D’autant que la symétrie à laquelleaboutit l’exercice, qui alourdit autant la facture budgétaire de la droite que de la gauche,rend le chiffrage plus contraignant que politiquement rentable. Qui plus est, la situationsemble favoriser un troisième homme.
LE FAVORI DU CHIFFRAGE
Vers la fin de la campagne, l’idée s’impose progressivement que le dispositif del’Ide fait le jeu de François Bayrou, qui semble être le seul à marquer des points dansun combat politique organisé autour du coût des programmes. J.-D. Pô décrit commentles relations nouées avec Charles Amédée de Courson 4 étaient les plus professionnellesde toutes celles qu’il a pu entretenir avec les staffs politiques. L’ancien conseiller réfé-rendaire à la Cour des Comptes et haut fonctionnaire à la direction du Budget auraitpleinement joué le jeu du processus itératif que J.-D. Pô espérait. Courson ouvre sa copie,montre ses notes et fait partager ses calculs. Pour autant, comme le font remarquer certains
1. Le Figaro, 10/06/2006.2. Le Parisien, 20/02/2007.3. Entretien avec Guillaume Delacroix, cité.4. Député nouveau centre, ex-UDF, conseiller économique et budgétaire de François Bayrou
pendant la campagne présidentielle 2007 et secrétaire de la commission des finances à l’Assembléenationale.
421
Chiffrer les programmes politiques
opposants politiques et certains journalistes, Bayrou est le dernier à livrer des propositionssuffisamment détaillées pour faire l’objet d’un chiffrage : « Il s’en est sorti comme ça »,persifle un cadre du parti socialiste 1. Cela n’empêche pas Bayrou d’apparaître comme lebon élève budgétaire ; « incollable », il est surnommé le « champion du chiffrage » et lesjournalistes relaient le fait que Bayrou marque des « points » dans les barèmes de l’Ide 2.« Le processus itératif » que Jean-Damien Pô souhaite instaurer entre les partis et lacellule de chiffrage Débat 2007 fonctionne au final avec le seul Bayrou, qui joue entiè-rement la carte du chiffrage. Les journalistes y débusquent les intérêts bien compris du« troisième homme » : le chiffrage lui permet de se distinguer et d’ajuster « son tir surles jumeaux Ségo-Sarko » 3. La maîtrise des déficits et la résorption de la dette publiquedevient un axe majeur de la campagne de François Bayrou et le terrain privilégié à partirduquel il peut se démarquer des deux autres candidats.
« Avec Charles de Courson, on est allé trois fois [à l’Ide], sur la discussion deschiffrages. Parce qu’au début, ils disaient : “Là-dessus, on n’est pas d’accord avecça.” Et finalement, on est arrivé à quelque chose de pratiquement identique. Toutnotre programme, il était chiffré. Il était quatre fois inférieur en termes de coût parrapport aux programmes des deux autres. Et donc, à 2 ou 3 milliards d’euros près,on était au même chiffre que celui de l’Institut de l’entreprise. Charles de Coursona beaucoup travaillé avec eux. C’est ça, l’échange. L’intérêt, il est là. Mais c’étaitune pratique nouvelle. » 4
L’animateur de Débat 2007 relate ainsi la collaboration avec le chiffreur de l’UDF.« Courson a fait [son chiffrage] de manière extrêmement professionnelle. Il souhai-tait capitaliser sur le caractère vertueux, entre guillemets, du programme budgétairede son candidat et, par conséquent, il a voulu déminer le terrain en présentant uneévaluation budgétaire du coût des mesures qui était la moins attaquable possible. » 5
Sondant sur son site Débat 2007 le vote à la prochaine présidentielle des internautesvisiteurs, l’Ide recueille un score très favorable pour François Bayrou au premier tour,score sans commune mesure avec les résultats réels de l’élection présidentielle 6. Candidatle plus « sérieux » ou candidat le « moins disant en dépenses publiques » 7 ? L’Ide n’acessé de se défendre de faire le jeu du « moins disant », réfutant l’accusation de provoquerdes « enchères inversées ». Mais, le présupposé d’autofinancement budgétaire, présenten germe dans le projet de l’Ide et annoncé en conférence de presse, rejoint l’hypothèsepolitique de François Bayrou.
« Si on doit donner, si on doit s’engager dans des dépenses supplémentaires, il fautimmédiatement dire comment on les finance, c’est-à-dire par quelles économies on
1. Entretien avec un cadre du parti socialiste, cité.2. « Bayrou vainqueur de la bataille du chiffrage. Qui l’eut cru ? », Le Figaro, 16/02/2007 ;
« Des trois candidats en tête dans les intentions de vote, le programme de Bayrou est celui dont lespropositions coûtent le moins cher », Le Monde, 8/03/2007.
3. Le Figaro, 16/01/2007.4. Entretien avec un conseiller parlementaire du Nouveau Centre (ex-UDF), qui a contribué
avec Charles de Courson au chiffrage de François Bayrou.5. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.6. Bayrou arrive en tête avec 37,6 % des intentions de vote, suivi de Sarkozy avec 27,3 %
et Royal avec 20 % (Sondage interne Débat 2007, « Engageons le débat », réalisé entre les 11 et22 avril 2007).
7. On qualifie même son programme de « minimaliste » (L’Express, 22/02/2007).
422
Benjamin Lemoine
les finance, sachant qu’on ne peut plus continuer à augmenter les prélèvementsobligatoires. » 1
Bayrou apparaît comme le seul à se soumettre jusqu’au bout aux exigences dudispositif de chiffrage. Dans la dernière ligne droite, les deux autres candidats ne semblentplus considérer la stratégie du bon chiffrage comme efficace 2. Pô explique, non sansdéception, comment les équipes de campagne, prises par la compétition, cherchent avanttout à multiplier les ressources, à maîtriser leur image et non à dévoiler leur jeu.
« J’aurais souhaité que ce soit des échanges ouverts et les partis auraient souhaitéque ce soit des échanges fermés [...]. L’objectif aurait été de nouer avec les partisun dialogue ouvert pour qu’on évite d’aboutir à des évaluations non explicitées.L’idéal aurait été qu’on confronte nos chiffrages à leurs chiffrages, pour qu’on puisserentrer un peu dans le détail et voir les hypothèses sur lesquelles ils se fondent, çaaurait été de préciser la portée des promesses, des propositions. Alors une partie duchemin a été conduite, c’est-à-dire que là où les partis ne chiffraient même pas leurspropositions, ils ont été contraints par la pression des médias et de l’opinion publiqueà le faire. C’est une bonne chose en soi, mais on n’est pas rentré dans une analysemesure par mesure. » 3
L’EFFONDREMENT DES ALLIANCES
Le réseau de confiance que l’Ide est parvenu à tisser avec les journalistes et lesprofessionnels de la politique repose sur une alliance conjoncturelle dans laquelle lesconsidérations stratégiques ont joué un rôle prépondérant ; l’alliance s’en montre d’autantplus précaire. La version non partisane du chiffrage, telle que l’orchestre l’Ide, ne procureaux deux futurs sélectionnés du second tour aucun avantage ; au contraire, en favorisantBayrou, il produit des effets en leur défaveur. Plus rien ne peut lier les deux candidatsdu PS et de l’UMP au projet défendu et mis en œuvre par l’Ide. La rupture se fait defaçon tonitruante au PS et intervient dans le contexte du départ d’Éric Besson du partisocialiste. L’interprétation des motifs de sa démission constitue d’ailleurs un enjeu tac-tique pour le centre et la droite. Pour Charles de Courson, chiffreur de Bayrou, il n’y apas de doute, Besson est parti à cause de « l’irresponsabilité budgétaire » de sa candidate.
« Ségolène Royal, c’était une soixantaine de milliards de dépense supplémentairesavec interdiction de dire comment on financera. Donc c’était quand même une stra-tégie étrange. Besson, le malheureux Besson, il a fini par craquer, il s’est sauvé etpuis il est passé dans le camp adverse, bon... » 4
Éric Besson, soucieux dans les premiers moments de ne pas trop nuire au partisocialiste, démentira publiquement que les questions budgétaires soient à l’origine de son
1. Entretien avec Charles Amédée de Courson, député Nouveau Centre, soutien de FrançoisBayrou. Le prérequis de ne pas élever les prélèvements obligatoires se retrouve dans les recom-mandations de l’Ide. Cf. Michel Pébereau, Bernard Spitz, C’est possible, voici comment. Lettreouverte à notre prochain(e) président(e), Paris, L’Institut de l’entreprise/Robert Laffont, 2007.
2. « Le chiffrage des programmes, s’il a fait débat dès le début du mois de février, n’est plusmis en avant par aucun candidat à l’approche du premier tour. Chacun a pris des libertés par rapportaux engagements de départ, ajoutant dans la dernière ligne droite de nouvelles mesures » (LesÉchos, 17/04/2007).
3. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.4. Entretien avec Charles Amédée de Courson, cité.
423
Chiffrer les programmes politiques
départ. Quelque temps après, l’équipe de chiffreurs remplaçant Besson au PS, représentéepar Michel Sapin et Didier Migaud, organise une conférence de presse 1. J.-D. Pô s’y faitinviter en tant que responsable d’un site Internet. Au moment des questions-réponses, ilprend la parole et interpelle les représentants de la candidate sur leurs calculs.
« [Il] nous a interpellé en nous disant qu’on ne savait pas compter. On lui expliquaitque, un : “On sait très bien compter”. Que, deux : “Nous, on avait des choix poli-tiques et on affecte tant de milliards dessus. On est pas plus bête que les autres.” Ettrois : en restant courtois je lui ai redit et je le répéterai, autant que faire se peut :“Je suis certain que c’est pas le bon endroit de venir à la conférence de presse.” Oninvite les journalistes. Il s’est mis au milieu. Il s’est levé “Vous ne savez pas compter,vous faites obstruction !” Il a été tellement suivi par les journalistes. Nous, on voitla salle se vider à moitié puis les journalistes revenir une fois qu’ils avaient eu leurssons. » 2
« Honnêtement le chiffrage, c’était vraiment un épisode ridicule, il y a eu tout d’uncoup un souci de respectabilité, et... sous pression de l’Ide qui jouait vraiment unjeu pas très clair et, à mon avis, très politisé. On a eu des trucs pas très beaux,notamment au milieu de la conférence de presse, l’Ide était là et a commencé à fairesa contre-conférence de presse au milieu, enfin un truc complètement hallucinant. » 3
Ces récits témoignent de la dégradation des relations entre l’Institut de l’entrepriseet le parti socialiste. Le constat est vrai plus généralement : c’est tout le réseau d’associésque Débat 2007 était parvenu à tisser autour de son dispositif qui s’effrite peu à peu. Lanoblesse du chiffrage impartial, fruit d’un travail de neutralisation des effets politiques,perd de son vernis ; la crédibilité accordé par les médias aux chiffres de l’Ide tend às’effondrer simultanément 4. Les journalistes, présents à la conférence de presse, sontchoqués de l’interpellation de l’Ide.
« Quand je disais qu’ils ont un peu outrepassé leurs prérogatives, c’est qu’ils se sontincrustés dans les conférences de presse des candidats, c’était pas leur place, c’étaitni leur rôle ni leur place. Moi je me souviens d’une conférence de presse au PS, ilsont réussi à rentrer, je sais pas comment, au siège du PS, rue de Solférino et il yavait le calculateur de l’Institut de l’entreprise qui est intervenu dans la conférencede presse, qui a engagé un débat avec Michel Sapin. Enfin c’était pas le lieu, etnous les journalistes, on était furieux parce qu’on était pas là pour ça [...], c’étaitpas sérieux. C’était pas leur place, les conférences de presse, c’est pour les journa-listes. Ce n’est pas pour les intervenants qui viennent faire des débats. » 5
Si la prestation de l’Ide à la conférence de presse est interprétée par certains commeune forme d’intrusion et de « court-circuitage » des chaînes de médiation ordinaires entrepolitiques, journalistes et citoyens-spectateurs, pour Jean-Damien Pô, cette interrogationdirecte sur le chiffrage et le cadrage économique et financier des propositions s’inscrit
1. Parti socialiste, « Le pacte présidentiel, un financement juste pour des réformes profondes »,21/02/2007.
2. Entretien avec cadre du parti socialiste, cité.3. Entretien avec un conseiller parlementaire de Didier Migaud.4. G. Delacroix écrit ainsi : « L’intervention quasi quotidienne de l’Institut de l’entreprise
commence à agacer au PS. L’entourage de Ségolène Royal n’est pas convaincu de l’impartialitédes chiffrages du club patronal présidé par Michel Pébereau. “Je suis prêt à aller devant lui pouren débattre point par point”, a lancé sèchement Michel Sapin. Didier Migaud conteste le référent :“L’Ide ne délivre pas la Bible” » (Les Échos, 22/02/2007).
5. Entretien avec journaliste Y, rendu anonyme, cité.
424
Benjamin Lemoine
dans la continuité du rôle d’information citoyenne qu’il assigne au site Internet Débat2007 1. Au final, le conflit est interprété comme un marqueur de l’aspect militant, oupolitisé de l’outil de chiffrage promu par l’Ide.
À moins de trois mois du scrutin, les candidats UMP et PS tentent de contournerun chiffrage qui devient un obstacle. Ainsi, Ségolène Royal semble gênée par la focali-sation médiatique sur le chiffrage. À plusieurs reprises, elle affirme de ne pas vouloirrester « enfermée » dans des discussions « comptables ». Elle oppose aux sommationssur le coût de son programme, le style « terrain » et « humain » de sa campagne et ditne pas tomber dans le piège du chiffrage 2. Pour sa part, Henri Guaino, connu pour êtrela plume du candidat Sarkozy, a déjà publié à plusieurs reprises des tribunes dans lapresse contre le principe même du chiffrage 3. Évoquant les tiraillements et les contra-dictions au sein de son parti, où les « budgétaires » tentent de tordre le bâton de lacampagne dans un sens plus rigoriste et modéré sur le plan financier, Sarkozy laissepercevoir son irritation : lorsqu’il tirera le bilan de sa campagne, il en fera état commedu seul regret et couac de cette campagne. Et de lancer : « Le vrai sujet, ce sont lesvaleurs » 4.
APRÈS « L’ASPHYXIE » 5, LA GRANDEUR DES PROMESSES POLITIQUES
« Jusqu’à présent, ceux qui ont eu raison, au sens démocratique, c’est-à-dire qui ontgagné la confiance des électeurs, ce sont ceux qui ont promis des choses dont ilssavaient qu’ils ne tiendraient pas, alors on peut dire : “c’est triste, c’est triste pourla démocratie”. » 6
Face à l’ampleur que prend le chiffrage, s’installe donc une autre version de lapolitique qui met l’accent sur l’importance de mettre les moyens à la disposition de lavolonté : on réaffirme une autre grandeur du politique qui nécessite de privilégier lesvrais combats, ceux qui se jouent dans le domaine des idées et des valeurs : « On ne faitpas une campagne de Premier ministre » 7, « Je ne me présente pas à la présidence duconseil général » (dixit Nicolas Sarkozy 8). Dans une tribune qui place la polémique surle chiffrage au centre de son propos, Henri Guaino plaide pour la résurgence de l’éco-nomie « politique et morale », fondée sur des choix en valeur, l’ennemi étant « le posi-tivisme » en économie et le « rappel permanent de la contrainte » 9. Dans les dernières
1. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.2. « Royal ne veut pas se laisser enfermer dans le débat sur le chiffrage », Les Échos,
14/02/2007.3. Henri Guaino regrette que « le comptable ait pris le pouvoir dans le débat politique », dans
les chroniques « L’ambiguïté des chiffrages », Les Échos, 24/10/2006, et « Économie politique ouscience économique », La Croix, 18/12/2006.
4. Le Figaro, 18/04/2007.5. En référence à un titre de Pébereau, qui parle des dérapages de la dette publique comme
cause de l’asphyxie de l’action publique : Michel Pébereau, Sébastien Proto, « Dette publique,rétablissement ou asphyxie », dans C’est possible, voici comment..., op. cit.
6. Entretien avec Charles Amédée de Courson, cité.7. Alain Gérard Slama, « Aussi longtemps que les candidats actuels se laisseront enfermer
dans une campagne de Premier ministre, le crédit de notre vie politique n’aura rien à gagner », LeFigaro Magazine, 10/03/2007.
8. Le Monde, 21/10/2006.9. Henri Guaino, La Croix et Les Échos, art. cités.
425
Chiffrer les programmes politiques
semaines avant le jour du scrutin, les candidats du PS et de l’UMP se soucient moins dela traduction chiffrée des propositions, ce que les journalistes ne manquent pas de relever.L’exercice du chiffrage est renvoyé à son statut d’instrument au service du politique, etnon plus d’arbitre neutre et contraignant. Les défenseurs « de la grandeur politique » faceà l’exercice comptable s’en prennent à l’inversion des séquences de la campagne élec-torale et réaffirment explicitement la figure volontariste du politique : en résumé, leschoix d’abord, les moyens et la technique ensuite.
LA POLITIQUE DE L’INSTRUMENT « DÉVOILÉE »
L’impartialité du chiffrage Débat 2007 est mise en doute, dans le cadre d’une contro-verse entre économistes, au moment de la publication d’un manifeste en provenance del’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 1, une semaine après laconférence de presse houleuse où le représentant de l’Ide s’était confronté aux représen-tants du parti socialiste. Jean-Paul Fitoussi et Xavier Timbeau, au nom de la scienceéconomique et de sa « déontologie », désavouent le travail des chiffreurs. Timbeau, direc-teur du département Analyse et prévision de l’OFCE, considère le chiffrage comme uneversion « ultra-dégradée » du « véritable » travail de l’économiste. Selon lui, la voie nor-male des campagnes électorales consiste à solliciter les experts pour leur demander des« évaluations » sur le bien-fondé d’une mesure particulière. Ces évaluations reposeraientsur un jugement « bouclé » 2, constitué à partir « d’un cadre d’hypothèses macro-écono-miques déterminé ». Impossible, d’après lui, de conduire ce type de travail d’après lespropositions « flottantes » des candidats, qui ne cessent de se modifier au fil de la cam-pagne, et au gré des revirements successifs occasionnés par le rythme effréné des cam-pagnes : « Ça saute du coq à l’âne » 3. Pour l’OFCE, qui, d’une manière générale, fait del’évaluation son cœur de métier, la rapidité d’exécution des chiffreurs de la cellule patro-nale et le succès médiatique rencontré ont été déroutants. Sans être formalisés, des débatsvirulents sur ce refus de chiffrer les propositions des candidats ont lieu au sein même del’Observatoire.
« Ici, il y a quand même une culture du chiffrage, il y a toujours eu ça, c’est un peunotre rôle aussi. On a les outils pour le faire ici et on a la culture. Donc, si on lefait pas, on a l’impression de ne pas faire notre travail. [...] Il y a eu ici tout uncourant pour dire : “Mais si on mesure pas les programmes, si on chiffre pas toutesles mesures, alors on fait pas notre travail”. [Untel] disait : “On sert plus à rien, il
1. L’OFCE est un institut qui, structurellement et conjoncturellement, défend une positionrelativiste sur la question de la dette publique. Rattaché à la Fondation nationale des sciencespolitiques, l’observatoire est créé en 1981, sous l’impulsion de Raymond Barre (au même momentque Rexecode, institut patronal, et l’IRES, géré collégialement par les syndicats de salariés) « pourconcurrencer sur le terrain de l’expertise l’Insee et la Direction de la prévision ». Mario Dehoveexplique que l’OFCE n’est pas soumis directement à une urgence ou une contrainte politique :« L’OFCE produit en toute liberté des analyses de la conjoncture d’inspiration plus keynésienneque celle des administrations publiques » (Mario Dehove, « Les acteurs de l’expertise économiqueen France », dans Benoît Ferrandon (dir.), La politique économique et ses instruments, Paris, LaDocumentation française, 2004, p. 138-143).
2. Une évaluation bouclée signifie joindre, dans le calcul, le coût ex ante d’une mesure etson rendement in fine.
3. Entretien avec Xavier Timbeau, directeur du département Analyse et prévision de l’OFCE.
426
Benjamin Lemoine
faut donner votre démission parce qu’on vous paie et vous faites pas votre boulot ».Finalement, on a un peu rien fait, ça a fait des énormes discussions”. » 1
La prise de position de l’observatoire, controversée en interne, est justifiée dans unmanifeste publié dans la presse. De nouvelles affinités électives vont se nouer entre lesprofessionnels de la politique déçus du chiffrage et les économistes de l’OFCE réduits àla passivité. Pour « torpiller » l’entreprise de la cellule de chiffrage de l’Ide, l’OFCEemploie les « mêmes armes », « agit par voie de presse » afin de détricoter le réseauassocié autour de l’opération de chiffrage non partisan. Il s’agit de (re)convertir les jour-nalistes à la cause de ceux qui se considèrent comme les vrais « économistes », c’est-à-dire à « l’évaluation ». Le dialogue s’amorce et le ralliement de journalistes à la positionde l’OFCE s’apparente pour Timbeau à un trophée. Selon ce dernier, les journalistespeuvent dorénavant opposer à « l’appétit » des rédacteurs en chef pour les chiffres del’Ide la caution scientifique d’une expertise alternative 2.
Pour enterrer le dispositif de l’Ide, l’évidence de l’équation « Pébereau = chiffrage »est réaffirmée : l’arbre est réduit à ses racines et non plus jugé sur ses fruits. Le cadredu parti socialiste, rédacteur des argumentaires économiques pendant la campagne, recon-naît dans la prise de parole publique de l’OFCE une manière salutaire de re-politiser lesenjeux, quand le dispositif de chiffrage de l’Ide s’apparente, selon lui, à une réduction« idéologique », sous couvert de neutralité, des discussions économiques. En rendantdiscutable l’impératif du chiffrage ex ante par le politique, l’OFCE trouve des alliés àgauche comme à droite. Le dispositif technique est un obstacle pour les dénonciateursde l’attention portée au chiffrage en prétendant re-polariser idéologiquement le débat :en empêchant des options politiques alternatives d’émerger, le dispositif technique estperçu comme politiquement actif.
« Les démarches des économistes de l’OFCE sont intéressantes parce qu’elles per-mettaient de politiser les enjeux, et on y a tous gagné. » [...] « L’Ide dépolitise parceque c’est technique, moi je reste persuadé qu’il y a quand même un fond politiquedépensophobe. Donc politiquement à droite, mais ça c’est parce que j’ai 20 ans demilitantisme, que je lis pas les choses que techniquement. Je pense que la neutralitéest un principe de droite. Quand on confond technique et politique, c’est qu’on estde droite. » 3
« Le politique, il faut qu’il soit bien convaincu que réduire la dette, ça va résoudretous ses problèmes. Parce que vous vous engagez dans un programme assez violentde réduction de la dette. Vous réduisez la dette. Pébereau est content, mais il reste59 millions 999 999 Français à convaincre. » 4
Les deux principaux partis politiques réaffirment, aidés par l’OFCE, leur choix faceau cadre politique « donné » du chiffrage : c’est aux partis qu’incombe la tâche de placerla « borne » entre le politique et le technique (les moyens budgétaires). La controverseest l’occasion d’un exercice collectif de réflexivité sur la place de l’expert et le rôle qu’ildoit jouer auprès du politique : l’ascendant de la technique et de ses « technocrates » qui,en balisant l’espace des possibles, empiéterait sur le terrain de la politique est « dévoilé »et l’OFCE peut prétendre restaurer le politique dans sa « noblesse ».
Au-delà d’une explication qui réduirait ces combinaisons à une simple opportunité
1. Entretien avec économiste de l’OFCE, rendu anonyme.2. Entretien avec Xavier Timbeau, cité.3. Entretien avec un cadre du parti socialiste, cité.4. Entretien avec Xavier Timbeau, ibid.
427
Chiffrer les programmes politiques
ou revirement de campagne 1, il est intéressant de comprendre comment des outils cogni-tifs sont porteurs d’horizons temporels différents pour l’action politique : entre court,moyen et long terme 2. Au moment des discussions du projet de loi de finances pour2008, Jean-Paul Fitoussi publie un texte intitulé : « La certitude des chiffres et l’incerti-tude du savoir ». Dans un encadré, il met en cohérence la position de l’OFCE pendantla campagne et définit le rôle des économistes auprès des politiques.
« L’OFCE avait pendant la campagne présidentielle refusé de participer aux exer-cices de chiffrage des programmes des candidats qui faisaient alors florès. Il noussemblait vain de hiérarchiser les programmes selon l’importance de la dépense exante qu’ils impliquaient et qui de surcroît était mal connue. Il est de gros investis-sements rentables et de petits qui ne le sont pas du tout. L’un des métiers principauxde l’OFCE est l’évaluation des politiques publiques. Or, une telle évaluation n’estpossible que lorsque les politiques envisagées sont connues avec précision de façonà ce que l’on puisse en étudier les conséquences éventuelles [...]. Ce sont les effetsdes politiques qu’il convient d’analyser – en quelque sorte leur rendement – davan-tage que leur coût initial. » 3
Deux approches du savoir économique se donnent ainsi à voir. Du côté des chiffreurs,on retrouve une épistémologie « réaliste » : les vrais chiffres du coût budgétaire existent.Ils sont connus et incontestables, et il est possible de calculer le coût futur d’une mesurepolitique à l’aune de ces connaissances stabilisées du présent : les données recensées parles chiffreurs sont officielles, extraites de la loi de finances, des « bleus budgétaires »,certifiés, insoupçonnables en somme. Selon Pô, aucune incertitude ne peut être opposée à« l’arithmétique » ex ante du chiffrage, qui relève d’une « mécanique incontestable » 4.Quand les évaluations macro-économiques d’une proposition politique délivrent un dia-gnostic sur l’impact économique – positif ou négatif – à venir (futur et ex post) de mesuresdécidées, le temps du chiffrage budgétaire est celui du présent. Selon les défenseurs duchiffrage, l’évaluation des impacts économiques d’une mesure projetée et ses effets poten-tiels sur la croissance bénéficient d’un degré de crédibilité scientifique moindre que lechiffrage des coûts ex ante. La science du chiffre, matériellement durcie dans des équationsbudgétaires, est associée à un discours de pédagogie du fait scientifique. La situation« réelle » des finances publiques est contenue dans les chiffres. Le rôle du politique est dese faire le porte-voix de la connaissance rationnelle des faits économiques. Le « savant »guide le politique en lui indiquant la « vérité » de l’ingénierie budgétaire 5.
Pour les opposants au chiffrage, quand l’attention aux coûts budgétaires devientun axe d’orientation politique et une priorité, la connaissance du présent devient
1. L’interprétation opportuniste de ces associations (et dissociations) entre les professionnelspolitiques et les économistes est d’ailleurs partagée par le journaliste-essayiste François De Closetsqui fait le récit un an plus tard des polémiques sur le chiffrage. Il déplore le fait que les candidatsn’écoutent pas les « bons » experts, ceux qui tiennent compte du chiffrage et de la dette publique.« Il existe de nombreux économistes responsables dans la majorité qui manifestent en privé leursinquiétudes. Mais à l’évidence, ils n’ont pas l’oreille de Nicolas Sarkozy. De Henri Guaino àJean-Paul Fitoussi, les endetteurs sont toujours les conseilleurs » (François de Closets, Le divorcefrançais. Le peuple contre les élites. Paris, Fayard, 2008, p. 241).
2. Cf. Michel Armatte, Amy Dahan, « Modèles et modélisations (1950-2000) : nouvellespratiques, nouveaux enjeux », Revue d’histoire des sciences, 57 (2), 2004, p. 243-303.
3. Jean-Paul Fitoussi, Lettre de l’OFCE, 288, 26/07/2007.4. Entretien avec Jean-Damien Pô, cité.5. François Bayrou, dans l’esprit de Courson, son porte-parole budgétaire, est le « seul à dire
la vérité en matière budgétaire » et à en « tirer les conséquences dans ses propositions ».
428
Benjamin Lemoine
« présentisme » 1 : on ne peut pas juger du bien fondé pour le futur des finances publiqueset de l’économie française exclusivement à l’aune des coûts du présent. Ainsi, selon lesdétracteurs du chiffrage, celui-ci coincerait le politique en l’enfermant dans le présent.En réaffirmant l’économie comme « une science morale et pas tout à fait une scienceexacte » 2, Timbeau oppose sa définition du politique comme domaine de choix dans un« univers incertain », horizon où les « choix sont faits collectivement », à la façon d’unpari. L’expert se contenterait de présenter au politique les choix collectifs possibles, lesgrandes alternatives. L’évaluation de l’OFCE se veut morale et déterminée par un cadreexplicite d’hypothèses. Selon les experts de l’observatoire, l’Ide aurait imposé aux can-didats un modèle normatif implicite. Dans cette redéfinition du politique, le chiffragen’est qu’un problème d’allocations de ressources (des moyens à mobiliser pour mettreen œuvre une mesure) qui appartient au domaine de la technique, et non des choix envaleur 3. Marginalisés sur la dette publique en amont des débats présidentiels, puis aumoment de la focalisation médiatique et politique sur le chiffrage budgétaire des pro-grammes en début de campagne, ces experts ont joué une carte de visibilité politique,quitte à subir des critiques parmi les économistes. La prise de parole publique de l’OFCEsur le chiffrage intervient au moment où s’ouvre une fenêtre d’opportunité scientifiqueet politique : c’est-à-dire une fois que le chiffrage non partisan ne parvient plus à s’arti-culer aux intérêts de Royal et de Sarkozy, qui de fait le rejettent. C’est l’occasion pourl’OFCE de revenir sur les conventions sur la dette publique, sur les questions ayant traità l’investissement et à la dépense publique, cristallisées autour d’un bloc consensuel, etde faire valoir, sur ces sujets, son point de vue propre et alternatif. En situation defermeture des possibles sur la dette publique, lorsqu’un consensus s’est imposé parmi lescandidats, le manifeste anti-chiffrage se présente comme une relance de la controversesur les finances publiques et le souci « envahissant » du chiffrage.
**Au final, le chiffrage des propositions de campagne apparaît comme une obli-
gation souple, un devoir avec lequel le professionnel de la politique s’arrange, demanière plus ou moins aisée, selon l’état de la compétition et la solidité du consensussur les finances publiques. Au moment où le candidat souhaite donner la preuve deson « sérieux », le dispositif du chiffrage de l’Ide constitue une carte tactique inté-ressante à jouer. Mais quand la promesse d’élaboration d’un projet de société (d’une« rupture », ou d’un « ordre juste ») se fait sentir de façon pressante pour le politiqueet que le chiffrage est devenu plus contraignant qu’avantageux, la relativisation del’importance de celui-ci devient l’option tactique la plus adaptée. Les conventions surles finances publiques, qui découlent de la définition commune que reçoit le problèmede la dette pendant la campagne, ne sont structurantes que lorsque les candidats etleurs équipes estiment qu’il est trop coûteux de s’en éloigner.
En appliquant un traitement symétrique aux partis politiques concurrents (droite et
1. François Hartog, Régimes d’historicité, présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil,2003.
2. Entretien avec Xavier Timbeau, cité.3. Par exemple, au sujet des emplois-tremplins : « Ce qui intéresse l’électeur et le politique
c’est pas de savoir combien ça coûte quand on fait 500 000. C’est de savoir, est-ce que c’estintéressant d’en faire un, ou est-ce que c’est pas intéressant ? S’il est convaincu par les argumentsqui font que c’est intéressant et bien à ce moment-là, en faire 500 000, 1 million, un milliard. C’estun problème d’allocation de ressource, d’arbitrage. Mais bon, voilà ok, on va dégager les moyens... »(Entretien avec Xavier Timbeau, ibid.).
429
Chiffrer les programmes politiques
gauche), ce qui constitue un moyen de garantir son statut d’institut indépendant auprèsdes journalistes, le dispositif de l’Ide annule précisément ce qui pouvait intéresser lepolitique dans le chiffrage – à savoir la possibilité de se démarquer des autres candidats –et crée les conditions de son échec. La version non partisane de l’instrument, jouant lerôle d’arbitre, ne survit pas aux alliances conjoncturelles avec les journalistes et leséquipes des partis politiques, autant de transactions locales fortement soumises aux exi-gences de la compétition électorale. La mise en œuvre d’un chiffrage impartial, quis’imposerait de façon stabilisée et durable comme un référent incontournable et faible-ment discutable des arènes de confrontation politique (on pourrait dire, en jouant sur lesmots, un « chiffrage universel »), apparaît, dans le cas du dispositif porté par l’Institutde l’entreprise en 2007 1, comme un projet inaccessible 2.
Benjamin Lemoine est doctorant au Centre de sociologie de l’innovation (CSI-Écoledes Mines de Paris) depuis 2006. Sa thèse porte sur les états du problème public de la dettede l’État. Il étudie les liens entre l’expertise économique, les finances publiques et le métierpolitique qui font fluctuer selon les configurations historiques la mise en politique de la dettepublique. Plus généralement, il s’intéresse aux usages de la quantification et à la mobilisationde l’expertise économique dans la décision politique (CSI <[email protected]>).
RÉSUMÉ/ABSTRACT
CHIFFRER LES PROGRAMMES POLITIQUES LORS DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 2007.HEURTS ET MALHEURS D’UN INSTRUMENT
La controverse autour du chiffrage budgétaire des programmes politiques émerge à la suitedes tentatives de l’Institut de l’entreprise visant à installer un dispositif de calcul impartialet extérieur aux partis. Localement utilisé par les journalistes et provisoirement investi parles équipes de campagne, l’instrument de chiffrage tend à neutraliser ses résultats et estproche de jouer le rôle d’arbitre du débat public sur les questions économiques et budgétaires.Échappant en partie à la maîtrise tactique des candidats, la mesure des coûts d’un projet semue en contrainte plutôt qu’en une source de rendement pour le professionnel de la politique.Les alliances précaires nouées autour du chiffrage « non partisan », qui en faisaient sa forceobjective, s’effondrent quand l’impératif politique de l’emporter dans la campagne électoraledevient trop pressant.
1. L’impossibilité du chiffrage universel, qui échappe aux singularités, contraste avec le casdes Pays-Bas où toute campagne électorale – et ce fut le cas pour le scrutin législatif de novembre2006 – est précédée d’une évaluation chiffrée et précise par le Bureau central du Plan, une traditionlancée en 1986. L’an dernier, huit partis en lice ont ainsi demandé à cet organisme indépendantd’établir le coût des mesures qu’ils proposaient. « C’est un moyen, non partisan, de comparer lespropositions, de rendre compréhensibles les mesures avancées et d’offrir un service tant aux élec-teurs qu’aux partis », explique un porte-parole (« Aux Pays-Bas, on ne rigole pas avec les évalua-tions », Le Monde, 20/02/2007).
2. Cet article a bénéficié des lectures attentives et critiques de Michel Dobry, DominiqueLinhardt et Jean-Luc Parodi. Je les en remercie.
430
Benjamin Lemoine
POLITICAL PROGRAMS BUDGETARY COST ASSESSMENT. THE CASE OF THE 2007 PRESIDENTIALELECTION IN FRANCE
The debate around political program assessment arises in France with the attempts of theInstitut de l’entreprise to settle an impartial calculating device outside of the political parties.Occasionally used by journalists and temporary allowed by political parties, the instrumentof calculation is near to be neutral and to play the arbitrator role in public debate on bud-getary and economics matters. By escaping to politicians’ strategies, cost assessment is morea constraint than a political output. Precarious coalitions tied around impartial figuring, thatmade its objective strength, collapse when the necessity of election victory becomes too critical.
431
Chiffrer les programmes politiques