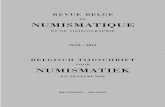Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps, Rapport de fouilles préventives
"Bois l'Abbé" (Eu, 76) - Campagne de fouilles 2010 - annexe 3 archéozoologie
-
Upload
u-picardie -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "Bois l'Abbé" (Eu, 76) - Campagne de fouilles 2010 - annexe 3 archéozoologie
AGGLOMÉRATION ANTIQUE D’EU “Bois l’Abbé”
(Seine-Maritime - 76 255 001 AH)
____________
FOUILLE PROGRAMMEE PLURIANNUELLE
Campagnes 2010-2012
Campagne de fouilles 2010
- Février 2011 -
Étienne MANTEL Service Régional de l’Archéologie de Haute-Normandie
Sophie DEVILLERS Service Municipal d’Archéologie de la Ville d’Eu
Stéphane DUBOIS Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
EU (76) “Bois l'Abbé” É. Mantel, S. Devillers, S. Dubois Rapport campagne de fouilles 2010
ANNEXE
3
ÉTUDE ARCHÉOZOOLOGIQUE DES OSSEMENTS DECOUVERTS DANS L’ESPACE II ENTRE 2005 ET 2009
Alice BOURGOIS Dans le cadre d’un Master I Recherche Histoire et archéologie des mondes anciens et médiévaux (Université de Picardie Jules Verne– Amiens)
Annexe 3 1
Étude archéozoologique des ossements découverts dans l’espace II – Basilique – entre 2005 et 2009
Alice BOURGOIS
Présentation de l'échantillon
L’échantillon étudié ici est composé des ossements animaux découverts dans l’espace II, entre 2005 et 2009. Il a fait l’objet d’une étude détaillée, dans le cadre d’un Master I (Bourgois 2010, UPJV, Amiens), dont le présent article est la synthèse. Il contient au total 4275 restes, 3968 si on exclue ceux retrouvés dans la terre végétale. Les restes de poissons, les mollusques terrestres et aquatiques, ainsi que les bois de cerfs ont été exclus de cette étude, ils seront étudiés ultérieurement. Le taux de détermination sur l’ensemble de l’échantillon est de 68,7%. La plupart de ces ossements ont pu être réparti selon trois ensembles chronologiques1 : 1058 restes
1 Phases de la chronologie proposées par É. Mantel et S. Dubois en 2009.
appartiennent à la phase 2, 774 à la phase 6 et 2078 à la phase 7. Seule une trentaine de restes n’a pas pu être intégré à la chronologie actuelle.
espèces NR2 %NR PR3 %PR
boeuf 120 17,9 1697 26,5
porc 450 67,1 3992 62,4
caprinés 71 10,6 504 7,9
cheval 2 0,3 140 2,2
canard sp.4 2 0,3 4 0,1
cerf 2 0,3 30 0,5
choucas 1 0,1 0 0
coq 18 2,7 22 0,3
lièvre 2 0,3 6 0,1
oie 2 0,3 6 0,1
pigeon sp. 1 0,1 0 0
déterminés 671 63,4 6401 91,0
indéterminés 387 36,6 632 9,0
TOTAL 1058 100,0 7033 100,0
2 NR : nombre de restes. 3 PR : poids des restes en grammes. 4 sp. : species (différentes espèces).
Annexe 3 2
Distribution des restes dans l’aire de dépôts
rituels (PHASE 2).
espèces NR %NR PR %PR
boeuf 79 13,9 1083 22,5
porc 391 68,7 3048 63,5
caprinés 73 12,8 547 11,4
cheval 1 0,2 60 1,3
chien 1 0,2 0 0
canard sp. 2 0,4 2 0
coq 15 2,6 17 0,4
grue 1 0,2 4 0,1
lièvre 2 0,4 3 0,1
pigeon sp. 2 0,4 0 0
sanglier 2 0,4 40 0,8
déterminés 569 73,5 4804 94,2
indéterminés 205 26,5 298 5,8
TOTAL 774 100 5102 100
Distribution des restes dans les niveaux de
construction de la basilique (PHASE 6).
espèce NR %NR PR %PR
boeuf 258 18,1 4754 28,7
porc 940 66,0 9499 57,4
caprinés 116 8,1 786 4,8
cheval 10 0,7 538 3,3
chien 6 0,4 47 0,3
batracien 3 0,2 0 0
canard sp. 5 0,4 7 0
castor 1 0,1 2 0
cerf 8 0,6 482 2,9
chevreuil 1 0,1 10 0,1
choucas 3 0,2 0 0
chouette sp. 4 0,3 4 0
coq 28 2,0 32 0,2
grive, merle 1 0,1 0 0
lièvre 6 0,4 16 0,1
oie 4 0,3 6 0
ours 2 0,1 35 0,2
pigeon sp. 20 1,4 2 0
rat noir 1 0,1 0 0
sanglier 8 0,6 344 2,1
déterminés 1425 68,6 16564 90,9
indéterminés 653 31,4 1658 9,1
TOTAL 2078 100 18222 100
Distribution des restes dans les niveaux de
destruction - récupération des matériaux
(PHASE 7).
Annexe 3 3
0
10
20
30
40
50
60
70
porc bœuf caprinés cheval chien oie/coq volailletotale
Répartition des animaux domestiques sur l’ensemble des couches stratigraphiques (terre végétale exclue).
Les animaux de l'espace II Malgré un spectre faunique assez large (21 espèces différentes), c’est la triade domestique porc/bœuf/caprinés5 qui domine dans toutes les phases. Le porc occupe une majorité écrasante ; dans certaines US, les proportions de porcs atteignent les 70%. Vient ensuite le bœuf qui représente entre 14 et 22% des restes selon les couches, puis en troisième position les moutons et les chèvres (environ 10% des restes). Le quatrième animal le plus fréquemment rencontré est le coq. Il faut néanmoins signaler que l’écart entre les NR de bœufs et de caprinés peut être le fruit d’une conservation différentielle, les os
5 Ce terme englobe les moutons et les chèvres. La majorité des ossements retrouvés proviennent probablement de moutons ; néanmoins dans cet échantillon, quatre restes ont pu être attribué avec certitude à une chèvre (Bourgois 2010). Les deux espèces sont donc présentes sur le site.
de moutons étant plus fragiles que ceux de bœufs ou de porcs (Bourgois 2010).
Malgré la fragmentation, l’aspect général des os de bœufs et de porcs laisse penser qu’il s’agit plutôt d’animaux de grande stature et non des espèces indigènes plus petites, ces dernières ayant été remplacées à la fin de la période de La Tène par de gros animaux importés (Lepetz 1996).
Une grande partie des animaux domestiques semble avoir été abattue jeune6. Comme c’est fréquemment le cas, la plupart des porcs sont abattus juste après avoir atteint leur maturité 6 Deux méthodes ont été utilisées pour déterminer les âges d'abattage : l'observation des épiphysations et les âges dentaires (résultats exposés ici). Les résultats obtenus avec les deux techniques sont similaires (Bourgois 2010).
Annexe 3 4
pondérale (entre 1,5 et 2,5 ans). Très peu de restes d’individus séniles ont été retrouvés, en revanche les restes de porcelets sont beaucoup plus fréquents. Sept restes de fœtus de porcs ont également été découverts (Bourgois 2010), ce qui pourrait indiquer que des femelles pleines ont été abattues. Pour les caprinés, la répartition est plus singulière ; le nombre d’agneaux tués est assez élevé, les autres caprinés sont eux largement adultes (3 ans et plus). L’âge des bœufs n’a pas pu être estimé mais si l’on se fie à la taille et à l’aspect général des restes, il semblerait qu’ils soient abattus à l’âge adulte. On ne peut cependant pas savoir s’il s’agit plutôt de jeunes adultes ou d’individus d’âge avancé.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 à 1 an 1 à 1,5ans
1,5 à 2ans
2 à 3 ans 3 à 7 ans + de 7ans
Répartition des âges dentaires des porcs, évaluée
sur 26 mandibules.
0
2
4
6
8
10
12
0 - 1 an 1 - 2 ans 2 - 4 ans 4 - 6 ans + de 6 ans
Répartition des âges dentaires des caprinés, évaluée
sur 24 mandibules.
Une estimation du sex-ratio a été possible pour les porcs. Les mâles sont toujours majoritaires : selon la phase chronologique, la fréquence oscille entre deux tiers et trois quarts de mâles. Pour les gallinacés, mâles et femelles sont présents dans l'espace II mais le nombre limité de restes ne permet pas de faire une estimation du sex-ratio (Bourgois 2010). Une pathologie particulière a été observée sur deux tarsométatarses, il s’agit probablement d’une conséquence de la castration des mâles pour obtenir des chapons (Lepetz 1996).
Deux tarsométatarses de coqs présentant une
malformation de l’ergot, découverts dans
les US 2 2 01 (phase 7) et 2 2 23 (phase 2).
Annexe 3 5
Un contexte rituel
Les parties anatomiques les plus fréquemment rencontrées chez les trois espèces de la triade domestique correspondent aux morceaux les plus riches en viande voire les plus « luxueux » : les épaules et les cuisses pour les caprinés et les porcs, les côtes chez le bœuf, etc. De très nombreuses traces de découpes attestent du prélèvement de la viande.
La distribution des parties anatomiques chez ces trois espèces ressemble à celle de nombreux autres sanctuaires du Nord de la France : Ribemont sur Ancre (80), « La Bauve » à Meaux (77), Estrées-Saint-Denis (60) ou bien encore "Digeon" à Morvilers-Saint-Saturnin (80) (respectivement : Fercoq-Leslay, Lepetz 2008 ; Lepetz 1998 ; Lepetz 2002 et Méniel 1986). Cette répartition, couplée à l'aspect détritique des restes, rappelle les déchets culinaires que l'on trouve à la fois dans les habitats et les sanctuaires de la même période (Lepetz, Van Andringa 2008). Il pourrait bien s'agir de restes de repas sacrés (banquets), malheureusement on ne peut pas l’affirmer avec certitude, même si pour les niveaux de « terre noire », le contexte rituel est confirmé. Ours et castor
Le dernier élément remarquable dans cet échantillon est la découverte de deux métapodes d'ours et d'une incisive de castor dans les niveaux de destruction (phase 7). Ces deux espèces sont suffisamment rares dans les sites gallo-romains du Nord de la
France pour que l'on souligne leur présence. Pour le castor, il est possible qu'il s'agisse d'un élément intrusif, puisque l'animal se trouvait à l'état sauvage dans toute la Gaule, à proximité des fleuves et rivières (Lepetz 1998). Les dents de castor pouvaient être portées en pendentif, comme celles de sanglier ou de loups (Barge 1982). L'ours par contre n'existe plus à l'état sauvage dans le Nord de la France à l'époque romaine. La présence de ces deux métapodes ne peut donc être le fruit du hasard. Ils proviennent peut être d'une peau d'ours amenée au "Bois l'Abbé" par un voyageur ou un soldat de l'armée romaine7. On peut également envisager la possibilité que l'animal ait été amené vivant sur le site. Il arrive parfois que des restes d'ours soient retrouvés à l'intérieur ou à proximité d'un amphithéâtre mais ce type de découverte reste rare (Lepetz 1996).
Métacarpe V d'ours présentant une pathologie au
niveau de la diaphyse.
7 La peau d'une bête sauvage, telle que le lion, le loup ou l'ours, fait partie de la parure militaire d'un signifer ou d’un aquilifer.
Annexe 3 6
Il est regrettable que ces trois restes proviennent des niveaux remaniés de la phase 7, ce qui rend impossible une interprétation plus poussée.
Conclusion La stabilité des proportions des différents animaux au fil du temps n'est pas forcément significative, dans la mesure où les niveaux des phases 6 et 7 ne sont composés que de remblais. On ne peut toutefois pas totalement écarter l'hypothèse que les pratiques alimentaires et rituelles n'aient pas beaucoup évolué au cours des siècles. Il est intéressant de signaler que dans les US de la phase 7, les proportions d'animaux sauvages sont légèrement plus élevées que dans les niveaux antérieurs. On y trouve également un certain nombre de rejets de tabletterie : des éclats d'os longs de chevaux et des fragments de bois de cerf (portant parfois des marques de sciage).
Les résultats obtenus avec ce lot d’ossements sont assez « classiques », en particulier pour ceux de la « terre noire » ; ils rappellent ceux des autres sanctuaires gallo-romains de la région. Le problème majeur de cet échantillon reste le remaniement des U.S. supérieures, qui fausse probablement une partie de ces résultats.
L'étude des restes découverts dans l'espace II lors de la campagne de fouilles de 2010 (et ceux qui seront mis au jour durant la campagne de 2011) apporteront sans doute de nouveaux éléments qui viendront compléter cette première étude de la faune du site. Il faudra également s'atteler à étudier d'autres zones, en s'attardant d'avantage sur les niveaux de « terres noires », plus riches, plus fiables et directement liés à l'activité cultuelle, ainsi que sur les dépôts particuliers (par exemple : 2 6bis 10, 2 23 10, 2 8 02, 2 44 04, etc.).









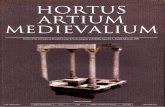



![Campagne e agricoltura attraverso il «Magazzino toscano» (1770-1782) [RSA 2010-2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318fbd765e4a6af370f9947/campagne-e-agricoltura-attraverso-il-magazzino-toscano-1770-1782-rsa-2010-2.jpg)