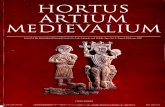« Avènement du Twiléspectateur et hashtags contestataires, faits marquants de la campagne sur les...
Transcript of « Avènement du Twiléspectateur et hashtags contestataires, faits marquants de la campagne sur les...
1
Avènement du Twiléspectateur et hashtags contestataires,
faits marquants de la campagne 2012 sur les réseaux socionumériques
Arnaud Mercier
Professeur en Information-communication,
Université de Lorraine (CREM), à Metz
Introduction
Dès 2008, il est apparu que la campagne de Barack Obama avait été boostée par son
engagement massif sur de multiples réseaux sociaux (y compris ceux plus restreints à visée
communautariste). Il faut toutefois rester prudent quant aux extrapolations aussi enthousiastes
qu’abusives. Même aux États-Unis, en 2008, il ne faut pas surestimer le poids que les réseaux
sociaux avaient (pour le moment ?) sur le suivi de la campagne par les citoyens. Et ce dans
toutes les catégories d’âge, alors même que la variable générationnelle a une influence
évidente sur la hiérarchie des sources d’informations entre citoyens jeunes et plus âgés.
18-21 ans 22-35 ans 36-55 ans > 56 ans
Internet Internet Télé Télé
Télé Télé Journaux Journaux
Journaux Journaux Internet Radio
You Tube You Tube Radio Magazines
Réseaux sociaux Radio Magazines Internet
Magazines Magazines You Tube Livres
Radio Réseaux sociaux Livres You Tube
Blogs Blogs Blogs Blogs
Livres Livres Réseaux sociaux Réseaux sociaux
Sources d’information politique des électeurs américains classées par ordre de consommation1
Ceci étant, sa présence sur les réseaux sociaux pour faire connaître son activité de campagne
et pour encourager ses supporters à se mobiliser a forcément contribué, pour partie, à la
victoire d’Obama. D’autant qu’en face, John McCain a très peu et mal utilisé ces nouveaux
1 Paul Haridakis, Gary Hanson, « Comparing You Tube, social networking and other media use among
younger and older voters », in J. A. Hendricks, L. Lee Kaid (eds), Techno politics in presidential
campaigning, New York, Routledge, 2011, p.75.
2
moyens de communication. Succès qu’Obama a su continuer à faire fructifier en 2012 pour sa
réélection, jusqu’à l’apothéose de son annonce de victoire sur Facebook et Twitter : « Four
more years », avec une photo du couple présidentiel, retwittée plus de 535 000 fois (record
absolu pour Twitter), ayant atteint le record absolu de plus de 2,1 millions de Like sur
Facebook et 180 000 partages. Dans sa note en ligne, de novembre 2012, sur le bilan de la
campagne aux États-Unis (« Barack Obama a gagné la bataille sur les médias sociaux,
aussi ! ») TNS Sofrès souligne le maintien de grandes disparités entre les deux candidats dans
leur usage des réseaux sociaux. Les disparités furent en effet spectaculaires, l’écart dans le
nombre d’abonnés se comptant en dizaines de millions, le nombre de messages postés sur
Twitter variant de 1 à 6, et, fait incroyable, le nombre de comptes suivis par le candidat
républicain est inférieur à 300 personnes, là où Barack Obama en suivait plus de 670.000 ! La
clé de répartition en pourcentage, entre chaque candidat permet de prendre conscience de
l’incroyable supériorité d’Obama dans sa stratégie d’usage des réseaux sociaux.
Répartition en %
Barack Obama Mitt Romney Obama Romney
Nombre de "likes" sur la page officielle Facebook
> 32 millions > 12 millions 73% 27%
Nombre de followers sur le compte Twitter du candidat
> 22 millions 1,8 million 92,50% 7,50%
Nombre de comptes Twitter suivis par le candidat
670.000 274 99,96% 0,04%
Nombre de tweets émis 7929 1350 85,50% 14,50%
Fort de ce succès et de l’usage bien établi que ce qui se passe aux Etats-Unis arrive tôt ou tard
chez nous, de nombreux commentateurs avaient prédit que les réseaux sociaux joueraient un
rôle majeur durant la campagne de 2012. D’ailleurs en Espagne, un an plus tôt, Twitter avait
été beaucoup investi politiquement. Ainsi, du 10 septembre au 20 novembre 2011, 2.875.000
tweets publiés contenaient au moins le nom d’un des deux principaux candidats ou partis,
pour 377.000 usagers Twitter différents2. Les usages attendus en France étaient donc d’avoir
un rôle dans la mobilisation des militants et sympathisants (qui deviendraient des relais
précieux de la parole du candidat via leurs followers) ; un rôle de dissémination de la parole
du candidat à destination du grand public sans passer par les fourches caudines des
journalistes ; un rôle de lice électorale, où une partie des joutes verbales s’y dérouleraient ; et
d’être un nouveau lieu d’interactions entre candidats et journalistes. Si toutes ces réalités
peuvent avoir été identifiées, force est de constater que la campagne électorale des principaux
candidats de la présidentielle 2012 ne s’est pas déroulée d’abord, prioritairement, 2 Pablo Barbera, « A New Measure of Party Identification in Twitter. Evidence from Spain », Paper for
the 2nd EPSA Conference, June 2012.
[En ligne : https://files.nyu.edu/pba220/public/barbera_epsa2012.pdf]
3
massivement, sur les réseaux sociaux. Il n’y a presque pas eu de tweet-interview (à
l’exception de F. Bayrou au moment de son entrée en campagne), peu de « tweet clash »
relayés ensuite (comme cela fut le cas avant entre le ministre E. Besson et la leader des Verts
C. Duflo lui reprochant de « faire le kéké sur Twitter »), à l’exception de la façon dont le
compte Twitter de Jean-Luc Mélenchon est allé porter la contestation, notamment contre des
journalistes (on sait depuis que c’était un collaborateur, dans une assez grande autonomie, qui
s’y livrait : « J’ai pu manipuler de façon autonome la parole de Jean-Luc Mélenchon. C’était
grisant. »3). La campagne n’a pas non plus porté au sommet de la médiatisation des tweets,
posts ou messages assassins issus d’un compte de candidat ou de ses proches, à l’instar de ce
qui est arrivé peu après pour Valérie « Tweetweiler », première dame de France qui a eu bien
du mal à se glisser dans le moule, pour s’éviter le ridicule d’étaler sur la toile publique
(comme on disait naguère la place publique) sa jalousie et les confusions qui en résultent en
termes de soutiens politiques. L’équipe du LabEurope1 prouve pourtant depuis lors, que
Twitter est une mine où elle sait fouiller chaque jour pour extraire de leur gangue et de leur
semi-clandestinité (un petit réseau de followers) quelques « pépites » propres à justifier
d’écrire un article. Le tout avec l’espoir d’alimenter quelques polémiques, de faire le buzz, par
la simple publicité ainsi donnée à des messages que leurs auteurs politiques croyaient pouvoir
cantonner à une diffusion restreinte.
Les Français ont, eux, été actifs sur les réseaux sociaux, et singulièrement sur Twitter, durant
cette campagne, et de plus en plus, à l’heure où l’échéance finale approchait, comme le
montrent les données de l’Institut Netscope.
Le « Barotweet » LH2, Nouvel Observateur, donne davantage de détails et prouve que
l’évocation des candidats sur le réseau Twitter a non seulement été un phénomène de masse,
mais que la hiérarchie des candidats en termes de notoriété et d’intention de vote s’est
3 Mathieu Deslandes, « L’homme qui « tweetait » pour Mélenchon », Rue89, 25 juin 2012. Cela lui a
d’ailleurs valu d’être publiquement désavoué par J.L. Mélenchon le 7 janvier 2013 en direct sur le
plateau de Mots croisés à propos d’un tweet appelant à le regarder, lui, le représentant de « la vraie
gauche » : « C'est pas moi qui suis derrière le compte tweet. Y'a pas la fausse gauche et la vraie
gauche. C'est une belle bêtise ! ».
4
retrouvée dans le poids relatif de chacun sur le réseau. Notons toutefois que Marine Le Pen est
bien en retrait par rapport aux autres candidats du top five.
Dans ce contexte global, deux phénomènes nous apparaissent marquants sur Twitter. Il s’agit
de la constitution de communautés politiques provisoires et actives, via l’usage d’un hashtag
rassembleur d’individus épars, et le renforcement d’une parole contestataire qui trouve dans
les réseaux sociaux les moyens de se diffuser et d’acquérir une visibilité, en se greffant à ce
qui reste le plus pourvoyeur d’audience et de notoriété : les émissions télévisées. On peut dès
lors considérer que le phénomène le plus notable de cette campagne sur les réseaux sociaux
fut l’apparition de téléspectateurs actifs, qui commentent en direct un programme télé et la
prestation des candidats ou qui suivent ces commentaires sur leur smartphone, tablette ou
ordinateur. Un tel renouvellement de l’expérience téléspectatorielle justifie de proposer une
nouvelle dénomination, combinant une double écoute (l’émission de télévision + le fil
Twitter) qui enrichit la compréhension ou la critique des propos politiques tenus sur un
plateau et qui donne tout son sens à l’idée d’écoute partagée entre plusieurs téléspectateurs.
Nous appelons donc ces citoyens qui, en direct, commentent et/ou suivent les commentaires
sur Twitter d’une prestation politique télévisée, des twiléspectateurs. Une partie non
négligeable de ceux-ci font preuve d’un esprit critique ou activiste, tant vis-à-vis des
candidats que des journalistes.
Nous allons donc essayer maintenant de cerner les caractéristiques de cette parole
contestataire et ses effets induits sur la réception du discours politique et médiatique, via
l’émergence de ces communautés temporaires unies autour d’un mot-clé et via l’avènement
des twiléspectateurs. Mais avant, nous reviendrons brièvement sur les usages électoraux des
réseaux sociaux par les équipes de campagne.
1° Candidats sur les réseaux sociaux : une présence mais pas une priorité
Les candidats ont certes investi ce terrain, ne serait-ce que par un esprit d’émulation et pour
ne pas paraître « ringards », en retard d’un moyen d’expression. On peut d’ailleurs repérer à
cet égard, l’ouverture de comptes au nom des candidats sur des réseaux encore assez
confidentiels en France, comme Instagram pour le partage de photos, dont l’observation
prouve que ni les équipes de campagne ni les sympathisants n’ont su qu’en faire au juste. Les
principaux candidats ont donc beaucoup investi Internet, avec des budgets d’environ 2
5
millions d’euros chacun pour F. Hollande et N. Sarkozy, qui ont servi à créer des sites, ouvrir
des comptes sur les réseaux sociaux (timeline Facebook de N. Sarkozy ; comptes TumblR,
Instagram ou Flick’r), développer des outils de diffusion (soundcloud radioHollande, chaîne
Youtube), avec des usages inédits (la websérie de J.-L. Mélenchon pour relater ses
déplacements sur le terrain ; les vidéos LOLcat du site d’Eva Joly pour inciter les jeunes à
aller s’inscrire sur les listes électorales ; les déplacements de campagne de N. Sarkozy
annoncés et à suivre sur ses comptes Foursquare ou Facebook Places…). Ces outils
numériques furent souvent de niveau très professionnel dans leur design et leur capacité
d’usage. On connait aussi l’importance qui fut donnée aux cellules de veille sur Internet et
aux équipes de riposte pour occuper le terrain des forums et les réseaux afin d’aller porter la
bonne parole citoyenne ou de contester les prises de positions critiques de son camp. Les
concepteurs de ces campagnes ont même valorisé ces supports numériques. C’est le cas lors
de l’interview pour lesinrocks.com de Nicolas Princen, coresponsable de la campagne
numérique de N. Sarkozy, le 20 avril :
« L’objectif de notre campagne sur internet en 2012 n’est pas celui de 2007. Ce n’est
pas uniquement animer sa propre communauté de supporters, c’est aller chercher de
nouveaux soutiens, trouver les moyens de les convaincre. Il y a donc deux campagnes
en une : celle d’internet comme média avec lequel on communique – pour expliquer le
bilan, le projet, raconter la campagne et porter notre message –, et celle du numérique
comme outil d’organisation, pour mobiliser et moderniser tous les éléments de la
campagne – faciliter l’organisation des meetings, rassembler plus de monde… –, en se
fixant l’objectif de parler à des personnes qui ne viendraient pas d’elles-mêmes vers
nous. Facebook est donc déterminant ».
L’investissement stratégique de l’équipe Sarkozy sur Facebook s’est traduit dans les faits. N.
Sarkozy est le seul à avoir pleinement utilisé le potentiel du nouveau dispositif de Timeline
créé par Facebook à l’époque, avec un mur faisant défiler le récit en textes et images de toute
sa vie depuis son enfance. De tous les candidats, il est celui qui a connu le plus grand succès,
au point de rassembler à lui seul les deux tiers des abonnés Facebook de tous les candidats, F.
Hollande et J.L. Mélenchon en réunissant chacun presque 10%, seulement (décompte au 20
avril 2012).
Répartition des abonnés Facebook des 9 candidats, en pourcentage.
N. Sarkozy F. Hollande J.L Mélenchon M. Le Pen F. Bayrou E. Joly
6
Pour autant, les candidats ont massivement misé sur les grands classiques de la
communication politique : meetings (notamment en plein air), retour du porte-à-porte pour le
PS, émissions politiques télé & radio, interviews presse. Il suffit de se souvenir du marathon
médiatique de l’entre-deux tours, de ce que le journaliste bloggeur Erwan Gaucher appela
« l’incroyable sprint médiatique final » :
Le marathon médiatique de l’entre-deux-tours de N. Sarkozy
24 avril Interview « Les 4 vérités », France 2
25 avril Invité la matinale de France info
Plateau JT de 20h, TF1
26 avril
Invité la matinale de France Inter
Invité « Des Paroles et des Actes », France 2
27 avril
Invité la matinale de RTL
Interview avec J. Vendroux sur le sport, France Info
Interview pour les titres de la presse quotidienne
régionale. (Au moins 11 titres en ont fait leur
« une »)
28 avril Interview à L'Equipe
Interview à Paris Turf
29 avril
Interview au Journal du dimanche
Invité de « Dimanche + », Canal +
Invité de Radio J
Invité de Stade 2, France 2
Invité JT de 20h, France 2
La campagne ne s’est pas d’abord faite sur le web. Dans son instructif bilan de l’élection
présidentielle sur Internet, l’institut Netscope pointe que ce qui se passe sur le web n’a pas
encore assez de force pour devenir le faiseur d’agenda, pour dicter son tempo à la campagne
électorale :
« Ce sont encore les grands médias classiques – au premier rang desquels les
principales chaînes de télévision et dans une moindre mesure les grandes radios
périphériques et les principaux organes de presses – qui font l’agenda politique et
imposent les sujets d’actualité. [..] Les réseaux sociaux et les blogs n’ont été à
l’origine d’aucun buzz de grande ampleur au cours de cette campagne. Ils n’ont
fait que réagir à des signaux issus des médias traditionnels, contribuant ainsi
parfois à les amplifier et à les entretenir. Un réseau social tel que Twitter est ainsi
7
particulièrement réactif au passage des candidats en prime time sur TF1 ou
France 2. C’est dans ce type de situation que les « grands candidats » enregistrent
leurs pics d’audience sur le réseau social et que les « petits candidats » génèrent
des volumes de messages sans commune mesure avec leurs ratios habituels »4.
Si donc on a pu croire, après 2008, à l’importation du modèle américain en France pour 2012,
la simple comparaison des chiffres que nous proposons ici, démontre ô combien cruellement,
que les présidentiables français sont loin de rivaliser.
Abonnés le jour
du scrutin B. Obama N. Sarkozy F. Hollande
Facebook 32 425 821 596 300 82 000
Twitter 22 364 527 150 700 220 000
Instagram 1 656 864 13 195 165
Pour résumer, le paysage des réseaux sociaux de la campagne française de 2012 fut peu
engageant : peu ou pas de dérapages verbaux sur les comptes officiels ; peu ou pas
d’invectives entre candidats ; peu ou pas d’interactions directes entre journalistes et hommes
politiques ; peu ou pas de débats participatifs pour élaborer le programme ou des
argumentaires de campagne ; mais beaucoup de placards publicitaires annonçant le
programme de campagne de chaque candidat, donnant des liens vers des archives où retrouver
les interviews médias des candidats, exposant des verbatim savamment triés des dernières
déclarations de campagne lors d’un meeting ou d’une émission. Tout sembla se passer comme
si les équipes de campagne avaient aseptisé ces dispositifs sociotechniques, refusant ou étant
incapables de s’emparer de ces outils et des potentialités qui en font leur spécificité : possible
renouvellement de la prise de parole publique ; échanges collaboratifs et partage généralisé
sur un pied d’égalité. Côté médias, il y a eu beaucoup de retranscriptions factuelles, de
verbatim (propos tenus sur les plateaux ou dans les meetings) par les journalistes (mais aussi
les militants) afin de donner un écho supplémentaire à ce qui se passait en direct sur un autre
média et donc valoriser la rédaction et la marque. Et grâce aux données de l’institut Trendy
Buzz, qui calcule un indice d’unité de visibilité internet, au 5 mars 2012 :
4 Institut NETSCOPE - AMI Opinion Tracker, « Quelques enseignements de la campagne sur le web à
J -2 avant le 2nd tour ». [en ligne : http://netscope.fr/pdf/42.pdf]
8
on se rend bien compte que l’écrasante majorité des informations publiées sur les blogs et
réseaux sociaux provient d’autres usagers que les candidats et leurs soutiens institutionnels.
Et quand on cherche à trouver, vainement, des corrélations entre notoriété sur les réseaux
sociaux et évolution du vote, on se dit que les équipes de campagne ont peut-être eu raison de
ne pas surestimer cette nouvelle lice électorale. On peine en effet à trouver une corrélation
entre l’évolution de l’influence sur les réseaux sociaux et l’évolution des intentions de vote
dans les sondages. Le cas le plus emblématique est celui de Jean-Luc Mélenchon. Il a vu sur
le dernier mois de campagne s’accroître de + 46% ses fans et de +31% ses followers,
pourtant, après une hausse de 3 points des intentions de vote il a rebaissé de 3 points dans les
derniers jours.
Il faut dire que la notoriété sur Twitter n’est pas tout, encore faut-il qualifier cette audience et
comprendre comment on parle des uns et des autres, comment leur parole est relayée. Or,
Nicolas Sarkozy « a enregistré à lui seul entre le tiers et la moitié des tweets politiques chaque
9
jour. Cette forte exposition du candidat-président va de pair avec son très fort rejet sur la
Toile. Il suscite en temps normal entre 10 000 et 15 000 tweets négatifs par jour, soit 39% en
moyenne sur la période. À titre de comparaison, François Hollande n’en recueille quant à lui
qu’entre 3 000 et 5 000. Le buzz de Nicolas Sarkozy, bien que de grande ampleur est donc
loin de lui être favorable. Le Web, que ce soit le réseau social Twitter mais aussi la
blogosphère, aura ainsi été tout au long de la campagne, un espace de résonnance de toutes les
variantes de l’anti-sarkozysme » 5
comme le montre le tableau ci-dessous de Netscope.
L’exemple de Nicolas Sarkozy prouve que les propos qui s’échangent sur les réseaux sociaux
ont souvent à voir avec une parole contestataire, qui vient fragiliser les mécanismes bien
huilés de la communication politique et du jeu politico-médiatique.
2° Fédérer des « aclictivistes » via un hashtag
Aux États-Unis, où l’usage de ces réseaux est le plus développé, ceux-ci servent aux citoyens
d’outil d’affichage de ses convictions politiques et d’incitation à faire voter ses fréquentations,
conformément à une tradition politique bien établie. Ainsi, selon un sondage du Pew Internet
and American Life Project effectué début novembre 2012, 20% des électeurs inscrits
affirment avoir incité leurs proches et amis à voter en postant un message en ce sens sur leurs
comptes de réseau social et 25% affirment y avoir été incités par des proches. Et dans une
étude préalable6, le même institut montrait que 20% des utilisateurs de réseaux sociaux
avaient utilisé cet outil pour suivre un candidat, 34% pour afficher leurs convictions et
commentaires sur les sujets politiques, 35% pour encourager les gens à aller voter.
En France aussi, la prise de parole politique sur ces réseaux existe, mais elle prend assez
souvent une forme plus contestataire que loyaliste à l’égard d’un camp. L’institut d’études
Lightspeed Research avait interrogé au mois de mars 2012 plus de 1000 Français ayant
l’intention de voter pour l’élection présidentielle. Très peu de Français s’informent des
évolutions de la campagne grâce aux sites internet des partis politiques (12%) ou à leurs
5 INSTITUT NETSCOPE-AMI OPINION TRACKER, "Quelques enseignements de la campagne sur
le web à J -2 avant le 2nd tour". [en ligne : http://netscope.fr/pdf/42.pdf]
6 « Social Media and Political Engagement », 19 octobre 2012, [En ligne :
http://pewinternet.org/Reports/2012/Political-Engagement.aspx]
10
réseaux sociaux (entre 2 et 3%). Ils jugent ces sources peu fiables. Seuls 7% des sondés jugent
les sites internet des partis comme une source fiable et une proportion dérisoire d’électeurs
(2%) estiment que Facebook et Twitter sont les sources d’information les plus fiables. Ceci
explique qu’une infime minorité des sondés juge nécessaire d’afficher ses opinions sur ces
réseaux ou de s’abonner aux réseaux sociaux des candidats. On remarquera surtout la
proportion de 85% des sondés qui déclarent n’avoir fait aucune des activités en ligne testées.
Quand il s’agit de mesurer l’engagement politique sur les réseaux sociaux, on ne peut se
contenter d’une approche quantitative absolue. Ainsi, si sur Facebook, N. Sarkozy écrase la
concurrence, il faut aussi vérifier que ce public qu’il a su agréger depuis sa précédente
campagne et sous son quinquennat est disposé à se mobiliser, à devenir actif.
Fans Fans actifs
Taux
d'engagement
N. Sarkozy 594377 51076 8,60%
F. Hollande 79821 21471 26,90%
J.L Mélenchon 62260 38383 61,60%
M. Le Pen 51767 14048 27,10%
F. Bayrou 27745 6907 24,90%
E. Joly 19401 4056 20,90% Nombre de fans et de fans actifs fin mars 2012 (étude Publicis Consultant - Net Intelligenz, avril 2012
7)
Le nombre de fans actifs correspond au nombre de fans ayant publié un commentaire, un post
ou ayant partagé ou « liké » un post (ici entre le 1er février et le 31 mars 2012, ce qui n’est
donc qu’une exigence assez minimale) sur la page d’un candidat ou de son parti ou à partir de
cette page à destination de ses amis. En rapportant le nombre de fans actifs au nombre total de
fans, on obtient donc ce que nous proposons d’appeler un taux d’engagement Facebook. À
l’aune de ce critère, on constate dans le graphique ci-dessous que la hiérarchie s’inverse. N.
Sarkozy qui était en tête en valeur absolue, se retrouve dernier en pourcentage, au profit de
J.L. Mélenchon qui possède la communauté la plus active, la plus militante. M. Le Pen et F.
Hollande arrivent derrière. La chef du FN dans une logique de compensation relative (pas
beaucoup de fans, mais plus d’un quart est actif), F. Hollande dans une logique médiane, bien
à son image (un nombre moyen de fans et de fans actifs)
7 http://dl.dropbox.com/u/17447887/netintelligenz-facebook-election2012.pdf
11
Hiérarchie des comptes Facebook des principaux candidats entre février et mars 2012
On le voit, l’engagement Facebook reste encore peu pratiqué en France, mais le phénomène
s’est enclenché durant cette présidentielle, et on voit mal comment cet activisme politique par
simples clics n’irait pas en s’accroissant à l’avenir. Il en va de même pour la recherche
d’informations de campagne. Lorsque l’on demanda aux Français8, fin mars 2012, de citer les
deux premiers vecteurs d’information sur la campagne présidentielle, la télévision est restée
largement en tête, avec 74% devant Internet (40%) et la radio (34%). Questionnés sur leurs
pratiques politiques sur Internet, 36% des sondés vont au moins une fois par semaine ou tous
les jours rechercher des informations sur l’actualité politique, 20% affirment visionner des
vidéos humoristiques sur la politique, confirmant l’usage sarcastique de ce support, 11%
affirment transférer des informations sur l’actualité politique à leurs proches via le mail ou les
réseaux sociaux, 10% seulement visitent le site d’un parti ou d’une personnalité politique et
8% commentent l’actualité politique sur Facebook et/ou Twitter. Dans cette enquête, une
minorité (13%) peut être considérée comme très active politiquement puisqu’elle cumule au
moins trois des activités citées chaque semaine. Cette minorité active est dès lors mobilisée
sur les réseaux sociaux, qui apparaît comme le véhicule idéal de leur engagement numérique :
un tiers ont un compte Twitter, la moitié commente l’actualité sur ses réseaux sociaux, 55%
rediffuse de l’information politique sur ses réseaux.
Parmi les pionniers de l’engagement politique sur les réseaux sociaux, certains savent
s’organiser pour agir. Il se crée ainsi sur Twitter des communautés virtuelles reliées
provisoirement par un hashtag, véritable outil de coordination servant à construire un fil
conversationnel critique, sur un événement ou un thème précis. Ce mot-clé relie ensemble des
individus qui ne se connaissent pas, qui ne se suivent pas forcément les uns les autres. C’est la
8 « La webcampagne 2012 », sondage CSA pour l’Observatoire Orange – Terrafemina, réalisé fin mars
2012. Voir aussi les résultats de l’enquête Présidoscopie, notamment : Thierry Vedel, « Processus
d’information des électeurs et suivi de campagne : le paradoxe des campagnes électorales », in P.
Perrineau (Dir.), La Décision électorale en 2012, Paris, Armand Colin, pp. 59-68.
0123456
N. Sarkozy
F. Hollande
J.L Mélenchon
M. Le Pen
F. Bayrou
E. Joly
Hiérarchie Fans
Hiérarchie Fans actifs
Hiérarchie taux d'engagement Facebook
12
force de cet outil de coordination sociale que d’établir des ponts entre des gens qui s’ignorent.
« Chaque utilisateur participant à une conversation forgée par un hashtag possède le potentiel
d'agir comme un pont entre la communauté hashtag et son propre réseau de followers »9. Il
existe donc des situations sociales où le hashtag permet de construire ce que Bruns et Burgess
nomment « des publics ad hoc » que nous qualifierons plutôt ici de « communauté interactive
en ligne », donc formant une « communautés d’intérêts », au sens de Licklider et Taylor10
.
« Ces communautés se composeront de membres géographiquement séparés, parfois
regroupés en petites grappes et parfois travaillant seuls. Ils seront des communautés non de
lieu partagé, mais d'intérêt commun. (...) Tous vont être reliés entre eux par des canaux de
télécommunications. L'ensemble constituera un réseau labile de réseaux en constante
évolution, à la fois dans le contenu et la configuration ». Le hashtag agit alors comme un
« énoncé performatif » au sens d’Austin, puisqu’au-delà de la réalité que le mot-clé désigne, il
vise au même moment à agréger un public d’usagers de Twitter, à les construire en une
éphémère communauté d’intérêts numérique mais qui peut se révéler active le temps du débat
ainsi lancé. En ce sens, « le réseau Twitter est à la fois réel et imaginé. Il est réel parce que les
participants interagissent, en particulier entre pairs. Il est imaginé parce qu'ils ont un certain
sens de la communauté, de l'engagement interpersonnel »11
.
Twitter peut donc être approprié comme un outil de prise de parole dans un micro-espace
public afin d’y porter une voix contestataire. Twitter est utilisé par une frange très active de
citoyens mobilisés, pour créer et/ou diffuser : des propos militants de soutien ou de
dénonciation (souvent virulente) ; des interpellations à destination des politiques pour mettre
en évidence leurs contradictions ; des interpellations critiques sur le travail journalistique ; des
envois de questions aux rédactions ; des commentaires personnels décalés souvent avec mise
en dérision de la politique. On se propose de parler « d’aclictivisme », pour désigner ces types
d’activistes en ligne, qui en quelques mots, dessins, photomontages ou autres détournements
graphiques, diffusés sur leurs réseaux, aspirent par effet ricochet, à toucher des dizaines de
milliers de personnes qu’ils ne connaissent et à participer ainsi au combat d’influence
électorale.
Bien sûr, comme plusieurs formes d’activité politique en ligne, ces participants sont plus ou
moins investis et peuvent, pour certains, prêter le flanc à une critique émergente de
« slacktivism », mot-valise formé de slacker : fainéant, et activism pour activisme politique, et
qui désigne des formes d’engagement apparent en ligne qui n’auraient en fait que de peu
d’effet politique car peu impliquantes. Il est vrai que de programmer sur son fil Twitter un
mot-clé et recevoir ainsi tous les messages contenant ce hashtag n’a rien d’impliquant. Le fait
de soi-même envoyer des messages en sachant que tous ceux qui suivent ce hashtag pourront
9 Bruns, Axel, Burgess, Jean E., “The use of Twitter hashtags in the formation of ad hoc publics”, 6th
European Consortium for Political Research General Conference, 25-27 August 2011, University of
Iceland,Reykjavik. [En ligne : http://eprints.qut.edu.au/46515/] 10
J. C. R. Licklider, R. Taylor, « The Computer as a Communication Device », Science and
Technology, April 1968. 11
Anatoliy Gruzd, Barry Wellman, Yuri Takhteyev, "Imagining Twitter as an Imagined Community",
American Behavioral Scientist, 2011 55 (10), 1294-1318.
13
le lire (parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes) l’est déjà plus. Surtout si c’est pour
formuler des commentaires critiques, pour relayer des informations complémentaires à un
propos politique tenu en direct. Et bien sûr, des hacktivists peuvent librement se greffer à une
telle communauté virtuelle, pour y faire passer leurs messages engagés, contestataires voire
virulents. La dimension contestataire de Twitter est d’autant plus intéressante pour des
activistes que, comme le rappellent Bruns et Burgess, « la nature ascendante (« bottom-up »)
de Twitter comme espace de communication » se confirme par « l'incapacité des acteurs
institutionnels [« mainstream media organisations, politicians, industry, and other ‘official’
interests »] à canaliser efficacement ou à dominer la conversation ». Car même si des
journalistes, des hommes politiques, des chercheurs viennent se mêler au fil hashtag, ils
n’apparaissent que comme un énonciateur parmi d’autres, leurs messages ne s’insérant dans la
conversation qu’au nom du principe chronologique de la date d’envoi. Aucun marqueur pour
les différencier, les rendre plus visibles. Seul un succès dans le nombre des reprises (les
retweets) peut aider à les rendre pour finir un peu plus visibles en cas de recherche à
posteriori. A ce jeu, ce ne sont pas toujours ceux qui bénéficient à priori d’une parole
autorisée qui s’en sortent le mieux et sont les plus repris. Le hashtag se révèle un formidable
outil de désintermédiation et de nivellement des statuts pour la prise de parole publique.
L’abonné au mot-index, reçoit sans tri préalable, sans aucun principe de hiérarchisation, tous
les tweets émis. Que ces derniers soient le fruit de bloggeurs identifiés, de particuliers, de
parfaits inconnus anonymes s’exprimant sous avatar, ou de journalistes plus ou moins
identifiables, de rédactions identifiées, d’experts ou d’acteurs concernés. Le succès de certains
de ces mots-clés conduit en effet les internautes ayant une autorité sociale reconnue à
rejoindre ce flux. Et quand certains auteurs de tweets n’ont pas pensé à sigler leur message
avec un hashtag, il arrive fréquemment qu’un internaute ajoute le hashtag lors de son retweet,
l’insérant ainsi dans le flux global et balisé. Ajoutons que « le rôle des hashtags est [aussi]
d’exposer les usagers à des contenus qu’ils n’auraient sans doute pas choisi par avance »12
puisqu’on n’est jamais certain des opinions et intentions de tous les émetteurs utilisant un
hashtag donné.
Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer sur le réseau Twitter durant cette élection, nous
allons étudier le cas exemplaire du hashtag Radiolondres.
3° Le succès contestataire du #Radiolondres
Comme son nom l’indique, ce hashtag (symbolisé par le signe : #, sur les réseaux sociaux)
veut incarner un esprit de « résistance ». (cf. article qui décrit l’origine du terme). Une telle
démarche collective vise à faire vivre un idéal libertaire auquel est associé depuis l’origine le
web 2.0, avec une dimension de « médiactiviste » et « d’internet militant »13
.
12
M. D. Conover, J. Ratkiewicz, M. Francisco, B. Goncalves, A. Flammini, F. Menczer, « Political
Polarization on Twitter », conference paper for the Association for the Advancement of Artificial
Intelligence, 2011, p.7.
[En ligne : http://truthy.indiana.edu/site_media/pdfs/conover_icwsm2011_polarization.pdf] 13
Dominique Cardon, Fabien Granjon, Médiactivistes, Paris, Presses de Sciences-Po, 2010.
14
Par la magie de la démocratie basiste d’Internet, trois militants vont donner corps à un mot qui
va ensuite faire florès et devenir l’un des hashtags les plus populaires en France pendant toute
la séquence électorale, et va sans doute même rester pour les élections à venir. En 4 tweets
tout a été dit : l’un lance à son réseau l’idée de choisir un mot-clé. Un autre répond, un
troisième fait une contreproposition et le deuxième surenchérit sur le troisième, en proposant
une formule inspirée par lui.
Quand on cherche les traces de ces internautes sur leur profil Twitter ou sur leur blog, aucun
ne fait mystère de son militantisme à gauche. Le premier, Marc Vasseur, sur son profil
Twitter se présente comme « ancien élu socialiste » dans le Nord et son avatar est la très
reconnaissable photo de Pierre Mendès-France. Le premier à lui répondre, Guy Alain
Bembelly ne fait pas mystère non plus de ses attaches à gauche sur son blog politique.
D’ailleurs sa suggestion de hashtag « c’est fait » sonnait comme un soulagement. Et le 17 juin
il salue sur son blog la victoire de la gauche aux législatives par un titre similaire : « ça c’est
fait ». Son avatar (le chevalier de Saint George, esclave affranchi de Guadeloupe, musicien,
homme d’armes proche des milieux abolitionnistes durant la Révolution) ne laisse là aussi
aucun doute. Et le jeune animateur culturel Rémi Sabau se dit lui aussi explicitement
« socialiste » sur son profil Twitter. Marc Vasseur a 3600 followers, alors que les deux autres
en ont moins de 1500. Ils ne sont donc même pas des prescripteurs d’opinion patentés sur
Twitter. Mais ce réseau social est ainsi fait que ces trois militants inconnus vont créer un mot
que les autres usagers vont s’employer à populariser, au point que les journalistes, politiques
et autres paroles légitimes à priori devront suivre et s’insérer dans le trafic généré par ce fil,
s’ils veulent être vus les jours de scrutin. Le 22 avril, ce hashtag a généré plus de 1800 tweets
par heure. Ce qui permet à Sabine Blanc, journaliste du site d’information activiste Owni.fr,
de se réjouir sur son fil Twitter : @sabineblanc On a dit que le numérique était absent de la
campagne… jusqu’à ce #Radiolondres qui fait exploser des règles obsolètes et absurdes.
D’autres bloggeurs militants vont ensuite entrer dans l’arène pour déterminer ce que l’on va
s’y dire et surtout comment on va faire preuve d’esprit de résistance, au sein de cette
communauté d’intérêts électorale. Il s’agit d’une part de braver les interdits pesants de la loi
électorale sur l’impossibilité de dévoiler - avant 20h et la fermeture de tous les bureaux de
vote - la moindre information disponible sur les résultats du scrutin ; l’autre objectif est de
15
célébrer la défaite attendue et espérée de Nicolas Sarkozy (sans doute plus d’ailleurs que la
victoire de François Hollande). Du coup, la régulation interne s’organise autour de débats sur
le choix de formules propres à être reconnues par les initiés de Twitter pour annoncer des
résultats tout en ne le disant pas explicitement.
Et dès le début, on constate que les énoncés se veulent humoristiques et même sarcastiques.
Christophe Grébert (le fameux bloggeur de Monputeaux.com, poursuivi en justice par son
édile) se mêle ainsi à la conversation entre gens de gauche pour dire que quel que soit le
« grand » candidat arrivé en tête, ce sera selon lui une catastrophe.
La motivation des twittos de se brancher sur ce hashtag reposa fortement sur l’idée de braver
un interdit, jugé, en plus, stupide et archaïque, puisque les sites de la presse francophone
limitrophe annonceront les premières estimations électorales une heure et demi avant la fin de
l’embargo. Et l’apport fut souvent contributif, puisque le hashtag a viré au concours de
blagues (plus ou moins potaches) ou de poésie (plus ou moins inspirée). Voici des extraits
significatifs de ce qui a pu circuler au premier ou au second tour :
16
Les médias d’information et journalistes professionnels se joignent au mouvement et font, peu
ou prou, œuvre de briseurs de loi. C’est singulièrement le cas des journalistes francophones
suisses et belges, qui ont communiqué les données chiffrées en leur possession dès le milieu
de l’après-midi, en établissant des liens avec leurs sites (qui seront d’ailleurs saturés face à
l’afflux de visiteurs RTBF, Le Soir, Le Temps, La Tribune de Genève & la RTS, pour
l’essentiel).
17
Des journalistes français se contentent de faire savoir qu’ils savent. Aux Inrocks, Pierre
Siankowski se contente d’un laconique « Bon j’ai les résultats c’est chaud ». On est loin du fil
RTBF info : #premiersrésultat sondages sortie des urnes : #Hollande serait en tête devant
#Sarkozy (avec un lien vers le site). D’autres journalistes français s’y essaient également mais
souvent de façon plus déguisée ou allusive.
@B_Roger_Petit Première estimation fiable : la tête d’Eric Brunet sur #Bfmtv, auteur
de Pourquoi Sarko va gagner
@Atlantico_fr Tiens, la police vient de fermer la place de la Bastille…
Ensuite, selon un effet boule de neige bien connu, le succès du mot-clé et la constitution d’une
communauté éphémère de plus en plus large, ont conduit les internautes à s’y fondre pour
observer, rire, s’informer. Comme il est d’usage, dès lors qu’une clé d’entrée auprès du public
est découverte, des passagers clandestins s’en emparent. Certains ont utilisé ce hashtag en le
détournant de son esprit pour en faire un support publicitaire pour ses analyses sur l’élection,
la politique en général. Assurés dès lors d’avoir une tribune populaire élargie, nombreux sont
les ralliés qui ont affiché des discours de soutien aux candidats ou de dénigrement d’autres.
C’est ainsi que l’UMP rejoint le fil hashtag initié par des militants de gauche.
L’engagement sur le #radiolondres a pu être vécu comme un acte citoyen, une façon de
revendiquer et de contribuer à faire sauter une digue devenue vermoulue et percée, celle de
l’interdiction d’évoquer les premières estimations avant 20h. Il s’est joué là une querelle des
Anciens et des Modernes, autour de l’idée qu’Internet faisait exploser les codes et règlements,
et que c’était fort bien ainsi. Sentiment partagé par des anonymes, des experts ou des
journalistes.
18
D’autres s’insèrent dans cette communauté interactive en ligne pour dénoncer la couverture
médiatique de l’événement, le rôle des journalistes en général. L’autre forme de contestation
est une dénonciation de l’absurdité de ce qui se passe à la télévision avec l’interdiction faite
aux journalistes de divulguer quoi que ce soit. Les propos dans cette optique sont de deux
ordres. C’est la revanche d’Internet, Twitter étant présenté comme le média d’avenir, celui
qui domine la vieille télévision, d’un coup ringardisée. Ou bien, c’est la dénonciation de
l’hypocrisie ou de la gêne des journalistes de télévision qui meublent l’antenne avec des
inepties ou qui font passer des messages subliminaux ou très implicites, cherchant à violer
l’embargo légal sans se faire prendre. De simples citoyens s’y emploient :
@Manny_Lectro Une horde de militant PS hurlent « On a gagné ! » Le journaliste dit
« L’excitation monte au fur et à mesure de l’attente ». LOL #Radiolondres
@Naivlys Il y a une certaine forme d’hypocrisie : on nous montre une Concorde vide
et une Bastille pleine. #Radiolondres #Onagagné
@oToulouse1 Regardez moi c connard de journalistes de la 2, ils ont el sourire
jusqu’aux oreilles. #Radiolondres
mais aussi des journalistes, critiques à l’égard de leurs confrères :
@CDestraque Ca me rappelle ma soirée municipale 2008 à la mairie de Metz
cachant une « surprise » à 19h30 avec des hurlements de joie derrière #ridicule
@MargauxBergey Pensées pour les confrères de télé qui doivent encore meubler
l’antenne pendant 45min alors qu’on connaît les résultats #Presidentielle
Surtout quand l’hypocrisie prend une tournure inédite, puisque l’AFP fait une dépêche sur les
estimations des instituts de sondage, mais demande à ses clients de ne pas en faire état en
nommant l’agence, et que d’autres médias du coup repoussent jusqu’aux limites le jeu de la
transgression. La pression mise par les usagers des réseaux sociaux est donc telle, que les
journalistes ont été amenés à transgresser eux aussi les règles, en essayant différentes
formules pour jouer avec les marges du tolérable, et ce durant les deux tours.
19
En même temps, les titres d’information qui avaient joué les bravaches, sont amenés à reculer,
face au rappel sévère du CSA à la loi et aux sanctions qui vont avec. Libération avait joué les
Matamore, annonçant à grand renfort de publicité que dès lors que les titres étrangers et les
internautes feraient circuler des données, il ferait de même. Finalement par un long message,
son directeur justifie une reculade complète :
« Nicolas Demorand, directeur de la rédaction de Libération, s’invite sur le live de Libé. Voici
son message :
“Nous vous avions donné rendez-vous à 18h30. (..) Nous devrions peut-être disposer d’ici 30
minutes environ des premières estimations que la loi nous interdit de publier. Le risque encouru
est au minimum de 375.000 euros pour une entreprise de presse, sans parler d’autres
conséquences économiques, réelles et sérieuses, qui fragiliseraient Libération. L’ensemble de
ces sommes nous semble disproportionné par rapport à l’intérêt d’une information rendue
publique à 20h. En vous donnant rendez-vous ce dimanche soir, nous souhaitions porter ce
débat sur la place publique. Et forcer les institutions à admettre leurs contradictions, au prix du
ridicule et de contorsions risibles. Au passage, se trouve engagé un vaste chantier qui incombe
aussi au législateur : repenser la structuration de ce qu’est l’espace public ; redéfinir ce qu’est
un média par opposition à une correspondance privée ; réfléchir au désormais large partage,
au-delà des seuls professionnels des médias, de la responsabilité de publier et de diffuser une
information”. »
Les commentaires acerbes n’ont pas manqué, notamment chez les confrères, comme celui du
Monde : @samuelLaurent Et voilà, le concours du « t’es pas cap » vient de se terminer.
Bravo la presse française, à dans 5 ans pour un nouveau psychodrame ds le vide. On retrouve
là un des usages de Twitter par les journalistes que nous avons mis en lumière14
, celui de
redresseur de torts au sein de la profession. Ils pointent les incohérences et donc les doutes
dont les informations issues de cette concurrence déloyale sont porteuses. Une polémique nait
ainsi sur l’existence ou pas de sondages sortie des urnes le jour du premier tour. Le blogueur
Erwan Gaucher recruté par France2 pour suivre la soirée sur les réseaux sociaux s’en fait
l’écho très vite : @egaucher Le débat commence, les estimations Ipsos données par @lesoir
ne sont pas celles qu’Ipsos donne ici… Sachant que les instituts de sondage eux-mêmes
communiquent sur Twitter pour nier toute participation à ce type d’enquête et donc se
désolidariser des chiffres qui traînent. Messages que nombre de twittos ont relayé sur le fil
#Radiolondres.
14
A. Mercier, « Twitter l’actualité : usages et réseautage chez les journalistes français », Recherches
en communication (Bruxelles), n°39 été 2013.
20
4° Affaiblir la persuasion politique par les commentaires collectifs : expérience de TV
sociale durant le débat de second tour
Durant les élections générales récentes de plusieurs pays occidentaux, on a pu observer avec
constance, que les pics de publications de messages sur les réseaux sociaux correspondaient
souvent aux émissions politiques mettant en jeu les principaux candidats, les réseaux sociaux
devenant en Australie15, aux Etats-Unis16 ou en Suède17 un outil approprié par des citoyens
intéressés par la politique pour commenter la parole politique ou suivre ces commentaires et
critiques en direct. La France a rejoint le mouvement en 2012, à l’occasion de la
présidentielle.
En effet, l’autre phénomène marquant de cette campagne sur les réseaux sociaux concerne la
formation de communautés d’intérêt numériques provisoires, le temps d’émissions politiques
avec les candidats. Les chaînes tendent à encourager leur audience à s’approprier les
programmes (surtout de divertissement) en les commentant sur les réseaux sociaux, via un
hashtag propre à l’émission, et souvent suggéré par la chaîne elle-même. C’est ainsi que
France 2 propose pour l’émission politique Des paroles et des actes, de commenter les
prestations avec #dpda. Ce fut aussi le cas pour la récente prestation télévisée du Président
Hollande. France télévision s’est même réjouie d’avoir été en tête de l’audience sur les
réseaux sociaux le 28 mars 2013, puisque entre 20:15 et 21:25, l’institut TvTweet a
comptabilisé 117.302 tweets, venant de 27.717 émetteurs différents, avec une moyenne de
1675 tweets /minute. Une bataille de hashtag s’est déroulée entre militants des deux bords.
Quatre hashtags se sont même disputés le podium du mot-clé le plus utilisé sur le fil Twitter
français.
15 A. Bruns, « Key Events in Australian (Micro-)Blogging during 2010 », paper presented at ECREA
2010, Hamburg.
[En ligne : http://www.slideshare.net/Snurb/key-events-in-australianmicroblogging-during-2010]
16 D. Shamma, L. Kennedy, E. Churchill, « Tweetgeist: can the Twitter timeline reveal the structure of
broadcast events ? », paper presented at the 2010 ACM Conference on Computer Supported Work,
Savannah, USA.
17 A. O. Larsson, H. Moe, « Studying political microblogging. Twitter users in the 2010 Swedish
election campaign », New Media and Society, August 2012, 14 (5), pp.729-747.
21
Hashtag Rang maximal
en France
Durée du
maintien à ce
rang maximal
(en minutes)
Nombre de
tweets
#StopHollande 1 230 32008
#SansHollande 1 110 8198
#entretien 2 130 20048
#AvecHollande 2 50 22875
Le commentaire en direct sur Twitter des émissions politiques (mais aussi sur les dispositifs
de couverture Live en ligne des journaux) est monté progressivement en puissance durant la
séquence électorale ouverte par les primaires socialistes de l’automne 2011. Une étude de la
Netscouade18
montre cette progression :
Et lorsqu’il s’agit de comptabiliser le nombre de tweets émis pendant la durée de l’émission,
on peut se rendre compte que la quantité est loin d’être négligeable, car un tweet émis est lu
par des dizaines, centaines ou milliers d’abonnés ou d’internautes inscrits au hashtag donné.
La Netscouade fournit là aussi des estimations instructives du phénomène :
18
« Présidentielle 2012 : débats télévisés + Twitter = TV augmentée », Netscouade.com, mis en ligne
le 2 mai 2012.
22
Ce phénomène est évidemment observable également aux États-Unis. En octobre 2012, le
PEW Research Center a ainsi interrogé les Américains qui ont regardé le premier débat entre
les deux prétendants. Il apparaît que 11% l’ont regardé en double écran, mais surtout un effet
génération est manifeste, puisque au-delà de 40 ans, on tombe à 1% alors que chez les 18-39
ans on double le score pour atteindre 22%. Différence qui est gage d’une extension de ces
pratiques à l’avenir.
Dans ce contexte d’usage croissant du regard en double écran, le débat présidentiel français
représente l’acmé de ce phénomène, puisque selon l’agence ZenithOptimedia, entre 19h et
minuit, le jour du débat, ce sont 237.000 tweets qui ont été émis en référence à cette émission.
Le chiffre est bien plus grand si on prend en compte tous ceux contenant le nom d’un des
deux candidats : 680.000 (mais attention, un certain nombre pouvaient contenir les deux noms
à la fois), TNS Sofrès, avec ses partenaires, en compte même 725.000 contenant le nom d’au
moins un des deux candidats. Ces données démontrent que l’on atteint un niveau suffisant
pour pouvoir le considérer comme un phénomène de masse, avec plus de 90.000 émetteurs
différents, et ce d’autant que les messages circulent aussi sur Facebook, qui possède bien plus
d’abonnés que Twitter.
23
Beaucoup de ces tweets étaient des actes de soutien ou des critiques destinés à l’un ou l’autre
des candidats. Deux hashtags concurrents ont construit la communauté d’intérêts numérique :
#Ledébat ou #débat, avec des fortunes diverses. Mais un nouvel hashtag est apparu, pour
renouer avec une version plus subversive et affirmer sa radicalité de militant Internet
(#autredebat) face à des hashtags jugés trop neutres qui agrègent trop d’acteurs, y compris
institutionnels. Les hashtags du débat ont souvent été talonnés dans le palmarès des usages de
de deux fils concurrents, #voterHollande et #voterSarkozy ou #avecSarkozy.
Puis, un hashtag a fait florès durant l’émission, pour soutenir F. Hollande ou s’en moquer, de
la part de simples citoyens, de personnalités ou de journalistes : #moiprésidentdelarepublique.
@cecile2menibus Grand jeu concours ! Combien y avait-il de
#moiprésidentdelarepublique ?
@ctricot #moiprésidentdelarepublique je raccourci la durée voyage Terre-Mars
#ledebat
@Sneazzy1995 Si il repète #moiprésidentdelarepublique je quitte la France.
@nicolasvoisin Merde, François a eu une punition, il doit répéter 466 fois ‘moi
président de la République » ! #Ledebat
24
De façon générale, on peut remarquer une forte tension entre internautes de gauche et de
droite, avec un usage régulier de termes péjoratifs pour qualifier l’adversaire : « nain »,
« nabot » pour l’un, « flanby » pour l’autre, soulignant ce qui serait sa mollesse et son
inconsistance. Une partie des commentaires est donc une dénonciation des traits de
personnalité du débattant, jugé souvent menteur, agressif ou incompétent et pas la hauteur de
l’enjeu ou de la fonction. Les réseaux sociaux servent à cet égard d’exutoire pour exprimer
crument ses convictions, sans s’interdire les invectives ou des rappels très défavorables au
passé politique des candidats. On observe aussi souvent une posture de mise en dérision des
candidats et de la politique en général. Il s’agit de s’exprimer librement en espérant trouver
une tribune élargie grâce à son insertion dans le flux du hashtag.
@bruno_walther Hollande offre des iPad aux collegiens, sarkozy offre des epad mais
uniquement pour son fils #ledebat.
@MemePasGrave Oups. Sarkozy favorable au droit de vote des étrangers en 2005 (+
URL YouTube) #Ledebat
@Authueil Mais arrêtez donc avec ces querelles de chiffres… On ne demande pas à
un président d’être un technocrate #autredebat.
@descoursdenis Je tiens à prévenir Sarkozy : s’il faut faire des tests de français pour
entrer en France, il aura du mal à revenir. #VoteHollande #LeDebat
@narvic #Ledebat Normalement on dirait juste que le match est... nul. Mais vu
comment Sarkozy annonçait le blitzkrieg : c’est clair, il se rétame !
Et comme la force de Twitter réside dans l’aptitude qu’il donne de prendre la parole tout de
suite, sans avoir besoin du relais médiatique, en comptant sur les internautes pour relayer, on
a pu voir des acteurs mis en cause dans le débat intervenir pour s’expliquer directement. Ce
fut le cas de Mathieu Pigasse dont le message fut rapidement retweeté avec hashtag :
Selon l’étude TNS Sofrès, Sopra Group & Vigiglobe, pour chaque candidat la proportion des
jugements accompagnant les messages est quasi identique : les deux-tiers sont qualifiés de
neutres, 10% s’accompagnent de jugements laudatifs, et environ un quart sont négatifs.
Les journalistes actifs sur le réseau social furent aussi présents pour commenter en direct
l’événement. Le compte Twitter @YMobActus qui recense les journalistes français présents
sur ce réseau, a publié, au soir du débat, deux statistiques instructives à partir de sa base de
25
données : plus du tiers des journalistes de sa base, soit 1034 étaient connectés le soir du débat,
et ils ont publié 3153 messages. Pour certains journalistes, il s’agissait surtout de suivre ce
que les internautes disaient et de s’en servir comme une sorte de pouls de l’opinion, en direct,
avec l’idée de produire pour leur site un tableau d’honneur des meilleurs messages publiés.
Ces journalistes se livrent alors sur Twitter à un exercice de méta commentaire sur ce qui se
passe sur Twitter. Plusieurs liens vers des articles sont postés pour relater ce qui est en train
de s’y passer ou pour souligner a postériori l’inventivité verbale des tweetos, mettre en
exergue ceux qui ont fait preuve du plus d’humour, d’esprit, de causticité... On peut proposer
une sélection de messages laissés durant le débat sur Twitter pour approcher les différents
types de messages journalistiques. Il faudrait aussi parler du fact checking, le contrôle en
direct de la véracité des propos des candidats, autre innovation importante de cette campagne,
mais cela excèderait le cadre de cet article.
Typologie des commentaires de journalistes publiés sur Twitter durant le débat présidentiel
Types de
commentaires Les tweets
rédaction
de
l’auteur
du tweet
Critique en
direct de la
rhétorique ou
de la posture
des acteurs du
débat
@ArLeparmentier #Hollande domine le débat face à
un #Sarkozy nerveux (+URL vers Le Monde.fr) Le Monde
@SalahShou Sarkozy qui balance DSK à ce moment
du débat, c’est comme un joueur qui tente une frappe
de 57m avec son mauvais pied à la 93ème. #LeDebat
Télé Sud
@C_Barbier Sarkozy a gâché la cartouche DSK… L’Express
@paulac Hollande donne l’impression d’être le
président en place et Sarkozy d’être le petit nouveau Huffington
Post
@siankowski Hollande est autoritaire comme un
libéro de Bundesliga Les Inrocks
@marclandre Nicolas Sarkozy donne trop de chiffres
et ne parle pas assez aux gens, contrairement à F.
Hollande… #ledebat
Le Figaro
@amauryguibert Mais pourquoi Nicolas Sarkozy n’a
pas interrompu François Hollande dans son monologue #moipresidentdelarepublique ?
France 2
@egaucher Joli coup de N. Sarkozy sur « Mitterrand
aurait pu vous confier des responsabilités, ça vous
aurait familiarisé » #lautredebat #ledebat
Blog &
France 2
@marclandre Nicolas Sarkozy marque 1 point sur les
centres de rétention et F. Hollande dans un corner en
évoquant sa lettre à France terre d’asile
Le Figaro
@Poussielgue #Ledebat PAS UN MOT SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE… ou presque…
Apparemment ce n’est plus à la mode !
Les échos
26
Bilan du
débat à la
façon d’un
match de
boxe
@nicodomenach Qui déjà avait dit que Hollande
allait "être pulvérisé... atomisé... explosé"?
Marianne
@RenaudDely je ne suis pas tout à fait sûr que N.
Sarkozy ait, comme il l’avait annoncé, « explosé » ce
« nul » de F. Hollande…
Nouvel
Observateur
@gammaire Sarkozy est out, KO, sonné #ledebat
Hollande montre une maîtrise impressionnante
indépendant
@edwyplenel Un Sarkozy perdant et perdu, un
Hollande battant et digne. A nous tous de faire le
reste : refonder la République et relever la France.
Mediapart
Sarcasmes
sur les
candidats ou
le dispositif
du débat
@Bruce_Toussaint C’est la faute aux Zipads !
#LeDebat Europe1
@davdu #leDebat. Dédé, GENIAL, ce plan de la table
vue haut. Tu peux le refaire ? indépendant
@benoitraphael Je rêve ou Hollande vient de bailler
? #ledebat indépendant
@Garriberts Ah, il y a le grec-frite qui vient de
remonter chez Hollande. #Ledebat
Libération
Mais les débatteurs ne sont pas la seule cible des commentaires, soutiens ou critiques. Parmi
les cibles des aclictivistes qui commentent le débat en direct, figurent en bonne place les
journalistes. On retrouve là un usage initial du militantisme sur Internet. Il s’est construit
précisément contre les médias dominants et a toujours fédéré des internautes qui
revendiquaient l’expression d’une parole alternative, puisque les médias grand public sont
accusés de confisquer l’espace public et de censurer les paroles divergentes et critiques. Les
Twittos rivalisent d’esprit pour proposer un bon mot qui rabaisse les deux « animateurs » du
débat qui, tout le monde le constate, brillent en fait par leur effacement face aux candidats.
@ElsaMazone Il faut être quoi pour être journaliste sur TF1, un bafa ?? #LeDebat
@Fredzone Je crois que Laurence Ferrari joue à Angry Birds Space #LeDebat
@sprykritic Temps de parole à 22h13 : F. Hollande : 32:00 N. Sarkozy : 31:17 D. Pujadas :
00:46 L. Ferrari : -02:52 #LeDebat
@NicolasBedos Laurence Ferrari vient de finir 16 pages de Sudoku
@michelhenrion Pour sauver Laurence, tapez1. Pour sauver David, tapez 2. #leDebat
Et Bastien Kerspec, webdesigner, crée pendant le débat un détournement d’affiche qui
connaîtra un vrai succès, ayant été retweeté plus de 350 fois. Il fait circuler sa production via
son fil Twitter. @Kastien L’affiche du film muet de l’année : The Journalists avec David
Pujadas et Laurence Ferrari #LeDebat. Jalal poste depuis son compte Twitter @Djal4real
cet autre détournement ironique, tournant en dérision un support de diffusion médiatique pour
se moquer des journalistes :
27
De façon générale, la contestation sur Internet se fait volontiers graphique, ce qui n’est pas
sans rappeler l’effervescence des affiches et tracts de mai 68. Et cela se fait de façon
extrêmement réactive. Ainsi, lors du débat est créé par un jeune internaute de 20 ans
(@seriousCharly), un compte Tumblr pour y déposer ses propres détournements graphiques
et pour inviter ceux qui le veulent, à lui fournir leur création pour publication centralisée sur
http://ledebat.tumblr.com (les deux détournements ci-dessus en proviennent). Les outils
créatifs numériques (dessins, retouche photos, vidéos montages…) et le fonds d’archives
ouvertes qu’Internet offre comme ressources, facilitent grandement un tel investissement
graphique pour exprimer sa contestation. Et le succès est sensible, puisque cette initiative va
générer une conversation sur le fil Twitter en général et via le #Ledebat.
28
Conclusion : vers un « social network turn » ?
La technologie de télévision connectée est déjà prête et les chaînes, de par le monde,
s’exercent déjà à développer le commentaire en direct sur les réseaux sociaux de leurs
programmes, essentiellement de fiction et de divertissement. Les postes de télévision vont
donc offrir de plus en plus, au fur et à mesure du renouvellement du parc des téléviseurs, des
écrans scindables où l’image sera accompagnée en latéral d’un accès possible à ses réseaux
sociaux, pour partager avec ses proches ou une communauté d’intérêts numérique provisoire,
ses avis et opinions sur le programme regardé. L’expérience de téléspectateur est donc
amenée à être renouvelée en profondeur quand cette possibilité sera devenue un usage régulier
voire généralisé. On voit l’utilité commerciale que les chaînes peuvent en tirer. Cela
renouvelle en effet le vécu de téléspectateur et évite la concurrence d’un second écran, source
de déperdition d’audience, puisque le téléviseur accueillera les deux écrans. Cette télévision
enrichie, combinant programmes et commentaires de ses communautés, est une source
potentielle de maintien de la télévision dans sa position de fédératrice d’audiences. Twitter est
en effet associé à « de nouvelles voies sur lesquelles une partie de l’audience des medias se
mobilise et interagit avec ceux qui font le contenu des medias »19
,
Ce qui est vrai pour la télévision comme dispositif technique ne l’est pas en revanche pour la
parole politique médiatisée. Le commentaire live (plus encore s’il est doublé par des
dispositifs de fact checking journalistiques) est un potentiel puissant outil de subversion des
tactiques marketing et rhétoriques. La parole politique est alors contestée au moment même
où elle est émise. Dans un cadre de partage collectif de l’esprit critique, selon une logique
d’égalisation de la légitimité à prendre la parole et sans pouvoir contrôler le flux créé par les
hashtags (sauf peut-être en les saturant de messages partisans de soutien ou de dénigrement
des adversaires), la parole politique est soumise à une nouvelle épreuve de désacralisation,
subissant des procès en délégitimation par le biais de l’injure numérique, de la critique
factuelle, de la confrontation aux actes ou propos passés, de la contre-argumentation, de la
réinterprétation ou de la dérision. On peut dès lors parler de la mise en place des conditions
d’un tournant majeur dans la façon de réceptionner la parole politique à la télévision, ce que
nous appellerions volontiers le « social network turn ». Ce tournant, nous dit Dominique
Cardon, « se caractérise par une ouverture de l’espace d’interprétation des informations à un
cercle élargi d’usagers actifs du Web et des réseaux sociaux. Si l’affirmation des subjectivités,
le relâchement des formes énonciatives, la ludification de l’information, l’humour et la
distanciation cynique, la rumeur et la provocation, etc., sont en train de devenir des tendances
centrales du rapport à l’information, l’exigence de véracité et la quête de nouvelles données
ne cessent aussi de se renforcer »20
.
19
Ruth Deller, « Twittering on: Audience research and participation using Twitter », Participations.
Journal of audience & reception studies, Vol.8, (1), may 2011, p.237.
20 Dominique Cardon, « Jusqu'où va la démocratie sur Internet ? », nonfiction.fr, 7 juillet 2011, p.6.
[http://www.nonfiction.fr/article-4832-
jusquou_va_la_democratie_sur_internet__interview_de_dominique_cardon.htm]
29
Sans verser dans l’idéalisation d’une intelligence collective rendue évidente grâce à Internet et
aux réseaux, on peut cependant noter que l’économie de partage des commentaires dans
laquelle on rentre, donne vie à l’idée d’innovation ascendante défendue par Eric Von
Hippel21
. On voit des nouveaux usages apparaître, des dispositifs être critiqués ou subvertis, et
des paroles profanes accéder au rang de parole légitime, partagée et reprise. Deux
politologues autrichiens en ont fait la démonstration dans leur analyse des usages politiques
de Twitter dans leur pays. « Les citoyens privés, notamment les blogueurs, apparaissent aux
côtés des journalistes et experts politiques en tant que relais centraux d'information et
connecteurs entre sous-réseaux sur des sujets spécifiques. Nous appelons ces acteurs, des
‘autorités de niche’ »22
.
Et en France, en s’aidant de l’outil d’analyse des audiences internet, Topsy, un journaliste a
établi le palmarès des 3 messages politiques Twitter les plus rediffusés23
entre le 1er
janvier et
le premier tour de scrutin. Ce palmarès est intéressant car il montre que les citoyens et
personnalités de la société civile arrivent bien avant les candidats, attestant du profil très
bottom-up de ce qui circule et plait sur les réseaux sociaux. Arrive en tête avec plus de 2000
retweets, un webmaster-webdesigner, Christophe Général qui raille N. Sarkozy début janvier,
en s’associant à l’information qui faisait le buzz, l’arrivée de Free dans la téléphonie mobile à
prix cassé : @christophegen #Free vient de faire plus pour le pouvoir d’achat en 5 minutes
que Nicolas #Sarkozy en 5 ans… En deuxième, on trouve, avec plus de 1500 retweets, le
secrétaire général de l’association anticorruption Anticor qui s’indignait le 25 mars des
amalgames xénophobes, en meeting, de Marine Le Pen : @pprevert Marine Le Pen :
« combien de Mohamed Merah dans les bateaux qui arrivent chaque jour en France ? » Il est
né à Toulouse, abrutie. Enfin, le troisième message le plus rediffusé (1400 retweets) doit
beaucoup à son auteur, artiste très connu. Le 15 avril Jamel Debbouze se félicite des propos
de J. L Mélenchon : @debbouzejamel Notre chance c’est le METISSAGE ! C’est la phrase la
plus censée que j’ai entendu depuis longtemps en politique ! BRAVO !
On notera aussi que plusieurs commentateurs et journalistes ont choisi pour résumer le débat
présidentiel de se référer à un tweet émis par un père de famille citant son enfant : @sknob
Mon fils : « Sarkozy, premier homme à se casser les dents sur un flanby ! » #LeDebat
#VoteHollande. Sortis vainqueur de leur bataille avec les journalistes pour la maîtrise de la
médiatisation, les communicants devront donc sans doute trouver de nouvelles stratégies face
à l’émergence de ce social network turn qui risque fort de modifier le schéma du two-step-
flow of communication et le jeu de la persuasion politique, en introduisant de nouveaux
influenceurs dans le jeu et en modifiant les conditions de réception critique du discours
politique médiatisé.
21
Eric Von Hippel, “Open Source Projects as Horizontal Innovation Networks - By and For Users”,
june 2002, MIT Sloan Working Paper, n°4366 (2). [En ligne: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.328900] 22 Julian Ausserhofer & Axel Maireder, “National politics on Twitter”, Information, Communication &
Society, 16 (3), 2013, p.305. 23
Paul Larroutourou, “Les trois tweets les plus retweetés de la campagne”, Le LabEurope1, 26 avril
2012.