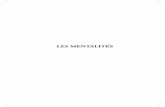Alliance, filiation et statuts sociaux en Asie
Transcript of Alliance, filiation et statuts sociaux en Asie
Alliance, filiation et statuts sociaux en Asie:
les cas des Lao du nord-est de la Thaïlande et des
Panjabis musulmans du Pakistan
Tahnee Dierauer
EHESS
M1 AMO 2013/2014
1
Introduction p.2
I Choix matrimoniaux: expliquer critères, symbolique et
utilité par les relations familiales p.3
a) Effet miroir et tabous: reproduire et rejeter des
modèles familiers
b) Assimilations et extensions: quand l'Autre devient le
nôtre
II Statuts sociaux et échanges: dons rituels, réciprocité
et respect p.6
a) Un système de dettes: donner pour recevoir
b) L'échange comme principe de l'alliance: le mariage,
un moment clé
Conclusion p.9
Illustration couverture:
Les ladduām, petites friandises à base de farine de pois chiche, de semoule ou
de noix de coco râpée, sont une partie incontournable de l'échange rituel de
cadeaux au Panjab, surtout à l'occasion de mariages.
Source illustration: blendwithspices.com, consulté le 29 avril 2014.
2
Introduction
"Après une longue éclipse, les études de la parenté suscitent de nouveau l'intérêt des
anthropologues" écrit Dominique Casajus, anthropologue, directeur de recherches au CNRS
et maître de conférences à l'Ecole polytechnique en 2008.1 Ce sont plutôt de bonnes
nouvelles pour la recherche en sciences sociales - ne pourrait-on pas dire que la filiation et
l'alliance, les deux constituantes majeures de la parenté, se trouvent en effet à la racine de
toute société?
C'est ce que semblent vouloir montrer Bernard Formoso - ethnologue français enseignant
l'identité ethnique et l'anthropologie économique à l'université Paris Ouest-Nanterre la
Défense depuis 1990, ses études portant, dans un premier temps, sur les communautés Rom
et Sinte dans le Sud de la France, puis, sur l'Asie du Sud-Est, le monde chinois et ses
périphéries2 - et Anjum Alvi - anthropologue sociale d'origine panjabie pakistanaise ayant
enseigné à l'Université libre de Berlin, à l'université de Heidelberg, à l'université de
technologie de Darmstadt, à la Quaid-e-Azam University à Islamabad et, depuis 2008, au
département Humanités et Sciences Sociales de la Lahore University of Management
Sciences, s'intéressant à l'individu panjabi, ses relations et son comportement social3 - dans
leurs articles respectifs qui font l'objet de notre étude comparative.
Il s'agit de deux études de cas qui semblent différer à tous points de vue: tandis qu'Alvi
étudie avec le Panjab pakistanais dans India and the Muslim Punjab: A Unified Approach to
South Asian Kinship4 non seulement la région la plus peuplée, mais aussi la plus fertile et
développée du pays, Formoso choisit pour son enquête Alliance et séniorité - Le cas des Lao
du nord-est de la Thaïlande5 le plateau du Khorat, zone la plus pauvre de la Thaïlande, dû à
son aridité. Formoso étudie avec les Lao thaïlandais - aussi appelés les Isan - une minorité
ethnique, influencée culturellement et dominée économiquement par la majorité siamoise,
alors qu'Alvi s'intéresse avec les Panjabis au groupe ethnique sur tous les plans dominant du
Pakistan. Et ce ne sont pas les seules différences: tandis que Formoso analyse une société
traditionnellement matrilinéaire, pratiquant un système uxorilocal, Alvi étudie une société
patrilinéaire et patrilocale.
Quel intérêt, pourrait-on donc se demander, de faire une lecture parallèle de ces deux
enquêtes de terrain? D'une part, il est intéressant de noter le fait que les deux chercheurs
ont choisi pour leur travail de recherche le milieu rural en région plutôt montagnarde. Dans
les deux cas, il s'agit donc de lieux assez isolés, où les pratiques sociales traditionnelles - dont
1 CASAJUS, Dominique, Du nouveau sur la parenté, 3 novembre 2008, laviedesidées.fr, consulté le 29 avril
2014. 2 Source: mae.u-paris10.fr, consulté le 29 avril 2014.
3 Source: lums.edu.pk, consulté le 27 avril 2014.
4 The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.13, No.3, Sep., 2007, pp.657-678.
5 L'Homme, tome 30, n°115, 1990, pp.71-97
3
celles liées à la parenté - ont été conservées et moins exposées à l'influence étrangère
qu'elles ne l'auraient probablement été en milieu urbain.
Examiné de plus près, les objets d'étude d'Alvi et de Formoso paraissent donc bien
semblables. On pourrait ajouter que même leurs intérêts de recherche ne divergent
finalement pas tant que cela: les deux auteurs semblent mettre en évidence dans leurs
articles le lien qui existe au sein des sociétés étudiées - lao et panjabie - entre la filiation,
l'alliance et les statuts sociaux.
Quel est donc ce lien, et comment se manifeste-t-il? Nous allons chercher à répondre à cette
question en analysant, toujours sur les traces des deux chercheurs, la manière dont les
critères, la symbolique et l'utilité des choix matrimoniaux peuvent s'expliquer par les
relations familiales, puis, nous nous intéressons à la composante essentielle que semble
être, en matière de statuts sociaux, l'échange de cadeaux et de services.
I Choix matrimoniaux: expliquer critères, symbolique et utilité par les relations
familiales
a) Effet miroir et tabous: reproduire et rejeter des modèles familiers
Au premier abord, les règles ou, du moins, les préférences concernant les choix
matrimoniaux laos et panjabis ne semblent avoir rien en commun: alors que, selon Formoso,
"les idylles romantiques" sont "valorisées par les Laos" et que l'on laisse "une grande part
aux initiatives des jeunes gens" - permettant ainsi ce que l'on appelle, en Asie du Sud
communément le love marriage - les alliances matrimoniales panjabies sont, comme on le
voit dans l'article d'Alvi, généralement arrangées par les parents des jeunes mariés. Une
autre différence majeure est l'interdiction au sein de la société lao de se marier entre
cousins de premier degré, alors que l'idéal du mariage panjabi musulman est celui avec la
cousine et surtout avec la fille du frère du père (FBD). Alors qu'Alvi ne mentionne pas l'âge
ou l'appartenance à une génération comme critère, l'accent est mis, chez Formoso, sur le fait
que les Laos ne doivent pas se marier avec une personne appartenant à une autre
génération, surtout dans le cas où la mariée serait l'aînée.
Cependant, même si ces interdits et préférences divergent drastiquement, les deux modèles
semblent avoir en commun le fait que le berceau de ces mêmes critères est à chercher dans
les relations au sein de la famille proche.
En effet, la composante la plus importante des relations familiales chez les Laos paraît être la
dichotomie aîné-cadet. Ainsi, les cadets - c'est-à-dire, les générations suivantes - doivent le
respect, l'obéissance et la gratitude aux aînés et ne doivent pas blesser leur amour propre,
pendant que les aînés réciproquent en protégeant et en aidant les cadets.
4
L'âge établit donc au sein de la famille une hiérarchie qui attribue à chacun son rôle
particulier d'aîné ou de cadet. Or, cet ordre hiérarchique ne semble pas être la vision idéale
lao d'une vie conjugale: si l'on étudie les critères des choix matrimoniaux, l'on remarque que
l'âge peut effectivement être considéré comme central. Comme nous l'avons pu voir ci-
dessus, l'interdiction de se marier avec un membre d'une autre génération est très forte et
domine clairement les autres critères ; ego ne doit pas se marier avec son aîné, ni avec son
cadet générationnel. Selon Formoso, de grandes différences d'âge entre époux seraient ainsi
rarissimes. On pourrait conclure que des rapports égaux au sein du couple sont recherchés,
mais cela ne semble pas exactement être le cas: ainsi, un homme ne doit surtout pas
épouser une femme plus âgée que lui, et en cas de transgression de cette règle, les mariés
entretiendront un rapport fictif aîné-cadet, la femme se comportant en cadette. Ce rapport
aîné-cadet peut même s'étendre à des branches entières de la famille: deux cousins de
second degré ou plus n'ont, par exemple, pas le droit de se marier si le garçon appartient à la
branche cadette.
La dichotomie aîné-cadet semble donc bel et bien être le critère le plus influant concernant
les choix matrimoniaux: il s'agit effectivement à la fois de rejeter et de reproduire les
rapports hiérarchiques qu'entretient ego avec les aînés et les cadets de sa famille.
Quant à la préférence des Panjabis musulmans de se marier entre cousins de premier degré,
nous ne pouvons pas l'attribuer à l'âge ou à la hiérarchie des générations, qui est également
une réalité bien établie en Asie du Sud. Alvi explique que, même si "les règles indo-aryennes
d'exogamie" interdisent le mariage entre cousins, celui-ci est considéré comme prestigieux
au Panjab musulman, tout comme au Moyen Orient, étant donné qu'une certaine pureté du
clan (birādarī en Asie du Sud, du persan birādar, frère) est préservée. Mais plutôt qu'à
l'influence de l'islam, Alvi attribue cette préférence à l'importance de la relation frère-sœur
chez les Panjabis musulmans: ainsi, elle soutient que celle-ci est un reflet (mirror image) de
la relation époux-épouse et explique le désir d'une femme de marier sa fille au fils de son
frère, ce choix lui permettant de rejoindre, au moyen de sa fille le foyer - et le frère - qu'elle-
même a dû quitter lors de son mariage, obéissant aux règles du système patrilocal.
Cependant, cette explication ne semble pas rendre justice au mariage idéal qui serait, selon
Alvi, d'épouser la fille du frère du père. Ce qui est néanmoins sûr est qu'un couple essaie de
marier ses enfants aux enfants de frères, sœurs ou cousins. Alvi ajoute qu'à travers cette
pratique, au sein d'un village panjabi musulman "chaque personne a plusieurs liens de
parenté avec les autres" et surtout que l'on "considère comme frère et sœur tout homme et
toute femme qui sont de la même génération mais qui ne sont pas époux" - un fait qui
semble bien confirmer la règle qu'énonce l'indianiste Francis Zimmermann dans son ouvrage
Enquête sur la parenté: "Dans la société traditionnelle, tous les habitants du village sont
parents."6 Réunir symboliquement frères et sœurs et préserver à la fois le prestige du clan
semblent donc être les critères les plus influents pour les mariages panjabis musulmans.
6 ZIMMERMANN, Francis, Enquête sur la parenté, Presses Universitaires de France, 1993, Chap.1: La filiation,
p.51
5
b) Assimilations et extensions: quand l'Autre devient le nôtre
"Morā apnā begānā chūto jāe, bābul morā" - "Je quitte les miens, mon père", écrit le
poète et dernier nabab de l'Etat de l'Awadh Wajid Ali Shah au dix-neuvième siècle en se
mettant dans la peau d'une jeune mariée indienne quittant le foyer de ses parents, "Āmgnā
to parbat bhayā aur dehari bhayī bideś" - "Ta cour est devenue une montagne et ton seuil un
pays étranger". Ces lignes illustrent parfaitement le statut ambigu de la femme mariée que
décrit Alvi dans son article: ne faisant pas partie, à part entière, de la famille de son mari, elle
est désormais aussi considérée comme "étrangère" par ses propres parents et devient
l'Autre par excellence.
Cependant, Alvi montre également que le mariage au Panjab musulman ne fait pas que
séparer, mais aussi regrouper les individus: "un homme appelle le mari de sa sœur jījā (beau-
frère), et selon le principe de l'hypergamie, le jījā du jījā est également appelé jījā, ce qui fait
des épouses de ces hommes des sœurs et de leurs frères les frères de ego". La même chose
serait vraie pour une femme. En effet, Francis Zimmermann dit, en citant Louis Dumont, que
la terminologie de la parenté en Asie du Sud est constituée par des termes de consanguinité
d'une part et des termes d'alliance d'une autre.7 Sachant que, comme nous avons pu le voir
ci-dessus, dans la société traditionnelle du village, tous les habitants sont parents, l'on
pourrait conclure qu'ils sont tous désignés par ego avec des termes exprimant le ou les liens
de parenté (le jījā pourrait en même temps être un cousin, etc.).
Les alliances maritales dans la famille poussent donc l'individu panjabi musulman à établir un
lien l'unissant avec une personne auparavant considérée comme "étrangère" à la famille, en
assimilant celle-ci à une tierce personne parente des deux premières, si aucun lien de
parenté direct est apparent. Le mariage semble donc brouiller les frontières entre l'Autre et
le nôtre, tout en les affirmant.
Chez les Lao du nord-est de la Thaïlande, nous l'avons déjà mentionné, ego identifie et
assimile les personnes selon leur âge aux membres respectifs de la famille proche. L'usage
de la terminologie de la parenté s'étend même jusqu'au patron qui est vu, par l'employé,
comme un aîné - peu importe la différence d'âge, si différence il y a, - auquel il doit du
respect, tout comme, par exemple, à son père. La même chose est valable pour les
supérieurs au sein de la communauté monastique, ainsi que dans le domaine du transfert
des savoirs, où le disciple se comporte en cadet.
Il ne s'agit, effectivement, pas que d'un simple usage extensif d'un certain vocabulaire: celui-
ci s'accompagne de tout un code de conduite, incluant, selon Formoso, gestes, postures, ton,
registre lexical, formules de politesse et contenu des propos échangés: on adapte son
comportement à l'âge - réel ou fictif - de la personne avec qui l'on s'entretient.
L'impact du mariage sur les relations familiales des Lao du plateau de Khorat semble être
moindre qu'il ne l'est sur celles des Panjabis musulmans. Toutefois, le changement de statut
7 ZIMMERMANN, Francis, Enquête sur la parenté, Presses Universitaires de France, 1993, Chap.2: L'alliance,
p.90
6
marital d'un individu a "des répercussions directes sur les termes qu'il emploie pour désigner
ses germains et leurs conjoints. […] En effet, il se place désormais dans la position de ses
enfants nés ou à naître et applique à ses propres frères et sœurs ou à ceux de son conjoint,
ainsi qu'à leurs alliés, la taxinomie qu'il emploie habituellement pour désigner ses oncles et
tantes patri- ou matrilatéraux." Selon Formoso, il s'agirait d'une expression du fait que
l'individu est désormais en mesure de fonder sa propre branche de l'arbre généalogique et
de devenir lui-même un aîné, en assurant sa descendance, dont il adopte désormais le point
de vue. On pourrait donc supposer que le mariage a un impact direct sur le statut de
l'individu au sein de toute la société du village.
Il semblerait effectivement y avoir bien plus de connections entre liens de parenté et statuts
sociaux que l'on pourrait peut-être le croire au premier abord: alliance et filiation
apparaissent tout d'abord comme un moyen d'identification de l'individu qui serviront par la
suite à lui accorder une place au sein de la société. Comme l'exprime Zimmermann en
parlant de la fin du dix-neuvième siècle, "la parenté n'était pas définie par les liens
personnels qu'elle instituait, mais par les formes d'organisation sociale et politique qui
tiraient leur légitimité de ces liens du sang."8
II Statuts sociaux et échanges: dons rituels, réciprocité et respect
a) Un système de dettes: donner pour recevoir
Chez les Lao du nord-est de la Thaïlande, le critère le plus important pour déterminer
la position sociale d'un individu est, l'ordre de naissance. Comme nous avons pu le voir ci-
dessus, la dichotomie aîné-cadet s'accompagne d'un système de donnant-donnant au sein
de la famille, tout aussi bien qu'en dehors de celle-ci. Formoso fait également remarquer
que "la réciprocité […] cimente la relation entre les âges et les générations et par extension
toute interaction entre supérieur et subordonné".
Tandis que les aînés doivent protéger et aider les cadets, ceux-ci leur doivent, comme nous
l'avons déjà vu, le respect, l'obéissance et la gratitude. Mais ils ont également le devoir de ne
pas faire perdre la face à leurs aînés en portant publiquement atteinte à leur honneur, de
leur garantir un soutien moral et matériel et, surtout, de réaliser "avant et après leur mort
des mérites religieux qui leur garantiront un destin meilleur dans le cadre des
transmigrations futures". Il s'agirait ici de l'ordination pour un fils et d'offrandes régulières
pour une fille. Selon Formoso, "la réciprocité typique des relations filiales couvre donc à la
fois la dimension matérielle et spirituelle de la vie et se perpétue dans les rapports qui lient
les vivants aux morts, les ancêtres à leurs descendants".
8 ZIMMERMANN, Francis, Enquête sur la parenté, Presses Universitaires de France, 1993, Chap.1: La filiation,
p.40
7
Il est intéressant de noter ici le fait que les groupes de filiation vouent traditionnellement un
culte à l'ancêtre maternel - une pratique qui est aujourd'hui en déclin, selon Formoso
probablement dû à "l'affaiblissement de l'autorité des anciens et de l'influence croissante
des valeurs occidentales, notamment en matière de sexualité".
Cette occidentalisation progressive ne semble cependant pas avoir grandement affecté le
caractère essentiel de la dichotomie aîné-cadet et de l'interdépendance des générations au
sein de la société lao. En effet, l'échange de services et, dans une moindre mesure, de biens
matériels, semble tout à fait au cœur des relations sociales, déterminant si quelqu'un fait
bien son devoir d'aîné ou de cadet en se comportant de façon appropriée à sa position
sociale.
Au Panjab pakistanais - et indien, peut-on sûrement supposer - l'échange rituel de cadeaux
et d'autres faveurs est également tout à fait central aux relations sociales: ainsi, Zekiye Eglar,
auteure de la première étude du village panjabi pakistanais que mentionne Alvi dans son
article, écrit que cet échange est "d'une importance vitale pour les gens comme moyen
d'obtenir […] du prestige".9 Elle ajoute que "tout doit être réciproqué et les échanges
doivent être effectués à un niveau qui correspond au statut social d'un individu".10
Les échanges de cadeaux – sous forme de beurre clarifié (ghī), de sucre ou de diverses
pâtisseries, comme par exemple les incontournables ladduām, petites friandises à base de
farine de pois chiche, de semoule ou de noix de coco râpée, ou encore de tissus ou de
vêtements - se font notamment lors d'occasions tels des mariages, des naissances ou des
décès ; quant à l'échange de services, il s'agit plutôt d'une extension du premier rituel,
résultant en une relation dans le cadre de laquelle "deux individus, deux familles, deux
villages […] se sentent libres de demander des faveurs l'un à l'autre" 11 et sont eux-mêmes
prêts à en accorder.
Alvi mentionne également une autre forme d’échange qui semble particulièrement
intéressante en matière d’alliance et de filiation : le watta-satta12, cas dans lequel deux
hommes "échangent" leurs sœurs en tant qu'épouses, ce qui garantirait un bon traitement
de la jeune mariée, ainsi qu'une fortification du lien entre les deux familles. Mais cette
pratique n'est finalement pas si surprenante : "les femmes figurent parmi les prestations qui
passent effectivement d'un groupe à l'autre" écrit Louis Dumont13.
L'échange semble en effet essentiel en matière d’alliance matrimoniale – on pourrait donc
se demander si l'inverse ne serait pas tout aussi vrai.
9 EGLAR, Zekiye, A Punjabi Village in Pakistan, Columbia University Press, 1960. Part II. Vartan Bhanji, chap. x :
The Meaning of Vartan Bhanji, p.105 10
EGLAR, Zekiye, A Punjabi Village in Pakistan, Columbia University Press, 1960. Part II. Vartan Bhanji, chap. x : The Meaning of Vartan Bhanji, p.107 11
EGLAR, Zekiye, A Punjabi Village in Pakistan, Columbia University Press, 1960. Part II. Vartan Bhanji, chap. x : The Meaning of Vartan Bhanji, p.105 12
Alvi n’utilise pas, dans son article, de signes diacritiques. 13
DUMONT, Louis, Groupes de filiation et alliance de mariage : introduction à deux théories de l’anthropologie sociale, Editions Gallimard, 1997. Troisième partie : La théorie de l’alliance de mariage, p.118
8
b) L'échange comme principe de l'alliance: le mariage, un moment clé
Selon Zimmermann, en effet, "l'échange est le principe de l'alliance." 14 Comme nous
avons pu le voir ci-dessus, cette dernière peut effectivement consister en un véritable
échange de mariées – Dumont ajoute que, de manière générale et même au sein des
sociétés dites matrilinéaires "les hommes échangent les femmes et non l’inverse." 15
Cependant, Alvi – tout comme son précurseur Zekiye Eglar – insiste sur le rôle central que
détient la femme mariée elle-même dans les échanges rituels ayant lieu dans la société
villageoise du Panjab pakistanais : elle seule est responsable du bon déroulement de ces
pratiques, du maintien de la réciprocité ainsi que de la conservation du statut social qui en
dépend. "C'est la femme mariée, surtout la femme la plus âgée de la maison, qui joue le rôle
le plus actif et dirigeant dans les transactions, à travers l'échange de cadeaux et sa présence
aux événements importants où elle représente son foyer" écrit ainsi Eglar.16 Alvi explique
que la jeune fille célibataire ne prend pas activement part à ces rituels : jusqu'au jour de son
mariage, elle est – tout comme son frère non marié - rattachée aux échanges de cadeaux de
sa mère qui réceptionne les dons à son intention et les réciproque. Une jeune femme
célibataire ne serait, selon Alvi, même pas autorisée à assister à la disposition publique des
cadeaux.
Le mariage semble effectivement être un moment clé de la vie chez les Panjabis pakistanais,
tout particulièrement pour les femmes : en effet, ce n'est que le mariage qui semble rendre
possible l'acquisition d'un statut social, la jeune mariée étant désormais en mesure d'établir
elle-même des relations d'échange et de garantir, en ce faisant, le prestige de son foyer.
Ainsi, en quittant sa maison parentale, elle "met en marche" ce qu'Alvi désigne comme
"dynamiques de la parenté" (dynamics of kinship) qui se traduiront par la suite par les
échanges de cadeaux et de services que nous venons d’étudier de plus près.
Chez les Lao du nord-est de la Thaïlande, le mariage ne semble pas aussi étroitement lié aux
échanges de services, loin de les initier : nous avons pu voir qu'au sein de la société lao, cette
pratique est fondée sur un principe moral de dette réciproque entre les générations
antérieures et postérieures uniquement, le mariage ne chamboulant pas cette hiérarchie
bien établie. On pourrait présumer que les alliances maritales ne sont toutefois pas sans
importance quand il est question de statuts sociaux chez les Lao, sans pour autant les
affecter aussi radicalement que le mariage le fait dans le cas des Panjabis pakistanais :
l'ensemble des "prohibitions matrimoniales" est effectivement impressionnant, tout aussi
bien que leur complexité, révélatrice de l'importance du mariage au sein de la société.
14
ZIMMERMANN, Francis, Enquête sur la parenté, Presses Universitaires de France, 1993. Chap.2 : L’alliance, p.86 15
DUMONT, Louis, Groupes de filiation et alliance de mariage : introduction à deux théories de l’anthropologie sociale, Editions Gallimard, 1997. Troisième partie : La théorie de l’alliance de mariage, p.118 16
EGLAR, Zekiye, A Punjabi Village in Pakistan, Columbia University Press, 1960. Part II. Vartan Bhanji, chap.xii : The Groups Involved, p.116
9
Cependant, étant donné le rôle central que joue la dichotomie aîné-cadet pour déterminer la
position sociale d'un individu, on peut supposer que le mariage chez les Lao n'est vu comme
moment clé que dans la mesure où il initie le passage de l'existence de cadet à l'existence
d’aîné, l'individu pouvant désormais engendrer une descendance ; chose qui s’exprime par la
terminologie employée, comme nous l'avons mentionné ci-dessus.
Le mariage semble donc dans les deux cas, lao et panjabi pakistanais, marquer le début –
réel ou virtuel – d'une nouvelle vie sociale de l'individu, liée à de nouveaux devoirs et
responsabilités.
Conclusion
Les liens entre filiation, alliance et statuts sociaux se manifestent donc, comme nous
avons pu le voir, de plusieurs façons chez les Lao du nord-est de la Thaïlande ainsi que chez
les Panjabis musulmans au Pakistan, notamment à travers l'échange de biens et de services
qui est règlementé par les relations de parenté dans les deux cas. Les deux systèmes de
parenté semblent en effet avoir plusieurs points en commun.
On ne peut cependant négliger le fait que les deux anthropologues occupent des positions
très différentes au sein des sociétés qu'ils étudient : tandis que Bernard Formoso est
clairement perçu comme étranger chez les Lao, Anjum Alvi, en tant que Panjabi pakistanaise
se retrouve, en quelque sorte, "parmi les siens". On peut supposer que les réactions des
sujets observés et interrogés à la présence du chercheur respectif varient en fonction de
l'identité de ce dernier : ainsi, on cherchera peut-être davantage à expliquer rationnellement
des phénomènes sociaux face à un anthropologue occidental – dans le cas de Formoso -
tandis que le chercheur indigène est plus facilement accepté comme simple observateur,
dont on présume par ailleurs qu'il connaît et comprend déjà ces mêmes phénomènes. Cela
explique peut-être le fait que l'article d’Alvi peut paraît, par endroits, un peu confus, voire
contradictoire, pendant que l'étude de Formoso apparaît, dans son ensemble, comme un
développement très logique.
Dans la même veine, l'on pourrait peut-être même aller plus loin et soutenir que les
réflexions d'Alvi sont moins objectives que celles de Formoso : dans le cadre de son étude,
elle cherche à présenter un aspect de sa propre culture à un public occidental – et peut-être
à donner une image des pratiques sociales du Panjab pakistanais qui mettrait l'accent sur
une identité culturelle panjabie, et non sur l'identité religieuse musulmane : son explication
du mariage entre cousins de premier degré par le lien exceptionnel qu'il y aurait entre frères
et sœurs panjabis pakistanais est assez surprenante si l'on sait que ce genre d'alliance est
considéré comme inceste et, par conséquent, interdit chez les sikhs et hindous du Panjab
indien et du reste du nord du sous-continent indien – mais courant chez les autres
communautés musulmanes, en Asie du Sud et ailleurs. La préférence du mariage entre
10
cousins, comme la décrit Alvi, s'expliquerait-elle donc davantage par les préceptes de l'islam
que par des relations familiales qui seraient propres au Panjab pakistanais ? Connaissant
l'histoire du Panjab, région de l'Asie du Sud ayant connu un terrible déchirement au nom de
la religion en 1947, dans le contexte de la création du Pakistan en tant que nouvel état pour
les musulmans du sous-continent indien, on pourra plus facilement interpréter l'article d'Alvi
comme un engagement - que l'on pourrait qualifier de nationaliste - dans la quête d'une
identité panjabie pakistanaise, caractérisée par une certaine prise de distance par rapport à
l'identité islamique: une procédure qui semble peu étonnante si l'on sait, par exemple, que
la langue panjabie – bien que parlée par la grande majorité de la population pakistanaise –
est complètement dénigrée dans le pays – on ne l'enseigne même pas dans les écoles – au
profit de l'ourdou, considéré comme la langue par excellence des musulmans de l'Asie du
Sud.
Ce dernier développement montre bien à l'étudiant en sciences sociales que connaître le
profil culturel et social du chercheur et de le situer dans un contexte historique et politique,
est tout à fait essentiel pour comprendre ses travaux et ses intentions.