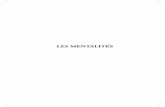La Serbie et l'Union européenne: une mise au point dans une période charnière
Luneau E_2013_Les mutations sociopolitiques de la civilisation de l'Oxus à la période finale (Asie...
Transcript of Luneau E_2013_Les mutations sociopolitiques de la civilisation de l'Oxus à la période finale (Asie...
les mutations sociopolitiques de la période finale
de la civilisation de l’oxus(asie centrale, âge du Bronze) :
quels indicateurs de changements ?
— élise Luneau
mots clésBactriane, Âge du Bronze, organisation sociopolitique, pouvoir, transfor-
mations sociopolitiques, transformations symboliques, populations androno-viennes, relations nomades/sédentaires, architecture, pratiques funéraires.
KeywordsBactria, Bronze Age, sociopolitical organization, power, sociopolitical transfor-
mations, transformations of the symbolic system, steppe andronovian tribes, relations between nomadic and sedentary tribes, architecture, burial practices.
abstractIn the mature period of the Oxus civilization (about 2300-1800 BC) several
archaeological signs (architecture, burial practices, artifacts, and iconography) reveal the existence of some kind of hierarchy, whose forms however are imprecise. During the next period (about 1800-1500 BC) corresponding to the decay of this civilization, these forms alter, sometimes radically, thus presupposing a lesser social differentiation. This major transformation is accompanied with some important modifications of the symbolic system that are visible in the burial practices and the material culture. May we consider a total transformation of the political structures of this society? During the Late Bronze Age, the increasing interactions between the populations settled in Bactria and Margiana and the steppe andronovian tribes established in the north of Central Asia as well as the penetration of these tribes in the south of Central Asia, known by some settlements, graves and artifacts constitute a fundamental basis for understanding the sociopolitical mutations of the Oxus civilization.
PUBLICATIO
NS DE L
A SORBONNE
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
222
Le vaste ensemble culturel connu sous le terme de « civilisation de l’Oxus » ou « Bactrian-Margian Archaeological Complex » est réparti sur les deux rives de l’Amu-Darya, en Bactriane méridionale (Afghanistan), Bac-triane septentrionale (sud de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan) et Margiane (Turkménistan central) avec des extensions dans les piémonts du Turkmé-nistan, dans le nord-est de l’Iran, voire jusqu’aux confins indo-pakistanais (fig. 1). Il est daté entre 2300 et 1500/1450 avant notre ère.
Deux grandes phases ont été mises en évidence. À la première période (entre 2300 et 1800 avant n. è. environ), la phase urbaine, correspondant à l’essor de cette civilisation, succède la période du déclin qualifiée de post-urbaine marquée par de profonds changements touchant l’ensemble des domaines de la société, débutant vers 1800 avant n. è. pour aboutir à sa chute aux alentours de 1500 avant n. è. (Francfort, 2003, p. 30-31).
Cette civilisation proto-urbaine à populations sédentaires pratiquant une économie agro-pastorale rendue possible par le développement d’importants réseaux d’irrigation, a laissé des vestiges d’établissements de tailles diverses, parfois fortifiés et pourvus d’une architecture monumentale. La culture matérielle, riche et abondante, révèle, outre une production céramique variée essentiellement réalisée au tour, un travail remarquable de nombreuses
1 | Carte de la civilisation de l’Oxus (carte de Lecuyot G. et Houal J.-B., dans Bopearachchi et al., 2003, p. 34).
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
223
matières (or, argent, bronze, pierres semi-précieuses, pierres tendres, os). Ces objets ont pu circuler sur de grandes distances, grâce à l’existence d’échanges importants avec l’Iran, la Mésopotamie, le Golfe persique ou encore la val-lée de l’Indus. Les pratiques funéraires étaient relativement stables. Inhumés dans des fosses simples ou des tombes pourvues d’une chambre funéraire, les défunts étaient très majoritairement placés en position repliée avec les membres fléchis sur le côté droit ou gauche, et souvent accompagnés de céra-miques et autres types d’artefacts en métal, pierre, os ou argile (Francfort, 2003).
Des indicateurs de différenciation sociale apparaissent nettement à la phase d’apogée de la civilisation de l’Oxus, mieux connue qu’à la période sui-vante grâce à l’ampleur des fouilles réalisées sur certains sites, laissant suppo-ser l’existence d’une hiérarchie sociale affirmée. La phase finale semble quant à elle marquée par une moindre différenciation sociale, suggérant l’hypo-thèse d’un changement majeur au niveau des structures sociopolitiques.
Ainsi, après une présentation sommaire de certains éléments de compré-hension du système sociopolitique de la période d’apogée, il s’agit de s’inter-roger sur les permanences et les changements observés à la période suivante de l’Âge du Bronze final, de façon à mettre en évidence l’évolution structurelle de cette société. L’arrivée de populations nouvelles sur le territoire occupé par la civilisation de l’Oxus semble jouer un rôle majeur, mais peut-elle, à elle seule, expliquer les mutations sociopolitiques constatées ?
Un bilan du type d’organisation sociopolitique de la civilisation de l’Oxus à la période d’apogée (environ 2300-1800 avant n. è.)Quels marqueurs de pouvoir à la période d’apogée ?
Les vestiges archéologiques de cette période fournissent plusieurs indica-teurs nets de l’existence d’une différenciation sociale observable dans l’archi-tecture, les pratiques funéraires, la culture matérielle et l’iconographie.
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
224
l’architecture
La plupart des grandes cités de la Civilisation de l’Oxus présentent des vestiges de bâtiments monumentaux. Pourvus de murs défensifs en briques crues, ils sont de plan quadrangulaire ou circulaire, et généralement munis de tours rondes ou carrées le long de l’enceinte et aux angles (Dashly 3 « Temple » et « Palais », Sapallitépé, Dzharkutan, Gonur sud « Temple » et Gonur nord « Palais », etc. ; fig. 2). La question de la fonction de ces bâti-ments n’est pas encore résolue. Certaines hypothèses mettent en avant une fonction soit domestique et défensive, comme celle de palais, soit religieuse comme celle de temples, et notamment de temples du feu en lien avec un proto-zoroastrisme (Askarov et Shirinov, 1993 ; Sarianidi, 1994). Cepen-dant, la faible quantité d’armes découvertes aux abords de ces édifices, la fai-blesse des murs de fortification, ainsi que l’agencement interne ne parlent pas en faveur d’une fonction défensive (Francfort, 1985). La fonction religieuse n’est pas non plus recevable dans la mesure où les éléments mentionnés
2 | Plan du complexe de Gonur Nord, Turkménistan (d’après Sarianidi, 2008, p. 11, fig. 2).
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
225
comme la présence de pièces à enduits blancs sur les sols et les murs, de banquettes de calage pour des jarres, ou de pièces avec des cendres et des foyers ne fournissent pas des preuves suffisantes (Francfort, 1994a, p. 275). La plupart de ces bâtiments monumentaux montrent l’association de zones à caractère probablement domestique et de zones économiques et de stoc-kage. L’identification de ces bâtiments à des manoirs à fonction résidentielle et économique apparaît actuellement la plus probable. Ces édifices possèdent par ailleurs un caractère purement ostentatoire, en tant que réels marqueurs de pouvoir, reflétant la domination d’un individu ou d’un groupe d’individus sur les autres du fait de sa capacité à bâtir et à entretenir de tels monuments.
les pratiques funéraires
Parmi le grand nombre de tombes attribuées à la civilisation de l’Oxus (plus de 3 000 tombes pour la seule nécropole de Gonur-Dépé 1), certaines constructions funéraires se démarquent. La majorité des sépultures sont des tombes à chambre funéraire ou de simples fosses, tandis que d’autres, bien moins nombreuses, sont construites en briques crues1.
Par ailleurs, un certain nombre de tombes construites très particulières, encloses dans le périmètre de l’enceinte de la fortification de Gonur Nord, comprenant, outre un riche matériel, plusieurs chars ou roues de chars aux côtés de chameaux, d’équidés, de bovins et de chiens, constitueraient selon V. I. Sarianidi (2006) une nécropole royale (fig. 2).
les objets
L’analyse comparative des objets présents dans les tombes d’hommes et dans celles des femmes met en évidence une répartition préférentielle de certains biens funéraires selon le genre (Luneau, 2008). Les femmes bénéficieraient de davantage de céramiques, d’objets en métal ou en maté-riaux précieux, et certains types d’objets leur seraient associés de manière quasi-exclusive comme les sceaux en métal ou en pierre2, les figurines fémi-nines en terre cuite et les statuettes composites3 en chlorite et calcaire blanc.
1. Moins de 5 % des tombes de la nécropole de Gonur-Dépé 1 appartiendraient à ces types de tombes (Sarianidi, 2007).
2. L’interprétation de ces objets n’est pas unanime. Ils pourraient notamment être de véritables cachets ou des insignes de pouvoir ou des emblèmes d’une communauté familiale ou clanique.
3. Les figurines composites sont considérées comme des représentations de la déesse féminine au sommet du panthéon de la civilisation de l’Oxus.
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
226
Inversement, dans les tombes d’hommes, se rencontreraient plus spécifique-ment, outre des outils, certains artefacts en pierre ou en métal caractéristiques de la Civilisation de l’Oxus : des colonnettes (fig. 3), des disques en pierre ou en plomb, des pierres ansées, des bâtons en pierre, des anneaux en plomb, des haches en métal, des pommeaux ou têtes de masse d’arme en métal ou en pierre et des « trompettes » en métal (bronze, argent) ou parfois en gypse. Bien que plusieurs hypothèses aient été avancées pour expliciter la fonction de ces objets divers (Pottier, 1984 ; Sarianidi, 2001 ; Boroffka et Sava, 1998 ; Lawergren, 2003), celle-ci reste actuellement inconnue. Un caractère haute-ment symbolique pourrait toutefois leur être attribué au regard de leur rareté, du matériau employé ou du degré d’élaboration de certaines pièces, ainsi que de leur contexte de découverte isolé ou en association dans des tombes, des cénotaphes4, dans des édifices monumentaux et plus rarement dans des habitats simples. Objets exceptionnels, n’ayant pas de fonction purement funéraire, ils peuvent être considérés comme des symboles de prestige et marqueurs d’un statut social particulier.
4. Le cénotaphe correspond à une sépulture sans squelette, laquelle peut toutefois être pourvue de biens funéraires (Crubézy et al., 2007, p. 236).
3 | Colonnettes de Togolok 1, Turkménistan (d’après Sarianidi, 2002, p. 132).
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
227
Il s’agirait alors de deux groupes d’objets distincts à valeur symbolique, de prestige, voire de pouvoir, en relation avec le genre de l’individu inhumé. Les sceaux et figurines majoritairement associés aux femmes représenteraient-ils le pendant des colonnettes, bâtons, disques ou haches majoritairement associés aux hommes ? Puisque ces marques de statut sont différentes entre les hommes et les femmes, l’existence d’une hiérarchie entre les deux sexes ne peut être établie. Des relations plus nuancées entre les individus ont pu avoir cours, comme une éventuelle bipolarité du pouvoir dirigeant entre les hommes et les femmes, celles-ci détenant des compétences que n’auraient pas eu les hommes, et inversement (Luneau, 2008).
L’iconographie
L’analyse iconographique permet de dégager un certain nombre d’élé-ments supplémentaires. Les frises de certains gobelets métalliques semblent mettre en évidence un système de différenciation sociale par classe d’âge entre les anciens, les personnes d’âge moyen, et les plus jeunes. Les scènes de banquets masculins apparaissent toutefois peu hiérarchisées sans personnage dominant à l’opposé de celles de Mésopotamie où le personnage principal domine nettement la représentation (Francfort, 1994b, p. 407).
une hiérarchisation sociale avérée mais encore de nombreuses questions
Les différents indicateurs recensés montrent bien l’existence d’une hiérar-chisation structurelle de la société. Cependant, le degré de cette hiérarchisa-tion ne peut seul être approché par l’analyse architecturale, limitée par sa trop grande généralité (Francfort, 1985), ni par la différentiation économique des tombes, dans la mesure où la richesse des tombes n’implique pas nécessaire-ment une relation directe avec la position sociale ou le pouvoir.
De façon générale, l’image qui se dégage du système sociopolitique de la civilisation de l’Oxus à la période d’apogée correspondrait à celle d’une société de type proto-étatique plutôt décentralisée, dirigée par des potentats locaux rattachés à des grandes familles résidant dans des bâtiments fortifiés et contrôlant un territoire irrigué (Francfort, 1994a). Une certaine puis-sance politique est perceptible dans l’architecture (édifices fortifiés, pilastres ornementaux, double symétrie des plans), les objets (objets à caractère
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
228
symbolique, sceaux, etc.) et l’iconographie. L’organisation sociale de la civili-sation de l’Oxus apparaîtrait par ailleurs fondée sur plusieurs variables :
– l’existence d’une élite, peut-être regroupée en lignages, accumulant les richesses et légitimant leur position sociale par un système symbolique de prestige ;
– une différenciation par classe d’âge ;– une distinction de genre importante mais pas nécessairement tournée
en faveur de l’un ou de l’autre sexe.Comment se structuraient ces différentes variables au sein de la société et
au niveau de la structure politique ? Quelle était la nature et le degré de cen-tralisation du pouvoir ? Des études plus précises quant à la complexité sociale et au type d’organisation sociopolitique de la civilisation de l’Oxus dans sa phase d’apogée apparaissent nécessaires pour répondre à ces interrogations.
les mutations de la période finale (1800-1500/1400 avant n. è.)Les vestiges matériels dégagés sur l’ensemble des sites de la civilisation de
l’Oxus montrent une situation très différente pour la phase post-urbaine qui laisse supposer une transformation importante des structures de pouvoir.
Quels indicateurs de différenciation sociale à la période finale ?
l’architecture
De nombreuses cités anciennement occupées sont abandonnées, comme Altyn-Dépé ou Ulug-Dépé, ou se réduisent drastiquement en surface, comme Namazga-Dépé ou Tekkem-Dépé (Kohl, 1984). Malgré les connaissances lacunaires sur cette période et notamment l’absence de plans complets publiés, en raison d’une disparition plus importante des couches supérieures et d’un moindre intérêt des fouilleurs, il semblerait qu’aucun édifice monu-mental et fortifié comparable à ceux de la période précédente n’ait été édifié au cours de la phase finale. Une restriction dans les dimensions des bâtiments ainsi qu’une conception architecturale différente apparaissent généralisées.
À Tekkem-Dépé, il faut noter la découverte d’un important bâtiment pourvu d’au moins 15 pièces et d’une tour ronde, qui ne présenterait cepen-dant pas, selon le fouilleur, la monumentalité des grands édifices de la période
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
229
d’apogée (Ganjalin, 1956). À Namazga-Dépé, les fouilles réalisées sur les niveaux de la période finale dans une zone nommée « Vyshka » d’environ 2 ha., montrent, dans des couches dont la forte épaisseur témoigne d’une occupation relativement longue, l’existence de bâtiments à plusieurs pièces en briques crues, ayant subi plusieurs remaniements mais sans monumenta-lité ni fortification (Shchetenko, 1972). Certains bâtiments monumentaux élevés à la période précédente continuent d’être utilisés, comme à Adzhi Kui 9 (Rossi-Osmida, 2007) ou à Dzharkutan où l’abandon du « temple » et du « palais » est daté de la période finale Molali-Bustan (Askarov et Shirinov, 1993).
Enfin, sur l’ensemble du territoire, les sites fondés à cette période tardive ne révèlent aucun bâtiment monumental comme cela est le cas à Takhirbaj 3, Molali ou Kangurttut. Il faut par ailleurs souligner des différences impor-tantes dans la conception et l’agencement de ces bâtiments, puisqu’à Kan-gurttut (fig. 4), les bâtiments sont petits, parfois ouverts sur un côté et édifiés en pierre (Vinogradova et al., 2008).
les pratiques funéraires
Bien que les rites mortuaires présentent une certaine stabilité par rapport à la période précédente, dans la mesure où les individus sont toujours très majoritairement inhumés en décubitus latéral dans des tombes à chambre funéraire ou des fosses simples, des divergences paraissent significatives.
4 | Plan d’un bâtiment de Kangurttut, Tadjikistan (d’après Vinogradova et al., 2008, p. 306, fig. 9).
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
230
Il faut tout d’abord souligner un appauvrissement du matériel en terme quantitatif et qualitatif. La quantité de céramiques placées dans les tombes se réduit et la plupart des objets en matériaux précieux disparaît. Les sépultures montrent une plus grande homogénéité matérielle par rapport à la période précédente. En ce qui concerne la répartition des biens entre les tombes d’hommes et celles de femmes, un renversement de situation semble s’opérer avec l’observation d’une augmentation du nombre de céramiques et d’objets en métal dans les sépultures masculines et leur réduction dans les tombes féminines (Luneau, 2008).
Une diversification des pratiques funéraires est par ailleurs observée. Les crémations apparaissent en nombre restreint. À Bustan 6, 22 crémations sur 230 sépultures ont été découvertes, soit environ 9,6 % (Avanesova et Tash-pulatova, 1999). De même, à Dzharkutan, les démembrements du squelette avant mise en terre ne représentent qu’une proportion infime des sépultures (moins de 1 %). La présence de cénotaphes – dont certains possèdent des statuettes anthropomorphes en argile (fig. 5) – encore marginale par rapport aux inhumations standards sur les grandes nécropoles du sud de l’Ouzbé-kistan mais en augmentation croissante, devient sur certains sites du sud du
5 | Cénotaphe : sépulture no 111 de Bustan VI, Ouzbékistan (d’après Avanesova, 1995, p. 39, fig. 10).
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
231
Tadjikistan, comme à Kangurttut, le rite funéraire majoritaire à plus de 90 % (Vinogradova et al., 2008).
les objets
Dans le domaine de la culture matérielle, le phénomène le plus notable concerne la disparition progressive des objets de prestige et de l’art figuré. On ne connaît pas de pièces d’orfèvrerie ou d’argenterie directement attribuables à la phase tardive. La statuaire de la période précédente (statuettes composites ou en argile cuite) disparaît. Les seules figurines anthropomorphes connues sont celles réalisées en argile crue découvertes dans les cénotaphes. Probable-ment déposées en tant que substituts des corps humains, elles possèdent a priori une autre signification que les figurines de la période précédente consi-dérées comme des représentations de personnages mythologiques. Enfin, il faut noter l’absence presque totale des sceaux pour cette période.
Quelques « objets symboliques » du même type que ceux connus à la période d’apogée ont été découverts dans le sud du Tadjikistan. En l’état actuel des recherches, l’occupation de ce territoire n’apparaît qu’à la période tardive de la civilisation de l’Oxus. Il s’agit de plusieurs disques ansés et bâtons en pierre (fig. 6 ; Kaniuth, Teufer et Vinogradova, 2006). Bien que n’ayant pas
6 | Bâtons en pierre d’Uchkun (no 1-2) et de Gelot (no 3) au Tadjikistan (d’après Kaniuth et al., 2006, p. 91, fig. 17).
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
232
été découverts en contexte, il est toutefois important de noter qu’ils se trou-vaient toujours en surface ou à proximité de nécropoles ou de tombes isolées (Gelot, Makonimor, Uchkun). Malgré tout, ils ne peuvent être rattachés de façon hâtive à la période finale et indiquent peut-être au contraire une occu-pation de ce territoire plus ancienne qu’on ne le suppose actuellement.
De nouveaux assemblages matériels apparaissent au cours de cette période finale. Il s’agit d’une part d’une panoplie d’artefacts miniatures en métal (fig. 7). Considérés comme votifs, ceux-ci représentent des objets qui étaient autrefois déposés en taille réelle dans les tombes (couteaux, rasoirs ou miroirs). On les rencontre notamment sur les nécropoles de Bustan 6 (Ava-nesova, 1995), de Dzharkutan et de Kangurttut (Vinogradova et al., 2008).
7 | Objets miniatures en bronze de Kangurttut, Tadjikistan (d’après Vinogradova et al., 2008, p. 359, fig. 64).
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
233
Par ailleurs, plusieurs ensembles d’objets en terre crue, composés de façon récurrente d’un petit anneau circulaire, d’un petit vase, d’une cuillère et de trois petits cônes, ont été mis au jour dans six tombes de la nécropole de Bus-tan 6 (fig. 5 ; Avanesova, 1995). Quelle est la valeur fonctionnelle et symbo-lique de ces objets ? Leur lien avec une quelconque pratique du culte du feu en relation avec la religion avestique proposé par certains chercheurs (Avane-sova et Tashpulatova, 1999) ne peut être actuellement confirmé.
Enfin, l’assemblage céramique se modifie légèrement puisque, bien que des vases modelés existent dès les périodes anciennes de la civilisation de l’Oxus, il faut noter une plus grande proportion de poteries modelées, ainsi que des types nouveaux, comme les vases à fond rond (fig. 8).
L’iconographie
La disparition progressive des principaux supports iconographiques connus à la période précédente nous prive de critères majeurs d’interpré-tation de l’organisation sociopolitique de cette société. Cependant, une augmentation des représentations associées au cheval sur plusieurs types de support peut être remarquée à la période finale. Une des plus anciennes représentations correspond à une épingle en bronze pourvue d’une extrémité en forme de cheval debout découverte dans la sépulture isolée de Zardcha
8 | Céramique modelée à fond rond de Dzharkutan, Ouzbékistan (No A 517 963,
musée du Registan, Samarkand).
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
234
Khalifa dans le nord du Tadjikistan (Bobomulloev, 1999), ainsi que des têtes d’équidés en argile à Bustan 6 (fig. 5), Dzharkutan (Ionesov, 1988) ou Namazga-dépé (Kuzmina et Mair, 2008, p. 58).
Des changements importants dans l’organisation sociale
La comparaison des critères de différenciation sociale retenus entre la période d’apogée et la période finale de la civilisation de l’Oxus évoque un changement structurel de la société. La disparition des villes sous la forme observée à la période d’apogée pose le problème de la désurbanisation et du maintien de structures proto-étatiques telles qu’elles sont supposées pour la phase urbaine. La moindre différenciation économique observée dans les tombes de la période tardive, ainsi que l’absence de constructions à carac-tère véritablement monumental bâties à cette époque semblent indiquer une moindre distinction sociale qu’à la période précédente.
L’organisation de cette société à la période post-urbaine est-elle pour autant moins empreinte de hiérarchisation sociale ? Il est nécessaire d’être prudent et de préciser que tout en existant réellement, cette distinction pourrait se matérialiser d’une autre manière qu’à la période précédente, et/ou de manière plus ou moins visible sur le terrain. Les nouvelles pratiques funéraires observées étaient-elles réservées à une catégorie particulière de la population ? L’adoption d’une nouvelle politique funéraire, correspondant à une politique de distribution des biens à la communauté comme la définit A. Testart (2001), peut aussi être envisagée, ce qui suggérerait des changements symboliques importants, ainsi qu’un rapport différent au pouvoir.
L’univers symbolique de ces populations paraît en effet évoluer : la dispa-rition progressive de la statuaire, des sceaux et des « objets à caractère sym-bolique » (disques, colonnettes, trompettes et haches d’apparat), marqueurs d’un statut social passé n’ayant plus cours à la période finale, en serait l’illus-tration. Cela semble renforcé par l’apparition de nouvelles pratiques funé-raires (crémation, cénotaphe), d’une iconographie renouvelée davantage centrée sur le cheval, et de nouveaux assemblages matériels comme les objets métalliques miniatures ou les ensembles de petits objets en terre crue, mar-queurs de nouvelles valeurs et d’un autre type de statut social ou de pouvoir.
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
235
De nombreux chercheurs relient un certain nombre de ces modifications, notamment symboliques, à l’émergence d’un proto-zoroastrisme dans le sud de l’Asie centrale au cours de l’Âge du Bronze en connexion avec la venue de populations indo-iraniennes. Il n’est actuellement pas possible de confirmer cette hypothèse. L’association culture matérielle/population/langage ne peut pas être mise en évidence d’après les seuls vestiges matériels. Il est étonnant de constater que ces auteurs relient les thèmes avestiques aussi bien aux ves-tiges archéologiques de la période d’apogée (temples, chars, etc.) qu’à ceux de la période finale (cénotaphes, crémations, etc.), ce qui apparaît contradic-toire en raison des changements importants observés entre les deux phases.
Il ne faut cependant pas nier l’arrivée de nouvelles populations sur le ter-ritoire occupé par la civilisation de l’Oxus. De nombreux vestiges associés aux communautés de type andronovien5 du nord de l’Asie centrale y ont été découverts. Il s’agit essentiellement de traces de campement, de céramiques, d’objets en métal, mais également de sépultures entières. Les communautés andronoviennes sont encore mal connues dans la zone méridionale quant à leur structure sociale, leur mode de vie économique ou leur implantation (Cattani, 2008). La difficulté de connexion de ces vestiges de type androno-vien à une culture précise dans leur zone d’origine se révèle également ardue en raison d’une importante mixité des traditions culturelles. Les processus de migration s’avèrent en fait complexes, sur une longue durée, avec d’impor-tants phénomènes d’acculturation entre plusieurs communautés sans doute assez restreintes au cours de leur déplacement (Masson, 1999). Leurs vestiges apparaissent en contextes isolés non loin des établissements de la civilisation de l’Oxus, ou en association avec des assemblages bactro-margiens sur ces mêmes établissements (Vinogradova et Kuzmina, 1996). Des phénomènes d’emprunts et d’acculturation, aboutissant parfois à la formation de nou-veaux groupes culturels, comme les cultures de Bishkent et du Vakhsh, ont été mis au jour sur plusieurs sites d’Asie centrale méridionale, en particulier dans le sud du Tadjikistan (Vinogradova et Kuzmina, 1996). La nécropole de Dashti-Kozy, dans la vallée du Zerafshan, fournit également un exemple intéressant puisque l’on y retrouve l’association des deux traditions (Isakov et
5. Ces groupes de populations agro-pastorales appartiennent à un vaste ensemble culturel désigné sous le terme de culture Andronovo. Elles partagent un certain nombre de traits culturels, mais ne pré-sentent pas moins d’importantes variations stylistiques et chronologiques. Ces populations ne peuvent pas être considérées comme de « purs nomades », mais possèdent probablement un mode de vie plus mobile en lien avec la part élevée de l’élevage dans leur économie (Kuzmina, 2007).
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
236
Potemkina, 1989) : certains traits culturels (rituel funéraire) appartiennent au monde de la civilisation de l’Oxus, tandis que d’autres (poteries, artefacts) sont nettement attribués aux traditions andronoviennes.
Comme le remarque justement V. M. Masson (1999), l’arrivée des popu-lations andronoviennes n’a pas correspondu à une invasion massive, mais à un déplacement par vagues, constant et hétérogène depuis l’Âge du Bronze moyen se faisant de plus en plus prégnant au cours de l’Âge du Bronze final. Ces groupes andronoviens semblent alors peser de plus en plus sur l’orga-nisation sociale, économique, idéologique et politique de la civilisation de l’Oxus. Mais ces interactions entre les deux communautés suffisent-elles actuellement à expliquer le profond changement subi par la civilisation de l’Oxus au cours de sa période finale ?
des populations andronoviennes au pouvoir ?
Les nouveaux venus ont-ils été assimilés au sein de la civilisation de l’Oxus ? Ou ces nouvelles forces politiques ont-elles pu prendre le pouvoir ? Et dans quelle mesure ces populations ont-elles joué un rôle dans la désta-bilisation et la mutation des structures sociopolitiques de la civilisation de l’Oxus ?
Les changements des formes de pouvoir restent très difficiles à perce-voir d’après les seuls vestiges matériels. Rappelons que l’infiltration de ces populations n’a a priori pas entraîné un changement ethnique important de la population dans le sud de l’Asie centrale. Par ailleurs, bien que V. M. Mas-son (1999) évoque l’hypothèse d’une intrusion de communautés dirigées par une noblesse guerrière circulant en chars, les contacts semblent avoir un caractère pacifique, permettant de supposer un vaste éventail d’interactions possibles entre les deux communautés (échanges commerciaux, liens de mariage, partage d’activités, etc.), ce dont témoignerait la forte proximité des deux formes de peuplement.
Si les traces des populations andronoviennes se font de plus en plus pré-sentes sur le territoire de la civilisation de l’Oxus, leur culture matérielle ne se substitue pourtant jamais à celle des populations autochtones. Hormis certains cas de mixité manifeste déjà soulignés, les vestiges associant des éléments de ces deux communautés restent quantitativement faibles en Bac-triane-Margiane. Cette grande stabilité culturelle ne paraît pas soutenir l’idée
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
237
d’une acculturation entre les populations andronoviennes et celles de la civi-lisation de l’Oxus (Cattani, 2008).
Cependant, l’influence exercée par une communauté sur une autre peut engendrer certaines transformations matérielles, idéologiques, sociales, poli-tiques ou économiques sans nécessairement provoquer le changement radi-cal de la population présente ou de la culture matérielle. Une prise de pouvoir au niveau des élites peut être envisagée, les nouveaux dirigeants porteurs de valeurs neuves déployant alors un nouveau système symbolique de légi-timation de cette domination politique. S’agirait-il notamment de groupes de langue indo-iranienne ou indo-aryenne ? Non seulement l’affiliation des populations andronoviennes à des populations de langue indo-iranienne ou indo-aryenne n’est pas établie, mais l’unicité linguistique de ces groupes divers est encore débattue. Au vu de l’iranisation des steppes et des oasis après 1500-1400 avant n. è., la présence d’individus locuteurs de ces groupes de langues reste toutefois une hypothèse fort plausible (Francfort, 2005).
Il est par ailleurs indispensable de s’interroger sur la forme de ces chan-gements. S’agit-il de transformations radicales dans la nature du pouvoir en place, ou bien des modalités d’exercice de ce pouvoir ? Enfin, ces mutations sociopolitiques sont-elles le résultat d’un phénomène externe, tel que l’arri-vée de populations distinctes, ou peuvent-elles avoir été engendrées par une désagrégation interne du système politique mis en place à la phase d’apogée de la civilisation de l’Oxus, créant alors des conditions favorables à une prise de pouvoir de nouveaux groupes politiques ? Comme le souligne J.-R. Kup-per (1959) dans le cas de la Mésopotamie, les conditions de résistance d’une communauté face à de nouveaux groupes de population constituent un « fac-teur décisif » de ces changements.
Quelles que soient les modalités de ces changements, rien ne permet actuellement de désigner les populations andronoviennes comme entière-ment responsables des modifications structurelles intervenues dans la civi-lisation de l’Oxus à partir de 1800 avant n. è. Il n’est donc pas possible de les considérer de façon catégorique comme les nouveaux détenteurs du pouvoir et des structures politiques mises en place sur le territoire de cette civilisa-tion, mais cette hypothèse fort séduisante est envisageable.
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
238
L’analyse des vestiges reconnus comme des marqueurs de pouvoir, au sein de la civilisation de l’Oxus montre, dans une perspective diachronique, qu’à l’image d’une société basée sur une hiérarchie bien affirmée à la fin du 3e et au début du iie millénaire avant notre ère, se substitue celle d’une moindre hiérarchisation apparente au cours de la phase post-urbaine entre 1800 et le milieu du iie millénaire. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure clairement à une absence ou à une faiblesse des hiérarchisations sociales au cours de la période finale, du fait de l’absence matérielle ou d’une éventuelle inadéqua-tion des critères de détermination des différenciations sélectionnés, il apparaît nettement que les manifestations de pouvoir connues à la période d’apogée disparaissent à la phase finale de cette société. Celles-ci se trouvent considéra-blement renouvelées et exprimées de manière différente. S’agit-il d’un chan-gement des structures de pouvoir en place ? Malgré le poids grandissant des groupes allochtones sur la société bactro-margienne, les mutations politiques ne sont actuellement pas discernables d’après la culture matérielle. Les modi-fications ont pu concerner une certaine élite, entraînant un changement de l’univers symbolique et des structures politiques de la civilisation de l’Oxus. Leur prise de contrôle de ces structures, ou tout au moins leur participation à celles-ci, reste sujette à de nombreux questionnements, et la poursuite des recherches est indispensable. Il apparaît cependant certain que leur présence plus importante au cours de l’Âge du Bronze final n’a pu être fortuite et sans conséquence, mais a bien dû jouer un rôle significatif dans l’évolution de la civilisation de l’Oxus.
– élise LuneauUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UMR 7041 : Archéolo-gie et Sciences de l’Antiquité. Sujet de thèse : L’Âge du Bronze final en Asie centrale méridionale (première moitié du iie millénaire avant n. è.) : la fin de la civilisation de l’Oxus. Directeur : H.-P. Francfort. Thèse soutenue le 27 novembre 2010.
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
239
Bibliographie :
Askarov A. A. et Shirinov T. (1993) – Rannjaja gorodskaja kul’tura epokhi bronzy juga Srednej Azii, FAN, Samarkand.
Avanesova N. A. (1995) – Bustan VI, une nécropole de l’Âge du Bronze dans l’ancienne Bactriane (Ouzbékistan méridional) : témoignages de cultes du feu, Arts Asiatiques, L, p. 31-46.
Avanesova N. A. et Tashpullatova N. (1999) – Simvolika ognja v pogrebal’noj praktike sapallinskoj kul’tury (po materialam issledovanija mogil’nika BustanVI), Istoricheskaja Material’naja Kul’tura Uzbekistana, 30, p. 27-36.
Bobomulloev S. (1999) – Raskopki grobnitsy bronzovogo veka na verkhnem Zeravshane, Stratum Plus, 2, p. 307-313.
Boroffka N. et Sava E. (1998) – Zu den steinernen „Zeptern/Stössel-Zeptern“, „Miniatursäulen“ und „Phalli“ der Bronzezeit Eurasiens, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 30, p. 17-113.
Cattani M. (2008) – The Final Phase of The Bronze Age and the “Andronovo Question” in Margiana, dans S. Salvatori et M. Tosi (éds.), The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana Lowlands. Facts and Methodological Proposals for a Redefinition of the Research Strategies. The Archaeological Map of the Murghab Delta Studies and Reports vol. II, Oxford, Archaeopress, p. 133-151.
Crubézy E., Lorans E., Masset C., Perrin F. et Tranoy, L. (2007) – L’archéolo-gie funéraire, éditions Errance, Collection « Archéologiques », Paris.
Francfort H.-P. (1985) – Fortifications et sociétés en Asie centrale protohisto-rique, dans J.-L. Huot, M. Yon et Y. Calvet (éds.), De l’Indus aux Balkans. Recueil à la mémoire de Jean Deshayes, éditions Recherche sur les Civilisations, Paris, p. 379-388.
Francfort H.-P. (1994a) – Fondations de Bactriane et de Margiane protohisto-riques, dans S. Mazzoni (éd.), Nuove Fondazioni nel vicino oriente antico : realtà e ideologia. Atti des colloquio 4-6 dicembre 1991, Giardini Editori e Stampatori, Pise, p. 269-297.
Francfort H.-P. (1994b) – The Central Asian dimension of the symbolic system in Bactria and Margiana, Antiquity, 68 (259), p. 406-418.
Francfort H.-P. (2003) – La civilisation de l’Asie Centrale à l’Âge du Bronze et à l’Âge du Fer, dans O. Bopearachchi, C. Landes et C. Sachs (éds.), en col-laboration avec N. Cayzal et F. Millet, De l’Indus à l’Oxus. Archéologie de l’Asie
I I I . Pouvoir et structurat ion des espaces
240
centrale. Catalogue de l’exposition, Association IMAGO-Musée de Lattes, Lattes, p. 29-59.
Francfort H.-P. (2005) – La civilisation de l’Oxus et les Indo-Iraniens et Indo-Aryens, dans G. Fussman, J. Kellens, H.-P. Francfort et X. Tremblay (éds.), Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale, Diffusion de Boccard, Paris, p. 253-328.
Ganjalin A. F. (1956) – Tekkem-Depe, Trudy Instituta Istorii, Arkheologii i Etno-grafii II, Akademija Nauk TSSR, Ashkhabad, p. 67-86.
Ionesov V. I. (1988) – Novye issledovanija mogil’nika epokhi bronzy Dzharkutan 4 B, Istoricheskaja Material’naja Kul’tura Uzbekistana, 22, p. 3-13.
Isakov A. I. et Potemkina T. M. (1989) – Mogil’nik plemen epokhi bronzy v Tadzhikistane, Sovetskaja Arkheologija, 1, p. 145-167.
Kaniuth K., Teufer M. et Vinogradova N. M. (2006) – Neue bronzezeitliche Funde aus Südwest-Tadžikistan, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 38, p. 81-102.
Kohl P. L. (1984) – Central Asia. Paleolithic Beginnings to the iron Age, éditions Recherche sur les Civilisations, Paris.
Kupper J.-R. (1959) – Le rôle des nomades dans l’histoire de la Mésopotamie ancienne, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 2 (2), p. 113-127.
Kuzmina E. E. (2007) – The Origin of the Indo-Iranians, Brill, Leiden.
Kuzmina E. E. et Mair V.H. (2008) – The Prehistory of the Silk Road, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Lawergren B. (2003) – Oxus trumpets, ca. 2200-1800 BCE : Material Overview, Usage, Societal Role and Catalog, Iranica Antiqua, 38, p. 41-118.
Luneau E. (2008) – Tombes féminines et pratiques funéraires en Asie centrale protohistorique. Quelques réflexions sur le « statut social » des femmes dans la civilisation de l’Oxus, Paléorient, 34.1, p. 131-157.
Masson V. M. (1999) – Drevnie tsivilizatsii vostoka i stepnye plemena v svete dannykh arkheologii, Stratum Plus, 2, p. 265-285.
Pottier M.-H. (1984) – Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l’Âge du Bronze, éditions Recherche sur les Civilisations, Paris.
Rossi-Osmida G. (2007) – Adji Kui Oasis. La cittadella delle statuette, Il Punto Edizioni, Venise.
Les mutat ions sociopol i t iques de la pér iode f ina le de la c iv i l isat ion de l ’Oxus
241
Sarianidi V. I. (1994) – Temples of Bronze Age Margiana : traditions of ritual architecture, Antiquity, 68 (259), p. 388-397.
Sarianidi V. I. (2002) – Margush. Ancient Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murghab River, Türkmendöwlethabarlary, Ashgabat.
Sarianidi V. I. (2006) – Royal necropolis in North Gonur, Vestnik Drevnej Istorii, 2, p. 155-192.
Sarianidi V. I. (2007) – Necropolis of Gonur, Kapon Editions, Athènes.
Sarianidi V. I. (2008) – The Palace-Temple Complex of North Gonur, Anthropol-ogy & Archeology of Eurasia, 47 (1), p. 8-35.
Shchetenko A. J. (1972) – Raskopki “Vyshki” Namazga-Depe, Uspekhi Srednezi-atskoj arkheologii, 1, Nauka, Leningrad, p. 52-53.
Testart A. (2001) – Deux politiques funéraires, Trabalhos de Antropologia e Etno-logia, 41 (3-4), p. 45-66.
Vinogradova N. M., Ranov V. A. et Filimonova T. G. (2008) – Pamjatniki Kangurttuta v jugo-zapadnom Tadzhikistane (epokha neolita i bronzovogo veka), Insti-tut Vostokovedenija RAN, Moscou.
Vinogradova N. M. et Kuzmina E. E. (1996) – Contacts between the Steppe and Agricultural Tribes of Central Asia in the Bronze Age, dans F. T. Hiebert et N. di Cosmo (éds.), Between Lapis and Jade. Ancient Cultures of Central Asia, Anthro-pology and Archaeology of Eurasia, Sharpe, New-York, p. 29-54.