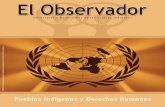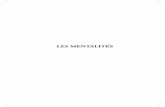Les Dossiers du Comité Asie n°2
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les Dossiers du Comité Asie n°2
Ces Dossiers sont le fruit des recherches et du dynamisme des membres du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun des membres pour leur implication et leur contribution.
Mes chaleureux remerciements vont également au Pôle Étude de l’ANAJ-IHEDN pour sa relecture méticuleuse et au Comité Directeur pour son soutien continu et effectif à nos activités.
Stéphane Cholleton, 60e session Jeunes, Lyon 2008
Responsable du Comité Asie
Abonnez-vous
Envoyez à un ami
DOSSIERS
ASIE
LES
DU
COMITÉ
ASIE
N°2
Hiver / Printemps
2012
2
Les Dossiers du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN
Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
A PROPOS DE L’ANAJ-IHEDN
Parce que la Défense ne doit pas être la préoccupation des seules Armées, le Premier Ministre a confié à l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) la mission de sensibiliser tous les citoyens, « afin de leur donner une information approfondie sur la défense nationale comprise au sens le plus large ». A l’issue de ces séminaires, les nouveaux auditeurs jeunes de l'IHEDN sont accueillis au sein de l'Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l'IHEDN : l'ANAJ-IHEDN. L'ANAJ-IHEDN, c’est aujourd'hui un réseau dédié à la défense et à la sécurité de plus de 1500 étudiants, jeunes professionnels, élus et responsables d'associations. Reconnue « Partenaire de la réserve citoyenne » par le Ministère de la Défense, l'ANAJ-IHEDN est là pour dynamiser et synthétiser une réflexion jeune, imaginative et impertinente, autour des problématiques de défense, regroupant les sphères économiques, civiles et militaires, et de relations internationales.
LE COMITÉ ASIE
Force est de constater que l’Asie a pris, notamment depuis la fin des années 1990, une part croissante dans l’économie et la politique internationale. Sur les questions des flux financiers internationaux, des ressources énergétiques, comme sur celles des revendications maritimes ou territoriales, des points chauds militaires et des grands marchés émergents, nos regards ne peuvent ignorer l’Asie. L’ANAJ-IHEDN compte parmi ses membres des personnes qui se sont plus particulièrement attachées à comprendre certains pays de ce vaste ensemble géographique. Nous avons donc voulu créer un groupe d’étude et de réflexion afin de partager, approfondir et diffuser les connaissances sur l’Asie. Le Comité Asie est ainsi né en mars 2011. Il fête, avec la parution de ce deuxième numéro des Dossiers du Comité Asie, sa première année d’existence. En 2011 nous avons, dans le cadre du Comité Asie, organisé deux conférences. Ainsi le professeur Yves Tiberghien est intervenu sur : « le rôle de la Chine dans la nouvelle gouvernance mondiale » et le Général Schaeffer sur : « la pratique chinoise du renseignement économique ». Nous avons également publié le premier numéro des Dossiers du Comité Asie et contribué au numéro 7 de la revue La Chouette consacrée à la Chine. Par ailleurs, les visites du Comité nous ont permis de découvrir ou redécouvrir ensemble, l’hôtel le Mandarin Oriental, qui a ouvert ses portes en juin 2011, le Musée Cernuschi, ainsi que l’exposition Photoquai du quai Branly. En cette année 2012, nous poursuivons nos activités de diffusion des connaissances et d’échanges sur les enjeux asiatiques. Ainsi une conférence, organisée en partenariat avec la revue Monde chinois des éditions Choiseul, autour de Mme Isabelle Facon, spécialiste de la Russie, s’est tenue le 25 janvier 2012 à l’école militaire. Elle sera suivie le 28 mars d’une conférence sur le thème : « La Chine, une menace pour nos entreprises ? » autour de Laurent Malvezin, directeur Asie chez SSF. Ce numéro 2 des Dossiers du Comité Asie est constitué de travaux réalisés par les membres du Comité Asie. Vous pourrez y lire un article de Milena Baud traitant des terres rares en Chine. Vivien Fortat explique ensuite le refus américain d’équiper Taïwan en avions de dernière génération. Vous pourrez également prendre connaissance de l’article d’Alexandre Heim, consacré à la politique chinoise de l’eau et ses implications transfrontalières avant de lire le compte rendu réalisé par Inessa Baban et Audrey Mussat de la conférence du 28 mars 2012 sur le thème : la Chine, une menace pour nos entreprises ? En vous remerciant de votre intérêt, je vous souhaite au nom du Comité Asie une très bonne lecture.
Stéphane Cholleton
N°2 Hiver / Printemps 2012 ANAJ-IHEDN Association
Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale
DANS
CE NUMERO
LES TERRES RARES EN CHINE Un enjeu Géostratégique
VENTES D'ARMES À TAÏWAN Pourquoi les Etats-Unis refusent d'équiper Taïwan en avions de chasse de dernière génération ?
LA POLITIQUE CHINOISE
DE L’EAU, une question transfrontière
LA CHINE, UNE MENACE POUR NOS ENTREPRISES ? COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 28/03/12
Les opinions
exprimées
dans les
différents
articles
n’engagent
que la
responsabilité
de leurs
auteurs.
LE COMITÉ
ASIE
Abonnez-vous
Envoyez à un ami
3
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
En septembre 2010, le Japon
arraisonne un navire de pêche
chinois en mer de Chine, au large
des îles Senkaku (ou DiaoYu en
chinois), revendiquées par les
deux pays. Si ce type d’incident
n’est pas exceptionnel dans la
région, emprise à de nombreux
contentieux territoriaux, la réponse
de Pékin était inattendue. La Chine
a en effet suspendu l’exportation
de terres rares vers le Japon,
exerçant ainsi une pression
importante sur le marché japonais.
Tokyo a fini par annoncer la
libération du capitaine chinois du
navire.
Le terme de « terres rares »
désigne un ensemble de 17
minéraux tels que le samarium, le
germanium ou encore le scandium.
Ces minéraux constituent les
matières premières essentielles à la
confection de nombreux produits,
civils et militaires à l’instar des
écrans plats, des téléphones
portables, des pigments de
peinture, des appareils de vision
nocturne ou encore des têtes de
missiles. Les terres rares sont en
effet nécessaires à la confection
des différents produits high-tech,
mais aussi des « technologies
vertes » tels que les accumulateurs
de voitures électriques. En 2010,
leur exploitation rapportait environ
1,3 milliard de dollars et devrait
atteindre les 3 milliards d’ici 2015.
Bien que ces minéraux soient
relativement répandus sur la
planète, les normes
environnementales adoptées par
l’Occident rendent leur extraction
coûteuse et très polluante. En
effet, certaines terres rares sont
présentes dans des minerais
contenant du thorium radioactif et
nécessitent, pour leur extraction,
de recourir à des techniques
onéreuses, afin d’éviter une
pollution environnementale. Ce
critère écologico-financier
constitue la principale explication
au quasi-monopole chinois en
matière de production de terres
rares. En effet, les autres pays ont
préféré réduire leur propre
production, à l’instar des Etats-
Unis, ancien grand producteur de
terres rares, qui a cessé toute
extraction en 2002, pour la confier
à la Chine, dont la législation
interne n’exige pas le respect de
ces normes environnementales.
Ainsi, alors que celle-ci n’est
assise que sur 36 % des réserves
de ces matériaux de la planète, elle
assure aujourd’hui 95 % de la
production mondiale.
UN MONOPOLE DE FAIT OU RÉSULTAT
D’UNE RÉELLE STRATÉGIE CHINOISE ? Parce que l’industrie
technologique et stratégique
mondiale repose en grande partie
sur ces matériaux, leur
exploitation est devenue un outil
géoéconomique, géopolitique et
même stratégique. Pékin l’a bien
compris et a su se rendre
indispensable sur le marché
mondial, grâce à des prix très
compétitifs du fait de coûts de
production très bas. Puis, la Chine
a graduellement décidé de
favoriser son industrie nationale,
aux dépens de l’Occident1. Fin
2010, Pékin annonce une
réduction de plus de 10 % de ses
exportations de terres rares pour
2011, à travers la mise en place de
quotas et de droit d’exportations.
En mai 2011, le champ de ces
quotas et taxes d’exportation est
élargi aux alliages contenant au
minimum 10 % de terres rares.
Pékin a donc, dans un premier
temps, su détruire la concurrence
des autres pays grâce à de faibles
coûts de production.
LES TERRES RARES EN CHINE, UN ENJEU GÉOSTRATÉGIQUE
Pays Production
(en % mondial)
Réserves
(en % des réserves mondiales)
Australie 0 5
Brésil 0,5 0,05
Chine 95 36
Communauté des Etats
Indépendants (ex-URSS) 2 19
États-Unis 0 13
Inde 2 3
Malaisie 0,3 0,03
Autres 0 22
Répartition mondiale des réserves de terres rares et leur production Source : US Geological Survey-2009
4
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
1 Le taux d’exportation de la production de terres rares chinoises est passé de 75% au début
des années 2000 à 25 % en 2010. 2La Chine avait adopté la même stratégie vis-à-vis de la production de panneaux solaires. Elle cherche aujourd’hui à racheter ses concurrents occidentaux aux technologies plus avancées. 3 Terme utilisé par les Etats-Unis dans leur plainte déposée à l’OMC. 4La Chine a perdu en appel devant l'OMC mais la décision ne couvre pas les terres rares. « Pékin n’est juridiquement pas obligé d’appliquer la décision de l’OMC à ces métaux de terres rares, ni à aucune matière première autre que les neuf mentionnées : bauxite, coke, spath fluor, magnésium, manganèse, carbure de silicium, silicium métal, phosphore jaune et zinc. » Cf 5 Le revenu par habitant est, en Chine, 10 fois inférieur à celui des Japonais. 6 “Chinese Government Wins Initial Success in Fight to Protect Tungsten, Antimony, and Rare Earth Elements”, Chinese Government Net, 7 mai 2009. 7 The New York Times, 14 janvier 2010.
Le monopole ainsi instauré, les
autorités ont ensuite appliqué des
mesures restrictives en matière
d’exportation. Celles-ci visant à
attirer les groupes étrangers en
Chine et ainsi acquérir les
technologies de transformation, et
autres technologies avancées, qui
lui font défaut, dans des secteurs
industriels que le gouvernement
définit comme prioritaires2. Car
extraire les terres rares du sol ne
suffit pas, encore faut-il savoir les
exploiter.
La stratégie chinoise semble avoir
fonctionné. De nombreux
exploitants occidentaux de terres
rares se sont installés en Chine, à
l’image du français Rhodia, leader
mondial de la métallurgie et de la
purification des terres rares,
présent en Chine depuis 2000.
Cette présence lui offre accès aux
terres rares à des prix plus
abordables.
Ces mesures chinoises, que les
officiels justifient par les
conséquences sur
l’environnement, ont néanmoins
entraîné de fortes réactions en
Occident. Les Etats-Unis, le
Mexique et l’Union européenne
ont saisi, fin 2009, l’organe de
règlement des différends de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Ce dernier a
reconnu, début juillet 2011, une
« distorsion de commerce »3 qui
permet aux entreprises chinoises
de bénéficier de prix plus
compétitifs et qui entraînerait une
envolée des prix des matières
premières sur le marché mondial.
Pékin a annoncé le 24 août qu’il
ferait appel4. Il pourrait
notamment invoquer l’article 20
de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce qui
autorise les pays à limiter leurs
exportations pour des raisons
spéciales, telle que la préservation
de l’environnement. C’est sans
doute la raison pour laquelle les
autorités chinoises mettent
l’accent sur les conséquences
écologiques de l’exploitation des
terres rares.
DE NÉCESSAIRES MESURES
INTERNES AUX CONSÉQUENCES
INÉLUCTABLES SUR LE MARCHÉ
MONDIAL Ces préoccupations écologiques
avancées par la Chine pourraient
ne pas être qu’un prétexte de
façade. En effet, au-delà de l’outil
géoéconomique et stratégique,
l’industrie des terres rares
constitue un enjeu interne majeur
pour le pays. Il ne faut pas oublier
qu’il demeure un pays émergent5
qui se doit d’assurer son expansion
économique et de protéger ses
ressources naturelles. Les terres
rares étant présentes dans la
plupart des produits de haute
technologie, la stratégie de Pékin
vise également à pouvoir alimenter
son marché intérieur.
Or, les défis internes sont réels. En
2009, le gouvernement chinois
s’inquiétait d’un épuisement des
ressources du pays6, faute de
régulation adéquate en matière
d’extraction des terres rares. La
Chine a pris conscience des
conséquences environnementales.
Les substances chimiques utilisées
par les mineurs chinois pour
l’extraction des terres rares
finissent en effet par s’infiltrer
dans le sol et détruisent rizières et
exploitations piscicoles. Les
compagnies minières chinoises
cherchent donc à développer leur
activité hors de Chine. Certains
exploitants espèrent ainsi ouvrir
des mines au Canada, en Afrique
du Sud (ancien pays exploitant) ou
encore en Australie.
Le manque de régulation entraîne
également une exploitation
anarchique des ressources. Selon
Stephen G. Vickers7, ancien chef
du service d’investigations
criminelles de la police de Hong
Kong, la majeure partie du secteur
minier chinois est contrôlé par un
réseau mafieux, soutenu par les
hauts fonctionnaires locaux.
Certains industriels affirment
même que seule la moitié des
exploitations minières du pays
serait légale.
En février 2010, le gouvernement
chinois a donc autorisé la société
BaoTou Steel Rare Earth,
contrôlée par l’Etat, à créer une
réserve stratégique de terres rares.
5
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
8 Aux Etats-Unis, le département de l’Energie a également présenté, début 2012, un
rapport reposant sur 3 piliers : diversifier les approvisionnements, développer des substituts et encourager le recyclage et la réutilisation. 9 Les piles rechargeables 1,2 V d'usage courant sont généralement des accumulateurs NiMH. Ils contiennent environ 7 % de terres rares. Leur avantage en matière d'environnement est l'absence de cadmium et de plomb, mais leur énergie massique est inférieure à celle des piles Li-ion. 10 Créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, l'OPECST a pour mission d'informer le
Parlement français des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions [NdE].
Celle-ci, portant sur 10 sites de
stockage, représenterait plus de 1,5
fois la production mondiale.
En septembre dernier, Pékin a
également annoncé la fermeture de
31 compagnies d’extraction et la
nationalisation de 4 autres, toutes
regroupées au sein de l’entreprise
d’Etat BaoTou. On peut supposer
que ce monopole étatique assurera
l’approvisionnement du marché
intérieur et contribuera à réduire
l’influence de la mafia puisque
tout le commerce sera entre les
mains de l'Etat.
DES ALTERNATIVES AU MONOPOLE
CHINOIS, POUR UNE ÉMANCIPATION
OCCIDENTALE ? Comme le souligne E. Bustraen,
directeur général de Rhodia Silcea,
« plus sa politique est restrictive,
plus il devient intéressant de
développer des projets hors de
Chine ». Dès lors, les dirigeants et
industriels occidentaux tentent de
s’émanciper des terres rares
chinoises bon marché. Selon le
bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM), environ 300
sociétés font de l’exploration de
terres rares à travers le monde.
Une vingtaine de projets
pourraient être suffisamment
avancés pour entrer en production
au cours des cinq prochaines
années. Deux d’entre eux sont déjà
en quasi production, aux Etats-
Unis et en Australie.
Le recyclage est également une
alternative sérieuse, notamment en
Europe8. En 2011, Rhodia a ainsi
annoncé la mise au point d’un
procédé de récupération et de
séparation des terres rares,
contenues dans les lampes basse
consommation usagées. Umicore a
également développé un procédé
de recyclage des terres rares
contenues dans les accumulateurs
nickel-hydrure métallique
(NiMH)9. Dans le cadre du projet
MORE (motor recycling), Siemens
AG dirigera un consortium
d’entreprises et d’instituts de
recherche sur le recyclage des
moteurs électriques.
Récupérer les terres rares
présentes dans les produits finis
nécessite cependant des techniques
dispendieuses, car l’accès et
l'extraction des métaux sont
malaisés. Le recyclage ne saurait
constituer une alternative sérieuse
à la production des terres rares,
que si la conception des produits
tient compte de la nécessité de
récupérer les métaux en fin de vie.
Cependant, le 23 août 2011,
l’Office parlementaire
d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques10
publiait un rapport, dans lequel il
soulignait les limites du
recyclage : certains usages, dits
dispersifs (cosmétiques, encres,
colorants etc.), interdisent le
recyclage, et la présence de ces
minéraux dans certains alliages est
trop faible pour qu'une extraction
soit rentable. Les parlementaires
invitent donc à étudier les
possibilités de substitution de ces
minéraux.
Par ailleurs, le 30 mars 2011, le
ministre français chargé de
l’Industrie, de l’énergie et de
l’économie numérique annonçait
la création du comité pour les
métaux stratégiques (COMES). Il
s’agit d’une instance de dialogue
entre ministères, établissements
publics et fédérations d’entreprises
et professionnelles, dont le but est
de soumettre des propositions aux
pouvoirs publics, en vue de
sécuriser l’approvisionnement en
métaux stratégiques des industriels
français.
Face aux restrictions de Pékin, les
pays occidentaux ont donc dans un
premier temps, étudié des
alternatives au monopole chinois,
pour répondre à ce qu’ils ont perçu
comme une stricte offensive
stratégique. Néanmoins, comme
nous venons de le voir, les
difficultés de la Chine en la
matière sont réelles.
Les mesures prises ne peuvent se
réduire à une simple stratégie
commerciale et ont conduit les
pays occidentaux à s’interroger sur
leur propre utilisation des terres
rares. Aussi, trouver des moyens
de substitution à ces matériaux
stratégiques pourrait constituer
l’enjeu majeur des années à venir.
Par Milena BAUD 73
e session, Paris 2012
Étudiante en Master de Sciences Politiques à l’Université Libre
de Bruxelles
6
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
VENTES D'ARMES À TAÏWAN POURQUOI LES ETATS-UNIS REFUSENT D'ÉQUIPER TAÏWAN
EN AVIONS DE CHASSE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION ?
Taïwan (ou République de Chine -
ROC en anglais) négocie
actuellement la modernisation de
sa flotte d'avions de combats
auprès des États-Unis. Le souhait
du gouvernement taïwanais est
d'acquérir 66 F16 de dernière
génération (modèles F16 C/D),
tandis que les Américains ont
formulé une offre comprenant des
équipements et matériels pour
améliorer 145 modèles de la
génération précédente (F16 A/B).
A l'inverse, les États-Unis ont signé
une promesse de vente de 24 F16
C/D avec l'Indonésie lors de la
tournée automnale du président
Obama en Asie-Pacifique.
Pourquoi une telle différence de
traitement, en la défaveur de
Taïwan qui est pourtant un des
alliés historiques de Washington
dans la région ?
La politique des États-Unis à
l'égard de Taïwan est régie par le
Taiwan Relations Act (TRA). Ce
traité signé le 10 avril 1979, sous la
présidence Carter, fut créé suite à
l'établissement de relations
diplomatiques entre la République
Populaire de Chine (R.P.C., ou
encore, la Chine) et les États-Unis ;
cette reconnaissance a entraîné par
conséquent l'arrêt de la
reconnaissance de Taïwan. En
matière de défense, ce traité inclut
une close imposant aux États-Unis
« d’approvisionner Taïwan en
armes à caractère défensif » et de
« maintenir la capacité des États-
Unis de résister à tout recours à la
force ou autres formes de
coercition qui compromettrait la
sécurité, la société ou l'économie,
du peuple de Taïwan ». Nous
allons ici nous concentrer sur le
premier point (appui via la vente
d'armes).
Depuis 2002, et malgré les
restrictions budgétaires imposées
au Ministère de la défense depuis
l'élection de Ma Ying-Jeou,
candidat du Kuomingtang (KMT,
parti favorable à un rapprochement
avec la Chine depuis le milieu des
années 90), Taïwan a été le 4ème
acheteur mondial d'armes
américaines (après Israël, l'Arabie
Saoudite et l’Égypte), avec un
montant total des achats s'élevant à
près de 11 milliards USD. Taïwan
est donc historiquement un des plus
importants clients de Washington
en matière d'armement.
Deux causes principales expliquent
le refus actuel des Américains de
satisfaire la demande de Taïwan
concernant les F16 C/D : la volonté
d'une amélioration (ou du moins
d'une « non dégradation ») des
relations sino-américaines et
surtout, la nature parfois ambiguë
des relations sino-taïwanaises.
TAÏWAN, UNE QUESTION SENSIBLE
DANS LES RELATIONS
DIPLOMATIQUES SINO-AMÉRICAINES La Chine est, encore plus peut-être
que tout autre pays, très attachée à
son intégrité territoriale suite au
dépeçage de celui-ci par les
puissances européennes au 19ème
siècle puis, au 20ème
siècle, par le
Japon. Considérant Taïwan comme
une de ses provinces, elle s'oppose
vivement à toute vente d'armes à
cette dernière, au même titre qu'à
tout ce qui pourrait laisser penser
que l'île n'est pas sous l'autorité de
la R.P.C. A cela s'ajoute le fait que
plusieurs désaccords existent entre
Taïwan et la R.P.C. au sujet de
certaines îles (et surtout des fonds
sous marins et des zones maritimes
associés, potentiellement riches en
ressources minières !). Washington
est donc accusé de soutenir
l'occupation illégale (du point de
vue de Pékin) de certaines parties
du territoire chinois en vendant des
armes à ses « occupants », accusés
de tendances séparatistes (dans la
phraséologie pékinoise). Enfin,
Pékin voit d'un mauvais œil le
soutien trop marqué des
Américains auprès de pays du front
pacifique, dans la mesure où,
toujours selon Pékin, ceux-ci
pourraient être utilisés comme
satellites pour toute mesure visant à
entraver l'accès de la Chine à
l'Océan Pacifique (et aux routes
commerciales maritimes).
TAÏWAN, PORTE D’ENTRÉE SUR
LA CHINE OU DE LA CHINE ? Néanmoins, il serait trop aisé de
limiter le problème à la position
chinoise sur la question taïwanaise.
En effet, les États-Unis équipent
bien en avions de combat de
dernière génération d'autres pays
avec lesquels la Chine a des
relations parfois tendues comme la
Corée du Sud ou, plus encore, le
Japon (sous licence, via un
partenariat Lockeed Martin –
Mitshubishi). Le poids symbolique
de Taïwan n'explique pas à lui seul
le refus actuel de vente de F16 C/D
à l'île. Ce qui pose problème aux
Américains, ce sont les relations
parfois troubles existant entre
certaines sphères ou individus
taïwanais et la Chine.
7
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
En effet, tous les ans sont arrêtés à
Taïwan des hauts gradés militaires
ou des personnes ayant eu accès à
des informations techniques ou
stratégiques sensibles, pour
espionnage au profit de Chine11
.
Les moyens employés sont
classiques (compromissions,
corruptions...) mais très efficaces ;
la Chine a déjà bénéficié à
plusieurs reprises de ces méthodes
pour récupérer des informations
techniques détaillées ou des
informations sur les capacités
d'armements américains, dont elle
reste loin de maîtriser la
technologie. Washington et les
industriels américains doutent
donc de la capacité taïwanaise à
imposer un hermétisme sur ses
secrets militaires et refusent ainsi
de vendre à l'île certains
armements sur lesquels la
technologie chinoise est en retard
par rapport à celle des pays
occidentaux.
LA CHINE VAINQUEUR QUOI QU’IL
ARRIVE ? On comprend donc ici que la
Chine joue un double jeu
diplomatique, gagnant à tous
coups. Coté pile, il consiste à
accuser les États-Unis d'ingérence
dans les affaires intérieures de la
Chine, de tentative d'atteinte à son
intégrité territoriale, et d'appliquer
des sanctions aux Américains en
guise de représailles (ex : la
suspension des discussions
militaires de haut niveau).
Cependant, coté face, Pékin a tout
intérêt à ce que les ventes d'armes
de dernière génération à Taïwan se
poursuivent du fait des capacités
de « transferts de technologies »
que le régime communiste possède
sur l'île (N.B. : il serait toutefois
injuste de ne pas reconnaître les
efforts des Taïwanais pour traquer
les espions/informateurs
prochinois, particulièrement au
sein de l'armée). En effet, les coûts
de recherche et développement
dans l'industrie de l'armement sont
extrêmement élevés ; ce procédé
permet donc à Pékin de réaliser
d'importantes économies d'argent
et de temps.
Cette posture permet également de
mettre les États-Unis dans une
situation inconfortable à l'égard de
ses alliés dans la zone Asie-
Pacifique. En effet, pour ne pas
froisser les Taïwanais en les
accusant de ne pas garantir la
protection des secrets militaires,
les Américains ne révèlent pas la
cause principale du refus de vente
d'armements de dernière
génération à l’un de ses alliés
essentiels. Washington apparaît
ainsi publiquement comme un
pays ne tenant pas ses
engagements vis à vis de ses alliés,
au titre du TRA signé avec
Taïwan, dans le but de ne pas se
fâcher avec la Chine ; ce pays
censément protecteur envoie donc
un signal très négatif à ses alliés
dans le Pacifique (Japon et Corée
du Sud, notamment, mais aussi
dans son propre pays où la
situation est parfois mal comprise.
Ainsi, un groupe de sénateurs
(emmené par le républicain John
Cornyn) fait actuellement pression
auprès du président Obama pour
que cette vente d'arme soit
réalisée, afin de prouver que les
États-Unis sont prêts à ne pas
« abandonner ses amis face aux
tactiques d'intimidation de la
Chine Communiste ».
Par Vivien FORTAT
296ème session sécurité
économique et protection du
patrimoine, septembre 2011
Docteur en Science Économique
11 Il est important de préciser que Taïwan fait ici référence à l'île principale de la république
de chine ainsi qu'aux îles Penghu. En revanche, d'autres territoires revendiqués par Taïwan, tels que Jinmen, les Matsus, ou encore l'île de Taiping (au cœur des conflictuels îles Spratlay), ne sont pas inclus dans le TRA.
8
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
Cet article fait suite à l’article du
même auteur L’eau, source de
stress pour la Chine paru dans le
n°7 de La Chouette, en septembre
2011.
Avec 6 à 7 % des ressources
mondiales annuelles, la Chine est
le cinquième pays de la planète le
mieux doté en eau. Cependant ces
ressources sont inégalement
réparties sur le territoire. Une
grande partie est itinérante et
forme des cours d’eau importants
dont certains fluent ensuite vers
d’autres pays. Ces ressources sont
donc partagées. Alors que le droit
international régissant le partage
des eaux est relativement évasif et
peu contraignant, la politique
chinoise de l’eau est avant tout
guidée par des considérations
strictement internes. Tant qu’elle
est présente sur le territoire
national, la ressource est librement
utilisée, sans coordination ou
gestion intégrée au niveau
régional.
Comme le disait en 1996 Jacques
Sironneau dans L’eau, Nouvel
enjeu stratégique mondial, les
grandes campagnes de contrôle
des eaux sont un moyen d’affirmer
la puissance d’un Etat au niveau
national et régional. Or de
nombreux fleuves internationaux
majeurs d’Asie naissent en
territoire chinois avant de
continuer leurs cours vers d’autres
pays en aval. Tout aménagement
de ces fleuves a donc
inévitablement des répercussions
sur leurs flux, leurs débits et donc
les pays d’aval. Ainsi les pays
d’aval du Mékong (Birmanie,
Laos, Thaïlande, Cambodge,
Vietnam), du Salouen (Birmanie),
du Brahmapoutre (Inde,
Bangladesh), de la Sutlej (Inde,
Pakistan), de l’Ili et l’Irtych
(Kazakhstan, Russie) et de
l’Amour (Russie) s’inquiètent de
l’accroissement rapide des projets
d’aménagement chinois de ces
fleuves ces dernières années. De
plus l’Asie est une région déjà
naturellement sensible aux
caprices et aléas du ciel. Les
inondations et sécheresses
majeures de ses dernières années
nous donnent un aperçu de
l’avenir climatique de l’ensemble
de la région, sans compter sur le
recul notable des glaciers
himalayens.
LA MAUVAISE GESTION
DES RESSOURCES, CAUSE PREMIÈRE
DE LA PÉNURIE D’EAU
Le contrôle de l’eau a toujours été
central dans la perception chinoise
de sa sécurité, depuis
l’endiguement multimillénaire des
fleuves Jaune et Yang Tsé
jusqu’aux destructions volontaires
de barrages afin d’ennoyer les
armées japonaises en marche
pendant le Second conflit mondial.
Le contrôle et l’utilisation
discrétionnaire des cours d’eau
présents sur le territoire est donc
un déterminant essentiel de la
vision chinoise de son
hydropolitique. Cette vision a
amené les Chinois, depuis les
années 1950 et le retour à l’unité
nationale, à utiliser l’eau sans
vision à long terme. Ainsi, outre la
surexploitation qui assèche
dramatiquement les lacs et
rivières, l’extrême pollution d’une
bonne partie des cours d’eau
chinois rend aujourd’hui le quart
des eaux de surfaces du pays
impropres pour tout usage, selon
une étude de l’Agence nationale
pour la protection de
l’environnement en 2010. Pékin
cherche désormais à
s’approvisionner à partir de
sources plus propres et abondantes
mais également plus lointaines et
traditionnellement inutilisées par
les Chinois. Ces sources incluent
des cours d’eau transfrontaliers
naissant en territoire chinois. De
ce fait les équilibres hydriques
traditionnels risques d’être
bouleversés, les pays riverains
voyant là une menace directe
contre leur sécurité.
Bien que le point commun dans la
relation entre la Chine et ses
différents voisins au sujet du
partage des grands fleuves naissant
en territoire chinois soit la façon
dont les Chinois utilisent ces cours
d’eau, chaque cas porte sur des
points de conflits particuliers.
Alors que le différend qui l’oppose
à la Russie sur le fleuve Amour
touche principalement aux
pollutions industrielles, avec
l’Inde les tensions portent
d’avantage sur les risques que font
peser la construction de nombreux
barrages sur le Brahmapoutre côté
chinois. Les tensions entre la
Chine et ses voisins portent sur
trois menaces contre la viabilité de
ces ressources : la pollution, le
besoin en irrigation et le
développement de
l’hydroélectricité. A cela s’ajoute
bien sûr la vision politique
régionale chinoise à long terme.
LA POLITIQUE CHINOISE DE L’EAU, UNE QUESTION TRANSFRONTIÈRE
9
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
BESOINS INTERNES ET DIFFÉRENDS
INTERNATIONAUX En effet, dans les régions du nord-
est chinois, à proximité de la
frontière avec la Fédération de
Russie, la présence d’importants
gisements de pétrole chinois ainsi
que d’usines de raffinage induit
une forte pollution chimique, qui
se déverse dans la rivière Songhua,
principal affluent du fleuve
Amour. Les accidents et
déversements criminels de
polluants y sont fréquents, comme
en novembre 2005 avec le
déversement de 100 tonnes de
benzène dans la Songhua ayant
privé les riverains d’eau potable
pendant 5 jours, tant côté chinois
que russe. Après qu’une forte
mobilisation anti-chinoise ait alors
embrasé l’opinion russe, une
commission environnementale ad
hoc russo-chinoise a été créée pour
se pencher sur l’état écologique
des cours d’eau frontaliers.
Depuis, plusieurs accords de
coopération russo-chinois ont été
signés afin de favoriser l’échange
d’informations et la coopération
scientifique en matière de
pollution aquatique sur l’Amour.
Ici, l’intérêt supérieur du
partenariat stratégique entre
Russes et Chinois a permis de
mettre en place ce cadre
institutionnalisé pour canaliser le
différend. Ce qui n’est pas le cas
avec les autres voisins de la Chine.
Avec le Kazakhstan la relation est
différente. Les rivières majeures
que sont l’Ili et l’Irtych, chacune
drainant son propre bassin versant,
sont les principaux cours d’eau de
la Région Autonome du Xinjiang,
exception faite du fleuve
endoréique Tarim, qui est
aujourd’hui presque entièrement
asséché. Mais ils sont également
les principaux cours d’eau de l’est
du Kazakhstan, là où se trouve le
cœur industriel du pays, ainsi
qu’ancienne et nouvelle capitales.
Or côté chinois, le programme de
développement de l’Ouest, initié
en 2001, voit ces deux cours d’eau
comme indispensable à l’essor
économique de la région. En effet,
le désertique Xinjiang est
aujourd’hui la première division
administrative productrice de
coton au monde. Mais pour ce
faire, la culture intensive requiert
de grands besoins en irrigation.
Aussi des travaux de dérivations
sur les rivières Ili et Irtych ont été
initiés. Les autorités chinoises ont
annoncé dès 2005 leur intention de
prélever jusqu’à 20% des eaux de
l’Irtych lorsque le projet sera
complété en 2020. En position de
faiblesse, le voisin Kazakh peine à
faire valoir ses intérêts en la
matière. D’autant plus que ce
dernier cherche à diversifier ses
clients pour son pétrole et son
uranium, ressources qui intéressent
au plus haut point l’industrie
chinoise.
Face aux pays de la péninsule
indochinoise également la Chine
bénéficie de sa puissance pour agir
en toute impunité. Ici le fleuve
Mékong est perçu par Pékin pour
son gigantesque potentiel
hydroélectrique. Les superbarrages
y fleurissent d’ailleurs ces
dernières années. Le projet
d’aménagement chinois du
Mékong comporte une série de
huit barrages en cascade le long du
fleuve dans la province du
Yunnan. Quatre sont déjà
complétés, dont le barrage de
Xiaowan, plus haut barrage arqué
au monde et le second générateur
hydroélectrique de Chine après le
barrage des Trois Gorges. Cette
multiplication des ouvrages et des
lacs artificiels de retenue
inquiètent les Etats d’aval que sont
la Birmanie, le Laos, la Thaïlande,
le Cambodge et le Vietnam. En
effet la multiplication des ouvrages
risque à terme de perturber
profondément le rythme de vie du
fleuve et son débit. Or pour les
populations riveraines du fleuve,
celui-ci représente le garde-
manger12
et la principale voie de
communication. Sans le Mékong
c’est toute l’activité économique
de la région qui est menacée. De
plus, chacun des Etats de la
péninsule élabore ses propres
stratégies de développement et
établit ses propres plans
d’aménagement du fleuve. Malgré
la création de la Mekong River
Commission en 1995, la désunion
est totale. Ce qui renforce d’autant
plus la position de la Chine, qui
elle traite en bilatéral avec chacun,
propose ses services et son
expertise technique, accroissant les
oppositions des petits entre eux.
Avec l’Inde, le différend porte
également sur des projets de
barrages hydroélectriques, mais
sur le fleuve Brahmapoutre. Ce
fleuve, dénommé Fils de Brahma
en sanskrit, est un des plus
importants cours d’eau d’Asie, et
le principal de l’extrême-est
indien. Il se jette ensuite dans le
Gange, avec lequel il forme le plus
grand delta au monde. Ce fleuve
traverse la région disputée de
l’Arunachal Pradesh, objet d’une
guerre entre les deux géants en
1962. Ce différend territorial
n’étant toujours pas résolu, la zone
constitue un point d’achoppement
majeur entre les deux. Or les
projets chinois et les réalisations
en matière d’aménagements
hydroélectriques sur le
Brahmapoutre ne manquent pas de
susciter de vives craintes côté
indien. Le risque est de voir le
débit du fleuve diminuer
considérablement, surtout pendant
les périodes les plus sèches,
lorsque le besoin en irrigation se
fait le plus ressentir.
10
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
Autre crainte, celle de voir les
Chinois détruire les barrages alors
construits pour ennoyer toute la
vallée en cas de conflit, ou
d’utiliser cette épée de Damoclès
comme moyen de pression. Enfin,
les projets chinois de dérivation de
certains cours d’eau vers le nord
du pays, asséché et aux ressources
hydriques surexploitées13
,
pourraient inclure le
Brahmapoutre dans son cours
tibétain, ce qui en diminuerait le
débit à terme.
L’INTÉRÊT NATIONAL AVANT TOUT Fidèle à sa vision très réaliste de
l’ensemble de sa politique interne
et étrangère, la Chine
d’aujourd’hui, en quête de
rayonnement international mais
également de stabilité interne,
définit sa politique de l’eau en
suivant des considérations
strictement nationales. Ses choix
d’aménagement du territoire ne
prenant pas en compte les besoins
des Etats voisins, les équilibres
historiques sur lesquels se sont
fondées les réalités géopolitiques
actuelles risquent à l’avenir d’être
bouleversés. Des zones entières de
l’Extrême-Orient seraient alors
touchées par les perturbations du
rythme de vie naturel des fleuves,
accentuées par les incertitudes
climatiques du siècle à venir. Et
alors que la relation entre la Chine
et ses voisins passe désormais par
le partage raisonné des ressources
en eau, une régulation
supranationale de l’utilisation de
ces ressources partagées fait
défaut. Guidée par de pures
considérations internes, les
déterminants principaux de la
politique chinoise de l’eau
s’intègrent à la relation historique
et l’évolution régionale souhaitée
par Pékin, autrement dit l’assise de
son nouveau statut reconnu de
première puissance régionale
asiatique.
Par Alexandre HEIM
Séminaire Master 2 « Sécurité-
Défense », mars 2009
Diplômé en Relations
Internationales/Etudes Stratégiques
Université Paris Nord
12 Le Mékong est le premier site de pêche en eau douce au monde
13 Voir l’article L’eau, source de stress pour la Chine paru dans le n°7 de La Chouette en septembre 2011
11
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
Conférence autour de M. Laurent
Malvezin, Directeur Asie de
Scutum Securty First (SSF)
Le titre de cette conférence est
intentionnellement « provocateur »
selon l’intervenant Laurent
Malvezin, Directeur Asie chez
Scutum Security First (SSF) dont
l’objectif majeur est de casser les
clichés sur la Chine qui est
souvent perçue comme une
menace pour les entreprises
françaises. Or, les réalités sont
beaucoup plus complexes et
exigent une analyse plus nuancée ;
il importe également de regarder la
Chine sous l’angle des oppor-
tunités que son marché représente
et des succès que connaissent
certaines entreprises françaises
implantées sur le territoire chinois.
De plus, le mot « menace » n’est
pas approprié lorsqu’on parle du
monde entrepreneurial parce qu’il
est plutôt du ressort de l’Etat. En
revanche, la notion de « risque »
est tout à fait pertinente en raison
de son caractère quantifiable et
mesurable. Par conséquent,
l’intervenant se propose de traiter
de manière successive les notions
de « menace chinoise », puis de «
risque chinois » avant de se
concentrer sur l’évaluation même
du risque chinois.
QUELLE MENACE CHINOISE ? Une compréhension préalable de
l’environnement chinois est abso-
lument nécessaire à l’entreprise
souhaitant s’implanter en Chine. Il
faut prendre conscience de
certaines caractéristiques d’ordre
organisationnel et politique,
spécifiques à la Chine. Celles-ci
sont importantes à intégrer, afin
d’affiner la compréhension du
pays et ne pas tomber dans les
clichés. Par exemple, l’Occident
parle du 12ème plan quinquennal
chinois, tandis qu’une centaine de
plans existent. On en distingue un
par province, plusieurs par
industries ou par segments (un
plan pour les pneus, etc.). En bref,
chaque secteur d’activité, chaque
industrie dispose d’un plan propre,
d’une feuille de route roulante («
Rolling road map »). Cette réalité
doit nécessairement être prise en
compte par les entreprises fran-
çaises envisageant de s’installer en
Chine.
Ensuite, les considérations d’ordre
politique ne sont pas moins
importantes que celles
organisationnelles. La période
actuelle semble être marquée par
un tournant politique à la tête du
pays où, outre Xi Jinping qui va
selon toute vraisemblance prendre
la place de Hu Jintao, 7 des 9
membres du Comité Central vont
être remplacés dans un futur
proche. Il ne faut pas tomber dans
le cliché selon lequel le système
politique chinois serait nettement
divisé en deux factions, les
conservateurs et les libéraux, ni
s’imaginer que ce changement au
sein de l’élite dirigeante aura des
implications immédiates pour les
entreprises. La véritable rupture
générationnelle de l’avant/après
révolution culturelle - matérialisée
par l’arrivée au pouvoir des post-
70 n’est estimée avoir lieu qu’aux
environ de 2020. Ce changement,
en revanche, est susceptible
d’avoir des implications concrètes
pour les entreprises à long terme.
Il convient donc, pour tout
entrepreneur, de se tenir informé
de l’actualité chinoise afin d’éviter
les erreurs de jugement et
d’appréciation, et réduire le risque
encouru par l’entreprise.
LE RISQUE CHINOIS L’ignorance et la méconnaissance
du contexte politique chinois ; la
mauvaise perception du risque
bilatéral ; le manque de prise en
compte de l’importance de l’œuvre
sociale chez les entreprises
chinoises ; et enfin, l’incompré-
hension de la marge de manœuvre
entre les lois et leurs applicabilités
sur le terrain, sont autant de
facteurs constituant le « risque
chinois ».
L’entreprise française souhaitant
s’installer en Chine est essentiel-
lement confrontée à deux types de
risques. D’un côté, il s’agit du «
risque concurrentiel » lorsqu’elle
devient une « cible » de
l’entreprise chinoise. Or, si la
machinerie chinoise n’est pas par-
faitement prévisible, les ambitions
commerciales le sont totalement.
A présent, la Chine bénéficie d’un
développement technologique
capable d’assurer la montée en
puissance de son industrie. Dès
lors, nous assistons à une montée
en puissance de l’entreprise chi-
noise qui se fixe un certain nombre
d’objectifs ambitieux, à plus ou
moins long terme (ex. s’intégrer à
la stratégie des marques et des
brevets d’ici 2010-2020). Face à
de telles prétentions, les entre-
prises françaises devront affronter
le durcissement de certains
domaines. D’un autre côté, il y a le
« risque du marché » lorsque le
manque de repères empêche
l’entreprise d’évoluer confortable-
ment dans l’environnement
chinois.
La Chine, une menace pour nos
entreprises ? Compte rendu de la conférence du 28/03 /12
12
Les Dossiers du Comité Asie de
l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
Pour contourner ces risques, les
entreprises françaises qui s’instal-
lent en Chine pourraient adopter
deux types de solutions. D’un côté,
il s’agit pour l’entreprise française
de chercher à mieux s’adapter à la
concurrence parfaitement organi-
sée de la Chine, souvent qualifiée
de « machine à fabriquer de
nouveaux intervenants ». D’un
autre côté, il s’agit de la nécessité
d’approfondir les connaissances au
sujet de l’environnement chinois
dont la méconnaissance explique
d’ailleurs le manque de visibilité
des PME sur le marché chinois.
L’absence de presse d’inves-
tigation en Chine témoigne d’un
marché officieux de l’information
local. Et pourtant, cela ne veut pas
dire que la Chine est une « boite
noire » car il y a des cabinets
privés dont les services facilitent
l’accès aux informations utiles
pour les entrepreneurs.
CONCLUSION Nos gouvernements doivent
éviter de considérer que le marché
chinois va nécessairement
converger avec les autres modèles
économiques dans son mode de
pénétration des marchés en raison
de ses particularités. Dès lors, la
connaissance affinée de l’acteur
chinois est vitale. Le Livre Blanc
de 2006 sur les investissements
français en Chine – l’un des rares
documents officiels à traiter de ce
sujet – résume brillamment les
trois grandes difficultés que les
entreprises françaises doivent
affronter lors de leur installation
en territoire chinois - à savoir la
gestion des Ressources Humaines,
la protection de la propriété
intellectuelle, et la connaissance du
partenaire chinois.
LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DU COMITE ASIE
DE L’ANAJ-IHEDN
12 avril, conférence autour
de Sébastien Colin, dans le cadre
des Rencontres du Comité Asie
sur le thème :
« La Chine et ses frontières »
Cette conférence se tiendra
à l’Institut de Géographie,
191 rue Saint-Jacques, 75005
de 18h00 à 20h00.
9 mai, conférence autour
d’Emmanuel Lincot et Guillaume
Giroir sur le thème :
« La Chine et le luxe »
Cette conférence se tiendra à l’École
militaire, amphithéâtre Desvallières,
de 19h30 à 21h00
Le prochain numéro des
Dossiers du Comité Asie
paraîtra à l’automne 2012.
Pour rejoindre le Comité Asie, merci
de nous adresser votre demande à :
Par Inessa BABAN, Séminaire Master II
Défense & Sécurité 2008 et Doctorante en Géopolitique à Sorbonne-Paris
Audrey MUSSAT, Étudiante de Relations Internationales à l’ILERI