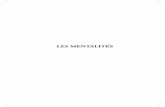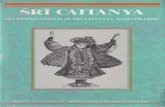Curriculum Vitae Europass - ICCU - Istituto Centrale per il ...
Techniques de metallurgie des alliages cuivreux en Asie Centrale meridionale, Mémoire de Master 1
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Techniques de metallurgie des alliages cuivreux en Asie Centrale meridionale, Mémoire de Master 1
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Histoire de l’art et Archéologie (UFR03)
MEMOIRE DE MASTER 1 « RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE »
TECHNIQUES DE METALLURGIE DES
ALLIAGES CUIVREUX EN ASIE CENTRALE
MERIDIONALE A L ’AGE DU BRONZE
Présenté et soutenu en juin 2013 par
Charly POLIAKOFF
Sous la direction de Guillaume Gernez, Maître de conférences à Paris 1
Membres du jury :
M. Pascal BUTTERLIN, Professeur de l’Université Paris 1
M. Henri-Paul FRANCFORT, Directeur de recherche au CNRS
M. Guillaume GERNEZ, Maître de conférences à l’Université Paris 1
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
3
AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS
La recherche d’un point de vue général pourrait s’envisager comme l’accumulation
d’erreurs dont la traçabilité – caractère essentiel de cette activité – en permet l’investigation à
posteriori sous la lumière des nouvelles données, techniques et méthodes disponibles. Les
nouveaux chercheurs, en s’essayant à retracer le parcours de pensée de leurs prédécesseurs
pionniers, commettront également des impairs, résultant pour une grande part de
l’imprégnation des contextes dans lesquels leurs publications auront lieu. Ces grandes
généralités n’ont pas pour but de donner une vision pessimiste du monde de la recherche mais
au contraire un aperçu d’une tangible efficacité : l’erreur est un sous-produit recyclable du
raffinement de la connaissance. Le travail du chercheur devient alors celui de raffiner en
permanence cette scorie, en produisant d’autres à leur tour épurées, enrichies.
Le travail de recherche en Master 1 est la première entreprise délicate et personnelle de
l’étudiant qui l’expose à un recul nécessaire sur son parcours. Du balbutiement du projet de
recherche sur une zone géographique et des cultures qui m’étaient totalement inconnues a
abouti une révélation personnelle. De nouvelles questions émergent alors au fur et à mesure
que ces caractères s’affichent, enrichies par une sorte de « conscience d’écart »…
Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à mes encadrants, Guillaume Gernez pour
sa disponibilité, son optimisme ses recadrages efficaces ainsi que ses conseils en matière de
sources ; Pascal Butterlin pour son émulation, ses pistes de réflexion notamment en ce qui
concerne le pôle minier et la question proto-élamite que j’aurais eu tendance à négliger ;
Henri-Paul Francfort pour sa rigueur, ses connaissances pointues et le séminaire fécond qu’il
nous a prodigué autant sur l’épistémologie que sur les pétroglyphes d’Asie Centrale. J’étends
volontiers cette attention aux chercheurs et au personnel de la M.A.E (surtout aux
documentalistes du fond d’archéologie) ainsi qu’aux associations Routes de l’Orient et des
Amis de Larsa qui ont impulsé des dynamiques studieuses. Enfin plus délicat, la longue liste
des personnes physiques qu’il serait injuste de citer partiellement et qui participèrent peu ou
prou et souvent à leur insu – au gré de nos interactions – à la maturation de ce travail.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
4
TABLE DES FIGURES
Figure 1 : Carte de l’Asie Centrale selon les Nations Unies .............................................. 69
Figure 2 : Carte des milieux................................................................................................... 70
Figure 3 : Carte des gisements de cuivre et d'étain en Iran............................................ 71
Figure 4 : Carte des prospections minières en Afghanistan ............................................ 72
Figure 5 : Carte des gisements d’étain en Asie Centrale ................................................ 73
Figure 6 : Carte de l'exploration archéologique en Asie Centrale................................. 74
Figure 7 : Le monde de l’Eurasie et de l’Asie Centrale à l’Âge du bronze en relation
avec la Mésopotamie et l’Indus.......................................................................................... 75
Figure 8 : Périodisation globale de l'Asie Centrale de l'âge du bronze au fer ancien 76
Figure 9 : Le phénomène métallurgique dans l’Ancien Monde..................................... 77
Figure 10 : Schématisation conceptuelle des étapes de la métallurgie des alliages
cuivreux, de l’extraction du minerai au dépôt archéologique...................................... 78
Figure 11 : Les diverses zones d'un gîte métallifère de type filonien en fonction de la
circulation de l'eau : Schéma idéal en terrain homogène ............................................. 79
Figure 12 : Eléments principaux de datation minière ....................................................... 80
Figure 13 : Les étapes du traitement d'un minerai de cuivre de type falherz............... 81
Figure 14 : Carte de localisation des sites étudiés ............................................................ 82
Figure 15 : Altyn-Dépé, topographie du site avec la localisation des activités ........... 83
Figure 16 : Sélection des artefacts analysés de Gonur et Togolok................................. 84
Figure 17 : Situation de Sapalli-Dépé .................................................................................. 85
Figure 18 : Site de Dzarkutan ................................................................................................ 86
Figure 19 : Artefacts prestigieux de Sapalli-Dépé ............................................................. 87
Figure 20 : Site de Shortughai ............................................................................................... 88
Figure 21 : Sélection d’épingles et de perles en cuivre de Shortughai.......................... 89
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
5
Figure 22 : Objets remarquables de Shortughai................................................................ 90
Figure 23 : Tépé Hissar, plan des fouilles de 1976 .............................................................. 91
Figure 24 : Restes de l'activité métallurgique à Tépé Hissar............................................. 92
Figure 25 : Sélection de matériel en alliage cuivreux de Tépé Hissar ............................ 93
Figure 26 : Localisation du site de Shahdad dans la plaine du Takab........................... 94
Figure 27 : Plan des ateliers du site "D" de Shahdad......................................................... 95
Figure 28 : Four de fusion de l’atelier n° 2 à Shahdad...................................................... 96
Figure 29 : Les types de four de fonte à Shahdad ............................................................ 97
Figure 30 : Céramique métallurgique à Shahdad ............................................................ 98
Figure 31 : Secteurs de production à Shahr-i Sokhta ........................................................ 99
Figure 32 : Restes métallurgique de Shahr-i Sokhta ........................................................ 100
Figure 33 : Zone métallurgique à Harappa colline "E" .................................................... 101
Figure 34 : Quelques types de semi-produits ................................................................... 102
Figure 35 : Terminologie technologique et découpage théorique de la métallurgie
des alliages cuivreux ........................................................................................................... 103
Figure 36 : Analyses d'artefacts à Altyn-Dépé................................................................. 104
Figure 37 : Outils lithiques du bronze ancien d’Altyn-Dépé (planche 1) ..................... 105
Figure 38 : Outils lithique du bronze ancien à Altyn-Dépé (planche 2) ....................... 106
Figure 39 : Restitution des creusets et fragment de litharge d’Altyn-Dépé................. 107
Figure 40 : Sélection d’objets en alliage cuivreux du bronze ancien à Altyn-Dépé..108
Figure 41 : Métallographie et granules de cuivre d’Altyn-Dépé .................................. 109
Figure 42 : Schème technique d'Altyn-Dépé au bronze ancien .................................. 110
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
6
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS................................................................. 3
TABLE DES FIGURES........................................................................................... 4
TABLE DES MATIERES........................................................................................ 6
INTRODUCTION ................................................................................................. 8
1. METHODOLOGIE ....................................................................................11
1.1. Archéologie de l’Asie Centrale .......................................................................... 12
1.1.1. L’ancrage géographique de l’étude............................................................. 12
1.1.2. La recherche archéologique en Asie Centrale............................................. 15
1.2. Métallurgie préhistorique ................................................................................... 20
1.2.1. La recherche en métallurgie préhistorique.................................................. 20
1.2.2. De la mine à l’atelier................................................................................... 24
2. INVENTAIRE TECHNOLOGIQUE ..............................................................30
2.1. Protocole opératoire ........................................................................................... 31
2.1.1. Documentation convoquée.......................................................................... 31
2.1.2. Découpage technologique et culturel.......................................................... 32
2.1.3. Unités de base : les sites retenus ................................................................. 34
2.2. Zone focale......................................................................................................... 37
2.2.1. Altyn-Dépé.................................................................................................. 37
2.2.2. Gonur-Dépé et Togolok .............................................................................. 38
2.2.3. Sapalli-Dépé et Dzarkutan .......................................................................... 39
2.2.4. Shortughai ................................................................................................... 40
2.3. Zone interface..................................................................................................... 42
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
7
2.3.1. Tépé Hissar ................................................................................................. 42
2.3.2. Shahdad....................................................................................................... 43
2.3.3. Shahr-i Sokhta............................................................................................. 44
2.3.4. Harappa ....................................................................................................... 45
2.4. Synthèse et mise en perspective ......................................................................... 47
3. ETUDE TECHNOLOGIQUE A ALTYN -DEPE..............................................49
3.1. Proposition d’un modèle .................................................................................... 50
3.1.1. De la technologie lithique à métallurgique ................................................. 50
3.1.2. Un modèle heuristique ................................................................................ 51
3.2. Données matérielles et analyses ......................................................................... 52
3.2.1. Installations ................................................................................................. 52
3.2.2. Outils et éléments connexes........................................................................ 52
3.2.3. Déchets........................................................................................................ 53
3.2.4. Produits semi-finis ...................................................................................... 53
3.2.5. Produits finis ............................................................................................... 54
3.2.6. Matériaux recyclables .................................................................................54
3.3. Interprétation des données.................................................................................. 55
3.3.1. Au bronze ancien ........................................................................................ 55
3.3.2. Au bronze moyen........................................................................................ 56
CONCLUSION ..................................................................................................57
BIBLIOGRAPHIE ...............................................................................................60
FIGURES...........................................................................................................69
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
8
INTRODUCTION
« On dissimulait dans des recoins insolites les bibelots que l’on croyait précieux, on
les enterrait dans les caves, certains même se défaisaient instamment de ce qu’ils tenaient
pour des trésors et pendant quelques jours on put voir aux coins des rues, autels burlesques
aux dieux de la guerre, des empilement hétéroclites où l’argenterie et la vaisselle précieuse
voisinaient avec les meubles de marqueterie d’essences rares, les vases somptuaires, les
pendules ou les portraits d’ancêtres. »
Jacques Abeille, Les barbares.
La métallurgie des non-ferreux a pendant longtemps jouit d’un engouement de la part des
chercheurs et des archéologues qui se penchaient sur les civilisations disparues. Les artefacts
en or, argent, et surtout ceux en alliage cuivreux ou « bronze » étaient devenus par-delà les
objectifs de leur artisans créateurs, des objets de connaissance pour les studieux.
Des informations plus ou moins pertinentes furent extraites de tels artefacts. En contexte
stratigraphique précis, il était tout à fait possible de les utiliser afin de raffiner les typo-
chronologies des assemblages céramiques et lithiques, mais ils permettaient surtout d’innerver
les théories de l’inégalité sociale. En effet, ces éléments prestigieux ne pouvaient par essence
se retrouver dans les mains du commun des mortels puisque dans les temps mythiques, ils
constituaient la panoplie du héros. Les termes « bronze » et « airain » jouirent en effet
d’antécédents littéraires et de représentations positives.
Paradoxalement, le travail en amont de ces nobles matériaux – la fonderie et la forge – a
fait l’objet d’une dépréciation certaine. Le saut qualitatif dans la compréhension de ces objets
n’a été possible qu’avec l’essor des analyses physico-chimiques qui, par la sublimation
scientifique des appareils de mesures et des interfaces, pouvaient permettre de poser un regard
sur des matériaux longtemps ignorés : les scories et autres déchets de la production
métallurgique. Cette effervescence dans un secteur en friche se condensa bientôt sous le terme
« paléometallurgie » présentant de nouvelles données sur les anciens artefacts et leur
fabrication.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
9
À la lumière de ce passif, la métallurgie préhistorique se cristallisa en un savoir
extrêmement dense lors de la deuxième moitié du XXème siècle. Un discours sur l’artisanat
cuivreux de ses origines obscures jusqu’à l’adoption du fer, fit émerger de grands paradigmes
proche et moyen-orientaux : les hommes auraient tout d’abord déformé du cuivre natif offert
par la nature, puis se seraient essayés à la réduction de minerais plus ou moins exigeants pour
enfin contracter des recettes d’alliage. Cependant, des données résiduelles semblèrent
échapper à l’orbite de ces schèmes au caractère « mantrique 1 » lorsque les chercheurs de
l’Ouest furent confrontés aux résultats soviétiques. Ceux-ci attestaient de l’existence
d’artéfacts métalliques à la morphologie semblable mais distincte bien plus loin au nord-est.
Au même moment, dans un espace-temps théorique éminemment connexe, l’Orient
Ancien faisait l’objet d’une profonde réflexion dans l’univers de la recherche archéologique.
Le paradigme du « système monde », avait relayé les découvertes d’Asie Centrale au rang de
périphérie des centres urbains civilisés. Malgré l’agrammatisme 2 de ces populations
encadrées par les illustres tablettes mésopotamiennes et le mystérieux script de l’Indus, les
chercheurs réussirent à y distinguer un caractère civilisé. A l’instar d’un syndrome
neurologique, la diagnose de cette « civilisation » reposait sur une liste de symptômes dont un
certain nombre devait être validé. Parmi ces critères G. V. Childe invoqua l’artisanat d’art et
plus précisément la métallurgie du bronze. Cette activité métallurgique pratiquée par des
populations en marge suscita la curiosité des missions archéologiques qui s’en allèrent
retourner le sable des déserts, gravir des montagnes enneigées et fouiller des oasis luxuriantes
à la recherche de généreux indices.
Ce sont ces documents rassemblés qui vont être étudiés dans ce travail. Ce pan de la
recherche sera sondé avec trois interrogations principales. La métallurgie des alliages
cuivreux de l’Asie Centrale peut-elle suivre les paradigmes appliqués au Proche et Moyen-
Orient ? Une heuristique technologique peut elle apporter des informations supplémentaires
aux études métallurgiques ? Enfin, est-il possible d’entrer dans le détail des « chaînes
opératoires » pour comprendre le savoir technique des artisans ?
1 Terme utilisé par C. P. Thornton dans son article de 2009 : « The emergence of complex metallurgy on the iranian plateau : escaping the levantine paradigm » p. 302.
2 Au sens archéologique de l’absence matérielle pouvant attester d’une écriture, à ne pas confondre avec son acception neuropsychologique.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
10
Pour ce faire, le présent travail se découpe en trois parties ou chapitres, armés chacun à
dessein d’une parataxe concernant l’univers de la recherche.
La première grande étape concerne la méthodologie. Dans sa première sous-partie seront
abordés le contexte géographique avec les définitions spécifiques de la zone d’étude, quelques
éléments climatiques et topologiques. Une attention particulière sera accordée à la localisation
des gisements dans ces régions. Secondement, sera présenté l’histoire de la recherche
archéologique russe et internationale en Asie Centrale, avec les éléments culturels et
chronologiques nécessaires pour circonscrire le sujet à l’âge du bronze. La seconde sous-
partie sera dédiée à la métallurgie préhistorique, comprenant l’élaboration théorique de la
paléométallurgie et les améliorations techniques de l’archéométrie. Elle n’hésitera pas à
entamer les paradigmes en place et les liens explicites entre métal et civilisation. Enfin,
l’organisation de la production sera abordée, de manière générale puis détaillée, de la mine à
l’atelier du bronzier.
La seconde partie sera dédiée à l’inventaire technologique de la métallurgie des alliages
cuivreux en Asie Centrale méridionale. Tout d’abord, dans sa première sous-partie, le
protocole opératoire sera présenté, indiquant la littérature comme « pool » de données,
rappelant brièvement l’existence et l’intérêt de la catégorisation ainsi que des typologies. Le
découpage de l’inventaire sera ensuite présenté spatialement et technologiquement, en faisant
un bref détour par l’approche technologique et ses ambiguïtés. Les sites traités seront alors
présentés. La seconde sous-partie traitera de la zone focale de l’étude, centrée sur l’aire
d’extension de la « civilisation de l’Oxus ». L’avant-dernier sous-chapitre comprendra le
traitement des sites de la zone interface très large s’étendant du plateau iranien au nord-est
pakistanais. Enfin, la dernière sous-partie présentera une synthèse technologique intermédiaire
à la lumière des paradigmes en place dans la littérature.
Le dernier grand volet de ce travail concerne l’étude de cas d’Altyn-Dépé. Après une
brève sous-partie où un modèle exploratoire sera proposé, un second point présentera de
manière détaillée les données en les organisant en six grandes catégories témoins de la
production. Finalement, le dernier sous-chapitre comprendra un niveau de synthèse
intermédiaire de ces données essentielle transition avant la conclusion.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
11
1. METHODOLOGIE
« Les conversations que j’eus à cette occasion avec Philip
Kohl achevèrent de me convaincre que nous avions, sur la
façon de parvenir à une connaissance plus équilibrée de
l’histoire de l’Asie Centrale, les mêmes opinions et les mêmes
desseins. »
Gardin, préface à l’ouvrage de Kohl :
Central Asia Palaeolithic beginnings to the Iron Age, 1984,
p. 7
“Reviewing the literature, however, is also
emboldening in that it highlights the lack of consensus that
often exists among the specialists who have assembled this
record.”
Kohl, Making of Bronze Age Eurasia, 2007, p. 8-9
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
12
1.1. Archéologie de l’Asie Centrale
Cette première sous-partie présente le contexte géographique spécifique et l’histoire de la
recherche archéologique. Il s’agit dans un premier temps de définir la zone d’intérêt : l’Asie
Centrale méridionale, avec quelques éléments de nature climatique et topographique
permettant d’introduire la gîtologie et les ressources nécessaires à la métallurgie des alliages
cuivreux. Dans un second temps seront traités les antécédents méthodologiques de la
recherche en Asie Centrale, de ses prémices régionaux soviétiques aux tentatives
d’intégrations dans des systèmes généraux, pour enfin aborder brièvement la chronologie.
1.1.1. L’ancrage géographique de l’étude
1.1.1.1. L’Asie Centrale méridionale
L’Occident exogène s’est approprié la représentation de ces lointaines contrées via une
construction géographique évolutive à l’enracinement largement mythique dans un premier
temps, puis progressivement géopolitique avec l’Asie Centrale soviétique. Elle a remplacé le
terme de Tartarie ou celui de Turkestan occidental au XIXème siècle (Francfort 2009, p. 92). A
l’époque perse, l’appellation Touran renvoyait aux difficultés liées au fait de canaliser un
monde nomade, c'est-à-dire le non-Iran, parlant notamment des langues turciques. Ce terme
sera repris par M. Tosi pour en faire une extension de l’Iran (Amiet 1986, p. 171).
En 2005, selon les Nations Unies, il s’agit du Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan,
Tadjikistan, Kirghizstan (fig. 1). Si l’on suivait une acception anglo-saxonne extensive, l’Asie
Centrale équivaudrait à la somme approximative des anciennes républiques soviétiques
modulo le Xinjiang, le nord de l’Afghanistan, jusqu’à l’ajout de la Mongolie, du Tibet, du
Pakistan et d’une partie du Caucase (Fourniau 2006, p. 16). L’Asie Centrale peut aussi
s’approcher de la notion de Turkestan : une surface oblongue qui s’étend au sud des steppes, à
l’est de la Caspienne jusqu’à l’extrémité de l’actuel Xinjiang, divisée en une partie ouest et
une partie est par le système de drainage du Pamir et du Tien Shan (Kohl 2007, p. 182).
Le présent travail se concentrera sur la partie méridionale de l’Asie Centrale dans sa
définition restreinte. On pourra retenir dans les grandes lignes quatre repères pour la fixer
largement : de l’est de la Caspienne à l’emprise de l’Amou-daria et des plateaux iraniens à
l’ Indus. Il est entendu par là en suivant un sens horaire : le nord-est de l’Iran, le
Turkménistan, le sud de l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, l’Afghanistan et une partie du Pakistan.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
13
1.1.1.2. Eléments géophysique et environnementaux
Le climat sur cette aire qui s’échelonne approximativement entre les parallèles 30° N et
50°N est majoritairement continental et sec dans l’ensemble, si l’on excepte les rivages de la
Caspienne. Cette aridité se caractérise par des températures moyennes, élevées et basses
respectivement aux solstices d’été et d’hiver. On constate que de nombreux déserts jalonnent
l’Iran mais également le Turkménistan avec sa grande étendue minérale de sable noir : le
Karakoum (fig. 2).
Cependant, le relief de l’Asie Centrale méridionale est caractérisé par son oscillation entre
plaines et plateaux de l’Iran à l’ouest jusqu’à observer vers l’est une augmentation dramatique
d’altitude à partir du Pamir et de l’Hindou-kouch. L’intérieur de ces hauteurs est doté de
glaciers qui lors du redoux creusent les contreforts et piémonts via des torrents. Ces derniers
rejoignent ou non de grands fleuves tel l’Amou Daria, le célèbre Oxus des anciens.
Les oasis de Margiane et Bactriane, résultant de ces précipitations, présentent un faciès de
forêts galeries avec un biotope riche. Cette jungle bordant les cours d’eau, aussi appelée
« tugaï » est composée de roseau, tamaris, peuplier et jujubier (Francfort 2003a, p. 21). Dans
les piémonts comme au Kopet Dagh entre 600 et 1800 m d’altitude, on trouve parfois de
petites tugaï. En zone montagneuse, on peut trouver des forêts de feuillus (chênes, genévriers)
puis de conifères en altitude (cèdre et pin).
Ce couvert végétal a pu servir de combustible pour répondre aux voraces besoins des
activités métallurgiques. De plus, dans le contexte de bassin sédimentaire en aval des
piémonts, les matériaux nécessaires pour le façonnage des céramiques et installations à
l’épreuve du feu ont pu être recherchés. C’est le cas de l’argile et du kaolin ainsi que de tous
les dégraissants possibles, aussi bien végétaux que minéraux pour répondre à ces contraintes.
Il ne faut pas non plus oublier les roches, qu’elles soient tendres ou dures, pour la confection
des moules et outils primordiaux.
1.1.1.3. Gitologie et sources métallique
Pour le minerai en revanche, des campagnes de prospection archéologiques anciennes et
récentes ont recensé des gisements dans les régions d’Iran, Afghanistan, Ouzbékistan et
Tadjikistan. Les expéditions soviétiques (infra 1.1.2), composées très souvent de géologues,
ont contribué à la cartographie de ces ressources minérales ainsi qu’aux spéculations quant à
la provenance des matériaux.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
14
Quelques gîtes probables en Iran ont été explorés par l’équipe de Berthoud, Besenval et
Cesbron (1976). Au sud de la Caspienne à Veshnove et au nord du détroit d’Hormuz à
Bardsir, des gisements de cuivre ont été échantillonnés. Au sud-ouest de Shahr-i Sokhta et
dans le sud du Khorassan, à Qaleh Zari ont été retrouvés des sulfures, oxydes et du cuivre
natif. Les travaux de la R.C.P 442 3 du CNRS ont également contribué à une meilleure
connaissance de la minéralogie de l’Iran. C’est le cas de l’échantillonnage du dépôt de
Talmessi dans la région d’Anarak (fig. 3). Ce gisement bien connu à 250 km au sud-ouest
d’Hissar présenterait du cuivre arsénié (Berthoud et alii 1982, p. 41). A l’est d’Hissar vers
Abbasabad, d’autres gisements ont été repérés (Ratnagar 2004, p. 119). Les plus gros gîtes se
situent dans une ceinture comprise entre Yazd et Bam, notamment à Rafsanjan. Enfin, plus
récemment, en marge de l’Asie Centrale vers le sud-ouest, des études poussées sur le minerai
de Dah Hossein dans le Zagros ont montré un potentiel d’ordre économique d’étain et de
cuivre (Nezafatis 2006, p. 97).
Plus à l’est, en Afghanistan, une expédition (Berthoud, Besenval, Carbonnel 1977)
cherchant à vérifier les études précédentes mit en évidence des gisements polymétalliques de
cuivre ainsi que la présence d’étain (fig. 4). Dans la province d’Herat, un minerai de cuivre
parfois arsénié, l’étain sous la forme de cassitérite annoncé par les rapports soviétiques n’a
pas été confirmé. En revanche, du côté de Farah dans la vallée qui s’étend au sud-est de
Sarkar, sa présence sous le faciès d’aiguilles « needle tin », indique une ressource probable.
Dans la région de Mukur, la région de Kaboul et l’Hindou-kouch on trouve les minerais
habituels mais également du cuivre natif.
Dans le sud-est de l’Ouzbékistan et à l’ouest du Tadjikistan, plusieurs gisements
stannifères ont été découverts, notamment dans la vallée du Zeravchan (fig. 5). A l’ouest de
Samarkand à Karnab, un gisement granitique contient de la stannite (Boroffka et alii 2002,
p. 144). En amont de la vallée du côté Tadjikistan, le site de Mushiston présente un minerai
primaire de cuivre très riche en étain, la cassitérite. Les gisements secondaires sont composés
de carbonates de cuivre (malachite, d’azurite) mais également mixte cupro-stannifère : de
varlamoffite et enfin de mushistonite, minerai éponyme du site (Ibid., p. 141).
3 Recherche Coopérative sur Programme
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
15
1.1.2. La recherche archéologique en Asie Centrale
1.1.2.1. Des clivages linguistiques et théoriques
La première double barrière rencontrée par la recherche est d’ordre linguistique. Si
aujourd’hui seulement quelques spécialistes de l’Ouest lisent le russe, le monde anglo-saxon a
souvent du mal à lire en dehors de son abondante littérature (Kohl 2007, p. 6). De même, les
divisions théoriques se déclinent en deux occurrences : géopolitique d’une part et dogmatique
d’autre part. Tout d’abord en raison de la guerre froide qui a séparé la recherche de la steppe
eurasienne de celle du Proche-Orient jusqu’en 1989, mais également entre les partisans de
l’archéologie processuelle et post-processuelle (Ibid. p. 7-8).
Les premiers travaux qui éclairent l’archéologie de l’Asie Centrale sont liés à la conquête
russe du Turkestan. Les fouilles étaient dirigées par les officiers et leurs troupes comme le
général Komarov en 1886 dans l’oasis de Merv. En sectionnant la butte nord, ce dernier
découvrit le site d’Anau dont les fouilles seront poursuivies par Pumpelly en 1908. Malgré les
inhérentes déprédations et la méthodologie tâtonnante de cette époque, nombre de ces
personnes publiaient leurs travaux, formaient des sociétés et participaient à la constitution de
musées (Kohl 1984, p. 17). Les hypothèses avancées pour expliquer le peuplement ancien
mettaient régulièrement en jeu la prééminence de l’environnement sur les populations. C’est
également à ce moment qu’apparût le sujet de M. Muller sur les terres natales des aryens,
nouvel enjeu pour l’Eurasie, sur lequel une mise au point est régulièrement nécessaire
(Parpola 1993 ; Francfort 2005).
L’arrivée au pouvoir des soviétiques dans les années vingt réorienta considérablement les
objectifs de recherche. La priorité revînt à dresser une carte archéologique de l’Asie Centrale
en lien avec l’intégration politique des nouvelles républiques soviétiques du Turkestan. Kohl
retient trois campagnes importantes dès la fin des années trente (Kohl 2007, p. 184-185). Tout
d’abord l’expédition du « Khoreszm 4 » de S. P. Tolstov ; le « Yu T.A.K.E 5 » de M. E. Masson
à Namazga-Dépé et enfin celle de V. I. Sarianidi dans le nord de l’Afghanistan 6 (sud
Bactriane) de 1969-1979 à Dashly avec A. Askarov à Sapalli-depe en Ouzbékistan (fig. 6).
4 The Khoresmian Archaeological Ethnographic Expedition. 5 The Southern Turkmenistan Complex Archeological Expedition. 6 The Soviet-Afghan Archaeological Expedition.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
16
Les années soixante-dix soviétiques sont marquées par les théories marxistes et
évolutionnistes, notamment en ce qui concerne l’organisation sociale. Elles mettent l’accent
sur un développement interne des sociétés (Kohl 2007 p. 186) qui s’organise autour d’étapes
progressives, de la société sans classes jusqu’au stade ultime : le socialisme-communisme.
Les archéologues de l’Est se focalisent alors sur les productions économiques et artisanales
parfois au détriment de la stratigraphie.
En 1988, Hiebert et Sarianidi s’associent sur le site de Gonur pour en préciser les
datations. Ce dernier propose de nommer ce vaste ensemble « B.M.A.C » 7, auquel H.-P.
Francfort préfère le terme « Civilisation de l’Oxus » (Francfort 1984, p.174).
Les chercheurs de l’Ouest se concentrent plutôt sur l’Iran, l’Afghanistan et le Pakistan.
Dans les années trente, l’archéologue américain E. F. Schmidt fouille sur le site de Tépé
Hissar et F. E. Wulsin découvre Tureng-Tépé, livrant sa célèbre céramique grise, repris par
J. Deshayes qui y dégage une puissante terrasse à degrés (Amiet 1986, p. 21). Des missions
françaises explorent l’Afghanistan dans le cadre de la D.A.F.A 8 dès 1922 (Djindjian 2011, p.
36). Elle fouille à Bactres au milieu des années vingt, à Mundigak dans les années cinquante,
à Aï Kanoum de 1965 à 1976 ainsi que le fameux site de Shortughai jusqu’à la fin des années
soixante-dix. D’autres travaux de prospections systématiques et d’études du paysage furent
menées sous la direction de J. C. Gardin (Gardin, Lyonnet 1978). Les tablettes « proto-
élamites » apparaissent à Tépé Yahya et à Shahr-i Sokhta (Amiet 1986, p. 21). Les recherches
seront interrompues en 1979 avec la révolution iranienne. Cette époque, marquée par des
fouilles extensives et des prospections tous azimuts, illustre la volonté de comprendre des
processus à grande échelle.
En 1991, le collapse de l’U.R.S.S libère le champ d’action des chercheurs de l’Ouest,
excepté en Afghanistan, pays qui connaît une succession de conflits. Il permet aux deux
mondes de la recherche de se rencontrer après leur évolution autonome. A part Sarianidi qui
continue la fouille de Gonur avec l’appui des italiens, les acteurs et institutions russes perdent
leur influence sur les ex-républiques soviétiques au profit des occidentaux (Luneau 2010, p.
69) 9.
7 Bactria-Margiana Archaeological Complex. 8 Délégation Archéologique Française en Afghanistan. 9 Pour de plus amples précisions sur la recherche des années 90 jusqu’en 2008-2009, la thèse d’Elise Luneau
présente un intérêt conséquent en ce qu’elle synthétise les projets les plus récents (Luneau 2010, p. 67-74).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
17
1.1.2.2. La « Civilisation de l’Oxus » et les entités proches
Les origines et les modalités de construction de la civilisation de l’Oxus dans la focale de
la présente étude restent encore à préciser. En effet, de nombreuses hypothèses relatives à ses
antécédents sont développées dans une littérature extrêmement vaste. Elle serait alimentée par
les grandes civilisations possédant l’écriture en Mésopotamie et en Indus, irriguée par des flux
migratoires de la steppe au nord dans ses époques plus récentes (fig. 7).
La néolithisation est adoptée en Iran et au Turkménistan courant 6ème millénaire dans les
piémonts du Kopet Dagh. Elle est en revanche différée dans d’autres régions comme
l’Afghanistan (Sarianidi 1992, p.126). Au cours du chalcolithique, du début du 5ème à la fin du
4ème milllénaire, son substrat s’élabore progressivement, visible notamment sur le site d’Anau
et les phases précoces de Namazga-Dépé. Les premiers rapports d’échanges longue distance
entre l’Iran, le Baluchistan, le golfe persique et la steppe ouralienne sont attestés (Francfort
2005, p. 255). Les premières inégalités sociales apparues précédemment sont bientôt
exacerbées par l’adoption de la métallurgie (Chernikh 1992, p. 1).
A l’âge du bronze, une dynamique commune se met en place du début du 3ème millénaire
atteignant son point culminant entre 2500 et 1800 avant notre ère pour observer un déclin
jusqu’en 1500 av. n. è (Francfort 2003b, p. 29). C’est ce grand motif culturel qui a été nommé
par H.-P. Francfort civilisation de l’Oxus. Largement agrammate, elle est caractérisée par une
production de céramique non peinte monochrome (de blanc à ocre), des sites d’une superficie
d’une dizaine d’hectares ainsi que la présence d’une architecture monumentale et la
production d’objets de prestige (métallurgie et pierres précieuses) retrouvés le plus souvent en
contexte d’habitat et funéraire (Francfort 2005, p. 253).
L’Elam, ce terme élaboré par les scribes d’Uruk, a été envisagé par l’iranologue W. Hinz
comme un État fédéral segmentaire qui s’opposait à celui hypercentralisé d’Ur lors de la
seconde moitié du 3ème millénaire (Potts 1999, p. 85 ; p. 156-157). On peut retenir comme
contribution du Proche-Orient l’expansion urukéenne en Susiane qui « féconde » un État et
sédentarise des populations nomades dans le Zagros et le Fars (Butterlin 2003, p. 142). Le
terme « proto-élamite » a été employé par J. R. Alden lorsque des tablettes indéchiffrables et
des niveaux plus anciens que ceux élamites ont été mis au jour. Ce néologisme hâtif, auquel
D. T. Potts préfère le terme « pré-élamite », s’avère cependant peu approprié eu égard à
l’incompatibilité du script proto-élamite de Suse III à l’écriture élamite postérieure (vers
2 300 av. n.è) qui a été déchiffrée (Potts 1999, p. 79).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
18
Ce terme a été réemployé par P. Amiet pour décrire l’alternative prééminence d’un
pouvoir du plateau iranien et de la plaine mésopotamienne sur Suse (Amiet 1986, p. 23). Ces
éléments conjugués à l’étude du mobilier en chlorite produit dans le Kerman, retrouvés à peu
près partout de la Mésopotamie à l’Afghanistan et au Pakistan, ont conduit Amiet à baptiser
ce phénomène « trans-élamite » (Potts 1999, p. 98). Ce mouvement serait encadré par un
phénomène plus large entre le 3ème et 2ème millénaire. Répondant au nom d’« Iran extérieur »,
il ne s’étendrait pas seulement en Iran mais en définitive partout, notamment sur la Turkménie
et la Bactriane (Amiet 1986, p. 171).
La « civilisation de l’Indus », aussi nommée harappéenne, éponyme du site découvert
non loin du village d’Harappa sur un ancien affluent de l’Indus, se découpe en plusieurs
phases (Lhuillier 2005, p. 9-10). A une première période dite « pré-harappéenne » succède la
période de « Ravi » entre 3300 et 2800 av. n.è. avec une culture matérielle caractérisée par de
la parure en pierre, terre cuite et coquille. La période suivante, « Kat-Diji » entre 2800 et 2600
av. n.è. présente des prémices d’écriture. Arrive enfin la phase harappéenne entre 2600 et
1900 av. n.è. qui inaugure un développement des techniques et des réseaux commerciaux. Ces
innovations sont accompagnées par la calibration des mesures et des poids, le tout
soigneusement officialisé par l’usage de sceaux et d’une écriture (Ibid.). A cette phase dite
« mûre » succède une phase de transition de 1900 à 1800 pour signer sa fin en 1750.
Dans cet élan de globalisation, Possehl a envisagé un modèle nommé « Middle Asian
Interaction Sphere » (Possehl 2012). Il consistait en un vaste réseau d’échanges se mettant en
place entre la Mésopotamie et l’Indus vers la fin du chalcolithique, annonçant un essor sans
précédent au 2ème millénaire. L’abrégeant M.A.I.S, il met en avant l’idéologie constituée d’un
tout cohérent comme clef d’évolution du système, véhiculée par les échanges d’objets de
« style international ». Ce cadre culturel commun a été daté à travers les objets de l’époque
d’Agadé aux débuts d’Isin-Larsa ou encore de la chute de Mari soit de 2300 à 1800/1750
(Pottier 1984, p. 55 ; Lyonnet 2001).
Autre phénomène de l’Asie Centrale, la dualité nomade-sédentaire s’inscrit également
dans une vaste littérature (Kohl 2007 ; Hanks, Linduff 2009). En effet, dès le 2ème millénaire
on assiste à une percolation progressive du monde des steppes du nord dans le Sud plutôt
sédentarisé. Elle débute avec les variantes de la culture matérielle Fedorovo-Alakul
(Francfort, Kuz’mina 1999, p. 488) rassemblées sous le terme culturel générique andronovo.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
19
1.1.2.3. Chronologie
La chronologie unique circonscrivant le développement de la civilisation de l’Oxus, bien
que précisée a rencontré des difficultés de synchronisation. Des datations insolubles entre un
nord steppique et un sud oasien (Francfort, Kuz’mina 1999, p. 467) ont été progressivement
résolues. De plus, la cohabitation de dates radiocarbone haute calibrée versus basse non-
calibré qui séparait le monde de la recherche, s’oriente plutôt en faveur de la datation haute à
la lumière des nouvelles données. Celles-ci confirmeraient l’apogée de la civilisation de
l’Oxus entre 2350 et 1750 av. n. è (Francfort 2009, p. 91).
Pour des raisons de simplicité et d’efficacité immédiate, la périodisation globale de l’Asie
Centrale présentée par E. Luneau en 2010 (fig. 8) présente de nombreux avantages pour cette
étude. On n’hésitera pas à employer la terminologie de la séquence stratigraphique de
Namazga, qui comporte un empan suffisamment long, couvrant le chalcolithique jusqu’à la
fin de l’âge du bronze. Il se peut cependant que l’on vieillisse certaines phases proposées dans
les anciennes publications pour s’adapter à l’évolution de la littérature et des datations
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
20
1.2. Métallurgie préhistorique
Cette seconde sous-partie aborde la thématique de la métallurgie en général et des alliages
à base de cuivre. Tout d’abord, un portrait historique de la paléometallurgie sera brossé, avec
les acquis méthodologiques et techniques de l’archéométallurgie ainsi que les paradigmes
généraux unissant métal et civilisation. Dans un second temps, la focale sera sur l’activité
métallurgique, à travers ses modalités d’organisation, en détaillant le contexte minier puis les
étapes théoriques du processus de transformation du métal dans l’atelier du bronzier.
1.2.1. La recherche en métallurgie préhistorique
1.2.1.1. Historique de la paléométallurgie
La paléométallurgie selon J.-P. Mohen est une « science débutante » qui étudie la
métallurgie ancienne (Mohen 1990, p.15). Le mot métallurgie dérive du grec metallon
transmis lui-même dans la langue latine sous la forme metallum. Les premières bribes de
discours ont été consignées par quelques auteurs classiques comme Aristote dans les
« Météorologiques ». Le philosophe distingue les minéraux non-métalliques des métaux
même si aucune différence n’est faite entre minerai et métal (Ibid., p. 16). Il faut attendre la
Renaissance pour voir apparaître les premiers ouvrages consacrés à la métallurgie avec le
« De re metallica » de Georgius Agricola et « De la pirotechnia » de Vannoccio Biringuccio
au XVIème. Ces auteurs s’emploieront au commentaire des sources anciennes, notamment les
écrits de Pline l’Ancien.
Plus tard, au XIXème siècle, un intérêt pour les « sciences précoces » voit le jour dans la
littérature. En 1888, Marcelin Berthelot s’intéresse à l’alchimie médiévale et classique.
Parallèlement à ce travail sur les sources textuelles, des enquêtes ethnographiques cherchent
des indications sur la métallurgie ancienne dans celle des tribus primitives. De nombreux biais
sont alors introduits dans la littérature tandis que formellement en 1815, Klaproth (le père de
la chimie analytique) va conduire les première analyses chimiques sur de la monnaie romaine
et une série de miroirs (Craddock 1995, p. 3-4).
Au XXème siècle, les études ethnographiques sont de plus en plus détaillées notamment en
Afrique avec Monsignor de Hemptinne pour la fonderie du cuivre et Walter Buchanan Cline
pour la métallurgie du fer (Herbert 1984, p. 51-55). En 1935 paraît la première étude
archéologique sur les mines romaine, celle d’Oliver Davies qui sera reconnue comme un
classique dans la discipline.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
21
Les synthèses initiées dans la seconde moitié du XXème vont offrir ses premières lettres de
noblesse à une nouvelle discipline en recherche d’actes fondateurs. C’est avec Jean René
Maréchal pour la France, Carlo Pansieri en Italie et l’irremplaçable Ronald Frank Tylecote
pour la Grande-Bretagne que sont réalisées les premières études métallographiques sérieuses
sur des artéfacts en métal (Craddock 1995, p. 5-6). Entre 1950 et 1972 ont lieu les premières
fouilles minières pluridisciplinaires à Timna en Israël. Celles-ci sont rattachées au Deutsche
Bergbau Museum de Bochum rassemblant des archéologues, des géologues et des anciens
mineurs de charbon de la Ruhr (Ibid., p. 6). Dans le même laps de temps en Russie, de vastes
campagnes d’analyses sur 60 000 artéfacts en bronze issus des contextes de l’Eurasie sont
entreprises (Chernikh 1992).
L’essor de l’expérimentation depuis ses débuts en 1894 avec Cushing ainsi que les travaux
pionniers de Coghlan en 1939, a été irriguée par l’arrivée des techniques d’enregistrement
vidéo à la charnière du XXIème siècle (Craddock 1995, p. 8). La recréation expérimentale
métallurgique est devenue un véritable outil pour tester des hypothèses lorsque la loquacité
des données archéologiques s’avère insatisfaisante. De bonnes synthèses sont présentées dans
l’ouvrage de Tylecote et Merkel (Tylecote, Merkel 1985) pour ne pas citer un des acteurs
français, Ph. Andrieux, qui expérimenta à l’archéodrome de Beaune (Andrieux 1991).
1.2.1.2. L’Archéométallurgie et ses moyens
Dans les années 80, l’amélioration des techniques d’analyses, de la métrologie ainsi que
des capteurs influencèrent fortement les disciplines liées à l’archéologie. L’archéométrie,
cette discipline en pleine élaboration va mener à l’archéométallurgie grâce à son association
spécifique au secteur métallurgique.
L’archéométallurgiste dans sa panoplie de laboratoire 10, dispose d’une batterie d’outils de
mesure et d’un arsenal d’analyses physico-chimiques. Tout d’abord, l’amélioration dans le
domaine médical de la radiographie a permis d’augmenter le rendement et de réduire
considérablement les coûts lors des campagnes d’analyses des artefacts métalliques
(Craddock 1995, p. 7). Autre technique relativement légère, la métallographie, observée sous
microscope optique et M.E.B 11 permet d’obtenir des informations de base sur la composition
10 On insistera sur la distinction diagnostiquée par Mohen entre l’archéologue et l’archéomètre, ce dernier se focalisent sur le bon déroulement du prélèvement des échantillons, son locus operandi majeur étant le laboratoire (Mohen 1990, p. 16).
11 Microscope Electronique à Balayage.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
22
du métal et sa microstructure, c'est-à-dire connaître le processus de fabrication de la zone
préparée (Pernot 1999). L’évaluation de la dureté du métal en laboratoire sur l’échelle de
Vickers (H.V 12) a également permis d’apporter des informations sur le travail de tassement
(écrouissage de la matière) afin de renforcer les extrémités opérantes des outils et des armes.
L’arsenal lourd de la batterie comprend l’ensemble des spectroscopies. La spectroscopie
par dispersion d’énergie de rayons X (E.D.X.S) permet de reconnaître la composition des
alliages et de certaines inclusions en comptant les raies spectrales caractéristiques des
éléments chimiques, excités au préalable par des électrons. Enfin, longtemps controversées,
les analyses isotopiques du plomb permettent de retracer la provenance de métaux. Elles
reposent sur le rapport entre le 204Pb et les autres isotopes de plombs issus de la désintégration
de 238U, 235U et du 232Th (Djindjian 2011). Ces proportions varient en gros avec l’âge de la
formation minérale contenant les métaux mais également en fonction du fluide minéralisateur
décliné en cinq occurrences. Chaque gisement présente une signature caractéristique de ses
isotopes du plomb qui le rend singulier et donc reconnaissable, car le processus de métallurgie
n’altère pas ou très peu ces rapports. Cependant, cet état optimiste est à nuancer. Les alliages
souvent composés de minerais différents, la connaissance partielle des gisements anciens ou
l’insuffisance d’échantillon pour les caractériser préviennent la fiabilité totale des analyses,
permettant surtout d’exclure des sources (El Morr 2011, p. 114).
1.2.1.3. Les paradigmes métallurgiques
De la division des trois âges mythiques chez Lucrèce (or, airain, fer), reprise par C. J.
Thomsen pour succéder à l’âge de pierre, on est en droit de se demander quels processus
cognitifs réels supportèrent l’apparition de ce nouvel ensemble technique, de l’ « invention »
aux origines obscures jusqu’à l’ « innovation », c'est-à-dire son adoption au sein d’un
collectif 13. Le développement de la métallurgie a longtemps été interprété avec des modèles
complémentaires dans une évolution unilinéaire, logique et largement évolutionniste (Mohen
1990, p. 38). Ce secteur d’investigation a donné lieu à des paradigmes, des plus étayés aux
plus farfelus et il convient de faire le tri parmi l’abondante littérature qui a déversé de larges
encriers.
12 Hardness Vickers Scale 13 Voir S. A. de Beaune (2011) pour un développement plus approfondi sur les processus d’invention et
d’innovation dans une approche plutôt cognitive.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
23
Basé sur une conception utilitaire, Semenov en 1963 montrait l’efficacité du métal sur les
autres matériaux, argument repris par Chernikh (1992, p. 5) pour la démonstration de
l’ « Early Metal Age ». En revanche, C. S. Smith en 1981 proposait plutôt que des besoins
techniques et économiques, le rapprochement homme-matériau dirigé par un attrait
socioculturel et esthétique (Roberts, Thornton, Pigott 2009, p. 1012). Dans le sens de cette
dernière proposition il n’est pas inutile de rappeler que ces minéraux étaient déjà utilisés
depuis le 11ème millénaire av. n.è comme éléments de parure colorés.
Dans les années 20-30, la recherche voyait l’origine de la métallurgie dans le Caucase ou
en Europe. Aujourd’hui il apparaît clair qu’elle provient d’Orient, ancré dans les esprits par
Childe avec le célèbre « ex oriente lux 14» (Montero-Fenollos 1998). La première application
de chaleur sur du cuivre natif aurait eu lieu à Cayönü tepesi dans l’est de la Turquie,
annonçant en 8000 av. n.è les prémices de la métallurgie (Maddin et alii 1999).
Néanmoins, la métallurgie ne commence réellement qu’avec la diffusion de la fusion.
Selon T. Wertime en 1964, cette technique particulière aurait nécessité tellement d’expertise
et de conditions favorables réunies qu’elle serait unique dans l’histoire de l’humanité contra
C. Renfrew qui en proposait des foyers multiples (Roberts, Thornton, Pigott 2009, p. 1012).
Si les premières céramiques pyrotechniques de Çatalhöyük et d’Ali Kosh datées du 7ème
millénaire sont controversées, celles retrouvées à Tal-i Iblis entre la fin du 6ème et le début du
5ème millénaire sont plutôt acceptées (Ibid., p. 1014). Même si l’on peut décemment envisager
ce noyau de diffusion primaire de la technique de fusion entre l’Asie Mineur et l’Iran, la
documentation qui a recours à la « tâche d’encre » pour illustrer ce phénomène (fig. 9) semble
être le synonyme de la méconnaissance quasi-totale des étapes et des modalités de
transmission d’une telle innovation.
La provenance de l’étain pour réaliser les alliages prisés de Mésopotamie a fait l’objet de
foisonnantes spéculations depuis la synthèse de 1977 (Wertime, Franklin, Olin 1977).
L’hypothèse suivie aujourd’hui est celle du commerce longue distance, qui irrigue dans le bon
sens les théories évolutionnistes de l’État avec un fort pouvoir central pour se procurer des
denrées aussi rares qu’éloignées (Berthoud et alii 1982).
14 Malgré de nombreux contre exemples ponctuels dans des cadres plus larges qui échappent à cette étude comme par exemple l’existence d’un foyer autonome de production de fer en Centre Afrique dès 1850 av. n. è alors que les théories diffusionniste invoquent le primauté du centre anatolien en 1600 ( Fluzin, Dillman 2010, p. 106-107)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
24
1.2.2. De la mine à l’atelier
1.2.2.1. Organisation de la production, contrôle et spécialisation
L’activité artisanale peut s’envisager entre deux pôles : libre ou rattachée à une institution
dont le type de production et de distribution est contrôlé par une élite (Costin 1991). En
Mésopotamie, les sources textuelles apportent des éléments de réponse sur le statut des
artisans sous la 3ème dynastie d’Ur : travailleurs saisonniers pour les institutions avec
rétribution de subsistance ; à temps plein attachés à une structure palatiale ou religieuse ; voir
serviles (Wright 1998). Pour les civilisations agrammates en revanche, on doit se reposer
uniquement sur les productions matérielles. La dispersion spatiale intra-site devient alors un
indicateur du degré d’intégration de l’organisation de la production (Tosi 1984, p. 23).
La spécialisation et la division du travail sont reconnues par les marxistes et les non-
marxistes comme des facteurs de développement des sociétés. Childe les corrélait à une
augmentation de la population, puis à la création de centres de production urbains, alors que
Trigger nuançait de telles perspectives, mettant en avant la rente agricole au Moyen-Orient
(Ibid., p.22). Cependant, certains critères ont été retenus pour envisager une classification des
tâches spécialisées (Averbouh et alii 2006, p. 14) :
- La taille de l’unité de production
- La périodicité de l’activité
- Le niveau de segmentation technique
- Le niveau de segmentation spatial
- Le volume de la production
- Le niveau d’autonomie vivrière
- L’échelle de diffusion de la production
- Le niveau d’ethnicité
Enfin, le découpage théorique des activités de la métallurgie des alliages cuivreux n’est
pas sans avoir une influence sur de telles considérations (fig. 10). Les activités d’extraction
sont suivies de la minéralurgie, de la métallurgie d’élaboration (le minerai devient métal), à
laquelle succède théoriquement la métallurgie de transformation comprenant la mise en
forme (fonderie et déformation plastique) puis les finitions (Pernot 1998, p. 107).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
25
1.2.2.2. Les gîtes et l’extraction minière
L’archéologie minière requiert des compétences particulières ainsi qu’une longue
expérience des fouilles souterraines (Craddock 1995, p. 8). Elle permet de connaitre
l’organisation spatiale d’une mine ou d’un établissement métallurgique et les liens qu’elle
entretient avec sa société. La « Terra Mater » que l’on croyait inépuisable, mère des métaux,
était en l’occurrence révérée pour ses bienfaits mais aussi violée lorsqu’on arrachait à ses
entrailles les précieux matériaux (Domergue 2008). En contrepartie de ce crime, les sociétés
ont très tôt élaboré des rites de réparation attestés par des objets ou installations à caractère
cultuel en bordure des sites mais aussi par la pratique du remblaiement lors de l’abandon de
l’exploitation.
Tous les types de gisement n’ont pas été exploités par les mineurs des époques
préhistoriques. Il fallait tout d’abord qu’ils soient repérables. Les gîtes filoniens primaires
d’origine hydrothermale, qui remplissent les anfractuosités de la roche, ont tendance à
émerger progressivement avec l’érosion (Craddock 1995, p. 23-24). Ceux-ci évoluent en
fonction de l’action des agents atmosphériques, des eaux météoriques et du niveau de la nappe
phréatique (fig. 11). Du minerai sulfuré primaire en profondeur, le filon devient sulfuré
secondaire dans la zone de cémentation sous la surface piézométrique 15 et s’oxyde
progressivement en remontant à l’air libre. Le dessus de ces gîtes polymétalliques est
généralement recouvert par de l’hématite et de la goethite, formant ce que les gens du métier
nomment « le chapeau de fer ». D’autres dépôts de type stratiformes se repèrent facilement
avec du minerai de surface altéré en malachite vert et azurite bleu. Enfin, les gîtes détritiques,
particulièrement importants pour l’or et l’étain, sont le résultat du lessivage des filons et de
l’accumulation sédimentaire des ces minéraux dans les vallées.
L’évolution des techniques minières a été restreinte au cours du temps. Les mineurs sont
passés de l’attaque au feu et de l’abattage de la roche avec des broyeurs lithiques rainurés
jusqu’à la fin de l’Âge du Bronze, à l’apparition des miraculeux outils en fer (fig. 12).
L’amélioration arrive seulement à l’époque romaine, où l’ingénierie et les prototypes de
machinerie hellénistique ont été utilisés plus systématiquement, puis l’invention de l’explosif
moderne, qui témoignera de la révolution des échelles et des techniques de production de l’ère
industrielle (Craddock 1995, p. 8-9).
15 Altitude entre la surface du sol et la limite avec la zone saturée par une formation aquifère où les sels minéraux se déposent sou l’action des eaux météoriques.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
26
Avec les moyens dont disposaient ces hommes, creuser dans une matière dure avec le
même matériau relève de l’exploit physiologique et technique. Aussi est on en droit de se
demander si l’on a affaire à des mineurs au sens où on l’entend aux époques historiques.
L’idée de creuser un trou dans la terre pour trouver du minerai a été empruntée à la mine
néolithique qui cherchait à atteindre le silex de meilleure qualité. Des comparaisons sur la
technologie du puits et des galeries rayonnantes néolithiques ont été mises en évidence sur les
premières exploitations minières chalcolithiques des Cabrières dans l’Hérault (Ambert,
Carozza 1996). Enfin, les préoccupations de ces mineurs préhistoriques étaient en général
l’accès, l’éclairage, la ventilation et surtout l’évacuation des eaux.
Une fois l’abattage accompli, les activités de traitement mécanique ou minéralurgie
avaient lieu, souvent proches de la mine afin d’éviter des pertes d’énergie liées au transport 16.
Il s’agissait tout d’abord de trier visuellement le minerai de sa gangue, pour le concasser
finement sur des enclumes en pierre puis le laver dans des bassins afin de concentrer les
éléments métalliques grâce à leur densité (Domergue 2008, p. 143).
1.2.2.3. Métallurgie des alliages cuivreux
Ces matériaux, débarrassés d’une partie des stériles, étaient acheminés à un centre de
traitement disposant de bas-foyer ou de fours de fusion. Cette évacuation de la gangue par la
fusion scorifiante produit des matériaux indésirables, les scories. Pour ce faire sont utilisés
des fondants (flux) à différentes étapes du processus. On a longtemps pensé en suivant un
raisonnement évolutionniste que les hommes préhistoriques étaient uniquement capables de
chauffer du cuivre natif et de réduire des minerais oxydés plutôt que ceux sulfurés comme la
chalcopyrite et le falherz 17 (Ibid., p. 153). En effet, il suffit d’être en atmosphère réductrice
(étouffée) aux environ de 1000°C pour les oxydes et les carbonates alors que les sulfures
nécessitent une opération d’oxydation préalable (Mohen 1990, p. 74-75). Le grillage des
sulfures ne doit pas être mené à terme sous peine de rencontrer des problèmes dans
l’extraction du cuivre. On procède ensuite dans un four à la fusion pour matte, qui peut se
répéter plusieurs fois pour obtenir le métal. Les minerais polymétalliques peuvent donner lieu
à des processus invoquant d’autre aspects ou filières comme celle du plomb (fig. 13).
16 Rothenberg dans le cas de l’activité minière de Timna, montre que sur 20 kg de minerai on ne récupère que 2 à 4 kg de métal, soit 80 à 90% de matière non désirée (cité par Montero-Fenollos 1998).
17 Le « cuivre gris » des mineurs, de composition polymétallique comprenant souvent du souffre, de l’argent, du fer et d’autres éléments chimique.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
27
La maîtrise des pyrotechnologies et des atmosphères a été empruntée à une activité
connexe, la cuisson céramique. L’évolution des fours et des foyers n’est pas bien connue. Non
contente des surprises que réservent les découvertes archéologiques 18, la littérature a
tendance à user de doublons lexicaux apportant une confusion non souhaitée au propos.
Cependant, la température théorique de fusion du cuivre dépassant le pouvoir de chauffe des
1000°C d’un feu naturellement « réducteur » n’est permise que par une flamme oxydante que
l’on avive avec un apport d’oxygène de l’air (Tylecote 1987, p. 107). Cet enjeu à été très tôt
compris par les métallurgistes qui ont usé de dispositifs d’aération naturelle en exposant les
fours aux vents dominants ou encore anthropiques avec chalumeaux et tuyères actionnés par
des soufflets en matériau périssable.
Le métal de cuivre épuré avait ensuite pour destination l’atelier du « bronzier 19». La
littérature invoque alors l’arrivée de produits semi-finis : les lingots, dont l’on ignore souvent
les compositions. Car c’est dans ces barres de métal, que des éléments parfois indésirables ou
d’autres fois désirés et ajoutés lors des opérations de réduction permettaient l’obtention des
alliages. En effet, ces compositions sont elles intentionnelles ? Dans le cas d’alliages
accidentels, on peut privilégier la qualité du ou des minerais ou bien le recyclage d’artéfacts
métalliques en fin de vie. Cependant, d’autres procédés ont été mis en évidence comme la co-
réduction de deux minerais (Thornton, Lamberg-Karlovski 2004, p. 51) dans le même foyer
ou bien le mélange de deux lingots aux compositions à peu près connues afin de donner un
alliage intentionnel. La littérature ancienne présentait une évolution linéaire d’un cuivre non
allié ou impur du chalcolithique au bronze à l’étain quelques millénaires plus tard.
Aujourd’hui, on considère plutôt des alliages binaires comme le Cu-As, le Cu-Pb, Cu-Sn, Cu-
Ag 20 ternaires avec le Cu-As-Pb, Cu-Sn-Pb voire quaternaire Cu-As-Sn-Pb. Récemment Z. El
Morr a montré pour le bronze moyen du Levant qu’il existait des recettes d’alliage adaptées
selon la fonctionnalité des objets, leur caractère prestigieux ou des considérations d’ordre
économique (El Morr 2011).
18 La question s’est posée sur les installations sidérurgique médiévale du XVIème de Castel-Minier dans le
Pyrénées Ariégeoises ou du minerai de fer naturellement riche en carbonne a été réduit dans des bas-foyer
inattendus (Florian Tereygeol, communication personnelle)
19 L’artisan qui travaille non seulement le bronze mais aussi les alliages cuivreux.
20 Dans la suite, cuivre (Cu), arsenic (As), étain (Sn), plomb (Pb), argent (Ag).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
28
La phase de mise en forme commence avec la coulée de l’alliage en fusion dans un moule
et s’achève par la déformation mécanique de l’ébauche obtenue. Lors de cette première étape
qui concerne la fonderie, de nombreuses préparations sont nécessaires. Il faut tout d’abord
disposer d’un creuset en terre réfractaire avec des dégraissants spécifiques et mixtes qui lui
confèrent une résistance aux hautes températures, ainsi qu’une certaine souplesse pour
résorber l’énergie des chocs (infra 3.2.2.2). Dans un second temps il faut préparer le moule
qui peut être permanent ou détruit avec l’opération (Pernot 1998, p. 108). Des techniques
telles que le moule ouvert, « bivalve », avec noyau, « assemblé à pièces multiples », la fonte
au « sable » et la « cire perdue » sont autant de possibilités permettant à l’artisan de rendre sa
production efficace et de s’affranchir de contraintes comme le phénomène de contre-
dépouille 21.
Enfin, le combustible nécessaire pour porter le métal dans le creuset à une haute
température fait l’objet d’un soin particulier. Le fondeur doit choisir des matériaux déjà
préparés par séchage et torréfaction, comportant un très haut taux de carbone et de faibles
pourcentages d’humidité, souffre, poussière et cendres. Il doit savamment préparer son
chargement avec une alternance métal-combustible et éviter les « feux creux » qui ont
tendance à rendre l’apport calorique hétérogène (Rama 2004, p. 106).
Une fois ces composants rassemblés, le processus pouvait s’initialiser. Quelques éléments
cruciaux méritent attention. Au cœur du brasier surgit un paradoxe : comment concilier des
espèces chimiques au point de fusion bas, comme l’étain et l’arsenic 22, avec le cuivre qu’il
faut maintenir en surchauffe à 1300°C, dans un creuset qui supportera difficilement (même
avec les meilleures préparations) des températures de plus de 1250°C (Andrieux 1991,
p. 120) ? Une réponse des artisans a été de mettre les éléments les plus volatiles au fond et de
chauffer le creuset par le dessus en inclinant les tuyères et tubes à vents de manière à ne pas
bruler ses parois. Par la suite, juste avant de couler l’alliage en fusion, il fallait être capable
d’extraire le creuset du four ou de pouvoir le faire basculer dans les entonnoirs de coulée des
moules préalablement réchauffés à 300-400°C. Ceci afin d’annuler le choc thermique et
réduire le coefficient de refroidissement linéaire auquel est soumis le métal dans les canaux de
coulée.
21 Forme du moule telle qu’elle s’oppose au démoulage. 22 L’arsenic très volatile sublime à 180°C
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
29
Une fois l’ébauche en métal obtenue, il ne reste plus qu’à la déformer, à chaud de
préférence voire à « froid 23» en fonction des propriétés de l’alliage et de ses impuretés en
usant de séquences de martelage sur des outils réactifs (Pernot 1998, p. 113). Des recuits de
cristallisation sont nécessaires pour homogénéiser la structure du métal et continuer la
déformation sans risquer sa fracturation. Ceux-ci peuvent être de plusieurs ordres, allant de la
recristallisation incomplète à complète selon les espèces présentes dans l’alliage, la
température et la durée d’exposition à la chaleur.
Lorsque l’artisan a mis en forme une arme ou un outil qui présente une partie
fonctionnelle, il peut choisir de la renforcer en appliquant un martelage à « froid » continu
ayant pour but de tasser la matière.
En toute fin de processus prennent place les finitions qui peuvent consister en l’ébarbage,
le polissage, l’affutage des tranchants, la perforation des trous de fixation. Toutes ces étapes
laissent des stigmates qui permettent de retracer une partie des procédés, sous réserve que la
corrosion du métal ne soit pas trop avancée (El Morr 2011).
23 Cela n’exclut pas un réchauffement de l’objet en cours de production en deçà ses points de
recristallisations et de fusion.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
30
2. INVENTAIRE TECHNOLOGIQUE
“Within these ‘hidden treasures,’ you will see some of the most
remarkable archaeological finds in all of Central Asia. These pieces
are not only artistically splendid, but also unravel significant elements
of the mystery of their ancient creators and owners and thus our
ancient shared past.”
Hiebert, Afghanistan, crossroad of the ancient world, 2011, p. 55
“The composition of the materials can give far more unambiguous
information on the technology of the process that produced them than on the
society that made and use them.”
Craddock, Early metal mining and production, 1995, p. 1-2
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
31
2.1. Protocole opératoire
Cette sous-partie présente le mode opératoire retenu pour traiter le sujet dans ce chapitre.
Après un bref état de la documentation et des informations exploitables, la procédure de
l’inventaire technologique sera exposée. Enfin, les contextes des sites avec une activité
métallurgique ou des artefacts métalliques disposants d’analyses seront brièvement décrits,
constituants l’unité retenue du corpus bibliographique.
2.1.1. Documentation convoquée
2.1.1.1. Le matériel via la bibliographie
La difficulté principale que présente l’étude s’origine dans le matériel que l’on traque, qui
ne sera manipulé que virtuellement alors qu’il eut été souhaitable de l’avoir au moins en main.
En effet, à part quelques publications attentives, les artefacts sont décrits sommairement avec
des contextes larges voir inconnus, des photos ou dessins de qualité moyenne jusqu’à
l’absence de publication et pour couronner le tout, des problèmes relatifs aux fouilles qui
finissent par révolter certains chercheurs (Salvatori 2007).
La bibliographie en général présente des objets en métal qui peuvent être retrouvés dans
quatre grands contextes : l’habitat, le funéraire, les « cachettes » et enfin « isolés » (Chernikh
1992, p. 23). Dans le cas de la production on sera concerné par le matériel retrouvé et
considéré lato sensu : des produits, semi-produits ou déchets dans les étapes de fabrication
mais également et surtout les rares installations fouillées.
2.1.1.2. Les catégories et typologies
Les études typologiques à large spectre ont été initiées par R. Maxwell-Hyslop dans les
années 40-50 considérablement améliorées sur le plan méthodologique par J. Desahyes
menant jusqu’à la conséquente synthèse de G. Gernez sur le Proche et Moyen-Orient (Gernez
2007). Plus spécifiquement en ce qui concerne les artefacts métalliques en Asie Centrale et
Iran, on peut compter sur M.-H. Pottier pour la Bactriane, F. Tallon pour Suse et récemment
un ouvrage de synthèse en allemand sur Sapalli-dépé par K. Kaniuth (Pottier 1984 ; Tallon
1987 ; Kaniuth 2006). Un autre classement sur critères fonctionnels du matériel qui comprend
la vaisselle, les outils, la parure et une catégorie « autres » (Miller 2009, p. 252-253) attire
l’attention sur la diversité des approches employées.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
32
Les types peuvent être réels, fondés sur les productions d’un atelier ou virtuels, reposants
sur des problématiques relatives à un ensemble clos (Djindjian 2011, p. 223-224). Les grandes
catégories d’objets qui peuvent paraître des truismes tels « les outils », « les armes » et la
« parure » peuvent être mis à mal si l’on décide de les considérer selon leurs potentiels usages
plutôt que leur fonction théorique. En renversant les valeurs, les armes deviendraient alors des
« outils » de combat (El Morr 2011, p. 219). Enfin la tentation de discriminer des artefacts
utilitaires versus de prestige comme dans certaines anciennes études sur le chalcolithique
(Shalev 1994) doit être sérieusement tempérée : tous les objets fabriqués sont « utiles » que
cela soit matériellement ou socialement dès le moment où ils répondent à un besoin.
2.1.2. Découpage technologique et culturel
2.1.2.1. Des informations technologiques
Le terme technique ne doit pas être confondu avec technologie même si dans la
phraséologie orale on a tendance à y avoir indistinctement recours par pure commodité. Le
suffixe –logos apporte l’idée du discours. En effet, si le technicien est le praticien des
techniques, le technologue en est le scientifique (Pigeot 2011, p. 154). Il n’est pas inutile de
préciser que ce registre sémantique a connu une dépréciation considérable dans l’histoire de la
recherche avec la discrimination entre sujets « nobles » concernant les activités de l’esprit et
« ignoble » s’intéressant aux activités manuelles (Digard 2004, p. 169-170).
L’approche technologique s’est condensée dans les travaux du préhistorien André Leroi-
Gourhan et ses suivants. Le mouvement est né dans les années 70 en réaction aux typologies
et statistiques excessives d’objets et d’attributs (Pigeot 2011, p. 157). En 1964 dans Le geste
et la parole, Leroi-Gourhan utilise « chaine opératoire », qui sous sa cursive n’est qu’un
pratique synonyme de « technique ». Le terme sera capté par les ethnologues du groupe
« Technique & Culture » avant d’être retransmis aux archéologues dans les années 1980
(Djindjian 2011, p. 60). La technique ou chaine opératoire est ainsi envisagée par Leroi-
Gourhan comme un médiateur entre la société, sa culture et son environnement.
La recherche archéologique a souvent étudié les phénomènes technologiques en lien avec
les cultures. Les trois niveaux d’analyse traditionnels de la technique du bronzier sont : la
« province technique » où l’on observe des pratiques homogènes sur une période donnée, le
site métallurgique qui entretient des relations avec d’autres centres de production de lingots
ou d’extraction de minerai et enfin les productions spécialisées où les semi-produits utilisés
doivent avoir des propriétés particulières pour produire des artefacts spécifiques
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
33
(Mohen, Walter 1998, p. 119-120). Chernikh quant à lui, utilise deux degrés d’analyse : le
« metallurgical province » une gigantesque entité avec des productions métallurgiques
similaire sur une longue durée, puis le « focus » où des artefacts et des métaux semblables
sont produits par un groupe d’artisan (Chernikh 1992, p. 7). Dans cette dernière notion, il fait
la distinction entre le focus qui travaille uniquement le métal et celui qui pratique les activités
d’extraction, en ajoutant des intermédiaires pour les relier. Ces modèles présentent en général
les mêmes informations selon un découpage différent.
2.1.2.2. Comparaisons spatiale et temporelle
Suite à ces précisions, il est possible d’introduire la démarche que l’on souhaite proposer.
Sur le versant spatial, le présent travail mise sur deux termes moins connotés que centre et
périphérie : zone focale et zone interface dont l’unité d’observation de base sera le site avec
des phases larges (fig. 14).
La zone focale est constituée d’une région aux variations géographique réduite. Il s’agit
d’un territoire dans lequel a été interprété la « civilisation de l’Oxus » ou B.M.A.C sur des
critères matériels et qui s’étend dans les piémonts du Kopet Dagh, dans les oasis de la
Margiane et les deux rives de l’Oxus en Bactriane. Les sites suivants ont été retenus : Altyn
Dépé, Gonur-Dépé et Togolok, Sappalli-Dépé et Dzarkutan, Shortughai.
La notion de zone interface, permet d’établir des comparaisons. On peut distinguer trois
pôles à géométrie et influence variable en fonction des époques : l’interface iranienne au
sud-ouest, l’interface harappéenne au sud-est et l’interface steppique au nord. Cette dernière
faisant l’objet d’une recherche autrement vaste vers le Nord ne sera qu’évoquée, cette étude
concerne comme l’indique son titre l’Asie Centrale méridionale. Ces zones contiendront alors
des sites ponctuels choisis pour leur éclairage spécifique dans le domaine de la métallurgie :
Tépé Hissar, Shahdad, Shahr-i Sokhta et Harappa.
La composante temporelle sera également évoquée mais très large en âge du bronze
ancien, moyen et récent. En effet les datations des contextes métallurgiques et les phasages
sont inégaux en fonction des régions. Dans le piémont du Kopet Dagh, en Margiane et même
en Bactriane, ce sont les phases du site de Namazga qui font en général autorité (supra
1.1.2.3).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
34
2.1.3. Unités de base : les sites retenus
2.1.3.1. Sites de la zone focale
Altyn-Dépé, situé dans le piémont nord-est du Kopet Dagh, a été découvert par Semenov
en 1929, la première fouille ne commençant qu’en 1951 avec la tranchée ouverte par Ershov.
Cette « colline d’or » présente une occupation du chalcolithique moyen (Namazga II, 4000-
3500) jusqu’au bronze moyen (Namazga IV-V) atteignant une superficie de 25 à 30 ha
(Salvatori et alii 2002, p.70). Des missions russes (Karakum expedition) et italo-turkmène
(université turkmène et IsIAO 24) ont contribué à la connaissance technologique du métal sur
le site, le seul de la zone focale avec des témoins de pratiques métallurgiques bien
documentées. Ce site fera également l’objet d’une analyse plus détaillée dans l’étude de cas
(infra 3.).
Gonur-Dépé non loin de Togolok dans le Murghab, estimé entre 30 et 50 ha et interprété
comme « capitale » de la Margiane a été découvert par Sarianidi qui visitait l’oasis proche de
Takhirbaj en 1972 (Kohl 1984, p. 20). Le site est situé 60 km au sud de la ville turkmène
actuelle de Mary. Il sera fouillé en 1988 avec l’archéologue américain Hiebert pour en
préciser les datations attribuée au bronze récent. Il faut cependant sérieusement envisager la
possibilité d’une datation plus haute du bronze moyen (Namazga IV-V). Sarianidi y a dégagé
une architecture monumentale dans la partie nord et des contextes funéraires qui ont révélé
des artefacts en métal dont il subsiste quelques timides analyses et reproductions graphiques.
On y associe l’étude du matériel du site voisin de Togolok, 10 km au sud.
Sapalli-Tépé et Dzarkutan, 30 km au nord, dans la plaine du Surkhan-Daria sur la rive
droite de l’Oxus datent de l’âge du bronze moyen au bronze récent. Ils ont été fouillés par
Askarov dès 1977 puis repris par une mission germano-ouzbek sous la direction de Huff et de
Shajdullaev depuis 1994 (Teufer 2005, p. 200). Les fouilleurs ont exhumé une architecture
monumentale et des sépultures à Dzarkutan. Le site de Sapalli est devenu la référence
culturelle de la région pour le bronze récent. Ses premières phases montrent des liens avec la
Margiane puis le sud du Tadjikistan et les steppes dans les niveaux plus tardifs.
24 “Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente” de Rome.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
35
Shortughai, dans la province de Takhar au nord-est de l’Afghanistan a été découvert par
l’U.R.A 25 n°10 en 1975 et publié par Francfort (1989). Il est situé sur la rive gauche de
l’ Oxus dans la plaine d’Aï Khanoum. Les datations montrent une occupation de 2200 à 1700
c'est-à-dire de la fin du bronze moyen au début du bronze récent. La colline « A » révèle des
installations de nature purement harappéenne lors de ses premières phases ce qui a été
interprété comme un avant-poste commercial de l’Indus, alors que sur le tell « B », la
signature est plutôt bactrienne dès la première moitié du 2ème millénaire.
2.1.3.2. Sites de la zone interface
Tépé Hissar est un site localisé dans la plaine du Gorgan au sud-est de la mer Caspienne.
Fouillé dans les années 30 par Schmidt, il a révélé une architecture monumentale et
domestique et 1500 tombes du chalcolithique à l’âge du bronze soit du milieu du 5ème
millénaire au début du 2ème millénaire. Des études de surface de l’artisanat lithique et lapidaire
du lapis-lazuli ont été réalisée de 1972 à 1975 permettant d’en comprendre l’organisation des
aires de production (Tosi 1984, p. 29).
Shahdad, dans le désert du Lut marque la limite méridionale de cette étude. Découvert
dans les années 70 par A. Hakemi, il a révélé un site métallurgique d’exception en 1977. Les
datations sur l’assemblage céramique montrent que ses activités artisanales se sont déroulées
de la deuxième moitié du 3ème jusqu’au début du 2ème millénaire (Hakemi 1992, p. 130).
L’aire d’activité fouillée aurait été beaucoup plus importante mais la déflation éolienne a
érodé les parties marginales du site.
Shahr-i Sokhta, « le village brûlé » en persan, situé dans le désert du Seistan, dans le sud-
est de l’Iran à fait l’objet de fouilles dès la fin des années 60 par des missions italienne et
iranienne. C’est entre autre sur ce site que Lamberg-Karlovski a découvert des tablettes proto-
élamites et que la céramique grise commune à Tureng-Tépé a été exhumé. Les premiers
objectifs visaient le dégagement d’un ensemble architectural puis s’orientèrent sur l’étude du
mobilier et des activités artisanales sur un empan temporel s’étalant entre 2400 à 2000 av. n.è
soit le début du Bronze Moyen (Namazga IV au Turkménistan).
25 Unité de Recherche Archéologique.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
36
Enfin on s’intéressera au site d’Harappa, éponyme et foyer de la civilisation urbaine
harappéenne, situé sur le système fluvial de l’Indus et du Ghaggar-Hakra au nord-est du
Pakistan. Découvert par James Lewis, un explorateur de la compagnie des indes au XIXème
siècle, il a été fouillé par Meadow puis par H. M.-L. Miller à la fin des années 90 (Miller
2005). Le site à été sectionné pour récupérer les briques préhistoriques afin de servir de
ballast pour le chemin de fer de Lahore-Multan fin du XIXème. On s’interessera
particulièrement à la période 3C, arrêtée entre 2200 et 1800 av. n.è, ce qui correspond au
bronze moyen (Namazga IV et V au Turkménistan).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
37
2.2. Zone focale
Cette sous partie décrit les techniques métallurgiques attestées sur les sites précédemment
présentés de la zone focale. On a recours ici aux installations ou aux analyses physico-
chimiques qui peuvent renseigner sur les traitements appliqués aux artefacts. Quelques
informations seront inférées d’éléments typologiques. On traitera des aires métallurgiques
d’Altyn-Dépé (étude détaillée infra, partie 3.) ainsi que les analyses des objets de Gonur-Dépé
avec Togolok, de Sapalli-Dépé avec Dzarkutan et de Shortughai.
2.2.1. Altyn-Dépé
2.2.1.1. Bronze ancien
Le site a été découpé en plusieurs quartiers artisanaux (fig. 15). Les niveaux du secteur 5
datés de la fin du chalcolithique au bronze ancien (Namazga III à IV) ont livré dans un
contexte d’habitat des outils lithique destinés au travail du métal (Kirco 1988, p. 44-47). Cette
activité, associée à un traitement de minerai aurait été effectué dans l’habitat eu égard à
l’outillage lithique constitué de broyeurs, de marteaux et de massettes, de mortier pilon et de
roche abrasive même si aucune trace de scorie ou de fonderie n’ont été répertoriées. Les
activités liées au feu se seraient déroulées selon les auteurs à l’extérieur de l’habitat. Les
artefacts retrouvés dans les sépultures locales ont été directement interprétés comme issues de
la production.
2.2.1.2. Bronze moyen
Étiqueté comme contemporain de Namazga IV-V, le « copper mound » ou cluster AS2,
localisé au sud du tell (fig. 15), à livré de nombreux fragments, résidus et objets finis
métalliques en présences de scories et de granules de cuivre. Cependant ces découvertes n’ont
été accompagnées que de très peu de paroi de four et d’aucun moules. L’interprétation
traditionnelle est que l’on a affaire à une aire de recyclage chargée de sélectionner et refondre
les chutes et objets avec au moins un four de fusion. Cependant des analyses postérieures ont
montré notamment avec la présence de sulfures que des réductions épisodiques pouvaient
avoir lieu (Salvatori et alii 2002, p. 86).
De plus, du minerai de galène et de la litharge, permettent de déduire un autre aspect de la
métallurgie à Altyn-Dépé, la filière du plomb (certains artefacts en contiennent jusqu’à 40%).
Cette tradition semble remonter au chalcolithique (Namazga I à III) comme à Ilgynly-Dépé un
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
38
site à quelques kilomètres au sud où des éléments en cuivre ont été retrouvés conjugués à des
fragments de lingot de plomb (Ibid.).
L’emploi de l’alliage Cu-As a été préférentiel par rapport aux objets en Cu-Sn plus rares.
Enfin si les études soviétiques présentaient la difficulté de forger des artefacts contenant du
Pb (Chernikh 1992), la structure métallique des objets analysés a montré que le martelage
pouvait être effectué à chaud ou à froid.
Sur le secteur AS7 des creusets reconstitués montrent des capacités variables avec des
traces de Sn et Pb mettant en évidence l’usage possible d’un alliage ternaire de Cu-Sn-Pb.
L’arsenic est retrouvé dans les creusets mais pas dans les parois de four, ce qui indique qu’il
était ajouté comme alliage plutôt qu’élément issu de la réduction du minerai (Masioli et alii
2006, p.172). On reviendra en détail sur ces éléments dans l’étude de cas.
2.2.2. Gonur-Dépé et Togolok
2.2.2.1. Bronze moyen
A défaut d’avoir des installations ou des témoins directs de l’activité métallurgique, des
analyses ont été effectuées sur quelques artefacts issus de plusieurs contextes, funéraires ou
habitats à Gonur-Dépé et Togolok. Si les anciennes datations du site sont relativement jeunes,
du bronze récent à l’âge du fer, on doit cependant selon les chronologies les plus récentes
attribuer ces artefacts au bronze moyen (Namazga IV et V).
Sur 203 objets en métal collectés, l’assemblage se compose de 16% d’accessoires de
toilette (miroirs, épingles, fioles) (fig. 16, 1-3), 12% de parure (4, 5 ; 7, 8), 15% de sceaux (6),
0.5% de haches (10, 11), 7.5% de lames et 37% d’outils domestiques (9) (Hiebert, Killick
1993, p. 186-187). En revanche si l’on considère ces proportions par la masse 26, ce sont les
haches qui deviennent saillantes ; les objets étudiés faisant respectivement 196 et 271 g.
Les analyses d’une épingle ont montré qu’elle aurait pu contenir un alliage avec du plomb.
Celui-ci laissant des micro-perforations en s’altérant dans la structure du métal. Elle aurait été
directement coulée puis incomplètement recristallisée après déformation.
Des bracelets en Cu-As avec une forme en « C » et des bagues ont été coulés et travaillés à
chaud puis recuits incomplètement sans martelage à froid. Ces objets présentent des duretés
26 La prise en compte de la masse est souvent négligée dans les études.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
39
peu élevées de 90 à 100 HV. L’aspect métallurgique du plomb se retrouve en général dans la
parure.
Un sceau compartimenté, coulé d’un seul bloc sans déformations postérieures est soudé à
un anneau. Les analyses ne précisent pas de quel type de soudure/brasure il s’agit.
Une hache à œillet « cérémonielle » décorée qui pèse 196 g, aurait été fondue « sur
place » (Hiebert, Killick 1993) sans autre traitement à part des finitions qui ont enlevé les
barbes de jointure du moule. Une autre hache à œillet sans recherche esthétique particulière
mais très symétrique et bien plus pesante, de 271 g a fait l’objet d’analyses. Sa structure
révèle une mise en forme par fonderie, avec un travail de meulage à son extrémité.
Des lames en revanches ont été travaillées à froid, ce qui a augmenté la dureté jusqu'à 150
en moyenne voir 200 HV sur le bord de la partie tranchante. Quelques analyses ont montré un
alliage Cu-As. Des ciseaux dont la lame a été travaillée par au moins deux à trois passes de
martelage et de recuit montrent une dureté qui s’élève à 150 HV.
La plupart de ces artefacts contiennent des sulfures qui indiqueraient une source
particulière d’approvisionnement. Il reste difficile de savoir si l’As est une impureté ou ajouté.
2.2.3. Sapalli-Dépé et Dzarkutan
2.2.3.1. Bronze récent (tardif 1)
La plupart des traces d’activités proviennent des contextes de l’âge du bronze tardif 1.
Dans la localité de Sapalli-Dépé (fig. 17), la salle 52 du bâtiment central a révélé 3 fours avec
des résidus métallurgiques. Sur le site de Dzarkutan, 8 fours ont été retrouvés interprétés
comme une aire de fonderie en raison des résidus de coulée. En revanche, même si l’analyse
des scories n’est malheureusement pas encore connue, aucune trace de réduction du minerai
n’est attestée, ce qui pencherait pour une importation des matières premières (Kaniuth 2006
p. 161). Certaines tombes du bronze tardif 1 présentent des objets de compositions similaires,
ce qui permet d’affirmer qu’ils ont été fabriqués à partir du même bronze, lors d’une
production événementielle.
2.2.3.2. Bronze récent (tardif 2)
A Dzarkutan sur la colline 8 (fig. 18), des traces d’activités ont été retrouvées pour la
période du bronze tardif 2, ce qui a été corrélé avec de nombreux objets miniatures qui
présentent des compositions similaire. Auraient-ils été fondus eux-aussi lors d’une même
campagne ? En revanche, certains artefacts présentent des compositions extrêmement variées
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
40
comme les perles, qui ont été interprétés plutôt en termes d’acquisitions personnelles au cours
de la vie des individus inhumés (Ibid., p. 163).
Les artefacts sont de facture soignée et contiennent des teneurs d’étain relativement
élevées. Des objets prestigieux sont mis en forme directement par fonderie, par exemple la
fameuse hache à œillet n° 92 (fig. 19, 1) retrouvée à Sapalli-Dépé qui contient 8,5% de Sn. De
plus, comme partout ailleurs en Asie Centrale méridionale, on retrouve des miroirs qui se
caractérisent par une poignée solidaire en métal (fig 19, 2). Cet élément pourrait poser la
question d’un manche en matériau périssable dans les autres versions retrouvées en
Turkménie.
2.2.4. Shortughai
2.2.4.1. Bronze moyen
Cette première étape qui correspond à l’occupation de la colline « A » a révélé un
assemblage d’artefacts en alliage cuivreux (fig. 20). Ceux-ci étudiés par les contributions de
Berthoud, Maxwell-Hyslop et Liszak-hours ont été ventilés en 11 catégories (Francfort 1989,
p. 148).
a) Les épingles même si composées majoritairement de nombreux fragments,
l’assemblage révèle 23 tiges de section plutôt ronde (fig. 21). De tels éléments ont été
coulés pour ensuite être déformés par des phases de martelages en fonction de la forme
d’origine et de la section finale souhaitée. Ces occurrences techniques d’origine
chalcolithique ont été documentées et enrichies par des études à Tépé Yahya
(Thornton, Lamberg-Karlovski 2004, p. 50). La tête de certaines épingles est aplatie et
peut comporter des représentations zoomorphe élaborées ce qui sous-entend l’usage
d’une technique comme la cire perdue.
b) Les tiges (poinçons ?) semblent faire l’objet de ces mêmes techniques notamment en
raison de la présence d’extrémités plates (0.2 cm d’épaisseur) et d’une partie mésiale
de section carrée ou rectangulaire de 0.5 cm en moyenne avec peut être un
renforcement de la structure du métal.
c) Les tiges creusées sont composées de feuilles de cuivre roulées et soudées. Cette
technique qui n’a pas fait l’objet d’analyse mériterait plus d’attention.
d) Les lamelles et
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
41
e) les plaques, pour lesquelles on peut encore adresser la question des lingots feuilles
sous réserve de plus amples analyses métallographiques.
f) Les couronnes
g) Les crochets supposent une action de torsion. En l’absence d’analyses, il est difficile
d’envisager plus de détails.
h) Les rasoirs
i) Les miroirs avec une étape de finition essentielle qui peut être deviné, le polissage,
sensé améliorer les propriétés réflexives de tels objets (fig. 22, 1).
j) Les pointes de flèches efficaces supposent un martelage de l’extrémité vulnérante,
mais il n’est pas exclu de trouver des objets mis en forme uniquement par fonderie
(fig. 22, 3)
k) Les lames et poignard en général on fait l’objet de forgeage à chaud suivi d’un travail
d’écrouissage sur les parties opérantes afin de les renforcer (fig. 22, 2).
Dans ces niveaux du bronze moyen, des éléments en plomb ont été retrouvés. Cependant
on rencontre des difficultés pour savoir si cet aspect de la métallurgie non-ferreuse avait lieu
sur le site ou si les lingots étaient importés d’un autre centre de production.
2.2.4.2. Bronze récent
Les artefacts de la phase III présentent des compositions autant de cuivre arsénié que de
bronze à l’étain ce qui peut être mis en relation avec les gisements à proximité du Zerafshan
(Francfort 1989, p. 208).
Des fragments de creuset et de cuivre ont été retrouvés dans tous les niveaux du site. Eu
égard aux petites capacités de ces conteneurs, il s’agirait plutôt de creusets destinés à
l’orfèvrerie (Ibid., p. 251).
De l’hématite et des scories ferreuses ont été également mises en évidence alimentent un
débat sur des origines précoces à la métallurgie du fer dans les derniers niveaux de l’âge du
bronze de la civilisation de l’Indus. Cependant il faut y présenter deux objections : l’hématite
peut servir de fondant (flux) pour la métallurgie du cuivre et un minerai polymétallique à forte
composante ferreuse peut générer une scorie à haute teneurs de fer.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
42
2.3. Zone interface
2.3.1. Tépé Hissar
2.3.1.1. Bronze ancien
Le site de Tépé Hissar (fig. 23) aurait très tôt présenté une métallurgie d’alliage cuivreux
avec ou sans arsenic. Ce dernier élément entrerait dans la composition des artefacts via
l’usage du « speiss » un alliage de fer arsénié (Thornton, Rehren, Pigott 2009). Les fouilles
réalisées par Tosi sur la colline sud ont révélé des parois de four, des scories, des fragments
d’un moule à « plusieurs canaux » et d’une hache à œillet (fig. 24) (Berthoud et Alii 1980, p.
105). Deux fondants étaient utilisés par les métallurgistes de Tépé Hissar afin d’extraire les
espèces indésirables du métal, des paillettes de quartz et l’hématite.
Les études menées sur les parois ont montré que les températures atteintes étaient
comprise entre 1 220 et 1 250°C, suffisantes pour former un lingot au fond du four. Deux
lingots ont à ce titre été exhumés dans le bâtiment brûlé au nord du site, avec des
compositions de Cu-As contenant un fort pourcentage de Pb. L’aspect de la métallurgie du
plomb est attesté en plus de celui du cuivre révélant peut-être en filigrane la coupellation du
plomb argentifère (Ibid.). On a déjà évoqué cette association de filières sur le site d’Altyn-
Dépé et on y reviendra abondamment dans l’étude de cas (infra Partie 3).
2.3.1.2. Bronze moyen
Les éléments présentés-ci avant sont retrouvés aussi partiellement pour les périodes les
plus récentes tout en montrant une augmentation des quantités d’As et de Pb dans les alliages.
Cela a été interprété comme une adaptation à la demande plutôt que le fruit d’une innovation
technologique. Une interaction entre les différentes activités artisanales a été illustrée par le
recyclage des scories vitrifiées en nuclei qui ont fait l’objet de débitages comme le silex.
Les artefacts évoluent en terme de quantité et de qualité avec de nouvelles formes de la
phase I à III (Schmidt 1933, p. 377). Les têtes de masse réalisées à la cire perdue avec des
motifs de plus en plus détaillés sont particulièrement évocatrices (fig. 25, 1, 2). Cependant,
une technique plutôt élaborée concernant les épingles à la phase II est abandonnée à la phase
III (fig. 25, 3, 4). Elle consiste en l’obtention d’une barre fine à l’extrémité bifide en « Y »
dont deux branches ont été soigneusement enroulées sur elle-même formant deux spirales
opposées.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
43
2.3.2. Shahdad
2.3.2.1. Bronze ancien au bronze moyen
C’est la localité « D » au nord-est du site « A » (fig. 26) qui a livré les éléments les plus
précieux en matière d’installation métallurgique. En effet, on y a retrouvé un atelier et des
fours in-situ qui ont fait l’objet d’une publication. La surface totale de cette architecture
occupe une surface d’environ 25 x 25 m composée de 29 pièces appartenant à cinq ateliers
distincts (fig. 27) rebaptisés « complexes » quelques années plus tard (Hakemi 1997, p. 85).
La plupart des ateliers comprennent les mêmes installations. Deux fours : un de fusion et
de fonderie, des espaces de stockage pour le minerai, l’argile et le combustible. Quelques
variations demeurent comme un four additionnel dédié à la fonte du métal dans les ateliers B,
C et D, ou parfois un stockage en moins mais leur configuration est similaire. On dénombre
ainsi 5 fours de fusions et 8 fours de fonderie avec leur vaisselle céramique, ce qui peut
donner une idée du potentiel de production si l’on émet l’hypothèse que ces complexes
fonctionnaient simultanément et à temps plein. Le minerai est en général stocké dans des
jarres, à fond plat soudé au sol, dans les cellules à proximité du four principal.
Le four de fusion de la chambre 6 dans l’atelier n° 2 donne un aperçu des caractéristiques
des fours de l’âge du bronze. Une plateforme de 1,30 x 0,85 x 0,28 m contient la très légère
dépression quadrangulaire où est réduit le minerai (fig. 28). Celle-ci, composée de terre
réfractaire afin de résister aux hautes températures alimente un canal pentu, destiné à évacuer
le flot métallique vers un creuset en contrebas (Hakemi 1992, p. 123-124).
En revanche, les fours destinés à la fonte présentent 4 variations : le modèle I exemplifié
par la chambre 2 aurait permis selon le fouilleur de refondre le métal obtenu à l’étape
précédente dans un récipient surélevé perforé 27, en disposant un creuset en dessous (fig. 29,
1). Le modèle II et IV, d’une forme respectivement rectangulaire et ovalaire présentent une
légère dépression centrale avec une conduite latérale qui dirige le métal vers un puits (fig. 29,
2). Le modèle III est composé d’une chambre arrondie qui épouse une fosse de 0,65 m de
profondeur (fig. 29, 3). Il présentait une voute et la constante toujours présente exposée du
canal de coulée.
27 « Leaky bowl on two legs » en anglais
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
44
La céramique métallurgique livrée par la fouille comprend des creusets variables en forme
et contenance (fig. 30, 1-4), un moule de hache à œillet retrouvé in-situ (5) mais aussi des
bouchons (6) pour réguler le débit des canaux. Des scories, parfois des cendres et des résidus
de coulée en cuivre ont également été retrouvés.
C’est un minerai d’apparence verte, la malachite qui était utilisé dans ces ateliers. L’état
des scories témoigne des étapes du processus de la fusion du minerai à la fonte du métal.
Quelques analyses montrent que les artefacts sont composés d’un cuivre avec des teneurs
en As, Pb, Sn inférieures ou égales à 1%. Le métal montre une structure poreuse
caractéristique du cuivre non allié. Ces résultats attestant d’alliages non-intentionnels selon
l’auteur témoignerait d’installations datant de l’ « âge du cuivre » (Hakemi 1992, p. 112).
2.3.3. Shahr-i Sokhta
2.3.3.1. Bronze ancien
Comme à Tépé Yahya et Shadad, Shahr-i Sokhta dans l’est de l’Iran présente une
métallurgie de cuivre arsénié. Il n’y a pas de matériel in-situ qui pourrait indiquer des ateliers
métallurgiques mais l’éparpillement (fig. 31) des témoins privilégierait des contextes de
production multiples (Artioli et alii 2003, p. 179).
Un « slag cake » (fig. 32, 1) qui aurait épousé une forme de cône tronqué lors de son état
semi-liquide permet d’aller dans le sens de l’utilisation de fours de fusion. Il semblerait
correspondre à une matte et un bouton de cuivre (fig. 32, 2). Les installations permettant
d’étayer une telle éventualité n’ont pas été retrouvées. Cependant, les granules de cuivres
piégées dans les scories mettent en doute le concassage systématique afin d’en récupérer les
précieuses granules. Les témoins de l’activité de fusion ont été retrouvés à même le sol en
contexte d’habitat ce qui a introduit la possibilité d’avoir affaire à une production de type
domestique (Berthoud, Craddock et alii 1980, p. 121).
Il semble que l’usage de fondants calcaire et ferreux soit privilégié.
L’étude des compositions des scories couplées à celle des minerais a permis de déterminer
que le cuivre exploité provenait d’oxydes mais également de cuivre natif de sources
distinctes. Les gisements au sud dans le Balouchistan présentant toutes ces occurrences
sembleraient être des candidats idéaux pour s’associer à la métallurgie de Shahr-i Sokhta.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
45
Un morceau de galène et un minerai contenant de l’argent ont été identifiés permettant de
proposer une autre filière métallurgique sur le site (Artioli et alii 2003, p. 183). De plus, la
quantité d’arsenic relativement faible dans les minerais semble être plus importante dans
quelques artefacts, témoignant peut être de l’ajout délibéré d’arsenic dans les recettes. Cet
élément alimente le débat autour du « speiss ».
2.3.3.2. Bronze moyen
Les indicateurs deviennent plus fréquents lors de la phase III vers le milieu du 3ème
millénaire, localisés dans l’ouest et le sud du site. Cette fréquence montrerait un déplacement
et un regroupement de l’activité (Tosi 1984).
2.3.4. Harappa
2.3.4.1. Bronze moyen
Lors de la période 3C (2200-1900) contrairement aux autres sites, Harappa ne présente pas
d’activité de fusion ni réduction de minerai mais plutôt les premières étapes de fonderie des
alliages cuivreux (Miller 2005, p. 248). Ces activités ont pris place au sud de la colline E du
site (fig. 33).
Il n’y aurait pas de preuves matérielles pouvant attester d’un contrôle institutionnel sur la
production alors qu’on pourrait s’attendre à ce qu’une telle activité soit encadrée. (Miller
2005, p. 249).
Les fragments de moules simples, de creusets et de fours présentent souvent des traces de
rubéfaction. Les creusets de forme curviligne ou linéaire possèdent une pâte composée de
dégraissants végétaux et minéraux, de la paille et de la silice. Certains creusets ont même
fondu pendant leur utilisation. Leur forme et leur taille en faisait des éléments pouvant être
basculés plutôt que déplacés, sans qu’il soit possible d’y reconstituer les becs verseurs. La
taille des creusets ne semble pas être standardisée, elle se distribue entre deux extrêmes ; des
très petit faisant environ 5 et 10 cm de diamètre intérieur et les grands avec des ouvertures
larges de 10 à 18 cm. Qui façonne ces céramiques ? Des potiers ou les métallurgistes eux
même ? (Miller 2005, p. 250). Les fragments du bord et les parois intérieures vitrifiées
témoignent d’une chauffe par le dessus.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
46
Les moules retrouvés sont ouverts composés d’argile sableuse et de paille pour en assurer
la résistance mécanique. Ils ne présentent pas de signes de forte chauffe et l’exemplaire
H2000/2742-2 semble proposer au métal une forme rectangulaire aplatie pour des objets à
forger comme les haches et les lames. Miller soulève un point intéressant, la possibilité que la
fonte du cuivre soit destinée à créer des lingots secondaires car aucune occurrence primaire
n’a été retrouvée sur le site (Miller 2005, p. 251).
La dureté des artefacts a bien pu être modifiée soit par un travail de forge en aval soit par
un alliage en amont, ce qui résulte de choix technologiques (Miller 2005, p. 248). Les
techniques de fabrications apparaissent moins « complexes » qu’en Iran selon l’auteur.
Des sources multiples ont été envisagées pour le minerai notamment via la corrélation de
signatures isotopiques des éléments métalliques analysés et les gisements au nord du
Rajasthan (Miller 2009, p. 247). Les alliages sur ce site sont douteux, car des artefacts
similaires présentent aussi bien du cuivre pur qu’arsénié sans compter l’influence du
recyclage ou d’un possible gisement polymétallique. Les métallurgistes ont très tôt connu les
propriétés des différents métaux en fonctions de leur provenance, notamment leur couleur.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
47
2.4. Synthèse et mise en perspective
Tout d’abord, la zone focale, malgré le peu de données liées aux installations semble de
toute évidence ne pas pratiquer directement l’extraction minière. Cette interprétation va dans
le sens de ce que Chernikh nomme « metalworking focus » (1992, p. 8). Les sites se procurent
les matières probablement par des échanges soit avec le sud iranien, l’est indo-afghan ou le
nord en fonction de leur position géographique et de leur affinités culturelles. Cependant on
constate qu’au bronze moyen, les sites ont peu à peu tendance à s’approprier la chaîne
opératoire en amont du simple travail du métal. Cela passe par des fontes et recyclage intra-
site mais également jusqu’à la réduction de minerai importé. L’hypothèse soutenue en général
est celle selon laquelle du chalcolithique au bronze ancien, l’impulsion dynamique provenait
des secteurs miniers qui détenaient le monopôle de l’activité (Berthoud, Cleuziou et alii
1982), redistribuant du métal « prêt-à-déformer ». Ensuite, se furent les grands centres
urbains, capables de dégager des excédents de l’activité agricole qui mirent la main sur ces
technologies et furent en mesure d’en sponsoriser le processus, sans pour autant retransmettre
les améliorations techniques (Ibid., p. 52).
A Suse dans le vase à la cachette des barres et des tiges montrent qu’il existe bien des
semi-produits (fig. 34, 1) qui permettent d’obtenir des barres et des bâtonnets
(Tallon 1987, p. 195). Selon les études de Thornton et Lamberg-Karlovski (2004), la barre
d’origine carré pouvait être déformée de deux manières : avec un martelage extensif sur le
pourtour pour progressivement en arrondir les arrêtes ou bien rabattre les coins de la section
pour les faire se rejoindre formant un « V ».
Les volumes d’alliage ne sont pas les mêmes lorsque l’on a affaire à une métallurgie
lourde consacré à des éléments volumineux comme les haches cérémonielles massives, en
comparaison des quantités plus restreinte que nécessitent les petits outils et l’orfèvrerie. Les
fameux lingots plano-convexes (fig. 34, 2) fournissent de précieuses informations sur les
desseins des artisans. Ceux-ci sont très standardisés du côté de Suse et ne varient que modulo
le rendement des minerais traités dans le four, s’accumulant sur une hauteur plus ou moins
importante. Force est de constater qu’ils possèdent souvent les mêmes diamètres entre 10 et
12 cm, ce qui leur confère une masse moyenne oscillant entre 1,900 et 2,100 kg (Tallon 1987,
p. 195).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
48
Malgré quelques valeurs extrêmes de 1,440 et 7,130 kg l’ordre d’idée de cette masse,
amène à réfléchir sérieusement aux objets retrouvés en Turkménie. Lorsque l’on considère le
maximum c'est-à-dire les haches de Gonur de moins de 0.300 kg voir le minimum avec les
épingles qui ne s’estiment qu’à quelques grammes, combien de moules pouvaient donc être
coulés lors de l’opération de fonderie, en fonction des capacités des creusets et des volumes
totaux à remplir ?
Dans certains cas, les artefacts ont tous été fabriqués pour des occasions, par exemple lors
d’une campagne. Cependant dans la zone interface ou des clusters entier de production
métallurgique ont été dégagés, force est de constater que des moyens sont mis en œuvre pour
atteindre une production continue relativement standardisée, témoignant d’une connaissance
réelle des propriétés de l’alliage en fusion et de son refroidissement.
Les alliages en revanche, sont beaucoup moins homogènes que prévus. Ils peuvent être en
Cu-As, Cu-Pb, Cu-Sn et Cu-Sn-Pb en fonction des époques et surement des possibilités
d’approvisionnement. Dans la zone interface, Hissar bien que sur la route commerciale qui
transit par le Khorasan ne présente pas d’artefact contenant de l’étain mais plutôt des alliages
en cuivre arsénié. Peut-on en déduire qu’il n’y a pas d’étain qui circule entre la Caspienne et
le Kopet Dagh ? L’As, en tant qu’élément d’alliage intentionnel est confirmé par son
introduction forcée dans les recettes via la technique du speiss (Thornton, Lamberg-Karlovski,
2004). Il est aussi attesté sur d’autres sites comme par exemple Arisman (Rehren, Boscher,
Pernicka 2012).
Un autre phénomène remarquable, la conjugaison généralisée de la filière du plomb à celle
du cuivre s’observe a partir du bronze moyen dans la zone focale alors que sa présence est
extrêmement variable pour les sites de la zone interface. Le plomb et d’autres impuretés ont
longtemps été considérés par les chercheurs russes comme une limite au forgeage à chaud
(Terekova 1981, p. 316). Cependant le bref état des données semble démontrer le contraire car
des objets contenant du plomb ont subi des tassements intentionnels de matière sur plusieurs
sites.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
49
3. ETUDE TECHNOLOGIQUE A
ALTYN-DEPE
“Capt. Dixon was neither a mineralogist, geologist, miner nor
metallurgist; for otherwise his description would have differed much from
what he has communicated. This is another illustration of the difficulty, not
to say impossibility, of describing from personal observation a simple
metallurgical process with necessary detail and accuracy in the absence of
previous special education on the part of the observer.”
Percy, 1870, The metallurgy of lead, p. 294
« […] on sent l’archéologue interrogatif et quelque peu déçu
que face aux autres vestiges d’une métallurgie épanouie on ne
trouve que de piètres vestiges à la genèse des objets. »
Andrieux, 1991, Le feu : métal et céramique, p. 118
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
50
3.1. Proposition d’un modèle
Pour l’étude de cas et à titre expérimental, on propose une alternative dans l’exploration
technologique de la métallurgie. Il s’agit de trouver des unités d’investigation permettant de
mieux rendre compte du processus de fabrication.
3.1.1. De la technologie lithique à métallurgique
3.1.1.1. Appareiller deux mondes théoriques
L’enjeu est d’appareiller le découpage technologique tel qu’il est utilisé pour décrire les
« chaînes opératoires » lithique au processus théorique de production du métal et des alliages
cuivreux. Si l’on reprend la définition de Leroi-Gourhan « La technique est à la fois geste et
outil, organisés en chaîne, par une véritable syntaxe, qui donnent aux séries opératoire à la
fois leur fixité et leur souplesse. » (1964, p. 164). L’originalité apportée par la fusibilité du
matériau que l’on traite engendre des difficultés à arrêter strictement le début du processus.
En effet, si le nucleus de silex évolue vers une réduction de volume (de matière utilisable)
pour être ponctué par un arrêt du débitage, le métal en revanche peut théoriquement effectuer
une ou plusieurs boucles techniques via le recyclage avant d’être finalement utilisé comme
objet puis abandonné. De même, les préparations effectuées au niveau local de la matière
lithique se retrouvent plus larges et diverses avec le façonnage de la vaisselle métallurgique et
la diversité des outils et des installations formant ce que l’on nommera des « techniques
connexes ».
3.1.1.2. Recherche d’un découpage pertinent
Le besoin de rendre le vocabulaire moins ambivalent et plus précis se fait tôt ressentir
chez le technologue. En effet, il ne faut pas confondre de nombreux termes au sens voisin
comme chaîne technique et chaîne opératoire. Le premier nommé aussi « schème technique »
correspond à l’étiquetage d’une production dans un contexte culturel donné alors que le
second s’entend comme l’ensemble de toutes les actions élémentaires de l’homme sur la
matière, sorte de programme à plusieurs échelles. Ces niveaux, du plus général au plus
élémentaire sont les phases et sous-phases, séquences et sous-séquences, séries (gestes
répétés) et enfin l’atomos de l’étude technologique ; le geste 28 (fig. 35).
28 Précision de terminologie communiquée par Nicole Pigeot lors du stage de technologie lithique au centre d’Etiolles en mai 2013.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
51
3.1.2. Un modèle heuristique
3.1.2.1. Procédure de présentation des données
Bien que de nombreux modèles présentent des approches complémentaires, dans cette
étude de cas on se contentera de réutiliser une catégorisation de la production utilisable sur les
faits matériels. Selon Tosi, on a : 1) des installations, 2) des outils, 3) des déchets et résidus,
4) des produits semi-finis, 5) des stocks, 6) des matériaux recyclables (Tosi 1984, p. 24).
Ces données matérielles ont un contexte spatial et temporel. On n’abordera pas dans le
détail la question du temps et de la chronologie car l’on ne dispose pas de tout les éléments
pour trancher sur le phasage, surtout lorsqu’il s’agit de ramassages de surface. De plus, non
content de présenter exhaustivement les données contenues dans la littérature on s’attachera à
rendre compte de l’éloquence des silences archéologiques.
3.1.2.2. Interprétation technologique
On souhaite introduire dans cette étude de cas les prémices d’une réflexion sur les niveaux
d’interprétation dans le domaine technologique métallurgique. En effet on se rend bien
compte que l’intérêt est soit porté au matériel avec des interprétations extrêmement détaillées
soit très générales, produisant des simplifications drastique. On propose alors le premier jet
d’un modèle contenant un intermédiaire permettant le passage entre les deux extrema.
Tout d’abord le plus fin, le niveau micro-technologique décompose la chaîne technique
pour suivre la chaîne opératoire qui conduit de la matière à un type morpho-fonctionnel
d’objet. Il s’agit de l’ensemble des interprétations inféré des restes matériels renseignant sur
les gestes effectuées par l’artisan dans le ou les contextes de production.
Un niveau méso-technologique permet la comparaison de plusieurs « chaînes
techniques ». Il opère à une échelle intermédiaire afin de déterminer des variantes culturelles
au sein d’une même région voir d’un site si différentes filières de métallurgie y coexistent.
C’est la passerelle théorique entre le niveau d’interprétation détaillé et global.
Enfin, ce que l’on définit comme un niveau macro-technologique formé par l’ensemble
des chaînes opératoires relatives à la métallurgie. Celui-ci a vocation à caractériser les
techniques d’un ensemble culturel étendu cohérent utilisant des filières globalement
semblables. Ce sont les interprétations générales que l’on tirera en conclusion finale.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
52
3.2. Données matérielles et analyses
Les données qui vont être présentées vont sembler redondantes mais il s’agit d’entrer un
peu plus dans le détail. Elles sont principalement extraites de Kirco (1988), Salvatori et alii
(2002) ainsi que de Masioli et alii (2006). On traitera en général de l’âge du bronze moyen sur
lequel on a le plus de données tout en évoquant explicitement les découvertes qui
correspondent à l’âge du bronze ancien. On procède à la distinction entre données présentes et
absentes.
3.2.1. Installations
Sur le sud du tell, les secteurs AS1 et AS2 ont livré des restes de fours piétinés in situ,
avec de nombreux témoins de l’activité métallurgique particulièrement en AS2 avec des
sulfures.
Toujours en AS2, 12 fragments vitrifiés de parois de four utilisés pour fondre des alliages
cuivreux (fig. 36, a) montrent une absence d’As et quelques occurrences de l’élément Sn, en
revanche, on n’a pas retrouvé de restes de tuyères ou de tubes à vent.
3.2.2. Outils et éléments connexes
3.2.2.1. Lithique
Au bronze ancien, dans le secteur 5 on a une collection d’outils en pierre destinée au
concassage de minerai jusqu’à le réduire en poudre (fig. 37, 1-3).
De plus, des outils avec ou sans poignées liés à la déformation plastique du métal (fig. 37,
4-6) ont été exhumés. Des objets pour étirer les feuilles métalliques ont aussi été retrouvés
comprenant des laminoirs et des poussoirs lithiques (fig. 37, 7-10) sur des enclumes
spécifiques ainsi que des marteaux et des matrices miniatures (fig. 38, 1-7). Des pierre
abrasives spécifiques pour les lames ainsi que pour l’aiguisage des pointes (fig. 38, 8-11).
Aucun outil lithique ni moule n’a été identifié pour le bronze moyen.
3.2.2.2. Céramique
Au bronze moyen dans le secteur centre nord-ouest AS7, 10 fragments de creusets ont été
trouvés permettant de restituer quatre formes (fig. 39, 1) allant du bol hémisphérique à
conique tronquée. L’ouverture probable selon les reconstitutions s’échelonne entre 10 et
16 cm ce qui donne des volumes estimés entre 1 300 à 3 300 cm3 (fig. 39, 2).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
53
Les études des techniques céramiques ont montré qu’elles ont été montées au colombin,
composées équitablement d’argile humide et de plusieurs dégraissants. Une composante
minérale avec du quartz broyé et organique végétale (et/ou animale ?) dont le revêtement de la
surface extérieure a été lissé avant d’être exposé à une cuisson oxydante. En dessous la
surface intérieure vitrifiée indiquant une forte température au niveau de la gueule du
conteneur, les analyses montrent plutôt une chauffe en atmosphère réductrice. Les analyses
des parois ont mis en évidence du Cu, Pb, As et quelques occurrences de Sn.
Deux autres fragments de creusets sont rapportés par A. N. Egor’Kov mais ne sont pas
publiés. L’un présenterait des traces de cuivre non allié et le second de fortes teneurs en
plomb.
Aucun moule en argile n’a été retrouvé.
3.2.3. Déchets
Aucune scories dans les niveaux du bronze ancien, même si le secteur 10 dans le nord-est,
présente une activité de concassage de minerai.
Des restes en lien avec le travail du métal sont répertoriés dans toutes les zones d’activités
du site. Il s’agit de chutes de cuivre, de fragments d’objets finis et de scories. Ces dernières
localisées en AS2 et sur le « Copper Mound » sont riches en Cu et Fe (fig. 36, b).
Aucun fragment de moule identifié.
3.2.4. Produits semi-finis
3.2.4.1. Filière du cuivre
Deux fragments de lingot en cuivre ont été retrouvés sur plusieurs secteurs (AS 488 et
ASE 6). En AS2, un fragment provenant d’une feuille de bronze a été trouvé.
3.2.4.2. Filière du plomb
Du minerai de plomb, la galène a été découverte accompagnée d’un fragment de « lingot »
de litharge en AS2 (fig. 39, 3).
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
54
3.2.5. Produits finis
Dans les couches du bronze ancien sur le secteur 5 dans le nord-est, les outils sont
généralement des alènes de section carrée avec une ou deux extrémités opérante (fig. 40, 8-
12), des lames avec un tranchant (1,2,4), une « dague » aiguisée avec une lame en forme de
dard et une languette plate (3), des fragments de lime (6, 7), une herminette (5).
Toujours au nord-est, des objets de parure du bronze ancien ont été retrouvés dans les
tombes locales fabriqués à partir de barres ou de bâtonnets en métal (fig. 40, 13-15), plaque de
métal arrondie et concave/convexe interprété soi comme miroir sans manche ou comme
élément de décoration qui s’accroche sur le vêtement, ainsi que des sceaux et cachets.
Les ramassages de surface ont mis au jour des fragments de tête d’épingle en forme
animale avec des traces de polissage, deux fragments de vase polis en AS2 et ailleurs. Des
fragment de sceau compartimenté en bronze contiennent du plomb. Des morceaux de scalpels
qui ont fait l’objet de métallographies révèlent des grains polygonaux organisés (fig. 41, 1).
Les objets trouvés en contexte funéraire sont considérés « détruits » à l’âge du bronze car
ils n’ont pas fait l’objet de recyclage.
3.2.6. Matériaux recyclables
Dans cette catégorie, on a trouvé 12 granules ou éclaboussures renversées sur le sol à
différentes phases du processus de fonderie (fig. 41, 2 voir aussi fig. 34, a) montrent un
alliage As majoritaire
Un résidu de coulée à l’extrémité d’un joint à deux canaux d’un moule a été sectionné ou
séparé des objets obtenus, indiquant une probable fonte à la cire perdue.
Enfin, 4 fragments de petites barres en alliage cuivreux ont été trouvés pour la plupart en
AS2.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
55
3.3. Interprétation des données
On formule ici les interprétations qui résultent de ce nouveau regard sur les données. A
titre expérimental on présentera ainsi les schèmes technologiques que l’on peut décemment
inférer des périodes observées.
3.3.1. Au bronze ancien
Au nord-est du site, deux filières distinctes cohabitent en contexte d’habitat. Elles n’ont
que peu de rapport, l’une concerne le traitement de minerais pour obtenir des solutés à usages
« alchimique 29 » ou pigmentaire et un artisanat qui fabrique des petits objets ; outils ou
parures. Cette première activité qui consiste à concasser du minerai en poudre grâce au
broyeur, n’est ni une filière de métallurgie ni de travail du métal et il convient de la délimiter
soigneusement.
A cette même époque en revanche, un travail du métal s’effectue sur des barres et plaques
de faible à moyenne épaisseur (0,5 cm environ) préformés. Plusieurs traitements sont alors
appliqués (fig. 42). Tout d’abord les corrections de la préforme et de sa section par des
martelages que l’on suppose « à chaud », des élongations par « laminage », des rétreintes sur
un outil dormant (installation de convexité/concavité sur un tas rond ou une salière). Des
techniques liées à l’entretient et aux finitions sont également attestées : le martelage léger à
froid avec ou sans intention de réduire l’épaisseur, l’aiguisage et l’affûtage. On peut supposer
les traitements de rectification et d’abrasions comme par exemple le polissage sans pouvoir en
déterminer avec exactitude la maille finale. Enfin, on ne sait pas si les artisans procédaient à
un écrouissage fonctionnel volontaire des objets en l’absence de mesures de dureté sur les
objets.
Les informations culturelles en l’état actuel des données sont minces. Il n’est pas possible
de savoir d’où viennent les préformes traitées, ni si une fonderie occasionnelle opérait sur le
site au bronze ancien. Cependant force est de constater que ces techniques et l’outillage
lithique, sont héritées des innovations du néolithique et chalcolithique, dénotant une certaine
inertie, sans organisation visible ou discrimination remarquable des activités.
29 Pour être moins évasif, on entend par là tout ce qui se rapporte à la préparation d’une quelconque solution
pour son application décorative (corps ou objet) ou consommation, avec tous les sous-entendu qu’implique de
telles notions comme cataplasmes, poisons, etc. dont on confiera volontiers la discussion aux spécialistes.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
56
3.3.2. Au bronze moyen
Au bronze moyen, les données permettent d’avancer la coexistence de deux filières
métallurgiques sur le site. Si des réduction/oxydation de minerai ont bien eu lieu, le processus
de fonderie a vraisemblablement été mené de la fonte d’éléments métalliques alliées issus de
lingots et de chutes recyclées jusqu’à la coulée. Il y a surement eu des recettes avec du Pb et
de l’As, voir d’alliage ternaire Cu-Sn-Pb. On ignore cependant dans quelles formes étaient
coulés les matériaux fusibles même si la technique de la cire perdue est probable. En outre on
pourrait proposer d’autres types de moules ayant pour but de fragmenter des lingots, de
moyenne a grosse taille en semi-produits, pouvant faire immédiatement l’objet d’un travail du
métal sur bâtonnets, câbles ou feuilles. Des fragments de moules restent à découvrir sur ce site
pour confirmer ou infirmer cette proposition.
Cependant les témoins de nature plombeuse esquissent la possibilité d’avoir en sus affaire
à un aspect métallurgique du plomb sans objectif argentifère. Pouvant être aisément réduit et
fondu, ses restes d’activités très discrets, il semble difficile d’exclure cette filière de
l’observation car connexe à celle du cuivre.
La déformation plastique est attestée dans les objets mais ses étapes et les outils ne sont
pas retrouvés directement sur le site. Peut-être les techniques du dinandier étaient-elles en
cours d’adoption mais cela nécessiterait également plus de données pour être confirmé.
Néanmoins, l’écrouissage du métal a été démontré dans les métallographies, par un forgeage à
chaud et ce malgré la présence du plomb vu comme une contre-indication.
La filière technologique connexe de la céramique permet d’ouvrir certaines questions
d’ordre culturel déjà exploitées par les auteurs à savoir qui réalise de tels objets ? En allant un
peu plus loin, on peut se demander comment sont coordonnées ces deux activités. Est-ce le
potier à qui l’on donne des consignes spécifiques pour cette vaisselle spécialisée sous la forme
d’une « commande » ou bien au contraire est ce le métallurgiste qui devient apprenti, se
formant aux techniques de façonnage auprès de l’autre bord des pyrotechnologies ? Ces
éléments pourraient très bien remettre en question ce qui semblait être acquis dans le domaine
de la spécialisation, ajoutant un troisième pôle de « spécialisation secondaire » en plus de
l’activité artisanale principale et de la production vivrière.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
57
CONCLUSION
Les sites étudiés ainsi que la tentative de refonte des données dans l’étude de cas d’Altyn-
Dépé semblent remettre en question quelques paradigmes métallurgiques généraux. La
métallurgie de ces contrées à l’âge du bronze, bien que se composant d’une lame de fond
commune héritée des traditions chalcolithiques, se caractérise localement par la variété de ses
réponses aux contextes, en faisant un phénomène nuancé et marginal.
Tout d’abord, à l’image du Proche-Orient, une discrimination géologique semble
départager un Iran au minerai cuivreux contenant de l’arsenic, contre un nord-est montagneux
afghano-tadjike aux gisements plutôt cupro-stannifères. À l’instar de la Mésopotamie, une
partie de la zone focale dépourvue de matières première est tributaire des réseaux d’échanges.
Elle se voit donc intégrée dans une maille plus large, au moins depuis la fin du chalcolithique
lorsque la métallurgie quitte les abords des sites d’extraction.
Néanmoins, les arcanes de la technique de fusion – début véritable de la métallurgie – ne
sont pleinement adoptés qu’au cours du bronze moyen dans les oasis d’Asie Centrale. Dans la
zone interface à l’ouest, l’initialisation de cette innovation a eu lieu au cours du chalcolithique
et du bronze ancien alors que dans l’est, les données révèlent que l’on a affaire à un autre
phénomène. Cette acquisition tardive par rapport aux « foyers métallurgiques » du Levant et
d’Iran semble témoigner d’un mécanisme de diffusion en provenance du sud-ouest. Même si
cette époque du bronze moyen permet de forclore une composante directe « proto-élamite »,
on ne peut cependant pas exclure un rapport entre le phénomène d’« Iran extérieur » et
l’adoption des processus en amont du travail du métal : la fonderie et la fusion.
L’heuristique technologique apporte des éclairages nouveaux sur la métallurgie dans les
deux zones étudiées. Tout d’abord elle permet de mettre l’accent sur l’aspect métallurgique du
plomb qui devient systématiquement associé au cuivre lors du bronze moyen sur tous les sites.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
58
De plus, au bronze moyen, l’intention d’alliage aux proportions éloquentes interroge les
liens entre recette, degré de connaissances des matériaux et objectifs des artisans. Ces
recettes, conjuguées à des installations standardisées, témoignent d’un savoir pérenne au tout
cohérent. Ainsi, le progrès métallurgique en Asie Centrale méridionale n’est pas tant de
découvrir dans certaines impuretés un partenaire privilégié pour la fonderie, mais d’avoir
plusieurs sources d’approvisionnement et par conséquent une plus grande liberté dans la
modulation des propriétés des artefacts. En investissant en amont sur la qualité des mélanges,
les métallurgistes s’assurent en aval une domestication accrue de la matière, c'est-à-dire, une
certaine prédétermination.
And last but not least, on s’autorise à froisser ici une croyance naïve sur la métallurgie
préhistorique, celle qui a attrait à l’accélération de l’inégalité sociale en lien avec les métaux.
En effet, contra une élite qui garderait les secrets techniques ainsi que les précieux outils dès
la découverte du métal, les éléments présentés dans ce travail amènent à proposer un scénario
bien divergent. Lors des premiers contacts avec les métaux, il se pourrait bien que tout
individu en mesure de se procurer la matière, ou des produits semi-finis, ait pu travailler à son
échelle, les quantités modestes nécessaires pour fabriquer les objets de parure et du quotidien,
par simple déformation plastique avec des outils lithiques. Peu à peu, l’élite imposa de
nouveaux standards sur les quantités et les échelles de production introduisant la fonderie. En
prenant le contrôle d’un matériau qu’elle convoitait, elle pouvait réduire à néant l’entreprise
domestique afin de l’organiser pour son propre compte. On peut alors formuler l’hypothèse
suivante : ce n’est pas le travail du métal mais l’apparition de la technique de fonderie avec
tout ce qu’elle implique de connexe sur un site qui révèle une inflexion dans l’organisation
sociale, dont il reste à préciser l’échelle et les modalités de contrôle.
Finalement pour répondre à la dernière question posée, malgré les attentes de ce travail, la
quantité et la qualité des informations ne permet pas de comprendre dans le détail les gestes
de l’artisan. Cela nécessiterait des études plus poussées sur les stigmates de production, ainsi
qu’un intérêt pour exhumer les artefacts avec leur contexte.
Néanmoins, ces résultats liminaires doivent d’être sérieusement tempérés. En effet, cette
étude largement exploratoire, cherchant à forcer les systèmes d’interprétation archéologiques
a également commis de nombreux impairs qu’il convient de soigneusement circonscrire.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
59
Primordialement, l’inégalité documentaire entre un bronze ancien mal connu et moyen
mieux représenté, floute les esquisses précédente. De plus, le corpus choisi comporte une
lacune monumentale : il n’intègre pas la composante majeure steppique qui permettrait de
comprendre le bronze récent. Enfin, le nombre réduit de sites et l’heuristique en construction
dans l’étude de cas ne permettent pas d’améliorer ces handicaps qui se conjuguent à une
asymétrie documentaire. Cette dernière est relative aux méthodologies, époques et objectifs
des fouilles archéologiques qui ont été observés, renseignant très rarement sur les mêmes
types de document.
Néanmoins afin de contourner ces difficultés, quelques pistes peuvent être proposées pour
la recherche future. Tout d’abord, il faudrait formuler une solide heuristique qui permettrait
d’extraire des typologies des invariants à caractères technologiques. Dans un second temps il
faudrait vraisemblablement envisager de construire une base de données, non pas uniquement
sur les artefacts, mais aussi sur les sites de productions en croisant toutes les données à
disposition sur le non-ferreux. En l’occurrence pour l’Asie Centrale, il faudrait incorporer aux
analyses les autres filières comme celle du plomb. Enfin, comme l’a proposé Z. El Morr dans
sa thèse, il faut conjuguer ces informations avec la recréation expérimentale permettant –
avec des hypothèses réfléchies – de proposer un timbre et une sonorité aux silences
archéologiques.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
60
BIBLIOGRAPHIE
AMBERT P., CAROZZA L., 1996, Origine et développement de la première métallurgie
française : Etat de la question, Archéologie en Languedoc, 20, p.43-56.
AMIET P., 1986, L'âge des échanges inter-iraniens 3500-1700 avant J.-C., Edition de la
Réunion des musées nationaux, Paris.
ANDRIEUX PH., 1991, La reconstitution des comportements techniques et thermiques :
des foyers pour la technologie du bronze, Archéologie expérimental, Tome 1 - le feu:
le métal, la céramique, actes du Colloque International Expérimentation en archéologie :
Bilan et perspectives, tenu à l'Archéodrome de Beaune les 6, 7, 8 et 9 avril 1988, Éditions
Errance, Paris, p. 118-122.
ARTIOLI D., GIARDINO C., GUIDA G., LAZZARI A., VIDALE M., 2003, On the exploitation
of copper ores at Shahr-i Sokhta (Sistan, Iran) in the 3rd millennium BC, in Jarrige C.,
Lefévre V (eds), South Asian Archaeology 2001, Éditions Recherche sur les
Civilisations, Paris, p. 179-184
AVERBOUH A., BRUN P., KARLIN C., MERY S., M IROSCHEDJI P. DE, 2006, Protocole de
comparaison des formes de spécialisation des tâches et d’organisation sociétale in
Spécialisation des tâches et société ? Technique & Culture n°46-47 2005-2006, p. 7-20.
BEAUNE (DE) S. A., 2011, Le processus de l’invention : approche cognitive, in Treuil R.
(dir.), L’archéologie cognitive. Techniques, modes de communications, mentalités, Editions
de la Maison des sciences de l’homme, Paris, p. 75-90.
BERTHOUD T., BESENVAL R., CARBONNEL J. P., 1977, Les Anciennes mines d'Afghanistan,
Paris : R.C.P n° 442, Commissariat à l'énergie atomique, Laboratoire de Recherche des
Musées de France, Unité de Recherche Archéologique n° 7.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
61
BERTHOUD T., BESENVAL R., CESBRON F., 1976, Les Anciennes mines de cuivre en Iran :
deuxième rapport préliminaire : prospection en Iran en 1976, Laboratoire de recherche des
musées de France ; Commissariat à l'énergie atomique, Unité de Recherche
Archéologique n°7.
BERTHOUD T., CLEUZIOU S., HURTEL L. P., MENU M., VOLFOVSKY C., 1982, Cuivre et
alliages en Iran, Afghanistan, Oman au cours des IVe et IIIe millénaires, Paléorient,
Vol. 8.2, p. 39-54.
BERTHOUD T., CRADDOCK P. T., HAUPTMANN A., MADDIN R., MUHLY J. D., PIGOTT V. C.,
STECH-WHEELER T., WEISGERBER G., 1980, Production, échange et utilisation des
métaux : Bilan et perspectives des recherches archéométriques récente dans le
domaine oriental, Paléorient, Vol. 6, p. 99-127.
BOPEARACHCHI O., LANDES C., SACHS C. (EDS), 2003, De l'Indus à l'Oxus : archéologie de
l'Asie centrale : catalogue de l'exposition, Lattes, Montpellier.
BOROFFKA N., CIERNY J., LUTZ J., PARZINGER H., PERNICKA E., WEISGERBER G., 2002,
Chapter 9 : Bronze Age tin from Central Asia: Preliminary Notes, in Boyle K.,
Renfrew C., Levine M. (eds), Ancient interactions : east and west in Eurasia, Short Run
Press, Exeter, p. 144-159.
BUTTERLIN P., 2003, Les temps proto-urbains de Mésopotamie : Contacts et acculturation à
l'époque d'Uruk au Moyen-Orient, CNRS Editions, Paris.
CHERNIKH E. N., 1992, Ancient Metallurgy in the USSR, Cambridge University Press,
Cambridge.
CHERNIKH E. N., 2009, Formation of the Eurasian steppe belt cultures. Viewed
through the lens of archaeometallurgy and radiocarbon dating in Hanks B. K.,
Linduff K. M. (eds), Social complexity in prehistoric Eurasia, Monuments, Metals and
Mobility, Cambridge University Press, p. 115-145.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
62
COSTIN C. L., 1991, Craft specialisation: issues in defining, documenting, and
explaining the organization of production in Shiffer M. B. (ed.), Archaeological method
and theory, 3, University of Arizona Press, Tucson, p. 1-56.
CRADDOCK P. T., 1995, Early metal mining and production, Edingburgh university Press,
Edimbourg.
DANI A. H., MASSON V. M. (EDS), 1992, History of civilization of Central Asia, vol. 1: The
dawn of civilization: earliest times to 700 B.C., PUF, Paris.
DIGARD J.-P., 2004, Anthropologie des techniques et Anthropologie cognitive, Etudes
rurales : 169-170.
DJINDJIAN F., 2011, Manuel d'archéologie : Méthodes, objets et concepts, Armand Colin,
Paris.
DOMERGUE C., 2008, Les mines antiques, La production des métaux aux époques grecque et
romaine, Picard, Paris.
EL MORR Z., 2011, La métallurgie du Levant au Bronze Moyen à travers les armes,
Université Bordeaux 3, Thèse.
FLUZIN P., DILLMAN P., 2012, Du minerai à l’objet, une lecture multidisciplinaire du
métal, in Beaune (de) S. A., Francfort H.-P. (Dir.), L’archéologie à découvert, CNRS
Éditions, Paris, p. 105-114.
FOURNIAU V., 2006, Qu'est ce que l'Asie Centrale ? Outre-Terre, n°16 (2006/3), 15-29.
FRACHETTI M. D., ROUSE L. M., 2012, Central Asia, the Steppe, and the Near East,
2500-1500 BC, in Potts D. T. (ed.), A companion to the archaeology of the Ancient Near
East, Vol. I & II, Wiley Blackwell, Oxford, p. 687-715.
FRANCFORT H.-P., 1984, The early periods of Shortugaï (Harappan) and western
Bactrian culture of Dashly, in Allchin B. (ed.), South Asian Archaelogy 1981,
Cambridge University Press, London, p. 170-175.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
63
FRANCFORT H.-P., 2003A, La Bactriane : le milieu, in Bopearachchi O., Landes C.,
Sachs C. (éds), avec Cayzac N., Millet F., De l'Indus à l'Oxus : archéologie de l'Asie
centrale : catalogue de l'exposition, Lattes, Montpellier, p. 21-26.
FRANCFORT H.-P., 2003B, La civilisation de l’Asie Centrale à l’âge du Bronze et à l’âge
du Fer, in Bopearachchi O., Landes C., Sachs C. (éds), avec Cayzac N., Millet F., De
l'Indus à l'Oxus : archéologie de l'Asie centrale : catalogue de l'exposition, Lattes
Montpellier, p29-34.
FRANCFORT H.-P., 2005, La civilisation de l’Oxus, et les Indo-Iraniens et les Indo-
Aryens en Asie Centrale, in Fussman G., Kellens J., Francfort H.-P., Tremblay X.,
Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale, séminaire organisé au Collège de France en
janvier 2001, Institut de Civilisation Indienne, Edition De Boccard, Paris, p. 251-329.
FRANCFORT H.-P., 2009, L’âge du bronze en Asie centrale, La civilisation de l’Oxus,
Anthropology of the Middle East, Vol. 4(1), p. 91-111.
FRANCFORT H.-P., KUZ'M INA E. E., 1999, Du nouveau dans la chronologie de l'Asie
centrale du Chalcolithique à l'âge du Fer, Evin J., Oberlin C., Daugas J.-P., Salles J.-F.,
C14 Archéologie, Actes du 3ème Congrès International, Lyon 6-10 avril 1998, Presses de
l'Université de Rennes, Rennes, p. 467-469.
GARDIN J.-C., LYONNET B., 1978, La prospection de la Bactriane orientale (1974-1978) :
Premiers résultats, Mesopotamia, p. 13-14.
GERNEZ G., 2007, L’armement en métal au Proche et Moyen-Orient (des origines à 1750 av.
J.-C.), Thèse de doctorat d’archéologie, vol. I & II.
HAKEMI A., 1992, Copper smelting furnaces of the bronze age in Shahdad, in Jarrige
C. (ed.) South Asian Archeology, papers from the tenth international conference of
South Asian archaeologists in Western Europe, Musée national des arts asiatiques
Guimet, 3-7 July 1989, Prehistory Press, Madison, p. 119-132.
HAKEMI A., 1997, Shahdad, Archaeological excavation of a bronze age center in Iran,
IsMEO, Rome.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
64
HANKS B. K., L INDUFF K. M. (EDS), 2009, Social complexity in prehistoric Eurasia,
Monuments, Metals and Mobility, Cambridge University Press.
HERBERT E. W., 1984, Red gold of Africa: copper in precolonial history and culture,
University of Wisconsin Press, Madison.
HIEBERT F., K ILLICK D., 1993, Metallurgy of Bronze Age Margiana, IASCCA
Information Bulletin, 19, Moscow, p. 186-204.
HOFFMAN B., M ILLER H. M.-L., 2009, Production and Consumption of Copper-base
Metals in the Indus Civilization, Journal of World Prehistory 22.3, p. 237-264.
KANIUTH K., 2006, Metallobjekte der Bronzezeit aus Nordbaktrien, Archäologie in Iran
und Turan 6, Verlag Phillip von Zabern, Mainz.
KOHL P., 2007, Making of Bronze Age Eurasia, Cambridge University Press, London.
K IRCHO L. B., 1988, The beginning of the early bronze age in southern Turkmenia on
the basis of Altyn-depe materials, East and West, 38(1-4), 33-64.
LEROI-GOURHAN A., 1964, Le geste et la parole - Technique et langage, Albin Michel,
Paris.
LHUILLIER J., 2005, Le matériel de type centre-asiatique dans la civilisation de l'Indus,
Mémoire de Maîtrise, Paris 1.
LUNEAU E., 2010, L'Âge du Bronze final en Asie Centrale méridionale (1750-1500/1450
avant n.è.) : la fin de la civilisation de l'Oxus, Thèse, Université Paris 1.
LYONNET B., 2001, Mari et la Margiane ou la circulation des biens, des personnes et des
idées dans l'Orient ancien à la fin du 3ème et au début du 2ème millénaire avant n.è., Thèse
d'habilitation à diriger des recherches, non publié.
MADDIN R., MUHLY J. D., STECH T., 1999, Early metalworking at Cayönü, in
Hauptmann A., Pernicka E., Rehren T., Yalçin Ü. (eds), The beginning of metallurgy,
Deutsch Bergbau Museum, Bochum, p. 37-43.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
65
MASIOLI E., ARTIOLI D., BIANCHETTI P., DI PILATO S., GUIDA G., SALVATORI S., SIDOTI
G., VIDALE M., 2006, Copper-melting crucibles from the surface of Altyn-depe,
Turkmenistan (CA 2500-2000 BC), Paléorient, Vol. 32.2, p. 157-174.
MASSON V. M., 1992, The environment, in Dani A.H., Masson V. M., (eds) History of
civilization of Central Asia, vol. 1 : The dawn of civilization : earliest times to 700 B.C., PUF,
Paris, p. 29-44.
M ILLER H. M.-L., 2005, Investigation copper production at Harappa: surveys,
excavations and finds, in Jarrige C., Lefèvre V. (éds) South Asian Archaeology 2001,
Editions Recherche sur les Civilisations, Paris, p. 245-252.
MOHEN J.-P., 1990, Métallurgie préhistorique, Introduction à la paléométallurgie, Masson,
Paris.
MOHEN J.-P., WALTER P., 1998, La métallurgie de l’Âge du Bronze sur le Fort-
Harrouard (Sorel-Moussel, Eure-et-loire, France), in Mordant C., Pernot M., Rychner
V. (éds), L’atelier du bronzier en Europe du XXe au VIIIe siècle avant notre ère. Actes du
colloque international Bronze ’96, Neuchâtel et Dijon, Tome II : Du minerai au métal,
du métal à l’objet, p. 117-122.
MONTERO-FENOLLOS J.-L., 1998, La Metalurgia en el proximo oriente antiguo (III y II
milenios a.C.), Aula Orientalis Supplementa, 16, AUSA, Barcelone.
NEZAFATI N., 2006, Au-Sn-W-Cu Mineralization in the Astaneh-Sarband Area, West
Central Iran. Including a comparison of the ores with ancient bronze artifacts from Western
Asia, PhD dissertation, Geowissenschaftliche Fakultät, Tubingen.
PARPOLA A., 1993, Margiana and the Aryan problem, IASCCA Information Bulletin, 19,
Moscow, p. 41-62.
PERCY J., 1870, The metallurgy of lead, John Murray, London.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
66
PERNOT M., 1998, L’organisation de l’atelier du bronzier, in Mordant C., Pernot M.,
Rychner V. (éds), L’atelier du bronzier en Europe du XXe au VIIIe siècle avant notre ère.
Actes du colloque international Bronze ’96, Neuchâtel et Dijon, Tome II : Du minerai
au métal, du métal à l’objet, Paris, p. 107-116.
PERNOT M., 1999, La métallographie, A la recherché du métal perdu, Editions Errance,
Paris, p. 65-69.
PIGOTT V. C., HOWARD S. M., EPSTEIN S. M., 1982, Pyrotechnology and culture change
at bronze age Tepe Hissar (Iran), in Wertime T. A., Wertime S. F. (eds), Early
pyrotechnology, papers presented at a seminar on early pyrotechnology held at the
Smithsonian Institution, Washington, D.C., and the National Bureau of Standards,
Gaithersburg, Maryland, April 19-20, 1979, Smithsonian Institution Press,
Washington, p. 215-236.
POSSEHL G. L., 2012, India’s relations with western empires, 2300-600 BC in Potts D.
T. (ed.), A companion to the archaeology of the Ancient Near East, Vol. I & II, Wiley
Blackwell, Oxford.
POTTIER M.-H., 1984, Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l'âge du Bronze,
Editions Recherche sur les Civilisations, Paris.
POTTS D. T., 1999, The archaeology of Elam: Formation and transformation of an ancient
Iranian State, Cambridge University Press, London.
POTTS D. T. (ED.), 2012, A companion to the archaeology of the Ancient Near East, Vol. I &
II, Wiley Blackwell, Oxford.
RAMA J.-P., 2004, Le bronze d’art et ses techniques, avec la participation de Berthelot J.,
Editions Vial, Paris.
RATNAGAR S., 2004, Trading encounters, Oxford University Press, New Dehli.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
67
REHREN T., BOSCHER L., PERNICKA E., 2012, Large scale smelting of speiss and
arsenical copper at Early Bronze Age Arisman, Iran, Journal of Archaeological Science
39, p. 1717-1727.
ROBERTS T. W., THORNTON C. P., PIGOTT V. C., 2009, Developpement of metallurgy in
Eurasia, Antiquity, Vol. 83, n° 322, p. 1012–1022.
SARIANIDI V. I., 1992, Food producing and other neolithic communities in Khorasan
and Transoxiana, in Dani A.H., Masson V. M. (eds), History of civilization of Central
Asia, vol. 1 : The dawn of civilization: earliest times to 700 B.C., PUF, Paris, p. 109-126.
SALVATORI S., 2007, About recent excavations at a bronze age site in Margiana
(Turkmenistan), Rivista di Archeologia [en ligne], Vol. 31, p. 11-28, Disponible sur :
http://www.bretschneider-online.it/rda/rda_pdf/rda_31/rda_07_salvatori.pdf
(Consulté le 22/05/2013).
SCHMIDT E. F., 1933, Tepe Hissar excavation 1931, The museum Journal, Vol. 23, n° 4,
University of Pennsylvania Philadelphia, p. 323-487.
SHALEV S., 1994, The change in metal production from the chalcolithic period to the
early bronze age in Israel and Jordan, Antiquity, 68 (228), p. 630-637.
TALLON F., 1987, Métallurgie susienne 1: De la fondation de Suse au XVIIIème siècle
av. n.è, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, Vol. I & II.
TEUFER M., 2005, The Late Bronze Age Chronology of Southern Uzbekistan. A
reanalysis of the Funerary Evidence, in Franke-Vogt U., Weisshaar H.-J. (eds), South
Asian Archaeology 2003, Proceedings of the Seventeenth International Conference of
the European Association of South Asian Archaeologists (7-5 July 2003, Bonn),
Linden Soft, Aachen p. 199-209.
TEREKHOVA , N. N., 1981, The history of metalworking production among the ancient
Agriculturists of Southern Turkmenia, in Kohl P. L. (ed.), The bronze age civilization of
Central Asia : Recent soviet discoveries, Armonk, New-York, p. 313-324.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
68
THORNTON C. P., LAMBERG -KARLOVSKY C. C., 2004, A New look at the prehistoric
metallurgy of southeastern Iran, British institute of Persian Studies Iran, Vol. 42, p. 47-
59.
THORNTON C. P., REHREN TH., PIGOTT V. C., 2009, The production of speiss (iron
arsenide) during the Early Bronze Age in Iran, Journal of Archaeological Science 36, p.
308-316.
TOSI M., 1984, The Notion of Craft Specialization and its representation in the
Archaeological Record of Early States in the Turanian Basin, in Spriggs M. (ed.),
Marxist perspectives in archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, p. 22-52
TYLECOTE R. F., 1987, The early history of metallurgy in Europe, Longman, London.
TYLECOTE R. F., MERKEL J. F., 1985, Experimental Smelting Techniques:
Achievements and Future, in Craddock P. T., Hughes M. J. (ed.), Furnaces and
Smelting Technology in Antiquity, London, British Museum. Occasional Papers n° 48,
p. 3-20.
WERTIME T. A., FRANKLIN A. D., OLIN J. S. (EDS) 1977, The search for ancient tin, seminar
march 14-15, 1977 organized by Theodore A. Wertime held at the Smithsonian
Institution and the National Bureau of Standards, U.S Government Printing Office,
Washington.
WRIGHT R. P., 1998, Crafting social identity in Ur III southern Mesopotamia, in Costin
C. L., Wright R. P. (eds), Craft and social identity, Archaeological papers of the
American Anthropological Association, 8(1), p. 55-69.
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
69
FIGURES
Figure 1 : Carte de l’Asie Centrale selon les Nations Unies
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/centrasia.pdf
(Consulté le 08/04/2013)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
71
Figure 3 : Carte des gisements de cuivre et d'étain en Iran
(Berthoud et alii 1982, p. 41)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
72
Figure 4 : Carte des prospections minières en Afghanistan
(d’après Berthoud, Besenval, Carbonnel 1977)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
73
Figure 5 : Carte des gisements d’étain en Asie Centrale
1 - Karnab ; 2 - Lapas ; 3 - Changali ; 4 - Mushiston (Boroffka et alii 2002, p. 140, fig 9.1)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
74
Figure 6 : Carte de l'exploration archéologique en Asie Centrale
Adapté de Tolstov 1962 par Kohl 1984, p. 19, map 2)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
75
Figure 7 : Le monde de l’Eurasie et de l’Asie Centrale à l’Âge du bronze en relation avec la Mésopotamie et l’Indus
(Frachetti, Rouse 2012, p. 688 fig. 36.1)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
76
Figure 8 : Périodisation globale de l'Asie Centrale de l'âge du bronze au fer ancien
(Luneau 2010, p. 85 tab. n°1)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
77
Figure 9 : Le phénomène métallurgique dans l’Ancien Monde
a - Exploitation du métal et occurrence naturelle, b - Diffusion de la technique de fusion (Pigott, Roberts, Thornton 2009, p. 1014 fig. a et b)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
78
Figure 10 : Schématisation conceptuelle des étapes de la métallurgie des alliages cuivreux, de l’extraction du minerai au dépôt archéologique
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
79
Figure 11 : Les diverses zones d'un gîte métallifère de type filonien en fonction de la circulation de l'eau : Schéma idéal en terrain homogène
(Domergue 2008 d’après Toilon, Béziat, Manguin 2004 p. 35 fig. 1)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
80
Figure 12 : Eléments principaux de datation minière
(Craddock 1995, p. 10 tab. 1.1)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
81
Figure 13 : Les étapes du traitement d'un minerai de cuivre de type falherz
(d'après F. Tollon 2007 dans Domergue 2008, p. 157 fig. 100)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
83
Figure 15 : Altyn-Dépé, topographie du site avec la localisation des activités
(d’après Masioli et alii 2006, p. 159)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
84
Figure 16 : Sélection des artefacts analysés de Gonur et Togolok
1-3 – éléments de toilette, 4, 5, 7, 8 – parure, 6 – sceau, 9 – lames & outils domestique, 10, 11 – haches (d’après Hiebert, Killick 1993)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
85
Figure 17 : Situation de Sapalli-Dépé
(Kaniuth 2006, p. 6 fig. 2)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
87
Figure 19 : Artefacts prestigieux de Sapalli-Dépé
1 – Hache à œillet n° 92, 2 – Miroir n° 3 (d’après Kaniuth 2006)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
88
Figure 20 : Site de Shortughai
(Francfort 1989, p. 5 fig. 1)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
89
Figure 21 : Sélection d’épingles et de perles en cuivre de Shortughai
(Francfort 1989, pl. 76)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
90
Figure 22 : Objets remarquables de Shortughai
1 - miroir, 2 - poignard, 3 - pointe de flèche, 4 - épingle élborée (d'après Francfort 1989, pl. 77-78)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
91
Figure 23 : Tépé Hissar, plan des fouilles de 1976
(Pigott, Howard, Epstein 1982, p. 218)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
92
Figure 24 : Restes de l'activité métallurgique à Tépé Hissar
(d’après Pigott, Howard, Epstein 1982, p. 224-225)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
93
Figure 25 : Sélection de matériel en alliage cuivreux de Tépé Hissar
1 – tête de masse (Hissar II), 2 – tête de masse (Hissar III), 3 - épingles (Hissar I), 4 – épingles à double spirale (Hissar III) (Schmidt 1933)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
94
Figure 26 : Localisation du site de Shahdad dans la plaine du Takab
(Hakemi 1997, p. 6)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
95
Figure 27 : Plan des ateliers du site "D" de Shahdad
(Hakemi 1997, p. 90 fig. 54 ; tab. 3)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
96
Figure 28 : Four de fusion de l’atelier n° 2 à Shahdad
(Hakemi, 1997, p. 125 fig. 50)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
97
Figure 29 : Les types de four de fonte à Shahdad
1 - type I, 2 – type II et IV, 3 - type III (d'après Hakemi 1992)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
98
Figure 30 : Céramique métallurgique à Shahdad
1-4 - creusets, 5 - moule de hache à oeillet, 6 - bouchons en céramique (d'après Hakemi 1992)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
99
Figure 31 : Secteurs de production à Shahr-i Sokhta
(Tosi 1984, p. 34 fig. 5)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
100
Figure 32 : Restes métallurgique de Shahr-i Sokhta
1 - "slag cake" vue du dessus et du dessous, 2 - matte et bouton de cuivre (Berthoud, Craddock et alii 1980, p. 122, fig. 1-3)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
101
Figure 33 : Zone métallurgique à Harappa colline "E"
(Miller 2005, p. 246 fig. 1)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
102
Figure 34 : Quelques types de semi-produits
1 - "lingot barre", 2 - lingots plano-convexes (les échelles ne sont pas respectées) (d'après Tallon 1989, p. 261 ; 264)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
103
Figure 35 : Terminologie technologique et découpage théorique de la métallurgie des alliages cuivreux
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
104
Figure 36 : Analyses d'artefacts à Altyn-Dépé
a - objets métalliques, b - parois de four (Salvatori, Vidale et alii 2002, p. 96 fig. 7)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
105
Figure 37 : Outils lithiques du bronze ancien d’Altyn-Dépé (planche 1)
1-3 outils de broyage, 4-6 marteaux lithique, 7-10 outils miniatures (d’après Kirco 1988)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
106
Figure 38 : Outils lithique du bronze ancien à Altyn-Dépé (planche 2)
1-7 marteaux miniature et outils dormant, 8-10 Outils abrasif, 11 - outil pour l’aiguisage (d’après Kirco 1988)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
107
Figure 39 : Restitution des creusets et fragment de litharge d’Altyn-Dépé
(Salvatori, Vidale et alii 2002)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
108
Figure 40 : Sélection d’objets en alliage cuivreux du bronze ancien à Altyn-Dépé
1, 2, 4 – lames, 3 – « dague », 5 – herminette, 6, 7 - limes, 8-12 alènes, 13-15 épingles, 16, 17 pointes (d’après Kirco 1988, p. 53 fig. 13)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
109
Figure 41 : Métallographie et granules de cuivre d’Altyn-Dépé
(d'après Salvatori, Vidale 2002)
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
110
Figure 42 : Schème technique d'Altyn-Dépé au bronze ancien
Légende : Forg (Forge), Mart (Martelage), Retr (Retreinte), Recu (Recuit),
Lami (Laminage), Ebar (Ebarbage), Pres (Pression), Tors (Torsion), Abra (Abrasion),
Aigu (Aiguisage), Affu (Affutage), Poli (Polissage), Buri (Burinage).