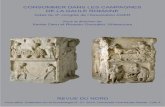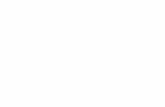Les statuts du chapitre cathédral de Vienne
-
Upload
univ-savoie -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les statuts du chapitre cathédral de Vienne
1
Yvain Maret
Master 2 Histoire
2011-2012
Les statuts du chapitre cathédral de
Vienne au Moyen Âge
Mémoire de Master 2 sous la direction de Laurent Ripart
2
Remerciements
Alors que la rédaction de ces remerciements marque la fin de l’année universitaire,
l’heure n’est plus aux recherches mais aux bilans. Le simple fait de rédiger cette page permet
d’en tourner une autre : celle de trois années de recherches dont deux consacrées à la
rédaction de ce mémoire. Ces travaux n’auraient pas eu lieu sans l’aide précieuse de Laurent
Ripart qui m’a conseillé durant toutes ces années en tenant compte de mes intérêts personnels
et professionnels dans un contexte politique agité pour le monde de l’université et de
l’enseignement. Qu’il soit ainsi remercié à la hauteur de ce qu’il représente pour moi.
Au cours de ces années, j’ai cru apercevoir quelques réalités du métier d’historien dont
la plus marquante fut pour moi l’appartenance de l’historien à une communauté de pairs. Je
remercie donc toutes les personnes qui m’ont permis d’observer cette communauté à l’œuvre,
qu’ils m’aient exclu, ou au contraire, intégrés à cette corporation intellectuelle. Parmi ces
historiens confirmés je remercie en premier lieu Mme Beate Schilling et M. Nathanaël
Nimmegeers qui par leurs échanges m’ont donné un souffle neuf et m’ont insufflé la volonté
de poursuivre mes recherches dans ces sources viennoises souvent bien difficiles à cerner.
Je profite également de cette page pour remercier tout ceux qui m’ont apporté une aide
précieuse : Lucie qui prit de son temps libre pour corriger ce mémoire ainsi que ma compagne,
Anne, qui me supporta et m’épaula dans tout les moments de doutes qui jalonnèrent le
parcours d’édification de ce travail.
Je remercie aussi la magnanimité des lecteurs de cette œuvre qui fut accouchée dans la
douleur et la frustration du travail inachevé. Les ambitions qui furent les miennes ne furent
pas toutes réalisées, me laissant un goût amer à l’heure où s’achève la rédaction de ce travail
universitaire.
3
« L'an 790 depuis la nativité de Jésus-Christ, par l'autorité, la libéralité et la
magnificence du très pieux empereur Charlemagne, et par les soins de vénérable personne le
Seigneur Wolfere, archevêque de Vienne, l'Eglise de cette ville a été réparée et de nouveau
fondée […], la discipline et la manière de faire le service divin rétablis ainsi que des
règlements et des statuts propres à lui rendre son ancien lustre et à maintenir le bon ordre ».
C’est en ces termes que Charlemagne aurait édicté les premiers statuts de l’Eglise de Vienne
et ouvert la série de statuts qui réglementent la vie du chapitre cathédral de Vienne. C’est
aussi l’étude de ce document – bien évidemment faux – qui nous servira de porte d’entrée à
une étude du chapitre cathédral de Vienne.
L’histoire de la ville de Vienne, et plus particulièrement son histoire religieuse, a été
délaissée par l’historiographie, la ville de Vienne ne bénéficiant pas ou de peu d’études
universitaires récentes et la société savante de la ville, « les amis de Vienne », n’ayant étudié
que très peu, au cours de ces dernières années, l’histoire ecclésiastique au Moyen Âge. Pour
l’essentiel, l’histoire du chapitre de Vienne reste dépendante de l’œuvre du grand historien
dauphinois, Ulysse Chevalier. Cet érudit fut le dernier qui se pencha de façon scientifique sur
l’histoire de l’Eglise de Vienne et son chapitre cathédral au Moyen Âge. C’est à partir de ses
publications que nous aborderons l’étude des statuts de l’Eglise de Vienne.
4
I. Les sources
A. Les actes capitulaires.
Les actes capitulaires du chapitre de Vienne ont été recopiés dans un manuscrit, aujourd’hui
perdu, qui a été publié par Ulysse Chevalier1. Il contient un grand nombre de délibérations
capitulaires ainsi que de nombreux statuts du chapitre édictés entre 1225 et 1333. L'origine du
manuscrit édité par Chevalier est inconnue, mais d'après les érudits du XVIIe et XVIIIe siècles,
il provient des archives du chapitre. Selon leur éditeur, les statuts étaient suivis d'une liste
d'églises dépendant de l'Eglise de Vienne qu'Ulysse Chevalier publia sous le titre « Poyptycha
id est regesta taxationis beneficiorum diocesum Viennensis, Valentinensis, Diensis et
Gratianopolitanae »2. On apprend dans la courte notice qui précède cet Appendix que le
manuscrit original avait été mis à la disposition d'Ulysse Chevalier par Paul-Émile Giraud et
qu'il s'agit d'un In 4° de 106 folios en vélin avec reliure en bois. Les statuts du chapitre de
Vienne occupent les folios de 1 à 35 de ce manuscrit et la liste d’églises qui les suit ne
représente que quelques folios supplémentaires. Le manuscrit a été composé au plus tôt après
1333, mais sans doute avant la publication des statuts de 1385 qui ne sont pas donnés par le
manuscrit. Enfin, on notera, M. Giraud avait, en 1843, le cartulaire de Saint-André-le-bas au
nom de la bibliothèque de Vienne en 1843 3· ; or ce cartulaire périt dans l’incendie de la
bibliothèque en 1854. On peut donc supposer que le manuscrit des statuts de l'Eglise de
Vienne connut le même sort.
B. Les statuts de 1385.
Les statuts originaux de 1385 sont aujourd’hui perdus. Néanmoins, les archives
départementales de l'Isère possèdent une copie imprimée en 1636 4. Ces statuts terminent la
série des nombreux statuts édictés au cours du XIIIe siècle et furent, sinon observés, au moins
considérés comme une référence dans le chapitre de Vienne jusqu'à la suppression de
1 Ulysse Chevalier, Actes capitulaires de l’église Saint-Maurice de Vienne : statuts, inféodations, comptes, publiés d’après les registres originaux et suivis d’un appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne (XIII è-XIV è siècles), Vienne, 1875, C.C.D. II, 1ère livr. 2 dans Documents inédits relatifs à l’histoire du Dauphiné, septième livraison, Accadémie Delphinale, 2eme vol., Grenoble, 1868, p. 22-25 3 Cf. I.Vérité Répertoire des cartulaires français, provinces ecclésiastiques d’Aix, Arles, Embrun, Vienne, Diocèse de Tarentaise, Paris, 2003, p.303-308 4 A.D.I, 2G1/a : statuts de 1385 imprimés en 1636.
5
l'archevêché en 1791, comme le prouve leur enregistrement au parlement de Grenoble le 8
juillet 1649, ainsi que le procès engagé entre le chapitre et le collège de Vienne dans les
années 1780 1.
C. L’acte de Charlemagne de 790/805
1. Publications du document aux XVIIe et XVIIIe siècles
La première mention de l'acte carolingien date de 1623, comme preuve en note de bas
de page de la restauration de l'Eglise de Vienne sous l'archevêque Wolfère2. L'auteur de cette
mention, Jean le Lièvre ne nous donne pas la source de l'acte qu'il transcrit d'après les codes
de son temps3. La source du document peut néanmoins être en partie élucidée grâce au travail
de Claude Charvet qui traduisit l’acte publié par son prédécesseur4 . C. Charvet devait
certainement avoir eu accès à l’acte original ou à l’une de ses copies, car nous pouvons noter
quelques variantes entre la publication en latin de Jean Le Lièvre et la traduction française.
Ces variantes peuvent toutes être considérées comme inhérentes au travail de transcription,
sauf une. En effet, la date de l’acte donné par Charlemagne n’est pas la même dans les deux
publications : Jean Le Lièvre estime que l’acte a été rédigé en 790, tandis que Claude Charvet
affirme que celui-ci date de 805. Cette différence majeure est due à la rectification de la date
par Charvet qui, constatant que Charlemagne portait le titre d’empereur, a éprouvé le besoin
de le dater après son couronnement à Rome. Ainsi, il semble bien que les deux érudits eussent
accès au même document ou à des copies relativement conformes. Notons également que le
seul manuscrit connu de ce texte est une copie du XVIII e siècle conservée à la bibliothèque de
Vienne5.
2. A la recherche du Tabbulae Ecclesiae Viennensis.
Lors de la publication de Claude Charvet, ce dernier met en marge les sources de l’acte
qu’il traduit. L’auteur met ainsi en avant, outre la publication antérieure de Jean Le Lièvre, le
Tabb. Eccl. Vienn., comme source de l’acte qu’il traduit. Les compilations et publications
postérieures ne reprenant pas l’idée « d’archives de l’Eglise de Vienne » ou de « tableau de
1 A.D.I. 2G1, e : procès (1700-1789) et Bibliothèque municipale de Vienne, M210. 2 J.Le Lièvre, Histoire de l’Antiquité et sainteté de la cité de Vienne en la Gaule celtique par messire Jean Le Lièvre, Jean Poyet, 1623, p.191-193. 3 On trouve par exemple transcrit les ‘a’ avec des accents : In sancta igitur Viennensi Ecclesia, quae constructa et dedicata est à priscis temporibus in honorem Dei saluatoris nostri Iesu Christi… 4 Claude Charvet, Histoire de la Sainte Eglise de Vienne, Lyon, 1761, p.157-159. 5 Bibliothèque municipale de Vienne, M38, f°1-2.
6
l’Eglise de Vienne », il faut trouver ce qu’entendait Claude Charvet dans cette expression de
Tabbulae Ecclesiae Viennensis.
Après une étude de toutes les références au Tabbulae Ecclesiae Viennensis citées par
Claude Charvet, il s’avère que cet ouvrage n’est autre que le grand cartulaire du chapitre
de Saint-Maurice de Vienne1. Les références qu’il cite dans cet ouvrage correspondent
toutes à la description de Jean-Baptiste Moulinet à l’exception de trois actes qui présentent
des variations notables2. Hormis ces trois variations notables, les références qu’utilise
Claude Charvet recoupent toutes, à moins d’un folio près, la description de Jean-Baptiste
Moulinet3. Il semble alors évident de conclure que Claude Charvet et Jean-Baptiste
Moulinet consultèrent tous deux le cartulaire du chapitre de Vienne, mais les variantes
mises en évidence nous poussent à croire qu’il exista deux copies de ce cartulaire. La
présence de l’acte de 790/805 dans l’une des copies mais pas dans l’autre pose question :
pourquoi avoir ajouté un faux dans l’une des copies du cartulaire et pas dans l’autre ? A
quel moment cet acte a-t-il été ajouté ?
3. Un document qui pose question dès la fin XVIIIe siècle
Au XVIII e siècle apparaissent les premières traces de doute concernant l’authenticité de
ce document. En effet, en 1788 au cours d’un procès entre le chapitre et le collège, on apprend
que « le tableau donné par le Sr. Bernard n’est fondé que sur un faux titre pour peu que l’on
connaisse l’histoire de cette Eglise et celle de Charlemagne à qui l’on attribue ce titre
prétendu [...], qui n’a pu être inventé que dans le XIII e ou XIVe siècle »4. Cette hypothèse
d’une rédaction au XIIIe ou XIVe siècle fut reprise par Ulysse Chevalier dans ses dernières
1 Soit 93 références dans l’ouvrage dont les références sont données ci-après. On trouve une référence au tableau de l’Eglise de Vienne aux p.87, p.119, p.157, p.163, p.164, p.175, p.176, p. 185, p.186 p.191, p.193, p.209, p. 226, p.227, p. 240, p. 245, p. 246, p. 249, p. 250, p. 255, p. 256, p. 260, p. 262, p. 263, p. 267, p. 270, p. 273, p. 279, p. 289, p. 295, p. 296, p. 310, p. 314, p. 322, p. 328, p. 329, p. 334, p. 337, p. 338, p. 343, p. 362, p. 367, p. 368. On trouve deux références au tableau de l’Eglise de Vienne aux p. 190, p. 210, p. 237, p. 242, p. 247, p. 248, p. 253 , p. 265, p. 271, p. 309, p. 332, p. 336, p. 358, p. 360. On trouve trois références au Tabbulae ecclesiae Viennensis aux p. 187 et 363, quatre aux p. 251, p.274, et p. 361 et cinq p.290. 2 A la page 157 de son Histoire de l’Eglise de Vienne, Claude Charvet donne la traduction d’un statut délivré par Charlemagne. Il indique que l’acte provient du folio 49 verso du Tabbulae ecclesiae Viennensis, or cet acte ne figure pas dans la description qu’en fit Jean Baptiste Moulinet. De même, à la page 309, Claude Charvet cite un acte provenant de la même source sans qu’il soit décrit par Jean Baptiste Moulinet. La troisième variante observée n’est qu’une variation de foliotation : à la page 279, Claude Charvet décrit un acte et indique qu’il provient du Tabbulae ecclesiae Viennensis folio 16 alors que Jean Baptiste Moulinet indique ce même acte dans sa description du folio 24. 3 Description publiée par U. Chevalier, Description analytique du cartulaire du chapitre de Saint Maurice de Vienne suivi d’un appendice de chartes et chronique des évêques de Valence et de Die, Valence, 1891, C.C.D. II, 2ème livr. 4 A.D.I. 2G1 e : Procès (1700-1798), f° 2.
7
œuvres. En 1913, dans son Regeste Dauphinois, Ulysse Chevalier avait considéré ce texte
comme authentique. En 1922 et en 1923, lorsqu'il avait écrit son ouvrage fondamental sur
l'église de Vienne1, Ulysse Chevalier avait signalé que ce texte lui paraissait suspect, mais se
montra peu loquace à son propos, sans doute parce que ce texte, qu'il avait considéré comme
authentique en 1913, le gênait : le repousser totalement aurait discrédité tout son travail sur
l’Eglise de Vienne, mais son honnêteté intellectuelle lui imposait d’indiquer ses doutes sur sa
provenance2.
Plus récemment, Nathanaël Nimmegeer le date de l’épiscopat de Guy de Bourgogne
(1088-1119)3. Ainsi, si quelques personnes ont pu douter de l’authenticité de ce texte, la
majorité des études l’éludent ou le considèrent comme la preuve de la restauration de l’Eglise
par Wolfère, à l’image de l’historien principal de Vienne au XXe siècle, Pierre Cavard4. Il
s’agit donc d’un texte délicat à cerner et l’objectif principal de ce mémoire sera de le dater
avec le plus de précision possible. Il convient alors de présenter les sources qui sont utiles à
notre étude.
D. Les sources des XIe et XIIe siècles
1. Les sources du chapitre
Le chapitre cathédral de Vienne, objet de notre étude, possédait dès le XIIe siècle, des
archives distinctes de celles de l’évêché. La production écrite du chapitre de Saint-Maurice
peut être divisée en deux en reprenant la terminologie d'Isabelle Vérité qui distingue le grand
cartulaire rédigé aux XIIe et XIIIe siècles d'un deuxième cartulaire appelé « petit cartulaire »
par les historiens des XVIIIe et XIXe siècles5.
1 U.Chevalier, Etudes… 2 Il signale alors simplement que ce texte manque dans le cartulaire de l’Eglise de Vienne. 790 ou 805 ; Dotation et fondation de la Sainte Eglise de Vienne faite de nouveau après sa ruine par le très pieux empereur Charlemagne, après qu’elle eut été restaurée par S Wolfère son archevêque. Cf. U.Chevalier, Regeste Dauphinois…, n°588. 3 N. Nimmegeer, La province ecclésiastique de Vienne au Haut Moyen Âge, Thèse inédite, Lyon, 2011, p. 32-33. Il se base sur la dédicace « à Jésus Christ Dieu notre sauveur, sous l'invocation des Saints Macchabées, de Saint-Maurice et de ses compagnons martyrs et soldats de la légion thébaine » pour se prononcer en faveur des XIe ou XII e siècle. Le fourmillement des détails lui fait penser que c’est le prélat réformateur Guy de Bourgogne qui commanda ce texte. 4 Voir par exemple Pierre Cavard, L’église Saint Maurice de Vienne, Vienne, 1978, p. 34. « l’archevêque Volfère, qui vivait au temps de Charlemagne, était regardé comme l’organisateur de la vie canoniale dans l’église de Vienne ». Notons que Pierre Cavard n’est pas le seul historien contemporain à se méprendre sur l’authenticité de cet acte. Voir par exemple Francis Salet, L’ancienne cathédrale saint Maurice de Vienne, Extrait du congrès archéologique du Dauphiné, Paris, 1974, p.509. 5 I.Vérité, Répertoire des cartulaires français, province ecclésiastique d’Aix Embrun Arles Vienne et ….Paris 2003, p. 313-319.
8
a) Le grand cartulaire
Le grand cartulaire composé à la fin du XIIe siècle voire au début du XIIIe contient 257
actes dont 48 datant du XIe siècle et 69 du XIIe siècle. Il n’existe malheureusement pas
d’édition complète de ce cartulaire, néanmoins Ulysse Chevalier en a publié une description,
d’après l’analyse faite en 1771 par Jean-Baptiste Moulinet, qui renvoie aux éditions partielles
du cartulaire1. Parmi ces éditions partielles, les plus importantes par leurs qualités et leurs
quantités furent éditées par Ulysse Chevalier qui publia en 1869, 1891 et 1912, un grand
nombre de chartes issues de ce cartulaire2. Outre cet érudit, il faut mentionner les chartes
éditées par Claude Charvet qui, en publia le plus souvent uniquement des extraits ou des
traductions. Ces manques et ces imprécisions sont liés à la méthode de l’auteur qui s’en sert
de preuves pour son ouvrage3. C'est pourquoi le plus souvent les actes reproduits, ou traduits
ne le sont que très partiellement et sont trop souvent cités sans mention des sources qu'il cite.
Ce grand cartulaire détruit pendant la Révolution a également été étudié par Nicolas Chorier
qui en publia lui aussi quelques extraits4.
Ainsi, la description publiée par Ulysse Chevalier facilite grandement l’approche de ce
cartulaire mais il faut néanmoins noter que certains actes ne sont pas publiés et sont connus
uniquement grâce à l’analyse de Jean-Baptiste Moulinet. Il faut aussi remarquer que la
publication de l’analyse du cartulaire est antérieure à la publication d’extraits du cartulaire par
Ulysse Chevalier en 1912. Ainsi, les tentatives d'approche de ce cartulaire s'avèrent très
délicates. De plus, il est fort probable qu’il exista au moins deux copies de ce cartulaire et que
Jean-Baptiste Moulinet n’eut pas la même version du cartulaire que Claude Charvet5.
b) Le petit cartulaire
Si le grand cartulaire est d’une approche relativement complexe, que dire de ce petit
cartulaire qui n’est connu qu’à travers les notes de Claude Charvet et Pierre-Joseph De
1 U.Chevalier, Description analytique du cartulaire du chapitre de Saint Maurice de Vienne et chronique des évêques de Valence et de Die, Valence, 1891, C.C.D. II, 2è livr.. 2 U.Chevalier, cartulaire de l’abbaye de Saint André le bas de Vienne, ordre de Saint Benoît suivi d’un appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne (IXè-XIIè siècles), Vienne, 1869, C.C.D. I. L’édition du grand cartulaire occupe les p.210-235, 237-238, 241-256, 260-261, 266, 268-271, 273-276, 279, 280-282, 287-292, 304, 307, 311-313 de l’appendix I, chartululariorum Viennensium quae supersunt inedita ainsi que la totalité de l’appendix II, chartarum Viennensium complementum (p.1*-36*). U.Chevalier, Description analytique… , p.5-18. U.Chevalier, Chartes de Saint Maurice de Vienne, de l’abbaye de Léoncel et de l’Eglise de Valence. Suppléments aux recueils imprimés, Paris, 1912, C.C.D. X, 1ère livr. Les chartes de Saint Maurice occupent les p.5-18. 3 C.Charvet, Histoire de la Sainte Eglise de Vienne, Lyon, 1761, 4 Nicolas Chorier, Histoire de Dauphiné, deux tomes, Grenoble, 1661. 5 Cf. supra.
9
Rivaz1 ? Nous ne connaissons que le dernier folio de ce cartulaire aujourd’hui perdu dont
Isabelle Vérité affirme qu’il comptait au moins 111 feuillets2.
2. Les sources issues de l’archevêché
Parmi les érudits des XVIIe et XVIIIe siècles, seul Nicolas Chorier mentionne un
cartulaire de l’archevêché, distinct du cartulaire du chapitre de Saint-Maurice. Cependant, les
actes qu'il cite (sans références explicites) sont tous présents dans le grand cartulaire. A-t-il
confondu les deux cartulaires ou ont-ils un large tronc commun ? Comme Charvet mentionne
un « livre » des archevêques de l’Eglise de Vienne dans ses sources3, Isabelle Vérité n’exclue
pas la possibilité qu’il exista un cartulaire issu de l’archevêché même si le manuscrit reste
encore à identifier4.
3. Le cartulaire de Saint-André-le-Bas
Si le cartulaire du XIIe siècle de cette abbaye bénédictine a été détruit dans un incendie
en 1854, il existe deux copies totales et une copie partielle effectuées au XIXe siècle. Ulysse
Chevalier publia, en 1869, la copie faite par Eugène Janin pour Paul-Emile Giraud en 1844
qui servira de référence dans cette étude5. Ce cartulaire compte 84 feuillets dont les 64
premiers sont écrits en minuscules du XIIe siècle puis s'ensuit des ajouts : un feuillet du XIV e
siècle en précède quatre autres du XIIIe siècle. Les six derniers folios datent des Xe et XIe
siècles6.
1 C.Charvet, Histoire de la Sainte Eglise de Vienne, op. cit., p.181. et P.J. De Rivaz, Diplomatique de Bourgogne, t.II,p.619-620 publié par Ulysse Chevalier : P.J. De Rivaz, Diplomatique de Bourgogne. Analyse et pièces inédites publiées par l’abbé C. U. J. Chevalier, Paris, 1875, C.C.D. VI. 2 I.Vérité, Répertoire…,p.319. Elle ne recense qu’un seul acte : C.Charvet, Histoire de la sainte Eglise de Vienne, op. cit., p.181. et P.J. De Rivaz, Diplomatique de Bourgogne…op.cit., p.52. Il s’agit d’un acte de 1146 coté I A, fol.111 par P.J. De Rivaz. 3 C.Charvet, Histoire de la Sainte Eglise de Vienne, op. cit. p.297, 299, 301. Sa cote est alors « liber n°1. L » 4 I.Vérité, Répertoire…,p.311-313. 5U.Chevalier, Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-le-Bas-de-Vienne : ordre de Saint-Benoît ; suivi d’un appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne : (IXe-XIIe siècle), Lyon, 1869, Désormais C.C.D. I. 6I.Vérité, Répertoire…,p.304-307.
10
E. Les sources des XIIIe et XIVe siècles
1. Pouillés de Vienne
Le plus ancien pouillé de Vienne date de 1275 et non comme le prétendit Ulysse
Chevalier du XVe siècle1. Ce document est organisé en une logique territoriale claire et
contient la liste des paroisses dépendant de l’église métropolitaine à la fin du XIIIe siècle.
Cette « photographie » du diocèse est très utile pour comprendre la mise en place de
l’administration diocésaine ainsi que pour dresser une carte du diocèse et de ses
doyennés/archiprêtrés.
2. Le Liber divisionum terrarum
Cet ouvrage est un énorme volume sur parchemin de 385 folios et sur le premier de
ceux-ci est écrit « liber divisiorum terrarum capituli ecclesie Viennensis, in quo continentur
dona canonicorum et divisiones terrarum et obedienciarum in porciones canonicas ». Cette
mention ajoutée probablement postérieurement à la rédaction de l’ouvrage donna son nom à
l’ouvrage. Il contient 248 partages de revenus vacants entre 1228 et 1536. Le plus souvent ces
partages de ces prébendes ont eu lieu suite à la mort des bénéficiaires mais il est parfois
annoté des démissions, des excommunications… Ce livre est donc très utile pour comprendre
le système des prébendes au sein du chapitre de Vienne, mais aussi pour faire une étude
détaillée de la seigneurie capitulaire. Ce n’est pas pourtant pour ces objectifs que nous
emploierons cet ouvrage : les mutations indiquées doivent pouvoir servir à déterminer la
composition du chapitre. C'est-à-dire, qu’à partir des dates de mort des chanoines, il est
possible de déterminer le nombre des membres du chapitre. De plus, les noms des chanoines
étant impliqués dans les partages peuvent nous renseigner sur l'évolution de leurs origines
sociales. Cet ouvrage apparaît donc comme étant une source fondamentale pour l’étude du
chapitre de Vienne. Néanmoins, le document ne nous a pas été accessible car il appartient à
un particulier. D’après la seule étude qui en fut faite2, en 1936, elle appartenait à la société
1 A.Bouvier, Structuration des lieux de culte en Viennois ; doyenné et archidiaconné d’Octaveon ; XIIIe-XVe siècles, Mémoire de Master « sciences humaines et sociales » : histoire : Grenoble, Université Pierre Mendés France, 2008, 2 vol. Et Ulysse Chevalier, Poyptycha id est regesta taxationis beneficiorum diocesum viennensis, valentinensis, diensis et Gatianopolitanae, dans Documents inédits relatifs à l’histoire du Dauphiné, septième livraison Accadémie Delphinale, 2eme vol., Grenoble, 1868, pp. 25 sq. Dans son ouvrage, Ulysse Chevalier ne reconnaît pas ce document comme étant un pouillé mais comme une liste d'églises dépendant de l'église de Vienne au XIIIe siècle. Quelques années plus tard dans acta capitularia sanctae ecclesiae viennensis,, C.C.D. II 1èere livr., Lyon 1875, il considère sa publication antérieure comme étant un pouillé cf. p.78. Nous considérons donc ce document comme le plus ancien pouillé du diocèse de Vienne retenant le dernier avis d’Ulysse Chevalier ainsi que celui de M. Bouvier. 2 Paul Thomé de Maisonneufve, le chapitre métropolitain de Vienne et le Liber divisionum terrarum, Grenoble, 1937.
11
Dauphin Humbert II à Romans qui semble aujourd’hui dissoute. Notre étude du liber
divisiorum terrarum se base uniquement sur la description qu’en fit Paul Thomé de
Maisonneufve.
3. Ordinaire de Vienne
Cet ouvrage liturgique, publié par Ulysse Chevalier1, fut rédigé vers 1240 et contient
une description minutieuse d’un grand nombre de cérémonies religieuses. Il fourmille de
détails qui permettent de comprendre très précisément la composition du chapitre de Vienne
au moment de la rédaction de l’ouvrage, les cérémoniels, les habitudes et les coutumes du
chapitre.
F. Conclusion : les enjeux du faux de 790/805
Nous avons vu que l’acte de Charlemagne ne pouvait être la copie d’une fondation ou
refondation carolingienne. Cet acte fut donc rédigé a posteriori et l'enjeu de notre travail
consiste alors à dater cet acte. Son contenu très précis à propos de l’organisation de l’Eglise
de Vienne a trop été utilisé par les historiens pour décrire la vie du chapitre de Vienne du IXe
au XIVe siècle pour souligner que celle-ci n’aurait guère évolué. La démarche que nous
proposons procède de l’esprit contraire : nous chercherons à comprendre la vie du chapitre
sans utiliser l’acte pseudo-carolingien et tenterons de le dater d’après l’organisation du
chapitre. Nous partons ainsi du postulat que ce faux acte décrit l’organisation de son temps et
qu’il convient de savoir à quelle période l’organisation du chapitre est conforme à celle
décrite dans le faux de 790/805 pour en estimer la date de la rédaction. Nous étudierons donc
les institutions décrites dans le pseudo acte carolingien pour nous attacher ensuite aux
effectifs du chapitre.
Le grand nombre et la grande diversité de nos sources rendent difficile la
compréhension du chapitre cathédral de Vienne. La plupart des originaux de nos sources
ayant disparu, il faudra, pour notre étude, utiliser abondement les érudits des XVIIe, XVIII e et
XIX e siècles, en ayant garde de distinguer les sources épiscopales et les sources capitulaires.
La confusion chez nombre de ces auteurs entre ces sources rend le processus délicat et il
convient alors de préciser au maximum la provenance des sources disponibles et d’en tenir
compte dans l’analyse. Nous remarquons également la faible représentation des actes de la
pratique. Cette lacune dans nos sources nous prive de l’accès à la vie quotidienne du chapitre,
et il nous faudra constamment croiser nos sources pour arriver à déterminer la composition et
1 Ulysse Chevalier, Ordinaire de l’église cathédrale de Vienne, Paris 1923.
12
les préoccupations du chapitre. Notons également un déséquilibre de ces sources. Si les XIIe
et XIIIe siècles sont assez bien documentés, les sources dont nous disposons pour les XIe et
XIV e siècles sont peu nombreuses et peu loquaces.
G. Le faux statut de Charlemagne traduit par Claude Charvet
Nous reproduisons ici le statut de 790/805 tel qu’il fut publié par Claude Charvet, dans
son Histoire de la sainte Eglise de Vienne, Lyon, 161, p.157-159.
Nouvelle fondation de l’église de Vienne, faite par le très religieux Empereur
Charlemagne.
L’an 805 depuis la nativité de Jésus-Christ, par l’autorité, la libéralité et la magnificence
du très pieux Empereur Charlemagne, et par les soins de vénérable personne le Seigneur
Wolfere, Archevêque de Vienne, l’Eglise de cette ville a été réparée et de nouveau fondée,
dotée et augmentée, soit dans ses revenus, soit dans son clergé. Le palais de l’Archevêque et
divers logements pour les chanoines et pour les autres clercs ont été construits aux environs de
l’Eglise, la discipline et la manière de faire le service divin rétablis ainsi que des Règlements
et des Statuts propres à lui rendre son ancien lustre et à maintenir le bon ordre.
Statut
Le service divin se fera à l’avenir et à perpétuité dans la sainte Eglise de Vienne, bâtie
dans les murs de la ville et dédiée dès les premiers siècles à Jésus-Christ Dieu notre Sauveur,
sous l’invocation des saints Macchabées, de saint Maurice et de ses Compagnons martyrs de
la Légion Thébaine, par des Chanoines et de Clercs séculiers, ainsi qu’il s’y est toujours fait
depuis sa fondation sous la conduite des saints Evêques nos prédécesseurs ; lesquels
Chanoines et Clercs composeront un chapitre et un Collège, et porteront en tout temps dedans
et dehors l’Eglise, l’habit canonial.
De l’habit
L’habit des Chanoines et des Clercs sera le surplis de toile blanche dont les manches
seront larges et amples, sans lequel ils ne pourront jamais paraître dans l’Eglise. Depuis la fête
de s. MARTIN jusqu'à celle de Pâques, ils porteront sur le surplis des chapes de drap noir, et
depuis Pâques jusqu'à la fête de tous les Saints, ils porteront le surplis sans chape, et sur leurs
têtes un chaperon de petit gris, appelé communément une aumusse. A l’égard du bas chœur,
13
les grands Clercs se couvriront la tête d’une aumusse noire, ou ils seront découverts ; et les
petits Clercs marcheront toujours la tête nue, soit dedans soit dehors l’Eglise.
Des Dignités, des Personnats, et des Offices de l’Eglise.
Le Chapitre sera composé de l’Archevêque, du Doyen et des Chanoines, et le collège
sera formé des autres Clercs. Tous seront incorporés à perpétuité dans l’Eglise. Il y aura
soixante Chanoines, cent Prêtres, vingt Diacres, vingt Sous-diacres, quarante grands Clercs, et
vingt quatre petits Clercs : lequel nombre pourra être augmenté ou diminué suivant
l’augmentation ou la diminution des revenus de l’Eglise.
La première dignité après l’Archevêque sera le Prévôt ; la seconde le Doyen ; la
troisième le Grand Archidiacre, et après lui les quatre Archidiacres forains, à savoir,
d’Altaveon, (c'est-à-dire, de Romans) de Salmorenc, de la Tour, et d’au-delà du Rhône ; la
quatrième l’Ecolâtre ou Capiscol.
Les personnats seront la Précenterie et la Chanterie.
Les Offices seront la Sacristie, la Mistralie et la Chancellerie.
Il y aura deux abbés Séculiers, l'abbé de Saint Ferreol, et l'abbé de Notre-Dame1.
Il y aura de plus six chevaliers savants dans les lois, qui seront les Avocats de l'Eglise ;
huit Archiprêtres ruraux, à savoir, celui de Valoire ou S. Valier ; celui d’Altaveon, c’est-à-dire,
de Romans ; celui de March ; celui de la Tour ; celui de Valdaine ; celui de Bressieu ; celui
d’Annonay, et celui de Vaulcance, c’est-à-dire, de Quintenas.
Il y aura encore dix Prêtres pour servir au Grand Autel, à savoir, quatre appelés Grands
Prêtres et six autres qui seront leurs Coadjuteurs : un Maître de Chœur sous le Capiscol ; un
grand Chapelain sous le Doyen, c’est-à-dire, le curé de la Croix.
Les Archiprêtres ruraux, dont il a été parlé, seront sous les Archidiacres, en sorte que
chaque dignité d'Archidiacre ait sous lui deux Archiprêtres excepté l'Archidiacre de
Salmorenc qui n'en a point.
Nul ne pourra obtenir aucune Dignité, ni aucun Personnat, Office ou Bénéfice dans
l'Eglise, qu'il ne soit auparavant incorporé ; et nul ne pourra servir, célébrer ou officier dans
l’Eglise s’il n’est également incorporé et du nombre arrêté ci-dessus.
1 Il s’agit de Notre Dame de Caras
14
II. LES INSTITUTIONS DU CHAPITRE : Des dignités, des
personnats et des offices de l’Eglise.
A. Fonctionnement et rôle du chapitre
Depuis la fin du XIe siècle, le rôle principal du chapitre est d'élire l'évêque lorsque la
cathèdre est vacante comme le rappelle le concile de Latran IV en 1215 1. A Vienne, il est
d’usage que la vacance soit assurée par l’évêque de Valence. Au cours du XIIIe siècle, la
papauté tente de s'immiscer dans les élections épiscopales. A Vienne, le 11 mai 1279, une
commission de quatre chanoines élit Raymond François préchantre de Saint-Maurice, sans
que le chapitre de Romans soit convoqué comme il est d’usage. En représailles, les chanoines
de Romans élisent à leur tour un archevêque de Vienne, Guillaume, alors archidiacre de
Vendôme dans le diocèse de Tours. Le 15 février 1283, le pape Martin V confirme l’élection
de Guillaume de Vendôme et ajoute que désormais le pape choisira lui-même l’archevêque de
Vienne2.
Si, au cours du XIIIe siècle, le rôle du chapitre diminue dans les élections, il conserve
une place importante dans l’encadrement religieux du diocèse3. Au cours des XIIe et XIIIe
siècles, les archidiacres et archiprêtres se voient affectés à des circonscriptions géographiques
où ils sont chargés du bon fonctionnement du culte dans les paroisses. Les chanoines
délèguent donc leurs tâches aux clercs de l’Eglise de Vienne qui ont ainsi la charge de
célébrer un nombre de plus en plus grand d’anniversaires des morts4. Le rôle des chanoines
est de plus en plus cantonné à l’encadrement des fidèles dans les paroisses, aux dons aux
pauvres, à la prédication, sans oublier la récitation des offices dont on pourrait situer l’apogée
1 H.Millet, « Les chanoines des cathédrales du midi » dans La cathédrale (XIIe--XIVe siècles), Toulouse, 1995,(Cahier de Fanjeaux n°30), p. 121-144. MAIS aussi J. Avril, « la participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse » dans Le monde des chanoines (XIe-XIVe s.), Toulouse, 1989, (cahiers de Fanjeaux n°24), p.41-64. 2 L. Boisset, Un concile provincial au XIIIe siècle, Vienne 1289, Théologie historique n°21, Paris, 1973, p. 116-118. Les immixtions du pape dans les élections épiscopales sont courantes à partir du XIIIe siècle mais deviennent plus fréquentes avec l’installation de la papauté en Avignon. Cf B.Guillemain et C.Martin, « Les élections épiscopales de la province de Narbonne entre 1249 et 1317 » dans Les évêques, les clercs et le roi (1250--1300), Toulouse, 1972, (Cahier de Fanjeaux n°7), p 91-106, ainsi que Y. Esquieu, Autour de nos cathédrales, quartiers canoniaux du sillon rhodanien et du littoral méditerranéen, Paris 1992, p. 51. 3 A. Massoni, « La participation des chanoines à l’encadrement religieux » dans MM. de Cevin et J-M. Matz (dir.), Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin, à compléter p. 85-94. 4 Cf infra pour la territorialisation des circonscriptions archi-diaconales. Pour le rôle de plus en plus grand tenu pour la célébration des anniversaires, nous pouvons retenir, outre la conservation des anniversaires dans les archives à partir du XIIIe siècle (ADI. 2G 56 à 2G 74), le statut du 13 juin 1245, attendentes quod propter multidudinem clericorum anniversaria ecclesie Viennensis intolerabiliter gravarentur…, Cf Statuts 1245. Annexes.
15
avec la mise en forme d’une liturgie propre à l’Eglise de Saint-Maurice au milieu du XIIIe
siècle1.
Il faut donc distinguer le chapitre de l’église de Vienne des desservants de l’église de
Vienne, les uns formant le chapitre et les autres, le collège2 . Cette distinction semble
nécessaire car les actes capitulaires de l’Eglise de Vienne statuent indifféremment sur le
chapitre ou sur le collège puisque la plupart du temps, ils statuent à propos de « l’Eglise de
Vienne » qui comprend le chapitre et le collège.
Les chanoines se distinguent des clercs du collège par l’attribution d’une prébende : seule
la prébende fait le chanoine et seul le chanoine à « voix au chapitre »3. Les revenus des
chanoines sont composés de deux parts : les « gros fruits » de la prébende, c'est-à-dire les
revenus de celle-ci, et les distributions. Ces dernières sont des revenus en argent auxquels les
« collègiés » ont droit. Fréquemment citée dans les statuts, la livre que les chanoines reçoivent
quotidiennement n’est peut-être pas d’un montant d’une livre, et Pierre Cavard préfère parler
de « livrée » d’un montant variable4.
Dans le midi français, la séparation des biens de l'évêque des biens du chapitre date le plus
souvent du Xe siècle5. A Vienne, la mense canoniale est séparée de la mense épiscopale en
1285, soit très tardivement6. L’attribution des prébendes est mal connue à Vienne avant cette
date7 : sont-elles affectées aux dignités et personnats ou sont-elles affectées aux chanoines
leur vie durant8 ? Par analogie avec le chapitre cathédral de Grenoble, nous pouvons tenter de
répondre. En effet, on trouve quelques donations de laïcs à l’Eglise de Vienne lorsqu’un
1 U. Chevalier, Ordinaire de l’Eglise cathédrale de Vienne, Paris, 1923. La date retenue pour la rédaction de l’ouvrage fait débat. Ulysse Chevalier, et nous suivrons son avis, fait remonter la date de rédaction du manuscrit entre les années 1240 et 1252. (cf. p. vi à xi). 2 Cette distinction apparaît très clairement dans le statut de 790/805 (Cf. Annexe) ainsi que dans les pièces du procès qui opposa le chapitre au collège. A.D.I. 2G1/e : procès (1700-1789) et Bibliothèque municipale de Vienne, M210. 3 C. Barralis, « les auxiliaires de l’évêque : chanoines et archidiacres » dans De Cevin et Matz (dir.) Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), op. cit., p. 151. Pour le cas viennois citons le statut de juin 1272 : nullus possit ascendere chorum majorem quousque ordinem sibi impositum susceperit, nec vocem habere in capitulo nec in divisionibus terrarum accipiere… Cf. C.C.D. II, 1ère livr. p. 24-25, et Annexes. 4 P. Cavard, La cathédrale de Saint Maurice de Vienne, Vienne, 1978, p. 83. 5 Y.Esquieu, « Les clercs dans la ville en France méridionale (IVe-XIe siècle) », dans Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe siècle), Toulouse, 2009, (Cahiers de Fanjeaux n°44), p. 32-50. 6 U. Chevalier, Actes capitulaires de l’Eglise saint Maurice de Vienne, Lyon, 1875, C.C.D. II 1ère livr., p. 43. cf. Annexe. 7 A partir de 1228, le liber divisiorum indique le partage des bénéfices ecclésiastiques vacants. Ceux-ci sont répartis de manière égalitaire entre les chanoines. Cf. Paul Thomé de Maisonneufve, le chapitre métropolitain de Vienne et le Liber divisionum terrarum, Grenoble, 1937. 8 Nous reprenons ici la distinction faite par Christine Barralis (cf. supra) qui distingue la dignité comme une fonction à responsabilité dotée d’une juridiction, et le personnat comme une fonction à responsabilité sans juridiction.
16
proche intègre le chapitre de Vienne1. Cela semble donc montrer qu'au XIe siècle, un usage
veut que, lors de l'accession au canonicat, un don au chapitre de Vienne soit recommandé2. Ce
don peut alors devenir, comme ce fut le cas à Grenoble, la prébende du nouveau chanoine, ce
qui donne donc à penser que la prébende est attachée à la personne du chanoine3. Pour les
périodes postérieures, il semble en revanche que certaines dignités ou personnats aient eu des
prébendes particulières attachées aux charges canoniales4.
B. Les institutions du chapitre cathédral de Vienne depuis les origines
Les sources locales, comme d’en bien d’autres lieux, étant peu nombreuses, il est
impossible de déterminer l’organisation du clergé viennois avant le IXe siècle5. Il semble
probable à Ulysse Chevalier que le chapitre de Vienne soit fondé sous l'épiscopat d'Agilmar
entre 843 et avril 873 6, date à laquelle figurent déjà un chorévêque, un prévôt, un prêtre, un
doyen, un avoué de l'évêque et un abbé diacre7. Notons que dans la thèse récente de
Nathanaël Nimmegeer, ce dernier situe la fondation du chapitre cathédral au tournant des
VIII e et IXe siècle sous l’épiscopat de Volfère (après 794-810)8. Si la date d’apparition du
chapitre fait débat, c’est sans doute que celui-ci reste très faiblement documenté avant la fin
du IXème siècle. Il convient alors de retracer l’histoire des institutions du chapitre pour
déterminer les variations de celles-ci au cours de l’histoire, pour ainsi pointer du doigt les
incohérences de l’acte donné par Charlemagne et établir avec le plus de précision possible la
date de la création de ce faux.
1 Y. Maret, La réforme du chapitre cathédral de Grenoble, mémoire de Master 1, Université de Savoie, 2010. 2 Vers 1070, Ismidon donna avec son neveu pour la communauté des frères qui servent saint Maurice une terre située dans Vienne près du palais du roi, et d’autres terres situées hors de Vienne. Il fit ce don pour l’âme de ses parents et pour le canonicat de son neveu, Milon. Cf. C.C.D. I, p29*, n°122*. En 1062, Foulque, prêtre et chanoine de Saint-Maurice donne pour son canonicat deux manses et un courtil dans la villa de Veynes, il est le fils d'Agnès. Le chancelier de Vienne est Pierre. Cf. C.C.D.I, p. 269, n°57*. 3 Entre 1030 et 1070, Armand chanoine de Saint Maurice donne pour la mense canoniale, pour son canonicat, un manse près d’Anonnay (Rosiaco) situé au Flachey (Flacchedum). Il le garde sa vie durant moyennant un porc de XII deniers au 15 août ainsi qu’un mouton fort et un bon agneau. Après sa mort, les chanoines en disposeront. C.C.D.I p.270, n°59*. 4 Vers 1118, Le diacre Bornon et son frère Adhemar donnent à Saint Maurice après leur mort, le bénéfice qu’ils ont à Maceum contre 5 sous à la fenaison. Si Adhemar a un enfant légitime il gardera la vigne qui fut à Silvius. Bornon reçoit la prébende du réfectoire et Adhemar 30 sous. Cf. C.C.D.I, p. 282, n°73. 5 En 812 et 820 nous trouvons dans la documentation le terme de canonia (U.Chevalier, Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l'année 1349, Valence, 1913-1924, six tomes (désormais Regeste dauphinois), n°593, n°612). L’archevêque Agilmar apparaît avec ses chanoines en avril 857 (Id. n° 708) mais le terme de chapitre n’est pas employé (on parle de la congrégation des clercs. En 870, on parle d’un collège de chanoines (Id. n° 771) et en 882 des officiers qui desservent chaque jour la cathédrale (Id. n° 839). En 889 on parle des chanoines (Id. n° 873) ou des prêtres et clercs de l’Eglise mère (Id. n° 877). 6 U.Chavalier, Etudes…, p.3. 7 Regeste dauphinois n° 784. 8 Nathanël Nimmegeer, la province ecclésiastique de Vienne au Haut Moyen Âge, thèse inédite, Lyon, 2011, p. 354-355.
17
1. Le prévôt
a) Des origines à la suppression de la charge
Dans les sources dépouillées, la première trace d’un prévôt à Vienne date du IXe siècle1,
mais celui-ci n’apparaît régulièrement dans nos sources qu’à partir de la deuxième moitié du
Xe siècle : Sobon figure deux fois l'année 925 2, son successeur probable Ingelbert est prévôt
après 936 jusqu'à au moins 958 3, date de sa dernière apparition4. Autour de 970, le prévôt est
Othmar et ce dernier apparaît deux fois de manière certaine5 , et peut être une fois
supplémentaire6.
Alphonse de Terrebasse fait remonter la disparition du prévôt à 10677. On trouve le prévôt
bien après cette date mais, effectivement, moins souvent qu’au début du XIème siècle. Ulysse
Chevalier prétend, pour expliquer ce phénomène, que le prévôt perd de l’importance dans la
vie du chapitre à la fin du XIème siècle. Il s’appuie sur deux actes : en 1066, si le prévôt
Arthaud est nommé avant le doyen Othmar8, il perd sa préséance vers 1068 car le doyen est
nommé avant le prévôt. Pour donner du poids à cette hypothèse, on pourrait ajouter la bulle
qu’envoya Urbain II aux évêques de Valence, de Genève, de Maurienne, de Grenoble, de Die
et de Viviers, dans le but de pourvoir le siège vacant de Vienne : dans celle-ci, c’est le doyen
de Vienne, Sieboud de Clermont, et non le prévôt, qui se rendit à Rome pour obtenir du pape
la garantie des biens de l’Eglise de Vienne dans l’attente de l’élection d’un nouvel
archevêque.Toutefois, le constat de la perte d'importance du prévôt est peut-être à nuancer car
dans les actes, le prévôt Arthaud figure encore devant le doyen sur la liste des témoins en
1077-1081, soit après la perte d'influence présumée du prévôt9. De plus, la dernière trace de
Rostaing, prévôt depuis au moins 1094 10, date de 1101-1105, or lors de cette dernière
mention, il figure comme témoin avant le doyen Subold11.
1 U.Chevalier, Cartulaire de St-André-Le-Bas, C.C.D. I, n°4*, p. 214. Juin 849 : Il s’agit du prévôt Mediolan. On trouve en Janvier 875 le prévôt Herlen. C.C.D. I, p.217, n°8* 2 C.C.D. I p.7*, n°104*. Et id. p. 229, n°19*. 3 U.Chevalier, description analytique de cartulaire de saint Maurice de Vienne, C.C.D. II. 2. Valence, 1891, p. 36, n°148. 4 Regeste dauphinois n°1260. 5 980, C.C.D. I, p.245-6, n°34* ; 980-995, C.C.D. I, p.89, n°125. 6 Vers 1075, un Othmar est témoin sans qu’il soit précisé s’il est le prévôt. C.C.D. I, p.271, n°60*. 7 A.de Terrebasse, Inscriptions... II, p. 238-9. 8 U.Chevalier, Cartulaire de St-André-Le-Bas, p.269-70, n°58*. Et U.Chevalier, Cart. de St. Maurice de Vienne, p.24, 60. 9 C.C.D.I, p. 272, n°61*. 10 Regeste Dauphinois N°2535. 11 C.C.D. I, p. 279, N°68*.
18
Cependant, il est vrai que l’arrivée de Guy de Bourgogne, réformateur de l’Eglise et,
comme bien d’autres grégoriens de son temps, peu conciliant avec la prévôté, fut fatale à cette
charge. Notons que l’archevêque attendit la mort du prévôt Rostaing, après 1100, pour se
débarrasser de l’opposition de la prévôté. Le prévôt disparut alors de nos sources et la prévôté
ne fut plus pourvue. Il est fort probable que le partage des bénéfices de Rostaing entre
l’archevêque et le chantre Guy eut pour valeur symbolique le démantèlement du personnat au
profit d’une charge qui prenait de plus en plus d’importance : la chantrerie1.
b) Un retour du prévôt au XIIIe ou XIVe siècle.
Il semble bien que le chapitre de Vienne voit le retour d’un prévôt dont les fonctions et
l’importance ont fortement diminuées. Le retour de cette charge, souvent supprimée lors de la
réforme grégorienne, ne semble pas être le seul cas de l’Eglise de Vienne : Malgré la
suppression de la charge à la fin du XIe siècle, le chapitre de Lyon compte parmi ses rangs un
prévôt de Fourvière à partir de 1193 2. A Vienne, le 10 février 1224, le pape Honorius III
ordonna que le grand archidiacre soit le second au chœur après le prévôt ou après le doyen, le
prévôt et le chantre3. C’est donc en toute logique que nous retrouvons la trace du prévôt dans
l’ordinaire de l’Eglise de Vienne rédigé vers 1250. Le prévôt préside le chœur droit devant les
archidiacres de Vienne, de Sermorens et d’Outre Rhône, l’écolâtre, le précenteur, le mistral et
23 chanoines4. Remarquons cependant que le prévôt n’apparaît pas dans les actes de la
pratique. Le premier prévôt connu après le retour de la charge, Guillaume Aymard, est
mentionné en 1336 dans les registres qui étaient à la fin du XVIIIe siècle encore dans les
archives de l’Eglise. Ces registres, aujourd’hui disparus, sont mentionnés au cours d’un
procès entre le chapitre et le collège5. Ce mémoire, produit par le collège dans sa lutte contre
le chapitre, contient la seule trace de l’existence d’un registre mentionnant les élections
annuelles des prévôts de 1336 à 1510. Malgré la disparition de ce registre, on peut affirmer
que le prévôt continua d’être présent au sein de l’Eglise de Vienne jusqu'à la suppression de
l’archevêché puisque la dernière mention du prévôt Bernard date de 1783. Il est tout de même
utile d’observer que le prestige de la fonction eut tendance à diminuer et, d’après Claude
1 Regeste 2546. La date de 1094 proposée pour la mort de Rostaing peut être reculée après 1101 malgré l’avis d’Ulysse Chevalier qui n’a pas vu la présence de Rostaing dans l’acte 68* du C.C.D.I. 2 J. Beyssac, Les chanoines de Lyon, Lyon, 1914, pp. 249-250 et 265-267. 3 U.Chevalier, Regeste Dauphinois, N°6719. 4 U.Chevalier, Ordinaire…, p.xvi. 5 Bibliothèque municipale de Vienne, M210 : Différend entre Chapitre et Collège 1782-1783, f° 66.
19
Charvet, le prévôt était considéré comme n’importe quel autre chanoine1. On pourrait même
s’interroger sur la nature de la charge : le prévôt était-il encore membre du chapitre ?
En effet, à la fin du XVIIIe siècle, il est très clair que d’après les pièces du procès entre le
chapitre et le collège, la prévôté n’est pas une charge du chapitre mais, au contraire, elle est
un enjeu pour le collège. Le prévôt est alors un préposé à l’administration des biens du collège
et doit défendre les intérêts des collègiés2. A l’examen des pièces du procès3, on s’aperçoit
que le collège tente de justifier la nécessité de la prévôté4. Est-ce le signe d’une menace d’une
nouvelle disparition de la charge ?
A partir des observations faites à propos de la fin du XVIIIe siècle, que peut-on conclure
sur le XIVe siècle ? Il semble évident, vu la discrétion du prévôt dans nos sources, que son
rôle fut dès le départ, fortement diminué. Comme il n’apparaît pas dans les statuts du chapitre
de 1385, il semble très probable qu’il fut, peu après sa réapparition, exclu du chapitre pour
être membre du collège. Aucun statut d’importance n’ayant été accordé entre la fin du XIVe
siècle et la fin du XVIIIe siècle le fonctionnement des institutions ne dut pas être modifié en
profondeur après 1385 : de là à conclure que dès sa réapparition, le prévôt fut un
administrateur des biens du collège ainsi qu’un médiateur entre le collège et le chapitre, il n’y
a qu’un pas à franchir. Nous ne le ferons pourtant pas, étant donné le peu de sources que nous
possédons, mais cette hypothèse semble séduisante.
2. Le doyen
Présent au chapitre de Vienne depuis les premières années du IXe siècle5, le doyen
préside les réunions et cérémonies liturgiques et dirige la communauté après la suppression de
la charge de prévôt vers 1101-1105. D’après une source qu’il ne cite pas, Claude Charvet
affirme que la nomination du doyen appartient au chapitre6. Est-ce valable pour le XIIe siècle ?
La charge de la doyenné est peu documentée au cours de cette période et seuls quelques noms
1 U.Chevalier, Etude…, p.27. 2 Bibliothèque municipale de Vienne, M210. f°40 et f°66. 3 Bibliothèque municipale de Vienne, M210 ; A.D.I. 2G e : procès (1700-1789). 4 Bibliothèque municipale de Vienne, M210, f° 40 : « mémoire pour le seigneur prévôt des collégiés de l’Eglise primatiale de Vienne contre le sir réfecturier du chapitre de la même Eglise » et f° 66 « septième question : les collégiés ont-ils un prévôt ou préposé à l’administration de leurs biens particuliers et à soutenir leurs intérêts ? Ont-ils le droit de s’assembler, d’avoir un secrétaire et des registres ? ». 5 Ulysse Chevalier, Etude sur la constitution…, p. 29. 6 U. Chevalier, Etude… , p. 29. Il cite la p. 279 de Claude Charvet, Constitution…,
20
nous sont parvenus1. La documentation changeant au milieu du XIIIe siècle, il nous est plus
facile de reconstituer la liste des doyens du chapitre de Vienne2. C’est en effet au cours du
XIII e siècle que la charge prend un poids considérable pour le chapitre : on apprend dans
l’ordinaire de Vienne que le doyen siège à la tête de la gauche du chœur et qu’il doit prêcher
régulièrement auprès du clergé cathédral dans la salle du chapitre. Dans les statuts de 1277, le
doyen a seul le droit d’admettre des clercs dans l’église3. Comme si son rôle ne faisait que
s’accroître avec le temps, les statuts de 1285 précisent que les décisions du chapitre prises en
l’absence du doyen ne seront considérées comme valables qu’après l’approbation de ce
dernier à son retour, et ce, même si l’archevêque est présent. En 1296, les statuts nous
apprennent que le doyen a le droit d’avoir comme compagnon un chanoine bachelier dispensé
de résidence. Cette dispense de résidence donne la garantie d’avoir droit aux distributions
même en cas d’absence au chœur, ce qui va à l’encontre de la plupart des statuts pris au cours
de cette période. Ulysse Chevalier prétend que dans les partages des prébendes, le doyen
reçoit le vingtième de la moitié des anniversaires soit 16 florins4.
Ces privilèges rendent donc la charge très attractive et l’on voit une véritable guerre
pour la doyenné surgir à la fin du siècle. Alaman de Condrieu soutenu par l’archevêque et la
majorité des chanoines se vit disputer sa charge par Geoffroy de Clermont, qui voulait
l’emporter par la force ayant mis la main sur les forteresses de Pipet et du Mont Salomon. On
peut dater cette lutte d’avant 1289, si l’on considère le 43ème et dernier statut du concile
provincial de Vienne qui précise qu’il est interdit d’utiliser la violence pour conserver ses
bénéfices ecclésiastiques5. Il semble bien que le message du concile ait été écrit dans ce
1 Du cartulaire de Saint-Maurice (C.C.D. II 2ème livr.) sont cités Alerius au Xème siècle (n°141) ; Siebold vers 1100 (n°11 et n°12) ; ce dernier apparaît encore à une date non déterminée dans les chartes de St Maurice publiés par U. Chevalier (C.C.D. X, 1ère livr). p.6, n°12; Burnon en 1200 (n°247). Du cartulaire de Saint-André-le-bas (C.C.D. I.) est cité Leutbert en 875 (n° 8*) ; Erlin vers 901-211 (n°13*) ; Othmar en 1067 (n°58*) ; Siebold vers 1090 (n°124*) ; Burnon en 1195 (n°235) ; En 1119 Pierre est doyen puis est élu archevêque en 1120 (cf. B.Schilling, Gallaia Pontifica, répertoire des documents concernant les relations entre la papauté et les églises et monastères en France avant 1198, Vol. III, t.1, diocèse de Vienne, Göttigen, 2006, p. 165). En 1125, Guillaume est doyen (U. Chevalier, codex diplomaticus sancti rufi, Valence, 1891, n°16). Ces mentions sont donc très incomplètes et il s’avère impossible de proposer une liste convenable des doyens de l’Eglise de Vienne. 2 Hugues de Paladru 1250-1254 ; Philippe de Savoie 1254-1268 ? ; Humbert de la Tour 1268-1273 (démissionne pour épouser la dauphine Anne ; Cf. Paul Thomé de Maisonneufve, le chapitre métropolitain de Vienne et le Liber divisionum terrarum, Grenoble, 1937, p.23) ; Geoffroy de Clermont 1274-1287 ; Allaman de Condrieu : 1287-1290 (+1309) ; Geoffroy de Clermont : 1290-1299 ; Hugues de Bressieu : 1300-1308 ; Guillaume de Clermont 1308-1334 ; Humbert de Clermont 1334-1339 ; François Lombard +1342 ; Jean de Clavesin +1344 ; Hugues Remestan vers 1350 ; Gillet de Montchenu +1361 ; Guillaume II de Clermont +1369 ; Guillaume de Virieu 1369-1389 ; Mathieu Costaing +1400. 3 Charvet ajoute que, lorsqu'il occupe sa stalle, tous les survenants lui font la révérence à reculons dans C. Charvet, Constitution, p. 120 cité par U. Chevalier, Etude…, p. 30. Statut 1277, Cf. Annexe. 4 U. Chevalier, Etude…, p.31. On suppose que cette information est issue du Liber divisiorum…. 5 Pour les canons du concile voir Louis Boisset, Un concile provincial au XIIIe siècle, Vienne 1289, Paris, 1973 (Théologie historique n°21).
21
contexte de dissensions internes au chapitre dans le but d’apaiser le conflit. Nous pouvons
peut-être avancer que la lutte commença aux environs de 1288, date à laquelle Alaman de
Condrieu est appelé doyen tandis que Geoffroy de Clermont n’est pas mentionné comme
chanoine de Vienne1. Cette guerre se termina en juin 1290 au terme d’un accord, dont nous
ignorons malheureusement le contenu2. Ulysse Chevalier prétend que c’est à cette occasion
que, pour dédommager Alaman de Condrieu, le chapitre se vit doter de la charge de sous-
chanterie à laquelle furent adjoints l’abbaye de Saint Ferréol et les quatre archidiaconés
ruraux3. Il semble difficile de suivre cet érudit puisque sa démonstration repose sur le seul fait
qu’un Alaman avait le titre d’archidiacre dans les statuts de novembre 1298 sans qu’il soit
précisé qu’il s’agit d’ d’Alaman de Condrieu4.
Les historiens Chorier et Charvet relatent un deuxième épisode violent autour de la doyenné
en 1308-1309 sans que nos sources le confirment : Hugues de Bressieux, doyen de Vienne,
ainsi que plusieurs autres conjurés, assassinèrent le courrier de l’Eglise dans la salle où rendait
la justice estimant que ses sentences étaient trop sévères. L’archevêque fit prendre les armes
aux bourgeois et assiégea les assassins. Dans l’attente du jugement, Ainard de Bressieux,
Arthaud de Roussillon, Guigues de Roussillon, le seigneur de Clérieu ainsi que Guigues
Alaman et le Dauphin intervinrent en faveur du doyen. Celui-ci fut démis de ses fonctions et
son canonicat fut remis à Guillaume de Clermont. De plus, il dut fournir des gages pour les
dédommagements à payer et fonder en expiation une chapelle dotée de 100 sols5.
Ces conflits nous montrent que la doyenné est un enjeu de pouvoir et une source de conflits
entre des réseaux à l’intérieur même du chapitre. Ce pouvoir sur le chapitre fut confirmé par
les statuts de 1385 qui indiquent que le doyen a le droit de juridiction et de correction sur les
chanoines, les prêtres, les clercs et les serviteurs du tribunal ecclésiastique6.
3. Les archidiacres
Les archidiacres exercent la juridiction spirituelle sur une partie du diocèse. Ils font partie
du groupe de clercs qui entoure le prélat et ils sont à l’origine du chapitre cathédral.
1 Statut du 1er mars 1288, Cf. Annexes. 2 Statut du 25 juin 1290, Cf. Annexes. 3 U. Chevalier, Etude…p. 29-30. 4 Statut du 2 nov. 1298. Notons tout de même qu’Ulysse Chevalier eut accès au liber divisiorum contrairement à nous. Son affirmation est peut-être tirée de cette source qui nous échappe. 5 N. Chorier, Histoire de Dauphiné, t.II, pp. 268sq. Et C.Charvet, Histoire…, p. 435-436. 6 Statuts 1385, Cf. Annexes.
22
L'archidiacre est donc un membre particulier du chapitre puisqu'il est chargé de tâches n'ayant
rien à voir avec la vie de la communauté capitulaire1.
La première mention d'un archidiacre dans le diocèse de Vienne date des environs de 516 2.
Sanctus, qui fut le premier à porter ce titre, fut archidiacre au temps du royaume burgonde qui
comptait d’autres archidiacres dans les diocèses de Marseille et de Trois-Châteaux. Leclercq
fait remonter la fonction au IVe siècle, donc, la présence de notre archidiacre viennois
n'apparaît en rien comme surprenante. Toutefois ce dernier précise que l’archidiaconné fut
rapidement appelée doyenné. Quoi qu’il en soit, il semble qu’après le VIe siècle, l’archidiacre
disparaisse des sources pour ressurgir à partir du XIe siècle. Effet de source ou mutation de la
charge ? Il semble peu évident de le dire. Ulysse Chevalier prétend, et nous le suivrons dans
cette voie, que le grand archidiacre ne devint pas le prévôt, mais que le prévôt se plaça au-
dessus de l’archidiacre3.
a) Les archidiacres aux XIe et XIIe siècles
Le premier archidiacre que nous connaissons après la réapparition de la charge dans nos
sources est Ismidon. Il donna avec son neveu pour la communauté des frères qui servaient
Saint-Maurice une terre située dans Vienne près du palais du roi et d’autres terres situées hors
de Vienne. Il fit ce don pour l'âme de ses parents et pour le canonicat de son neveu, Milon,
vers 1070 4. Il est difficile de savoir si cet homme exerça sa charge en même temps que
Rostaing et Richard, dont la seule preuve qu'ils furent archidiacres date de 1077-1080 5.
Notre documentation s’étoffant à l’aube du XIIe siècle, il est plus facile de retrouver les
archidiacres suivants, que nous choisissons de présenter dans un ordre chronologique :
- Silvion, archidiacre, est mentionné dans un acte daté de 1091-1115 6 . Ce dernier
s’empara de l’église des Contamines en 1120, soit peu après le départ de l’archevêque
nouvellement élu sur le siège de saint Pierre. Cette église appartenait à la « mense des frères »
et le tout nouveau pape lui enjoignit de la rendre sans délai7.
1 C. Barralis, « les auxiliaires de l’évêque : chanoines et archidiacres » dans M.-M. De Cevin et J.-M.Matz, Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin, p. 150. 2 Regeste Dauphinois, n° 286. 3 U.Chevalier, Etudes…, p.23, note 1. 4 C.C.D. I, p29*, n°122*. 5 C.C.D I, p. 272-3, n°61*. 6 C.C.D. I, p.276, n°65*. 7 C.C.D. I, p.287-8, n°75* et 76*. Cette expression mensam fratrum pose question. Comme la séparation de la mense capitulaire de la mense épiscopale date de 1285, il est difficile de l’interpréter : les menses capitulaires et épiscopales étaient-elles déjà séparées à cette date ? Faut-il alors penser qu’elles ont été réunies entre 1120 et 1285, date d’une nouvelle séparation ? Nous éluderons la question étant donné le manque de sources qui
23
- Adémar est archidiacre : il est mentionné dans deux actes datés de 1101-11051· et de
1091-1115 2. On retrouve un Adémar archidiacre à une date non déterminée de l’épiscopat de
Guy de Bourgogne3.
- Guillaume est archidiacre aux alentours de 11004, puis apparaît en 1101-11055, ainsi
qu’à une date non déterminée aux côtés d’Adémar6. Est-ce encore ce personnage qui est
mentionné vers 11187, ou est-ce un autre archidiacre du nom de Guillaume ? Il semble en
effet qu’il y ait eu plusieurs archidiacres du nom de Guillaume au cours du XIIe siècle puisque
on trouve Guillaume dans de nombreux actes qui ne sont pas datés. On le trouve cependant à
une date probablement antérieure à l’épiscopat d’Etienne8, puis sous l’épiscopat de celui-ci9,
mais aussi certainement après, à une date non déterminée10. On trouve un Guillaume de
Faramans, archidiacre à une date non déterminée11. Nous savons aussi que Guillaume de
Motte était archidiacre en 120212. Il est ainsi très difficile de distinguer le nombre de
Guillaume qui furent archidiacres au XIIe siècle, ainsi que l’étendue de la durée de leur charge.
- Girbert est archidiacre sous l’épiscopat d’Etienne13. Est-il ce Girbert de Vernosc
archiprêtre en 119014· ? Il me semble que l’hypothèse est peu probable étant donnée le hiatus
entre ces dates.
- Bernard de Miribel est appelé obédiencier des chasses en 117915, puis archidiacre en
118416. Nous savons que ce Bernard est toujours vivant en 119117, mais à cette date, il n’est
affecté d’aucune charge. Faut-il l’identifier comme l’archidiacre B. en 120218 ? Cela semble
permettent de répondre à cette question. Nous considérerons donc que la mense des frères indiquée dans ce texte est la seule mense de l’église de Vienne. 1 C.C.D. I, p. 279, n°68*. 2 C.C.D. I, p.276, n°65*. 3 U.Chevalier, Chartes de saint Maurice de Vienne, de Léoncel et de l’Eglise de Valence, Paris, 1912. p.9, f°80, n°200. 4 C.C.D. I, p. 278, n°67*. 5 C.C.D. I, p. 279, n°68*. 6 U.Chevalier, Chartes de saint Maurice de Vienne …, p.9, f°80, n°200. 7 C.C.D. I p. 282, n°73*. 8 U.Chevalier, Chartes de saint Maurice de Vienne …, p.7, f°68, n°165. 9 Id. p.7-8, f°72, n°178. 10 Id. p.9, f°80 n°199. 11 Id. p.8, f°72, n°180. 12 Id. p.16, f°88, n°252. 13 Id. p.7-8, f°72, n°178. 14 Id. p. 12, f°84, n°217. 15 Id, p.11, f°82v°, n°207. 16 Id. p.11, f°82, n° 205. 17 Id. p.12, f°83v°, n°214. 18 Id. p.15, f°87v°, n°248.
24
peu évident à affirmer car, cette année-ci, l’archidiacre Bornon de Lanz est présent au
chapitre1.
- Bernard Alaman est appelé archidiacre en 1179 2, tout comme en 1184 3. En 1185, il est
dit obédiencier4. Est-il à rapprocher de l'archidiacre B. de 1202 5, ou de l'archidiacre Alaman,
qui exerça sa charge sous l'épiscopat d'Etienne6 ? Si la première question me semble insoluble,
la deuxième paraît improbable, mais pas impossible, car la durée de sa charge dépasserait les
20 ans.
- Autour de 1200, les mentions se font de plus en plus précises et nombreuses : Guigues
d’Ornacieu fut archidiacre en 11967, et nous savons également que Guigues Evrisi le fut aussi
à une date inconnue mais située très probablement peu avant 1195, car dans l’acte figure
Aynard de Moirans sans qu’il soit mentionné sa qualité d’archevêque8. Peu après, en 1202 et
1203, nous trouvons deux mentions de l’archidiacre Guitfred Bachilin9, et en 1203 une
mention de l’archidiacre Didier10.
Le faible nombre des mentions des archidiacres nous invite à nous interroger sur leur
nombre : étaient-ils cinq à se partager l’administration du diocèse comme le prétend le
pseudo-acte de 790-805 ? Au XIIe siècle aucun élément ne donne à penser que les achidiacres
aient pu être plus que trois en charge simultanément. Dans les deux premiers tiers du XIIe
siècle, il semble qu’il n’y ait eu que deux archidiacres présents au chapitre. Cependant, en
1202, nous savons qu'il y eut au moins trois archidiacres et ceux-ci sont différents des deux
qui sont cités en 1203 11. Avancer que c’est à l’extrême fin du XIIe siècle que le nombre des
archidiacres fut augmenté au nombre de 5 est donc une hypothèse convaincante quoique non
démontrée avec certitude.
Nous avons pu remarquer au cours de l’étude des mentions des archidiacres qu’aucune des
mentions relevées ci-dessus n’est accompagnée de circonscriptions géographiques pourtant
clairement énoncées dans l’acte de 709/805. L'enjeu est donc de comprendre la mise en place
des circonscriptions archi-diaconales du diocèse de Vienne.
1 Id. p.16, f°88, n°252. 2 Id. p.11, f°82, n°205. 3 Id. p.11, f°82, n° 205. 4 Id. p.11, f°82, n°207. 5 Id. p.15, f°87v°, n°248. 6 Id. p.10-11, f°81, n°201. 7 Id. p.14, f°85v°, n°228. 8 Id. p.13, f°85, n°223. 9 Id. p.16, f°88, n°252 et p.17, f°88v°, n°253. 10 Id. p.17, f°88v°, n° 254. 11 C.C.D X, I, n°16.
25
b) La mise en place des archidiaconés au milieu du XIII e siècle
La première mention de l’un des cinq archidiaconés cités dans l’acte de 790/805 se trouve
dans une bulle pontificale datée du 10 février 1224. Dans cette bulle Honorius III charge
l’archevêque de Lyon et l’abbé de Belleville de pourvoir à l’observation du statut de l’évêque
de Porto, alors légat du pape, qui indique que le grand archidiacre de Vienne doit occuper au
chœur et au chapitre la première place après le prévôt. Partout ailleurs, ce dernier doit passer
après le doyen, le prévôt et le chantre1.
Nos actes ne nous permettent pas de savoir quand apparurent les circonscriptions de
chacun des cinq archidiaconés. Cependant, l'ordinaire de Vienne nous apprend que les limites
géographiques sont fixées lors de la rédaction de l'ordinaire, vers 12502 · : le premier
archidiaconé (Vienne) part de la porte de saint Pierre et va jusqu'à Glalaurum ; le deuxième
(La Tour) de la porte saint Sévère jusqu'au-delà de Carisium ; le troisième est au-delà du
Rhône ; le quatrième est l’Altaveon (Romans) ; le cinquième, quant à lui, est le Sermorens3. Il
est intéressant de remarquer que si les limites géographiques sont claires, les noms des
archidiaconés ne sont pas tous mentionnés. Le grand archidiacre n’est pas nommé comme
étant celui de Vienne, et tout comme celui de la Tour, nous connaissons les limites
géographiques de l’archidiaconat mais pas son nom. Ce constat peut néanmoins être nuancé :
nous trouvons dans ce même ordinaire la mention de l’archidiacre de la Tour à deux reprises4.
Le grand archidiacre ou l’archidiacre de Vienne est lui aussi mentionné mais en note5. Cette
correction fut-elle l’œuvre de l’auteur peu après la rédaction, ou bien est-ce une reprise
tardive ? S'il est impossible de répondre à cette question, nous pouvons néanmoins faire le
constat suivant : Si nous excluons les citations des archidiacres situés dans les notes, car elles
sont peut-être plus tardives que la rédaction de l'ordinaire, nous ne trouvons que six mentions
d'archidiacres où il est précisé leurs circonscriptions géographiques, tandis qu'il existe 18
1 U.Chevalier, Regeste Dauphinois…., n°6719. 2 U.Chevalier, Ordinaire de l’Eglise cathédrale de Vienne, Paris, 1923, p. 40. 3Id. : «Debet evangelium archidiacona Altavensis. In patriarchali ecclesia Vque sunt archidiaconie : prima archidiacona, a porta Sancti Petri usque ad Glalaurum, legat evangelium in Nativitate et Sabbato sancto et benedictionem cerei et in Assensione Domini ; Secunda, a porta Sancti Severi usque ultra Carisium, legat evangelium in Pascha et in Apparitione Domini ; tercia, ultra Rodanum, legat evangelium die Pentecotes et in Ramis palmarum ; quarta, Altavensis legat evangelium die sancti Mauricii et in Cena Domini ; quinta, Salmoracensis, legat evangelium in Dedicatione matris ecclesie et in festo Omnium Sanctorum et in Parasceve. » 4 Id. p.16 : euvang. archidiaconus de Turre Cum natus esset Jhesus ; p.48 : deinde archidiaconus de Turre deferat crucem auream, et alii diaconi ; 5 Id. p.83, note d : Cantores vero archydiaconus Artavensis et archydiaconus Vienne et archydiaconus de Turre ; succentores, archydiaconus Artavensis et archydiaconus Salmoracensis.
26
mentions d'archidiacres sans circonscription géographique 1 . Ainsi, les archidiacres
n'apparaissent avec leurs circonscriptions que dans seulement 25%% des cas. Ce faible taux
peut être expliqué aisément si l’on suppose que le milieu du XIIIe siècle est le temps de la
mise en place des archidiaconés, dont l’identité territoriale semble encore peu affirmée.
4. Le capiscol
Dans le faux de 790/805, la capiscolie est la quatrième dignité de l’Eglise de Vienne.
Celle-ci, comme toutes les autres, ne doit être tenue que par un chanoine. Notre absence de
documentation sur la capiscolie avant l’épiscopat de Jean de Bernin nous incite à penser que
cette charge n’apparaît qu’avec son premier détenteur connu, Berlion. Ce dernier est pour la
première fois nommé capiscol en 1228 dans les statuts de l’Eglise de Vienne lors des
promesses de dons pour les œuvres de l’église, mais il occupe certainement la charge dès
1225, lors la première mention de cette dignité2. Dès son arrivée dans l’entourage épiscopal,
le capiscol possède des pouvoirs étendus : il peut exclure ou réconcilier les clercs du chœur et
semble responsable de la tenue des offices3. Au titre de sa capiscolie, Berlion touche le tiers
des cens et ventes des maisons qui sont dans le cloître4. A cette date, il faut mentionner que
Berlion n’est pas membre du chapitre, ces revenus ne peuvent alors pas être considérés
comme une prébende. Cependant, nous pouvons supposer que les 6 livres et 14 sous qu’il
touchera chaque année après 1245 sont perçus au titre de prébende car c’est à cette date que
Berlion devient membre du chapitre et qu’il touche cette somme pour sa part de Chuzelles5.
Par la suite, tous les capiscols seront membres du chapitre, ce qui implique que le statut de
790/805 n'a pas pu être rédigé avant 1245. Dans ses attributions, le capiscol semble devoir
s’occuper du réfectoire puisqu’en 1247, Berlion touche 160 livres provenant du péage pour le
dédommager des réfectoires de l’année précédente6.
Il semble aussi que la principale attribution du capiscol est proche de celle du maître du
chœur puisqu’il peut affecter avec celui-ci des offices aux chanoines, chapelains et clercs de
1 Id. une mention p.10 ; p.39 ; p.41 ; p.42 (en plus de la mention de l’archidiacre de Sermorens) ; p.43 ; p.65 ; p.69 ; p.107 ; deux mentions p. 11 ; trois mentions p.44 ; quatre mentions p.33. 2 Cf. statuts 1225, 1228. Annexes. Dans les promesses de dons, Berlion n’apparaît qu’en 26ème position dans la liste et ne promet que 20 sous ce qui nous semble peu au regard des autres promesses de don. 3 Cf. Statuts 1225. Annexes. De plus, en 1278, le capiscol Humbert doit vérifier en compagnie du préchantre et de P. de Marjay, la qualité des répons récités lors de la révélation de saint Maurice. Cf. Statuts 1278. Annexes. En 1296, le capiscol, le doyen et le sacristain sont tous les trois responsables de l’organisation de la fête de la Nativité ainsi que de la fête de la conception de la Vierge. Cf. Statuts 1296. Annexes. 4 Cf. Statuts 1241. Annexes. Nous supposons que les limites fixées dans ce texte sont en réalité les limites du cloître au regard des limites indiquées en 1309 dans un acte qui ne nous est parvenu que par une traduction de Claude Charvet (C. Charvet, Histoire…, p. 441). 5 Cf. Statuts 1245. Annexes. 6 Cf. Statuts 1247. Annexes.
27
l’Eglise1, mais il semble que dès son apparition il est le supérieur du maître du chœur ainsi
que cela est précisé dans l’acte de 790/805. En effet, si tous deux peuvent nommer des clercs
dans le chœur2, sa prérogative est supérieure à celle du magister car lors des statuts qui
limitent l’accès des clercs au chœur, le capiscol conserve le droit de nommer un nombre
restreint de clercs tandis que le magister perd bien souvent ce droit3. De plus, c’est lui qui, à
partir de 1287 vérifie si les clercs qui accèdent au chœur savent lire et chanter4. Notons
également que le successeur probable de Berlion, Humbert de Seyssuel, dénommé capiscol à
partir de 12765, fait partie de ceux qui peuvent nommer 12 chanoines supplémentaires en
12876.
On apprend que le capiscol a, en 1261, un droit de regard sur les anniversaires des
mandements d’Illins, de Marennes, de Pinet et de ce qui est de l’autre côté du Rhône7. Cette
prérogative qui n’est pas du ressort de l’écolâtre, mais plutôt des procurateurs des
anniversaires, n’est pas liée à la personne de Berlion, car, en 1285, le capiscol Humbert est
dénommé procurateur des anniversaires8. Ce cumul de fonctions nous incite à penser que le
capiscol a un rôle particulier au sein du chapitre.
Ceci est confirmé en 1276, quand le capiscol Humbert de Seyssuel est désigné comme
arbitre dans le conflit qui oppose le doyen Geoffroy de Clermont, d’une part, et l’archevêque
et le chapitre d’autre part9. En 1277, ce même Humbert a un droit de regard sur les revenus
des anniversaires jusqu'en 1280 10. Lors de sa dernière apparition dans nos sources en 1298,
Humbert fait partie du groupe de chanoines choisis pour procéder à la division des terres11.
Ainsi, les deux capiscols connus pour le XIIIe siècle ont des pouvoirs très étendus et très
variés. Il semble cependant que le rôle principal du capiscol soit l’organisation des offices et
la qualité de ceux-ci. Cela est confirmé dans les statuts de 1385 qui indiquent que le capiscol
est tenu par sa fonction de fréquenter les offices divins de jour et de nuit, de gouverner le
chœur, de corriger les défauts du chant. Il peut néanmoins se faire remplacer par un chanoine
ou un prêtre capable. Le capiscol a droit de correction sur les clercs qui refuseraient de venir
1 Cf. Statuts 1251.1291 Annexes. 2 Cf. Statuts 1272. 1284 Annexes. 3 Cf. Statuts 1259. 1277. Annexes. 4 Cf. Statuts 1287. Annexes. 5 Cf. Statuts 1267. Annexes. 6 Cf. Statuts 1287. Annexes. 7 Cf. Statuts 1261. Annexes. 8 Cf. Statuts 1286. Annexes. 9 Cf. Statuts 1276. Annexes. 10 Cf. Statuts 1277. Annexes. 11 Cf. Statuts 1298. Annexes.
28
ou ne sauraient pas rendre les répons1. De plus, il s’engage à remettre au chargé du réfectoire
la liste des 68 prêtres, diacres, sous-diacres ou simples clercs du collège par ordre
d’ancienneté avant la fête de Saint-Maurice2. La qualité des offices étant liée aux clercs qui
les exécutent, le capiscol se doit de vérifier les compétences des clercs qu’il nomme3. Ces
attributions diverses et étendues nous indiquent que le capiscol a la confiance du chapitre et
de l’archevêque durant tout le XIIIe siècle, ce qui en fait un acteur fondamental dans la vie du
chapitre.
5. Le magister : un maître du chœur
Avant l’arrivée du capiscol, nous supposons que le magister est l’officier chargé de
l’instruction, de la direction des clergeons et de la tenue des offices4. Nous avons vu que le
capiscol possède la plupart de ces attributions et possède en outre une dignité supérieure à
celle du magister. Au XIII e siècle, les statuts nous apprennent qu’il dirige le chant des fêtes à
neuf lectures et qu’il a sous sa direction deux clercs formiers5. Il peut punir et réconcilier les
clercs qui manquent à leurs offices6. De plus c’est lui qui, avec le capiscol, peut intégrer des
clercs au chœur supérieur et recevoir du nouveau clerc l’argent nécessaire pour payer un repas
à l’Eglise de Vienne7. Les statuts de 1385 nous apprennent qu’il doit, avec le capiscol,
remettre au chargé du réfectoire la liste des 68 prêtres, diacres, sous-diacres ou simples clercs
du collège par ordre d’ancienneté avant la fête de saint Maurice8. On peut supposer qu'aux
XIII e et XIVe siècles le maître du chœur devait aussi inscrire chaque semaine les prêtres,
diacres, sous-diacres et clercs qui devaient assumer les offices de la semaine suivante comme
il devait le faire au XVIIIe siècle9.
L’enjeu pour cette charge est de savoir si tous les magistri sont des maîtres du chœur.
En effet, le titre de maître est parfois employé comme distinction honorifique pour un gradé
dans les lois. En 1263, le magister choro est un certain P. que l'on peut identifier à P.
EVRARD dénommé magister en 1259 et en 1261 10. Il semble donc que le titre de magister se
confonde avec celui de maître du chœur. Cependant, si ce constat est valable pour la seconde
1 Cf. Statuts 1385 n° 34. Annexes. 2 Cf. Statuts 1385 n° 3. Annexes. 3 Notons que le capiscol doit vérifier la légitimité des clercs ainsi que leurs capacités de lecture et de chant. Cf. Statuts 1385 n°25. Annexes. 4 U.Chevalier, Etudes …, p.36. de plus voir Y.Esquieu, Autours de nos cathédrales…,p. 77. 5 Cf. Statuts 1276. Annexes. 6 Cf. Statuts 1225. Annexes. 7 Cf. Statuts 1246 ; 1271 ; 1277 ; 1284. Annexes. 8 Cf. Statuts 1385 n° 3. Annexes. 9 Mémoire 1788, Bibliothèque municipale de Vienne, M210. 10 U. Chevalier, Etudes…, p.36.
29
moitié du XIIIe siècle, peut-on considérer que les magistrii des XIe et XIIe siècles sont bien les
responsables du chœur ou bien sont-ils des maîtres du droit comme c'est le cas dans certains
chapitres rhodaniens1 ? Nous nous garderons de répondre à cette question devant le manque
d’éléments pour y répondre.
6. Les chantres
Dans les prétendus statuts de Charlemagne on apprend que la préchanterie et la chanterie
sont des personnats c'est-à-dire, selon C. Barralis, une charge sans juridiction2. On trouve en
1125 deux chantres au chapitre de Vienne3. Yves Esquieu voit dans ces deux chantres, un
préchantre et un sous-chantre dont la distinction attribue au premier une dignité supérieure au
second. Selon lui cette distinction apparaît alors tardivement à Vienne si l’on compare le cas
des chapitres de la basse vallée du Rhône4. Cependant, on trouve déjà un préchantre, Richard,
en 1066 au sein de l’Eglise de Vienne5. On trouve même vers 1110 deux préchantres au sein
du chapitre, ce qui rend l'hypothèse d'Yves Esquieu fragile6. De plus, c’est le chantre et non le
préchantre qui peut, à partir de 1221, remplacer l’évêque absent pour gérer et contrôler la
résidence des chanoines, élément indispensable à qui veut prétendre au partage des terres
vacantes7 . Nous devons aussi remarquer que Raymond est tantôt appelé chantre tantôt
préchantre dans les statuts du chapitre, ce qui rend peu probable la distinction proposée entre
le chantre et le préchantre8. Il semble alors possible que cette distinction n'existe pas jusqu'à la
fin du XIIIe siècle et qu'il n'y a pas de différence entre le chantre et le préchantre. Cette
hypothèse est corroborée par la présence de deux chanoines appelés chantres dans les statuts
sans distinction du rang ou de dignité9. Ce n’est qu’en 1328 qu’Albert Lombard est dénommé
préchantre tandis que Lambert de Chandieu est clairement appelé sous-chantre. On peut alors
supposer que ce n’est qu’à la toute fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle qu’apparaît
une distinction de dignité entre les chantres.
1 Y. Esquieu, Autour de nos cathédrales… p. 76-77. 2 C. Barralis, « les auxiliaires de l’évêque : chanoines et archidiacres » dans De Cevin et Matz (dir.) Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), op. cit., p. 151. 3 U. Chevalier, Codex diplomaticus sancti rufi, Valence, 1891, n°16. 4 Y. Esquieu, Autour de nos cathédrales… p. 76-77. 5 Regeste dauphinois n°2021. 6 C.C.D.I n°69*. 7 Cf. Statuts 1221. Annexes. 8 Le 12 février 1285, Raymond est dit préchantre puis le 2 novembre de la même année, il est appelé chantre. Ce Raymond n’aura été, dans les statuts du chapitre dénommé préchantre que deux fois au maximum, en 1278 et 1285, tandis qu’il est appelé chantre 4 fois entre 1221 et 1286, date de sa mort. Cf Statut 1221, 1265, 1277, 1278, 1285, 1286. Annexes. 9 Après la mort de Raymond, c’est G. Remestan qui occupe ce personnat. Ce dernier toujours dénommé chantre au même titre que son collègue G. de Virieu. Cf. Par exemple Statuts 1288. Annexes.
30
Nous avons évoqué plusieurs rôles du chantre dans le chapitre. Ajoutons qu’en 1277, le
chantre Raymond fait partie des chanoines désignés pour organiser les autels, c'est-à-dire qu’il
affecte en compagnie du capiscol les messes et anniversaires aux clercs de l’Eglise1. Dans les
statuts de 1385, ce rôle est confirmé puisque le préchantre et le chantre doivent faire assurer
les offices par un chanoine idoine lorsque l’autel est paré et par un chevalier ou des
quaterniers lorsque ce n’est pas le cas2. Le préchantre doit aussi contrôler les répons chantés
lors de la fête de saint Maurice et veiller sur la caisse des aumônes3.
La nomination des chantres appartient au chapitre qui élit à l’unanimité G. Remestan à la
charge de chantre en 12864. Le chapitre peut aussi déléguer ses pouvoirs comme ce fut le cas
en le 25 juin 1290 lors de l’élection d’Odon Alaman qui fut nommé par trois commissaires :
l’archevêque, le doyen et l’archidiacre5.
7. Le sacristain
Si dans la moyenne vallée du Rhône la charge de sacriste ou sacristain est l’une des plus
anciennement établie dès le IXe siècle, il faut attendre 1050 à Vienne pour qu’apparaisse une
charge équivalente : le custos6. En 1069, Foulque est dénommé custos et primiscrimus, ce
qu'Ulysse Chevalier interprète comme gardien et chargé des armoires7. L’office change de
nom au début du XIIe siècle. A cette date, pour la première fois et systématiquement après, on
parle de sacristain dans nos sources et non plus de custos. Succèdent alors à Pascal, sacristain
en 1120, Amblard qui est dénommé sacristain vers 1125 8. Il faut attendre 1202 pour connaître,
grâce à la publication d’un acte par Claude Charvet, un autre sacristain, Pierre d’Arènes9.
Ce n’est qu’au cours du XIIIe que nos connaissances sur cet office s’étoffent. En 1243,
les statuts du chapitre nous apprennent que le sacristain a la gestion de l’argent nécessaire aux
travaux de réparation de la tour du château de Pipet10. En 1287, le sacristain Odon fait partie
d’un collège qui donne 40 sous aux obédienciers de Reventin pour rénover leur maison qui
tombait en ruine11.
1 Cf. Statuts 1277. Annexes. Notons également que Raymond est certainement le chantre désigné comme R. Francisci en 1265. Celui-ci touche alors 100 sous par an pour n’avoir pas reçu de part de la division des terres d’Humbert de Casaneto ni celle de Lanthelme de Chignin. Cf Statuts 1265. Annexes 2 Cf. Statuts 1385. Annexes. 3 Cf. Statuts 1278. 1286. Annexes. 4 Cf. Statuts 1286. Annexes. 5 Cf. Statuts 1286. 1290. Annexes. 6 Y.Esquieu, Autour de nos cathédrales…, p. 74. Il s’agit de Ponce cf. U. Chevalier, Regeste n° 1877. 7 U.Chevalier, Etudes…, p. 37 8 U.Chevalier, Regeste…, n° 3282 (Pascal), n°3378 et n°3423 (Amblard). 9 C.Charvet, Histoire…, p.367. 10 Cf. Statuts 1243. Annexes. 11 Cf. Statuts 1287. Annexes.
31
Outre la gestion de la caisse des travaux pour le compte de l’Eglise de Vienne, la
principale attribution du sacristain est l’organisation des offices. En 1248, un statut rappelle
que le sacristain Amblard doit sonner les cloches lors des célébrations qui recourent au chef
de saint Maurice1. Dans les statuts, nous apprenons aussi qu’il a la charge de pourvoir
l’éclairage nécessaire lors des offices, en particulier lors de la fête de la circoncision du
Christ2. Martin doit fournir au sacristain la lumière nécessaire pour la célébration de la fête de
saint Jean3. Le sacristain Odon doit organiser la fête de la conception de la Vierge en
compagnie du doyen et du capiscol4. Cependant, quelques années plus tard, en 1298, ce même
Odon en est dispensé5. Peut-être était-il malade ou trop âgé car l'année suivante, le sacristain
n'est plus Odon mais G. que l'on peut supposer être Guigues d'Amaysin6? En 1309, son rôle
est précisément décrit : il fait exécuter les sonneries, pourvoit aux luminaires, fournit la cire et
l’encens lors des offices7. Dans les statuts provinciaux de 1289 on apprend que les sacristains
de la province ecclésiastique doivent tenir clos et couverts les fonts baptismaux et en faire
laver le linge à Pâques8.
Ses attributions font du sacristain un personnage très important dans la vie religieuse de
la cathédrale. Le rôle primordial du sacristain est confirmé par divers statuts qui nous
rappellent son importance. Lorsque le chapitre élit un groupe de chanoines pour une mission
particulière, le sacristain est systématiquement présent dans le collège ainsi constitué : En
1257, le sacristain eut son mot à dire dans l'admission des clercs dans le chœur supérieur et
put choisir 12 chanoines supplémentaires lors de la grande « fournée » de 1288 9. En 1279, le
sacristain Odon fit partie du groupe de chanoines choisis par le chapitre pour emprunter et
rembourser les dettes du chapitre10. En 1285, Odon est à nouveau élu pour constater et réparer
les dégâts commis par la guerre entre le comte de Savoie et le Dauphin11. En 1278, ce même
Odon est choisi par le chapitre pour participer à la nomination du châtelain de Pipet12. En
1 Cf. Statuts 1248. Annexes. 2 Cf. Statuts 1269. Annexes. 3 Cf. Statuts 1279. Annexes. 4 Cf. Statuts 1295. Annexes. 5 Cf. Statuts 1298. Annexes. 6 Cf. Statuts 1299 et 1328. Annexes. 7 C.Charvet, Histoire…, p.437-445. 8 C.Charvet, Histoire…, p.424-428. et L.Boisset, Un concile provincial au XIIIème siècle, Vienne 1289, Paris, 1973 (Théologie historique n°21),. Les statuts de ce concile sont donnés en annexes. 9 Cf. Statuts 1257, 1288. Annexes. 10 Cf. Statuts 1279. Annexes. 11 Cf. Statuts 1278. Annexes. 12 Cf. Statuts 1285. Annexes.
32
1289, le sacristain est choisi par le chapitre pour faire partie de ceux qui pourront édicter et
corriger les statuts de l’Eglise1.
8. Mistral
Cet office ne semble apparaître à Vienne qu’à partir de la fin du XIIe siècle dans
l’entourage épiscopal où figurent Hipandius en 1184, et vers 1190, le mistral Guillaume2.
Nous trouvons également, dans un acte publié par Claude Charvet, le mistral Ismidon de
Cordon en 1202 sans qu’il soit précisé ses attributions et prérogatives3.
Il faut en effet attendre le XIIIe siècle pour que l'office soit décrit plus précisément.
Claude Faure nous apprend que le mistral de l’Eglise de Vienne était chargé de la justice
temporelle de l’Eglise ainsi que de la garde de la ville dont il possédait les clefs4. Il nommait
les portiers et recevait leurs serments. C’est lui aussi qui accordait les permissions de
secondes noces moyennant le payement de certains droits5. Notons également que Charvet
transcrit un acte datant de 1309 dans lequel on apprend que le mistral peut exercer la justice
dans le cloître mais qu’il n’a aucun droit sur les chanoines et clercs de la cathédrale6. Le 8
décembre 1320, le pape Jean XXII supprima le mistral de Vienne mais la charge ne s'éteignit
qu'en 1361 après la mort de Siebold de Clermont qui fut mistral entre 1312 et 1361 7. Devant
le peu d’informations que nous laissent entrevoir nos sources, nous sommes tentés de le suivre
dans ses affirmations bien qu’il ne cite aucune preuve de ce qu’il avance. Cependant, nous
apprenons par les statuts du chapitre que la nomination du mistral appartenait à l’archevêque
puisqu’en 1281, lors de la vacance du siège épiscopal, un collège de trois chanoines fut
désigné par l’évêque de Valence, assurant alors le gouvernement de l’Eglise de Vienne, pour
nommer le nouveau mistral, Odon Alaman8.
1 Cf. Statuts 1289. Annexes. 2 U. Chevalier, Etudes…, p. 44. et C.Faure, « Histoire de la réunion de Vienne à la France » dans bulletin de l’académie delphinale, Grenoble, 1905, t. 19, p.359-362.. 3 C. Charvet, Histoire…, p. 367 4 C. Faure, Histoire de la réunion de Vienne à la France dans Bulletin de l’Académie Delphinale, 1905-6, Série 4, T. XIX, p. 359-61. et Y. Esquieu, Autour de nos cathédrales…, p. 71. 5 C. Faure, Histoire de la réunion de Vienne a la France…., p. 359-61. 6 C.Charvet, Histoire…, p.437-445. Il semble qu’il succède à Odon Alaman puisque la dernière apparition de ce dernier date de 1309. Cf. Charvet, Histoire…, p. 437-445. 7 P.Thomé de Maisonneuve, Le chapitre…. Et U.Chevalier, Etudes…, p.45. 8 Cf. Statuts, 1281. Annexes. Odon Alaman était chanoine depuis 1275. Il fut nommé chantre en 1290 puis décéda en 1311. Son successeur probable à la charge de mistral, Sieboud de Clermont, n’apparaissant dans nos sources qu’à partir de 1309 il semble probable qu’Odon Alaman cumula ces charges. Cf. Paul Thomé de Maisonneuve op cit.
33
9. La Chancellerie
Apparaissant dans nos sources dès le XIe siècle, le chancelier est alors le rédacteur des
actes de l’évêque. Vers 1032, le chancelier Vigier rédigea la donation du chevalier Arnold
d’un manse près de Vienne à Saint-Maurice1. Son successeur probable, Pierre, rédigea un acte
en 1050 ainsi que vers 1062 2. En 1083, Boson est le dernier chancelier connu avant la
disparition de la mention des chanceliers jusqu'en 1195 3. Ce n'est qu'après un siècle sans
aucune mention de cette charge que le chancelier épiscopal est à nouveau indiqué4. Il s'agit
alors de Pierre d'Arènes qui occupera la charge de 1195 à 1219. Bruno Galland affirme que ce
personnage est issu d'une famille du Dauphiné également très présente dans le chapitre
cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne. Il retrace le parcours de ce personnage et nous apprend
qu’il devint chanoine en 1187 puis qu’il fut sacristain en 11935. Notons qu'un membre de sa
famille, J. d'Arènes, fut chanoine de Vienne en 1241 6.
Le successeur de Pierre d'Arènes est le chanoine et sacristain Guigues d'Auries qui est
attesté chancelier de l'église de Vienne entre 1227 et 1245 et le resta certainement jusqu'à sa
mort en 1250 7. La première mention de son rôle de chancelier date de 1227 et il est
intéressant de rappeler la remarque d’Ulysse Chevalier lorsqu’il décrit cet acte : le parchemin
que rédige Guigues d’Auries comporte deux sceaux, un grand sceau que nous pouvons
attribuer au chapitre ainsi que le sceau de Jean de Bernin8. Nous pouvons conclure que
désormais le chancelier est le gardien du sceau de l’évêque mais aussi de celui du chapitre.
Nous supposons que cette double responsabilité dut apparaître dès 1195. Remarquons autant
que Pierre d'Arènes, comme Guigues d'Auries, est chanoine et sacristain. Il semble ainsi que
la charge de chancelier soit liée de près à l'office du sacristain, de là à conclure à un cursus
honorum au sein du chapitre, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, car le successeur
de Guigues d'Auries comme sacristain, Aimon de Virieu, n'est jamais dénommé chancelier.
La liste des chanceliers se perd ensuite, mais l’on apprend par Claude Charvet qu’en
1309 un accord eut lieu entre le chapitre et l’archevêque Briand de Lavieu pour mettre un
1 U.Chevalier, Cartulaire de Saint André le Bas, n°94* : Data perm anus Vigerii cancellarii Vienne fore… 2 Id. n°120 Petri cancellarius scripsi et n°57 Acta Vienne, manu Petri cancellarii 3 Id. n°62 4 Id. n°235 5 B.Galland, Deux archevêchés entre la France et l’empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du XIIème siècle au milieu du XIVème siècle, Rome, 1994, pp. 154-155. 6 U.Chevalier, Actes capitulaires…p. 80. 7 B.Galland, op. cit. p. 156-157 nous indique que Guigues d’Auries présente le même profil que son prédécesseur : sa famille d’origine dauphinoise est elle aussi présente au chapitre de Saint-Jean de Maurienne. Notons que Guigues d’Auries séjourne en 1225 dans le château de Saint-Sévère et qu’il possède à ce titre les mêmes privilèges que les clercs qui séjournent à Pipet. (Cf. Statuts 1225, Annexes). 8 U.Chevalier, Regeste Dauphinois…, n°6902.
34
terme à leurs discordes concernant leurs juridictions respectives. L’un des termes de cet
accord fut que l’archevêque nommerait désormais le chancelier1. Il faut se rappeler que le
partage de la mense commune entre l’évêque et le chapitre en 1285 n’était assorti d’aucun
accord. Il semble donc que le conflit eut pour base le partage des juridictions capitulaires et
épiscopales et que sa résolution reprit les termes de l’accord passé entre l’archevêque
Guillaume de Livron et le chapitre en 12842. A cette date, le chancelier doit garder le sceau
des mariages et gardes pour sa charge le tiers des profits de ceux-ci mais ne garde plus le
sceau du chapitre désormais tenu par le chargé du réfectoire, Guillaume Remestain3.
Si au tournant du XIIIe et XIVe siècles l’archevêque devait désormais nommer seul le
chancelier de l’église de Vienne, il ne profita guère longtemps de ce privilège car comme le
fait remarquer Ulysse Chevalier, les papes installés à Avignon ne tardèrent pas à s’immiscer
dans les affaires de l’Eglise de Vienne. En 1320, Jean XXII concéda à Jacques Flotes un
canonicat dans l’Eglise de Lisieux en plus des bénéfices qu’il lui avait déjà attribués dont la
chancellerie de Vienne4. En 1347, le pape Clément VI nomma chancelier de Vienne Aymon
Lobet5. Remarquons également que le chancelier n’est jamais nommé dans les statuts de
1385 : est-ce le signe que l’officialité échappe au contrôle de l’Eglise de Vienne ou bien doit-
on conclure que la chancellerie est désormais sous la juridiction de l’évêque et échappe au
chapitre6 ?
1 C.Chavet, Histoire de la sainte église de Vienne…, p.437-445. 2 U.Chevalier,Regeste dauphinois, Supplément n°1787. Cet accord indique que l’archevêque n’aura aucune juridiction sur les chanoines et incorporés. Que la collation de la mistralie, la chancellerie, la sacristie, les archidiaconats ainsi que l’abbaye de Saint-Féréol appartiennent à l’archevêque. 3 Id. Et C.Charvet, Histoire… p. 445. 4 U.Chevalier, Etude…, p.46. 5 U.Chevalier, Etude…, p.46. 6 Cf. Annexe. Statuts de 1385.
35
III. 60 chanoines, 100 prêtres… Une tentative de dénombrer
l’entourage épiscopal.
A. une tentative pour dénombrer le chapitre
1. Des effectifs limités jusqu’au XIIIe siècle
Ne disposant pas de statut indiquant le nombre des chanoines présents au chapitre, notre
tentative pour dénombrer les chanoines de Vienne s’appuie sur leur présence comme témoins
dans les actes. Ainsi, Natanaël Nimmegeer, s’appuyant sur une charte avalisant l’élection de
l’archevêque Rainfroi qui comporte pour souscripteurs 27 prêtres ou diacres de Vienne, pense
que le chapitre de Vienne se compose d’environ trente membres au Xe et XIe siècles1. Ce
chiffre semble stable jusqu'au XIIe siècle car d'après le même procédé, nous comptons 22
chanoines en 1044 2. De plus, en 1125, il semble que la liste des chanoines soit complète dans
l’acte de confirmation fait par l’archevêque Pierre avec l’assentiment du chapitre, de la
donation de Guy de Bourgogne aux chanoines de saint Ruf. Dans cet acte, sont témoins 24
personnes qui semblent être chanoines ainsi que deux archidiacres, un trésorier, deux chantres
et le doyen soit un total de 30 chanoines3. A titre de comparaison, les chapitres d’Aix, d’Arles,
de Lyon, de Maguelonne, de Narbonne, d’Orange, de Saint-Paul, et de Viviers comptent une
vingtaine de chanoines4. Dans l’archidiocèse de Vienne, au début du XIIe siècle, le chapitre de
Grenoble est composé d’une vingtaine de membres, tout comme celui de Genève à la fin de ce
siècle, soit un peu moins que le chapitre de la cité métropolitaine, ce qui semble cohérent
d’après les observations de N. Nimmegeers5.
Ce nombre reste stable dans la première moitié du XIII e siècle puisqu’en 1228, 25
chanoines de Vienne promettent de verser aux œuvres de la cathédrale selon leurs moyens6.
1 N. Nimmegeer, La province ecclésiastique de Vienne… p. 357. et J.Marion, Cartulaires de l’église cathédrale de Grenoble dits cartulaires de Saint Hugues, Colmar, 1869, Chartes supplémentaires n°2, p. 260-261. 22 C.C.D.1, pp. 26*-27* n°119*. Dans cet acte, les témoins ne sont pas explicitement dénommés chanoines cependant nous sommes invités à le croire. En effet, cette donation d’une terre à Adalard est l’œuvre de l’archevêque et du chapitre de saint Maurice avec le seing de l’Archevêque, du prévôt, du doyen et de 20 autres témoins qui suivent. Ces 20 témoins n’ayant rien à voir avec le contenu de cette donation, il nous semble cohérent de suivre l’avis d’Ulysse Chevalier qui les considère tous comme des chanoines (Cf. C.C.D.II. 2ème livr. p.17, n° 17). 3 Là encore nous suivons l’avis d’Ulysse Chevalier lorsqu’il prétend que ces témoins sont chanoines. Cf. C.C.D. II 2ème livr., n°171, p.40. Pour la publication de l’acte voir U.Chevalier, Codex diplomaticus sancti rufi, Valence, 1891, n°16. 4 N. Nimmegeer, La province…, p. 357 et Y. Esquieu, Autour de nos cathédrales. Quartiers canoniaux du sillon rhodanien et du littoral méditerranéen, Paris, CNRS, 1992, p. 49-51. 5 Y. Maret, La réforme du chapitre cathédral de Grenoble, …. Et N.Nimmegeer, La province…, p. 357. 6 Cf. Statuts 1228, Annexes.
36
2. Une forte croissance du nombre des chanoines du milieu du XIIIe siècle au
début du XIVe siècle.
Disposant de peu de sources entre 1228 et 1250, il nous est difficile de connaître la
raison et les modalités de l’augmentation rapide du nombre de chanoines qui est attestée par
l’ordinaire de Vienne rédigé vers 1240 : ce document précise que le chœur doit comporter lors
offices la présence de 58 chanoines1. C’est aussi vers cette date que les partages de la division
des terres, lors du décès ou de la révocation d’un chanoine, sont de mieux en mieux
renseignés. D’après ces partages indiqués dans le Liber Divisiorum Terrarum ainsi qu’avec
les nominations canoniales recensées dans les statuts du chapitre, on peut esquisser
l’évolution de l’effectif du chapitre.
EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHAPITRE
0
10
20
30
40
50
1215
1235
1255
1275
1295
1315
1335
1355
1375
1395
ANNEES
NO
MB
RE
DECES
NOMINATION
Moy. mobile sur 6pér. (DECES)
1 U. Chevalier, Ordinaire de l’église cathédrale de Vienne, Paris 1923, p. xvi. Chœur droit : le prévôt, les archidiacres de Vienne de Sermorens et d’Outre Rhône, l’écolâtre, le précenteur, le mistral, 23 chanoines. Chœur gauche : l’archevêque, le doyen, les archidiacres d’Octavéon, et de la Tour, le chantre, le sacristain, le chancelier, 24 chanoines.
37
Notons ici les limites de ces sources : Sur la période 1215-1400, on recense 247 décès
pour seulement 148 nominations, ce qui implique que nos connaissances sont incomplètes.
Malgré le manque d’informations, nous pouvons toutefois esquisser les évolutions des
effectifs du chapitre. On remarque tout d’abord que le recrutement des chanoines s’effectue
par quatre promotions très importantes puisque certaines d’entre elles permettent de doubler
les effectifs du chapitre. La seconde, la « fournée » de 1272 augmente le nombre des
chanoines de 38. Si les effectifs du chapitre avant cette date sont mal connus puisque notre
dernière référence date des environs de 1250, soit plus de 20 ans auparavant, nous pouvons
tout de même supposer que celui-ci reste important1. Nous pouvons l’estimer de manière
approximative à 68 membres après cette fournée, puisque le liber divisiorum recense 30 décès
sur la période 1250-1271 et 4 nominations sur cette même période. Nous touchons ici la limite
de l’estimation précédente. En effet, par le même procédé, nous pouvons estimer la
composition du chapitre à 41 membres puisque le Liber divisiorum recense 21 décès dans la
période 1272-1288 et 3 nominations. Or nous savons qu'en 1272, le chapitre comptait 23
membres. Ainsi, avec la prudence dont nous devons faire preuve lorsque nous interprétons ces
sources, nous pouvons tout de même penser que le chapitre comptait une soixantaine de
membres en 1272. Ce chiffre proposé nous apparaît comme conforme à ce que l’on observe
en 1288 soit 16 ans plus tard. A cette date, après la promotion de 45 chanoines, l’Eglise de
Vienne en compte 68 au total2 . La dernière grande promotion de chanoines que nous
connaissons est celle de 1328 qui voit l’accession au canonicat de 42 nobles de la région,
essentiellement membres de familles déjà représentées dans le chapitre3. A cette date, nous
savons qu’il y a au moins 25 chanoines dont 21 qui sont considérés comme résidents. A
l’issue de cette promotion, le chapitre est donc porté à au moins 67 membres.
Nous avons ainsi pu voir, malgré de nombreuses incertitudes, que le chapitre cathédral
de Vienne compte, entre le milieu du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, des effectifs
variant d'une vingtaine à un peu moins de 70 membres. Malgré ces fortes variations, notons
que ces effectifs sont à de nombreuses reprises conformes à ceux que proposent les statuts
attribués à Charlemagne.
3. La crise, la peste et la réduction des effectifs
Le premier épisode de crise est cité par Pierrette Paravy qui remarque que les années
1317 à 1320 sont une période de désorganisation et de perte de revenus ecclésiastiques pour le
1 C’est l’ordinaire de Vienne qui nous permet de dénombrer le chapitre. Cf. Supra. 2 Cf. Statuts 1288, Annexes. 3 Cf. Statuts 1328. Annexes.
38
diocèse de Vienne 1. Nos sources ne nous permettent guère de commenter cette baisse des
revenus sur cette période, mais remarquons que les statuts font état des plaintes des faibles
revenus de la caisse des anniversaires en 1278 et 12862.
Les crises les plus flagrantes d’après nos sources sont les pestes. Le 15 mars 1349, le
pape Clément VI écrivit à l’archevêque de Vienne et lui demanda de procéder d’urgence à des
ordinations sacerdotales pour combler les vides causés par la mortalité3. Le liber divisiorum
comptabilise 14 décès de chanoines pour les années 1348 et 1349, mais c’est surtout l’année
1361 qui fut terrible pour le chapitre puisque 21 chanoines sont morts cette année-là. Nous
pouvons observer que nous n’avons aucune nomination après 1330, mais il faut se méfier de
nos sources : 100 décès sont attestés entre 1328 et 1385, ce qui implique pour la survie du
chapitre un certain nombre de nominations. Notons toutefois que ce fut dans cette période que
le chapitre passa de plus de 67 chanoines, soit un effectif proche du pseudo statut caroligien,
aux 20 membres mentionnés dans le statut de 1385.
B. Les clercs du collège.
Le collège de l’église de Vienne est d’après le faux statut de Charlemagne composé de
cent prêtres, vingt diacres, vingt sous-diacres, quarante grands clercs, et vingt-quatre petits
clercs. Ces desservants de l’Eglise apparaissent peu dans les actes et nous ne sommes donc
que très peu renseignés. Cependant, certains statuts nous informent sur les clercs du collège.
Il nous apparaît dans les statuts de chapitre de Vienne, une volonté de limiter l’accès du
chœur aux clercs de l’Eglise de Vienne. Ainsi, le 24 septembre 1246, il est statué qu’aucun
clerc, qu’il soit riche ou pauvre, ne sera introduit dans le chœur de Vienne durant un an
excepté si la volonté populaire le réclame4. À cette date, l'ordinaire de Vienne nous apprend
que le chœur est composé de 40 clercs formiers et de 24 clericules, soit exactement les
chiffres proposés par le faux de 790/805 5.
Quelques années plus tard, le nombre de clercs composant le collège est sévèrement
contrôlé par une série de statuts qui empêchent la nomination de nouveaux clercs dans
l’Eglise. Ainsi, le 9 juillet 1269, il fut statué qu’aucun clerc ne serait reçu dans l’Eglise de
1 P.Paravy, De la chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné, évêques, fidèles et déviants (vers 1340-vers1530), Rome 1993, p. 25-29. 2 Cf. Statuts 1278 et 1286. Annexes. 3 P.Paravy, De la chrétienté romaine… p.27 et AGraef, « Clement VI et la province de Vienne » dans Bulletin de l’académie delphinale, 1911, Série 5, t. 5. 4 Cf. Statuts 1246. Annexes. 5 U.Chevalier, Ordinaire de Vienne…, p.xvi-xviii.
39
Vienne pendant trois ans sauf les neveux des chanoines et les personnes importantes1. En
1272, il fut statué qu’aucun clerc ne serait introduit parmi le collège pendant 2 ans à
l’exception de 12 clercs2. Ce statut fut renouvelé pour trois ans en 1277, mais il fut prévu que
durant cette période, 12 clercs mineurs choisis par le doyen et le capiscol seraient nommés3.
L’année suivante, les revenus du chapitre ne permettant pas à l’Eglise d’assurer les dépenses
liées à un nombre trop important de clercs, le statut fut renouvelé. Ainsi, aucun clerc ne fut
nommé tant que les revenus de l’église ne permirent pas la distribution de 60 livres par jour.
En 1281, le chapitre manifesta toujours sa volonté de limiter le nombre de clercs de l’Eglise et
refusa la nomination de clercs pendant 3 ans4. Deux ans et demi plus tard, le chapitre nomma
8 clercs et renouvela l’interdiction d’en recevoir de nouveaux5. Nous apprenons par les statuts
de 1287 que le nombre de clercs dans l’Eglise était trop élevé et que les clercs qui seraient
nouvellement admis dans le chœur ne toucheraient pas la distribution quotidienne tant que la
caisse des anniversaires ne disposerait pas de 60 sous par jour6. Enfin, en 1288, il fut statué
qu’aucun clerc ne serait reçu dans le chœur pendant 10 ans, à l’exception de 12 clercs
capables7. Notons aussi qu’un siècle plus tard, les statuts de 1385 prévoyaient 18 clercs et 12
clericules dans le chœur, soit une baisse de la moitié des effectifs, conforme à la baisse
équivalente de la population liée à la peste8.
Ces statuts qui limitent régulièrement le nombre de clercs dans le chœur ou dans le
corps de l’Eglise de Vienne nous conduisent à penser que durant toute la deuxième moitié du
XIII e siècle, les effectifs des clercs du collège étaient supérieurs à 60 membres.
Nous pouvons quand même penser que ces effectifs augmentèrent dans la décennie
1270. En effet, 24 clercs au moins ont été nommés d’après les statuts entre 1272 et 1280. Si
nous supposons que le taux de décès parmi les clercs est semblable à celui des chanoines,
c'est-à-dire approximativement de 2,2 % par an9, on peut en déduire, si l’on estime l’effectif
des clercs à 60 membres, qu’environ 12 clercs sont décédés entre 1272 et 1280. Le bilan de
cette décennie s’avère donc excédentaire de 12 clercs. Ce constat ne prend pas en
considération les chanoines nouvellement nommés (soit 39 entre 1272 et 1280) qui étaient,
1 Cf. Statuts 1269. Annexes. 2 Cf. Statuts 1272. Annexes. 3 Cf. Statuts 1277. Annexes. 4 Cf. Statuts 1281. Annexes. 5 Cf. Statuts 1284. Annexes. 6 Cf. Statuts 1286. Annexes. 7 Cf. Statuts 1288. Annexes. 8 Cf. Statuts 1385. Annexes. A.Fierro, « un cycle démographique… »…, p. 953. Il estime la baisse de la population dans le viennois à 48% sur la période 1339-1411. 9 Taux calculé d’après les indications du liber divisiorum et des statuts de l’Eglise de Vienne sur la période 1250-1300.
40
avant leur accession au canonicat, clercs de l’Eglise de Vienne. D’après les informations dont
nous disposons, il semble qu’aucun de ces nouveaux chanoines ne fût clerc, mais peut-être
est-ce dû à un effet de sources ? En 1328, 7 chanoines sur les 42 nouvellement nommés
étaient déjà clercs de l’Eglise de Vienne. Si sur la période 1272-1280, on observe le même
taux de 17 % de chanoines auparavant clercs, taux calculé pour l’année 1328, nous pouvons
déduire que sur les 39 chanoines nommés entre 1272 et 1280, 6 ou 7 d’entre eux étaient clercs
avant leur nomination. Nous réduisons ainsi les estimations précédentes de moitié pour
désormais proposer que les effectifs des clercs du collège n’augmentèrent que de 5 ou 6
membres entre 1272 et 1280.
A contrario, si les statuts de 1288 furent respectés, l’effectif des clercs du collège resta
stable entre 1288 et 1298. En effet, par le même procédé, on déduit que durant cette période
13 clercs décédèrent alors que durant le même temps 12 furent nommés.
41
Conclusion
L'étude du chapitre cathédral de Vienne nous a permis d'entrevoir la construction de
cette institution à travers les statuts qu'elle a édictés. Il apparaît par ces règlements que le
chapitre se structure et se dote d'une composition qui se stabilise au milieu du XIIIe siècle
pour ne guère évoluer jusqu'en 1385, date à laquelle est rédigé l'ensemble des règles qui
régissent le groupe canonial jusqu'à sa suppression en 1791. Ainsi, c'est seulement à partir du
milieu du XIIIe siècle que la date de rédaction du faux statut de Charlemagne devient crédible.
Rappelons-nous que ce n’est qu’en 1245 que le capiscol devient membre du chapitre, or cette
condition est très clairement énoncée par le pseudo acte de 790/805. Si nous cherchons une
borne supérieure pour estimer la rédaction de cet acte, nous ne trouvons pas d'arguments
irréfutables mais plutôt une série d'indices qui nous font estimer que cet acte n'est pas rédigé
après le milieu du XIVe siècle. En effet, c’est dans la première moitié de ce siècle que les
effectifs du chapitre diminuent et s’avèrent être de moins en moins conformes à l’effectif de
60 chanoines clairement énoncé. De plus, nous avons vu que la charge de mistral fut
supprimée à Vienne par le pontife Jean XXII en 1320 mais que Siebold de Clermont fut
mistral vraisemblablement jusqu'à la fin de sa vie en 1361. Le pseudo statut le Charlemagne
n’a donc certainement pas été rédigé après 1361 et il nous paraît peu probable qu’il le fut
entre 1320 et 1361.
Si nous cherchons à resserrer cet intervalle de temps, nous sommes confrontés à un
manque flagrant d’informations fiables. Toutefois nous notons que le chapitre fait face à une
série de crises entre la fin du XIIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. La première de celles-ci
est avant tout une crise interne au chapitre : celui-ci est divisé par une guerre pour la doyenné
entre 1288 et 1290, et semble subir un autre conflit en 1308. La seconde de ces crises est une
crise financière puisque les revenus de l’Eglise sont en diminution à partir de 1278, date à
laquelle le chapitre se plaint pour la première fois du manque de liquidité et se prolonge au
moins jusqu’en 1320. La troisième de ces crises est liée aux conjonctures du XIVe siècle. Il
s’agit bien sûr des violents épisodes de pestes qui touchèrent de plein fouet le chapitre de
Vienne en particulier au cours des années 1349-1350 et 1361. Ces crises que nous résumons
sont bien sûr liées aux conjonctures du siècle, et nous supposons aisément qu’elles
interagissent les unes avec les autres. Ce qui nous préoccupe désormais est de savoir si l’acte
42
carolingien fut écrit dans une période de crise pour justifier des prétentions qui ne pouvaient
plus aller de soi, ou bien s’il fut au contraire rédigé dans une période de prospérité pour
magnifier l’Eglise de Vienne en se dotant d’un fondateur mythique. Ne pouvant trancher de
manière incisive, il est tentant d’imaginer que cet acte vit le jour sous l’épiscopat de Jean de
Bernin. C'est en effet au cours de la première moitié du XIIIe siècle que l'Église de Vienne vit
son apogée avec à sa tête un évêque dynamique et auréolé dès sa mort d'une odeur de sainteté
qui mit en place une liturgie propre à l'Eglise de Vienne. C’est aussi sous son épiscopat que,
pour la première fois, le chapitre cathédral fut conforme aux statuts de Charlemagne.
Cependant, par analogie avec les observations d'Amy Goodrich Remensnyder sur les
pratiques bénédictines dans le sud de la France au cours du XIIe siècle, on peut être tenté de
croire que le pseudo acte de Charlemagne fut l'œuvre d'une communauté en crise, en
recherche d'identité, qui tenta de conserver un rôle international1. C'est alors entre la fin du
XIII e siècle et le début du XIVe siècle qu'il faudrait situer la rédaction de cet acte. Il se
pourrait alors que le choix de Vienne pour l’établissement du concile oecuménique de 1311
soit lié de près à l’établissement de cet acte qui peut alors être perçu comme le dernier sursaut
d’une Eglise qui, bien qu’en crise, œuvra pour jouer dans le concert international.
1 Amy Goodrich Remensnyder, Remembering kings past : monastic foundation legends in mediaval southern France, New York et Londres, 1995. L’auteur s’interroge sur le but des légendes de fondation des monastères qui, pour elle, ont vocation à construire l’identité du monastère et à souder la communauté par le souvenir d’un âge d’or qui appartient au passé. La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée aux fondateurs des monastères, qui ne sont jamais choisis au hasard. Ceux-ci doivent être saints pour faire rejaillir leur aura sur le monastère, et doivent posséder une autorité temporelle ou morale pour justifier la légitimité de l’abbaye (et de ses possessions !!). Ainsi les personnages les plus employés sont les apôtres, les rois et reines (carolingiens surtout mais Clovis a aussi « ses » abbayes tels Moissac et Auch) ainsi que les princes locaux essentiellement issus de l’aristocratie romaine (St Chaffre par exemple) ou du monde carolingien. Ces fondateurs sont avant tout des mâles. Charlemagne occupe la place prépondérante dans les fondateurs (canonisation de ce dernier en 1165 par Barberousse). Il semble aussi que ces fondateurs figurent très souvent dans les chansons de gestes ce qui permet une diffusion très large de ces personnages et leur donnent une aura « internationale ». L’auteur revient dans la dernière partie de son ouvrage sur le contexte des monastères aux moments des rédactions des récits de fondations ou de refondations. Il apparaît alors que dans le récit de la légende, se rejoue un conflit contemporain, très souvent à propos de la sainteté du patron du monastère, du patrimoine matériel de l’abbaye, de ses libertés et parfois même d’un conflit interne au monastère.
44
Regeste des actes capitulaires de la Sainte Eglise de Vienne.
L’année du seigneur 1225, le 5 des calendes d’août (28 juillet 1225), le seigneur archevêque Jean et le chapitre ont remarqué que les statuts et ordonnances qui avaient été faits il y a longtemps pour le service de l’église, avaient été peu observés, tant par les chanoines que par les clercs. Cela a généré honte et déshonneur sur la célébration des offices divins de l’Eglise de Vienne. Aussi ils ont rénové les vieux statuts et ils en ont rajouté d’autres.
Ils ont statué que les clercs et prêtres du chœur soient séparés de la communauté du chœur s’ils ont acquis des bénéfices spirituels pour lesquels il est nécessaire qu’ils fassent résidence hors de la ville. Si toutefois, des vicaires qui font résidence ici servent pour eux, alors ils ne quitteront pas le chœur. S’ils quittent le chœur qu’ils n’y soient plus reçus sans l’accord du chapitre.
Si les clercs de notre grand ou moyen chœur présents dans la cité n’auront pas été présents aux heures du choeur, ils n’entreront plus dans le chœur, sauf par l’autorisation du doyen, des chantres et des chanoines présents. Cependant, que deux jours à 9 lectures continues ou davantage leur soient imputés pour chaque jour manqué. Pour leur réconciliation dans le chœur moyen, on appellera le capiscol ou son magister.
Si les chanoines auront été absents deux jours consécutifs à toutes les heures de l’office du chœur qu’ils s’acquittent alors de 7 deniers. S’ils ne les acquittent pas, qu’ils soient totalement exclus du chœur et du chapitre et qu’ils ne reçoivent plus la livre, jusqu’à ce qu’ils s’en acquittent. Il est admis que le jour de leur arrivée en ville n'est pas compté au-delà de deux jours consécutifs.
Que les chanoines et clercs, qui lors des fêtes n’auront pas été présents aux 9 lectures des mâtines, n’entrent pas dans le chœur pour toute la journée : nous acceptons toutefois qu’ils puissent s’excuser pour des infirmités, ou se faire remplacer par un « otage » ou encore pour toutes autres justes causes.
Que les chanoines qui n’auront pas présenté leurs vicaires au capiscol ou au magister pour faire leur semaine paient 7 deniers pour chaque jour où ils auront manqué à leurs offices. Dans le cas où les chanoines seront représentés par des vicaires, la peine des vicaires sera ce que le capiscol ou le magister décidera pour leur punition.
Les vicaires pourront servir non seulement pour eux, mais aussi pour d’autres.
Si les clercs de Pipet fréquentent la ville et qu’ils auront été vus pendant deux jours dans la ville, ils seront tenus à l’observation des statuts.
Pour l’observance de ce qui est dit ci-dessus, les chanoines qui étaient présents dans le chapitre se sont contraints à un serment valable de la prochaine fête de Toussaint pour une durée d’un an. Si quelqu’un aura fait l’objet d’un édit de condamnation, il ne pourra pas être réconcilié même par tout le chapitre, du jour de son expulsion ou de sa faute pendant un an. Cependant, si le capiscol ou son magister expulse un clerc du chœur ou de l'église, en raison de sa faute ou de son excès, il pourra le réconcilier. Durant le temps où il résidera hors de l’église ou du choeur, qu’il ne perçoive plus sa livre durant la période susdite. Que de cette
45
façon aucun clerc ne puisse être admis dans l’église sauf sur les conseils de quelques excellentes personnes.
Après cela, ils ont concédé personnellement à Guigues d’Auries, que tant qu’il séjournera dans la bastide ou le château de Saint-Sévère, lui et son compagnon seront clercs et pourront se prévaloir du privilège qu’ont les clercs de Pipet.
L’année de l’incarnation du Seigneur 1228, le 5 des calendes d’avril (28 mars 1228), le seigneur Jean, archevêque, les chanoines de l’Eglise de Vienne et les autres clercs préoccupés par la perfection du service de l’Eglise, ont ordonné que tous, selon leurs possibilités, confèrent chaque année, à l'œuvre de l’Eglise, quelque chose sur leurs biens. Qu’ils le payent lors de la fête de Saint André comme ils l’ont tous juré. Si d’aventure quelqu’un ne paye pas à cette fête qu’il n’entre plus dans l’église de Vienne, ni dans une aucune autre et qu’il ne touche plus sa livre jusqu'à ce qu’il paye. De plus, qu’il rende les usures et dépenses à ceux qui ont été préposés à les recevoir. Chacun sera tenu à cela pour sa part à partir de la prochaine fête de Saint André pour chaque année.
Le seigneur Guillaume, procurateur de l’église de Valence, donnera X livres. Le chantre Guy XXX sous. Drodon de Beauvoir, XL sous. Thomas, prévôt de Valence, LX sous. Pierre de Boton, XL sous. Anthelme de Chignin, XXX sous. Martin de Bachillin, XX sous. Jacques de Montchenut, XX sous que le réfectoire lui doit et XL sous que Nicolas lui doit et que Jacques donne quand il sera chanoine. Guillaume, archidiacre, C sous pour trois ans. Guigues d’Auries, XL sous. Pierre Falaveuz, X sous que le réfectoire lui doit. Albert de Bocsozel, XX sous. Pierre Callidus, XX sous. Guillaume de Clermont, XXX sous tant qu’il sera présent sur cette terre. Foulques Veyiers, XX sous. Nicolas XL sous. Ponce d’Auriol XL sous. Henri, XL sous. Berlion, prêtre, L sous. Guigues de Saint Georges, XL sous. Aymon Païen, XL sous. Gaudemar, XX sous. Pierre Loup, XX sous que lui doit le réfectoire. Jacques des Monts, XX sous. Berlion, capiscol, XX sous. M. Bachillins a juré pour le prêtre. Nicolas a juré pour Jacques de Mont Canut pour XL sous. Pierre de Botaon a juré pour Guigues de Saint Georges pour XXV sous et pour Pierre Loup pour XX sous.
46
Les noms des clercs qui ont donné pour les œuvres :Le prieur de Saint-Martin : XXX sous. Ponce de Sainte-Marie : XXX sous. Airald : X sous. Seigneur des aumônes : XV sous. Etienne Pied de Bœuf : XV sous. Gilbert de Vernout : VI sous. Guillaume de Royvon : V sous. P(ierre) Marescoz : V sous. Le seigneur Aimon : V sous. Silvion : V sous. Ponce de la Chapelle : IX sous. Garin : IIII sous. Aimon, neveu de Jacques : V sous. Rodolphe : V sous. B. Rogimol : II sous. André Byffons : III sous. Nicold : V sous. G. Fornier : V sous. B. clerc : V sous. Reynaud : V sous. Durand : V sous. Evrard Fouchier : V sous. G. de Lavaleta : V sous. Arbert de Villa : V sous. A. d’outre Rhône : II sous. Le Bos : XII deniers. Jean Recordons : II sous. Pierre Evrard : II sous. Guillaume de la Motte Pierre Cordier : IIII sous. Nicolas : III sous. Jean Chauve : III sous. Vital : X sous. Etienne, scribe : V sous. Durand Gayton : V sous. Raymond : II sous. Jarent : XX sous. Maître Jean : X sous. Pierre de Saint Alban (du Rhône) : XX sous. A. de Roussillon : X sous. G. d’Arey : V sous. G. archiprêtre : XX sous pour lui et son frère. P. d’Anjou : X sous. Guillaume Cordonnier : V sous. André de la Verpillère : X sous. Jean Roi : X sous. Michel : XX sous.
47
L’année du Seigneur 1231, le 4 des nones de mars (4 mars 1232 nouveau style), le seigneur Jean archevêque et le chapitre de Vienne réunis en chapitre général ont statué que ni les chanoines ni les clercs ne toucheront leur livre dans l’Eglise jusqu'à ce qu’ils payent en totalité ce qu’ils ont promis pour le service de l’Eglise. Ceux, qui n'ont rien promis, ne toucheront pas leur livre jusqu'au jour où ils promettront et payeront. Les chanoines, l'archevêque et le chapitre, ont aussi statué que si les clercs commensaux bien qu'avertis par le sacristain n'ont pas payé ce qu'ils doivent, qu'ils s'abstiennent d'entrer dans l'église de Vienne tant qu'ils n'auront pas totalement satisfait à leurs obligations. Il en est de même pour ceux qui n’ont rien promis jusqu'à ce qu’ils promettent et payent. Que le maître de l’œuvre reçoive la livre de ceux qui n’auront pas payé jusqu’au jour où ils se seront acquittés, pour leur peine.
L’année du Seigneur MCCXXXIII, le dimanche qui suit la fête de Saint Jean Baptiste (26 juin 1233), il fut statué lors du chapitre de Vienne que si celui qui aura été présent aux matines part sans aller au repas, il ne recevra pas sa livre quotidienne. De même il fut statué, que celui qui accepte sa livre ne l’exigera pas avant la fin des complies ou pour ses exigences, il ne la recevra qu’à la maison du procurateur des anniversaires.
L’année du Seigneur MCCXXXIII, le XII des calendes de décembre (20 novembre 1233), il a été statué que les gros fruits et les bénéfices vacants, que l’on appelle des dons, soient divisés entre les chanoines. Les élus choisis pour cette division les diviseront en bonne foi et par une juste estimation. Nous voulons que les chanoines soient satisfaits de la part qui sera assignée à chacun et qu’ils ne puissent demander davantage, même s’ils renoncent au bénéfice qui leur a été assigné. En outre, que les partageurs, qui ont prononcé la répartition, ne puissent réclamer rien de plus de cette répartition.
L’année du Seigneur MCCXL, le mois de février (février 1241 nouveau style), le seigneur archevêque Jean et les chanoines réunis en chapitre général, ont ordonné que Berlion, capiscol, au titre de sa capiscolie, ait le tiers des cens et ventes des maisons qui sont à l’intérieur des quatre rues suivantes : la première conduit de la demeure du clerc Jacques de Tour jusqu'au rocher de Vienne. La seconde part de là et conduit jusqu'à la porte du monastère. La troisième de ce lieu jusqu'à la maison de Plantir et la dernière revient jusqu'à la maison déjà citée de Jacques. Ils ordonnent aussi que la seigneurie et les cens soient divisés en trois parts par l'arbitrage des bonshommes et que ledit capiscol ait un tiers et le chapitre les deux autres parts.
L'année du Seigneur MCCXLIII lors du chapitre général d’après la fête de Saint Maurice (23 septembre 1243), le seigneur Jean archevêque et tous les chanoines présents ont statué qu’à partir de la prochaine fête de Noël, aucun chanoine ou clerc ne devra engraisser des porcs dans la clôture. Si quelqu’un aura trouvé des porcs dans la clôture, il est accordé à Guifred de Viriac de s’en occuper et de les capturer. Le même jour, ils ont ordonné que le sacristain de Vienne, Guigues, reçoive chaque année pendant quatre ans, les 15 premières livres du péage dans le but de réédifier et améliorer la grande tour de Pipet.
L'année du Seigneur MCCXLIIII, lors du chapitre général de la Toussaint (2 novembre 1244), le chapitre de Vienne a statué et ordonné que les chargés du réfectoire et les procurateurs des anniversaires n'ont pas le pouvoir de remettre ou de dispenser quelqu'un sur les cens qui sont dus au chapitre ou pour les anniversaires, quelque soit le temps depuis lequel ils sont dus. Cependant, nous voulons qu'ils dénoncent et désignent ceux qui doivent et ce qu'ils doivent aux chargés du réfectoire et procurateurs des anniversaires et qu'ils soient écartés du service divin s'ils ne s'en acquittent pas.
48
L’année du Seigneur MCCXLIIII lors du chapitre général du Carême (6 mars 1245 nouveau style), sur la demande du vicaire Foulques, qui fut chanoine de Vienne, il a été ordonné que les chargés des anniversaires fassent chaque année, lors de la fête de Sainte Catherine, une distribution d’une livre générale au couvent de l’église de Vienne ainsi que l’aumône ordinaire aux pauvres, comme elle est faite et instituée. Ils ajoutent pour l’aumône aux pauvres un setier de seigle quotidien. De même par la volonté de Foulques, il fut ordonné que lors du dimanche de mi-carême (le troisième dimanche avant pâques), les chargés des anniversaires fassent la distribution au couvent de la livre générale et de l’aumône aux pauvres qui sera alors augmentée d’un setier de seigle. Foulque supportant la dépense pour moitié, ce même anniversaire sera fêté chaque année au jour de sa mort. Pour cela, les chargés des anniversaires ou leurs procurateurs ont reçu 140 livres et 20 sous de petit poids.
Qu’aucun clerc ne soit reçu dans le chœur
L'année du seigneur MCCXLV la IIIe férie après les octaves de pentecôtes (13 juin 1245), le seigneur Jean archevêque avec tous les chanoines assemblés en chapitre général, observant la surcharge intolérable d'un grand nombre des anniversaires des clercs de l'église de Vienne, ont statué qu'aucun clerc ne sera reçu dans le chœur des clercs sauf par le chapitre général pour une durée de trois ans à compter de la prochaine fête de Saint Jean Baptiste.
Les mêmes ont doublé le don au maréchal
Les mêmes jour et année, sur les conseils du seigneur Philippe, élu à Lyon, ils ont doublé les revenus du maréchal. Alors qu’il recevait de l’Eglise de Vienne 2 setiers de blé, qu’il en perçoive désormais 4.
Les mêmes ont statué que P. Loup et B. capiscol soient faits membres du chapitre.
L’année de Seigneur MCCXLV, le premier jour de mars (1er mars 1246 nouveau style), tous les chanoines qui étaient présents au chapitre ont concédé et ordonné avec le seigneur Jean archevêque de Vienne, que le chapitre donnera désormais chaque année à P. Loups et Berlion capiscol 6 livres et 14 sous, pour leur part de Chuzelles. Le seigneur Ay(mon) Païens, Etienne de Candiac et les autres, donneront à ceux du chapitre 6 livres et 14 sous pour la partie de Chuzelles qui leur revient.
Nous statuons de même pour l’utilité de la confrérie
L’année du Seigneur MCCXLVI, le jour de mardi de la Pentecôte (29 mai 1246), le seigneur Jean archevêque et tout le chapitre de Vienne ont ordonné et ont statué pour l’utilité de la confrérie, que tous les clercs qui n’ont pas de seigneur et n’auront pas payé tout le blé et les deniers qui sont dus aux procurateurs de la confrérie aux octaves de pentecôtes, soient exclus du chœur. De plus, qu’ils ne reçoivent pas leur livre jusqu'à ce qu’ils payent. Cependant, s’ils ont un seigneur et que celui-ci ne paye pas aux octaves de Pentecôte, alors les dits procurateurs, recevront la livre due par le seigneur. Ils recevront aussi la livre des autres clercs de ce seigneur jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés selon la solution qui sera ordonnée par la confrérie.
Les mêmes ont statué et ont ordonné qu’aucun chanoine ou familier de celui-ci, ni qu’aucun clerc, laïc ou confrère ne recevra ou n’obtiendra quoi que soit de la confrérie en dehors du réfectoire à l’exception des pauvres auxquels il est d’usage de donner et de celui qui est si infirme qu’il ne peut venir.
49
De même il a été statué qu’aucun clerc ne soit reçu dans le chœur ni par le chapitre ni autrement.
L’année du Seigneur MCCXLVI le seigneur Jean archevêque et tous les chanoines, réunis en chapitre général célébré après la fête de Saint Maurice (24 septembre 1246), ont statué et ont promis, sous les liens de la grande fidélité qu’ils faisaient à l’Eglise, que durant un an à compter de la fête de la résurrection, aucun nouveau clerc ne serait reçu dans le chœur des clercs de Vienne. De même le capiscol Berlion et le magister Jean ont promis de n’y envoyer aucun clerc.
Qu’aucun clerc n’accède au chœur supérieur
De même ils ont statué et ordonné qu’aucun chanoine n’accède au chœur supérieur sauf par la volonté de tous, laquelle est relevée sur les places, dans les maisons ou dans l’église. Ceux qui seront présents verront alors ce qu’il convient d’ordonner à propos de ceux-ci.
De même ils ont renouvelé le statut qui stipule que les clercs ne seront pas reçus dans le chœur
La même année et au même lieu, le seigneur archevêque Jean ainsi que tout le chapitre de Vienne ont renouvelé le statut qu'ils avaient fait à propos de la non-réception des clercs dans le chœur de Vienne.Ainsi, jusqu’aux prochaines Pâques personne, pauvres ou puissants, ne sera reçu parmi les clercs de Vienne.
De même à propos des cens
De même ils ont statué et ordonné que tous les cens du chapitre doivent être rendus le lendemain de la Toussaint sans quoi on ne sonnera pas les heures ordinaires. Que celui qui n’aura pas payé ce jour ne rentre plus dans notre église et dans notre chapitre, qu’il ne reçoive pas sa livre, ni sa part de la division des terres, et qu’il s’acquitte d’une livre de cire pour chaque jour qui manquera à son versement. Nous décrétons cela pour les cens et pour les anniversaires à propos des chanoines à partir du premier jour où ils tiennent leur office à l’occasion de la collation du chapitre.
De même il a été ordonné que Jean Chalvet ait les deniers des acquisitions
L’année du Seigneur MCCXLVII, la veille de la saint Pierre (28 juin 1247), il a été ordonné que Jean Chalvet reçoive les deniers des acquisitions et qu’il les gère selon les conseils du seigneur Berlion capiscol. La somme qu’a reçue ce même Jean fut de 280 livres et 52 sous. Les 30 livres qu’il doit au seigneur Arbert de Faverges et les 35 livres qu’il doit à Pierre Menabos lui ont été comptés. Ce même Pierre doit au chapitre 180 livres qu’il a dépensées à Pipet et au Mont Salomon.
A propos du péage
De même, au cours du même chapitre, il a été ordonné que le capiscol Berlion ait et perçoive le cens du péage des pédagiers, jusqu'à ce qu'il reçoive les 160 livres qui lui sont dues pour les réfectoires de l'année précédente.
50
De même, qu’au lendemain de la Toussaint ne soient pas sonnées les cloches aux heures canoniques.
L’année du Seigneur MCCXLVI (lire VIII soit 1248), le lendemain de la fête de Saint Maurice (23 septembre 1248), le seigneur Jean archevêque ainsi que tout le chapitre ont statué et ordonné, que désormais, à partir de la première heure le lendemain de la Toussaint, on ne sonnera plus les heures canoniques jusqu'à ce que tous les chanoines aient payé au chapitre le cens qu’ils doivent et le cens que l’un doit à l’autre jusqu'à la collation du chapitre. Ils ont ordonné que l’on fasse tout de même l’office pour les morts comme il est convenu qu’il soit fait selon la coutume.
Que dans les fêtes de saint Vincent, saint Nicolas et sainte Catherine soient dit des répons.
L'année du Seigneur MCCXLIX lors du chapitre général qui est célébré le lendemain de la fête de Saint-Maurice (23 septembre 1249), le seigneur Jean archevêque ainsi que tout le chapitre a ordonné et a concédé, que désormais lors de la fête de Saint-Vincent, on dira des répons spécifiques Pour la fête de sainte Catherine on fera la même chose, et pour la fête de saint Maurice on chantera au cours des vêpres la séquence qui commence par sint lumbi vestri et lors de l’élévation à la messe on dira la même prose. De même ils ont ordonné que durant la quatrième fête de la Sainte Vierge pendant la messe Gloria in excelsis soit chanté spiritus et alme, puis un autre chant ainsi qu’un kyrieleyson décent.
A propos de la promesse pour l’oeuvre
L'année du Seigneur MCCXLIX le lendemain du vieux Carême (14 février 1250 nouveau style), lors du chapitre général, le seigneur archevêque Jean ainsi que tout le chapitre de Vienne ont statué que tous ceux qui n'auront pas payé ce qu'il avait promis à l'œuvre de l'église de Vienne à la moitié des 40 jours du carême, ne rentrent plus dans le chœur et ne reçoivent plus la livre jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de leur dette.
Pour ceux qui n’ont pas encore promis, et pour ceux qui n’ont pas été averti : qu’ils promettent et après leur promesse qu’ils payent sous huit jours ou qu’ils encourent les mêmes peines que les autres.
A propos des décimes du pape
Ils ont statué la même peine contre les conchanoines qui n’auront pas acquitté la part des décimes, ou l’impôt du vingtième que le seigneur pape réclame, aux chargés du réfectoire à la moitié des 40 jours du Carême.
A propos de l’organisation de la fête des Innocents pour qu’elle soit faite dans le chœur majeur de l’église Saint-Maurice
L’année du Seigneur MCCL le lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1250), le seigneur archevêque Jean et les autres chanoines, réunis en chapitre général, ont ordonné et ont statué que, désormais on célébrera la fête de l’Innocence dans le chœur majeur à l’exclusion des fous et des autres licencieux qu’ils soient clercs ou laïcs1. Jean Chalvez a donné une livre pour l’âme de son frère Pierre Chalvez diacre, qui fut rappelé à la vie ce jour.
1 Exclusis a été remplacé par la suite par le terme exceptis. U.Chevalier, Actes capitulaire…, p.13 note 1.
51
A propos de la saint Sylvestre et de la sainte Colombe
Ils ont ordonné la même chose pour que désormais, lors de la fête de saint Sylvestre et de sainte Colombe, soit faites neuf lectures.
A propos de tierce et midi
L’année du Seigneur MCCL au lendemain de la saint Maurice (23 septembre 1250), après avoir remis la garde du château de Pipet au seigneur Arbert de Villa et à son conchanoine, ils ont statué que désormais les chapelains qui font leurs semaines au grand autel, chantent tierce et sexte et que cela soit écrit dans un bref. Ceci ne concerne pas le seigneur archevêque et les chanoines.
A propos de l’office qui incombe au maître du chœur ou au capiscol.
L'année du Seigneur MCCLI, le lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1251), il a été statué au cours du chapitre général que tous les chanoines, chapelains ou clercs de l'église de Saint-Maurice qui ont reçu un office par le maître du chœur, par le doyen ou par le bref et n'auront pas fait ou dit eux-mêmes ou par un autre ce qui leur incombe pour leur office dans l'église, doivent payer une livre pour chaque jour manqué. Si ce chanoine est commensal d'un seigneur ce ne sera pas son seigneur mais lui-même qui payera la livre sur ses biens.
Que personne ne rentre dans le chœur sans chape1
L’année du Seigneur MCCXLIII, lors du chapitre général de la Toussaint (3 novembre 1253), il a été ordonné et statué que désormais, lors de la fête de la Toussaint, aux matines et après les matines, aucun clerc du chœur supérieur ou inférieur ne rentrera dans le chœur de l’église de Vienne sans chape et surplis entre les heures canoniales. Pour les autres heures, il pourra être avec seulement son surplis jusqu'à la fête de Saint-Martin.
De même à propos du cens qui est payé au lendemain de la Toussaint
L’année du Seigneur MCCLIIII, la veille de la saint Nicolas (5 décembre 1254), le seigneur Jean archevêque, le doyen Philippe ainsi que tout le chapitre de l’Eglise de Vienne ont statué et ordonné que les cens qui sont reçus par le chapitre de Vienne et qui lui sont dus seront désormais reçus chaque année le lendemain de la Toussaint. Si un chanoine aura été négligent pendant huit jours, le chœur l'exclut jusqu'à ce qu'il ait payé. Si 15 jours après la Toussaint, il n'a toujours pas payé, alors sa livre et celle de ses clercs ne lui sera pas donnée et sera reçue par l'aumône des pauvres.
A propos des chanoines qui ne payent pas les livres qu’ils doivent
L’année du Seigneur MCCLV, le lendemain de la saint Maurice (23 septembre 1255), le seigneur Jean archevêque ainsi que tout le chapitre de l’Eglise de Vienne ont statué que si un chanoine n’a pas payé la livre qu’il doit pour les anniversaires, il ne recevra pas sa livre ainsi que celle de ses clercs, s’il en a, et tant qu’il n’aura pas payé elles iront pour l’aumône des pauvres.
A propos de la rénovation du statut
1 Charvet dans Histoire de la Sainte Eglise de Vienne fait référence à ce texte qu’il estime issu des registres du chapitre de l’année 1253 coté n°L.I.
52
De même, renouvelant l’ancien statut, ils ont statué que si un clerc du chœur de l’Eglise de Vienne négligent devant Dieu, n’aura pas été présent au chœur pendant les heures durant deux jours, il sera renvoyé du chœur.
Qu’aucun clerc marié ne soit reçu dans le chœur
L’année du Seigneur MCCLV, le 9 des calendes de novembre (22 octobre 1255), le seigneur Jean archevêque ainsi que tout le chapitre de l’église de Vienne, ne voulant pas qu’un clerc marié ne rentre dans le chœur de l’église de Vienne, ont chassé et exclu le maître Pierre Lombard, dont ils constatent qu’il est marié. Ils ont ordonné que sa livre ne lui soit plus donnée. Ce statut a été fait dans le vestiaire l’année et le jour sus dit.
A propos des sépultures des quatre autres chapelains du grand autel
L'année du Seigneur MCCLVI, au cours du chapitre général qui est célébré le surlendemain de la Saint Jean Baptiste (26 juin 1256), le seigneur Jean archevêque ainsi que tout le chapitre a statué que pour chacun des quatre chapelains morts soient faits les mêmes honneurs qui sont faits envers les autres chanoines, tant en messes solennelles qu'en croix.
Que la livre soit donnée le jour avant le repas
L'année du Seigneur MCCLVII, au lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1257), le chapitre de la Sainte Eglise de Vienne a statué et ordonné que désormais, les dimanches et tous les autres jours de l'année, la livre sera payée avant le repas comme le veut la coutume. Si cela n’est pas, que les nones ne soient pas sonnées tant qu’est présent dans la ville celui qui doit la livre, jusqu'à qu’il décide de la payer. Cependant, à la fin de l'année les livres arrêteront d'être payées, sauf s'il y a autant de livres qu'il y a de jours dans l'année.
De même est statué à propos des promesses pour les œuvres
L’année du Seigneur MCCLIX, le lendemain de la fête de Saint Maurice (23 septembre 1259), le chapitre de la Sainte Eglise de Vienne réunit en chapitre général a ordonné que tous les chanoines payent pour les oeuvres de l’église de Vienne au moins quinze jours avant la Toussaint ce qu’ils doivent pour les œuvres. Ceux qui n’auront pas payé ne rentreront plus dans le chœur jusqu'à ce qu’ils payent. De même il a été ordonné que les clercs, qui n'auront pas payé au moins quinze jours avant la Toussaint, soient exclus du chœur. Anselme prêtre et Arbert doyen collectent ce qui doit être levé et le rendent au chargé des œuvres et ne doivent pas diminuer les peines qui ont été imposées.
A propos des clercs qui accèdent au chœur supérieur
De même il a été ordonné que quatre diacres et quatre sous-diacres du chœur accèdent au chœur supérieur, par les dénommés seigneurs archevêque, le sacristain et le capiscol.
A propos de la correction faite par le seigneur chantre R.
L’année du Seigneur MCCLX, au lendemain de la fête de Saint Jean Baptiste (25 juin 1260), le chapitre général a ordonné que le seigneur Raymond chantre, ait chaque année 40 sous jusqu'à ce que le chapitre lui assigne sa terre et 50 sous pour la réparation de la division de la terre du seigneur Drodon le jeune.
De même à propos de la rétention des livres pendant cinq ans
53
L’année et le jour sus dit, il a été ordonné et statué que toutes les semaines durant cinq ans les procurateurs retiennent une livre et cinquante sous pour la restauration des anniversaires. Les procurateurs continueront le versement des livres jusqu'au vieux Carême date à laquelle ils exposeront les dettes et les atteintes aux anniversaires devant le chapitre. Ceci étant exposé, qu'ils ne soient plus tenus de distribuer les livres jusqu'à ce que la somme due soit recouvrée.
A propos du don des maisons
De même, que les procurateurs puissent donner en cens, pour une année ou pour plusieurs, les maisons des anniversaires en temps limité ou à perpétuité, selon ce qu’il aura été convenu.
A propos de la maison de Faber de Cuveria
De même il a été ordonné que les présents procurateurs aient le pouvoir de vendre la maison dans laquelle séjournait Faber de Cuveria, à côté de la maison de Seigneur du Molar.
Que les œuvres retiennent les livres
De même il a été statué et ordonné que les oeuvres de l’Eglise de Vienne aient et retiennent pendant cinq ans, toutes les livres qu’elles donnaient tous les ans au couvent de l’Eglise de Vienne.
Que J. Chalvez reçoive les deniers des acquisitions
De même, il a été statué que Jean Chalvez reçoive les deniers des acquisitions ad librandum et après qu’il rende en toute bonne foi les fruits de ceux-ci.
Ce qui est compté dans les octaves
De même il a été ordonné que les procurateurs des anniversaires rendent des comptes, le lendemain de l’octave de Pâques. Le chapitre devra ordonner ce qui devra l’être pour que les anniversaires ne soient pas manqués.
Que le salaire ne soit pas donné
De même, il a été ordonné que les procurateurs des anniversaires n’aient pas de salaire pour cette année.
Que les gages ne soient pas reçus
L’année du Seigneur MCCLX, au lendemain de la Toussaint (2 novembre 1260), en chapitre général, le seigneur archevêque Jean ainsi que tout le chapitre de l’Eglise de Vienne ont statué et ordonné que désormais, les anniversaires et les procurateurs des anniversaires de l’Eglise de Vienne n’acceptent ni ne fassent aucun gage. Qu’ils ne fassent aucun achat sauf s’il est sans condition et sans gène pour les deniers des acquisitions.
A propos de l’ordination des procurateurs
L'année du Seigneur MCCLXI, au lendemain de la Saint Jean Baptiste (25 juin 1261), le chapitre a ordonné quatre personnes comme secrétaires/régents des anniversaires, c'est-à-dire :
54
Ademar de Bauci, Arbert de Villa chanoine, Pierre de Rivière chapelain. Les deux premiers dirigent les biens des anniversaires dans le mandement de Septème et du côté de Bourgoin, de La Tour, de la villa de Crémieu et de ses parties adjacentes. Le capiscol et Pierre de Rivière les dirigent dans les mandements d’Illin, de Marennes, de Pinet, d’outre-Rhône, de la Rive Blanche ainsi que de ce qu’il y a en aval. De même le chapitre a ordonné maître P. Evrard comme Librandum.
Qu’aucun chanoine ne reçoive la division des terres
De même, renouvelant le statut antérieur, nous statuons qu'aucun chanoine ne reçoive sa part de la division des terres, sauf s'il aura fait résidence durant un an et un mois avant la vacance des terres.
Que les drualies ne soient pas données
De même il a été ordonné que désormais, les drualies ne seront pas dépensées pour le commerce, pour les deniers des anniversaires ou encore pour le chapitre conformément à ce que les chanoines présents ont juré.
Que les deniers ne soient pas donnés pour le prêt
De même, que les deniers des acquisitions ne soient désormais plus dépensés pour un prêt, sauf par le chapitre ou par les procurateurs des anniversaires.
Qu’aucun clerc n’accède au chœur supérieur
L'année du Seigneur MCCLXV, le lendemain du vieux carême (15 février 1266 N.s.), au cours d'un chapitre général qui a été célébré dans l'église de Vienne, il a été statué par le chapitre que personne ne sera envoyé dans le chœur majeur sauf s'il a été préalablement constitué dans les sacrements. Ceci a été statué pour les clercs et pour les chanoines.
Que le seigneur sacristain soit tenu de sonner la grosse cloche lors de toutes les fêtes qui recourent au chef de Saint Maurice
L’année du Seigneur MCCLXVIII, le lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1268), lors du chapitre général qui est célébré dans l’église de Vienne, il y eut une discorde qui opposa une partie du chapitre et Anselme, sacristain d’une part et les autres membres du chapitre d’autre part. Le chapitre disait que le sacristain était tenu de sonner la grosse cloche, alors que le sacristain disait le contraire. Un compromis fut trouvé avec la sagesse du seigneur père Guy, archevêque de Vienne, Humbert doyen, Hugues sénéchal de Lyon, G. de Poipe précenseur de Lyon. Tous ont ordonné par le consentement des partis que le sacristain fera sonner ladite cloche tous les jours ou le chef de Saint-Maurice sera sur l'autel, à la mort et aux anniversaires de l'archevêque de Vienne ainsi que lors des fondations des anniversaires par les archevêques Il en sera de même lors de la mort et lors des anniversaires des chanoines de Vienne. Si quelques doutes ou points obscurs apparaissaient par la suite, cet acte est reconnu comme un arbitrage par le chapitre et par sacristain qui l’ont déclaré et interprété de concert.
Que ne soit pas arrêté pour le recouvrement des dettes ou des livres si ce n’est d’une tierce à l’autre
L’année du Seigneur MCCLXVIII, lors du chapitre général du lendemain de la Toussaint (2 novembre 1268), Humbert doyen et ledit chapitre ont statué que si un chanoine
55
doit le cens pour les anniversaires ou pour le chapitre et qu’il ne l’a pas payé au terme fixé, pour chaque jour manqué, d’une tierce à l’autre, il ne percevra pas le meit de seigle jusqu'à ce qu’il paye au chapitre ou aux anniversaires. Qu’il ne soit plus reçu dans le chœur ou dans le chapitre et ne reçoive plus la division des terres. Qu’il ne perçoive plus sa livre jusqu'à ce que sa dette et sa peine soient payées en entier sans que sa peine ne soit levée avant ce terme.
Qu’aucun clerc ne soit envoyé dans l’église pendant trois ans
L’année du Seigneur MCCLXIX, le mardi, 15 jours après la fête de saint Jean-Baptiste (9 juillet 1269), le seigneur Guy archevêque et le chapitre de Vienne, réunis en chapitre ont statué qu’aucun clerc majeur ou mineur ne soit reçu dans l’Eglise de Vienne pendant trois ans sauf si c’est une personne importante ou le neveu d’un chanoine.
Ce que disent deux clercs mineurs
Le même jour et la même année, il a été ordonné que les jours de fête double, deux clercs mineurs disent le premier répons dans le chœur majeur.
Que les chapes soient rendues
Le même jour et la même année, il a été ordonné qu’Anselme, sacristain et B. Conyngdos, chanoine, doivent recevoir les chapes dues par les chanoines, prêtres et diacres et autres clercs. Qu'ils aient le pouvoir de les contraindre à payer lesdites chapes jusqu'à fête de saint Jean-Baptiste. Les chanoines payent 10 livres, les chapelains 7 livres, les diacres 100 sous et les avoués 7 livres.
A propos de l’ordination des chanoines
Le même jour et la même année, il a été ordonné par le seigneur Guy archevêque et le chapitre que lors de la prochaine octave de la Toussaint, soient ordonnés des chanoines, et ce même jour qu’ils les assignent au chapitre. Que cela soit fait de cette manière et pas autrement.
A propos de la rénovation des statuts faits pour les clercs
Les mêmes ont renouvelé le statut édicté par le chapitre : que le clerc qui ne sera pas dans l’église pendant une heure en deux jours, renonce au chœur et à sa livre et qu’il ne puisse pas être pardonné sauf par le chapitre. Une heure est entendue : des matines à prime, de la seconde jusqu’à tierce, des messes jusqu’au midi (sexte), ainsi que de l’heure de none avec vêpres et complies. Deux jours consécutifs de neuf lectures sont comptés pour un seul.
Que lors de la fête de l’année nouvelle, la tête de Saint Maurice soit sur l’autel
La même année et le jour du samedi au lendemain de la Toussaint (2 novembre 1269), Guy archevêque de Vienne et le chapitre de Vienne ont statué que la tête de saint Maurice sera posée sur l’autel lors de la fête de la circoncision du Seigneur (1er janvier), c'est-à-dire que le sceptre ne sera pas pris. Que le sacristain fasse faire son office comme il se doit d’être fait et illuminé pour cette fête.
A propos des autres peines prononcées par le seigneur R. chantre
L’année du Seigneur MCCLXIII, le lendemain du vieux Carême (23 février 1265 nouveau style), en chapitre général, le présent seigneur Jean archevêque de Vienne, il a été
56
ordonné et statué par le dit chapitre et par le seigneur archevêque, que R.Francisci chantre ait 50 sous par an, pour la réparation des terres de Humbert de Castaneto et 50 autres sous pour la réparation de la division des terres de Lantelme de Chignin, qui fut chanoine de Vienne. Cette somme doit être versée annuellement par le chapitre jusqu'à ce que le chapitre lui assigne une terre.
Que les bénéfices ne soient pas conférés sauf à ceux qui auront fait résidence
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ amen. L’année de l’incarnation MCCXXI, le mois de novembre, le seigneur Jean archevêque et les chanoines de l’Eglise de Vienne réunis en chapitre général, ont statué pour l’honneur et l’utilité de cette Eglise que désormais, aucun bénéfice ne sera conféré sauf si le bénéficiaire fait résidence dans l’église. Est considéré comme étant résident celui qui tient continuellement pour toute l’année, deux clercs au moins qui servent l’Eglise peu importe qu’il soit présent ou absent, Sont tenus à cela, tous ceux qui ont des bénéfices de l’Eglise ainsi que ceux qui reçoivent dix livres par an. S’ils ne sont pas résidents, qu’ils ne perçoivent aucun don de l’église. Et pour ceux qui n’ont pas chaque année dix livres de bénéfices de l’Eglise, on considère comme résidents ceux qui sont présents durant la moitié de l’année, continuellement ou non, ainsi que ceux qui ont juré sous serment, qu’ils pourront desservir l’église. Pour quiconque voudrait percevoir une part de terre, il est indispensable qu’il commence à faire résidence avant que les terres ne vaquent. S’il veut résider, il se manifestera auprès du doyen ou, si le doyen est absent, devant le chantre et deux chanoines appelés pour cela par le chantre. Si quelqu'un voudra être utile aux écoles, lorsqu'il y sera en étude, qu'il ait pour résidence, ce qui lui revient pour la division des terres. Qu’il suive la théologie, pleinement sur toute chose, et ainsi, il recevra la livre ainsi que les autres choses comme s’il était résident. Sur autorisation du chapitre, les absences pour pèlerinages et infirmités seront acceptées s’il était auparavant résident. Qu’il soit fait de même pour l’entourage des évêques. Ceux qui étaient déjà bénéficiaires de l’église, qu’ils ne touchent pas les distributions hebdomadaires si par ailleurs ils ne sont pas résidents. La résidence sera comptée à partir de la prochaine fête de la Toussaint et le chapitre pourra toujours en dispenser qui lui plaira.
Qu’aucun chanoine n’accepte la division des terres sauf…
L’année du Seigneur MCCXLIX, le lendemain de la Circoncision (2 janvier 1250 nouveau style), le seigneur Jean archevêque et les chanoines de Vienne présents en chapitre ont statué qu’aucun chanoine n’accepte désormais des terres vacantes sauf si sa résidence comporte deux clercs au moins un mois avant la vacance de la terre.
Est statué que les revenus du repas sont convertis en armures.
L’année du Seigneur MCCLXIX, le lendemain de la saint Maurice (23 septembre 1269), qui est célébrée dans un chapitre général, le seigneur Guy archevêque et tout le chapitre ont statué à propos de la coutume antique longtemps observée dans l’Eglise de Vienne, qui précise que quiconque introduit un clerc fasse pour tous les autres clercs, un repas d’une valeur de 40 sous ou plus. Comme ces dépenses étaient converties en choses vaines et qu’elles ne revenaient pas pour l’utilité de l’Eglise, le seigneur archevêque et le chapitre ont voulu et statué que tous ceux qui seront introduits payent des armures à la place du repas qu’ils devaient faire au réfectoire. Si c’est un pauvre clerc qu’il paye un haubert mais si ce clerc est riche qu’il fournisse un godeberc. Si un chanoine est nouvellement créé, il doit payer un oberc, des chausses en fer ainsi que des couvertures en fer. Si un prêtre est nouvellement introduit, il
57
doit payer un haubert. Que les chargés du réfectoire aient la garde de ces armures mais qu’ils n’aient pas le pouvoir de les aliéner ou de les mettre en gage.
Il est statué qu’aucun chapelain ou clerc ne soit vicaire dans une autre église
L’année du Seigneur MCCLXX, le lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1270), qui est célébrée lors d’un chapitre général, le chapitre de Vienne et le seigneur Guy archevêque ont statué qu’aucun chapelain ou clerc de cette église ne peut être vicaire dans une autre église dans la cité de Vienne, sauf celle de la maison des aumônes de Saint-Paul qui relève du chapitre. Et si quelques chanoines ou clercs veulent tenir un vicariat sans le conseil du doyen, de son remplaçant ou du chargé du réfectoire, après huit jours durant lesquels il ne voudra pas se défaire de ce vicariat, il sera exclu de l’Eglise et ne percevra plus sa livre jusqu’au jour où il renoncera au vicariat.
Il est statué qu’aucun chanoine ou clerc n’accède au chœur supérieur sauf s’il avait été constitué dans les ordres sacrés
L’année du Seigneur MCCLXX, le lendemain du vieux Carême (23 février 1271 nouveau style), le seigneur Guy, archevêque de Vienne et tout le chapitre ont statué qu’aucun chanoine ou clerc n’accède au chœur supérieur s’il n’avait pas été constitué dans les ordres sacrés. Et cela, tout le chapitre a juré de l’observer, sauf si le chapitre l’ordonne autrement.
L’année du Seigneur MCCLXXI, le lundi après le vieux Carême (14 mars 1272 nouveau style), dans un chapitre général qui est célébré dans l’église de Vienne, il a été statué par le seigneur Guy archevêque et par le chapitre de Vienne, qu’à partir de la prochaine fête de saint Jean-Baptiste et durant deux années consécutives, aucun clerc ne sera reçu dans l’Eglise de Vienne. Le capiscol et le magister pourront toutefois placer 6 clercs capables dans le chœur. Le chapitre a retenu pour lui le pouvoir de placer 6 clercs dans l’Eglise et ces 6 doivent tous faire résidence.
L’année du Seigneur MCCLXXII, le lundi lors de la fête de saint Ambroise (4 avril 1272), il a été constitué par le seigneur archevêque Guy et par le chapitre, que désormais aucun autre laïc ou clerc, à moins qu’il ne fasse partie du collège de l’Eglise de Vienne, ne reçoive une quelconque livre de cette Eglise de Vienne, sauf pour les grands châtelains et barons auxquels on peut donner la livre avec l’accord du chapitre. Le seigneur archevêque et le chapitre ont promis d’observer ce statut de manière perpétuelle et avec ferveur.
La même année et le jour sus dit, il a été statué par le seigneur archevêque Guy et le chapitre de Vienne qu’aucun chanoine, clerc ou prêtre n’aille par le cloître ou par la cité sans l’habit coutumier à partir du premier jour de Pâques. L’habit ordinaire est défini par le chapitre comme « chapé et mantelé ».
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Nous Guy par la grâce de Dieu archevêque de la Sainte Eglise de Vienne, ainsi que tous les présents, inspectant les lettres nous observons que notre Eglise de Vienne est accablée par ce qui est dû pour les chanoines morts. A cause de cela le culte divin est négligé, alors qu’il doit être augmenté. Nous, par la création et l’ordination de chanoines dans notre Eglise, voulons agir, par l’habit, sur la diligence de notre action envers notre communauté. D’un commun accord et par la volonté unanime de tous les chanoines du chapitre le jour qui a été assigné pour la nomination de chanoines est le samedi du lendemain de la saint Jean-Baptiste. Ce jour se prolonge, par la nécessité des discussions demandées, jusqu’au mardi de la veille des saints apôtres Pierre et
58
Paul (25-28 juin 1272). Nous, l’archevêque et le chapitre, au cours de notre assemblée capitulaire réunie pour la création des chanoines, nous créons et élisons d’un commun consensus des chanoines et frères. Ces créations sont tenues par le droit que les coutumes ont imposé par le temps des statuts, et veulent être conformes au droit canon. Qu’aucun d’entre eux ne puisse accéder au chœur majeur, qu’il n’ait, ni voix au chapitre, ni de part de la division des terres et que nul ne puisse recevoir la grâce du chapitre ou du pape jusqu'à son ordination obligatoire. Ceci est pensé aussi pour tous ceux qui font partie du chœur supérieur.
Les huit premiers doivent être prêtres : Pierre de Loras prêtre, Albert Coindos prêtre, Guillaume de Balme prêtre, Anthelme Falaveuz prêtre, Albert Lumbarz prêtre, quand il aura l’âge mais qu’il s’abstienne durant trois années du droit canonial, Hugues Recoinz prêtre, Humbert d’Ays chapelain, Boson Poutrens chapelain.
Ceux qui sont diacres : Guillaume de Rochifort diacre, Pierre de Briort diacre, Foulques Orseuz diacre, Anthelme d’Ay diacre, Guillaume de Seyssuel diacre, Girard Coindos diacre, Jean Sechauz diacre, Georges diacre.
Ceux qui sont sous-diacres : Guy de Bellevue, Simon de Payrin, Aynard de Moirant, Guigues de Jareis, Sieboud Rovoyri, Humbert de Virieu, Pierre de la Borgia, Guigues Resmetainz et il doit être chanoine dans trois ans, Aymon de Faverges et il doit être chanoine dans deux ans, Pierre Athenulphe, Rodolphe Cros, Pierre Bovardi, Guillaume de Bellevue et il doit être chanoine dans cinq ans, Ponce Païens, Odon de Montchenu, Drodon de Saint Romain, Hugues de Paladru, Jacques de Candiaco.
Ils sont faits chanoines ce jour de l’année du Seigneur MCCLXXII.
Il est statué que lors de la fête de saint Maurice soit dit le Credo et lors de la fête de la Toussaint, la prose.
L’année du Seigneur MCCLXXV, le samedi au lendemain de la Toussaint (2 novembre 1275), il a été ordonné par le seigneur doyen Geoffroy et par le chapitre de Vienne que le Credo soit dit lors de la fête de saint Maurice et que lors de la Toussaint soit dite la prose qui est appelée Superne martis gaudia.
A propos des procurateurs des anniversaires
La même année et le même jour, il a été statué par le doyen et par le chapitre que désormais les procurateurs des anniversaires seront nommés lors de la fête de saint Jean-Baptiste et que les procurateurs nommés lors de cette fête rassemblent le cens des blés, les ventes et les autres usages des anniversaires jusqu'à la fête de la saint Jean-Baptiste. Qu’ils commencent à distribuer les livres au lendemain de la Toussaint et qu’ils soient tenus de les distribuer jusqu'à l’autre fête de la Toussaint, date à laquelle ils sont tenus de rendre le compte des recettes et des dépenses des anniversaires.
A propos de l’admission des diacres malades et des vieux clercs dans l’Eglise de Vienne.
L’année du Seigneur MCCLXXVI, le vendredi après la fête de saint Jean-Baptiste (26 juin 1276), réunis dans un chapitre général, le seigneur archevêque Guy et le chapitre de Vienne d’une part, et le seigneur Geoffroy de Clermont doyen d’autre part, se sont accordés à propos de la discorde ou querelle qu’ils avaient les uns envers les autres au sujet de l’admission dans l’Eglise de Vienne des diacres malades ainsi que l’admission des vieux clercs dans le chœur majeur. Comme le doyen disait qu'il était en droit de les placer dans
59
ladite Eglise et l'évêque et le chapitre disaient le contraire, le seigneur Odon de Montchenu, Hu. de Seyssuel capiscol et P. de Briort chanoine ont été désignés par lesdites parties comme arbitres et réconciliateurs des amitiés. Ces arbitres prononcèrent d’abord que le doyen était en droit de placer des diacres malades ou des vieux clercs dans le chœur majeur. Il a été tranché après, que les clercs que le doyen avait ainsi placés resteraient en place dans l’Eglise. Ces arbitres ont aussi promis que le doyen ne pourrait désormais plus placer des vieux clercs ou des clercs malades de l'Eglise dans le chœur majeur, de telle manière que pour son successeur, il n'y ait plus de préjudice. Retenant pour eux le pouvoir d’interpréter sur cet écrit, ils décident que le clerc qui a plus de 50 ans ne pourra pas être promu par le doyen. Si toutefois on doute de l’âge, on croira le clerc qui prêtera serment avec deux autres.
Il est statué que la tête de saint Maurice soit présentée en procession lors de sa fête
La même année, le lendemain de la fête de saint Maurice (23 septembre 1276), le seigneur archevêque, le seigneur doyen Geoffroy et tout le chapitre, ont statué que le chef de saint Maurice serait désormais présentée par deux chanoines au cours de la procession de cette fête et que lesdits chanoines ne pourront pas s’en excuser ou s’en démettre quand l’injonction leur en aura été faite.
Que deux clercs formiers fassent le chant
De même l’archevêque, le doyen et le chapitre ont statué que les clercs formiers fassent le chant tous les jours de fête de neuf lectures dirigées par le maître du chœur.
Il est statué que l’un du chœur majeur dise l’Alleluia avec le semainier.
De même, le lendemain de la Toussaint (2 novembre 1276), il a été statué par ledit chapitre, que lors de toutes les fêtes où sont dites neuf lectures, un membre du chœur majeur fasse l'Alleluia avec le chanteur de la semaine sous la direction du formarius qui s'occupe du chant. Le clerc de ce chœur majeur ne doit pas être le semainier.
Il est statué que la fête de saint Jean-Baptiste soit faite dans le chœur majeur
L’année du Seigneur MCCLXXVII, le vendredi au lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1277), le seigneur archevêque Guy, le doyen Geoffroy ainsi que tout le chapitre ont statué que la fête de saint Jean-Baptiste soit faite dans le chœur majeur et que la tête de saint Maurice soit posée sur le linceul. Que la messe qui était chantée après prime sur le grand autel soit chantée dans la chapelle de saint Jean-Baptiste et que la procession de ce jour se fasse avec la chape jusque dans ladite chapelle. Que le répons Inter natos soit chanté avant ladite chapelle et que dans l'introït du chœur soit chanté le répons qui est appelé Vir inclitus.
Il est statué que les octaves soient faites pour la fête de Saint Jean Baptiste ainsi que pour la Saint-Laurent.
Il a été statué ce jour, que les octaves soient faites pour la saint Jean-Baptiste et pour la saint Laurent sauf si on leur crée un office propre durant lequel les octaves ne doivent pas être faites.
Que la grosse cloche soit sonnée au cours de la procession de la fête des morts
De même, il a été ordonné ce jour et cette année, que la grosse cloche devra être sonnée lors de la procession de la fête des morts.
60
Il a été statué qu'à partir de la Toussaint prochaine et durant trois ans, aucun clerc ne soit introduit de nouveau.
La même année, le jeudi après la fête de Saint-Maurice (23 septembre 1277), le seigneur archevêque Guy et le doyen Geoffroy ainsi que tout le chapitre de Vienne ont statué qu'à partir de la prochaine fête de la Toussaint et pendant trois années consécutives, aucun clerc ne sera introduit dans l'Eglise de Vienne ni par le doyen, ni par le capiscol, ni par le magister. Durant ces trois années, le doyen pourra nommer six clercs et le capiscol pourra nommer six clercs mineurs.
Que le chapitre ne puisse nommer ni chapelain ni clerc dans le chœur supérieur.
Ce même jour, l’archevêque, le doyen et chapitre ont décidé que le chapitre ne pourra nommer ni chapelain ni clerc. Que le chapitre ne puisse pas donner la livre des chanoines à un autre clerc et qu’il ne puisse pas non plus élever les clercs dans le chœur majeur sauf si ces clercs ont été ordonnés dans la prêtrise.
Il a été ordonné ce même jour et année, que l’ancienne coutume de l’Eglise de Vienne qui impose aux clercs nouvellement introduits dans le chœur, de faire un repas le matin pour les autres clercs, soit revue. Le capiscol a ordonné que désormais, quand les clercs seront introduits dans l’Eglise, les dits clercs payeront au capiscol et au magister du chœur 40 sous pour le repas. Qu’ils les payent dans un délai d’un mois, et après qu’ils soient introduits dans l’Eglise. Si le nouveau clerc introduit est reçu comme chanoine, qu’il paye et remette au capiscol et au magister 60 sous : le capiscol, l’archevêque et le doyen veulent que cet argent soit dépensé pour l’honneur et pour l’utilité de l’Eglise de Vienne.
Il est statué à propos de l’organisation des autels
Ce même jour, ils ont statué que l’organisation des autels dépend du seigneur Raymond chantre, du capiscol Humbert et de Boson Poutrenc. Si celui qui est chapelain ne respecte pas l’organisation effectuée par lesdits chanoines, qu’il ne reçoive pas la livre qui lui est due pour ce jour. Ne la toucheront que ceux qui auront célébré le temps désigné et les heures déterminées. Que les organisateurs fassent écrire devant l’autel les heures que les chapelains doivent célébrer.
De même l’archevêque, le doyen et le chapitre, ont ordonné que l’archidiacre Humbert de Virieu, Humbert capiscol et Pierre de la Borgie, qu’ils soient seuls ou plusieurs, puissent accéder à tous les revenus des anniversaires à partir de la prochaine fête de saint Jean-Baptiste durant trois années consécutives. S’ils y accèdent avant la prochaine fête de la Toussaint, qu’ils n’aient pas le droit d’y accéder durant le temps défini ci-dessus.
Il est statué à propos des clercs qui ont un service d’autel dans l’église
De même, ils ont statué ce même jour à propos des fondations et des anciens statuts s’y rattachant, que tous les clercs qui ont un autel dans l’église de Vienne soient faits chapelains dans l’année sans quoi l’autel sera considéré comme vacant et sera confié à un autre.
A propos de l’organisation des autels prédits
Les mêmes ont statué que désormais quiconque se verra conférer un autel est tenu de jurer de recevoir les ordres des prêtres dans un délai d’un an après la réception de l’autel sans
61
quoi sa collation ne sera pas valide. Ce statut aussi est valable pour les trois chapelles qui sont en dehors de l’église.
A propos de l’organisation du château
La même année, le mercredi après la Toussaint (3 novembre 1277), dans un chapitre général, le seigneur archevêque Guy, le doyen Geoffroy et tout le chapitre ont statué que lors du chapitre qui sera tenu le lendemain de vieux Carême sera procédé et ordonné la garde du château de Pipet.
La suite de l’organisation du château de Pipet
La même année, le lundi après le vieux Carême (7 mars 1278 nouveau style), le chapitre général est poursuivi par le seigneur G archevêque, G doyen et le chapitre jusqu’au mardi suivant pour statuer sur la garde du château de Pipet. Ils ont donné le pouvoir de pourvoir le château au seigneur Odon sacristain à P. Bovard, à G.Coyndo et B. de Chignin. Ces quatre prédits doivent et peuvent ordonner la garde dudit château et leur pouvoir dure jusqu'à la fin des vêpres. Ces quatre prédits peuvent élire l’un d’entre eux.
La même année, le mardi suivant, le chapitre a été prolongé par le seigneur G. archevêque, G. doyen et par le chapitre jusqu'au mercredi suivant à cause de la garde dudit château.
Le mercredi, le chapitre a été prolongé jusqu’au jeudi par le seigneur G. archevêque, G. doyen et par le chapitre à cause de la garde du château.
La même année, le jeudi suivant, ledit chapitre général est prolongé pour la garde du château de Pipet. Le seigneur G. archevêque et G. doyen ont le pouvoir de désigner le château comme résidence pour les chanoines.
La même année, le jeudi prédit, il a été ordonné par le seigneur G. archevêque, G. doyen et par le chapitre de Vienne, que ceux qui tiendront Pipet doivent entretenir dix clients capables et de bonne réputation ainsi que cinq services de guet et un portier. Tous, lors de leur entrée en charge dans le château, doivent jurer et promettre fidélité aux chargés du réfectoire. Ils possèdent la garde dudit château pour l'utilité du chapitre de l'Eglise de Vienne contre n'importe quelle personne ou groupe de personnes, et lorsque le châtelain dudit château est proche de la mort, prisonnier, capturé, ou lorsque ledit châtelain le gère infidèlement contre le chapitre, nous voulons que le château revienne aux chargés du réfectoire ou à une personne choisie par tout le chapitre. De ces dix clients, huit doivent être présents tout le jour et toute la nuit, et le réfectorier, les chargés du réfectoire, ou ceux qui auront été envoyés par les chanoines résidents, doivent examiner la garde du château de Pipet dès l’instant où ils auront placé ces clients et guets ainsi que toutes les fois qu’ils le voudront. Chaque fois qu'ils auront trouvé que quelqu'un est trop peu suffisant ou incapable dans ledit château, ils pourront le rappeler ou le chasser.Le châtelain doit jurer que le château est gardé fidèlement et légalement selon les besoins dudit château. Il n’amènera pas une ou plusieurs pesonnes par lesquelles le chapitre pourrait avoir un dommage ou engager une guerre, sauf si cela est de la volonté du chapitre. De même, le châtelain doit jurer que dix clients compétents et exempts de suspicions tiennent dans le château cinq gardes et un portier. Ceux-ci doivent faire un serment de fidélité au réfectorier ou aux chargés du réfectoire, qui peuvent le démettre de leurs fonctions s’ils n’ont pas été capables dans les choses prédites ou s’ils sont entachés de suspicions.
62
A propos de l’organisation du château
De même, il a été ordonné par ledit chapitre au cours du chapitre général qui est célébré le lendemain du vieux Carême pour la garde du château de Pipet, que le châtelain doit se présenter aussitôt et apporter au chapitre les clefs de Pipet lors de ce chapitre. Il est ordonné en premier lieu que celui qui est envoyé comme gardien doit recevoir le château par le châtelain qui le tiendra lors de la prochaine fête de saint Michel.
De même, il a été ordonné la même année et le même jour, que le châtelain, tous les chanoines, les clercs et leurs familiers sont tenus de reconduire leurs envoyés selon les nécessités de la défense du château avec le droit d’en détenir avec leurs propres revenus.
De même, il a été ordonné par ledit chapitre que le châtelain ait 120 livres. Il doit avoir des 120 livres, 60 lors de la fête de saint Julien et 60 quinze jours après la saint André.
De même il a été ordonné que celui qui aura ledit château ne pourra pas le tenir pour une durée de plus d'un an.
Il est statué qu’aucun clerc ne soit nommé dans l’Eglise tant que les revenus ne le permettent pas.
La même année, le samedi au lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1278), le chapitre étant prolongé jusqu'au mardi de la veille de la saint Pierre, il a été statué que le seigneur doyen, le capiscol, et le magister ne puissent nommer aucun clerc dans l’Eglise tant que la livre sera plus faible que l’équilibre de chaque jour c'est-à-dire d’un montant de 60 sous.
A propos des donations de paix dans le chœur
De même, ce jour, il a été ordonné par le chapitre que la paix soit faite dans le chœur sous la forme de grandes messes.
De même qu’il soit donné comme disciple à Raynald Malgiron les seigneurs Pierre Bovard et G. de la Balme.
Il est statué qu’un clerc soit revêtu pour la procession
De même, ils ont statué qu’un clerc du chœur majeur soit revêtu en blanc le jour de la procession des morts et qu’il reste ainsi vêtu pour la grande messe pour qu’il desserve en blanc.
Que la tête de saint Maurice soit posée sur le linceul la veille de la saint Jean-Baptiste
De même, il a été ordonné par ledit chapitre, que la tête de saint Maurice soit posée sur le linceul la veille de la saint Jean-Baptiste lors du premier coup des vêpres.
Il est statué la diminution des distributions de livres
De même, le mardi de la veille de la saint Pierre (28 juin 1278), le jour où le chapitre a été prolongé dans le but de traiter de la diminution de la distribution des livres, il a été statué la prolongation d’un an du statut qu’aucun clerc ne serait introduit dans l’Eglise de Vienne de la fête de la Toussaint et pour trois ans consécutifs par le seigneur G. de Clermont doyen et
63
par le chapitre. C'est-à-dire qu’aucun clerc ne sera introduit dans cette Eglise à compter de la prochaine fête de la Toussaint et ce pour trois années consécutives.
La même année, le vendredi après la fête de saint Maurice (23 septembre 1278), au cours du chapitre général, le seigneur archevêque Guy, le doyen Geoffroy et tout le chapitre ont statué que chaque année le jour de la révélation de Saint Maurice, les nouveaux répons de Saint Maurice seront dits, si toutefois ils ont été contrôlés par le seigneur préchantre, par le capiscol Humbert et par P. de Marjays.
Est statué…
L'année du Seigneur MCCLXXVIII, le lundi du lendemain du vieux Carême (20 février 1279 nouveau style), le seigneur Geoffroy de Clermont doyen ainsi que tout le chapitre de Vienne, réunis en chapitre général, ont statué que toutes les restitutions que font les chanoines et clercs de l'Eglise de Vienne pour le chapitre de Vienne, ainsi que tous les cens qui sont dus par les chanoines et clercs au chapitre seraient désormais payés chaque année. C'est-à-dire que dorénavant les chanoines et clercs les payeront aux chargés du réfectoire de Vienne le dimanche suivant le synode de la Toussaint. Celui qui aura arrêté de payer ce qui est dû avant ce jour payera aux chargés du réfectoire un muid de seigle pour chaque jour manqué. Qu’il ne soit plus reçu devant le chœur et qu’il n’ait plus voix au chapitre. Malgré sa présence au chapitre qu’il ne perçoive plus la division des terres et qu’il ne touche plus sa livre quotidienne qui sera alors perçue par les chargés du réfectoire. Ces peines dureront jusqu'à ce qu’il paye aux chargés du réfectoire ce qu’il doit. De plus, bien qu’il ait payé le principal de ce qui est dû, il reste tenu de payer la peine du muid de seigle ou il aura d’autres peines pour le raffermir et l’endurcir. En plus de ces statuts, si les chanoines ou clercs ne peuvent pas payer la dette aux réfectoriers, qu’elle soit annulée sauf sur la dette courante. Nous voulons que cela soit attesté par la confession de ceux du réfectoire, par de bonnes lettres ou par un papier du chapitre.
Les mêmes peines sont statuées pour tous et par tous, pour ceux qui n’auront pas payé aux procurateurs des anniversaires le cens et les restitutions qui sont dus aux anniversaires au jour qui aura été décidé.
Il est aussi statué que lors de leur entrée en charge les chargés du réfectoire et les procurateurs des anniversaires sont tenus de jurer ensemble qu’ils exécuteront les peines édictées pour ceux qui les doivent. Qu’ils lèvent ces peines après leur payement quand ils auront pu le contraindre. Si un chanoine ou clerc se montre rebelle pour payer les peines et les subir, que les chargés du réfectoire et procurateurs des anniversaires puissent faire arrêter ces peines pour les raffermir et les endurcir. Nous voulons que les peines que les chargés du réfectoire et les procurateurs des anniversaires auront statuées soient remises et rendues aux procurateurs des œuvres de Saint Maurice.
Et il a été aussi statué, que les chargés du réfectoire fassent appliquer, au nom du chapitre, toutes les restitutions, pour tous les chanoines et clercs, le dimanche après le synode de la Toussaint. Les statuts sont ainsi édictés, et tous les statuts antérieurs faits à propos de peines sont révoqués.
L'année du Seigneur MCCLXXIX, le dimanche le lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1279), il a été statué par Geoffroy de Clermont doyen et par le chapitre de Vienne, que, lorsque le chargé du réfectoire, le trésorier ou ceux qui tiendront le sceau voudront
64
sceller une lettre, ils devront la sceller avec le nom et le prénom de celui qui garde le sceau placé sur la lettre. Le sceau propre de celui-ci sera apposé avec un grand ou un petit sceau.
La même année, le samedi, le lendemain de la saint Maurice (23 septembre 1279), il a été statué par le dit chapitre à propos des acquittements faits par le chapitre lors de la Toussaint. Les peines statuées à propos des acquittements seront lues au chapitre de saint Maurice et au chapitre de la Toussaint.
La même année, le lendemain de la Toussaint (2 novembre 1279), il a été statué par le seigneur Geoffroy de Clermont doyen et par le chapitre de Vienne, sur les vœux du seigneur Humbert de Virieu, que, lorsqu'on s'apprêtera à déposer la tête de Saint-Maurice sur l'autel, une bauda soit dite jusqu'à ce que la tête soit déposée sur l'autel au commencement du Magnificat. Que cette bauda soit sonnée par les deux grandes cloches et qu’elle débute lorsqu’ils commencent à parer l’autel et dure jusqu'à la bénédiction de la tête. Humbert a payé pour cette bauda six deniers maniglariis. Humbert assignera ensuite 14 sous de cens en revenu annuel. S’il s’avère qu’Humbert ne les assigne pas de son vivant, il a voulu qu’après sa mort le chapitre puisse la couvrir jusqu'à la valeur de 14 livres de Vienne, sur ses biens et sur les droits qu’il tient de l’Eglise de Vienne pour les placer pour l’œuvre de la sacristie.
La même année, le jeudi qui suit la Toussaint, le seigneur Geoffroy doyen et tout le chapitre de l’Eglise de Vienne ont révoqué le statut qui interdit de donner la livre aux laïcs. Le chapitre a alors concédé à Simon de Paladio la livre quotidienne que perçoit un chanoine au cours des distributions et a reçu Simon parmi les familiers pour qu'il soit opérarier de ladite église.
La même année et le même jour, le dit chapitre a statué, sur la demande de Martin de Maon, archiprêtre d’Annonay, que la tête de saint Maurice soit posée sur l’autel avant la porte latine lors de la fête de saint Jean l’Evangéliste. Martin doit procurer de la lumière au sacristain pour cette fête.
La même année, le jeudi qui suit la Toussaint, au cours d’un chapitre général de la Sainte Eglise de Vienne, ils ont ordonné, voulu et concédé que Geoffroy doyen, Odon sacristain, Pierre Bovard, G. Remestain, Humbert capiscol, Burnon de Chignin chanoines de cette Eglise puissent emprunter de l’argent en prêt avec usure ou sans usure avec des garanties ou sans garanties pour payer les dettes contractées par l’Eglise, pour payer celles qu’elle contractera et pour gérer les affaires de l’Eglise. De même qu’ils puissent ordonner selon ce qui est le mieux selon eux, et qu’ils puissent avoir l’argent en vendant les revenus du réfectoire de Vienne, dans la totalité ou en partie, pour un temps donné ou pour la vie. Qu’ils puissent collecter de l’argent auprès des chanoines, des clercs ou auprès des hommes de l’Eglise sans qu’aucun ne puisse s’en dispenser. Tout le monde a juré en touchant les Saints Evangiles de tenir et d’accomplir toutes les choses qu’ils ordonneront, sans empêchement d’aucun statut ou ordre faits par le chapitre. Si quelqu'un veut aller contre ces statuts ou que quelqu'un les contrarie, qu'il soit soumis aux peines qui ont été statuées contre ceux qui arrêtent les restitutions dues au chapitre ou à l'Eglise. Il est ajouté que si quelqu’un venant ou voulant venir contre ce qui a été ordonné, il quittera le chœur et le chapitre pour qu’ainsi, tous ceux qui y sont tenus par serment, observent correctement ce qui sera édicté. Nous voulons que P. Bovard trésorier et Humbert, chargé du réfectoire, ou un autre qui aura été chargé du réfectoire durant un temps, scellent du sceau du chapitre les lettres sur toutes les dettes contractées, celles à venir, ou sur les autres obligations que les six nommés ou quatre d’entre eux auront engagées.
65
Est statué
L’année du Seigneur MCCLXXX, le mardi après la fête de saint Jean-Baptiste (25 juin 1280), au cours d’un chapitre général, le seigneur Geoffroy doyen ainsi que tout le chapitre de Vienne ont statué et concédé, que Geoffroy, fils d’Aynard de Clermont soit reçu parmi les chanoines de Vienne. Ils le reçoivent parmi les chanoines et dans la communauté des frères, voulant qu’ensuite il leur fasse fidélité. Après son serment, il est dit que Geoffroy ne pourra accéder au chœur majeur ni avoir voix au chapitre pour une durée de trois ans sauf si Geoffroy est reçu dans l'ordre des sous-diacres.
Le même jour, le doyen et tout le chapitre de l'Eglise de Vienne prolongent le statut qui précise que nul ne se soit introduit dans ladite Eglise de Vienne à partir de la prochaine fête de la Toussaint, et ce pendant quatre années consécutives, à l'exception du seigneur Hugues Jordain, chapelain du seigneur archevêque de Valence, qui doit être reçu dans l'Eglise de Vienne.
Les mêmes ont autorisé maître Hu. De Serrières à intégrer le chœur majeur
Ils ont aussi concédé à Antelme Rigaud, chanoine de Lyon, le droit d’accéder au chœur majeur.
L'année du Seigneur MCCLXXXI, le mercredi du lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1281), au cours d'un chapitre général, il a été statué par ledit chapitre que tous les écrivains de la curie qui sont clercs de notre Eglise sont tenus d'écrire toutes les affaires de l'Eglise sur la réquisition des procurateurs des anniversaires du chapitre. Celui ou ceux qui auront été désobéissants ne toucheront plus leur livre durant un mois, et les procurateurs promettent qu’ils n’en excuseront pas un plus qu’un autre.
La même année, le mardi le lendemain de la fête de Saint Maurice (23 septembre 1281), au cours d’un chapitre général, il a été concédé au seigneur Geoffroy de Virieu l’autorisation d’être en retard tant qu’il vivra à Saint Gervais dans sa demeure avec trois de ses compagnons. Ainsi, ses compagnons pourront ne pas paraître lors des neuf lectures des matines des jours de fête ainsi qu'aux heures canoniques, et ce, malgré les interdictions édictées par les statuts.
Est statué
La même année, le jour du vendredi avant la fête de saint Maurice (19 septembre 1281), tout le chapitre de Vienne a ordonné et concédé de manière unanime que le seigneur Geoffroy de Clermont doyen, Pierre de le Borgia et Hugues Recuz chargé du réfectoire tiennent et gouvernent le saint siège de l’archevêché de Vienne, et qu’ils jurent de gouverner le dit siège sous la forme décrite ci-dessous. Le doyen et le chargé du réfectoire ont juré ce qui suit :
_Premièrement, les trois, c'est-à-dire le seigneur doyen, Pierre et Hugues, ont promis qu’ils règneraient sur le siège pour l’utilité de l’Eglise, et qu’ils garderont fidèlement en leur pouvoir le droit de l’archevêque et celui de la cité de Vienne. _Qu’ils ne recevront ni n’accepteront aucune restitution, aucun revenu, aucun bien meuble ni aucun droit de personne. _Qu'ils ne recevront pas les drualies, des dons, de l'argent ou des permissions pour les affaires du siège ou sur les tractations des affaires dudit siège. _Qu’ils serviront et administreront les droits du chapitre, des chanoines et des clercs. _Qu’ils ne dénonceront pas les droits du siège de l’évêché que ce soit pour de l’argent, de l’amour, de la haine ou toutes autres causes, mais au contraire qu’ils les conserveront, les
66
augmenteront et les défendront. _Que les chanoines qui tiendront le siège de l’évêque agiront selon la beauté de leur serment. _Qu'ils ne pourront concéder à personne, sauf aux chanoines, un bénéfice sans le consentement de la plus grande partie du chapitre. _Qu’ils ne déclareront aucune guerre sans le consentement de la majorité du chapitre. Tous, le doyen et le chapitre, ont ratifié et confirmé ceci le mardi qui suit la fête de saint Maurice (23 septembre) au cours d’un chapitre général.
De même, il a été concédé au dit doyen, à Pierre et à Hugues chargés du réfectoire, le droit d'enquêter sur la nomination du mistral de Vienne sur la demande du seigneur évêque de Valence. Le gouvernement de la sainte Eglise de Vienne étant vacant, le seigneur Odon Alaman, chanoine de Vienne, peut être nommé mistral par les trois qui peuvent lui conférer la mistralie ainsi que le chapitre peut le faire selon le droit coutumier.
De même, la même année et le même jour, le doyen et le chapitre ont statué qu’ils ne recevront aucun clerc dans l’Eglise de Vienne durant trois années consécutives à compter de la prochaine fête de la Toussaint. Ils reportent et repoussent toutes les admissions sauf celle de Geoffroy de Moirans clerc pour qu’il soit ainsi reçu dans le chœur de l’Eglise de Vienne et qu’il soit clerc dans l’Eglise de Vienne par la volonté du chapitre.
Le même jour, le seigneur doyen et tout le chapitre de Vienne réunis lors du chapitre général qui est célébré le lendemain de la saint Maurice, ont statué et ordonné qu’à partir de la prochaine fête de la Toussaint et pendant trois années consécutives, personne ne sera introduit dans l’Eglise de Vienne. De plus, ils ont réformé et conservé le statut antérieur concernant la non-réception des clercs dans l'Eglise de Vienne.
Est statué aussi
L'année du Seigneur MCCLXXXIII, le lendemain du vieux Carême (28 février 1284 n.s.), le seigneur Geoffroy, doyen et tout le chapitre de Vienne ont annulé les statuts de non-réception des clercs dans l'Eglise de Vienne, et ils ont concédé que le capiscol et le magister puissent nommer 8 nouveaux clercs dans ladite Église. Après ces nominations le doyen et le chapitre réformeront et renouvelleront le statut de non-réception des clercs.
Le même jour, il a été concédé à Jean de la Valette, quatre chapelles que tenait le seigneur Geoffroy de Moirans. Qu’il soit prêtre avant la prochaine Pâques.
Le même jour, révoquant le statut de la non-réception des clercs dans le chœur majeur, ils ont concédé à Hugues de Seyssuel d'être reçu dans le chœur majeur. Après avoir concédé ceci, ils ont rappelé le statut et l’ont réaffirmé avec force.
Le même jour, ils ont révoqué le statut qui prive les clercs de la livre des chanoines et ils ont concédé à Hugues de Saint Vallier archiprêtre, deux deniers sur la livre, mais qu’il fasse les semaines. Nous voulons et ordonnons que ledit statut soit rappelé et qu'il soit réaffirmé avec force.
Le même jour, observant que G. de la Balme chanoine de Vienne n'a pas fait les trois anniversaires qu'il aurait dû faire depuis longtemps, nous voulons que G. fasse un anniversaire avant Pâques, et qu'il fasse deux anniversaires avant un an.
De même, il a été imposé au seigneur G. de la Bellevue, qui doit deux anniversaires, qu’il fasse un anniversaire avant Pâques et l’autre anniversaire avant la fête de saint Michel.
67
De même est aussi statué
L’année du Seigneur MCCLXXXIIII, le lendemain de la saint Jean-Baptiste (25 juin 1284), au cours d’un chapitre général qui fut alors célébré, il a été concédé à Artaud de Roussillon 100 livres de Vienne que le seigneur Jean archevêque de bonne mémoire avait données au chapitre selon ses dernières volontés. Cette somme était due par l’archevêque au seigneur G. de Roussillon, le père d’Arnaud. Cette dette de 100 livres a été payée à Artaud à hauteur de 60 livres. Les 40 livres restantes ont été payées par le transfert de la dette due par le bourg de Lyon au chapitre de Vienne.
L'année du Seigneur MCCLXXXIIII, le lundi le lendemain du vieux Carême (12 février 1285 n.s.), il a été concédé par le seigneur Guillaume archevêque et par le chapitre de Vienne, que soient données 10 livres aux frères mineurs pour les bons anniversaires sur les aumônes que reçoit Albert Menabos procurateur des anniversaires. De plus que soit donnés 100 sous aux sœurs mineures de sainte Clair. De même que ledit Albert pourvoit Jacques de la Tour prêtre et le magister Gauthier pour leurs nécessités. Moi Jean de Mayreu, notaire dudit chapitre ai eu le consentement du doyen et c'est ainsi qu'il l'a voulu.
Le même jour, il a été concédé au seigneur Guillaume archevêque, que Thomas, son clerc, soit reçu dans l’Eglise de Vienne et qu’il soit clerc de l’Eglise, ainsi que l’a voulu le seigneur doyen.
Le même jour, il a été concédé au seigneur Raymond préchantre que Guillaume, son clerc pour le côté de saint Romain, soit reçu dans l’Eglise de Vienne et qu’il soit clerc de l’Eglise de Vienne ainsi que l’a voulu le seigneur doyen.
L’année du Seigneur MCCLXXXV, le lundi le lendemain du vieux Carême (4 mars 1286 n.s.), au cours d’un chapitre général, il a été décidé qu’Arbert Meneabos doive payer 100 sous pour les bonnes aumônes des frères mineurs de Vienne. Il doit de même aux frères prêcheurs de Lyon 100 sous, et aux sœurs mineures 60 sous. De plus qu’il fasse deux dons pour les bonnes aumônes, et il aura jusqu'à la fête de saint Jean pour payer ces bonnes aumônes aux pauvres de Dieu. De même, que 20 sous plus 2 sous chaque semaine soient donnés à Ponce Borget jusqu'à ce qu'il soit guéri.
De même, il a été ordonné au cours de ce chapitre, que les deniers qui sont dus par les chanoines et clercs aux frères de la confrérie doivent être payés quinze jours avant Pâques. Si un chanoine ou un clerc n’aura pas payé, qu’il perde sa livre qui sera reçue par les chargés du réfectoire. Que la livre dont il est exclu, soit remise en subside à ladite confrérie, par le ou les chargés du réfectoire qui la remettront au prieur de ladite confrérie quinze jours, après l'avoir reçue.
Le mardi suivant (5 mars 1286), il a été statué par le seigneur Guillaume archevêque et par le chapitre que les fêtes de Saint Jacques, de Saint Christophe et de Saint Jean de la décollation qui se faisaient dans la chapelle saint Jean se fassent désormais dans le chœur majeur.
Le mardi prédit, il a été concédé au clerc Albert Menabo que tant qu'il sera sous-diacre, il sera reçu dans le chœur supérieur.
Le mardi prédit, il a été concédé que le magister Guillaume de Valence, chanoine de Romans, soit reçu dans le chœur supérieur.
68
Il a été statué que lors des fêtes de saint Jean, saint Paul et saint Clément, soient faites 9 lectures.
De même, il a été statué que pour la saint Ruf et la sainte élection de l’évêque, on fasse comme pour les saints.
L’année du Seigneur MCCLXXXV, le vendredi du lendemain de la Toussaint (2 novembre 1285), il a été concédé par le chantre Raymond, que le clerc G. de Romans soit reçu dans le chœur supérieur.
L’année du Seigneur MCCLXXXV, le dimanche du lendemain de la saint Maurice (23 septembre 1285), au cours d’un chapitre général, il a été concédé au seigneur B. de Chignin, qu’il ait un don du chapitre à Virieu ainsi que l’argent de l’anniversaire que tenait le clerc Renaud Maugiron.
Le même jour, il a été convenu entre le vénérable père seigneur Guillaume archevêque et le chapitre de Vienne, qu’ils donnent le pouvoir au seigneur Hugues de Châteauneuf, au seigneur Boson Potrenc et Jean de Meyrieu clerc, pour qu’ils puissent diviser en deux parties les possessions, restitutions et dîmes communes. Que le seigneur archevêque ait sa part de la division, et que le chapitre ait l’autre, c'est-à-dire que chacun ait la part qui lui est assignée.
Le même jour, il a été ordonné par le seigneur archevêque et par le chapitre, que le seigneur Hugues de Châteauneuf et Ay. de Faverges soient procurateurs concernant les dégâts et dommages que firent les nobles hommes du comte de Savoie et du Dauphin. Que le chapitre fasse les dépenses le jour où Hugues de Châteauneuf et Ay. de Faverges auront engagé ces dépenses sur le compte du chapitre. De même, que les chargés des anniversaires fassent les dépenses le jour où ils auront engagé les dépenses sur le compte des anniversaires. Ils seront payés pour leur travail le jour de l’arbitrage par le seigneur G. de Virieu, Odon sacristain et Humbert capiscol. Le dit chapitre a voulu que ces procurateurs soient mandatés sur tous ceux qui ont causé des dommages au chapitre mais pas sur les chanoines.
De même ils ont donné le pouvoir à ces trois prédits pour qu’ils puissent recevoir de l’archevêque 30 sous que le chapitre possède sur le moulin du seigneur de Veseronc.
De plus, il leur a été concédé le pouvoir de faire les échanges des fiefs et d'hommages entre Durand de Communay et Pierre Aymard avec l'accord du dit Durand et dudit Pierre.
De même, il a été ordonné dans ce dit chapitre, que le seigneur Humbert de Virieu archidiacre et le seigneur B. de Chignin puissent chaque année affermer le grand péage au plus offrant conformément aux intérêts de l’Eglise de Vienne. Si un chanoine veut avoir ledit péage, qu'il puisse l'avoir à ce prix et non pour un autre.
Le même jour, il a été ordonné par le chapitre, que le seigneur G. de Lignon, gardien de Lyon, le seigneur Jean d’Anthon et B. de Chignin puissent négocier à propos de l’amitié, des rapports et des considérations faites entre les chapitres de Lyon et de Vienne. Que ces amitiés, rapports et considérations puissent se nourrir des conseils du révérend père le seigneur archevêque de Vienne, du seigneur Geoffroy doyen, de G . de Virieu chantre, d’Humbert de Virieu, d’Odon sacristain, d’Hugues capiscol et de G. Remestan. Que Jean d’A et B. de Chignin se nourrissent des conseils des prédits.
Le mardi 25 juin 1286 lors d'un chapitre général, il fut décidé de prolonger le chapitre jusqu'au mercredi sur la volonté de l'archevêque Guillaume et de tout le chapitre, pour régler
69
les affaires de l'Eglise. Cependant, il ne sera plus discuté du fait que nul ne soit fait chanoine ou clerc de Vienne. Ce à quoi, le chanoine Hugues de Paladru refusa la prolongation du chapitre. Le capiscol et procurateur des anniversaires Humbert lui rétorqua qu’il n’avait pas voix au chapitre tant qu’il n’aurait pas payé les deux livres qu’il devait. Le même jour, G. Remestan put introduire, avec la permission du chapitre et de l’archevêque, son neveu Guillaume Remestan dans l’Eglise de Vienne. Hugues de Paladru s’y opposa et le capiscol Humbert lui répondit qu’il n’avait pas voix au chapitre conformément à ce qui avait été annoncé plus haut.
Le mercredi 26 juin au cours du même chapitre général, les seigneurs Alamans de Condrieu et Bartholomé de Valette ont été reçus dans le chœur supérieur.
Le 23 septembre 1286, au cours d'un chapitre général, il fut assigné au seigneur G. de Rochefort, 70 sous sur la part des divisions des terres du chantre Raymond et du seigneur B. de Chignin jusqu'à ce que cette somme lui soit assigné en terres. Le même jour, G. Remestan l’ancien fut élu à l’unanimité par le chapitre et l’archevêque à la charge de chantre remplaçant ainsi le seigneur R. Le même jour, il a été reconnu par le chapitre à l’archevêque le droit de punir le seigneur Odon Alaman et les autres clercs qui s’étaient emparés du château de Pipet lorsque celui-ci était vacant. Il a été ordonné que le chantre G. soit chargé de veiller aux aumônes. De même il a été ordonné que Jean de Mayre soit chargé des œuvres. De même, le chapitre et l’archevêque ont fait et reçu parmi les chanoines, le seigneur Guy de Genève. Les mêmes ont voulu que Jean de Barnay soit reçu dans le chœur supérieur. Ils ont concédé aussi à Pierre de Pinay d'être reçu dans le chœur supérieur lorsque celui-ci sera sous-diacre. Les mêmes ont voulu prolonger le chapitre jusqu'au jeudi. L'archevêque et le chapitre ont voulu que nul ne soit reçu dans le chœur supérieur s'il n'a auparavant été sous-diacre. Ils ont voulu malgré les statuts que le conchanoine du seigneur Albert de Roussillon soit reçu dans le chœur supérieur. L'archevêque et le chapitre ont statué que personne d'autre ne sera reçu dans le chœur supérieur avant d'avoir reçu les ordres constitués, c'est-à-dire d'être sous-diacre.
Le lundi 24 février 1287 après le vieux Carême, au cours d’un chapitre général, le chapitre a concédé au conchanoine du seigneur Alamans de Condrieu, la moitié des trois parcelles de Saint Clair que tenait G. Coindos. Ils ont concédé et garanti les biens de Saint Clair à A. de Condrieu c'est-à-dire toutes les tornes que fera le chapitre jusqu'à ce que le seigneur G. soit quitte, et qu’il tienne Saint Clair sans être payé par le chapitre. De même, ils lui ont donné toutes les refusiones qui ont été faites par le chapitre à Bacaras et aux Côtes. Ils lui ont concédé aussi ce que tenait le chantre R(aymond) à Chaumont mais le seigneur Alamans devra construire et retenir l’église de Saint Clair pour l’arbitrage du seigneur Hugues de Châteauneuf et d’Aymon de Faverges. Si ce dernier engage plus de dépenses que celles qui sont concédées, le chapitre devra les payer selon l'arbitrage desdits arbitres. Si les dépenses sont moindres, il devra les rendre selon l’arbitrage des arbitres. Il a été concédé aussi à Alamans de Condrieu qu’il soit fait résident et qu’il puisse tenir son hospice et qu’il se paye lui-même avec ses compagnons. Les seigneurs Odon sacristain, Hugues de Chateauneuf, G. de la Balme et Pierre de Briort ont concédé aux obédienciers de Reventin qui ont la maison en ruines qui appartenait à G. Coyndos 40 sous de ce dernier pour construire à Reventin à la condition qu’ils soient résidents
70
avec leurs compagnons. Il a été convenu entre le chapitre et les obédienciers que ceux-ci seront payés uniquement si ce qui devra être construit le sera dans les termes convenus. Il a été concédé à Hugues de Châteauneuf, que son frère soit reçu dans l’église de Vienne par le capiscol. Il est rappelé que d’après les anciens statuts, lors de la création d’un anniversaire, il doit être payé 60 sous par an ou 60 livres viennoises. En raison du trop grand nombre de clercs de l'Eglise, il est statué que le chœur ne recevra pas de nouveaux clercs. Si toutefois il advient que des clercs sont admis dans le chœur, ceux-ci ne participeront pas aux distributions tant que les anniversaires ne disposeront pas de 60 sous par jour. De même il fut ordonné que les clercs ne soient pas reçus dans le chœur sauf s’ils savent lire et chanter d’après l’avis du capiscol ou s’ils sont nobles et font honneur à l’Eglise de Vienne. De même que les clercs du chœur ne soient pas introduits sauf s’ils savent les fériales, les saints et les offices des morts.
Le dimanche 25 juin 1287 au cours d’un chapitre général, le chapitre et l’archevêque ont admis le clerc Thomas dans le chœur supérieur. Par l’accord du chapitre, le seigneur Odon sacristain, P. de Marjais, G. de la Balme et Hugues de Châteauneuf peuvent modifier les statuts pour que ceux-ci soient utiles aux chanoines qui y sont astreints par serment, ainsi que pour l’utilité de ceux qui y sont tenus par honnêteté.
Le dimanche 2 novembre 1287, au cours d’un chapitre général, le chapitre a dispensé le seigneur Albert Lombard de tenir l’hospice jusqu’à Noël mais considère sa résidence comme s’il tenait l’hospice.
Le lundi 16 février 1288 après le vieux Carême, au cours d’un chapitre général, sur la volonté du chapitre, le seigneur Jean d’Anthon a reçu 30 sous de la part de la division des terres du seigneur G. de Lignon. Le chapitre a voulu que G. de Virieu chantre ait la moitié des vignes de la route du milieu que tenait G. de Lignon1.
Le mardi, il a été concédé au prieur de Saint Vallier, frère Rodolphe, d’être admis dans le chœur de Vienne. De plus, il a été concédé à Artaud de Roussillon l'introduction dans le chœur de Vienne du prêtre Guigues de Salomon.
Le jour suivant le dimanche où l’on chanta Oculi mei (Lundi 1er mars 1288), au cours du chapitre qui se poursuivit, le seigneur archevêque Guillaume, le doyen Alaman et tout le chapitre ont décidé que soit procédé à la nomination des chanoines et qu’ils touchent 40 sous pour chaque jour où ils servent l’église. Chaque chanoine nouvellement nommé est tenu de jurer qu’il observera les statuts. Si l’un d’entre eux accepte la livre ou touche une part de la division des terres alors qu’il n’a pas le droit d’après les statuts, qu’il soit privé du droit des chanoines.
Les chanoines du chapitre sont :
Le seigneur archevêque Guillaume, le doyen Alaman, G. Remestan chantre, G. de Virieu chantre, Henri de Geneve, Guy de Geneve, Jean d’Anthone, Guy de Bellevue, Humbert capiscol, Ponce de Roanne, Guillaume de Seyssuel, G. de la Balme, Aymon de Fabris, Albert de Villa, Odon sacristain, P. de Margais, G. de Rochfort, Jacque de Candiac, Hugues de Peyrau, Albert Coindos, Hugues de Chateauneuf, Guigues Remestan, P. de Briort.
1 Guillaume de Lignon est décédé en 1287. cf. Paul de Thomé de Maisonneuve, le chapitre métropolitain
de Vienne et le Liber divisionum terrarum, Grenoble, 1937, p.30.
71
Chacun pouvant nommer un chanoine :
L’archevêque nomma Guillaume, prévôt de Grasse et Bertrand le fils d’Ay. de Chabrillan, le doyen nomma Alaman de Albarippa et Humbert de Montluel ; G chantre nomma le neveu de Guillaume Remestan et le clerc Guillaume Remestan ; G de Virieu chantre a nommé au nom de l’archevêque le fils du seigneur de Candiac ; Henri de Genève nomma le fils de P. Flota ; Guy de Genève nomma P., le fils du seigneur de Montluel ; Jean d’Anthon nomma Ay. d’Anthone ; G. de Bellevue nomma G. son frère ; Humbert capiscol nomma Hugues son frère ; Ponce de Roanne nomma Ponce de Lignon ; G. de Seyssuel nomma Anthelme son frère ; Albert Lombard nomma Francis son frère ; Odon sacristain nomma Guillaume de Marjays ; G. de Rochefort nomma Guichard de Saint Symphorien le fils de P. de Saint Symphorien ; Jacques de Candiac nomma Lambert, son frère ; Hugues de Perau nomma Guelis d’Auriol ; Albert Coindos nomma Guillaume, son frère ; Hugues de Chateauneuf nomma Ay. de Crolles ; G. Remestan nomma Mathieu, son frère ; G. de la Balme nomma le clerc Francis de Quinceu ; Aynard de Faverges nomma son frère Anthelme.
De même ils ont ordonné que le seigneur archevêque, le doyen A., le chantre G., Odon sacristain, Humbert capiscol, Guillaume de la Balme, P. de Prior, Hugues de Chateauneuf, Ponce de Roanne, Guillaume de Rochefort, puissent nommer 12 chanoines et procéder à de nouvelles nominations s’ils sont tous d’accord sur les noms des chanoines à nommer. Sur ces 12 chanoines 7 doivent appartenir à l’église et 5 doivent être de l’extérieur. Ils ont ainsi voulu, sur les prières d’Hugues de la Tour, sénéchal de Lyon, que Guillaume de Bessan, Anthelme de Chignin ainsi qu’Amédée du Puy soient chanoines. Le lendemain, l’archevêque, le doyen A. et le chapitre ont accordé à Guillaume d’Anjou, seigneur de Serrières, que son neveu G. Barras soit fait chanoine. Les mêmes ont fait chanoine Hugues, le fils du seigneur de Bressieu et ils ont concédé à Arthaud de Roussillon que Foulques, fils du seigneur Ay. Guichard soit fait chanoine. Ce même mardi, P. de Briort est venu au chapitre et Jean de Mayre, notaire du chapitre de Vienne lui a présenté une charte qu’il refusa de lire. Ensuite l’archevêque, le doyen, le chantre, Odon sacristain, H. capiscol, G. de la Balme, H. de Chateauneuf, P. de Roanne, G. de Rochefort partageant les terres ont voulu ordonner les 11 chanoines qui restaient à nommer. Ils ont nommé Guillaume de Royans, le neveu de l’évêque de Grenoble, G. Rovoir, G. de Montchauve, Ponce de Seyssuel, Soffred Ferrand, Ay. de Clavaison qui furent les 7 chanoines appartenant à l’Eglise. Les 5 nominations de l’extérieur furent Jacques, le fils du seigneur Hugues de Peyrau ; Guichard, le fils du seigneur de Claireu ; Guigues, le fils de Drodon, seigneur de Beauvoir ; Odon de Chaurisac ; Jean de Villars. Ils ont juré de recevoir les ordres, et ils ne pourront pas accéder au chœur majeur ni avoir voix au chapitre ni prétendre à recevoir la division des terres tant qu'ils ne sont pas ordonnés. Ceux qui furent chapelains sont : Guillaume, prévôt de Grasse Aynard de Crolles G. de Margais Foulques G. de Montchauve Soffred Ferrand Odon de Chaurisac.
Ceux qui furent diacres sont : Guigues Remestan, clerc mineur Ponce de Lignon Hugues de Seyssuel Francis Lombard
72
Lambert de Candiac Guillaume Coindos G. de Bessan Anthelme de Chignin Guillaume de Rovoir G. de Royn
Ceux qui furent sous-diacres sont :
Bertrand, le fils d’A. de Chabrillan Alaman d’Albarippa Humbert de Montluel G. Remestan, le fils du seigneur de Candiac G. fils du seigneur de Montluel Ay. d’Anthon G. de Beauvoir Anthelme de Seyssuel Francis de Quinceu Guelis G. de Baras Anthelme de Faverges Odon de Montchenu Hugues de Bressieu G. de Saint Symphorien M. Remestan Amédée du Puy Ponce de Seyssuel Ay. de Clavaisin Jacques de Payrin G. de Claireu Guigues de Beauvoir Jean de Villars.
De même, ils ont concédé à Etienne cellérier le droit de chanter dans le grand autel et qu’il soit coadjuteur.
Le samedi suivant, il fut ordonné par l’archevêque Guillaume, le doyen A. et le chapitre que nul prêtre ou clerc ne soit reçu dans le chœur de Vienne durant 10 ans, ni par le chapitre, ni par le doyen. Le doyen A. a néanmoins le droit de nommer 12 clercs capables durant cette période dont 6 doivent être chapelains. Ce statut est irrévocable même par l’archevêque, le doyen ou le chapitre.
Le samedi 25 juin 1289, il a été concédé par le seigneur Guillaume archevêque, Alaman doyen et par le chapitre de Vienne que Foulque fils du seigneur Ay. Guichard soit reçu dans l’ordre des chanoines et qu’il soit prêtre comme l’a voulu le seigneur Albert de Roussillon mistral. Ils ont voulu que Foulque soit ordonné sous-diacre, qu'il soit reçu dans le chœur majeur et qu'il puisse avoir le droit des chanoines de l'Eglise de Vienne. Le même jour, ils ont voulu que le seigneur Hugues de Peyrau soit l’un des deux chanoines qui servent de compagnons au seigneur archevêque et qu’il reçoive la même part de la division des terres qu’un bachelier. Le chapitre a fait ceci sans contrainte et a voulu qu’Hugues de Peyrau ait 10 livres parmi les restitutions du chapitre de Vienne.
73
Le 20 février 1290, le chapitre de Vienne a concédé au conchanoine du seigneur Guillaume de Valence, la moitié du Montchenu qui était vacant.
Le dimanche 25 juin 1290, le seigneur Guillaume archevêque, Geoffroy doyen, Aimon de Condrieu et tout le chapitre ont reconnu la paix faite entre le seigneur archevêque, le chapitre et le seigneur A. de Condrieu d’une part et le seigneur G. de Clermont d’autre part. Ils l’ont ratifiée et ont voulu qu’elle ait la force d’être respectée dans les termes qui ont été prononcés par les arbitres. Les mêmes ont voulu que le seigneur doyen G. de Chatte, doyen de Valence soit fait chanoine ainsi qu’Humbert de Paladru et Soffred de Bellegarde, et que le seigneur Hu. de Paladru puisse nommer son neveu Evrys de Paladru. Le seigneur G. Archevêque, G. doyen, A. archidiacre ont nommé chantre le seigneur Odaon Alaman, par le pouvoir qui leur est concédé par le chapitre. Le chapitre accorde à G. archevêque, G. doyen, A archidiacre, Odon sacristain, P. de Briort, Aymon de Faverges, le pouvoir de promouvoir et réformer l’Eglise pour l’améliorer.
Le samedi 23 septembre 1290, le doyen G. et tout le chapitre ont voulu que les surplus des comptes soient affectés à l’édification de la maison de la grande route. Le doyen et le chapitre donnent le pouvoir de statuer et de corriger les statuts (sauf les peines et les anniversaires) à l’archevêque, G. doyen, Odon sacristain, Hugues de Châteauneuf et à A.
Le lundi après le vieux Carême, le 12 mars 1291, l’archevêque Guillaume et tout le chapitre ont voulu que maître And. Baudouin puisse reconnaître par le droit, ce que le seigneur Hugues Eschanpers, prêtre de Vienne, dit avoir. Que ce dernier soit nommé par Pierre de Briort comme chanoine de Vienne. Il a été concédé à Humbert Alioglar, pour le reste de sa vie, un muid de seigle tous les 15 jours. Il a été concédé au conchanoine de Mathieu Remestan, la maison qui est à côté du four de Saint Laurent et que tenait G. Remestan son oncle. Ce à quoi le seigneur Hugues de Seyssuel a répondu que G. Remestan la lui avait volée et il a voulu qu’elle soit reconnue comme son don pour la part de la division au seigneur G. de Virieu. Il a été ordonné qu'une procession soit faite lors de l'Annonciation du Seigneur dans l'église de sœurs deSainte-Marie de l'autre côté du Rhône. Il a été ordonné pour les six chanoines qui siègent en dehors de la ville, qu’ils soient trois d’un côté et trois de l’autre. Il a été ordonné que les sous-diacres qui se revêtent lors des jours de fête, ne se déshabillent pas avant que les diacres l'aient fait. Il a été confirmé le don qu’a fait le seigneur G. Archevêque au seigneur Hugues de Peyrau près de saint Donat. Ils ont concédé que le seigneur Hugues de Châteauneuf et Mathieu Remestan puissent arrêter la dette du conchanoine d’Albert Lombard que ce dernier doit pour les anniversaires.
Le 25 juin 1291, lors du chapitre général de la saint Jean-Baptiste, l’archevêque Guillaume et tout le chapitre ont ordonné qu’aucun chanoine ne puisse entretenir un clerc dans sa maison ou dans une autre même d’un prix certain. Si un chanoine désobéit, il ne touchera plus sa part de la division des terres. Si quelqu’un a un doute, que le chanoine et le clerc fassent une déclaration sous serment.
Le dimanche 23 septembre 1291, l’archevêque Guillaume, le doyen Geoffroy et tout le chapitre de Vienne ont donné à Pierre de Briort chanoine de Vienne et Humbert Eschanper
74
prêtre et qui prétend avoir un canonicat, le chanoine de Vienne Guy de Beauvoir et l’ont nommé commissaire enquêteur. Ce dernier pourra entendre et connaître les affaires judiciaires et il agira selon les usages du droit et selon les coutumes de l’Eglise de Vienne.
Ils ont voulu que Pierre de Marjays et Albert Lombard puissent amender et corriger les statuts sauf ceux qui concernent les cens du chapitre, les anniversaires, le château de Pipet ainsi que ceux qui nécessitent l’accord de l’archevêque et du doyen. Pour corriger les statuts, ils peuvent entendre les chanoines qui ont vu des choses à améliorer.
Le vendredi 2 novembre 1291, l’archevêque Guillaume et le chapitre concèdent au seigneur G. Remestan chanoine, la création d’un anniversaire. Celui-ci sera payé lors du Benedictus des matines de la saint Michel qui seront faites comme lors de la fête de saint Maurice. Ils ont voulu que G. Remestan le vieux, P. de Marjays et Humbert capiscol, soient ordinaires des autels. L’archevêque et le chapitre ont voulu que le doyen Geoffroy soit considéré comme étant résident lors de la division des terres ainsi que pendant la guerre sauf si le chapitre l’ordonne autrement. Ils ont concédé à Guillaume Coyndos le cens et les usages qu’a légué Boson Potrens aux anniversaires. Pour cela, Guillaume fera un anniversaire chaque année le jour de la mort de Boson. Ils ont concédé à Hugues de Seyssuel tous les biens et restitutions qui proviennent des alentours de Chaponnay que tenait Etienne de Chaponnay. Il les tiendra sa vie durant mais il devra faire un anniversaire chaque année excepté la première.
Le lundi du vieux Carême, 25 février 1292, l’archevêque, le doyen et tout le chapitre ont affecté la livre des aumônes aux œuvres pour une durée de quatre ans à compter de la saint Jean-Baptiste. Ils ont donné à G. Coyndos et G. de la Balme le moulin de Saint Gervais et tout ce qui s’y rattache. Ils doivent faire pour cela deux anniversaires chaque année et desservir un autel pour la somme de 40 sous. Ils ont concédé que quand le maître B. Sextoris, récemment official, sera sous-diacre, il sera reçu dans le chœur supérieur. Ils ont prolongé le chapitre au mardi pour les affaires de l’Eglise. Le mardi, il fut ordonné que les chanoines devront porter l’habit coutumier jusqu'à la Pentecôte. Les clercs le porteront jusqu'à l’Assomption de Sainte Marie. Le même jour, Hugues de Seyssuel renonça au don de la division d’Albert Coyndos et de Humbert de Virieu pour le donner aux divisions des terres du chapitre. Il le fit pour son neveu et pour lui-même.
Le mercredi 25 juin 1292, l’archevêque Guillaume, le doyen Geoffroy et tout le chapitre ont voulu qu’Albert Menabos rende compte des créances qui restent à recouvrer depuis huit ans. De plus qu’il rende le compte des dettes achevées au cours des deux dernières années. Albert les rendra par écrit au chapitre, et le chapitre payera ses dettes aux créanciers. Ils ont convenu que Pierre de Briort, G. de la Balme, Hugues de Châteauneuf, aient les pleins pouvoirs à propos des affaires de Coyndos. Ceci est décidé sur les conseils de G. Remestan, G. de Beauvoir, P. de Marjay, et Hu. capiscol. Les mêmes peuvent ordonner à propos de la reprise du château de Pipet. Ils ont concédé à Hugues de Seyssuel, le droit d’accenser, les terres cultes et incultes qu’il tient du chapitre et qui furent à Etienne de Chaponnay mais il doit lui remettre le cens. Les
75
deniers qu’il avait pour la forteresse sont considérés pour le reste de sa vie comme son bien propre avec l’assentiment du chapitre.
Le jeudi 25 juin 1293, l’archevêque Guillaume, le doyen Geoffroy et tout le chapitre ont convenu que Geoffroy doyen, A. archidiacre, Guigues Remestan, Hugues de Châteauneuf, G. de Beauvoir, Hugues capiscol, G. de la Balme, Hugues de Seyssuel, G. Rovoir et Bertrand de Chambrillan ou six d’entre eux, peuvent pour terminer les querelles entre le chapitre de Vienne et celui de Roman, connaître et passer des accords avec le chapitre de Roman et les chanoines de Roman qui seront désignés. Il a été précisé que si six d’entre eux peuvent négocier, il faut cependant que les dix soient présents pour terminer les accords. Ils ont confirmé les donations de l'archevêque à son clerc anglais Thomas, c'est-à-dire le moulin de Veseronc, les vignes d'Allegracer et de Colombe. Siebold Rovoir a concédé au seigneur Guillaume Coyndos chanoine, la vigne qu’il possédait du chapitre au prix de 13 livres et 10 sous. Si Siebold survit à Guillaume, il renonce à la vigne et le chapitre pourra la diviser selon la coutume, et si Guillaume survit à Siebold, Guillaume tiendra la vigne sa vie durant mais il la tiendra du chapitre. La vigne est située près d'Acum, à côté de la vigne que Jean Maire tient du chapitre.
Le lundi du vieux Carême, le 8 mars 1294, au cours d’un chapitre général, le chapitre a concédé la vigne d’Acum que tenait Jean Maire au seigneur Bertran de Chambrillan chanoine de ce lieu pour le reste de sa vie, en raison de son rôle dans les affaires de l’Eglise.
Le 25 juin 1294, au cours d’un chapitre général tenu en l’absence du doyen, le chapitre et l’archevêque ont conféré à Guigues Remestan le vieux, à Humbert capiscol, à Aymon de Faverges et à Mathieu Remestan le pouvoir de donner les biens de l’Eglise, à ceux qui ont aidé l’Eglise dans ses affaires. Ils ne pourront toutefois pas donner les terres vacantes qui doivent être divisées.
Le lundi après le vieux Carême, le 21 février 1295, le chapitre a donné le pouvoir de gérer les affaires de l’Eglise avec la France et l’Angleterre à l’archevêque, au doyen, à A. mistral, à A archidiacre, à Humbert de Seyssuel capiscol, à Hugues de Châteauneuf, à Hugues de Seyssuel, à Guigues de Bellevue, à Aymon de Faverges et à G. de la Balme. Ils ont promis de respecter le choix de la majorité dans leurs décisions et ils ont voulu que désormais, soient faites des lettres cachetées du sceau du chapitre. Ils ont statué de même à propos des affaires d’Aynard de Clermont. De même, l’archevêque et le chapitre ont donné le pouvoir d’organiser la fête de la Conception de Sainte Marie au doyen, à Odon sacristain, et à H. capiscol. Le chapitre a été prolongé jusqu'au mardi pour traiter des affaires de l'Eglise et faire ce qui a été dit.
Le lundi après le vieux Carême, le 13 février 1296, il fut accordé par l’archevêque et le chapitre à Guigues Remestain le vieux, chanoine de Vienne, que l’autel qu’il avait doté revienne au plus vieux chanoine ou clerc de sa filiation. S’il n’y en a pas, l’autel reviendra au chapitre. Si après sa mort, il n’y a toujours pas de chanoine ou clerc de sa famille, l’autel restera pour le chapitre jusqu'à ce qu’un chanoine ou clerc de sa filiation le reçoive. Il a été concédé à Siebold Rovoir le droit de vendre à un chanoine de l’église, sa part des restitutions qu’il touche pour le reste de sa vie.
Le samedi 25 juin 1295 le chapitre général est prolongé jusqu’au dimanche. Le dimanche, il fut donné au doyen, à l'archidiacre, à H. de Châteauneuf et à A. de Chignin le pouvoir d'ordonner les services et de faire des statuts. Qu’ils ne puissent toutefois pas statuer à
76
propos des peines. La livre des chanoines fut donnée au chevalier Jacquet de Malleval tant qu’il est présent.
Le lundi 25 juin 1296 le seigneur Geoffroy doyen et le chapitre ont concédé au seigneur Aynard de Clavaison et Mathieu Remestan son conchanoine le même pouvoir qui avait été donné aux autres pour régler les affaires du chapitre en ce qui concerne le seigneur Humbert Eschanper, prêtre de Vienne d’une part, et le chapitre d’autre part. Ce pouvoir est concédé par une lettre marquée du sceau du chapitre et du sceau d’Humbert. Ils concèdent, pour le reste de sa vie, au seigneur Guillaume de Saint Symphorien, chapellain du grand autel de Vienne, une maison inhabitée sise dans le cloître de Vienne, à côté du four qui est devant l’église saint Laurent. Ils concèdent à Guy de Royans, chanoine de Grenoble, la possibilité d’entrer dans le chœur de Vienne et de percevoir la livre des clercs, en sa qualité de prieur de Saint Vallier. Selon les conseils d’Odon, Humbert de Seyssuel capiscol et Guillaume de la Balme chanoine de Vienne, ils exonèrent d’impôts pour les autels et les anniversaires la maison d’Odon sacristain, pour que l’argent puisse être déposé en un autre endroit. Il est statué que désormais, les chanoines et clercs ne doivent plus se présenter en chausses sauf si elles sont noires.
Le dimanche 23 septembre 1296, le chapitre et l’archevêque réunis pour sonner la cloche des morts, ont donné le pouvoir d’organiser la fête de la Nativité et de la Conception de Sainte Marie au seigneur doyen, au sacristain et au capiscol. Il fut concédé à Bertrand de Chambrillan que tant qu’il est à l’école, on le considérera comme étant résident. Hugues de Châteauneuf, Aymon de Faverges et Humbert de Paladru, ont reçu le pouvoir de résoudre les querelles entre le doyen et le chapitre.
Le vendredi 2 novembre 1296, le chapitre réuni pour sonner les cloches des morts a concédé au doyen Geoffroy, le droit d’avoir durant le temps qu’il vivra, un chanoine bachelier qui sera considéré comme résident en ce qui concerne la division des terres.
Le lundi du vieux Carême, le 4 mars 1297, le chapitre réuni pour sonner la cloche des morts a reçu maître P. de Becius dans le chœur majeur. Le chapitre a été prolongé au mardi par la nécessité des affaires de l’Eglise.
Le mardi 25 juin 1297, le seigneur archevêque, le doyen Geoffroy et le chapitre ont confirmé à maître Jean de Salpayssia, clerc de l’église de Vienne, 12 parts de Cuyllin et de Breyssen qui lui sont données pour le reste de sa vie par le sacristain Odon. Il les gardera s’il meurt après le sacristain comme cela est consigné.
Le lundi du Vieux carême, le 24 février 1298, l'archevêque Guillaume, le doyen Geoffroy et tout le chapitre ont concédé à maître Jean de Salpayssium clerc de vienne pour le reste de sa vie, toutes les restitutions que fit Jean de Montluel quand celui-ci sera décédé ainsi qu'il l'a voulu. Ils ont voulu que lors de la fête de la Nativité de Sainte Marie, la tête de Saint Maurice soit posée sur l’autel et que cette fête soit célébrée comme si elle n’était pas une fête double. Que deux chanoines soient désignés et se chargent de l'organisation mais que le sacristain en soit dispensé. L’archevêque et le chapitre ont donné le pouvoir au doyen, au capiscol Humbert, à Mathieu Remestain et aux obédienciers de Communay de nommer pour le chapitre un maynerius qui fasse office de bedeau. François de Quinceu a dit qu'il voulait remplir ce rôle.
77
Le chapitre a été poursuivi le mardi pour ordonner la garde du château de Pipet. Le mardi, ils ont concédé à Mathieu Remestan, une dispense de l’impôt pour les anniversaires sur sa maison pour le reporter en un autre lieu.
Le dimanche 2 Novembre 1298 au cours d’un chapitre général assemblé pour sonner la cloche, l’archevêque G. et le chapitre ont admis dans le chœur majeur Thomas Lamare et Etienne de l’Oeuvre pour les récompenser d’avoir augmenté le cens de leurs anniversaires. L’archidiacre Alaman, Guigues Remestan l’ancien, le capiscol Humbert, P. de Briort, Anthelme de Chignin et Anthelme de Seyssuel, ont été choisi pour diviser les terres que tenait le doyen Geoffroy. Ceux-ci ont eu ce pouvoir jusqu'au jeudi suivant inclus et ils ont pu faire comme le prévoit la coutume, c'est-à-dire diviser, assigner les terres ainsi que rémunérer celui qui s’occupait des chevaux. Le chapitre a donné le pouvoir d’élire un doyen à l’archevêque, à l’archidiacre Alaman, à P. de Marjays, à Guigues Remestan l’ancien, à Humbert capiscol, à P. de Briort, à Goeffroy, doyen de Valence, à Jacques de Coindos, à Guigues Remestan le jeune et à Siebold Rovoir. Ils ont ce pouvoir jusqu'au dimanche suivant et doivent donner le nom du doyen le mercredi d’après si leur choix les satisfait. Si le choix du doyen ne les satisfait pas, le chapitre général sera poursuivi jusqu’au mercredi pour choisir un nouveau doyen.
Le lundi du vieux Carême, le 9 mars 1299, au cours d’un chapitre général assemblé pour sonner la cloche des morts, l’archevêque Guillaume et le chapitre ont admis dans le chœur de Vienne, le docteur Martin, médecin de l’église de la Tour. L’organisation des autels a été confiée à Guigues Remestan et à H. capiscol. Le chapitre a été prolongé jusqu’au mardi matin avant le repas pour les affaires de l’Eglise. Le mardi matin, le chapitre, assemblé pour sonner la cloche des morts a chargé le seigneur G. archevêque, l’archidiacre Alaman, P. de Marjay, Guigues Remestan l’ancien, Hugues de Châteauneuf, P. de Briort, le capiscol H., Aymon de Faverges, Guigue de Bellevue, Guigues Remestan le jeune et Hugues de Seyssuel, d’organiser la justice, les enquêtes, les procès et les torts faits à l’Eglise de Vienne. L’archevêque, P. de Marjays, Guigues de Beauvoir et les autres ont promis par serment de respecter les choix de la majorité. Les autres qui ont juré sont les seigneurs Guillaume, prévôt de Grasse, G. de Seyssuel, Hugues Rescuyns, H. de Peyraudum, G. Coindos, Ponce de Roanne, G. Rovoir, Siebold Rovoir, Albert Lombard, G. Remestan, H. de Paladru, G. de Besan, Mathieu Remestan, Anthelme de Chignin, Anthelme de Seyssuel, Ponce de Lignon et Guiffred d’Auriol. L’archevêque et le chapitre ont chargé H. de Paladru de recevoir le fief de Pierre Evris et d’enquêter sur G. Dudin qui tient des fiefs de l’Eglise de Vienne. G. de Seyssuel, A. de Seyssuel et Guy de Beauvoir, sont mécontents du partage des terres effectué par le doyen et refusent de nommer quiconque tant qu'ils ne seront pas satisfaits.
Le lundi de la fête de la révélation de Saint Etienne, le 3 août 1299, le chapitre assemblé pour sonner la cloche des morts, a renouvelé le pouvoir qu’il avait donné le lundi 9 et le mardi 10 mars 1299 à l’archidiacre Alaman, P. de Marjay, Guigues Remestan l’ancien, Hugues de Châteauneuf, P. de Briort, G. sacristain, Hugues de Peyraud, G. de Seyssuel, Ponce de Roanne, Siebold Rovoir, G. Coindo, G Rovoir, Albert Lombard, Guigues Remestan le jeune, Hugues de Seyssuel, Mathieu Remestan, Hugues Rescuin, G. de Besant, Ponce de Seyssuel, Ponce de Lignon et Anthelme de Chignin. Ce pouvoir fut donné pour qu’ils puissent organiser la justice et la défense de l’Eglise de Vienne. De plus, qu’une lettre soit écrite au nom du chapitre pour attester du pouvoir donné à Guigues Remestan le jeune et Anthelme de Chignin.
78
Le vendredi 23 septembre 1328, l’archevêque Bertrand, le doyen Guillaume et tout le chapitre ont voulu améliorer les statuts, modifier les peines, examiner les plaintes des chanoines sur la division des terres, ordonner à propos des impôts selon les lieux de la juridiction du chapitre et recouvrer les dettes dues aux anniversaires. Ils ont donné les pleins pouvoirs jusqu'à la prochaine Pâques aux commissaires, c’est-à-dire l’archevêque, le seigneur Jacques le vieux, P. de Vernet, G. de Vireu et le sacristain Guigues. Ils ont voulu qu'Hugues de Malbec renonce à son canonicat et que son frère Aynard de Malbec soit chanoine de Vienne et sous-diacre. Ils ont créé un canonicat, affranchi de communauté mais dépendant en propre de l’Eglise de Vienne, et l’ont donné au seigneur Guillaume de Sure, archidiacre de Lyon. Ils ont créé un canonicat parmi la communauté et l'ont donné au clerc de Vienne, Henri de Castellione, fils du noble Jean de Castellione, seigneur de Chautagne et qu'il soit sous-diacre. Ils ont voulu que Guillaume Blanc de Forez, dont le courage est reconnu par le pape, soit chanoine de Vienne et qu’il soit reçu parmi la communauté. Cependant, qu’il n’ait pas voix au chapitre et qu’il ne fasse pas le serment habituel à l’église avant la prochaine saint Jean-Baptiste. Ils ont donné les pleins pouvoirs à l’archevêque et au mistral pour recevoir Guy, fils de Gilles Coper parmi la communauté des chanoines. Ils ont voulu que Jean de Fuer et Guillaume Blanc de Forez soient diacres. Ils ont nommé Pierre de Genas, prêtre, comme chargé du grand autel de l’Eglise de Vienne et qu’il touche 7 deniers. Le Chapitre fut prolongé au dimanche pour traiter des affaires de l’Eglise et des plaintes des chanoines à propos des divisions des terres sauf de celles nouvellement créées. Le dimanche, poursuivant le chapitre, l’archevêque, le doyen et le chapitre ont voulu qu’Humbert de Clermont, archidiacre, et Guigues Remestan soient chargés des négociations avec l’Eglise de Lyon à propos des accords entre les chapitres de Lyon et de Vienne. Nous voulons qu’ils rendent compte des accords passés lors du chapitre général de la Toussaint. Le pouvoir a été donné par le chapitre à l’archevêque B. et à Siebold, mistral, pour que soit fait le renoncement de Pierre de Roussillon ou de son représentant parmi les chanoines, et que Guy, fils de Gilles Coper, soit chanoine de Vienne dans 5 ans et pas avant. Il a été accordé aux chanoines de nommer un chanoine le prochain vendredi au cours du chapitre général.
Les chanoines qui furent nommés
Le vendredi 23 septembre 1328, observant la mort de nombreux chanoines, le chapitre voulant que le culte divin soit augmenté, souhaita que soient nommés de nouveaux chanoines. Que chaque chanoine résident du chœur majeur puisse nommer un chanoine d’ascendance noble, même s’il est mineur, jusqu’au lendemain de la prochaine Toussaint. Que ces chanoines soient reçus parmi la communauté et qu’ils jurent de recevoir les ordres dans 5 ans. Ces chanoines ne peuvent avoir voix au chapitre, ne toucheront pas de part de la division des terres et ne recevront pas les ordres avant la fin de ces 5 ans. Qu’ils ne puissent pas non plus accéder au chœur majeur et s’il s’avère que ces chanoines reçoivent les ordres avant le terme prédit, ils n’obtiendront pas le droit des chanoines. Il est ajouté que comme l'Eglise de Vienne a besoin d'hommes lettrés, que les nouveaux chanoines étudient les lettres et qu'ils aillent à l'école durant 5 ans et ainsi être plus utiles plus tard. Les chanoines présents ou absents doivent, soit en personne soit par leur procurateur, nommer avant le lendemain de la Toussaint, leur chanoine devant le notaire et le réfectorier du chapitre. Et s’il s’avère qu’un nouveau chanoine est couvert de reproches, il est convenu que l’archevêque et le doyen peuvent le récuser.
79
Les chanoines qui sont résidents sont : L’archevêque le doyen G. de Clermont Albert Lombard préchantre Lambert de Chandeu sous-chantreGuigonet Remestan Jacques Archinjautz François Lombard Jacques Vetule Siebold de Clermont mistral Aynard de Crolles Richard de Chausenc Ervy de Paladru Raynard de la Balme Aynard d’Anjou Pierre de Vernet Guigues sacristain Ardenchon Guillaume de Virieu Humbert Lombard capiscol Jean de Clavaison Arthaud de Salfacco Guillaume de Maloc bachelier
L’archevêque Bertrand a nommé Hugues de Lavieu de Rivière prêtre et Pierre Lavieu de Rivière G. de Clermont doyen a nommé Louis fils de Geoffroy seigneur de Clermont et Boniface d’Aoste fils du défunt Yblon d’Aoste et neveu du seigneur de Chalan. Humbert Lombard réfectorier a nommé Aynard de Virieu seigneur de Faverges clerc et Pierre Moirod prêtre. Albert Lombard prechantre a nommé son neveu Guigues Rolland prêtre de Vienne. Lambert de Chandieu sous-chantre a nommé son neveu Pierre, fils du seigneur Jean de Chandieu. Guigues Remestan a nommé Aymard de Borseu clerc de Vienne.
Jacques Archinjautz par ses procurateurs Guiguonet Remestan et Bartholomée de Valette a nommé Didier Arthaud clerc, fils de Jean Arthaud chevalier de Chatte. François Lombard a nommé son neveu Hugonnet Lombard clerc de Vienne et fils de Raymond Lombard. Jacques Vetule chevalier a nommé son neveu Pierre, fils de Jean Vetule chevalier. Aynard de Crolles a nommé Pierre, fils d’Humbert Remestan chevalier. Richard de Rostan, sacristain de Rome a nommé par ses procurateurs Guigues d’Amaysin sacristain de Vienne et Guillaume de Virieu chanoine, Gotafred Rostan son neveu et fils de Pierre Rostan. Hervys de Paladru a nommé Humbert clerc de Vienne et fils de Guillaume de Fabris. Raynald de la Balme a nommé son neveu Henri clerc de Vienne et fils de Jean de la Balme. Aynard d’Anjou a nommé Arthaud, fils d’Hugues de Paladru. Pierre de Vernet a nommé Ponce surnommé Chopart, clerc de Vienne et frère du seigneur de Rochibaron. Guigues d’Amaysin sacristain, a nommé son neveu Jean, fils du chevalier Humbert
80
d’Amaysin. Guillaume de Virieu a nommé son frère Jean de Virieu clerc de Vienne. Humbert Lombard capiscol a nommé son neveu Berthon, fils de Raymond Lombard. Jean de Clavaison a nommé son neveu Arthaud Alaman, fils de Guillaume Alaman. Artaud de Salsac a nommé son frère Helieton de Salsac clerc de Vienne. Guillaume de Maloc a nommé son neveu Jean de Maloc, fils du chevalier Guillaume de Maloc. Ardenchon de Valence a nommé par une procuration donnée à Humbert de Clermont archidiacre, Guigues Remestan et Raynald de la Balme, son frère Jean de Valence, fils d’Arden de Valence. Tous sont tenus de jurer d’observer les termes décrits plus haut et si quelqu'un y contrevient qu’on lui rappelle pour le corriger. Les chanoines nouvellement créés auront droit aux distributions quotidiennes sous les mêmes conditions que les chanoines.
Le mercredi 2 novembre 1328, l’archevêque Bertrand, Guillaume de Clermont doyen et tout le chapitre ont créé un canonicat pour Geoffroy, fils du noble Geoffroy de Clermont et le reçoivent parmi la communauté de l’Eglise de Vienne. Ils ont voulu que Thomas, clerc de l’archevêque soit reçu parmi les clercs de l’Eglise de Vienne. Ils ont nommé commissaires les seigneurs Humbert de Clermont, archidiacre, Guigues Remestan et Raynald de la Balme. Ceux-ci ont donné à Ardenchon, chanoine vertueux, de nommer des chanoines. Il peut nommer son frère Jean, fils d’Ardenc de Valence et le recevoir parmi la communauté. Il peut aussi nommer les chanoines jusqu’au chapitre du vieux Carême. Ils ont donné le pouvoir d’enquêter sur les fiefs, les reconnaissances des fiefs, et la rétention de ceux-ci que Guichard de Boscosel tient de l’Eglise vers Valarnout et que tenait de l’Eglise l’écuyer Geoffroy Garcin. Sur les prières de l’archevêque de Lyon, ils ont voulu que si un clerc de l’archevêque de Lyon se présente au capiscol, il soit reçu parmi les clercs de l’Eglise de Vienne pourvu qu’il soit capable. Ils ont voulu et ils ont fait entendre au révérend archevêque de Vienne qu’ils ont de vertueux hommes de lettres et comme il est dit : les sceaux du chapitre, c'est-à-dire Gilles de Montchenu, Alaman de Beausemblant, Humbert de Bessan, et Guichard fils du chevalier Jean Alaman, doivent le recevoir parmi les chanoines et dans la communauté de l’Eglise dès que possible, sous la forme d’un canonicat qui doit dès à présent, être créé. Et que l’archevêque puisse le reconnaître, par le droit, conforme à la coutume.
Le dimanche 26 septembre 1333, les commissaires du chapitre, à savoir, Raynald de la Balme préchantre, Humbert Lombard capiscol, Evris de Paladru, Jocerand de Venche et Arthaud de Salsac ont créé de nouveaux chanoines et créé de nouvelles charges avec l’assentiment d’Humbert de Clermont archidiacre, Jean de Charbonnier conchanoine alors absent mais convoqué pour le dimanche. Alors qu'ils procédaient à l'ordination des chanoines nommés en 1328, sur les conseils de l'archidiacre, ils ont créé de nouveaux chanoines avec les contraintes suivantes : ceux-ci ne pourront recevoir les ordres même mineurs et ne pourront accéder au chœur majeur ni avoir voix au chapitre. Tant qu’ils n’auront pas payé leur chape, et pour cela, payer 20 sous gros tournois en argent du royaume de France à Jacques Nicolas clerc de Vienne, leur assignation est annulée jusqu'à ce qu’ils terminent de payer. Si un chanoine est nommé prêtre et a payé 20 sous gros tournois avant qu’il puisse avoir voix au chapitre, la valeur de la chape lui sera restituée. Lorsque la cloche des morts fut sonnée pour rassembler le chapitre général, tous ont consenti, sauf Hugues de l’Ile, conchanoine, à l’ordination des chanoines par les commissaires et à leur entrée en charge.
81
Les ordinations
Ceux qui sont prêtres : Hugues de Lavieu Pierre Moyroud Guigues Rolland Jean fils du seigneur G. de Maloc Amédée de Briançon fils du seigneur de Varses Humbert de Bletteret
Ceux qui sont diacres : Pierre de Lavieu de Rivierie Aymar de Boursieu Jean Ardenc de Valence Guiot fils de Gilles Copier Alaman de Beausemblant Humbert de Bessant ! Guichard, fils de Jean Alaman Jean Baudet Guigues, fils d’Humbert Remestan Guigues, fils d’Anthelme de Lans
Ceux qui sont sous-diacres : Louis, fils du seigneur de Clermont Boniface d’Aoste Aynard, fils du seigneur de Faverges Pierre, fils du seigneur de Chandieu Didier, fils de Jean Arthaud Hugues, fils de Raymond Lombard Pierre, fils de Jean Vetule Pierre, fils d’Humbert Remestan Humbert, fils de Guillaume de Faverges Henri fils de Jean de la Balme Geoffroy Remestan Arthaud, fils d’Hugues de Paladru Ponce surnommé Chopars, fils de Roche Baron Jean, fils de G. de Virieu Berton, fils de Raymond Lombard Arthaud, fils de Guillaume Alaman Heliecon de Salsac Ayard de Maubec Henri, fils du seigneur de Châtillon Geoffroy, fils du seigneur de Clermont Gilles de Montchenu Odon, frère du seigneur de Tournon Guy, fils du défunt Ay. de Paladru Mathieu, fils de Jean de la Balme Pierre Mitte neveu de Ponce Mitte Boniface, fils de Jacquet de Seyssuel Guigues de Tourche Fellon Guigues de Daimaisin neveu de G. sacristain Hugues, fils de seigneur de Bressieu
82
Les statuts de 1385
Archives départementales de l'Isère. 2G/a. I In primis considerantes & attendentes quod onerosa multitudo nihil habet honestum, &
quia reditus & proventus dictae Viennensis Ecclesiae propter mortalites, sterilitates & guerras, quae in istis partibus diutissime viguerunt, & quorumdam malignorum occupationes sunt ad eo diminuti, quod consueto Canonicorum, Capellanorum, Clericorum & aliorum dictae Ecclesiae servitorum numero sufficere non valeret : Quin immo quod dolendum est, iam plures ex ipsis urgente nessecitate coacti sunt, sese a servitio ipsius Ecclesiae abdicare & alibi vitae necessaria procurare : Idcirco multa deliberatione praehabita, & inquisitione solerti, cogimur antiquum Canonicorum, Capellanorum, et aliorum servitorum memoratae Ecclesiae numerum moderare : cum nobis circa hoc diutius & deliberatius cogitantibus, modus alius non occurrat, per quem aliter posset circa haec commode provideri. Statuimus igitur & auctoritate Apostolica ordinamus quod in praedicta Viennensi Ecclesia, de caetero sit numerus vinginti Canonicorum, quadraginta Capellanorum, quorum decem sint ad servitium magni altaris, inclusis quator Subdiconorum de minori choro, decem & octo Clericorum, duodecim Clericulorum, & duorum militum seu Advocatorum dumtaxat. Nec recipiantur aliqui in dicta Ecclesia loco cedentium vel ducendentium, quousque Canonici, Capellani, Clerici, & alii servitores praedicti ad praetaxatos numeros redigantur.
II Item quia dignum est & rationi congruit, maioribus a minoribus honorem & reverentiam
exhiberi. Ideo statuimus & ordinamus quod praedicti Capellani, Diaconi & Subdiaconi, Clerici & Clericuli in choro & infra dictam Ecclesiam & civitatem Viennae, & ubilibet alibi, honorem debitum et reverentiam debitam et congruentem Decano dictae Ecclesiae et aliis dignitates, personatus in dicta Ecclesia obtinentibus, & singulis dictae Ecclesiae Canonicis praestare & exhibere & facere debeant & teneantur, prout in antiquis institutionibus & ordinario dictae Ecclesiae ad quas nos refferimus, dicitur plenius contineri.
III Item quia in iuramento quod quilibet Canonicus de novo receptus in dicta Ecclesia
praestat cavetur expresse, quod quicumque Canonicus de novo receptus sovat capam, seu indumenta titulo sibi per Capitulum assignato congruentia usque ad valorem sexaginta florenorum auri, aut refectorarium Capituli continentum reddat, Alioquin ad capitulares actus & ad perceptionem quarumcumque obventionum dictae Ecclesiae nullatenus admittatur : Iuramentum huiusmodi & formam ipsius in libris dictae Ecclesiae scriptam ad quam nos referimus approbando. Statuimus quod quilibet Canonicus dum de novo fuerit receptus solvat capam realiter si voluerit, aut vestimentum titulo sibi assignato conveniens usque ad valorem dictorum sexaginta florenorum auri, vel de dicta summa sexaginta florenorum auri, refecturarium praedictum contentum reddat. Sic tamen quod de dicta summa remissio nec praerogatio ulla fieri possit, & Canonicus donec soverit capam per modum praedictum, ad perceptionem aliquarum obventionum dicta Ecclesiae & ad capitulares actus non amittatur. Item & idem statuimus de Presbiteris dictae Ecclesiae ut secundum antiquam consuetudinem ipsius, scilicet dum assumuntur de inferiori choro ad superiorem chorum, pro capa solvant
83
eorum quilibet quatuor florenos auri, de quibus etiam nulla possit in solvendo remissio, nec temporis dilatio fieri sive dari.
IIII Item statuimus et ordinamus quod Capiscolus et Magister Chori qui nunc sunt & alii qui
pro tempore fuerint in sua creatione iurent et iurare teneantur super sancta Dei Evangelia, quod ipsi vel alter ipsorum per se vel per alium tradant, & tradere teneantur in scriptis refectuario nomina & cognomina omnium antiquorum incorporatorum & continuorum servitorum dictae Ecclesiae usque ad numerus sexaginta octo. Et hoc quolibet anno per octo dies ad minus ante festum beati Mauritii, & quod capiscolus per se vel alium debeat, & teneatur dicta nomina indicare in scriptis & affigere in ostio revestiarii dictae Ecclesiae, per octo dies ante vigilam festi beati Mauritii : ad finem quod dicti domini Decanus, & alii Canonici propter ignorantiam non se valeant excusare in praefentando, sed dictos servitores pro commensalibus suis in dicta vigila possint & valeant facilius praesentare, ut in sequenti articulo co(n)tinetur, & si quis alios quam de praedictis indicatis & assixis ut supra praesentaverit, pro non preasentante teneatur.
V Item quod omnes & singuli Canonici supradicti, qui tamen percipiunt & percipient in
futurum in donis, & grossis fructibus dictae Ecclesiae usque ad valorem quilibet viginti quatuor florenorum auri co(m)munis ponderis , praesentent & praesentare teneantur per se vel alium ac debeant hospitia sua & commensales suos certos & nominatos, videlicet tres de Collegio ipsius Ecclesiae de numero sexaginta in vigila festi beati Mauritii per totam diem annuatim, tunc finitis vesperis in choro dictae Ecclesiae refecturario seu Capitulo & Canonicis dictae Ecclesiae ibidem praesentibus, aliter non praesentans ipso facto sententiam excommunicationis incurrat, & nihilominus in crastinum festi beati Mauritii per totam diem, refecturarius qui fuerit pro tempore, & si non esset refecturarius preacentor dictae Ecclesiae, hospitia et commensales Canonicorum deficientium in praesentando ut supra dictum est praesentet, videlicet pro quolibet Canonico non praesentante tres commensales & semper de antiquioribus continuis servitoribus incoporatis dictae Ecclesiae fiant praesentationes, & talis seu tales Canonici non praesentantes lapso una mense a dicta die vigiliae beati Mauritii computando portionem & ratam dictorum viginti quatuor florenorum auri praedictam, dictis commensalibus praesentatis per dictos refecturarium, seu praecentorem solvere intergraliter teneantur, videlicet singulis mensibus tantum quantum ascendet quolibet mense de portione & rata ante dicta. Et nisi solverint, quod lapso dicto mense & octo diebus immediate sequentibus dictum mensem, dicta rata et portio de tempore praeterito duplicetur, & perdant vocem in Capitulo, & partendas sive divisiones si quae pervenerunt medio tempore nec ad illas admittantur : & ulterius sententiam excommunicationis incurrant ipso facto. Quae duplex portio & partenda Capitulo pertineat, nulla gracia vel remissione eidem Canonico facienda nec etiam profutura, & si de facto fieret nullius sit momenti, & nihilominus dicti tres commensales ut supra proxime per refecturarium vel praecentorem praesentati percipere debeant & habere vicesimam partem medietatis anniversariorum dictis Domini Canonicis pertinentis, ipsius medietatis oneribus primitus supportatis : ita tamen quod dicta portio solvatur quolibet mense pro rata dicti mensis commensalibus ante dictis, si vero talis seu tales non praesentantes solvere non curaverint ratam & portionem praedictam debitam cuilibet praesentato : sententiam excommunicationis quam incurrerant pro eo quod non praesentaverunt & non solverunt ut dictum est , per duos menses sustineant, & aggraventur per exequutores horum statutorum infra scriptos, seu per alterum ipsorum & denuncientur publice(m ?) excommunicati per curatum sanctae crucis in Ecclesia praedicta, quousque absolutionis beneficium de partis consensu, vel per realem solutionem seu depositionem
84
debiti pro quo fuerant excommunicati cum expensis & interesse inde sequutis merverint obtinere. Quae deposito si quam propter culpam partis absentis, vel debitum suum accipere nolentis fieri contingat, debeat fieri in manibus curati sanctae Crucis praedicti vel antiquioris quaternarii in quaternaria dictae Ecclesiae. Et pro onere dictorum sexaginta commensalium tenendorum per dictos Dominos Canonicos, ipsi Canonici percipere debeant, & habere medietatem omnium anniversariorum generalium quae supra petram antiquitus librabantur. Ita tamen quod Clericuli qui in dicta Ecclesia praecipue portant pondus diei & aestus, libram Clerici percipiant in dicta medietate dictorum anniersariorum libranda in choro, & nihilominus super alia medietate dictorum anniversariorum generalium dictis Canonicis pertinente, anno quolibet duos florenos auri dum tamen fuerint continui servitores quilibet ipsorum Clericulorum percipiat, & quod nullus ipsorum pro commensali praesentetur, aut aliter reputetur quouismodo : Et cum aliis oneribus inferius declaratis, & alia medietas eorumdem anniversariorum in choro libretur etiam cum oneribus inferius declaratis.
VI Item quia secundum statuta antiqua & consuetudines dictae Ecclesiae, nullus Canonicus
percipiebat in partendis dictae Ecclesiae, nisi hostelarius. Igitur statuimus & ordinamus, quod quicumque Canonicus etiam si nihil percipiat in donis seu partendis dictae Ecclesiae, si tamen voluerit esse seu reputari hostalarius, & percipere in partendis futuris, pro ut caeteri Canonici praesentet & praesentare teneatur suum hospitium, & commensales quolibet anno pro ut in statuto praecedenti latius continetur, alioquin deficientes seu deficiens in praesentando non reputentur hostalarii, & nihil percipiant in donis seu partendis dictae Ecclesiae vacaturis illo anno, vel aliis annis quibus defecerint in praesentando, & nihilominus alias poenas in praecedenti statuto contentas incurrant ipso facto.
VII Item statuimus quod quotiescumque mori contigerit aliquem de dictis incorporatis pro
commensalibus praesentatis quod ex tunc infra quindecim dies post mortem praedictam a die notitiae dicatae mortis continue numerandos Canonicus qui illum mortuum primo praesentaverat alium loco ipsius mortui de incorporatis praedictis praesentare per se vel per alium teneatur, dum tamen dictus commensalis in dicta Ecclesia reperiri possit. Aliquin pro hostalario minime reputetur, poenis nihilominus in antecedenti stauto contentis contra dictos Canonicos in suo robore totliter permansuris.
VIII Item statuimus, pronunciamus et declaramus quod si contigeret, quod numerus viginti
Canonicorum praetaxatus ut supra , non esset completus in Eccclesia aut si esset completus, et non essent hostalarii usque ad dictum numerum, eo quod non percipiant de dictis donis usque ad summam viginti quatuor Florenorum auri praedictorum, vel alia quacumque de causa : quod refecturarius qui est & qui fuerit pro tempore, solvat integraliter et perfecte tribus commensliabus pro quolibet Canonico deficente, vel non tenente hospitium : ratam et portionem sibi contingentem, videlicet viginti quatuor florenorum auri communis ponderis, pro quolibet Canonico hospitium non tenente , una cum vicesima parte medietatis anniversariorum deductis oneribus dictorum anniversariorum , et hoc de bonis et rebus infra scriptis, videlicet de pedis vacantibus et vacaturis, apud villam subtus Anjo, de padagio Viennensi quod est dicti Capituli de emolumentis molendinorum de quarto, & de censibus ac reditibus dicti Capituli & laudimiis & emolumentis omnium rerum praedictarum : quae bona Capituli & Canonici dictae Ecclesiae tradiderunt et tradunt refectutario, ex nunc pro ut ex tunc pro satisfactione commensalium dictorum Canonicorum deficientium in numero praedicto et aliorum hospitium non tenentium et ipsa bona et reditus et proventus eorum obligaverunt et
85
obligant et obligata esse consentiunt et volunt in perpetuum pro satisfactione dictorum vigniti quatruor Florenorum, pro singulis deficientibus de numero Canonicorum hospitium, & commensales non habentium nec tenentium ut supra, & refecturarius qui nunc est, & qui fuerit pro tempre praedicta facere & complere : in susa creatione iurare teneatur in praesentia duorum Capellarum maiorum dictae Ecclesiae si interesse volverint, quos in dicta refecturarii creatione dicti Domini Canonici vocare teneantur : & si contingeret quod die praedicta videlicet in crastinum festi beati Mauritii, quo die consueverunt Canonici dicate Ecclesiae Capitulum generale tenere non esset refecturarius creatus in dicta Ecclesia, vel die illa non crearetur, seu si creatus foret & praedicta facere nollet, vel onus tale in se suscipere recusaret : & praedictis commensalibus magistrum non habentibus, de octo Florenis pro quolibet ipsorum respondere per annum, vel eos contentos reddere nollet solvendo et dividendo pro quolibet mense pro rata, tunc in illo casu die praedicta, aut die immediate sequenti, primitus & ante omnia & antequam ad alia quaecumque negotia, seu actus capitulares procedatur Capitulum dictae Ecclesiae praefatis commensalibus magistrum non habentibus & erorum cuilibet assignare, & realiter tradere & expedire certa bona ex praedictis seu proventus et reditus, eorumdem ad aequivalentiam summae pecunie, dictis commensalibus pro illo anno debitae, vel per firmarios, seu arrendatores dictorum bonorum seu redituum eorumdem de dicta summa dictis commensalibus debita respondere, & in tuto et securo eos ponere et reducere teneatur, sic quod merito possint et debeant contentari, & ut per hoc nullam occasionem habeant divinum officium in dicta Ecclesia definendi, seu se ab illo quomodolibet abdicandi. Quod si Capitulum praedictis diebus ea quae supradicta sunt facere recusaret seu omitteret, vel longius tempus differret, de praedictis bonis sive eorum proventibus superius descriptis et obligatis, nihil omnino Capitulum seu singulares Canonici possint, ex quacumque emergente causa recipere, vel levare, donec & quousque dictos commensales magistrum non habentes, de rata cuilibet eorum debita persoluenda, per modos praedictos aut aliter, tutos redidreint et contentos : & hoc facto & non antea, residuum dictorum bonorum seu eorum redituum et proventuum quod restaret, detracta summa dictis commensalibus magistrum non habentibus pro quolibet anno debita, ad Capitulum pro sustentandis emergentibus oneribus pertineat et per ipsum Capitulum libere percipi valeat & levari. Si vero aliquis ex ipsis Canonicis dictae Ecclesiae, etiam dignitates et personatus obtinentibus in eadem in praemissis prout descripta sunt quo minus fierent & sortirentur effectum impedimentum, seu impedimenta praestaret, seu praestari procuraret directe, vel indirecte : bona praedicta vel partem eorum seu redituum et proventuum ipsorum capiendo vel occupando, per se vel per alium, aut aliter quomodolibet praedicta prout scripta sunt impediret, tunc ipso facto sententiam excommunicationis incurrat, a qua absolvi non possit nisi restitutione illorum quae recepisset realiter facta, & impedimento seu impedimentis per eum praestitis sublatis penitus et remotis, & damnum passis de damno et interesse primitus satisfactis. Statuimus nihilominus et ordianaumus quod si Capitulum dictae Ecclesiae vel singulares Canonici praemissa omnia prout supra scripta sunt non servarent, seu in aliquo contradicerent, quod ad illa obseruanda, tenanda et complenda ad simplicem quaerelam dictorum commensalium, & dictae Ecclesiae incorporatorum vel alterius ipsorum cuius interesset per exectuotres istorum statuorum inferius descriptos, seu eorum alterum summarie & de plano, & absque aliqua iudiciali forma & dilatione remota per censuram Ecclesiasticam, & per sententiarum aggeavationes & reaggravationes et aliis opportunis remediis cogi valeant, & compelli monitione tamen legitima et iuridica praecedente
IX Item statuimus et ordianamus, quod si et dum et quandocumque contigerit Capitulum
res et bona praedicta aut aliqua ex illis superius descripta et pro alimentandis dictis incoporatis Magistrum non habentibus per modum praedictum obligata, ad firamam seu
86
censam dare, seu arrendare : quod firmarii et arrendatores dictorum bonorum et rerum, seu aliquorum ex ipsis ad soluendum firmam conuentam in conuentis terminis se debeant submittere coercioni, compulsioni et iurisdictioni dictorum exequutorum huiusmodi statutorum, sic quod per censuram Ecclesiasticam, et alliis iurium remediis ad soluendum praemissa cogi et compelli possint per exequutores praedictos, vel alterum eorumdem, et quod firma et censa huiusmodi fiat cum onere, dictis commensalibus Magistrum non habentibus, de summa eisdemn per modum praedictum debita respondendi, ad quod onus dictis commensalibus solvendum expresse se debeant obligare. Alioquin firma seu censa huiusmodi viribus non subsistat.
X Item ut facilius numerus commensalium, Magistrum ut supra dictum est non habentium
sustentetur & eisdem in alimentis provideatur : auctoritate Apostolica supra dicta statuimus, quid si in praesenti sint in dicta Ecclesia Capellani, seu milites qui oneribus omnibus deductis percipiant de grossis fructibus, terris, siue donis dictae Ecclesiae usque ad valorem annuum viginti quatuor Florenorum, deductis oneribus pervenire, quod ab inde in antea pro commensali non reputentur, neque per aliquem ex Canonicis praesententur, nec ulterius alimentari debeant, cum debeat sibi sufficere illud quod percipiunt de dictis grossis fructibus sive donis : una cum librationibus fiue distributionibus in choro fiendis, prout in statutis huiusmodi declaratur. Si quod autem dubium suoer hoc emerserit, hoc est, an praedicti Capellani seu milites de grossis fructibus sive donis dictam summam viginti quatuor Florenorum oneribus deductis percipiant, an non : hoc ad examen exequutorum statutorum huiusmodi referatur, &quod per eos vel eorum aterum determinatum, vel iudicatum fuerit observetur, & ipsi vel eorum alter per censuram Ecclesiasticam, omni appellatione remota faciant inviolabiliter observari.
XI Item quia ab antiquo observatum est in Ecclesia Viennesi, quod Canonici hospicia et
commensales tenentes, possint si volverint hospitia sua dimittere, in festo Nativitatis S. Ioannis Baptistae, usque ad festul S. Mauritii. Idcirco statuimus et ordinamus quod rata & portio anniversariorum Dominorum Canonicum sic ut praemissum est dimittentium hospitia sua dicto mediante tempre quo dimittent sua hospitia dividantur : & solvantur commensalibus dictorum Canonicorum hospitium sic dimittentium, cuilbet aequaliter prorata sua.
XII Item statuimus quod de grossis fructibus donis et praeisiis quae propter mortem
Canonicorum dictae Ecclesiae, vel aliter quouismodo in divisionibus obuenire consuerunt fiant et fieri debeant viginti partes aequales iuxta numerum Canonicorum supra dictorum, quarum diuisionum singuli Canonici tenentes sua hospitia habeant partem suam iuxta morem solitum. Alii vero Canonici non tennetes hospitia nihil habeant. Sed pars et portio quam haberent et habere deberent si sua hospitia tenerent, aut etiam si numerus dictorum Canonicorum non esset completus, partes talium Canonicorum deficientum ad dictum Capitulum totaliter remaneant, pro suportando dumtaxat defectus talium Canonicorum non existentium, seu hospitia non tenentiumquouismodo, per praemissa non intendimus minuere ea quae spectant specialiter et spectare consueverunt ad quoscumque de praedictis Canonicis ratione dignitatis vel personatus seu officii eorumdem, quae obtinent in Ecclesia saepe dicta, nec eis circa ipsa in aliquo de rogare : imo ipsi in dignitate vel personatu aut officiis existentes percipiant ultra praedicta etiam milites et quatuor maiores Capellani ac coadiutores, & habeant prout proportionabiliter percipere soliti sunt et habere
87
XIII Item cum propter mortalitatum pestes quae hactenus diutius viguerunt, multae
mutationes tenementariorum et illorum qui tenentur ad census & servitia & reditus annos Ecclesiae & Capitulo Viennensi, factae sunt, propter quod feuda, iura census, & servitia praedicta posset ficiliter deperire. Ideo statuimus et ordianamus, quod omnes et singuli Canonici etiam in dicta Ecclesia dignitates personatus, & officia obtinentes, & quicumque alii de dicta Ecclesia qui perceperunt hactenus et percipiunt in diuisione terrarum et redituum dictae Ecclesiae : Infra unum annum a publicatione horum statutorum numerandum, faciant fieri recognitiones et terreria nova, de omnibus & singulis feudis reditibus, iuribus, censibus, seu servitiis debitis eisdem ratione divisionis terrarum et redituum dictae Ecclesiae, quas tenent et possident quilibet ipsorum Canonicorum et aliorum qui in terris et donis percipiunt in expensis eorum propriis & copiam sive transcriptum illarum recognitionum, siue terreriorum sic de novo factorum infra unum mensem dictum annum proxime sequuturum tradere teneantur in communi Capitulo dictae Ecclesiae, ut exinde unum terrerium siue liber recognitionum de novo fiat : qui liber sive terrerium ad futuram rei memoriam et observationem feudorum, iuium et redituum et censuum dicate ecclesiae in archiviis Capituli reponatur. Si quis vero canonicus aut alius dictae Ecclesiae, praemissa infra dictum tempus non fecerit, nec compleverit, media parte omnium redituum, censum seu servitiorum quae de terris & diuisionibus dictae Ecclesiae per annum recipit, lapis praedictis anno et mense, sit ipso facto pro illi anno priuatus. Quae media pars ad commune dicti Capituli pertineat et accrescat, ut ex inde per ipsum Capitulum lapso dicto anno infra sequentem annum : recognitiones siue terreria pro parte illorum qui ea facere fieri obmiserunt possint fieri & dictam mediam partem in hoc & non in usus alios decrevimus conuertandam & applcandam
XIV Item ex eadem ratione statuimus et ordinamus, quod per deputandos a Decano et
Capitulo et Colegiatis siue incoporatis dictae Ecclesiae infra dictum annul a publicatione & prout supra fiat terrerium siue liber recogntionum omnium anniversariorum communium, ad dictam Ecclesiam Vienneensem pertinentium ubicumque fuerint, & hoc in expensis de communi dictorum anniversariorum recipiendis, qui liber, seu quod terrerium pro conferuatione dictorum anniversariorum in archiuis Capituli reponatur.
XV Item statuimus quod si esset aliquis Canonicus nihil percipiens in grossis fructibus et
donis dictae Ecclesiae, vel saltem percipiens usque ad valorem octo Florenorum auri annuorum qui vellet tenere suum hospitium et reputari hosalarius prout Canonici hospitia sua tenent, pro eo casu dictum Capitulum de donis, & grossis fructibus quae ad manum suam tenet de diuisionibus, vel aliis rebus et bonis ipsius Capituli tradere & supplere debeat, & teneatur cuilibet tali Canonico suum hosptitium tener volenti, usque ad summam et valorem annum octo Florenorum auri, nisi ipsos ut supra perciperet, inclusis his quos percipierbat : Et casu quo hospitium incoeperit & ipsum dimiserit, aut aliter tenere noluerit, dicti octo Floreni auri sibi propter hoc per dictum Capitulum, vel supplementum ipsorum & omnia sibi data vel collata de dictis grossis fructibus a tempore dicti supplementi, exceptis fructibus consumptis ad dictum Capitulum pro ipsius Canonici supplendo deffunctu totaliter revertantur, & quod dicti octo Floreni vel eorum supplementum per Capitulum solvatur in duabus synodis aequaliter annuatim, donec in terra dictos octos Florenos percipiat ut superius est.
XVI Item quia ab antiqua consuetudine fuit obseruatum in dicta Ecclesia quod quicumque
Canonicus in civitate Viennensi residentiam personaliter faciens qualibet die unam libram in
88
distributionibus quotidianis, quae supram petram antiquitus librabantur perciperet. Statuimus quod ultra libram in choro communiter faciendam quae fieri debet de medietate anniversariorum ad hoc deputata, quilibet Canonicus commensales habens vel hostalarius reputatus, personaliter existens in choro in matutinis habeat & percipiat dimidiam libram, & in magna missa aliam dimidiam, & in vesperis aliam dimidaim et hoc super alia mediatate anniversariorum dictis Dominis Canonici pertinentium ut superius est dictum : Canonici vero commensales non habentes, vel hostalarii non reputati, etiam si in proximo dictis horis intersint, de dictis tribus mediis libris nihil percipiant, quoniam hoc statutum est,ut commensales tenentes, illos melius valeant sustinere.
XVII Item statuimus quod pro quibuscumque refusionibus per Dominum Decanum &
Capitulum vel singulares Canonicos dictae Ecclesiae debitis procuratoribus, seu censeriis anniversariorum generalium : portiones incorporatorum praesentatorum non subtrahantur, sed eisdem pleno iure persolvantur per dictos procuratores seu censerios : casu, tamen quo ipsi incoporati non esssent alimentati in mensa Dominorum suorum. Et ulterius quod quicumque Canonius vel incorporatus eiusdem Ecclesiae debes aliquid dictis Procuratoribus seu censeriis dictorum anniversriorum, nisis post lapsum terminum solutionis infra quindecim dies post requestam dictorum procuratorum a die dictae requisitionis continuem numerandos eisdem satisfecerit, ex tunc sententiam excommunicationis incurrat. Et si per octo dies dictam sententiam excommunicationis sustinuerit dictum debitum duplcetur, quae poena duplex Capitulo applicetur : nec debens illam absolui possit donec dictum debitum, & dicatm poenam duplicem realiter persolverit. Et dicti censerii, seu procuratores dictorum anniversariorum dictis Dominis Canonicis solvere non teneantur, nisi quolibet mense pro rata temporis.
XVIII Item quia ultra numerum sexaginta commensalium restant ad proudidendum octo
incorporati dictae Ecclesiae, de numero sexaginta octo superius ordinato. Ideo ordinamus et statuimus quod domus uticensis, cum suis iuribus et pertinentiis alimentare debeat et teneatur tres commensales, seu tradere & solvere cuilibet ipsorum octo florenos auri, prout caeteris aliis incoporatis et praesentatis per Canonicos solvuntur prout superius continentur. Et in dicto casu Dominus Decanus qui dictam domum tenet de praesenti, vel sui in dicta domo successores dictos tres commensales tenere volentes et alimentare in mensa, unam libram quotidianam, pro quolibet ipsorum commensalium percipiant et habeant super medietate anniversariorum generalium quae in choro liberatur, alioquin dicta libra ad dictos commensales, una cum dictis octo florenis auri pro quolibet totaliter reuertantur. Et ipsi commensales & quilibet ipsorum per se vel per alium celebrare debeant in Capella dictae domus semel in hebdomada, pro remedio animarum fundatorum dictae domus et benefactorum suorum, et pro qualibet missa obmissa substrahatur eisdem in poenam, unus grossus floreni. Et insuper ordianmus quod dicta domus cum suis iuribus et pertinentiis alicui Canonico, vel alteri cuicumque in partendis de caeteri non conferatur sed quicumque dictam domum cum suis iuribus, & pertinentiis in futurum habere & tenere voluerit : iurare & se obligare teneatur praedicta facere & totaliter ad impere, ipsamque domum cum suis pertinentiis manu tenere & in statu debito sustentare. Et quia dicta domus tempore quo fuit tradita dicto Domino Decano praesenti magnam & periculosam minabatur ruinam, propter quam ipse Dominus ordinamus quod dictus Dominus Decanus non treneantur tenere nisi duos commensales dumtaxat sub modo praedicto quamdiu dictam domum tenuerit.
XIX
89
Item quia Dominus Guillelmus Coindos quandam Canonicus dictae Ecclesiae Viennesis, in suo ultimo testamento ordinavit, quod quaedam domus sua sita infra claustrum Viennensis, quam nunc tenet Dominus Bartholomaeus de Brollio Presbyter dictae Ecclesiae, et quidam census seu reditus quos ipse Dominus Guillelmus habebat et tenebat apud Chaponnay quam nunc tenet Dominus Reynardus praepositi Presbyter Ecclesiae praedicatae onus duorum commensalium suppotare et cantur. Igitur ordianamus quod dicti Domani Bartholomaeus et Reynardus, ac eorum in dictis domo et censibus successores, duos commensales tenentes et alimentantes in mensa, unam libram quotidianam pro quolibet ipsorum commensalium percipiant et habeant super medietate anniversariorum generalium quae in choro libratur. Alioquin dicta libra una cum octo florensis auri, per quemlibet ipsorum Dominorum Bartholomaei et Reynardi et successorum suorum in dictis domo et censibus soluendis annuatim, ad dictos duos commensales pleno iure deuoluantur, et quod dicti duo commensales debeant et teneantur quilibet ipsorum per se vel per alium, qualibet hebdomada unam missam celebrare in Ecclesia Viennensi, pro remedio animae dicti Domini Guillelmi et benefactorum suorum, et ulterieu quod dicta domus et census alicui Canonici vel alteri cuicumque in partendis de caetero non conferantur, sed quicumque dictos census et domum habere et tenere voluerit iurare et se obligare teneatur praedicat facere et totliter adimplere, et nullum alius onus pro dictis domo et censibus dictae Ecclesiae solvere teneatur, nisi unum anniversarium dumtaxat quod facit dicta domus, et dictam domum tenere in statu condecenti. Ita tamen quod dicti Domini Bartholomaeus et Reynardus, et sui in dictis domo et censibus successores habeant electionem, praedicat onera solvere praedictis duobus commensalibus, vel eisdem dimittere praedictos domum et census pro oneribus supra dictis.
Item XX Item quia ad huc restant tres incorpotati de numero taxato ad providendm in alimentis :
idcirco ordinamus us quod ipsi tres et alii si qui sunt ultra numerum praedictum de praesenti qui praesentes et personaliter fuerint in tribus horis principalibus, videlicet in matutinis percipiant plusquam alii ibidem praesentes dimidam libram, & in magna missa aliam dimidiam libram, & in vesperis aliam dimidiam libram, de & super medietate anniversariorum in choro libranda, & hoc pro alimentis & victualibus eorumdem.
XXI Item statuimus et ordinamus quod quandocumque et quotiescumque aliquis Canonicus
dictae Ecclesiae cederet vel decederet, & nullus alius Canonicus nouus superveniret qui hospitium loco ipsius tenere vellet, & haeredes dicti Canonici praemortui fructus ipsius Canonici post eius mortem, iuxta & secundum morem Ecclesiae percipere vellent, quod ipsi haeredes providere teneantut tribus commensalibus per dictum Canonicum praenonminatum praesentatis, usque ad subsequens festum Beati Mauritii alioquin dictum capitulum dictos fructus percipiat, ac etiam si dictus Canonicus non perciperet in donis & grossis fructibus usque ad summam valentem viginti quatuor Florenos auri, & eisdem prouideat iuxta et secundum formam superius annotatam
XXII Item statiumus et ordinamus quod quatuor Cappellaniae vulgariter dictae maiores vel
quaternariae, cum vacabunt Capllanis de Collegio de idoneioribus & non aliis conferantur, super quo decani et Canonicorum conscientias onereramus : & cum Capellas, seu alteria ad collationem seu dipositionem capituli spectantis vacare contigerit, quod illi de Collegio qui melius servierint et magis idoneri videbuntur ad eas vel ad ea per Capitulum assumantur. Alii vero qui qui sint ad quos praesentatio vel collatio Capellanarium in dicta Ecclesia existentium
90
pertinebit, etiam idoneum et bene seruientem Decano & Capitullo, vel Capitulo absente Decano praesentatis seu idoneo et bene servienti de eis studeant prouidere, alioquin praesentati seu provisi nisi sufficientes fuerint, nulatenus per Capitulum admittantur.
XXIII Item statuimus et ordinamus quod dicate Capellaniae nulli nisi vicesimum aetatis annum
attigerit conferantur, & quod illi quibus ipsas conferri contigerit in receptione sua personaliter si sint praesentes, alioquin per procuatores praestent in forma consueta solita iuramenta coram Dominis Decano & Capitulo quanto citius et comode poterit fieri, & specialiter de servandis iuribus Capelliniarum sibi collatarum, & alienatis pro viribus revocandis, & quod se facient ad sacros ordines saltem Subdiaconatum promoveri infra annum, a temopre adeptae possessionis pacificae hujusmodi Capellaniae, vel quod per ipsum steterit, quominus sit adeptus : & postquam attigerit vicesimum quintum annum infra ipsum annum se faciet ad sacerdiotum promoveri, & interim per alium iodoneum sacerdotem dictae Ecclesiae Dominis de Capitulo praesentandum, faciat in dicta Capella laudabiliter deservire, aliquo praemissorum defecerit, sciat se ipsa Capellania lapso anno huiusmodi fore privatum : per hoc tamen non intendimus, oridinationibus factis vel faciendis per fundatorem Capellaniarum ipsarum in aliquo derogare.
XXIV Item statuimus et sub poena excommunicationis praecipimus quod quilibet altariensis
seu Capellanus dictae Ecclesiae infra unum mensem a tempore publicationis praesentium statuorum valorem redituum sua Capellaniae & in quibus consistunt notificet, et tradat in scriptis Capitulo seu ad hoc per Capitulum deputatis, quae sic tradita et notificata redigantur in libro aliquo in archivis dictae Ecclesiae conservanda, & ista fiant ad finem quod dictum Capitulum possit & valeat moderare pro ut sibi videbitur onera seu servitia dictarum Capellaniarum iuxta & secundum valorem earumdem. Et quod quilibet Capellanus celebret vel per alium faciat celebrare missas ad quas celebrandas ex fundatione suae Capellaniae, vel aliter ex ordinatione Capituli tenetur, quod si non faceret, duodecim denorios monetae librabilis sovat pro qualibet missa obmissa post moderationem per dictum Capitulum faciendam, qui duodecim denarii fabricae dictae Ecclesiae applicentur, & nihilominus dictas missas obmissas redere teneatur : & nisi dictus deficiens infra octos dies post dictum deffectum immediate sequentes dictos duodecim denarios solverit, ex tunc immediate dupplicentur, & nisi infra alios octo dies immediate sequentes dictos duos solidos solverit, et missas obmissas per se vel per alium reddiderit, ex tunc immediate sententiam excommunicationis incurrat, a qua non valeat absolvi, nisi satisfactionne praemissorum totaliter praecetente, non tamen intendimus quod dicta poena duodecim denariorum pro qualibet missa obmissa apprehendat vel arctet illos qui ordinati sunt ad serviendum in magno altari Capellas in Ecclesia habentes, dum & quando ex suo ordine missas in magno altari celebrabunt. Nolumus tamen quod dicta poena illos arctet qui ex ordinatione fundatorum majorem poenam incurrere possint, nisi in tantum quod poenam pecuniariam appositam per fundatores, solvant rectores earumdem infra octo dies post deffectum, alioquin excommunicationis sentenciam incurrant, salva semper meliori provisione, si Dominis Decano et Capitulo circa hoc in futurum videatur facienda, nullus autem missam celebrare audeat infra Ecclesiam Viennensem nisi fuerit in matudinis eiusdem diei, aut a Capitulo licentiam super hoc habuerit specialem, quam licenciam concedere possint Canonici qui illa die praesentes fuerint in matutinis. Et si unus tantum Canonicus praesens fuerit, ille dictam licentiam concedere possit.
XXV
91
Item cum nullus illegitimus debeat ad Ecclesiasticos honores assumi, Statuimus et ordinamus quod capiscolus dictae Ecclesiae, aliquem Clericulum non creet vel introducat in ipsa Ecclesia, nisi de legitimo matrimonio procreatum, et qui sciat legere et cantare et commune feriale ac sanctorum corde tenus : nec etiam Decanus Clericum, nisi sit legitimus , et illud idem sciat vel saltem construere et latinum intelligere, et hoc nisi super insufficientia literaturae per Decanum et Capitulum fuerit dispensatum, vel per capitulum Decano absentes : nec introducat aliquis ipsorum quem quam in ipsa Ecclesia, nisi cum aliquis defecerit de numero superius limitato : alioquin receptio ultra numerus nulla sit ipso jure, praecaveant etiam ipsi Decanus et capiscolus quod recepiendi per ipsos habeant tam de librationibus quam aliter unde possint honorifice sustentari, ni ipsorum aliquem oporteat in opprobrium Ecclesiae mendicare.
XXVI Item statuimus et ordinamus quod nullus qui in aliqua religione profesionem
fecerit vel expressam, de caetero recipiatur in Collegio Ecclesiae Viennensis praedictae, nihil per hoc contra Canonicos SS Martini et Petri inter vineas infra civitatem Viennensem vel in eorum prejudicium volomus innovari.
XXVII Item statuimus et ordinamus quod recipiendi Presbyterri vel Clerici in dicta Ecclesia
quando recipienentur, & iam recepeti : infra mensem a publicationem horum statutorum continue numerandum, iurent per modum qui sequitur corram Domino Decano si praesens fuerit : alioquin coram Domini praecentore seu Cantores vel eorum altero gradatim si praesens fuerit : alioquin coram antiquiore Canonico dictae Ecclessiae et ponat in papiro seu registri Capituli cum annotatione testum ad perpetuam memoriam. Forma autem intamenti talis est.
Ego iuro ad tancta Del Evangelia, esse ex nunc in antea fidelis & obediens Ecclesiae Viennensi, Decano et Capitulo Eccclesiae Viennensis et seruabo bonos usus et consuetudines Ecclesie & statuta ipsius edicta vel edenda, rationabilia, licita et honesta et iura Ecclesiae pro posse meo servabo et deffenda et utilitatem Ecclesiae et Capituli procurabo, ac damnum etiam Canonicorum euitabo, non ero in consilio, auxilio, consensu, vel facto, ut aliquis dictorum Decani, vel de Capitulo vitam perdant, aut membrum, aut capiantur mala captione, nec faciam, vel inhibo aliquo tempore, publicem, vel occulte cum aliquibus personis, maxime dictae Ecclesiae, creandis vel creatus, contra praedictos aliquam societatem illicitiem, ligam, vel conuenticulum, confederationem, conspirationem, seu coniuratione : consilium quod mihi perse, vel per literas, aut nuntium, vel aliter manifestabunt, ad eorum damnum scienter nemini pandam : si vero ad mei notitiam aliquis devenire contigerit , quod in periculum dictorum Decani Canonicorum, Capituli, aut Ecclesiae Viennensis vergeret, seu graue damnum, illud pro posse impediam, & si impedire non possim, procurabo bona fide ad ipsorum notitiam perferri : & si convincar contrarium praemissorum, vel alicuius ex praemissis, quod absit fecisse, ipso facto volo esse a choro, ac omnibus librationibus dictae Ecclessiae et libra priuatus. Et simile intramentum et obedientiam debeant facere et praestare Meynerii et familiares Ecclesiae creandi, & si contra venerint Meynerii Ecclesia sint priuati.
XXVIII Item statuimus et ordinamus quod praefatio Apostolorum de caetero dicatur ia festo
Apostolorum praeter quam in festi Beati Ioannis Euangelistae in quo dicitur praefatio Nativitatis Domini. In festi Apostolorum Phillippi et Icaobi et Ioannis ante portal Latinam poterit dicti praefatio resurectionis.
XXIX
92
Item statuimus et ordinamus quod de caetero magnum altare in Ecclesia Viennensi praesata non paretur nec ornetur de Capite beati Mauritii et aliis reliquiis et iocalibus nisi dumtaxat in diebus sequentibus & vigilis praecedentibus prout est consuetum, videlicet in diebus Natalis Domini, Epiphaniae, Paschae, Ascensionis Domini, Pentecostes, Eucharistiae, seu Corporis Christi , S. Ioannis Baptistae, Annunciationis B. Mariae quando sit post Pascha, Purificacionis, Assumptionis et Nativitatis eiusdem B. Mariae, B. mauriti patroni Viennensis ecclesiae, ac reuelationis eiusdem, ac festi omnum Sanctorum, vel in adventu alicuius principis vel praelati cui processionaliter esset excundum, & quod non obstante restrictione praedicta de paramentis seu ornamentis dicti magni altaris quo ad reliquias & localia dumtaxat ponantur panni aurei. Illuminentur cerci et cantetur, pulsetur et officietur et obseruetur quo ad caetera soleniter prout hactenus extitit fieri consuetum, & prout ante in festis solemnibus fiebat, hoc etiam addito quod a festo omnium Sanctorum usque ad Pascha, non teneatur quis se radi facere si locus advenerit infra quindecim dies a die praecedente rasurae, & a dicto festo Paschae, usque ad dictum festum omnium Sanctorum, infra decem dies, & a die praecedente rasurae continue numeranandos.
XXX Item statuimus quod si aliquis Canonicus vel alius Collegiatus de caetero defectum
faciat in Missis, Evangeliis, Epistolis, Lectionibus, Responsoriis, vel aliis sibi iniunctis seu incumbentibus, quod propter defectum ipsius nullus de choro exeat, vel ipsum chorum intret qui aliter intrare non posset si deffectus non fieret, praeter quam in matutinis dierum novem lectionum in quibus quis intrare possit, sed libram non recipiat pro eo, quia illam perdiderat, ex quo aliter intrare non poterat.
XXXI Item quod in casu quo per Canonicum, Presbyterum vel Clericum, forsam fieret in
officando defectus : ad praeceptum seu mandatum Decani, Praecentoris, Cantoris, Capiscoli, seu antiquioris vel dignioris Canonici praesentium vel officiantium in ipsa Ecclesia alius de Collegio teneatur: alioquin consimilem poenam committat, contra defectus facientes inferius ordiantam, videlicet si fit Presbyter qui recuset facere Officium Canonici sibi iniunctum, solvat decem octodenarios : si fit Diaconus, Subdiaconus Clericus solvat poenam Clerici, hoc est duodecim denarios tantum.
XXXII Item ut ipsi Canonici , Presbyteri vel Clerici a defectibus huismodi abstineant,
Statuimus quod facientes deffectum huismodi si fit Canonicus duos solidos monere librabilis, Presbyter vero decem et octo denarios, Clerricus duodecim denarios eiusdem moneate pro quolibet deffecto persolvat : quorum medietatem habeat supplens defectum huismodi, alterius vero mediatatis mediam partem habeat ipsarum poenarum laeuator per Decanum & Capitumum deputandus, alia vero ipsius medietatis medietas fabricae assignetur, & casu quo dictus defectus per aliquem non suppleretur medietas dictae poenae dicto levatori et alia medietas dictae fabricae totaliter applicetur, & ut defectus huiusmodi facilius corrigantur, volumus et ordianamus quod ipse levator dictarum poenarum per Decanum et Capiotulum ordinandus singulis diebus in missi et matutini, vespersi et allis horis defectus ipsos notare et scribere debeat quodq; diebus singulis sabatinis hora primae in Capitulo si sit Capitulum : alioquin coram Decano, praecentore, cantore vel capiscolo, vel locum te tenente eorumdem seu altero ipsorum gradatim defectus huiusmodi in tota septimana comissi recitentur in scriptis ut fideliter levari valeant poenae superius designatae et si ille defectus faciens dictam poenam infra octo dies post commissionem dicti defecetus non solverit, etiam fine aliqua interpellatione, dictam poenam duplicetur, & nisi infra alios octo dies immediate sequentes
93
dictam poenam cum dupla solverit, ex tunc sententiam excommunicationis incurrat ipso facto, et exommunicatus in choro & processione singulis diebus per curatum dictae Ecclesiae publicem nuntuetur, & per aliquem absolvit aut relaxari non valeat nisi prius & omnino satisfecerit de praedictis, nulla remissione etiam sibi pro futura: cuius dupli quarta pars levatori poenarum ut praemissum est deputato, et aliae tres partes fabricae Ecclesiae dicatae applicentur.
XXXIII Item statuimus quod praecentor et cantor praesate Ecclesie officia ipsuis et eorum
cuilibet incumbentia iuxta morem dictae Ecclessiae faciant, vel officient in eadem per se vel idoneum Canonicum, diebus quibus altare erit paratum si tamen Canonicus in civitate fuerit : sin autem , per unum de militibus vel quaternariis dictae Ecclesiae et aliis temporibus per idoneum Capellanum dictae Ecclesiae, prout fuit hactenus in dicta Ecclesia observatum, et sub poenis in statuto supra in secundo proximo declaratis.
XXXIV Item cum Capiscolus ex officio suo habeat Ecclesiam et diuina officia tam nocturna
quam diurna frequentare et chorum regere, defectus que cantus corrigere. Statuimus et ordinamus quod Capiscolus qui nunc est, & qui pro tempore fuerit, recordationes faciat per se vel per alium Canonicorum sufficientem vel idoneum sacerdotem diebus omnibus sabbatinis et aliis festiuitatum vigilliis consuetis dum pulsabitur pro vesperis : & ibi omnes Clerici de inferiori Choro conueniant et responsorio reddant corde tenus et decantent, et si in veniendo et comparendo fuerit aliquis dictorum Clericorum negligens vel rebellis, vel responsoria reddere et cantate nesciuerit, per dictum Capiscolum palam disciplinetur, pro ut in ipsa Ecclesia est ab antiquo fieri consuetum et si quod absit idem Capiscolus recordationes huismodi pro ut fertur non fecerit , pro qualibet die qua hoc facere obmiserit, duos solidos monetae librabilis persolvat fabricae Ecclesiae apllicandos et idem facere debeat Magister Chori de Clericulis, et sub poena simili, fabricae similiter applicanda, quas poenas soluere teneantur infra terminos supra in statuto contentos item ut ipsi Canonici : alioquin poenas ibidem contentas incurrant ipso facto, & contra eosdem observantur prout in eodem continetur.
XXXV Item statuimus et ordinamus quod dicti Presbyteri, Diaconi et Subdiaconi hebdomadas
Canonicorum facere tentantur, ad requisitionem ipsorum pro salario, videlicet pro hebdomada Presbyteri quindecim grossis, pro hebdomada Subdiaconi septem grossis et Diaconi quinque grossis dicti vero canonici summas pecuniarum pecuniarum praedicats teneantur offerre & deponere in choro hora primae sabbato suam hebdomadam praecedente, quas recipiet si voluerit locum primum obtinens post ipsum in choro, alioquin obtinens secundum ; et sic de caeteris usque ad ultimum. Volumus tamen et ordianamus quod in festis duplicibus Canonici personaliter serviant ut tenentur, et si contigat quod per praedicatos qui faciunt hebdomadas seu officia Canonicorum in officiando fieret deffectus per eos ; si sit Presbyter, poenam decem octo denariotori pro quolibet defectu incurrat : Si diaconus, Subdiaconus, vel Clericus, pro quolibet deffectu duodecim denarios monetae praedicate librabilis.
XXXVI Item statuimus et ordinamus quod nullus Canonicus, Presbyter, seu Clericus dicatae
Ecclesiae vel quicumque alter de Collegio, de caetero audeat cessare seu cessari facere ab officiando aut aliter de Collegio, de caetero audeat cessare seu cessari facere ab officando aut
94
aliter vocem suam fraudulenter subtrahere pro debito seu deverio quo praetendit sibi deberi ratione vel causa dictae Ecclesiae ab aliqua persona de eadem Ecclesia, Capitulo vel Collegio : alioquin in contrarium faciens sit ipso facto excommunicationis sentencia innodatus, debens autem etiam si Capitulum debuerit nisi solvat infra octo dies a die termini solutionis faciendae vel ubi non esset certus terminus a die requisitionis comptutandos, solvat duplum infra quindecim dies ex tunc sequentes, quod duplum communi Capituli applicetur, quod si non fecerit ex tune excommunicationis sententiam incurrat ipso facto, aqua nisi praemissa satisfactione nullatenus absolvatur, si vero Capitulum debuerit & infra octo dies a die termini solutionis faciendae vel ubi non esset terminus praefixus ad solvendum a die requisitionis computandos non solverit, tunc lapsis dictis octo diebus ipso facto sententiam supensionis a diuinis incurrat, aqua non absoluatur nisi satisfactione praemissa ut supra.
XXXVII Item statuimus et ordianamus quod Decanus et Capiscolus per se vel per alium
Canonicum in eadem Ecclesia, officium suum quod tangit Vicariatum seu exercitium iuridictionis vel correctionis, aliud vero quod tangit officium diuinum, per Capellanum idoneum ut consuetum est fieri continue : nec non sacrista per se vel per Capellanum seu Clericum idoneum : Magister vero chori per Cappellanum dictae Ecclesiae etiam continue facere teneantur, quodque unus ex dictis Canonicis, Capellanis vel Clericis ad officium duorum supplendum nullatenus admittatur, alioquin ipsorum Decani, Sacristae, Capiscoli, et Magistri Chori quilibet, pro temporibus quibus ut praemittitur non feruiet, solvat pro prima hebdomada qua defecerit unum florenum, pro secunda duos, pro tertia tres, pro quarta quatuor florens auri , & sic deinceps per hebdomadas quibus continue defecerit, poenas multiplicando usque ad quantitatem quam recipiunt ratione Canonicatus et praebendae, dignitatis seu officii suorum, vel aliter quouismodo in ecclesia memorata, cuius poenae medietas supporatandis oneribus Capituli et alia medietas distributionibus Chori aplicentur, et retineatur dicta quantitas de quibuscumque librationibus vel aliis quae ipsis assignari debebunt, et si ipsi contumaciter restiterint ipso facto sint excommunicationis sententis innodati a qua absolui non valeant misi de dicta poena plenarie satisfacto, per hoc etiam non adimantur, praedicti Decanus, Capiscolus, Sacrista, et Magister Chori a residentia in horis & alii statutorum Capitulis ordinata.
XXXVIII Item statuimus quod nullus Canonicus, Presbyter aut Clericos teneat concubianm fiue
socariam, quodque quisque incedat in veste non notabiliter breui, sed honesta et decenti nec de super more laycorum succinctus et etiam non incedat per civitatem Viennensis nisi tonsus in capite et barba, iuxta morem Ecclesiae laudabilem hactenus observatum, qui vero concubinam seu socariam tenebit ipso facto excommunicationis sententia existat innodatus, & si per mensem in huiusmodi perseueret et concubinatu ex tunc ad requestam procuatoris fiscalis dicti Capituli, per curatum dicate Ecclesiar nominatum excommunicatus publicem nuntietur & ad arbitrum iudicis Decani et Capituli ultra excommunicationem vel publcationem in huisumodi peccato puniatur, nullo appelationis, aut alterius provocationis vel remedii iuuamine sibi suffragante, qui vero vestes in honetas breues notabiliter, & indecentes portabit publicem per dicatm civitatem Viennensem & succintus supra nec ut praemittitur tonsus incedat, choro, mensa et distributionibus ac fructibus et emolumentis quibuscumque quod ex eadem Ecclesai habet percipere sit ipso iure priuatus, donec vestes et succinturas praedictas dimiserit cum effectu et se tondi fecerit ut supra : qui fructus, libra, et emolumenta supportandis oneribus Capituli applicentur.
95
XXXIX Item Statuimus et ordinamus quod ex nunc cessent abusus qui fieri consueuerunt per
Abbatem vulgariter vocatum stultorum seu sociorum, sed quod ad illium qui ex Presbyteris et Clericis idoneus et sufficiens ad hoc fuerit electus, per Capelleanos et Clericos vel maiorem partem et senirem spectet exercitium iuridictionis dictis Abbatis & omni aspectent ad ipsum quae spectarunt hactenus ad Abbatem praedictum, sic tamen quod ubi ad Abbatem, Decanum, et Capitulum seu iudicem eorum aliquiis recurreret per simplicem querelam vel appellationem, quos praedicti decanus et Capitulum seu eorum iudex huiusmosi causam ad se evocare possint et statim inhibere et iusticiam ministrare : per hoc tamen non excludimus quoniam Clericus tamquam magis idoneus et sufficentior concorditer per praedictos eligatur, si talis in Ecclesia reperiatur.
XL Item statuilus et ordianamus : cum in Ecclesia Dei non decent fieri ludibria vel
inhonesta commiti, quod in festis Sanctorum Stephani, Ioannis Evangelistae, Innocentium et Epiphaniae Domini de caetero officietur et deferuiatur in diuinis pro ut in aliis diebus infra fieri statuetur, & quod nullus de caetero ut quando que factum fuisseaudivimus portetur in rost, & quod de nulla persona Ecclesastica ea vel seculari cuiuscumque ; status existat, inhonesti vel diffamatorii richmi recitentur et quod nullus pignoretaut aliena rapiat quouismodo : alioqui praemissa facientes ipso facto sententiam excommunicationis incurrant, a qua absolui non valeant nisi damnificato vel iniurato prius emandam fecerint competentem. ¨Per hoc tamen prohibere nolumus quin Diaconi de choro inferiori in S. Stephani, Presbyteri in S. Ioannis, Clericuli in Innocentium festis praedictis cum almuciis et in choro superiori, dummodo aliter honeste, officiare valeant, pro ut est hactenus fieri consuetum : hoc tamen statutum annis singulis in vigilia Nativitatis Dominicae publice legi volumus in Ecclesia saepe dicta, ne quis praetextu ignorantiae se valeat excusare
XLI Item statuimus et ordinamus quod in festo Circumcisionis Domini officietur honeste et
de quod nullius portetur in rost seu pignoretur, aut aliter quomodoibet in iurietur, sed omnes de Ecclesia, etiam de officiarii laci existentes in civitate Viennensi, venire teneantur in primis velpetis, in matutinis, magna missa et secundis vesperis dicate diei, & ibidem deservire in divinis, iuxta et secundum eorum scientiae qualitatem, & quod quicumque deficiens praemissis, exceptis Clericulis, pro qualibet dictarum horarum in qua deficent, solvat duos solidos monete librabilis quos nisi solverit infra octo dies post dictam diem duplicentur et nisi infra alios octo dies poenam cum dupla solverit, ex tunc sententiam excommunicationis incurrat ipso facto aqua nulla tenus absolvi vel relaxari valeat nisi prius omni moda praemissorum satisfactione subsecuta, quarum poena et dupli quarta pars levatori earum dem tribuatur residuum vero interessentibus in horis cum aliis librationibus totaliter appliectur et quod in dictis festis Sanctorum Stephani, Ioannis Evangelistae, Innoncentium, Circumcisisonis et Epiphanae Domini, quando non erit qui velit esserex inscribantur in breui pro dicendis lectionibus et responsoriis pro ut in aliis festivitatibus est fieri confuetum, et per illlos qui debent dare et inscribere alio tempore.
XLII Item statuimus et ordinamus et sub poena excommunicationis praecipimus, quod nullus
Collegiatus ipsius Ecclesiae Celebrando missam vel alta divina officia, audeat dicere vel legere maledictionis speciales et generales quae consueverunt dici contra iniuriantes Ecclesaiam et oppressores ipsuis etiam contra esos quos diceret vel credeter specialiter fore
96
dictae Ecclesiae inimicos nisi a Domini Decano et Capitulo haberet super hoc speciale mandatum.
XLIII Item statuimus quod omnes illi qui intererunt in matuitinis novem lectionum non exeant
ante septimam lectionem et aliis diebus trium lectionum ante tertiam lectionem nisi iusta causa subesset, & tunc de licentia petita a Decano, Praecentore, Cantore, Capiscolo seu Canonico antiquiore praesente, vel eorum altero gradatim si sit praesens super hoc et obtenta, alioquin predictis absentibus a digniore officiante praesente, qui vero aliter exierit reuerti non posssit, sed horae illius libram perdat, qui antem modo debito exierit tenetur reverit ante, Te deum et quando non erit Te Deum, infra quintum versum, de, Dominum regnavit, vel Miserere mei : et ad tollendum malum et in ordinatum exitum et abusum exeundi a choro solitum fieri in Ecclesia Viennesi dum missa dicitur et alia divina officia celebrantur : Ordinamus quod illi qui fuerint in magna missa exire non possint Chorum donec missa sit completa, nisi modo praedicta sub poena praedicta , scilicet ex iusta causa, petita licentia et obtenta, et qui aliter exierit non revertatur et perdat libram suam : illi vero qui fuerint in vesperis exire non possint Chorum nisi modo praedicto, et poenus qui fuerint in vesperis exite non possint Chorum nisi modo praedicto et poeius praecitis, usque quo comemoratio Sancti Mauritii completa fuerit et tunc et quandocumque exire contigerit Chorum, dum divina officia celebrantur ibidem, non exeant similiter omnes et impetuosem, sed bini et bini cum modestia et honestate sine strepitu, sic quod dum duo primi exire voluerint, alii volentes exire non se moveant de locis suis donec qui primo inceperant exire, tranfierint portas Chori, & sic de aliis exire volentibus successive. Si qui vero contra modum et formam praedictos, hoc est non petita licentia et non obtenta et modo exeundi praedicto non seruato chorum dictae Ecclesiae dum ut praemissum est divinia celebrantur, vel dicuntur ibidem exierit, sit ipso facto quod ex sui notorietate pater poterit, a perceptione omnium distributionum sive librationum quae in singulis horis fient in choro dictae Ecclesiae per totam diem illam qua hoc contigerit et duos dies immediatem sequentes privatus, & nihil in dicta Ecclesia percipiat, etiam si personnaliter inter fuerit induimis, quarum librationum medietas fabricae dictae Ecclesiae, & alia medietas librationibus omnibus applicetur : & ulterius quod nemo possit interesse in processione mortuorum nisi de choro exeat cum dicta processione et in regressu non possit recedere a dicta processione donec chorum intraverit cum eadum : in aliis vero processionibus dum itur per civitatem nullus intret processionem, nec exeat processione, processione ipsa per civitatem publicem procedente, possit intrare tamen processionem dum deuventum fuerit ad Ecclesiam, vel Ecclesias in quibus consueuerunt fieri stationes : volumus etiam quod quandocumque contigerit tertiam, meridiem, vel nonam, horas celebrare ante magnam missam, & in aliqua ipsarum contigerit fieri deffectum quod omnes illi ex quorum choro fiat dictus deffetus libram perdant in magna missa et si ex parte utriusque chori fieret deffectus : omnes libram perdant cuiuscumque status vel conditionis existant exceptis illis qui praesentes fuerint in choro, & per quos non contigerit deffectus, quarum librarum medietas fabricae et alia mediatate librationibus dictae Ecclesiae tribuatur, ut supra.
XLIV Item statuimus et ordianamus quod in processione et benedictione aquae in diebus
Dominicis omnes tam Canonici quam etiam incoporati dictae Ecclesia qui erunt in civitate tenentur venire & personliter interesse saltem dum dicitur Miserere mei, & quod intrent modo consueto, sic tamen quod nullos possit dictam processionem intrare nisi de chro exierit cum eadem, nec de dicta processione exire donec processia in chorum fuerit reversa et cuilibet interessenti dum dicetur Antiphona. Salue Regina, si fit de superiori choro litentur duo denarii, et de inferiori choro unius denarius moneta librabilis de rebus inferius declaratis
97
XLV Item statuimus et ordinamus quod ille qui consuevit dicere et scribere brevem qualibet
die Sabbatti inscribat tres de Collegiatis de superiri choro, et unum ex Canonici dicate Ecclesiae, de quibus est solitum quod in brevi scribantur per circulum et gradatim. Ita quod omnes per ordinatum apprehendat qui per totam septimanam sequentem teneantur interesse, per se vel per alium idoneum qualibet die illius septimane in hora primae, et in officio mortuorum quando secumdum consuetudinem dictae Ecclesie est dicendum sive dicatur ante prandium vel post, et in hora Nonae : quibus singulis diebus pro hora Primae debeant librati et dari cuilibet duo denarii monetae librabilis et in officio mortuorum et hora Nonae quando nona dicitur post prandium alii duo denarii dictae monetae, et quando fiet de Mortuis officium novem lectionum, inscrinbantur in brevi tres de inferiori choro dictae Ecclesiae pro tribus lectionibus dicendis, quando vero dicuntur solum tres lectiones de mortuis unus de inferiori et alius de superiori choro inscribantur pro una lectione dicenda et cuilibet per modum per dictam lectiones legenti dentur duo denarii si fit de superiori choro, si vero de inferiori unus denarius dictae monerae, sive fiat officium mortuorum in matutinis sive post prandium iuxta consuetudinem dictae Ecclesiae in hoc hactenus consuetam, excepto quod a Dominica Carnisprinii ulterius suque ad octavas Pasche nihil debet librari supra dictis, quia tunc datur in refectorio potatio ad quam venire omnes tenentur : sit tamen quod nullus in dictis potationibus admittatur dum fuerit nisi praesens fuerit et resederit in officio mortuorum.
XLVI Item statuimus quod si contingeret de dicta Ecclesia Viennesi cuiuscumque dignitatis
status aut conditionis fuerit fraudulenter, et contra mentem et tenorem statutorum huiusmodi et ordinationum intrando chorum dum dicuntur divina, vel aliter libram que sibi secundum statuta vel ordinationes huiusmodi non debebantur recipiendo, et illiam sic fraudulenter ut dicitus saepius contigisse receperit, ipso facto sententiam excommunicationis incurrat, et nihil omninus libram sicut faudulenter receptam libratori a quo recepit restitutere teneatur, nulla super hoc remissione sianda.
XLVII Item statuimus et ordinamus quod medietas aniversariorum in choro libranda
distribuatur singulis diebus in hunc modum, videlicet dimidia libratio in matutinis, alia dimidia in magna missa, allia dimidia in Vesperis : si quid vero residuum fuerit, illud interesnentibus in hora Primae et Processione Dominicali et officio mortuorum et horae Nonae per modum in praecedenti articulo dictum distribuatur una cum allis ad hoc applicandis : Et ut laudabilis et sine defectu dictis horis primae et officio mortuorum, et nonae et processioni dominicali deserviatur. Statuimus et ordinamus quod ad librationem fieri dam in dictis horiis pertineant, ex nunc in antea omnia obvenientia vertuorum sive hastes et omnia pertinentia partius anniversariis quae tamen non sunt ordinataper reliquentes ad librationes distinctas, ac etiam reditus dominorum Hugonis de Capella qui sunt ultra Rodanum et Andreae de opere qui sunt citra Rodanum alias dati et legati per eosdem, finito tamen accensamento facto dominis Bartholomeo de Brollio, et Reynardo propositi, de censibus domini Hugonis de Capella Praedicti.
XLVIII Item statuimus et oridinamus quod in exequiis decedentium consideratis et attentis
personatum statibus, habeatur talis moderatio in pulsatione campanarum quod nec nimis brevis sit ipsa pulsatio, nec taediosa, nec per hoc obviari volumus laudabili usui ipsius Ecclesiae circa illos qui amore Dei in forma pauperum, cuiuiscumque status vel conditionis
98
existant ibi eligunt sepeliri, videlicet quod gratis et libere sepeliantur, et quod sacrista campanas pulsari facere teneatur sine custu, nec aliud recipiat nisi quod a Capitulo propter hoc recipere consuevit, quod si sacrista vel eius locum tenens facere recusauerit tunc refecturarius dictae Ecclesiae illud expensis eiudem sacristae fieri facere tenenatur.
XLIX Item statuimus et ordianamus quod de caetero nullus Canonicus admittatur in choro
superiori nec recipiat in partendis nisi ad sacros ordines sit promotus : nisi ex causa rationabili per Capitulum aliud ordinetur seu dispensetur, quae ordinatio seu dispensatio quiquennium nullatenus excedere possit : contra tales etiam non promotos servetur, quod de non habendo vocem in Capitulo statuunt canonicae sanctiones : volumus etiam et oridinamus quod tituli de numero dictorum viginti Canonicorum sint octo Subdiaconi, sex diaconi inclusis Archidiaconis, et caeteri capelli : qui ordinum tituli aliquo tempore laxari non possint.
L Item statuimus et ordianamus quod quilibet Canonicus teneatur facere residentiam
personalem in civitate Viennensis, morando sive in claustro, sive extra anno quolibet per quatuor menses continuem vel per intervalla : alioquin quilibet Canonicus percipiens in donis seu grossis fructibus annuatim valorem viginti florenorum, duos florenos. Qui vero valorem triginta florenorum, tres florenos, qui autem valorem quinquaginta percipit annuatim, quatuor florenos pro quolibet mense quo residere ut supra omiserit singulis annis realiter persolvat, ad supportandum onera Capituli Ecclesiae applicanda, nulla remissione per capitulum super hoc facienda. Et si fieret, nullius sit momenti, quod si dictos florenos solvere omiserit, infra unum mensem post dictum annum immediatem sequentem ex tunc ipso facto sit excommunicationis Sententia innodatus : qui annus in festo beati Mauritii semper incipere debeat
LI Item quia aliquotiens contingit quod propter defectum Canonicorum officia non fiunt in
Ecclesia ut deberent : idcirco ad finem quod officium divinum non remaneat celebrandum. Statuimus et ordinamus quod in casu quod non esset in Ecclesia numerus Canonicorum ordinatus vel in ipso numero non essent tot et tales Canonici de superiori choro qui possent officiare pro ut est consuetum, vel nisi cum ipsis non habilibus esset dispensatum a Capitulo de percipiendo in partendis, quod eo tunc in diebus solemnibus et aliis novem lectionum dumtaxat, ille qui dabit breve in matutinis, dare debeat uni Capellano vel pluribus de quibus sibi videbitur officium quod facere deberent Canonici, si tot et habiles ad hoc in dicto numero reperirentur, per hoc tamen statutum non intendimus quod dicti Collegiati debeant dicere secundam lectionem, cuius onus Capitulum supportare consuevit, nec aliqua alia onera dictorum Canonicorum suportare, nisi ut superius dictum est in aliis statutis et supradicto contigente.
LII Item statuimus et ordinamus quod si aliquis de Pesbiteris vel aliis inferioribus
Collegiatis dictae Ecclesiae extra civitatem mansionem faciat, et ad iuridicam vocationem Decani et Capituli non venerit Ecclesiae debitum servicium inpensurus termino congruo sibi assignato, tunc Decano absente, possint alium instituere loco sui, nec primus redire et servire volens possit praedictum expellere institutum : et ulterius quod si aliquis de dictis incorporatis promoveatur ad ulteriorem seu altiorem ordinem durante numero de et pro quolibet ipsorum ordinum ordinato nihil in dicta Ecclesia habeat vel percipiat, nec alimentetur, quousque infra dictum numerum loco suo adveniente extiterit collocatus.
LIII
99
Item statuimus quod Capitulum generale bis dumtaxat teneatur in anno videlicet in crastino festi B. Mauritii, et feria secunda post Dominicam primam quadragesimae, cum continuatione dierum sequentium ad hoc opportunorum, pro ut Capitulo videbitur esse faciendum, aliis autem diebus pro particulari Capitulo non pulsetur, nisi immineat necessitas vel in hoc ipsius Ecclesiae euidens utilitas perpendatur, et tunc de mandato Decani vel refecturarii, seu Canonicorum vel majoris partis isporum tunc in civitate Viennensi praesentium fiat hujusmodi pulsatio, aliter non.
LIV Item statuimus et ordinamus quod feudorum fidelitates, recognitiones, et homagia per
illos qui talia feuda tenent de caetero recipiantur in Capitulo et non alibi, et in registro seu papiro per Capituli Notarium inscribantur, nisi ex magna et rationabili causa foret per Decanum et Capitulum, vel Capitulum absente Decano dispensatum : alioquin receptionem et praestationem ipsorum haberi volumus pro non factis.
LV Item statuimus et ordinamus quod de caetero libra nemini concedatur ad vitam, vel ad
tempus, vel alias augmentetur quouismodo, nisi magistro lathomo fabricae, Secretario Capituli pro negotiis Ecclesiae deputandis, nihil tamen propter hoc contra illos qui nunc libram percipiunt legitime assignatam quominus ipsam qumdiu vixerint recipere valeant, vel circa ea quae pro matriculari elemosina tota et quibuscumque aliis ipsius Ecclesiae fieri consueverunt non intendimus innovare.
LVI Item statuimus et ordinamus quod Curati Ecclesiarum Sancti Georgii, Andreae
monialium, Ferreoli, domus Elemosinae, Sancti Pauli et sancti Severi qui hactenus potationes matutinales in hebdomada Paschali quae pehellees seu Chambes de bacon vulgariter nuncupantur dare seu facere consueuerant, solvant de caetero loco et pro recompensatione omnium potationum, pro ut alias voluisse et consensisse dicuntur, quilibet ipsorum et eorum in dictis Ecclesiis successores sex libras monetae librabilis in Ecclesia praedicta annis singulis, quae aequaliter inter Canonicos, Presbyteros, Clericos et Clericulos distribuantur et aequis portionibus nihil plus vel minus dando alteri dividantur, videlicet interessentibus in divinis, scilicet in matutinis, magna missa et vesperis singulis dierum illius hebdomadae : dictus autem rector domus Elemosinae ultra debeat annuatim qualibet die illius hebdomadae per septem dies in choandos in crastinum festi Paschae, solvere tres solidos dictae monetae Clericulis qui interfuerint in missa matutinali, et quod per hoc dicti rectores sint quiti perpetuo de pehellees, seu potationibus supradictis.
LVII Quia vero in multis ex praedictis statutis Sententiae excommunicationis latae per nos
existunt, esset que nimis suptuosum & difficile eas incurentibus ad nos vel Superiorem nostrum pro absolutione obtinenda habere recursum. Reverendissimo in Christo Patri Domino Archiepiscopo Viennensi : ac venerabili Patri Domino Abbati Monasterii Sancit Petris foris portam Viennensem. Nec non venerabilibus viris Dominis Decano eiusdem Ecclesiae Viennensis et Officiali Viennesi qui sunt vel erunt pro tempore. Dum tamen Officialis non trahat in proprio auditorio Officialatus et cuilibet eorum committimus absolutionem illorum qui dictas Sententias virtute Statutorum praemissorum incurrerint quoquomodo. Servatis tamen mente et tenoribus statutorum ipsorum, circa quae nihil valeant innovare. Quibus etiam et eorum cuilibet vices nostras committimus, ut per censuram Ecclestisticam, & per Sententiarum aggrauationes & reagrauationes & aliis iuris remediis opportunis statuta
100
huismodi in singulis suis articulis, dum ad eos seu eorum alterum queremonia devenerit faciant in posterum auctore Domino firmiter et inuiolabiliter obseruari.
LVIII Sed quia hactenus per certos dictos reformatores & commissarios pros statu dicate
Ecclesaie & divino officio in melius reformandis auctoriatate Apostolica deputatos, multa statuta facta fuerunt : et ordiantiones multae et compositiones post modum inter Capitulum et incorporatos dicate Ecclesiae multacontinentes capitula subsequutae, quae omnia in scriptsi redacta fuerunt ex quibus omnibus haec statuta facta et collecta fuerunt multis refecatis, additis, correctis et emendatis, prout visum est expedire : propterea ne ex multiplicatione scriptutarum dictorum statutorum & compositionsi orirentur dubia in futurum.
Ideo dicta statuta hactenus edita et compostionem illam in illis in quibus praesentibus statutis & ordinationibus contrariarent, seu in aliquo derogarent, auctoritare Apostolica nobis in haec parte concessa tollimus annullamus, irritamus & viribus evacuamus, & haec statuta & ordinationes sevari volumus, & obtinere perpetuam roboris firmitatem.
LIX Statutis igitur prea scriptis & ordinationibus factis, editis & correctis, & conclusione
penitus in eidem adveniente, die sexta mensis septembris dictum mense iulium immediate sequentis hora primae, praefatis Domini Decano Canonici & Capitulo, ac Praesbyteris & Clericis dictis incoporatis dictae Ecclesiae Viennae ad mandatum nostrum in Capitulo dictae Ecclesiae ad sonum campanae ut moris est convocatis , & praesentibus omnibus qui interesse voluerunt & poterunt : praedicta statuta & ordinationes in scriptis redacta de verbo ad verbum, alta & intelligibili voce personaliter legimus & poenas & sententias in eidem contentas in scriptis pronunciavimus & protulimus, & eidem Decano, Canonici & Capitulo Praesbyteris & incorporatis dictae Ecclesiae intimamus, notificamaus & publicamus, ut nullus ex ipsis possit in poterum aliquam de contentis in eisdem statutis ignorantiam allegare, nemine ex ipsis contradicente, appellante, seu aliter discrepante. In quorum fidem & testimonium de suprascriptis omnibus quibuscumque per Notarium infra scripum scribam notrum preasens publicaum instrumentum, & sigilli nostri officii Clericatus camerae appensione muniri, ad perpetuam memoriam rei gestae, ad laudem & honorem omnipotentis Dei & beate Virginis Mariae matris eius, beatique Mauritii & sociorum eius martyrum de legione Thebae, & totius caelestis curia supernorum. Amen. Datum & actum Viennae in Capitulo dictae Ecclesiae, diebus & mensibus prae scriptis. Anno a Nativitate Domini, millesimo trecentesimo octuagesimo quinto indictione octava. Pontificatus dicti Domini nostri Papae Clementis anno septimo. Praesentibus quoad dictam publicationem discretis viris : Jocerando Laurentii, Aymaro de Verfay, Guillelmo Neyrodi Notariis & ciuibus Viennae, pro testibus adhibitis & vocatis.
Bibliographie
A. Sources et outils
101
Auguste Almer et Alfred de Terrebasse, Inscriptions Antiques et du Moyen Âge de Vienne en Dauphiné, Vienne, 1875, t.5 et t.6 consacrés aux inscriptions du Moyen Âge. Ulysse Chevalier, Actes capitulaires de l’église Saint Maurice de Vienne : statuts, inféodation, comptes, publiés d’après les registres originaux et suivis d’un appendice de chartes inédites dans le diocèse de Vienne (XIIIè-XIVè siècles), Vienne, 1875, C.C.D. II, 1ère livr.
Ulysse Chevalier, Codex diplomaticus sancti rufi, Valence, 1891. Ulysse Chevalier, Description analytique du cartulaire du chapitre de Saint Maurice de Vienne suivi d'un appendice de chartes et chroniques des évêques de Valence et de Die, Valence, 1891, C.C.D. II, 2ème livr. Ulysse Chevalier, Cartulaire de l'abbaye de Saint-André le bas de Vienne, ordre de Saint-Benoît ; suivi d'un appendice de chartes inédites dans le diocèse de Vienne (IXe-XIIe siècles), Lyon, 1869, C.C.D.. Ulysse Chevalier, Chartes de Saint Maurice de Vienne, de l’abbaye de Léoncel et de l’église de Valence, Paris, 1912 (supplément aux recueils imprimés publiés par le chanoine Ulysse chevalier), C.C.D.X, 1ère livr. Ulysse Chevalier, Ordinaire de l’église cathédrale de Vienne, Paris 1923. Ulysse Chevalier, « Poyptycha id est regesta taxationis beneficiorum diocesum viennensis, valentinensis, diensis et gratianopolitanae », dans Documents inédits relatifs à l'histoire du Dauphiné, 2e vol., septième livraison Académie Delphinale, Grenoble, 1868. Ulysse Chevalier, Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l'année 1349, Valence, 1913, six tomes.
Etienne Clouzot, Pouillés des provinces de Besançon, de Tarentaise et de Vienne, publiés sous la direction de Joseph Calmette (recueil des Historiens de la France, Pouillés, t. VII.), Paris, 1940-1946, 2 vol. Jules Marion, Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, dits cartulaires de Saint Hugues, Colmar, 1869.
Beate Schilling, Gallia Pontifica, répertoire des documents concernant les relations entre la papauté et les églises et monastères en France avant 1198, Vol. III, t.1, diocèse de Vienne, Göttingen, 2006, p. 165)
Isabelle Vérité, Répertoire des cartulaires Français, provinces ecclésiastiques d’Aix, Arles, Embrun, Vienne, Diocèse de Tarentaise, Paris, 2003.
102
B. L'Eglise et les chanoines du XIe au XIVe siècles La cathédrale (XIIe-XIVe siècles), Toulouse, 1995 (Cahiers de Fanjeaux n°30). Le monde des chanoines (XIe- XIVe s.), Toulouse, 1989 (Cahiers de Fanjeaux n°24). Les évêques, les clercs et le roi (1250-1300), Toulouse, 1972 (Cahiers de Fanjeaux n°7). Moines et religieux dans la ville (XIIe XVe siècle), Toulouse, 2009 (Cahiers de Fanjeaux n°44). Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, Saint-Etienne, 1991. Joseph Avril, « Une association obligée : l’archiprêtré ou doyenné » dans Revue d’Histoire de l’Eglise de France, t.93 (n°230), janvier-juin 2007, p.25-40. Dom Jean Becquet, « La réforme des chapitres cathédraux en France aux XIe et XIIe siècles », dans Bulletin philologique et historique jusqu'à 1610 du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1977, p. 31-41. Jean Beyssac, Les chanoines de Lyon, Lyon, 1914. Jean Châtillon Le mouvement canonial au Moyen Âge. Réforme de l’église, spiritualité et culture. Etudes réunies par Patrice Sicard, Paris, 1992, (bibliotheca victoriana, 3). Ulysse Chevalier, « la vie religieuse du chapitre de Vienne » dans Bulletin de la société d’archéologie et statistique de la Drôme, deuxième série, tome cinquième, Valence, 1922, p.86-96. Gilbert Coutaz, Les chanoines réguliers de saint Augustin en Valais : le Grand-Saint-Bernard, Saint Maurice d’Agaune, les prieurés valaisans d’Abondance, Helvetia Sacra : sect. 4 ; vol. 1, Bâle, 1997. Marie-Madeleine De Cevins et Jean-Michel Matz (dir.), Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), Rennes, 2010. Charles Dereine, « Chanoines » dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, Paris, 1953, t.12, p. 354-404. Charles Dereine, « Vie commune, règle de Saint Augustin et chanoines réguliers au XIe siècle » dans Revue d'histoire ecclésiastique, 41, 1946, p. 365-406. Augustin Fliche, La réforme grégorienne, t.I : la formation des idées grégoriennes, Louvain, 1924 ; t.II : Grégoire VII, Louvain, 1925 ; t.III : L'opposition anti-grégorienne, Louvain, 1937. Jean Hervé Foulon, Eglise et réforme au Moyen Âge. Papauté, milieux réformateurs et ecclésiologie dans les pays de la Loire au tournant des XIe-XIIe siècles, Turnhout, 2008 Amy Goodrich Remensnyder, Remembering Kings Past : Monastic Foundation Legends in Medieval Southern France, New York et Londres, 1995.
103
René Locatelli, Sur les chemins de la perfection : moines et chanoines dans le diocèse de Besançon (vers 1060-1220), Saint-Etienne, 1992. Jean Longère, L'abbaye parisienne de Saint-Victor au Moyen Âge, communications présentées au XIIIe Colloque d'Humanisme médiéval de Paris (1986--1988), Paris, 1991, (bibliotheca victoriana, 1). Gabrielle Michaux, Le chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne du XIe au XIVe siècles, Travaux de la société d'Histoire et d'archéologie de Maurienne, Tome XXXVII, Chambéry, 2003. Florian Mazel (dir.), L’espace du diocèse. Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (Ve--XIIIe siècle), Rennes, 2008. Michel Parisse (dir.), Les Chanoines réguliers, émergence et expansion (XIe-XIIIe siècles), Actes du sixième colloque international du CERCOR au Puy en Velay du 29 juin au 1er juillet 2006, Saint-Etienne, 2009. Odette Pontal, Les conciles de la France capétienne jusqu’en 1215, Paris, 1995. Francis Salet, L’ancienne cathédrale saint Maurice de Vienne, Extrait du congrès archéologique du Dauphiné, Paris, 1974. Gerd Tellenbach, The church in western Europe from the tenth to the early twelfth century, Cambridge, 1993, (1ère éd., Göttingen, 1988). André Vauchez et Cécile Caby (dir.), L'histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Âge, l'atelier du médiéviste t.9, Turnhout, 2003.
C. Vienne et sa région au Moyen Âge. Lucien Bégule et Jules Bouvier, L’église saint Maurice, ancienne cathédrale de Vienne en Dauphiné, Paris, 1914. Louis Boisset, Un concile provincial au XIIIe siècle, Vienne 1289, Théologie historique n°21, Paris, 1973. Antoine Bouvier, Structuration des lieux de culte en Viennois ; doyenné et archidiaconé d’Octaveon ; XIIIe-XVe siècles, Mémoire de Master « sciences humaines et sociales » : histoire : Grenoble, Université Pierre Mendés France, 2008, 2 vol. Bernard Bligny (dir.), Histoire des diocèses de France- Grenoble, 1979. Bernard Bligny, L’Eglise et les ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, Paris, 1960. Pierre Cavard, La cathédrale Saint Maurice de Vienne, Vienne, 1978. Pierre Cavard, Vienne la sainte, Vienne, 1977.
104
Claude Charvet, Histoire de la sainte Eglise de Vienne, Lyon, 1761. Ulysse Chevalier, Etudes historique sur la constitution de l’église métropolitaine et primatiale de Vienne en Dauphiné (Origines-1500), Vienne, 1922 et 1923, 2. tomes. Nicolas Chorier, Histoire de Dauphiné, Grenoble, 1661, 2tomes,. Yves Esquieu, Autour de nos cathédrales, quartiers canoniaux du sillon rhodanien et du littoral méditerranéen, Paris, 1992. Claude Faure, « Histoire de la réunion de Vienne à la France (1328-1454) » dans Bulletin de l’académie delphinale, 1905, t.19, p. 327-501.
Alfred Fierro, « Un cycle démographique : Dauphiné et Faucigny du XIVe au XIXe siècles » dans Annales, économie, société, civilisation, 1971, vol.25, n°5, p. 941-959.
Abbé Graef, « Clément VI et la province de Vienne » dans Bulletin de l'académie delphinale, 1911, Série 5, t. 5, p. 329-410. Bruno Galland, « Le rôle du royaume de Bourgogne dans la réforme grégorienne » dans Francia, 2002, p. 85-107. Bruno Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire : Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome, 1994. Gérard Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit, l’exemple de la Provence et du Dauphiné (XIIe début XIVe siècle), Rome, 1988. Joseph Lecler, Le concile de Vienne 1311-1312, Paris, 1964. Mermet, Chronique religieuse de la ville de Vienne, Vienne, 1856 (posthume) Georges de Manteyer, Les origines du Dauphiné en Viennois : la première race des comtes d’Albon (843-1228), Gap, 1925.
Nathanaël Nimmegeer, La province ecclésiastique de Vienne au Haut Moyen Âge, thèse inédite, Lyon, 2011.
Pierrette Paravy, De la chrétienté romaine à la réforme en Dauphiné, collection de l’école française de Rome n°183, deux tomes, Rome, 1993. René Poupardin, Le royaume de Bourgogne (888-1038). Etude sur les origines du royaume d'Arles, Paris, 1907 Laurent Ripart, « Du royaume aux principautés (Savoie-Dauphiné, Xe-XIe siècles) » dans Le Royaume de Bourgogne autour de l’an Mil, publication du séminaire tenu les 15 et 16 mai 2003 à Lyon, Chambéry, 2008, p. 247-276.
105
Laurent Ripart, « Du comitatus à l’épiscopatus : le partage du pagus de Sermorens entre les diocèses de Vienne et de Grenoble » dans L’espace du diocèse. Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (Ve- XIIIe siècles), Rennes, 2008, p. 253-287. Louis Étienne Gustave De Rivoire de la Batie, Armorial du Dauphiné contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles et les notables de cette province accompagnées de notices généalogiques complétant les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard, Lyon, 1867. Francis Salet, L’ancienne cathédrale saint Maurice de Vienne, Extrait du congrès archéologique du Dauphiné, Paris, 1974. Paul Thomé de Maisonneufve, le chapitre métropolitain de Vienne et le Liber divisionum terrarum, Grenoble, 1937.
Table des matières
Remerciements .................................................................................................................. 2
I. Les sources ................................................................................................................. 4
A. Les actes capitulaires.......................................................................................... 4
B. Les statuts de 1385. ............................................................................................ 4
C. L’acte de Charlemagne de 790/805................................................................... 5
1. Publications du document aux XVIIe et XVIIIe siècles ............................. 5
2. A la recherche du Tabbulae Ecclesiae Viennensis..................................... 5
3. Un document qui pose question dès la fin XVIIIe siècle............................ 6
D. Les sources des XIe et XIIe siècles.................................................................... 7
1. Les sources du chapitre .............................................................................. 7
2. Les sources issues de l’archevêché ............................................................ 9
3. Le cartulaire de Saint-André-le-Bas........................................................... 9
E. Les sources des XIIIe et XIVe siècles............................................................... 10
1. Pouillés de Vienne.................................................................................... 10
2. Le Liber divisionum terrarum .................................................................. 10
3. Ordinaire de Vienne ................................................................................. 11
F. Conclusion : les enjeux du faux de 790/805 .................................................... 11
G. Le faux statut de Charlemagne traduit par Claude Charvet ............................. 12
II. LES INSTITUTIONS DU CHAPITRE : Des dignités, des personnats et des offices
de l’Eglise............................................................................................................... 14
106
A. Fonctionnement et rôle du chapitre.................................................................. 14
B. Les institutions du chapitre cathédral de Vienne depuis les origines............... 16
1. Le prévôt .................................................................................................. 17
2. Le doyen................................................................................................... 19
3. Les archidiacres........................................................................................ 21
4. Le capiscol................................................................................................ 26
5. Le magister : un maître du chœur............................................................ 28
6. Les chantres.............................................................................................. 29
7. Le sacristain.............................................................................................. 30
8. Mistral ...................................................................................................... 32
9. La Chancellerie ........................................................................................ 33
III. 60 chanoines, 100 prêtres… Une tentative de dénombrer l’entourage épiscopal. ... 35
A. une tentative pour dénombrer le chapitre ......................................................... 35
1. Des effectifs limités jusqu’au XIIIe siècle ................................................ 35
2. Une forte croissance du nombre des chanoines du milieu du XIIIe siècle
au début du XIVe siècle........................................................................... 36
3. La crise, la peste et la réduction des effectifs.......................................... 37
B. Les clercs du collège. ....................................................................................... 38
Conclusion....................................................................................................................... 41
Annnexes......................................................................................................................... 43
Regeste des actes capitulaires de la Sainte Eglise de Vienne.................................. 44
Les statuts de 1385 ................................................................................................... 82
Bibliographie................................................................................................................. 100
A. Sources et outils............................................................................................... 100
B. L'Eglise et les chanoines du XIe au XIVe siècles............................................. 102
C. Vienne et sa région au Moyen Âge. ............................................................... 103
Table des matières......................................................................................................... 105