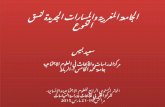Communautés juives de São Paulo et intégration nationale brésilienne. Evolutions d'un paradigme....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Communautés juives de São Paulo et intégration nationale brésilienne. Evolutions d'un paradigme....
160
Chapitre 3
L’installation des immigrants juifs à São
Paulo :
Habiter un espace, appréhender un
contexte, créer une sociabilité
161
À la fin de la seconde Guerre mondiale, la majorité des immigrants juifs se sont
installés sur le sol brésilien. D’autres, notamment des réfugiés de guerre et des migrants
en provenance du bassin méditerranéen, arriveront plus tard. Mais l’essentiel des
migrations, nous l’avons vu, s’est effectué au cours de la décennie 1930-1939. À la fin
des années 1940, on peut commencer à observer comment ces nouveaux arrivants ont
pris place sur le territoire et dans la société brésilienne. Comment ces exilés se sont
installés sur le sol brésilien et en particulier dans la ville de São Paulo ? Une fois
l’immigration réalisée avec plus ou moins de difficultés, comment ont-ils, au cours de
ces premières années, perçu le pays d’accueil ?
Jeffrey Lesser affirme dans ses travaux l’existence d’une relation complexe entre les
juifs et l’Etat Brésilien, en particulier sous le gétulisme. Selon lui, le « problème juif »
ne se poserait qu’au moment de l’immigration, de l’entrée sur le territoire. Une fois sur
place, les juifs ne seraient plus perçus comme de véritables étrangers, en tout cas pas
comme des sémites, mais plutôt comme des blancs. En cela, la démocratie raciale, en ce
sens qu’elle n’est jamais totalement séparée de la volonté de blanchiment –
d’européanisation – progressif du Brésil, pourrait être considéré comme un atout dans
les premiers pas de l’intégration des juifs. Si l’on reprend ensuite les écrits de certains
auteurs clairement antisémites proche de l’Intégralisme, comme Cabral, les juifs sont
inassimilables car ils ne se mélangent pas. Ainsi Cabral cite-t-il, dans un ouvrage paru
en 1937 et préfacé par Gustavo Barroso, différents penseurs antisémites de sa
génération en exergue à chacun des chapitres de son livre A Questão Judaica. Il fait par
exemple référence à Bernard Lazare ou Léon de Poncins. Pour précéder son chapitre 2,
« Um Estado no Estado », il cite Leopoldo Kahn qui affirmait le 30 juillet 1903 : « Le
162
juif ne s’assimilera jamais. Jamais il n’adoptera les us et coutumes d’autres peuples. Le
juif restera juif dans les autres nations ». Cabral, à travers la voix de Kahn, parle d’un
mélange culturel, d’une intégration culturelle à la nation brésilienne.
Il est un peu tôt pour estimer cette intégration culturelle des juifs paulistes229. En
revanche, nous avons bien souligné que ce préjugé est présent au moment où s’effectue
la plus grande vague migratoire des juifs vers le Brésil. Il témoigne plus largement de la
volonté de « nationaliser » la population brésilienne. Est-ce que ceci va intervenir dans
les modes d’installation de la diaspora juive qui se constitue sur le sol pauliste ? Et si
oui, comment.
Pour répondre à ces questions et considérations que nous posons en préambule à ce
chapitre, nous étudierons d’abord comment les migrants, en tant qu’acteurs, ont mis en
place les conditions de leur nouvelle vie à São Paulo qui petit à petit s’impose comme le
principal foyer de la diaspora juive au Brésil. Puis nous verrons comment il est difficile
de décrypter l’attitude de l’Etat qui, à travers ces positionnements ambigus, ne nous
laisse pas facilement percevoir le rapport qu’il souhaite entretenir avec ces nouveaux
venus. Enfin, nous nous demanderons si la société brésilienne a été si accueillante et
bienveillante que l’étude des témoignages de migrants le laisse supposer.
229 La question de l’intégration sera l’objet de la deuxième partie de ce manuscrit.
163
I. S’installer à São Paulo : la mise en
place des conditions d’une nouvelle
vie ou d’un nouveau départ
En arrivant aux Brésil, les juifs qui vont s'établir à São Paulo mettent en place les
conditions de leur nouvelle existence, transposant sur ce nouveau territoire des modes
de vie importés des régions dont ils proviennent. On ne peut donc pas, à proprement
parler, désigner cela comme une nouvelle vie car il n’y a pas une rupture totale entre le
passé et l’avenir, mais plutôt une adaptation. Toutefois, cette installation constitue
véritablement un nouveau départ impliquant nouvelles sociabilités, nouveaux emplois,
nouvelles habitudes que les migrants cherchent à développer dans le sens d’une certaine
forme de continuité. Leur présence contribue également à modifier le principal quartier
qu’ils habitent : le Bom Retiro. Ce quartier est alors à dominance industrielle, occupé
par de nombreux immigrés, essentiellement italiens, mais aussi des juifs provenant
d’autres régions et de migrations plus précoces.
A. Répartition géographique :
a. Une population majoritairement urbaine
Les migrants juifs qui arrivent au Brésil dans les années 1930-1940 s’installent en
grande majorité dans les zones urbaines du pays. Trois villes se distinguent très
clairement : Rio de Janeiro dont l’attrait est toujours réel, São Paulo qui connaît une
croissance industrielle notable à cette période, et Porto Alegre dont l’économie se
développe. La vie en milieu rural est elle plus circonscrite et le fruit des migrations du
début du siècle orchestrées en partie par la Jewish Colonization Organization.
164
1. La vie dans les colonies organisées par la JCA est un peu
l’exception rurale
Concernant l’immigration juive, on peut parler d’une exception rurale quand on pense
aux migrants installés dans les colonies agricoles, que ce soit à titre individuel ou par le
biais des terres achetées et peuplées grâce à la JCA. Celle-ci, après avoir contribué à
l’émigration vers l’Argentine de juifs d’Europe Orientale (Russie, Bessarabie, Pologne)
confrontés aux difficultés économiques et politiques précédemment citées, développe au
Brésil de nouvelles colonies agricoles. Il faut noter par ailleurs qu’une partie des colons
installés en Argentine va passer la frontière pour s’installer, avec leur famille, au Brésil.
Avec l’installation de bureaux de la JCA à Rio de Janeiro en 1904 et l’acquisition de
lots de terre dans le Rio Grande do Sul, la colonisation agricole devient possible au
Brésil. L’association philanthropique du Baron Hirsch permet l’installation d’une
centaine de familles dans les colonies de Quatro Irmãos et Filipson où une aide
matérielle leur est fournie. Certains juifs immigrent aussi d’eux-mêmes, sans l’aide de
la JCA, en direction de ces terres. Cependant, les colons ne restent pas tous sur ces
terres agricoles. Plusieurs facteurs les poussent à quitter les colonies et participer à la
vague d’urbanisation du Brésil : le manque de rendement de la terre, l’instabilité
politique due à l’éclosion de mouvements révolutionnaires, ou encore l’inadaptation à
un mode de vie rural pour certains colons qui venaient de la ville. Ce déplacement
interne contribue au développement d’un petit foyer de peuplement juif dans la ville de
Porto Alegre.
2. Une répartition dans les centres urbains en développement
En effet la plupart des juifs migrants choisissent de s’installer en milieu urbain, dans les
villes ou en zone suburbaine. Cette forte propension à l’urbanité est assez particulière.
Elle n’est pas le seul fait des juifs puisqu’elle concerne également l’immigration
syrienne et libanaise, mais aussi italienne. Toutefois, elle contraste là encore avec les
autres migrations qui se répartissent plus équitablement entre milieu urbain et rural. Ce
165
dernier est pourtant fortement demandeur de main d’œuvre que ce soient dans les
activités traditionnelles de production de café ou pour le développement d’une
agriculture vivrière où les Japonais, dont la période migratoire est finalement assez
comparable puisqu’elle débute en 1908, sont très présents dans la région pauliste.
L’attirance pour la vie urbaine se comprend à la lumière des activités professionnelles
exercées avant la migration. N’ayant pas le droit de posséder la terre pendant plusieurs
siècles en Europe, ils ont acquis des compétences dans les activités présentes en zone
urbaine et ont très souvent une réelle méconnaissance du travail agricole. C’est donc
très logiquement que leur installation de prédilection est la ville. Ainsi, en 1940, d’après
le premier recensement faisant apparaître le judaïsme parmi les religions potentielles
des personnes interrogées, le Sudeste domine comme principale zone d’implantation
des juifs au Brésil. Cette région est alors et restera d’une part la plus urbanisée du Brésil
et d’autre part la zone de plus forte concentration juive. Ainsi, en 1940, 78,2% des juifs
brésiliens résidaient dans le Sudeste et 14% dans le Sud230.
3. Rio de Janeiro attire encore
Jusqu’à la fin des années 1940, la ville de Rio de Janeiro attire encore les migrants.
Principale destination urbaine sous l’Empire, car principale ville et capitale du Brésil,
celle-ci continue à être un port d’entrée sur le sol brésilien. Des associations d’accueil y
ont été développées et contribuent à faciliter l’immigration et les premiers pas des
migrants. Les quartiers de Leopoldina et de la Praça XI sont les deux principaux lieux
d’installation des juifs à Rio de Janeiro. Leopoldina abrite surtout des émigrés de
l’Empire Ottoman en décomposition (Syriens et Libanais) alors que la Praça XI compte
une population plus nettement ashkénaze. Un autre pôle, en dehors de la ville, mais
accessible par train, Nilópolis, compte une population plus mixte entre sépharades et
ashkénazes. Entre Rio et Nilópolis s’égrène également toute une population de migrants
juifs231. Dès le début des années 1950, une partie de cette population et aussi les
230 Source : IBGE, Recensement de 1940. Le pays est découpé en cinq zones : Sudeste, Sud, Nordeste,
Nord, Centre-Ouest, comptant respectivement 78.2, 14, 3.9, 2.8 et 0.1% de la poulation juive brésilienne. 231 Sur la présence juive à Rio de Janeiro, nous pouvons renvoyer le lecteur à trois ouvrages spécifiques :
MALAMUD, Samuel, Memórias da Praça Onze, Rio de Janeiro, Kosmos, 1983, 119p. ; VAITSMAN,
166
nouveaux migrants arrivant par Rio de Janeiro suivront le flux démographique
conduisant certains cariocas vers São Paulo.
b. Le Bom Retiro devient le « quartier juif » de São
Paulo
L’arrivée des immigrants à São Paulo se fait en deux temps. En effet, la ville n’étant pas
portuaire et les arrivées se faisant par voie maritime, ils débarquent dans un premier
temps dans le port de Santos. C’est donc par train qu’ils arrivent dans la capitale
pauliste et c’est à la Estação da Luz qu’ils découvrent la ville. Beaucoup d’entre eux
vont d’ailleurs s’installer dans les environs de cette gare, quartier connu sous le nom de
Bom Retiro. Comme on le voit sur la carte ci-après, le Bom Retiro se trouve au centre
géographique de la ville.
Heliete, Judeus da Leopoldina, Rio de Janeiro, Museu Judaico do Rio de Janeiro, 2006, 194p. ;
VELTMAN, Henrique, A história dos judeus no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Expressão e Cultura, 1998,
180p.
167
Carte 3 : Quartiers administratifs de São Paulo : sous-préfectures (subprefeituras) et districts
(distritos) selon les lois municipales 11.220 de 1992 pour les districts et 13.399 de 2002 pour les sous-
préfectures.
Carte élaborée par la Secretería Municipal de Planejamento (Sempla) et le Departamento de
Estatística e Produção de Informação (Dipro).
168
1. L’arrivée par le port de Santos et les quelques quartiers de
prédilection
Comme Porto Alegre, São Paulo a accueilli d’anciens colons agricoles dans les années
1920. C’est notamment le cas des parents et de la grand-mère maternelle de Luiza
Cymbalista. Ayant quitté Odessa et s’étant installés dans la colonie de Quatro Irmãos en
1913, ils font le choix de la ville et de São Paulo dans les années 1920 :
« Comme la JCA offrait des conditions favorables pour les juifs russes qui
souhaitaient immigrer (au Brésil), la JCA proposant les colonies, alors ils ont
accepté et sont venus s’installer dans les colonies, ils sont restés là jusqu’en
1922 ; comme ils avaient quatre enfants, ils ne voulaient pas que leurs
enfants soient des paysans232 et (souhaitaient) qu’ils aillent étudier ici à São
Paulo, alors ils sont tous venus pour étudier à São Paulo »233.
Outre le parcours migratoire à l’intérieur du pays, Luiza Cymbalista nous apprend
également que les deux colonies de Quatro Irmãos et Filipson étaient exclusivement
composées de russes utilisant le yiddish comme langue vernaculaire. Elle indique
également que sa famille était « très religieuse », à l’exception de son père qualifié de
« très traditionnel », et que la Palestine et le sionisme étaient très souvent évoqués dans
les discussions depuis son enfance (elle est née en 1914).
232 Le terme original employé ici est « caipira ». La traduction que nous avons choisie est la moins
connotée. En effet, le mot est très ambigu et il peut également être employé de façon péjorative, marquant
une forme de mépris pour les ruraux de la part des urbains, dans le sens assez proche de « bouseux » en
français. La personne entretenue semble vouloir se distinguer, à plusieurs reprises, du travail de la terre,
précisant que sa famille en Russie étaient « très bien établie » (« muito bem situados ») et qu’une famille
de russes non juifs travaillaient la terre pour eux, en tant que péons, ouvriers agricoles non qualifiés
(« peões »). Ce milieu rural n’est pas celui de sa famille et il se peut qu’elle éprouve une certaine forme
de dédain pour le travail agricole. 233 « Como a ICA estava oferecendo condições para os judeus russos que querem imigrar, a ICA dando lá
para as colônias então eles aceitaram e vieram para as colônias, ficaram lá até mil novecentos e vinte
dois; como tinham os quatro filhos, não queriam que os filhos fossem caipira e viessem para estudar aqui
em São Paulo, vieram todos para estudar aqui em São Paulo ». Entretien de Luiza CYMBALISTA, réalisé le
11.08.1995, Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, Núcleo de História Oral, ref. 174BR05.
169
A ces migrants de l’intérieur, se sont adjoints des migrants de l’extérieur en une
quantité bien plus importante. La composition de cette immigration est par ailleurs plus
hétérogène en terme d’origines géographiques, sociales et culturelles comme nous
l’avons vu. L’office des migrations de Santos, ville portuaire de São Paulo, conserve les
registres d’arrivée de toutes les personnes arrivées au Brésil par voie maritime dans
l’Etat de São Paulo. Il a vu affluer une grande quantité de candidats à l’immigration.
Entre 1820 et 1949, sur les 4.8 millions de personnes entrées sur le territoire, 2.5
millions, soit plus de la moitié, sont arrivés par ce port234. Le chemin traditionnel des
migrants les conduisait vers la ville de São Paulo235 et vers les plantations de café de
l’intérieur de l’Etat et du Minas Gerais. Dans le cas des juifs, ce chemin s’est très
majoritairement arrêté dans la ville de São Paulo. Les migrants se sont établis dans
quelques quartiers de prédilection, populaires, reflétant leur niveau socio-économique
au moment de l’arrivée. Il s’agit principalement des quartiers de Brás, Bela Vista,
Penha, Vila Mariana, Santa Cecília (appelé aussi Higienópolis) et Jardim Europa pour
les ashkénazes, et de Cambuci, Moóca et Ipiranga pour les sépharades.
Dès le début du 20ème siècle, ces quartiers ont été les premières destinations des
immigrés juifs à São Paulo, immigrés en provenance des régions de Smyrne, Rhodes,
Salonique, Palestine (Empire Ottoman en décomposition), Hongrie et Bulgarie. À la fin
des années 1910, les juifs de l’actuel Liban s’installent avec plus de prédilection dans le
quartier de Moóca. C’est donc au début des années 1920 que le quartier du Bom Retiro
commence à attirer de très nombreuses familles d’origine juive. C’est à ce moment que
le quartier de la Estação da Luz devance les autres en termes d’attractivité.
2. La formation d’un « quartier juif » : le Bom Retiro
Jusqu’au début des années 1880, le Bom Retiro se caractérise par un profil
d’intermédiaire entre la ville et la campagne. Il se situe entre le Rio Tietê au nord et la
234 Boletim de Imigração e Colonização, São Paulo, n°7, décembre 1952, p.103. 235 La ville de São Paulo est alors particulièrement cosmopolite : en 1934, les immigrés représentent 28%
de la population de la capitale et 67% des paulistes sont étrangers ou descendants d’étrangers d’après le
Boletim do Departamento Estadual da Estatística, São Paulo, 1939, pp. 13-18.
170
ligne de chemin de fer au sud. Cette ligne, inaugurée par les Anglais en 1867, permet le
transport de marchandises. Elle facilite aussi le développement industriel du quartier.
Ainsi, celui-ci devient très vite une localisation de choix pour les premières industries
de transformation. Mais cela facilite aussi l’arrivée de migrants, d’autant que s’y trouve
la Estação da Luz, gare où s’arrêtent les trains en provenance de Santos. Ainsi,
« Très rapidement, le Bom Retiro s’est caractérisé comme un quartier
prolétarien et d’immigrants, en raison de la présence d’industries attirées par
sa localisation adjacente à la voie ferrée et par les conditions topographiques
propices, à proximité de la plaine. D’une part, la possibilité de travail offerte
par ces industries et, d’autre part, la proximité avec le centre ont rapidement
fait du Bom Retiro un quartier d’immigrants, qui vint même à abriter,
pendant environ cinq ans, le premier centre d’immigration de São Paulo »236.
Les premières industries sont des poteries, et une manufacture de tissage et filage. Les
principaux employés de ces entreprises sont des italiens, peu qualifiés, souvent
analphabètes (à 70%) qui sont les premiers ouvriers étrangers du quartier à la fin du
19ème siècle237. D’autres activités se développent faisant du secteur un quartier mixte, à
la fois industriel, résidentiel et commercial : merceries, teintureries, pharmacies,
établissements de raffinage de sucre et de café, boutiques de chaussures, petites
manufactures de vêtements et de chapeaux, fabriques de pâtes… Ces échoppes ou
manufactures étaient souvent de petites structures n’employant que peu de personnes,
fonctionnant parfois à échelle familiale, ou ne dépendant que d’un seul homme.
236 « Desde logo, caracterizou-se o Bom Retiro como bairro proletário e de imigrantes, em virtude da
presença de indústrias atraídas pela localização adjacente à ferrovia e pelas condições topográficas
amenas, próximas à várzea. De um lado, a possibilidade de trabalho oferecida por essas indústrias e, de
outro, a proximidade com o centro logo fizeram do Bom Retiro um bairro de imigrantes, que chegou
inclusive a abrigar, por cerca de cinco anos, a primeira hospedaria de imigrantes de São Paulo ». TRUZZI,
Oswaldo, « Etnias em convívio : o bairro do Bom Retiro em São Paulo », Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, n°28, 2001, p.145. 237 Pour plus de précisions à ce sujet, se référer à TRUZZI, Oswaldo, op. cit. ; BANDEIRA JR, Antonio
Francisco, A Industría no estado de São Paulo, São Paulo, 1901 et Boletim do Departamento Estadual do
Trabalho, São Paulo, Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, n°1-2, 1912.
171
Avec l’arrivée des juifs qui choisissent massivement ce quartier pour installation leur
foyer, le Bom Retiro va changer de visage pour être considéré aujourd’hui comme le
quartier juif traditionnel de São Paulo. Ainsi, les juifs qui commencent à s’installer dans
le Bom Retiro dès le début du 20ème siècle contribuent au développement du commerce
de détail et le plus souvent ambulant. Cette tendance est confirmée avec l’arrivée des
juifs russes puis polonais à partir des années 1920. Ainsi Nahum Lerner, le père de Sara
Lerner238, arrive de Safed, en territoire palestinien, et s’installe dans le Bom Retiro au
cours de la décennie 1910. Il est l’un des premiers juifs à ouvrir un commerce dans le
quartier. Bien qu’installée depuis cinq générations en Palestine, la famille Lerner est
ashkénaze ; on sait aussi que la famille maternelle de Sara, dont le nom de famille est
Abramovitch, est originaire de Roumanie. La famille Lerner a quitté la Palestine en
deux temps : le père d’abord, puis le reste de la famille en 1912. En effet, en Palestine,
« La misère était grande là ! Et en Orient vous savez qu’on apprend à parler
beaucoup de langues. Mon père était très vif et très dynamique, c’est
pourquoi il a décidé de partir en Amérique du Sud pour tenter sa chance et la
famille est restée là (en Palestine). Il travaillait ici (au Brésil) et envoyait (de
l’argent) pour subvenir aux besoins de la famille »239.
En effet, on remarque fréquemment une arrivée fractionnée de la famille : le père part
d’abord, parfois accompagné du fils aîné, puis le reste de la famille le(s) rejoint. Et c
sont donc des familles juives, souvent avec des enfants qui s’installent dans le Bom
Retiro, vivant du commerce et de petits métiers artisanaux contribuant au
développement du quartier et profitant du croissance urbaine de São Paulo. Ce mode
d’installation se retrouve dans d’autres témoignages de migrants240.
238 Sara Lerner est son nom de jeune fille et de femme mariée puisqu’elle a épousé Mauricio Lerner. 239 « A miséria era grande lá no ! E no Oriente a senhora sabe que aprenda-se muitas línguas a falar. Meu
pai era muito vivo muito esperto então ele resolveu vir para América do Sul para fazer a vida e a família
ficou lá. Ele trabalhou aqui e mandava para sustentar a família », Témoignage de Sara LERNER, réalisé les
25.09.1996 et 2.10.1996, Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, Núcleo de História Oral. 240 C’est aussi le cas notamment de la famille de Fany Adler, originaire de Russie où le père a été
condamné à mort à la suite des Révolutions en raison de ses activités capitalistes, installée à Varsovie
pendant huit ans à partir de 1820-21. Le père émigre le premier avec un de ses fils en juillet 1929 à cause
de difficultés économiques et de l’antisémitisme. Le reste de la famille les rejoint en février 1930. Ils
172
La croissance de la population juive dans le quartier s’enclenche véritablement après
1918. L’entre-deux-guerres est la phase des plus grandes migrations vers le Brésil. À
cette époque, le Bom Retiro est encore, selon les termes de Sara Lerner qui rentre alors
d’un séjour prolongé en Allemagne,
« très en retard, très, une femme ne pouvait pas marcher seule dans la rue et
j’arrivais d’Allemagne, d’un endroit tellement civilisé, ça me surprenait
beaucoup, beaucoup, je n’arrivais même pas à comprendre ma famille, je
parlais une langue et eux une autre. J’ai beaucoup souffert au début. Je
parlais seulement allemand et eux ne parlaient pas allemand non, seulement
yiddish et portugais. Et le yiddish pour l’allemand, certains mots, ça va
pour… mais ça va pas pour… Beaucoup de juifs pensent qu’ils savent parler
(allemand) »241.
Elle poursuit au sujet des façons de penser et de vivre :
« C’était tellement différent, le Brésil était très, très, très en retard par
rapport à l’Europe et principalement à l’Allemagne, l’Allemagne était un
(des pays) les plus avancés, non ? Et, de telle façon, j’avais l’impression
d’être rentrée, mais deux cents ans en arrière »242.
Ce décalage ne concerne pas seulement la société brésilienne, il est perceptible aussi
dans le fonctionnement de la communauté. Ce « retard » se ressent dans les relations
personnelles et notamment dans le mariage alors presque exclusivement endogamique.
s’installent dans le Bom Retiro. Témoignage de Fany ADLER, réalisé le 2.03.1994, Arquivo Histórico
Judaico Brasileiro, Núcleo de História Oral, ref. 079-RUS-04. 241 « Era muito atrasado, muito, uma mulher não podia andar sozinha na rua e eu cheguei da Alemanha,
dum lugar tão civilizado, eu estranhei muito, muito, eu não podia nem entender com minha família, eu
falava outra língua e eles falavam outra língua. Eu sofri muito no começo. Eu só falava alemão e eles não
falavam alemão no, só idish e português. E o idish pró alemão algumas palavras dá pra... mas não dá
pra... Muito judeu pensa que sabe falar ». Témoignage de Sara LERNER, op.cit. 242 « Era tão diferente, muito, muito, muito Brasil era mais atrasado do que a Europa principalmente da
Alemanha, Alemanha era um dos mais adiantos non! Eh, de maneiras que me senti como se estivesse
duzentos anos atrás que voltei. » Id.
173
Cette volonté conduit à un choix très restreint, notamment aux débuts, lorsque la
communauté est encore très petite à São Paulo.
La proximité du Bom Retiro avec le centre ville est un facteur clé qui a favorisé son
choix. En effet, sa localisation rend le commerce ambulant plus simple. Mais l’autre
facteur déterminant est le faible coût de l’immobilier dans cette zone ouvrière. Et, au fur
et à mesure, la présence de juifs déjà implantés incite les nouveaux venus à choisir la
même destination résidentielle. C’est pourquoi Oswaldo Truzzi affirme qu’il ne faut pas
sous-estimer la « migration en chaine », responsable selon lui de la « venue de
contingents appréciables. Il y a de nombreux récits d’immigrants qui trouvèrent
rapidement une place dans des entreprises dont les propriétaires, eux aussi d’origine
juive, avaient déjà prospéré et s’étaient établi là depuis plus longtemps »243.
Le commerce ambulant est dominant parmi les juifs du Bom Retiro. Mais certains ont
des boutiques, essentiellement liées à la confection. Souvent après avoir séjourné dans
des pensions, comme la Pensão Chapovalacha244 ou la Pensão Schleif245, les juifs
s’installent dans leur propre maison. Ils résident surtout dans la partie haute du quartier
où leur proportion relative ne cesse d’augmenter face aux Italiens. Selon Truzzi,
utilisant les chiffres du recensement de l’Etat effectué en 1934, ils représentent au
moins un tiers des habitants du quartier. Mais, compte tenu de l’imprécision et du mode
de recensement, par nationalités, Truzzi estime que ces chiffres étaient certainement
plus proches de 40%. Dès le début des années 1940, une hiérarchisation sociale s’opère
parmi les juifs du quartier entre le « haut » du quartier, plus prospère, et le « bas », plus
populaire246. Au sein même de la zone haute, on peut observer des différences en terme
de qualité de logement. Ainsi, « au tournant des années 1940 se forme un habitat
immobilier et mobilier plus riche autour du Jardim da Luz comme, par exemple, la Vila
243 TRUZZI, Oswaldo, op. cit., p.149 : « não se deve menosprezar, no caso judeu, a assim chamada
"migração em cadeia", responsável pela vinda de contingentes apreciáveis. Há muitos relatos de
imigrantes que logo encontraram colocação junto a firmas cujos proprietários, também de origem judaica,
já eram prósperos e encontravam-se há mais tempo estabelecidos ». 244 Rua Ribeiro de Lima. 245 Rua da Graça. 246 KOSMINSKY, Ethel V., « Os judeus no bairro do Bom Retiro (São Paulo : 1925-1955) », Cadernos
CERU, vol.2, n°13, 2002, pp. 47-71.
174
Império »247. La présence démographique croissante et confirmée sur le territoire
contribuent à modifier le paysage du quartier. Le Bom Retiro ne devient pas pour autant
une enclave ethnique dans la mesure où Italiens et juifs continuent à partager des
relations de voisinage – le quartier ne se scinde pas en deux enclaves – et le souvenir
des mêmes débuts difficiles. Très vite, les migrants s’organisent pour faciliter l’arrivée
des nouveaux venus et la vie de ceux qui ont décidé de rester.
Photo 1 : Rua da Graça, Bom Retiro, juin 2007. Photo personnelle.
247 FEBROT, Luiz Izrael, « Cidade judaica : gênesis », In : MEDINA, Cremilda (org.), Paulicéia prometida,
São Paulo, CJE/ECA/USP, 1990, p. 221.
175
B. Les débuts de l’organisation en
communauté(s)
D’une présence quasi nulle au début du 20ème siècle, les juifs ont commencé à constituer
au cours des années 1930 une petite communauté à São Paulo et principalement dans la
quartier du Bom Retiro où le quotidien s’est organisé. Leur présence croissante, leur
expérience de la migration et les débuts de leur insertion sur le marché du travail ont
tout à la fois nécessité et facilité la mise en place d’un réseau communautaire.
L’hétérogénéité du groupe qu’ils constituent se reflète déjà dans leur organisation qui, à
biens des égards, est plus une organisation en diverses communautés ou kehillot qu’en
une seule univoque et uniforme.
a. L’aide aux migrants entre réseaux internationaux
et associations locales
L’aide aux nouveaux migrants est sans doute le premier réseau mis en place. D’abord à
titre personnel, puis par le moyen d’organisations. Le premier soutien revient à
employer, au sein de sa boutique, des coreligionnaires. L’acquisition d’une boutique
propre est rarement immédiate, ainsi le père et le frère de Fany Adler commencent par
du commerce ambulant, la vente de cravates, pour le compte de Moishe Guerchman, un
client du père déjà installé au Brésil. Ce premier emploi leur permet de s’insérer dans le
marché du travail, d’épargner pour ouvrir ensuite leur propre fabrique de miroirs248.
L’insertion économique passe par le travail et l’accès au crédit car souvent les familles
partent avec très peu d’argent. La création d’une Coopérative de Crédit Populaire dans
le quartier du Bom Retiro en 1928 est donc une avancée considérable pour la
communauté. Elle permet de soutenir ceux qui souhaitaient débuter leur vie à São
Paulo. Et la coopérative couvre l’ensemble de l’Etat.
248 Témoignage de Fany ADLER, op.cit.
176
Mais l’aide est aussi institutionnelle. C’est en effet par le biais de différentes
associations étrangères – européennes ou étasuniennes – que la majeure partie des juifs
est entrée au Brésil dans les années 1910 et 1920. La Jewish Colonization Association
(JCA) a, nous l’avons signalé, permis l’installation de colonies agricoles. La Joint (puis
JDC – Joint Distribution Committee for the Relief of Jewish War Sufferers) et la HIAS
(Hebrew Immigrant Aid Society) ont permis la fuite et l’installation de juifs européens
au Brésil, comme dans le cas de Fany Adler et sa famille. Une fois cette migration
effectuée et l’éventuel coup de pouce initial, la vie reste compliquée pour les migrants et
un soutien local se met en place. Entre 1910 et la fin des années 1930, l’essentiel des
organisations d’assistance liées à l’immigration juive est fondé à São Paulo. Au-delà de
leur fonction initiale qui est de fournir les services d’assistance non pris en charge par
l’Etat brésilien, celles-ci contribuent à façonner les contours d’une société juive pauliste
en construction. Ce soutien va contribuer à faciliter l’insertion économique et sociale
des migrants déjà favorisée par les opportunités de travail présentes à São Paulo et les
ressources, les capacités, l’habilité dont témoignent les migrants juifs.
Les associations de bienfaisance, charité et entraide sont organisées selon des
considérations thématiques. La première à voir le jour est destinée à l’assistance et la
prise en charge des femmes enceintes et des nouveaux nés. Il est intéressant de
remarquer que la fille aînée de ces organisations, la Sociedade Beneficiente das Damas
Israelitas, se consacre donc en premier lieu à la famille, témoignant ainsi du caractère
jeune et familial de la migration. Pour une aide médicale à proprement parler, il faudra
attendre 1929 et la création de la Sociedade Beneficiente Linath Hatzedek qui deviendra
la Policlínica. Autre organisation généraliste, mais destinée aux femmes, l’Organização
Feminina de Assistência Social (OFIDAS) est fondée en 1940. Ensuite diverses
associations sont en prise plus directe avec la dimension de migration et parfois d’exil
des populations juives arrivant au Brésil. Il s’agit tout d’abord de la Sociedade
Beneficiente de Auxílio aos Pobres Ezra qui, à partir de 1916, facilite l’arrivée et
l’installation des migrants très souvent démunis. Elle s’allie en 1924 avec la Sociedade
Pró-Imigrante et devient la Sociedade Beneficiante Israelita Ezra. Enfin, dans les années
1930, se mettent en place des organisations destinées plus précisément à l’accueil et au
soutien des réfugiés de l’Allemagne nazie qu’ils soient des enfants (Lar das Crianças de
la Congregação Israelita Pauliste, 1937) ou non (Comissão de Assistência aos
Refugiados Israelitas da Alemanha – CARIA, 1933).
177
Ces fondations d’associations charitables peuvent être comprises suivant deux points de
vue selon Roney Cytrynowicz249. Il peut s’agir d’une simple volonté charitable portée
par l’ « altruisme et (la) philanthropie »250. Mais elles peuvent aussi comprises comme
une volonté de ne pas perturber ou compromettre l’insertion des juifs arrivés
précédemment : elles constitueraient ainsi des « processus de discipline et de contrôle,
dans l’objectif d’insérer et encadrer les migrants et de ne pas laisser leur présence
mettre en danger le statut de ceux qui sont arrivés depuis plus de temps et qui sont déjà
intégrés à la société »251. Quoi qu’il en soit, ces organisations ont atteint leur objectif de
facilitation de l’arrivée, l’installation et la vie des migrants. En plus de ces associations
charitables, un réseau religieux se met progressivement en place. C’est celui-ci qui
révèle les différentes affiliations de pensée des migrants, en connexion avec leurs zones
de provenance géographique et culturelle.
b. Une organisation religieuse en différentes kehillot
Le Bom Retiro et São Paulo de façon générale voient affluer des immigrants de
différents horizons. Ces horizons sont à la fois géographiquement et culturellement très
variés. Et les migrations, en lien étroit avec les conditions économiques et politiques des
pays de provenance, laissent une empreinte sur la façon dont les personnes vont
concevoir leur installation au Brésil. Tous ces facteurs conduisent à la mise en place
d’une organisation spécifique de la vie religieuse qui ne repose pas uniquement sur la
distinction entre rites sépharade et ashkénaze, mais bien aussi sur une répartition par
pays d’origine qui ont tous façonné une façon de concevoir le judaïsme, et parfois aussi
les relations à la société environnante.
249 CYTRYNOWICZ, Roney, « Instituições de assistência social e imigração judaica », História, Ciênciais,
Saúde, Manguinhos, vol.12, n°1, janvier-avril 2005, pp. 169-184. 250 « Altruísmo e filantropia ». Ibid., p.172. 251 « Processos de disciplina e de controle, no sentido de inserir e de enquadrar os imigrantes e não deixar
que sua presença coloque em risco o status dos chegados há mais tempo e já integrados à sociedade », Id.
178
Interviewée par Carlos Alberto Póvoa dans le cadre de la thèse de celui-ci, Raquel
Mizrahi se souvient des relations entre ashkénazes et sépharades à São Paulo durant
cette période :
« La communauté juive ne pouvait pas avoir de lien, au début (…), au moment
de l’arrivée (…) parce que l’un parlait une langue, l’autre parlait une autre
langue, nous avions des coutumes différentes (…), c’était comme si nous étions
deux peuples bien distincts, mais (…) la distance entre le quartier du Bom
Retiro et les quartiers de Mooca et du Brás n’était pas géographique, mais une
question territoriale (…), le lieu des sépharades et le lieu des ashkénazes (…).
Les juifs de Mooca qualifiaient les ashkénazes de "gringos" (…), et les
ashkénazes considéraient les sépharades comme des "turcs" parce qu’ils
venaient du Moyen Orient (…). Les ashkénazes nous désignaient comme des
"juifs de seconde classe", rendez-vous compte… »252
Ces différences culturelles sont visibles dans la plupart des domaines de la vie
quotidienne. Le yiddish n’est la langue que des ashkénazes et est un des marqueurs
culturels très puissants du Bom Retiro. Les sépharades ne partagent pas ce fond culturel.
Les tenues vestimentaires sont différentes même parmi les ashkénazes : aux tenues
traditionnelles portées par ceux venus des campagnes de Pologne, Russie, Lituanie,
s’opposent les habits des juifs allemands ayant adopté les codes de la société dans
laquelle ils s’étaient totalement insérés. Ces différences et ces visions sont très
perceptibles au point de vue religieux.
252 « A comunidade judaica não poderia ter vínculo mesmo, isso no início (…), na chegada (…) porque
um falava uma língua, outro falava outra língua, tínhamos hábitos diferentes (…) era como se fôssemos
dois povos bem distintos, mas (...) a distância entre o bairro do Bom Retiro e os bairros da Mooca e do
Brás não era geográfica, mas uma questão territorial (..) o lugar dos sefaradim e o lugar dos ashkenazim
(...)os judeus da Mooca chamavam os ashkenazim de “gringos” (...), e os ashkenazim consideravam os
sefaradim, como “turcos” por causa da origem do Oriente Médio (...) os ashkenazim nos atribuíam como
“judeus de segunda classe”, imagina... » Interview de la Professeur Raquel Mizrahi, 2007, São Paulo,
réalisée par Carlos Alberto Póvoa. Cf. POVOA, Carlos Alberto, A territorialização dos judeus na cidade
de São Paulo-SP : a migração do Bom Retiro ao Morumbi, Thèse de doctorat sous la direction de Rosa
Ester Rossini, Géographie Humaine, São Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de Letras e
Ciências Humanas (FFLCH), 2007, p.158.
179
A cette distinction entre sépharades et ashkénazes se superpose en effet une vision sur
les pratiques religieuses entre libéraux et orthodoxes. Cette distinction devient patente
avec l’arrivée des juifs allemands qui ont échappé au nazisme. Selon Lesser, ceux-ci
seraient environ 9400 à avoir quitté l’Allemagne et à avoir rejoint le Brésil entre 1933 et
1941. Leurs origines sociales et culturelles se distinguent très nettement de celles des
autres ashkénazes : ils sont souvent qualifiés, voire très qualifiés, instruits, membres des
professions libérales, gérants d’entreprise, commerçants ou travaillant dans la finance.
Contrairement aux sépharades et aux ashkénazes d’Europe orientale, ils sont bien plus
libéraux: ils ne portent pas la kipa ou les vêtements traditionnels. Ce sont des « juifs
modernes et préoccupés par le maintien d’un judaïsme libéral, ils ne parl(ent) pas
yiddish et (sont) opposés au traditionalisme religieux ». Leur vision du libéralisme,
qu’ils opposent au traditionalisme, se comprend à leur façon de vivre la religion qui est
plus une expérience intime, privée, que des rites extériorisés. C’est une pratique aussi
plus « moderne » dont Sara Lerner parle, à la lumière de son expérience dans un internat
allemand religieux mais non orthodoxe :
« Les juifs allemands étaient très en avance, il y avait des personnes très
importantes parmi les juifs, non ! Mais, mais ils nous enseignaient le samedi, le
directeur nous donnait les cours de religion et nous racontait l’histoire des juifs
depuis les temps précédant Pharaon ! Et tout ça, mais ce n’était pas casher et les
prières étaient chantées »253.
De leur côté, les ashkénazes d’Europe de l’Est, réunis dans le Centro Brasileiro
Hebraico qui est une fédération d’associations communautaires, « se méfient des
nouveaux venus d’Europe Centrale, vus (…) comme "assimilationnistes" et
"antijuifs" »254.
253 « Os judeus alemães eram muito adiantados, tinha pessoas importantíssimos do lado dos judeus, non!
Mas eh, mas ensinavam nós o Sábado, odiretor que dava aulas de religião pra nos e contava a historia dos
judeus desde o tempo de antes o Faraó, non! E isso, mas não era cocher e as rezas eram cantadas. »
Témoignage de Sara LERNER, op.cit. 254 Eles « desconfiavam dos recém-chagados da Europa Central, vistos por eles como “assimilacionistas”
e "antijudaicos" ». POVOA, op. cit., p.159.
180
Les divisions entre sépharades et ashkénazes d’une part, et au sein même des
ashkénazes d’autre part se répercutent dans la mise en place d’organisations religieuses
qui vont en outre avoir des perceptions très différentes sur la façon d’envisager
l’installation au Brésil. L’association à caractère religieux, mais s’adressant à tous, est
la Sociedade Cemitério Israelita qui commence à fonctionner en 1923 et se charge des
services funéraires de l’ensemble de la communauté. Le reste des organisations a une
orientation plus marquée. Pour l’essentiel, il s’agit de temples fonctionnant de façon
isolée et n’ayant qu’une fonction religieuse. Les activités religieuses de la
« communauté séfarade » sont réparties au sein de deux temples : la Sinagoga Ohel
Yaacov créée en 1928 et la Sinagoga Israelita Brasileira en 1930. Pour les ashkénazes, il
s’agit, dans l’ordre chronologique de leur fondation, de : la Sinagoga Israelita de São
Paulo (1912), la Knesset Israel (rattachée à la Sociedade Israelita Pauliste, 1916), le
Templo Beth El (de la Congragação Israelita Ashkenazi, 1929), la Sinagoga Israelita
Pauliste (1931), la Sinagoga Israelita Brasileira do Brás (1933), la Sinagoga Israelita de
Pinheiros Beith Jacob (1937), tous d’orientation traditionnelle, et enfin la Congragação
Israelita Pauliste (1936) d’orientation libérale. Le cas de la CIP est un peu particulier car
elle est le fruit de l’évolution de la SIP – Sociedade Israelita Pauliste (1934) –
association créée par des juifs allemands installées à São Paulo et devant faciliter la
conciliation entre l’héritage juif et l’insertion dans la société brésilienne. Cette
association se dote en 1936 d’un rabbin, Fritz Pinkuss, venu de Heidelberg en
Allemagne et frère de l’un des fondateurs de la SIP. C’est la seule véritable organisation
religieuse et culturelle d’orientation véritablement libérale.
On voit donc que dès la fin des années 1930, différentes kehillot calquées les
organisations des migrants suivant leurs origines géographiques, culturelles et
religieuses, sont présentes à São Paulo.
c. Assurer une continuité : la mise en place rapide
d’un réseau culturel et scolaire
181
Organisations charitables, mise en place d’une offre religieuse, l’installation signifie
aussi le développement d’un réseau culturel et scolaire. Celui-ci va permettre d’offrir un
enseignement non catholique et de maintenir et transmettre l’héritage culturel,
historique de ces migrants. Il pallie aussi la méconnaissance de la langue portugaise. Il
témoigne enfin de la difficulté, pour tout migrant, de s’insérer dans une société en niant,
abandonnant toute référence à son univers culturel. Ce réseau permet de maintenir un
lien avec le passé et atteste une volonté de ne pas le nier. Très rapidement des journaux,
programmes radio, théâtres, écoles, activités sportives, conférences même pro sionistes,
cours de langue hébraïque, yiddish et portugaise se développent.
En effet, une des priorités est la création d’un réseau scolaire propre inexistant pour les
premiers migrants. Un des premiers obstacles à la fréquentation des écoles locales est la
méconnaissance de la langue portugaise. Fany Adler explique ainsi : « Au début, ça a
été très difficile. Sans amies, sans connaître la langue, ma personnalité a beaucoup
changé avec cette émigration ». Mais elle fréquente finalement une école classique, la
Escola de Comercio Prudente, Avenida Tiradentes. Les parents de Sara Lerner font un
autre choix. À défaut d’une école judaïque encore inexistante en 1912, ne voulant pas
que celle-ci fréquente une école catholique, mais sachant par des contacts en Europe
qu’il existe un internant à Hanovre, son père décide de l’envoyer y faire ses études
secondaires. Sara part donc s’installer en Allemagne à 10 ans. Elle rentre en 1918255. La
première école n’est créée qu’en 1922, il s’agit du Colégio Hebraico Brasileiro
Renascença. D’autres suivront comme la Escola Luiz Feitlich en 1937256. Ce réseau
scolaire est complété par l’ouverture de bibliothèques maintenant un fonds littéraire en
yiddish et en hébreu, comme la Biblioteca Israelita. Fany Adler qui vit alors avec sa
famille dans le Bom Retiro témoigne de l’intérêt de ces bibliothèques publiques
destinées aux membres de la communauté juive :
« Les livres me manquaient. J’aimais beaucoup lire mais nous n’avions pas
les moyens d’acheter des livres. J’ai découvert une bibliothèque Rua da
Graça, une bibliothèque fréquentée par des Polonais qui étaient antisémites.
255 Témoignage de Sara LERNER, op.cit. 256 FALBEL, Nachman & Equipe de História Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, « A Imigraçao
Judaica em São Paulo », Herença Judaica, n°88, avril 1994, p. 8.
182
J’ai arrêté de fréquenter la bibliothèque. J’avais environ 15 ans. Je lisais en
yiddish. Ensuite a été fondée la Poilisher Farband où il y avait aussi des
livres »257.
En dehors des écoles et des bibliothèques, des organisations développent des activités
culturelles, notamment le théâtre comme le groupe Sholem Aleichem et la Sociedade
Philo Dramática, de loisirs dès les années 1910 avec la Sociedade Juventude Israelita
puis le Círculo Israelita de São Paulo (1926), et même sportives comme le Clube
Esportivo Israelita Macabi (1927). De leur côté, la WIZO – Women International
Zionist Organization – fondée en 1926 et la SIP puis la CIP – Sociedade puis
Congregação Israelita Pauliste – organisent conférences et débats. La WIZO a des
objectifs philanthropiques, sociaux et d’éducation, tout en ayant une dimension
politique. La SIP, puis la CIP, participe à la formation des migrants leur proposant des
cours de langue, culture, religion, histoire. La CIP a également des projets politiques en
promouvant l’insertion à la société brésilienne sur le modèle de l’intégration pratiquée
en Allemagne. Il faut enfin signaler la richesse de la production écrite très sensible à
travers la profusion de journaux et revues en yiddish, en allemand, mais aussi en
portugais dès 1933258.
La vie institutionnelle qui se met en place dès les années 1910 recouvre tous les aspects
de la vie sociale des immigrés juifs. Elle permet une installation progressive, elle
facilite l’arrivée, l’insertion professionnelle et économique, mais aussi culturelle et elle
dessine les contours d’une judéité brésilienne en formation. Elle est très riche,
présentant diverses tendances et cultures. C’est pourquoi on voit déjà apparaître
différents courants témoignant de la pluralité des sensibilités représentées qui prennent
la forme d’autant de kehillot. La création de la FISP – Federação Israelita de São Paulo
– en 1946, vient clôturer d’une certaine façon l’institutionnalisation de la présence juive
à São Paulo puisqu’elle introduit de nouveaux objectifs, différents de ceux de l’entre-
257 Témoignage de Fany ADLER, op.cit. 258 On peut citer en yiddish : le Idisher Gezlschaftlicher und Handels Buletin (Bulletin social et
commercial judaïque, 1928), Idish Velt (Le Monde juif, 1928), tout deux de courte durée, et le San Pauler
Idishe Zeitung (Journal Juif de São Paulo, 1931) ; et en portugais : A Civilização (La Civilisation, 1933),
Páginas Israelitas (Pages israélites, 1940) et la Crônica Israelita (Chronique Israélite, 1940).
183
deux-guerres : il s’agit désormais de représenter, selon Cytrynowicz259 et Lesser260, les
intérêts d’une communauté de « juifs-brésiliens », une communauté à l’identité déjà en
trait d’union261, avec « ses préoccupations d’image publique comme groupe face à la
société »262. Quel est justement le rapport qui se crée avec l’Etat durant cette période ?
II. Un Etat ambigu émettant des signaux
contradictoires
Sous l’ère Vargas, et particulièrement pendant l’Estado Novo, nous avons vu que l’Etat
adoptait des mesures visant à contenir l’arrivée des juifs dans le pays, à limiter leur
entrée sur le territoire national. D’après les tenants de cette politique en effet, les juifs
constituaient une menace pour le développement de la nation pour plusieurs motifs. Le
premier d’entre eux avait une dimension religieuse et se prolongeait par une
justification raciale : les juifs sont par nature différents et inassimilables. Le deuxième
reposait sur leur profil politique supposé : internationalistes, communistes ou
capitalistes, cherchant quoi qu’il en soit à renverser les Etats et à dominer le monde.
L’attitude de l’Etat brésilien face à la question juive a été guidée par l’objectif
nationaliste, fondement de la politique gétuliste : le développement passait, au vu de
l’adoption de la théorie du blanchiment, par l’immigration d’origine européenne mais
aussi par l’intégration réelle de la population brésilienne déjà présente par le métissage
culturel et biologique. Elle visait aussi à développer un sentiment d’appartenance
nationale. Les préjugés concernant les juifs européens n’ayant pas disparu, ils ont
justifié l’adoption de politiques spécifiques notamment en termes migratoires. Le
259 CYTRYNOWICZ, Roney, « Instituições de assistência social e imigração judaica », História, Ciênciais,
Saúde, Manguinhos, vol.12, n°1, janvier-avril 2005, pp. 169-184. 260 LESSER, Jeffrey, Negociating national identity : immigrants and the struggle for ethnicity in Brazil,
Durham, Duke University Press, 1998, 281p. 261 « Hyphen identity » 262 « suas preocupações de imagem pública como grupo frente à sociedade », CYTRYNOWICZ, Roney,
2005, op. cit, p.181.
184
développement au Brésil de mouvements sionistes dès la fin du 19ème siècle et la
création de la Fédération Sioniste du Brésil en 1922 confirment l’activité politique des
juifs paulistes si crainte et désapprouvée par les nationalistes. Ainsi, même si le
sionisme n’est pas prôné par l’ensemble de la communauté juive brésilienne, il n’est
finalement remis en question que par une autre forme politique : le Bund. Comme le
rappelle Samuel Malamud,
« Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le mouvement sioniste ne
prédominait et ne rassemblait pas la majorité de la population des
communautés juives d’Europe Orientale. Le mouvement le plus populaire,
particulièrement en Pologne, était le Bund, mouvement socialiste judaïque
ayant surgi à la fin du 19ème siècle en Russie et qui luttait pour l’autonomie
des minorités nationales. C’est pourquoi il était antisioniste et combattait
l’idée de la création d’un Etat juif souverain en Eretz Israël. Le Bund avait
pour principal leader et théoricien le marxiste Vladimir Medem. En outre,
même ceux qui professaient les thèses sionistes se subdivisaient en
différentes conceptions politiques à l’intérieur du sionisme. La subdivision
persiste aujourd’hui et va de l’extrême droite à l’extrême gauche, incluant
les religieux, eux-mêmes divisés »263.
Ces deux mouvements, le sionisme d’une part et le Bund proche du marxisme d’autre
part, ont une dimension internationale très prégnante. C’est pourquoi on peut se
demander si la participation ou simplement la supposition de la participation de juifs
installés au Brésil à ces mouvements ne vient pas rallumer la hantise du gouvernement
Vargas et contrarier l’objectif nationaliste. En outre, plus encore que le sionisme,
263 « Até a II Guerra Mundial o movimento sionista não predominava nem aglutinava a maioria da
população das comunidades judaicas da Europa Oriental. O movimento mais popular, especialmente na
Polônia, era o Bund, movimento socialista judaico surgido no fim do século XIX na Rússia e que lutava
pela autonomia das minorias nacionas. Por isso mesmo era anti-sionista e combatia a idéia de criação de
um Estado judaico soberano em Eretz Israel. O Bund teve como seu proeminente líder e teórico o
marxista Vladimir Medem. Além disso, mesmo os que professavam as teses sionistas se subdividiam em
várias concepções políticas dentro do sionismo. A subdivisão persiste até hoje e vai da extrema-direita à
extrema-esquerda, incluindo os religiosos, por sua vez subdivididos. » MALAMUD, Samuel, Do Arquivo e
da Memória : fatos, personagens e reflexões sobre o sionismo brasileiro e mundial, Rio de Janeiro,
Bloch, 1983, p.29.
185
l’existence du Bund ou la proximité de certains juifs avec le communisme, à un moment
où la lutte contre celui-ci est déjà une des priorités de la police politique (DOPS),
portent à croire que ces années 1930-1947 ne sont pas une période facile pour la
participation des immigrés juifs dans la vie nationale brésilienne. En ce sens, la fin du
gétulisme en 1947 marquerait un tournant pour l’intégration pleine et entière des juifs
au Brésil. Qu’en est-il concrètement ? Peut-on noter une différence de traitement pour
les immigrés juifs par rapport aux autres immigrés ? Ont-ils particulièrement souffert
pendant cette période ? L’Etat brésilien a-t-il posé des obstacles à leur installation ?
A. Les polémiques quant aux intentions
de l’Etat : la question des obstacles
spécifiques à la vie des immigrés juifs
Deux thèses s’affrontent en la matière, chacune a son porte-parole. La première est celle
de Maria Luiza Tucci Carneiro264 qui cherche à démontrer que ces années 1930-1947 et
plus particulièrement à partir de 1937 constituent une période singulièrement difficile
pour les juifs installés au Brésil. Selon l’auteur, suivie par d’autres comme Taciana
Wiazovski265, la communauté juive est alors particulièrement sous surveillance. Par
ailleurs elle souffre d’attaques visant à limiter le fonctionnement de ses organisations.
La seconde thèse est celle de Jeffrey Lesser266 rejoint notamment par Roney
Cytrynowicz267. Selon Lesser, les préjugés à l’encontre des juifs avant leur arrivée vont
être renversés : de handicaps, ils deviennent des atouts. Ainsi la suspicion de
capitalisme deviendrait une valeur positive une fois au Brésil puisque leurs capitaux
264 TUCCI CARNEIRO, Maria Luiza, O anti-semitismo na era Vargas : Fantasmas de uma geração (1930-
1945), São Paulo, Perspectiva, 2001, 536p. 265 WIAZOWSKI, Taciana, Bolchevismo e judaísmo : a comunidade judaica no olhar do Deops, São Paulo,
Arquivo do Estado, Imprensa Oficial, 2001, 195p. 266 LESSER, Jeffrey, Welcoming the Undesirables. Brazil and the Jewish Question, Berkeley et Los
Angeles, University of California Press, 1995, 280p. 267 CYTRYNOWICZ, Roney, « Além do Estado e da ideologia : imigração judaica, Estado-Novo e Segunda
Guerra Mundial », Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 22, n°44, pp. 393-423.
186
permettraient le développement de l’économie locale. Surtout, Lesser et Cytrynowicz
démontrent que même si les préjugés ont perduré et ont conduit à placer des obstacles
dans l’organisation sociale des juifs, ceux-ci n’ont pas eu un comportement victimaire
et ont su s’adapter, permettant que le réseau communautaire continue de se développer
pendant cette période.
La politique menée sous l’Estado Novo n’est pas exempte d’ambiguïtés c’est pourquoi
elle peut soulever autant de polémiques : « Jusqu’à l’entrée en guerre des Etats-Unis, en
1941, Vargas mène une politique d’équilibre entre fascismes et démocratie »268. Celui-
ci ne cache pas une certaine forme d’admiration pour l’efficacité nazie et mussolinienne
avec lesquels – particulièrement avec l’Allemagne – il développe les échanges
commerciaux, tout en maintenant des liens économiques avec les Etats-Unis. Au sein de
son gouvernement, deux tendances s’affrontent :
« Goes Monteiro, à la tête de l’état-major, et Eurico Dutra, la ministre de la
Guerre, aux sympathies nazies avérées, poussent au rapprochement avec le
Reich, tandis qu’Osvaldo Aranha, l’inamovible ministre des Relations
extérieures, met toute son autorité au service de la cause de Washington »269.
Cette position de Aranha est remise en question par Maria Luiza Tucci Carneiro à
plusieurs reprises dans son ouvrage, O anti-semitismo na era Vargas. Elle fait peser
plus qu’un simple doute sur la probité d’Aranha dans sa thèse, ce qui n’a pas manqué de
susciter des réactions sur la scientificité de sa démarche270. Utilisant des sources
primaires d’une grande qualité, le travail de Carneiro est pourtant très militant et
clairement à charge. Faute de pondération, de mise en perspective, de recul, ses
arguments perdent beaucoup de leur intérêt. Vingt ans plus tard, Carneiro modère
268 MARIN, Richard, In : BENNASSAR, Bartolomé & MARIN, Richard, op. cit., p.347. 269 Id.
270 Sur les réactions face à la thèse de Tucci Carneiro, voir par exemple la note de lecture écrite par
Marcos Chor Maio pour la revue Estudos Históricos : MAIO, Marcos Chor, « O anti-semitismo na era
Vargas: fantasmas de uma geração (1930-1945), de Maria Luiza Tucci Carneiro. São Paulo, Brasiliense,
1988, 600 p. », Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1988, p. 304-310.
187
quelque peu ses propos dans un entretien accordé au journal A Folha de São Paulo271.
Toutefois, si elle concède un profil pro Etats-Unis à Oswaldo Aranha, elle réaffirme
cependant qu’en tant que ministre des Affaires étrangères, celui-ci a fait appliquer les
circulaires secrètes limitant l’entrée des juifs sur le territoire. Selon nous, cette position
gouvernementale est cependant très nettement liée au rejet du communisme et à la
démarche autoritaire nationaliste du régime. Selon Richard Marin, « le dictateur rejette
tant "l’impuissance" démocratique que le communisme et admire le sens de l’ordre du
fascisme et du nazisme »272. Ses objectifs sont clairement définis : la formation d’un
Etat fort centralisateur et surtout unificateur (territorialement et culturellement), un
nationalisme économique et la lutte contre le communisme. Ses moyens sont simples :
la lutte contre le communisme, le développement économique et industriel, le
renforcement de la défense nationale, l’interdiction des partis politiques et la formation
de syndicats soumis à l’autorité de l’Etat273.
B. La suspicion de communisme ou la
« force du préjugé »274
Dans ce cadre, les juifs présents sur le sol brésilien ont dû faire face à certaines
difficultés bien réelles, notamment la force du préjugé. Que l’Etat soit antisémite ou
non, il n’échappe pas à toute une série de poncifs sur ce que les juifs sont sensés être ou
faire. En cela, la proximité de personnalités antisémites au sein du gouvernement
Vargas a nécessairement joué. Comme nous l’avons expliqué, les antisémites font de
tous les juifs des communistes. Et certains juifs, nous l’avons aussi dit, ont réellement
une sensibilité marxiste. Dans son ouvrage, Taciana Wiazovski évalue ainsi l’attitude de
271 « A solução parcial, Entrevista com Maria Luiza Tucci Carneiro », entretien réalisé par Mario Gioia
pour A Folha de São Paulo, Caderno + mais !, 20.04.2008. Entretien disponible sur le blog Estudos
Judaicos : http://estudosjudaicos.blogspot.com/2008/04/soluo-parcial-entrevista-com-maria.html 272 MARIN, Richard, in BENNASSAR & MARIN, op. cit., p.347. 273 CARVALHO, José Murilho de, Cidadania no Brasil, o longo caminho, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2006, pp. 87-126. 274 Expression empruntée à Pierre-André Taguieff.
188
la police politique brésilienne à l’égard des juifs communistes comme une manifestation
de l’antisémitisme de l’Etat. Selon elle, la DOPS était particulièrement vigilante envers
les juifs, le judaïsme étant un facteur de suspicion de communisme. Elle explique ainsi
que les fiches des personnes supposées communistes ne portaient la mention « juif » ou
« israélite », mais jamais « catholique », démontrant une attitude spécifique à leur
égard :
« La préoccupation de la police quant au fait qu’un individu soit juif et/ou
communiste peut être constatée dans les annotations effectuées dans un
rapport qui contient, entre autres choses, celui de "Différentes Adresses".
Dans un premier temps, cette rubrique n’avait pas d’autre utilité que de
répondre à la préoccupation constante des enquêteurs de pouvoir localiser le
plus grand nombre possible des subversifs. Mais les registres assument aussi
une autre dimension dans la mesure où nous pouvons constater que, à côté
de l’identification – "Persach Elias Tigel – communiste – Lgo. Riachuelo,
n°7" –, était ajouté le terme "JUIF".
Le sujet en question a été classifié comme communiste et juif. Si le critère
était religieux, les autres noms seraient probablement accompagnés de leur
religion respective, ce qui n’est pas le cas. Ensuite, il y avait une attention
particulière portée sur les juifs, de façon générale. Selon l’historienne Tucci
Carneiro, spécialiste de l’antisémitisme dans la période Vargas, le fait que le
terme juif apparaisse entre guillemets et écrit en lettres majuscules n’arrivait
pas sans raison ou ingénument. D’autres expressions similaires peuvent être
constatées dans des situations qui, évaluées dans le contexte de la répression
des années 30 et 40, confirment la persistance d’une mentalité antisémite au
sein des autorités dirigeantes du Pouvoir »275.
275 « A preocupação da polícia quanto ao fato indivíduo judeu e/ou comunista pode ainda ser constatada
em anotações reservadas efetuadas em um relatório que contém, entre outros itens, o de "Endereços
Vários". Numa primeira avaliação, esse tópico não tem outro sentido além da constante preocupação dos
investigadores de localizar o maior número possível de subversivos. Mas os registros assumem uma outra
dimensão ao constatarmos que, ao lado da identificação – "Persach Elias Tigel – comunista – Lgo.
Riachuelo, n°7" – , foi acrescentada a palavra "JUDEU".
O sujeito em questão foi classificado como comunista e judeu. Se o critério fosse religioso,
provavelmente os outros nomes viriam acompanhados de suas respectivas religiões, o que não é o caso.
Logo, existia uma expectativa direcionada para os judeus, de uma maneira geral. Segundo a historiadora
Tucci Carneiro, pesquisadora do anti-semitismo no período Vargas, o fato de o termo judeu aparecer
189
A notre sens, l’ouvrage de Wiazovski est un document très intéressant car il fournit,
outre des synthèses, des fiches constituées par la DOPS puis DEOPS. Cependant, la
quasi-totalité de ces synthèses comporte la mention de communisme à l’exception de
quelques unes pouvant indiquer prostitution, vol, camp de concentration (sort des
survivants de l’holocauste plus précisément), naturalisation, immigration illégale et
expulsion, actions antifascistes contre l’armée. Sur 113 cas recensés et fichés par
l’auteur jusqu’aux années 1970, seuls 5 ne correspondent pas à une suspicion de
communisme. Seules certaines fiches n’ont pas la mention « juif ». Ces faits
corroborent l’idée que le judaïsme constitue certainement une caractéristique que les
autorités recherchaient chez les communistes. En ce sens, nous concordons avec l’idée
selon laquelle « la police (était) attentive à l’idée d’un complot judaïco-communiste de
portée internationale », ce qui « (l’)a conduite à détecter un secteur israélite au sein du
Parti Communiste »276. Cependant, là où nous émettons des réserves réside dans
l’utilisation du terme antisémitisme. En effet, nous pouvons affirmer qu’il existait bel et
bien un préjugé à l’égard des juifs concernant leurs liens supposés avec le communisme.
Mais cette filiation au communisme était une réalité pour certains juifs installés au
Brésil. Ce préjugé a conduit à une « vigilance » particulière à l’égard de la communauté
juive et a provoqué des expulsions dont un des cas le plus connus est celui d’Olga
Benário277. Cependant, d’une part, il n’était non sans fondement et surtout il a conduit à
des enquêtes individualisées. De ce fait, il nous semble incohérent de parler d’une
empregado entre aspas e escrito em letras maiúsculas não ocorria sem razão ou ingenuamente. Outras
formas de expressão similares podem ser constatadas em situações que, avaliadas no contexto dos anos
30 e 40, confirmam a persistência de uma mentalidade anti-semita presente nas autoridades gerenciadoras
dos órgãos do Poder. » In : WIAZOWSKI, Taciana, op. cit., p.33. 276 « A polícia, attenta à idéia de um complô judaico-comunista de âmbito internacional, chegou a detetar
um setor israelita no Partido Comunista ». Ibid., p.34. 277 Olga Benário est une militante communiste juive d’origine allemande, l’une des fondatrices de l’ANL.
Elle rencontre Luis Carlos Prestes à Moscou, où tous deux sont réfugiés, lors du Ve Congrès mondial de
la jeunesse communiste internationale de 1931. Ils se marient et s’installent à Rio de Janeiro. Tous deux
sont dénoncés et arrêtés en 1936. Enceinte, Olga Benário est remise aux autorités allemandes. Sa fille
Anita nait en prison. Olga Benário est ensuite déportée dans le Camp de concentration de Ravensbrück et
assassinée dans une chambre à gaz de Bernburg. Sa fille échappe aux chambres à gaz à la suite d’une
mobilisation internationale. Son histoire est relatée dans un livre devenu un classique : MORAIS,
Fernando, Olga, São Paulo, Editora Alfa-Omega, 1985, 314p.
190
essentialisation de la communauté dans son ensemble. Oui, il y a préjugé, mais oui,
aussi, il y a enquête. C’est pourquoi plus que d’antisémitisme – qui supposerait une
indifférenciation des individus – nous préférons conclure à une présomption portant sur
certains individus. D’ailleurs, il est utile de préciser qu’une des fiches indique qu’un juif
a dénoncé deux autres juifs à la police car il les supposait communistes. Ce fait nous
confirme que l’objectif anticommuniste était sans doute le moteur de cette politique et
qu’il était partagé par certains juifs brésiliens. Il n’en est pas moins sûr que la force du
préjugé a joué en la matière, que certains policiers ont été antisémites tout comme des
membres du gouvernement, et enfin que cette lutte contre le communisme a conduit à
des expulsions de juifs installés au Brésil. Là, où nous nous distançons donc de Tucci
Carneiro et Waziovski n’est pas sur le fait que les juifs au Brésil ont été sous la
vigilance plus qu’accrue de la police politique, mais plutôt sur le fait que
l’antisémitisme n’a pas été, à notre sens et au regard de la farouche bataille engagée
contre le communisme, le moteur de cette vigilance. Selon nous, la surveillance des
juifs au Brésil est liée au préjugé liant communisme et judaïsme. Dans chacun des cas
cependant, le préjugé a été mis à l’épreuve d’une enquête, ce qui nie un comportement
aveuglément antisémite.
Un autre point mérite d’être débattu, celui de l’attitude de l’Etat brésilien à l’encontre
des associations communautaires qui se mettent en place dès les années 1910 comme
nous l’avons vu plus haut. Ces associations ont subi les mêmes restrictions que
l’ensemble de toutes les organisations étrangères et politiquement engagées. D’une part,
il a été interdit que la direction ne soit tenue par des étrangers, d’autre part, l’activisme
politique qu’il se fasse dans le cadre de partis, de syndicats ou même d’associations a
été interdit, enfin, la langue portugaise a été imposée comme unique langue véhiculaire
notamment dans la presse ou les écoles. Évidemment, ces restrictions menées par un
Etat autoritaire ont touché les organisations développées par les immigrés juifs au
Brésil. La question qui se pose ici est de savoir si, là encore, la cible de ces politiques
étaient les juifs. Avant cela, il faut aussi se demander si cela a perturbé, au quotidien, la
vie de toutes ces associations communautaires.
191
C. Associations communautaires face au
nationalisme unificateur
La première « victime » de Vargas, avant même la proclamation de l’Estado Novo, est
l’Aliança Nacional Libertadora. Face à la montée en puissance de l’Intégralisme, ce
mouvement regroupant communistes, socialistes et divers démocrates est créé en mars
1935 sous la houlette du Komintern. Profitant de la première Loi de Sécurité nationale,
loi n°38 du 4 avril 1935, Vargas dissout cette organisation. L’ANL continue à
fonctionner, mais dans la clandestinité. Cette volonté de contrecarrer la « menace
communiste » est une des seules constantes de toute l’ère Vargas. Et c’est le Plan
Cohen, monté de toutes pièces et présenté comme un plan de subversion communiste,
qui va lui permettre de mettre une place une politique fermement nationaliste et anti-
communiste. Pour réduire à néant l’opposition, tous les partis politiques (dont l’Action
Intégraliste) sont dissous dès le 2 décembre 1937. Toute participation à une association
ou à un parti politique devient, de fait, une atteinte à la sécurité de la nation. Très
rapidement, des limitations visant au contrôle et à la « nationalisation » de la population
brésilienne sont mises en place. Comme le rappelle Jean-Pierre Blancpain,
« La Constitution de 1937 est d’ailleurs très claire, qui proclame la nécessité
d’empêcher "l’édification artificielle de minorités ethniques, linguistiques et
religieuses", afin de "préserver l’unité ancienne", précisant que "le Brésil est
de tous les pays celui qui a le plus éprouvé ce danger d’une idée des
minorités étrangères au droit et au fait américain" »278.
Les affaires intérieures jouent aussi sur le plan international. Ainsi, après avoir mené
une politique ambiguë et entretenu des rapports de coopération avec l’Allemagne, la
donne change très nettement en 1938. « La campagne nationaliste provoque même de
278 BLANCPAIN, Jean-Pierre, Les Juifs allemands et l’antisémitisme en Amérique du sud, Paris,
L’Harmattan, 2008, 250p., p. 86. L’auteur se réfère à la Legislação do Novo Governo, Rio de Janeiro,
1938, fasc. 1, pp.3-440. Citée par La revue générale de Droit international public, sept. 1939, n°5,
pp.576-577.
192
sérieuses tensions diplomatiques avec Berlin »279. En effet, dans les colonies allemandes
du sud du pays, principalement dans les trois Etats du Rio Grande do Sul, Paraná et
Santa Catarina, l’influence politique du Reich a contribué à l’essor du nazisme au sein
même du Brésil. Des photographies trouvées dans le département archives de la
bibliothèque de l’Etat du Paraná à Curitiba montrent que des défilés étaient organisés.
Malheureusement, ces images, que nous avons pu consulter pendant la préparation du
DEA ne sont pas en notre possession aujourd’hui. En fait, l’Allemagne nazie a
développé une propagande à l’attention du million d’Allemands ou descendants
d’Allemands vivant au Brésil.
« Les colonies, dès 1930, sont prises en main par l’Ausländische
Organisation (AO) du parti nazi, véritable "cinquième colonne" dirigée par
le Gauleiter Bohle, Allemand de l’étranger lui-même, né en Angleterre et
élevé en Afrique du Sud. Indépendant du ministère des Affaire étrangères
(auswärtiges Amt), il est chargé par les S.S. de faire revenir dans la
communauté nationale le Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA),
association unifiée des groupements culturels germanophones de l’étranger
créés par Bismarck »280.
C’est un travail de propagande nazie, disposant d’une organisation hiérarchique,
partisans, presse et même d’une police, qui est mené au sein des colonies. Il s’agit de
convaincre les brésiliens d’origine allemande de rejoindre leurs rangs en montant
« l’efficacité » et « le travail allemands » contre « l’indolence créole »281. Ce travail
obtient des résultats, certes, mais il ne parvient pas à convaincre l’ensemble de la
population d’origine allemande dont la fidélité au Brésil est réaffirmée régulièrement282.
279 MARIN, Richard, In : BENNASSAR & MARIN, op. cit., p.348. 280 BLANCPAIN, Jean-Pierre, op. cit., p. 85. 281 Le « Jour du colon », visant à célébrer, à partir du centenaire de la colonie de São Leopoldo en 1924,
l’apport des colons au développement du pays est ainsi détourné en 1935 de son objectif national : les
nazis cherchent à en faire le symbole de la supériorité allemande et des caractères propres aux Allemands,
nécessairement supérieurs à eux des brésiliens créoles, c’est-à-dire métisses. 282 Voir notamment : METZLER, F., « Deutsch-brasilianische Probleme », Deutsches Volksblatt, Porto
Alegre, Typ. do Centro, 1935, p.71, 86.
193
Cependant, ces organisations vont être combattues283, au même titre que toutes celles
mettant en danger l’unité nationale brésilienne provoquant une rupture avec Berlin. La
campagne de nationalisation touche l’ensemble des minorités présentes sur le territoire,
qu’elles soient italiennes, allemandes ou japonaises. L’établissement du portugais
comme langue véhiculaire d’enseignement conduit à la fermeture de plus d’un millier
d’établissements germaniques. En outre,
« le décret-loi d’avril 1938, prohibant toute activité politique des étrangers
au Brésil, entraine la dissolution de 80 sections et plus du parti national-
socialiste, dans les Etats du Sud. S’ensuit un très sérieux différend avec
l’ambassadeur Ritter qui, après avoir protesté contre ces mesures, est déclaré
persona non grata à Rio. À partir d’octobre 1938, il n’y a plus que des
chargés d’affaires dans les deux capitales »284.
Les relations diplomatiques sont rompues en 1942, année où Vargas dénonce
l’antisémitisme (22 décembre).
L’action nationalisatrice conduit les associations juives à s’adapter. L’interdiction des
partis politiques, l’obligation faite aux associations d’être dirigées par des Brésiliens,
l’enseignement en portugais sont autant de mesures portant atteinte à la liberté
d’association et d’organisation. L’essentiel des travaux sur la question portent à croire
que la communauté juive a été particulière visée par ces décrets-lois. Comme nous
venons de le voir, elle n’a pas été la seule concernée par la volonté d’assimilation et
d’annihilation de l’opposition politique. Nous avons également signalé que cette
période des années 1930 jusqu’à la fin de la seconde Guerre mondiale a vu se
développer un large réseau associatif. Selon Cytrynowicz285, la communauté juive a su
composer avec les restrictions et les institutions judaïques ont continué à fonctionner
activement durant cette période. Celui-ci précise même : « En tant que groupe, les juifs
n’ont souffert d’aucune discrimination spécifique, étant soumis aux mêmes contraintes
283 Voir notamment les travaux de Ana Maria Dietrich et plus spécialement Caça às suásticas : o Partido
Nazista em São Paulo sob a mira da polícia política, São Paulo, FAPESP, 2007, 385p. 284 MARIN, Richard, In : BENNASSAR & MARIN, op. cit., p.348. 285 CYTRYNOWICZ, Roney, « Além do Estado e da ideologia : imigração judaica, Estado-Novo e Segunda
Guerra Mundial », Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 22, n°44, pp. 393-423.
194
et interdits que les autres groupes immigrants, à savoir parler, enseigner, ou éditer des
journaux dans des langues considérées "étrangères" »286. Cytrynowicz montre dans son
article que les associations, la presse et même des émissions de radio n’ont pas été
éradiqués. De plus, un activisme politique en faveur des alliés et de l’entrée en guerre a
pu être observé. Des ajustements ont été effectués, des comités de direction des
associations ont été modifiés, le portugais s’est imposé. Mais la vie des associations n’a
pas été remise en question. Même si l’on analyse le fonctionnement du réseau scolaire,
dont on sait qu’il a été un des moyens de nationalisation les plus efficaces et mobilisés,
on peut conclure que leur fonctionnement n’a pas été remis en cause. Les écoles ont pu
assurer leur fonction : certaines ont dû changer de nom – en 1940, le Centre Talmud
Thora Beth Jacob devient la Sociedade Brasileira de Instrução Religiosa Israelita – ou
de direction – comme la Renascença qui doit élire une direction de « Brésiliens natifs »
en 1942. Mais ces écoles continuent à enseigner le judaïsme, le yiddish, l’hébreu mais
aussi les matières générales fondamentales. Malgré un contrôle précis et régulier de ces
écoles, et grâce à l’adaptabilité de la communauté, l’enseignement n’a pas eu à subir de
sanctions ou fermetures.
D. La question du sionisme
Tout d’abord, il nous faut signaler que l’ensemble des associations judaïques n’a pas
une dimension politique. Ensuite, certaines associations qui ont une idée sur la question
du sionisme ne sont pas nécessairement favorables à l’établissement d’un foyer juif.
L’organisation qui représente le plus nettement cette position antisioniste est la
Congregação Israelita Pauliste. Fondée par des juifs allemands installés au Brésil, elle
adopte une position assimilationniste, ce qui n’est pas sans créer des tensions internes à
la communauté ashkénaze287. Cette précision posée, nous pouvons à présent nous
286 Ibid., p.395. « Enquanto grupo, os judeus não sofreram nenhuma perseguição específica, sendo
submetidos aos mesmos constrangimentos e proibições que outros grupos imigrantes, de falar, ensinar ou
editar jornais em línguas consideradas "estrangeiras". » 287 Cf. LESSER, Jeffrey, Welcoming the Undesirables. Brazil and the Jewish Question, op. cit., pp. 106-
109.
195
intéresser au fonctionnement des associations sionistes sous Vargas. Celles-ci ont dû
subir les mêmes difficultés que l’ensemble des organisations partisanes, qu’elles soient
portées ou non par des étrangers, et surtout quand elles avaient une dimension
internationale.
Les associations sionistes se trouvent en effet sous le coup du décret-loi 383 de 1938,
interdisant les mouvements subversifs internationaux, c’est à dire les activités de nature
politique et l’organisation de sociétés, fondations, communautés, clubs de caractère
politique, considérés étrangers. En revanche le décret permet aux
« étrangers de s’associer à des fins culturelles, de bienfaisance ou
d’assistance, de s’affilier à des clubs et à quelque autre établissement avec le
même objectif, ainsi que de se réunir pour commémorer les fêtes nationales
ou les événements de signification patriotiques »288.
Avec l’Estado Novo, le sionisme a effectivement été interdit jusqu’à la fin de la guerre.
Mais, selon une lettre du 6 août 1938 écrite par le secrétaire général du mouvement
sioniste à Buenos Aires et adressée à l’exécutif de Londres, cette interdiction n’est pas
dirigée contre les juifs brésiliens. Moshe Kostrinsky, secrétaire général du mouvement
Ichud Poalei Zion Zeire Zion de Buenos Aires, affirme même l’opposé quand il écrit :
« le décret contre les activités des organisations étrangères a été, comme
vous le savez, dirigé exclusivement contre les nazis. Pour des raisons
évidentes, le décret a pris un caractère général et il a été légalement appliqué
à toutes les activités étrangères. En même temps, nous devons insister sur le
fait qu’il n’y a pas d’antisémitisme au Brésil, bien que des agents allemands
aient occupé différentes positions à divers niveaux du gouvernement, et
qu’ils aient exercé, non officiellement, une influence considérable »289.
288 Décret-loi n°383 de 1938, cité par CYTRYNOWICZ, op. cit., p.404. 289 « O decreto contre as atividades de organizações estrangeiras foi, como vocês sabem, dirigido
exclusivamente contra os nazistas. Por razões óbvias o decreto assumiu um caráter geral e legalmente foi
aplicado a todas as atividades estrangeiras. Ao mês mo tempo temos que enfatizar que não há anti-
semitismo no Brasil, apesar de que agentes alemães tenham ocupado varais posições em diversos níveis
do governo, e tenham exercido, inoficialmente, uma influência considerável. » Lettre traduite et citée par
FALBEL, Nachman, Menashe : sua vida e seu tempo, São Paulo, Perspective, 1996. Cité également par
196
Ce décret a conduit à transformer différentes associations à caractère politique et
sioniste en associations à caractère religieux afin de dissimuler plus aisément leurs
activités. Le mouvement sioniste a continué à fonctionner, à se réunir, et à diffuser ses
idées. Selon Malamud, « on ne peut affirmer que ces réunions se sont réalisées dans
l’absolue méconnaissance des autorités policières. Les rencontres étaient tolérées »290.
Les activités sionistes, bien qu’officiellement interdites, ont pu continuer à se
développer essentiellement sous couvert d’action d’assistance mais aussi, et c’est sans
doute le point le plus important à souligner, car la police n’a pas cherché à les éradiquer.
La mort à petit feu du régime et la fin de la guerre coïncident. Est-ce que cela va
contribuer à réviser la position de l’Etat à l’égard du sionisme ? Avec la fin de la guerre
et la fin du régime, l’interdiction est levée. Surtout, la question du sionisme devient plus
pressante car de nombreux réfugiés cherchent à quitter l’Europe. On assiste à des
départs massifs dont l’épisode de l’Exodus a certainement pesé sur les esprits des
membres des Nations Unies. En effet, la Grande-Bretagne demande l’aide de l’ONU
pour régler son problème palestinien et pour faire face à l’afflux de rescapés du nazisme
qui arrivent en nombre. L’Assemblée, présidée par Oswaldo Aranha, vote le 29
novembre 1947 la partition de la Palestine. La résolution 181 prévoit la formation d’un
Etat arabe, un Etat juif et une zone « sous régime international particulier ». Elle est
adoptée par 33 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions. Le New York Times, dans
son édition du 30 novembre, revient sur le rôle actif d’Oswaldo Aranha pendant les
délibérations291. C’est pourquoi Aranha, accusé d’antisémitisme par Tucci Carneiro, est
défendu par Max Golgher dans la revue Menorah. Dans l’édition d’août 1989, il
commence par affirmer son soutien à Aranha en évoquant des doutes très puissants
quant à sa responsabilité dans la diffusion de l’antisémitisme au Brésil et dans le refus
de l’attribution de visas aux juifs européens cherchant asile au Brésil. Il dit ainsi :
CYTRYNOWICZ, op. cit., p. 404. Disponible dans le dossier Z4/10229, Central Zionist Archives,
Jérusalem. 290 « Não se pode dizer que as reuniões se realizaram com absoluto desconhecimento das autoridades. Os
encontros eram tolerados », MALAMUD, op. cit., pp.36-37. 291 HAMILTON, Thomas J., « Assembly votes Palestine Partititon ; Margin is 33 to 13 ; Arabs walked out ;
Aranha hails work as session ends », New York Times, 30 novembre 1947.
197
« La thèse de Tucci Carneiro, O Anti-Semitismo na Era Vargas, 1930-1945,
aurait pu devenir un classique sur le sujet, si l’auteur ne faisait pas preuve de
cette obsession à tenter de prouver sans succès, qu’Oswaldo Aranha aurait
été un des plus grands pontifes du préjugé, de la discrimination des juifs au
sein du gouvernement gétuliste, en étant responsable des refus de visas
d’entrée à des centaines ou milliers d’entre eux, les condamnant ainsi à une
mort certaine des mains des bourreaux nazis »292.
Il attaque ensuite la thèse de Carneiro. Il dénonce l’acharnement personnel de Carneiro
à l’encontre d’Aranha et souligne les erreurs scientifiques de celle-ci, avant de
conclure : « Comme on peut le voir, l’exaspération émotionnelle n’est pas amie de la
méthodologie scientifique… »293
On peut constater que cette période engendre une grande controverse opposant les
tenants de la thèse de l’antisémitisme à ceux de la thèse du pragmatisme, et donc de
l’oscillation de Vargas en fonction des intérêts (les siens ou ceux du Brésil) en jeu. De
cette période Vargas, il est devenu assez dominant dans l’historiographie depuis les
travaux de Tucci Carneiro de dire qu’elle a constitué une période particulièrement
sombre, marquée par l’antisémitisme de l’Etat. Cependant, il serait scientifiquement
malhonnête à notre sens de ne relever que les éléments confirmant la présence
d’éléments antisémites à la proximité du pouvoir, la collaboration avec l’Allemagne
hitlérienne qui aura conduit à la livraison de nombreux juifs, la suspicion de
communisme et le maintien sous contrôle des associations communautaires. Tout ceci
est une réalité. Il n’est pas question ici de nier ces faits. En revanche, il nous semble
utile de préciser que le louvoiement de l’Etat jusqu’à son entrée en guerre contre les
pays de l’Axe reflète l’ambigüité d’un gouvernement qui ne semble pas savoir trancher,
certainement car le fond idéologique gétuliste n’est pas très puissant. L’objectif de
292 « A tese de Tucci Carneiro, "O Anti-Semitismo na era Vargas – 1930-1945", poderia ter se tornado um
clássico sobre a matéria, não fosse a obsessão da autora em tentar provar sem êxito, que Oswaldo Aranha
teria sido um dos pontífices máximos do preconceito, discriminação dos judeus no Governo getulista,
sendo responsável pela recusa de vistos de entrada a centenas ou milhares deles, condenando-os assim à
morte certa nas mãos dos carrascos nazistas. » GOLGHER, Marx, « Oswaldo Aranha. O antisemita da era
Vargas ? », Menorah, n°362, août 1989, p. 13. 293 « Como se vê, a exasperação emocional não é boa amiga da metodologia científica... », Id.
198
Vargas est le développement économique du pays – ce qui le conduit à mettre en
concurrence Allemagne et Etats-Unis – , la diffusion de la brasilidade et le nationalisme
– par le biais d’une politique d’assimilation dure – , et la lutte contre le communisme et
toute association mettant en péril l’intérêt national. Dans ce cadre, il s’agit avant tout
d’une défense de l’intérêt national selon la définition donnée par le régime. Ceci
explique aussi pourquoi les colonies allemandes ont été particulièrement visées. C’est
pourquoi il nous semble que, plus que les juifs en tant que groupe, ce sont le
communisme et l’internationalisme qui sont visés. Cependant, le ciblage des juifs,
notamment en ce qui concerne leur filiation avec le communisme, témoigne du maintien
de préjugés à leur égard. Qu’en est-il des rapports à la société brésilienne ?
III. Une société brésilienne non
raciste dans le regard des immigrants
L’étude des entretiens réalisés auprès des juifs brésiliens depuis les années 1990 nous
apprend beaucoup sur leur rapport avec la société environnante. Les témoins reviennent
très fréquemment sur leurs débuts au Brésil, ils retracent leur parcours migratoire,
depuis leur pays de départ jusqu’à leur vie actuelle. Ils dressent ainsi un portrait de leur
mode d’insertion au sein de la société brésilienne. Ce qui nous intéresse tout
particulièrement ici, ce sont leurs premiers pas, leur découverte, leurs rapports initiaux
avec leur pays hôte et plus précisément avec sa société. Le problème qui se pose à nous
est que ce sont des entretiens a posteriori laissant place à des imprécisions et à des
interprétations subjectives et rétrospectives. Dans ce cas précis, le regard porté sur la
société brésilienne est particulièrement positif, soulignant l’absence de discrimination
de la société à leur égard. Ces témoignages sont-ils réalistes ou idéalistes ? Arrêtons-
nous d’abord sur la spécificité de l’utilisation de témoignages a posteriori comme
sources primaires.
199
A. De la difficulté d’utiliser des
témoignages a posteriori
Les documents que nous allons utiliser pour cette étude sont des entretiens réalisés dans
le cadre d’une collecte visant à donner la parole aux acteurs de la migration juive vers le
Brésil. Dans un second temps, cette compilation s’est enrichie de témoignages de juifs
brésiliens natifs. Ces documents appartiennent au Núcleo de História Oral Gaby Becker
de l’Arquivo Histórico Judaico Brasileiro de São Paulo. Fondé en 1992, ce projet non
universitaire cherche à donner la parole aux acteurs de l’histoire. Selon l’AHJB, ces
témoignages donnent accès à une « histoire vivante, parce que contée par ses propres
protagonistes, (une) histoire vivante parce que l’histoire du 20ème siècle est
indélébilement liée à leurs vies »294. Cette volonté de donner la parole aux témoins et
acteurs du siècle s’inscrit dans le courant d’Histoire orale souhaitant ne plus s’intéresser
seulement aux destins exceptionnels mais aussi à la vie quotidienne. Cette discipline,
par l’usage de sources orales, permet donc d’avoir accès à des récits qui ne seraient pas
parvenus jusqu’à nous. En effet, en dehors des cahiers personnels, intimes, les sources
concernant la vie quotidienne ne sont pas des récits. Jusque là, on disposait des écrits de
personnes relativement érudites, assez en tout cas pour être capable d’écrire, et surtout
ayant eu la volonté de transmettre quelque chose. La connaissance du passé
« ordinaire » reposait sur l’usage d’autres sources bien connues des historiens : faits
divers de journaux, documents officiels, photographies, cartes postales, objets transmis
par les aïeux, etc. C’est donc une nouvelle source que les historiens ont commencé à
utiliser suivant des codes et méthodes, permettant de saisir une histoire plus sociale, une
histoire des mentalités aussi.
Comme beaucoup de nouvelles méthodes de travail dans les sciences humaines et
sociales, celle-ci s’inspire de l’Ecole de Chicago dans sa volonté de proposer un autre
regard sur la société et sur l’histoire. Dans les années 1960, l’histoire orale naissante est
donc une discipline presque militante : contrairement à la « Grande Histoire », elle
294 « História viva, porque contada pelos próprios protagonistas. História viva porque a história do século
XX está indelevelmente ligada às suas vidas. »
http://www.ahjb.org.br/ahjb_pagina.php?mpg=02.04.00.00
200
donne à voir une histoire souvent occultée, celle des « oubliés de l’histoire », c’est-à-
dire le commun des mortels. Elle se croise donc souvent avec l’histoire des femmes, des
ouvriers, des acteurs inconnus de grands moments historiques. Le témoignage d’une
personne anonyme est considéré comme révélant d’autres clés tout aussi importantes
pour la compréhension de l’histoire. La discipline se répand en Amérique latine dans les
années 1970, elle prend souvent un tour activiste, parfois anticolonialiste. Elle laisse un
ouvrage sur le Mexique qui a beaucoup marqué, The Children of Sánchez, dans lequel
son auteur, l’anthropologue Oscar Lewis295, développe le concept de « culture de la
pauvreté ». Au Brésil, l’un des grands noms de la discipline est José Carlos Sebe Bom
Meihy, professeur à l’Université de São Paulo. Concernant le projet de l’AHJB, Meihy
affirme : « le Centre d’Histoire Orale de l’AHJB développe le plus grand et le plus
important projet d’histoire orale réalisé en dehors de la sphère académique au
Brésil »296. Avec plus de 400 entretiens réalisés sur près de 20 ans, le projet est
effectivement de grande ampleur. Il constitue une source inégalée pour la
compréhension de la vie au Brésil des juifs qu’ils soient migrants ou non. Cependant,
l’utilisation d’une telle documentation n’est pas sans poser quelques difficultés. Le
premier problème concernant cette source qu’est l’histoire orale est le fait que le
document, la source, est « provoquée ». Le second est qu’elle est récoltée a posteriori.
Un entretien provoqué, tel est le premier problème que connaît l’ensemble des
chercheurs en sciences sociales. Il n’est pas propre à l’histoire orale. L’entretien doit-il
être dirigé ? Si oui, comment ? Ou doit-on laisser la personne livrer ce qu’elle souhaite à
travers un récit de vie, quitte à ne pas avoir de réponses aux questions que l’on se
posait ? Dans notre cas, les entretiens ont été réalisés par des tiers. Nous n’avons donc
pas eu à nous demander comment conduire ces entretiens. Mais nous n’avons pas non
plus pu poser les questions qui nous intéressaient. Nous ne savons pas en outre quel
était exactement le mode opératoire. À l’écoute et à la lecture des entretiens – nombre
d’entre eux ont été retranscrits – il apparaît qu’aucun protocole systématique n’a été mis
295 LEWIS, Oscar, The Children of Sánchez: autobiography of a Mexican family, New York, Random
House, 1961, 499p. 296 « o Núcleo de História Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro desenvolve o maior e mais
importante projeto de História Oral realizado fora da área acadêmica no Brasil ».
http://www.ahjb.org.br/ahjb_pagina.php?mpg=02.04.00.00
201
en place. Les personnes sont invitées à répondre à quelques questions précises
composant une sorte de carte d’identité, puis à évoquer leur enfance, la migration et leur
vie depuis leur installation au Brésil. Cependant, les questions posées par les
intervieweurs – en général deux – varient beaucoup d’une personne à l’autre, s’adaptant
à la vie de chacune d’entre elles. En fonction des personnes conduisant l’entretien, les
interrogations se focalisent sur certains points plutôt que d’autres, mais tous insistent
beaucoup sur la vie avant le départ. La question des discriminations est souvent
évoquée, mais plus avant la migration qu’après. Certains entretiens sont très clairs et
précis, d’autres flous, brefs et superficiels. Le matériau mis ainsi à la disposition des
chercheurs est donc de qualité très inégale. Ils témoignent de l’écueil principal
concernant les entretiens : peu dirigés, ils comportent de longs passages qui, aux yeux
du chercheur, n’ont pas d’autre portée que personnelle et individuelle ; (trop) dirigés, ils
suggèrent le contenu des récits. Nous avons essayé de retenir des témoignages les plus
significatifs et les moins orientés, guidés par les questions les plus ouvertes possibles. Il
faut signaler globalement concernant cet aspect que le travail fait par les interviewers
est assez remarquable : en prenant du temps avec les témoins, créant ainsi une
atmosphère non précipitée, paisible (les entretiens sont généralement réalisés au
domicile des témoins), dans une relation de respect et de confiance, les témoins livrent
leur mémoire de façon libérée.
Cependant, on arrive au deuxième écueil de l’histoire orale : a posteriori, mémoire
individuelle et collective se mélangent, les souvenirs peuvent s’estomper, et la
« réalité » s’en trouver transformée. On peut être confronté à des « phénomènes
d’amnésie ou de flou dans la mémoire des individus appartenant à un groupe social
donné, quel que soit leur sexe : imprécision fréquente de la chronologie (…), oubli de
pratiques ne correspondant pas à la définition sociale du groupe »297. En d’autres
termes, il est courant que lors de témoignages a posteriori, l’enquêté fasse des erreurs
involontaires dans la restitution des faits ou, au contraire, modifie volontairement sa
297 THIESSE, Anne-Marie, « Histoire orale et histoire des femmes », Bulletin de l'Institut d'Histoire du
Temps Présent, série Histoire orale, n°1, 1982, Compte-rendu de lecture in Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations, 1984, vol. 39, n° 1, pp. 43-45.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-
2649_1984_num_39_1_283041_t1_0043_0000_001 Consulté le 16 décembre 2010.
202
version donnant au chercheur ce qu’il veut entendre ou ce qu’il est convenu de dire. Les
erreurs involontaires tiennent au fait que la mémoire individuelle est composite, faite de
souvenirs du vécu, mais aussi de lectures, de connaissances acquises a posteriori qui
peuvent conduire à une réinterprétation inconsciente des faits. Les arrangements avec la
réalité procèdent d’un autre processus, tout aussi pervers, qui vise à ne pas contredire ce
qui fait autorité, que ce soit la personne qui interroge, arrive avec une connaissance
livresque et apparaît dans une position dominante par rapport à l’interrogé, ou que ce
soit l’interprétation dominante des faits en question. Dans les témoignages rétrospectifs
se mêlent donc imprécisions et modifications dans la restitution des faits. En ce sens, ils
nous enseignent sur l’époque relatée mais peut-être encore plus sur le processus, le
cheminement de pensée des personnes interrogées et les évolutions de l’idéologie
dominante concernant certains aspects d’une société donnée.
Ces témoignages sont très utiles en soi, mais, en raison des limitations précitées, nous
avons décidé de les confronter à des faits connus et étudiés afin de mieux saisir si la
société brésilienne décrite comme dépourvue d’antisémitisme par les témoins
correspond à une vision idéalisée a posteriori.
B. Une société brésilienne idéalisée ?
L’étude des témoignages nous révèle une perception de la société brésilienne comme
dépourvue d’antisémitisme. Selon leurs récits, les migrants n’ont pas eu à subir de
discrimination de la part des Brésiliens. Toutefois, il apparaît que ce regard est en partie
lissé.
a. Une absence de discrimination d’après les
témoins
203
Les expériences des témoins ne laissent pas percevoir de discrimination à leur égard.
Dans la plupart des entretiens en effet, la question de l’antisémitisme est posée. Pour les
témoins qui étaient assez âgés au moment de leur départ, cette question est posée à la
fois pour leur vie dans leur pays de naissance et au Brésil. On peut ainsi voir clairement
une différenciation très nette entre leur vision de l’Europe et celle du pays d’accueil.
Voici ici retranscrit un extrait du témoignage de Luiza Cymbalista sur son enfance au
Brésil.
Question : Concernant l’antisémitisme chère Luiza, avez-vous eu une
expérience désagréable dans votre vie ?
Luiza : Personnellement non, moi, personnellement, je n’en ai jamais eu.
Question : Pas même à l’école ?
Luiza : A l’école, non. Il n’y en a jamais eu, pas même à l’école.
Question : A l’école juive ? Vous n’avez jamais étudié dans une autre
école ?
Luiza : J’ai étudié dans une autre école, mais j’étais très respectée, je ne me
souviens pas que quelqu’un… Je sais seulement qu’à un moment, nous
avions une employée de maison et elle… On lui avait raconté que dona
Clara, qui est ma mère, était juive et elle lui a demandé : « Est-ce que c’est
vrai dona Clara que vous êtes juive ? Parce que vous n’avez pas de cornes ?
(rires) »298
Luiza Cymbalista fait ici la distinction entre l’antisémitisme et les préjugés. Ceux-ci ont
cours dans la société brésilienne marquée encore par des croyances répandues par le
christianisme et par une méconnaissance complète de la judéité. Elle témoigne aussi
298 Entretien de Luiza CYMBALISTA, réalisé le11.08.1995, Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, Núcleo
de História Oral, ref. 174BR05.
« Q: Em relação ao antisemitismo dona Luiza, a senhora teve uma experiência desagradável na sua vida?
L: Particularmente não, eu particularmente eu nunca tive.
Q: Nem na escola?
L: Na escola não. Eu não tive, mesmo na escola.
Q: Na escola judaica? A senhora não estudou em nenhuma outra escola?
L: Eu estudei noutra escola, mas era muito respeitada, eu nunca, eu não me lembro que alguém... eu só sei
que uma vez nós tínhamos uma empregada e ela então... Contaram para ela que dona Clara que é minha
mãe é judia, ela chegou e falou: "É verdade dona Clara que a senhora é judia? Mas a senhora não tem
cornos" (risadas) »
204
d’une forme de naïveté, de rapports sociaux non fondés sur le raisonnement mais sur les
« on dit ». Sara Lerner nie aussi toute forme d’antisémitisme à São Paulo depuis son
arrivée en 1918 :
« Question : Dona Sara et avez-vous assisté à une quelconque attitude
antisémite durant votre vie ?
Sara Lerner : Ici, non.
Question : Pas même de la part des voisins ?
Sara Lerner : Non ! Non ! »299
Quant à Fany Adler, arrivée en 1930 et alors âgée de 14 ans, elle évoque une totale
absence d’antisémitisme : « Je n’ai jamais ressenti d’antisémitisme dans ma chair »300.
Elle ajoute : « Le peuple brésilien est formidable, il aide beaucoup les immigrants »301.
Ceci ne signifie pas pour autant que la vie à São Paulo est dépourvue de craintes comme
envers l’Action Intégraliste. À la demande de son interviewer, Sara Lerner revient ainsi
sur la situation politique des années 1930 :
« Sara Lerner : Ah, je me souviens de Getúlio Vargas : Un Misérable qui n’a
eu le courage que d’attraper une femme enceinte… Comment s’appelait-
elle ? Celle qui était mariée avec le chef des communistes ?
Q : Olga Benário.
Sara Lerner : (…) Oui, il y avait les Intégralistes, il y avait les Intégralistes
qui marchaient et tout, et nous, les juifs, nous mourrions de peur, non ! Que
ça devienne comme en Allemagne. (Silence) »302
205
Ces craintes sont toujours en résonnance avec les événements politiques constatés en
Europe, montrant que le traumatisme ne s’arrête pas une fois la frontière franchie. Ces
souvenirs sont régulièrement associés à d’autres récits d’événements venant toutefois
minimiser la menace. Sara Lerner explique ainsi, par exemple, que les bombardements
touchant São Paulo pendant la Révolution de 1932 conduisent sa famille à quitter la
ville, mais précise par la même occasion que les juifs ne sont pas du tout les cibles.
Les témoins ont souvent un discours assez nuancé mettant l’accent à la fois sur une
absence d’antisémitisme de la part des brésiliens dans leur ensemble, et soulignant des
sources de peur ou des attitudes ouvertement antisémites mais toujours précisées
comme n’étant pas le fait de brésiliens. Fany Adler affirme ainsi qu’elle a été
confrontée à de l’antismétisme, mais de la part de Polonais et non de Brésiliens : « J’ai
découvert une bibliothèque, rua da Graça, bibliothèque fréquentée par des Polonais qui
étaient antisémites. J’ai arrêté de fréquenter la bibliothèque ».303 Il est de fait difficile de
savoir si ce discours n’est pas le fruit d’une élaboration ultérieure visant à réécrire les
rapports entre les juifs immigrés et les brésiliens ou si, au contraire, ces souvenirs
retracent fidèlement le passé. Dans la mesure où les témoignages concordent et ne sont
pas monolithiques, il semblerait qu’ils soient une représentation assez fidèle de la
299 Témoignage de Sara LERNER, réalisé les 25.09.1996 et 2.10.1996, Arquivo Histórico Judaico
Brasileiro, Núcleo de História Oral.
« Q: Dona Sara e alguma atitude antisemita durante a sua vida a senhora presenciou?
S: Aqui, não.
Q: Nem de vizinhos?
S: Não! Não! » 300 « Nunca senti anti-semitismo na minha pele ». Fany ADLER, op. cit. 301 « O povo brasileiro é formidavel, ajuda muito os imigrantes ». Fany ADLER, op. cit. 302 Témoignage de Sara LERNER, réalisé les 25.09.1996 et 2.10.1996, Arquivo Histórico Judaico
Brasileiro, Núcleo de História Oral.
« Sara Lerner : Ah, me lembro o Getúlio Vargas : Um Desgraçado, o que ele teve coragem de fazer pegar
mulher grávida, a… a… Como é que ela se chamava ? Que era casada com o chefe dos comunistas ?
Q : Olga Benário.
Sara Lerner : (…) Sim, tinha os Integralistas, tinha os Integralistas que marchavam e tudo, e nós os judeus
morriam de medo, non ! Que se torno igual a Alemanha. (Silencio) ». 303 ADLER, Fany, op. cit. « Descobriu uma biblioteca na rua da Graça, biblioteca freqüentada por polacos
que eram anti-semitas. Deixou de freqüentar a biblioteca ».
206
réalité, à moins que le discours dominant sur cette période n’ait modifié la perception
qu’en ont les acteurs. C’est pourquoi il est utile de confronter ces témoignages aux
études faites sur cette époque, ce qui nous permettra de mieux saisir les rapports qui se
sont tissés entre les nouveaux venus et les Brésiliens de São Paulo.
b. Préjugés et quiproquos dans une société
brésilienne épargnée par l’antisémitisme
Les témoignages décrivent une société brésilienne ouverte mais non exempte de
préjugés. Cette expérience vécue et remémorée par les différents témoins est aussi
perceptible à travers un recueil d’articles paru dans les années 1930. Dans cet ouvrage,
intitulé Por Que ser Anti-Semita ?, des intellectuels brésiliens, cherchant à démontrer la
stupidité de l’antisémitisme développé par certains de leurs contemporains au Brésil ou
en Europe, tombent eux-mêmes dans une défense mal habile. Si les auteurs sont
globalement capables de remettre en cause l’idée même d’une race juive, s’ils ne sont
pas dans une essentialisation biologisée donc, ils n’en tombent pas moins assez souvent
dans des préjugés très courants, voire même dans une essentialisation culturaliste. De
façon générale, de nombreux articles ont du mal à penser l’hétérogénéité du groupe.
Parfois même, leur défense tient plutôt à dire : si tout ce qu’on dit sur eux est vrai, alors
ils constituent plutôt un atout. En dehors de l’intérêt que représente cet ouvrage en tant
que manifeste contre l’antisémitisme, son apport le plus instructif concerne finalement
la persistance de préjugés même parmi ceux qui veulent venir prendre la défense des
juifs au Brésil, philosémitisme et antisémitisme reposant sur la même matrice du
préjugé, positif pour l’un, négatif pour l’autre. La question à se poser dans ce cas est la
suivante : ce préjugé survit-il à la rencontre de l’Autre ?
En effet, si les témoins nous disent ne pas avoir souffert d’antisémitisme pendant les
premières années de leur vie au Brésil, leurs premiers pas dans la société brésilienne ont
aussi été marqués par les quiproquos, les préjugés et les obstacles objectifs à leur
insertion. Le premier de ces obstacles est certainement le maniement de la langue
portugaise. La plupart des migrants arrivant de pays d’Europe centrale ou orientale, ils
207
ne parlent pas portugais à leur arrivée. Le Brésil n’a pas, en tant que pays hôte, organisé
des sessions pour apprendre la langue portugaise. Toutefois les juifs, grâce au riche
tissu organisationnel mis en place promptement, ont eux-mêmes dispensé ces cours
d’initiation. De plus, leur regroupement résidentiel dans certains quartiers – comme le
Bom Retiro ou Moóca – et le développement d’un réseau professionnel fondé sur les
relations amicales et familiales leur a permis de s’insérer progressivement dans la vie
sociale et économique globale. Cette méconnaissance du portugais et ce regroupement
ont aussi favorisé la survivance du yiddish hors de l’Europe Orientale et le maintien
d’une culture yiddish vivante en diaspora. Enfin, la nationalisation du pays voulue par
Vargas passant par un enseignement en langue portugaise, les enfants des immigrés ont
pu bénéficier d’un apprentissage du portugais. Ainsi cette mesure, fondée sur la volonté
d’éradiquer les différences linguistiques et culturelles et de comprendre, maîtriser et
surveiller les comportements des « étrangers », a cependant eu pour conséquence
positive de permettre aux plus jeunes d’acquérir les moyens linguistiques de s’intégrer
plus aisément et grâce à l’Etat – et non aux seules associations privées – dans la société
brésilienne. Cette mesure nationalisatrice coercitive a donc aussi eu un impact positif
sur l’intégration des juifs au Brésil.
Concernant l’insertion sur le marché du travail, il faut aussi signaler que les débuts
n’ont pas été faciles. Les migrants ont disposé d’une conjoncture favorable puisque la
ville de São Paulo était en plein développement économique et industriel. Ils ont ensuite
su s'établir dans des quartiers propices. Toutefois, l’installation a été difficile à bien des
égards : beaucoup sont partis sans argent et ont dû recommencer de zéro ; leurs emplois
étaient le plus souvent de la vente ambulante ou de proximité – ce qui leur a valu le
surnom de « russos de prestação » ; la grande majorité d’entre eux a vécu dans des
auberges ou pensions pendant des mois avant d’avoir leur habitation propre. Les
difficultés, on le voit, ont été multiples, mais, là encore, le soutien des associations, la
mise en place d’un réseau interpersonnel d’aide ainsi que les volontés individuelles ont
permis de dépasser ces obstacles.
Enfin se pose la question des préjugés. Si ceux-ci n’ont, semble-t-il, pas produit de
discrimination d’après les personnes interrogées, s’ils paraissent plus fondés sur une
ignorance naïve (et donc sont balayés par la connaissance) que sur une construction
intellectuelle (dans ce cas, aucune démonstration ne peut venir mettre un terme à une
208
essentialisation qu’elle soit ethnique, raciale ou culturelle), a priori et incompréhensions
ont causé des difficultés dans la vie des juifs venus vivre à São Paulo. Nous retiendrons
ici deux exemples significatifs. Le premier d’entre eux est le lien avec la prostitution.
Le second est la gémellité entre le yiddish et l’allemand.
En effet, une double défiance s’est développée à l’encontre des femmes juives, à la fois
au sein de la société brésilienne mais aussi au sein même de la communauté juive
brésilienne. Elle est due à l’existence d’un réseau de prostitution international étudié
notamment par Beatriz Kushnir, le Zwi Migdal. Ce réseau a fonctionné pendant près
d’un siècle, entre 1860 et 1939. Il a été particulièrement actif après la Première Guerre
mondiale. Ce réseau organisait le trafic et la prostitution de femmes juives provenant
des shtetls pauvres d’Europe orientale. Grâce à des manœuvres et ruses aujourd’hui
courantes – la promesse d’une vie meilleure à l’étranger grâce au mariage ou à un
emploi de domestique par exemple – les « recruteurs » ont convaincu des familles de
leur confier des jeunes filles généralement mineures. En réalité, leur destination n’était
rien d’autre qu’une maison close en Argentine, au Brésil ou en Afrique du Sud. Beatriz
Kushnir s’est particulièrement intéressée au cas de Rio de Janeiro et de la Praça XI,
mais l’organisation fonctionnait également à São Paulo. L’existence de ces prostituées
contre leur gré a conduit à dégrader l’image de la population juive aux yeux des
Brésiliens mais aussi et peut-être surtout aux yeux de leurs coreligionnaires. Des
mesures d’exclusion s’en sont suivies, conduisant les jeunes filles et les femmes à
développer un réseau spécifique d’entraide. À la trahison et l’asservissement s’est ainsi
greffé le rejet au sein même de la communauté qui s’est par exemple manifesté par
l’existence de cimetières dédiés afin de maintenir une distanciation morale et physique
avec les prostituées. L’aide ne venant pas de la société brésilienne, elle-même très
critique à leur égard, ces (jeunes) femmes ont connu les pires difficultés à trouver une
place positive au sein de la société environnante.
Nous signalions aussi le problème lié à l’usage du yiddish et même de l’allemand. Ces
deux langues vernaculaires sont parlées par une grande partie de la société juive
présente à São Paulo comme nous l’avons dit. Les juifs d’Europe orientale ne parlaient
souvent que cette langue, quant aux juifs originaires d’Allemagne, ils avaient
abandonné le yiddish pour l’allemand. Yiddish et allemand étant deux langues
particulièrement proches et méconnues des Brésiliens, elles étaient souvent confondues.
209
Or, quand le Brésil a décidé d’entrer en guerre, il l’a fait par les armes mais aussi par
l’imposition de la langue portugaise. Et les juifs d’Europe centrale ou orientale,
germanophones ou apparemment germanophones, se sont trouvés assimilés à des
Allemands… à des alliés de l’Axe. Comble du paradoxe ! En pointant du doigt les
descendants d’Allemands installés dans le sud du Brésil et proches de l’Etat nazi, l’Etat
a contribué à faire peser le soupçon sur l’ensemble des germanophones qu’ils soient
chrétiens, proches du nazisme ou non, ou qu’ils soient juifs. Fritz Pinkuss, le premier
rabbin de la CIP, se souvient de cette période :
« L’interdiction de l’allemand304 a fait que le public a dû s’accoutumer au
service en portugais, avec une prédication en portugais. C’était une situation
ridicule, très souvent si les personnes âgées, qui ne parlaient pas portugais,
parlaient allemand dans la rue, elles se faisaient arrêter et étaient conduites
au poste de police. Et ça nous causait des maux de tête énormes de faire
libérer ces personnes et de faire comprendre à l’officier que ces gens
n’avaient pas d’autre moyen de communiquer entre eux. C’était la lutte du
Brésil contre la langue, comme c’était la lutte du Brésil contre les cibles
infériorisées de l’Axe que nous étions !
Un consul américain m’a dit : "Vous êtes considérés comme des Allemands.
Mais les Allemands dangereux sont déjà naturalisés, ou sont déjà des
Brésiliens natifs, dans la sud du pays." »305
Cette confusion généralisée, les quiproquos et la persistance de préjugés ont constitué
autant d’obstacles aux premiers pas des juifs dans le pays. Toutefois, il serait exagéré de
présenter la communauté juive comme une victime de l’ère Vargas car cela tendrait à
304 A la CIP, congrégation libérale, le service se faisait déjà en langue vernaculaire, donc en allemand. 305 Entretien de Fritz PINKUSS, réalisé le 16.03.1992, Projeto Memória da CIP, Arquivo Histórico Judaico
Brasileiro, Núcleo de História Oral.
« A proibição do alemão fez com que o público tinha de se acostumar ao serviço em português, com
prédica em português. Houve uma situação ridícula, muitas vezes gente velha que não falava português,
se na rua falava alemão, foi presa e levada à polícia. E nós tivemos muita dor de cabeça de livrar esta
gente, e fazer entender ao delegado que esse pessoal não tem outro meio de se comunicar. Foi a luta do
Brasil contra a língua, como foi a luta do Brasil contra os súditos do Eixo, que éramos nós!
Um cônsul americano me disse: "Vocês são considerados como alemães. Mas os alemães perigosos já são
naturalizados, ou já são brasileiros natos, no sul do país". »
210
négliger la capacité d’adaptation dont les juifs ont fait preuve en tant qu’acteurs. Les
stratégies mises en place leur ont permis de s’organiser et d’agir. Nous concordons en
cela avec Jeffrey Lesser306 et Roney Cytrynowicz307 : il ne faut pas négliger cette
capacité afin que « les groupes minoritaires ne soient pas considérés simplement comme
des victimes passives de l’Etat ou de l’idéologie officielle, ou ayant une attitude
simplement de réaction face au discours dominant – ce qui leur ôterait leur condition de
sujet »308. Par ailleurs, cette période Vargas, même durant l’Estado Novo, est une phase
plus d’intégration que de persécution, les témoignages montrant bien le décalage entre
l’historiographie habituelle et d’ailleurs plus consacrée à l’Etat qu’à la société
brésilienne. Si l’Etat Vargas est suspect, la société brésilienne n’a pas manifesté
d’antisémitisme en dehors des foyers pronazis. Selon Cytrynowicz, durant cette période,
la culture étatique n’a pas réussi à infiltrer la culture populaire. En témoigne le préjugé
de l’employée de maison, préjugé à la fois très haut en couleurs et très éloigné des
discours à prétention savante proches des sphères du pouvoir. Par ailleurs cette période
est une phase où la population juive a commencé à sédimenter : elle a posé les bases
nécessaires à sa formation et à son renouvellement identitaires ainsi qu’à son
développement économique et son intégration dans la société brésilienne.
***
En conclusion, il faut déjà signaler que l’organisation communautaire, avec ces diverses
tendances, reflète bien l’hétérogénéité de cette immigration qui ne constitue pas un bloc.
Les juifs qui s’installent au Brésil jusqu’à la fin des années 1940 ne constituent pas une
communauté homogène même s’ils rencontrent des préoccupations similaires : accès à
l’emploi, au logement, à l’éducation, à une alimentation cacher, volonté de conserver
des rites et des traditions importées de leur pays de provenance, etc. Mais justement, ils
portent en eux l’héritage culturel laissé par leur pays d’origine. On peut ainsi opposer le
comportement de la CIP, portée par les Allemands et à tendance assimilationniste, aux
306 LESSER, Jeffrey, Negociating National Identity : Immigrants and the Struggle for Ethnicity in Brazil,
Durham, Duke University Press, 1998. 307 CYTRYNOWICZ, Roney, Além do Estado…, op. cit. 308 Ibid., p.395 « (...) para que os grupos minoritários não sejam considerados apenas vitimas passivas do
Estado ou da ideologia oficial, ou tendo uma atitude apenas de reação diante do discurso dominante – o
que lhes retira a condição de sujeito. »
211
groupes d’Europe orientale, russophones, beaucoup plus marqués par une tendance
sioniste. Cette propension de la communauté à s’organiser en fonction des pays
d’origine se vérifiera par la suite, avec la venue des nouveaux migrants. La communauté
juive brésilienne n’est pas créée ex nihilo mais est bien une agglomération d’héritages
culturels et historiques, de comportements religieux et de sensibilités politiques. D’autre
part il faut signaler que cette période Vargas si décriée est une période intense de
sédimentation institutionnelle et que les juifs, présentés comme des victimes de cette
période ont su développer des stratégies qui leur ont permis dès les années 1940 de
semer les germes de leur future intégration économique et sociale au sein de la société
brésilienne.