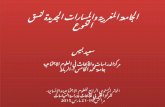Communautés juives de São Paulo et intégration nationale brésilienne. Evolutions d'un paradigme....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Communautés juives de São Paulo et intégration nationale brésilienne. Evolutions d'un paradigme....
77
À l’avènement de la République, en 1889, le Brésil dispose d’une population
composite, issue de quatre siècles de colonisation, mais celle-ci ne constitue pas
réellement de communauté nationale. Par ailleurs, la fin de l’esclavage, les
transformations et la diversification du secteur agricole ainsi que le développement
industriel causent des problèmes de main d’œuvre et d’investissements financiers que
l’immigration européenne a pour vocation de pallier. Cette époque est aussi celle du
développement des théories déterministes qui vont conduire les élites brésiliennes à
envisager l’immigration européenne comme une des solutions au « retard » brésilien
d’une part et la démocratie raciale comme la garantie d’un peuple uni d’autre part.
L’idée de la démocratie raciale est en fait que « le métissage a permis une certaine
"démocratie sociale", c’est-à-dire la possibilité pour certains métis d’échapper au
système de castes qui s’installe habituellement dans les sociétés esclavagistes », ce qui
ne signifie pas qu’être noir n’aurait aucune conséquence, mais que « la ligne de division
principale de la société brésilienne réside dans le mépris de classe. La "couleur" (et pas
la race, car pour lui – Freyre – la différence est importante) a moins d’importance que la
classe sociale dans la détermination des parcours individuels ». Comme le rappelle donc
Christophe Brochier, il n’a jamais été question de dire, même dans le cadre de la
démocratie raciale, « que la société était sans racisme ou préjugés »86.
86 BROCHIER, Christophe, « Sur quelques erreurs et impasses dans l’étude des relations raciales au
Brésil », RITA n°5, décembre 2012, Mis en ligne le 15 décembre 2011. Disponible en
ligne: http://www.revue-rita.com/dossier-thema-61/sur-quelques-erreurs-et-impasses-dans-letude-des-
relations-raciales-au-bresil.html
78
La question qui sous-tend ce premier chapitre est donc de savoir si, dans « un pays sans
peuple », l’immigration peut permettre de forger une identité nationale. C’est aussi la
question que se sont posée des intellectuels à la fin du XIXe siècle au Brésil. Pour
répondre à cette interrogation, nous analyserons d’abord comment l’immigration
européenne s’est imposée comme une composante essentielle de la croissance
démographique à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles, puis nous démontrerons
comment cette immigration a été choisie, définie idéologiquement, dans le but d’un
développement, d’une modernisation du pays passant par le métissage et le blanchiment
progressif de sa population.
79
I. L’immigration, composante essentielle
de la croissance démographique
brésilienne, fin 19ème – début 20ème
siècles
La croissance démographique d’une population est composée d’une part de la
croissance démographique naturelle et d’autre part de l’apport migratoire, lui-même
contribuant à la croissance démographique naturelle si les populations immigrées
s’installent définitivement. Dans le cas du Brésil, la croissance de sa population est liée
à des facteurs politiques et économiques qui vont permettre ou non l’immigration et
également déterminer une évolution de sa composition. Durant l’époque moderne, le
Brésil est une des colonies du royaume du Portugal, tournée vers l’exploitation de ses
ressources naturelles. C’est d’ailleurs le nom de sa première matière d’exportation le
pau brasil ou bois brésil qui le fera passer du nom de Terra de Santa Cruz – Terre de la
Sainte Croix – à celui de Brésil. L’exploitation progressive et successive de différentes
matières premières a deux implications. La première est le recours massif à une main
d’œuvre servile composée d’esclaves importés d’Afrique et d’Indiens réduits en
esclavage. La seconde est le déplacement progressif de ces populations au sein du pays
en fonction des besoins de l’économie. Parallèlement, l’immigration, bien moindre en
nombre, de colons européens se consacrant alors essentiellement à l’encadrement
économique, administratif et spirituel de la colonie se développe dans ces zones
géographiques contribuant aux débuts d’un essor urbain. Dans ce cadre colonial de
main d’œuvre servile et d’encadrement européen87, deux facteurs vont participer à
l’évolution démographique brésilienne. Le premier d’entre eux est l’Indépendance
brésilienne le 7 septembre 1822, le second est la fin de l’importation d’esclaves à partir
1850 et la fin de l’esclavage en 1888. La fin de l’esclavage et le nouveau statut du
Brésil passant de colonie à Etat indépendant vont contribuer à modifier la démographie
87 Même s’il est vrai que des migrants européens ont participé aux travaux de mise en valeur ou
d’exploitation du territoire, l’essentiel de la main d’œuvre était alors servile.
80
brésilienne, l’Etat brésilien cherchant à pallier le passage de la population servile à une
population salariée pouvant dès lors quitter les campagnes et migrer vers les villes où
l’industrialisation de la fin du 19ème siècle pouvait apparaître comme un choix
potentiellement plus intéressant.
A. Croissance démographique brésilienne
et migrations internationales
Le 19ème siècle est un siècle clé pour la démographie brésilienne en raison des facteurs
précédemment cités. Le siècle se caractérise par quatre aspects : l’accroissement
considérable de la population, la prépondérance d’un mode de vie rural, et, à la fin du
siècle, la fin de l’esclavage et l’augmentation de l’immigration européenne.
Entre 1823 et 1890, c’est-à-dire en trois générations, la population a presque quintuplée.
Sur cette période, elle passe d’un peu moins de quatre millions d’habitants en 1823 à
10 112 061 en 1872 et 14 333 915 en 1890. Nous avons évoqué le fort recours à une
main d’œuvre servile jusqu’à la moitié du siècle, cependant Bartolomé Bennassar
signale que l’importation, même si ce terme paraît aujourd’hui mal venu, était de
700 000 individus jusqu’en 1850, date qui signe la fin de la traite. Parallèlement,
l’immigration européenne est de 100 000 personnes jusqu’en 1880. Cette forte
croissance démographique ne peut s’expliquer par les seuls facteurs exogènes
(immigration et importation d’esclaves), et est donc due à un fort taux d’accroissement
naturel de la population.
D’un point de vue qualitatif, le 19ème siècle est une période fondamentale du peuplement
du Brésil, mais elle ne modifie pas fondamentalement le paysage urbain. La répartition
de la population sur le territoire national montre une prédominance très nette des ruraux.
Les zones d’exploitations agricoles comptent toujours une part importante de la
population. Ainsi, « en 1872, les huit provinces du Nordeste, malgré la chute (des cours)
du sucre, concentrent encore 4 272 295 habitants, soit près de 42% de la population
81
totale »88. Par ailleurs, les recensements nous montrent les déplacements de population
vers le Sudeste du pays avec le développement du cycle de l’or89. La population est
ainsi évaluée à 4 016 922 habitants en 1872. Parallèlement se développent des zones
pionnières de population, toujours dans une logique d’exploitation des ressources
naturelles et de mise en valeur des terres agricoles. Les Etats concernés se situent au
Nord, au Centre et au Sud du pays. Des migrations internes au pays sont en cours au
19ème siècle. Elles restent essentiellement intra rurales jusqu’à la fin du siècle, mais
connaissent une évolution notable quand l’esclavage est aboli, drainant d’anciens
esclaves des campagnes vers les villes.
En effet, nous disposons également d’une évaluation qualitative de la population. Le
recensement de 1872 indique que la population servile représente 15,2% de la
population totale. Notons que l’importation d’esclaves, interdite à partir de 1850, a
connu une hausse notable dans les années précédents son interdiction90. La fin de
l’esclavage en 1888 va donc mettre sur le marché du salariat au moins 15% de la
population. Cette évolution politique ne signifie par pour autant la fin des préjugés
raciaux au Brésil. Pour cette raison même, nous le développerons peu après,
l’immigration caucasienne, donc européenne, va être encouragée à la fois pour ses
aspects économiques (le développement de l’industrie et de l’agriculture pour lesquels
on va préférer un salariat et un entreprenariat européen) et idéologiques (le blanchiment
espéré de la population et la cohésion nationale).
Du point de vue de l’immigration, le 19ème siècle ne se caractérise pas par une
croissance externe très forte. Nous l’avons dit, environ 100 000 immigrants s’installent
alors au Brésil. Ils sont essentiellement européens et s’installent surtout en zone rurale,
notamment dans les fronts pionniers, même s’il faut souligner l’attrait que constitue
pour le commerce la capitale Rio de Janeiro. On trouve aussi une immigration juive
88 LE LIEVRE, Aurélie, op. cit., p.21.
89 En 1872 : recensement dans le Nordeste (8 provinces : Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambouc, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí) : 4 272 295 hab, 42% pop. Développement grâce au sucre. Population
qui migre vers le Sudeste avec le cycle de l’or.
En 1872 : recensement dans le Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo) :
4 016 922 hab 90 D’après BENNASSAR et MARIN, op. cit.
82
marocaine qui va se destiner principalement vers les sites de production de caoutchouc
naturel (hévéa) du Nordeste mais aussi à Rio. La grande période migratoire au Brésil se
situe pendant la Première République (1889-1930). Ont lieu alors d’importants
mouvements de population, aussi bien des migrations internes qu’une immigration
soutenue. Toutefois, c’est l’immigration étrangère qui est la plus significative en terme
de quantité. Ceci fait dire à Bartolomé Bennassar, qu’ « avec un total de 3 526 645
entrées, la Première République est l’âge d’or de l’immigration »91. Boris Fausto92 parle
de chiffres comparables, avec une estimation de 3, 8 millions d’immigrants entre 1887
et 1930. Le Memorial do Imigrante93 de São Paulo donne des chiffres qui se situent
dans la même tranche atteignant 3 645 448 personnes immigrantes pour la période
1889-1930. Cette forte immigration ne sera limitée que par les quotas de 1934 et la crise
des années 1930, nous y reviendrons un peu plus loin. Les auteurs et institution se
rejoignent pour signaler une décroissance nette de l’immigration à partir de 1915. Ainsi
la période 1887-1914, selon les chiffres de Boris Fausto, concentre environ 2,74
millions de personnes soit 72% des migrants entrés au Brésil entre 1887 et 1930,
pendant 27 années sur 43, soit 62% du temps migratoire global. La décennie 1890-1900
correspond au plus grand nombre d’entrées avec 1 205 703 immigrants selon les
chiffres donnés par Bennassar. Et cette immigration a pour principale destination les
zones rurales, conformément aux desiderata politiques.
Grâce aux données annuelles fournies par le Memorial do Imigrante, nous pouvons
signaler un rythme annuel moyen 88 913 migrants entre 1889 et 1930, ce qui nous
permet d’isoler des périodes d’immigration plus ou moins fortes. Se distinguent ainsi
les périodes 1888 à 1897 (années inclues) et 1808-1914 (années inclues). En élargissant
les données à la période 1870-1953, le rythme moyen devient de 58 036 immigrants par
an, ce qui permet de distinguer trois phases migratoires majeures : 1888-1898, 1905-
1914 et 1920-1930. Cette troisième période ne présente pas de pic à proprement parler
91 BENNASSAR, op. cit., p.285. 92 FAUSTO, Boris, História concisa do Brasil, São Paulo, EDUSP, 2006, p.155. 93 Le Memorial do Imigrante est un organe lié à l’Unité de Préservation du Patrimoine Muséologique du
Secrétariat d’Etat de la Culture de l’Etat de São Paulo. Cette institution a été créée comme Musée de
l’Immigration en septembre 1993 et convertie en Memorial de l’Immigrant en avril 1998. Sa mission est
d’une part la conservation des archives liées à l’immigration et d’autre part la valorisation et la
participation au développement de recherches sur les faits migratoires.
83
mais une série de dix années très régulières et plus élevées que la moyenne. Ce sont ces
trois périodes qui se distinguent sur le graphique ci-dessous.
Graphique 1: Nombre d'immigrants au Brésil par année, entre 1870 et 1953, d'après les chiffres du
Memorial do Imigrante.
La provenance géographique des migrants est très diversifiée. Les plus nombreux sont
les Italiens et les Portugais, puis les Espagnols. On compte aussi de nombreux
Allemands et Japonais, mais aussi des Russes, Polonais, Hongrois, Tchèques,
Autrichiens, Lituaniens, Syrio-Libanais. Parmi ces groupes nationaux, les religions ne
sont pas prises en compte en tant que telles, c’est pourquoi on trouve des juifs, non
comptabilisés en tant que juifs, mais parmi les différentes nationalités qui immigrent
alors vers le Brésil. Le graphique présenté ci-après (graph.2) permet de mieux
appréhender les différentes vagues migratoires par pays. D’un point de vue global, il
confirme en effet que la majorité des migrants arrive au Brésil jusqu’au milieu des
années 1910, moment où s’amorce une première décrue malgré une continuité de
l’immigration, et une seconde décrue, plus nette à partir de 1940. Du point de vue des
provenances géographiques, on peut en outre remarquer que les vagues migratoires ne
coïncident pas nécessairement entre elles. Ainsi, l’essentiel des migrants italiens sont-ils
84
déjà sur le sol brésilien quand s’amorce le début de l’immigration japonaise en 1908.
L’évolution démographique brésilienne est étroitement liée à l’évolution de sa situation
politique et aux différents cycles d’expansion économique. C’est pourquoi il est utile de
comprendre comment les facteurs économiques ont pu favoriser à la fois le départ des
migrants et leur arrivée au Brésil.
Graphique 2: Entrées migratoires au Brésil de 1870 à 1953 en fonction de différentes nationalités:
allemande, espagnole, italienne, japonaise, portugaise, russe et une catégorie "divers" englobant
d'autres origines nationales. Source : Memorial do Imigrante, SP.
85
B. Un pays économiquement attractif et
demandeur de main d’œuvre
Les facteurs économiques ont un rôle prépondérant dans le développement
démographique du pays, nous l’avons souligné. Souvent ils constituent aussi un motif
migratoire. L’aspect économique est donc à la fois facteur de départ et de réception.
C’est pourquoi, l’idée selon laquelle « les migrations de masse, depuis le 19ème siècle,
ont surtout été des migrations de travail »94 se vérifie dans le cas brésilien. Ainsi, les
principales zones réceptrices à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles sont les
régions du Centre-Sud, Sud et Est du Brésil, régions de majeure attractivité
économique. L’économie du Brésil est alors encore largement tournée vers les
campagnes, et elle se confond avec l’histoire politique. C’est pourquoi Bartolomé
Bennassar nomme « République des fazendeiros » la Première République. Il justifie
cette appellation par la relation étroite entre les producteurs de café et la politique
nationale95. Cette époque ne saurait cependant se limiter au café. Elle marque aussi le
début de l’industrialisation. À cela plusieurs causes : la fin de l’esclavage et par
conséquent le début du salariat, l’arrivée de migrants européens, les dévaluations de la
monnaie qui permettent un boom de la production caféière, le développement d’un
capitalisme privé et le début des substitutions aux importations. En effet, la fin
définitive de l’esclavage et le besoin d’un développement de la production agricole ont
engendré un besoin de main d’œuvre en milieu rural. Les débuts de l’industrialisation
ont également constitué un facteur d’appel de bras. Développement agricole et
industriel d’une part et fin de l’esclavage d’autre part ont donc contribué à faire
émerger un marché intérieur d’emplois auquel les esclaves affranchis ne pouvaient pas
répondre selon les idéologies dominantes à l’époque, nous y reviendrons très vite.
L’essor économique du Brésil dépend de deux facteurs : la bonne santé des productions
agricoles et matières premières d’abord, le développement d’une activité industrielle
ensuite, le second dépendant de la première. Pendant la Première République,
l’économie est tirée par la production de café, principal produit d’exportation brésilien.
94 GREEN, Nancy L., Repenser les migrations, Paris, PUF, 2002, p.78. 95 BENNASSAR, op. cit., pp.277-335.
86
Le premier bassin de production est le Sudeste, plus précisément les régions de Rio de
Janeiro et de São Paulo. Mais Rio, en déclin, se voit devancée définitivement par São
Paulo dès 1870. Le poids qu’occupe le café dans le système agro-exportateur brésilien
engendre un bouleversement démographique : la répartition de la population sur le
territoire se modifie durablement et le Sudeste devient durant cette période la première
zone de peuplement. Les autres matières premières ou agricoles ne contre-balancent pas
la domination caféière. Même si le développement du caoutchouc en région
amazonienne est manifeste depuis le milieu du 19ème siècle, même si la production de
cacao tempère le déclin bahianais parallèle à celui du sucre, même si le coton dont
l’âge d’or des exportations est derrière lui (1861-1870) permet le développement d’une
industrie textile, l’économie est étroitement liée à la production et l’exportation de café.
L’économie brésilienne se caractérise également par les débuts d’une ère industrielle :
« Les premières manufactures s’établissent entre Rio et São Paulo. À Rio,
c’est la chute du secteur caféier qui est vecteur d’industrialisation : le secteur
commercial joue la carte de l’industrie face à la chute de ses revenus liés au
café. À São Paulo, au contraire, l’essentiel des investissements vient de la
bourgeoisie du café qui reverse une part de ses profits dans le
développement manufacturier »96.
Dressons ici une typologie du développement manufacturier. Nous observons en effet
trois types d’industrialisation : le développement d’une industrie périphérique ou
complémentaire à l’activité liée aux matières premières, une industrie de transformation
des matières premières ou agricoles, et enfin une industrialisation par substitution des
importations. L’industrie périphérique est liée à la mise en valeur des matières
premières. Un exemple pourrait être la fabrication de sacs de conditionnement pour le
café. Concernant l’industrie de transformation, nous pouvons par exemple citer le cas
du coton traité par les manufactures textiles. La substitution aux importations quant à
elle est le résultat de la dévaluation de la monnaie et de la nécessité de produire sur
place des biens qu’on ne peut plus importer faute de devises. Les frontières de ces types
d’industrialisation ne sont pas étanches pour autant. Si nous reprenons l’exemple de la
96 LE LIEVRE, Aurélie, op. cit., p. 22.
87
fabrication de sacs pour le transport du café, nous pouvons ainsi voir qu’il se situe à la
fois comme industrie périphérique (le conditionnement nécessaire à l’exportation) et de
transformation (fabrication à partir de matières premières).
Face à ces besoins de l’économie brésilienne, une politique volontariste de peuplement
est mise en place. Celle-ci a pour but de répondre à la demande de main d’œuvre.
« La prédominance des activités agro-exportatrices, pendant la Première
République, n’était pas absolue. Non seulement la production agricole pour
le marché intérieur avait de l’importance mais aussi l’industrie était en train
de s’implanter de façon croissante. L’Etat de São Paulo était face à un
développement capitaliste caractérisé par la diversification agricole,
l’urbanisation et l’essor industriel. Le café continuait à être un axe de
l’économie et constituait la base initiale de ce processus. Un point important
qui assurait la production caféière se trouve dans la formule trouvée pour
résoudre le problème du flux de main d’œuvre et pour stabiliser les relations
de travail. Le premier aspect a été résolu par l’immigration ; le second, par le
colonat. »97
Le recours à l’immigration internationale pour faire face à ces besoins de main d’œuvre
incite l’Etat fédéral brésilien à se doter d’une politique migratoire à la fois fédérale et
décentralisée. Chaque Etat est libre de mettre en place sa politique migratoire grâce à
l’argent versé par l’Etat fédéral. En plus, chaque nouvel arrivant se voit verser une
« prime à la traversée » par l’Etat fédéral. L’Etat de São Paulo crée ainsi une hospedaria
dos imigrantes en 1887, « centre d’accueil et de tri »98, qui fonctionne comme un lieu de
répartition des immigrants dans les fazendas.
Les immigrants viennent essentiellement d’Europe, mais aussi d’Argentine ou du Japon
à partir de 1908. La cause de leur départ est essentiellement économique. Ainsi la
récession argentine et la crise italienne dans les années 1880 constituent des facteurs
déterminants de l’émigration. Dans le graphique 2 présenté plus haut, on peut ainsi
remarquer que l’essentiel des migrations italiennes a eu lieu très tôt et qu’elle coïncide
97 FAUSTO, Boris, op. cit., p.159. 98 BENNASSAR, op. cit., p.287.
88
avec les graves difficultés économiques rencontrées. À partir de 1908, les migrations
japonaises sont également concomitantes avec les grandes transformations engagées
pendant l’ère Meiji ayant pour but la modernisation interne et le développement des
relations extérieures du Japon. Cette modernisation accentuant les tensions sociales et
agraires, et les relations avec les pays occidentaux permettant la conclusion d’accords
migratoires, une émigration de travailleurs ruraux japonais en partance pour le Brésil a
pu être engagée.
Les possibilités d’emploi rencontrées par les migrants sont de trois ordres : l’emploi
agricole dans une fazenda, la colonisation familiale agraire, et l’insertion dans le marché
du travail urbain. Jusqu’en 1914, le Brésil dirige l’essentiel du flux migratoire vers les
fazendas du café. Les conditions de travail y sont décrites comme particulièrement
difficiles, les migrants remplaçant alors les esclaves affranchis. C’est pourquoi le
gouvernement italien a protesté contre les conditions de vie et de travail de ses
nouveaux ressortissants. Par le décret Prinetti de 1902, l’Italie fait ainsi pression sur le
Brésil pour que soient interdites les subventions versées aux Italiens pour venir
s’installer au Brésil. Les migrations prennent la forme de colonies agraires dans le Sud
mais aussi dans l’intérieur de l’Etat de São Paulo ou du Minas Gerais. Le front pionnier
composé par le Paraná, le Santa Catarina et le Rio Grande do Sul voit ainsi la
colonisation entamée sous l’Empire se confirmer. La migration y est familiale et de type
« agricole ». Les migrants reçoivent un lot de terre publique qu’ils doivent rembourser à
l’Etat en dix ans et qu’ils doivent mettre en valeur en y développant une polyculture.
Enfin, certains migrants se dirigent vers les villes où ils répondent aux besoins de
l’industrie naissante et au développement des activités de commerce et de services.
En fonction de leur provenance géographique, on peut remarquer quelques destinations
privilégiées pour les migrants. Ainsi, les Italiens se retrouvent dans les trois secteurs
évoqués et plutôt dans la ville de São Paulo et les Etats du Sud. Les Portugais se
dirigent plutôt vers Rio de Janeiro et se consacrent à des activités urbaines. Les
Espagnols sont pour les trois quarts d’entre eux regroupés dans l’Etat de São Paulo,
d’abord dans les fazendas de café puis dans l’industrie. Les Allemands, Polonais et
Japonais s’installent plutôt en zone agricole, les premiers et deuxièmes dans le front
pionnier du Sud et les troisièmes dans la région pauliste où ils introduisent les cultures
maraîchères et la riziculture.
89
La majorité des migrants, qu’ils soient Russes ou Tchèques, Portugais ou Italiens,
Allemands ou Japonais, constitue peu à peu une immigration de peuplement. Une partie
d’entre eux quitte toutefois le Brésil dans les années 1930, en raison des répercussions
de la crise économique. Ainsi, sur les 1 221 282 migrants entrés entre 1908 et 1936 par
le port de Santos (cf. tableau 1), point d’entrée des migrants se dirigeant vers l’Etat de
São Paulo et le Sud, 667 080 quitteront le pays. C’est environ la moitié des migrants de
cette période, mais c’est relativement peu comparativement au nombre d’entrées dans le
pays depuis 1870. Notons par ailleurs une plus ou moins propension à quitter le Brésil
en fonction des pays d’origine : certains migrants présentent un grand nombre de sorties
sur cette période, comme les Italiens (176 991 sorties pour 202 749 entrées), quand
d’autres sont à peine concernés par le phénomène, comme les Japonais (12 615 sorties
pour 176 775 entrées). Nous ne reviendrons pas ici sur les conditions d’insertion des
migrants et sur leur ascension sociale99 parfois contestée. Nous pouvons toutefois
signaler que ces migrants installés au Brésil ont eu sans doute plus de facilité à s’élever
dans l’échelle sociale dans les villes qu’en milieu rural.
99 Cf. FAUSTO, Boris, Historia concisa do Brasil, p. 158 ; FAUSTO, Boris, Historiografia da imigração
para São Paulo, São Paulo, Editora Sumaré, FAPESP, 1991 ; STOLCKE, Verena, Cafeicultura : homens,
mulheres e capital (1850-1980), São Paulo, Brasiliense, 1986 ; HALL, Michael, The origins of mass
immigration in Brazil, 1871-1914, thèse de doctorat, Columbia University, 1969 ; MARTINS, José da
Souza, A imigração e a crise do Brasil agrário, São Paulo, Pioneira, 1973 ; MARTINS, José da Souza O
cativeiro da terra, São Paulo, Ciências Humanas, 1979 ; HOLLOWAY, Thomas, Immigrants on the land :
coffee and society in São Paulo, 1886-1934, Chapel Hill, University of California Press, 1980 ; FONT,
Mauricio, « Coffee Planters, politics and development in Brazil », Latin American Research Review,
vol.22, n°3, pp.69-90 ; LOVE, Joseph L., « Of planters, politics and development », Latin American
Research Review, vol.24, n°3, pp.127-135.
90
Nationalités Entrées Sorties
Portugais 275 257 160 920
Espagnols 209 282 107 179
Italiens 202 749 176 991
Japonais 176 775 12 615
Brésiliens100 125 826 95 845
Allemands 43 989 34 816
Turcs 26 321 12 364
Roumains 23 756 7 126
Yougoslaves 21 209 5 134
Lituaniens 20 918 3 373
Syriens 17 275 7 587
Polonais 15 220 6 612
Autrichiens 15 041 7 180
Autres 47 664 29 338
Total 1 221 282 667 080
Tableau 1: Mouvements migratoires par le port de Santos, Etat de Sao Paulo, de 1908 à 1936.
Source : Memorial do Imigrante, SP.
Ces migrations de travail se convertissant souvent en migrations permanentes, certains
facteurs idéologiques vont contribuer à promouvoir ou non l’entrée de certains
candidats à l’immigration.
100 Il s’agit de migrations internes empruntant la voie maritime.
91
II. Le manque de main d’œuvre comme
argument. Une immigration sélective,
définie idéologiquement
Les conditions économiques liées aux débuts de l’industrialisation et à la fin du système
esclavagiste ont généré un fort besoin de main d’œuvre salariale. La question que l’on
peut se poser alors est : pourquoi n’a-t-on pas assisté à un simple transfert permettant
aux anciens esclaves de devenir les salariés de ce nouveau système ? Plusieurs
hypothèses peuvent être développées, la première étant l’insuffisance numérique, les
seuls esclaves affranchis ne constituant une main d’œuvre suffisamment nombreuse
pour pallier l’important développement tant industriel qu’agricole. Ce facteur a sans
doute joué. Deuxième hypothèse, la volonté des hommes et des femmes libérés de leur
statut servile de quitter la terre et donc un affaiblissement numérique du personnel
agricole disponible. C’est également une hypothèse valable car on voit alors une partie
d’entre eux affluer vers les villes car ils veulent alors se détacher le plus possible de leur
ancien statut. Troisième hypothèse, celle de la réticence des propriétaires terriens de
rétribuer des personnes qui, jusque là, ne leur coûtaient rien. Ce facteur a été sans doute
déterminant. Dernière hypothèse, qui fait entrer en scène un nouvel acteur, la volonté de
l’Etat brésilien de se doter alors d’un peuple particulier, le tout dans l’optique de se
moderniser et avec comme fond de pensée, l’idée que la modernité est liée à la
blancheur de la population. C’est cette dernière hypothèse que nous allons développer
ici, les autres facteurs, bien que réels, étant toutefois moins déterminants en ce qui
concerne la définition des politiques migratoires mises en place par le Brésil depuis la
fin du 19e siècle.
En effet, nous allons voir dans un premier point que se développe à cette période un
courant de pensée en Europe qui est entendu jusqu’au Brésil. Les liens intellectuels avec
le Vieux Continent étant particulièrement développés, on ne peut nier l’existence d’une
influence de ces théories surtout dans la mesure où l’Europe est idéalisée, perçue
comme un modèle car développée. Toutefois, après avoir dessiné les contours de ces
92
théories déterministes, nous analyserons dans un second point comment elles on été
réinterprétées et adaptées au cas brésilien. À la fixité pessimiste, le Brésil opposera un
évolutionnisme optimiste mais non moins idéologiquement fondé sur l’existence de
races plus ou moins avancées.
A. Les théories européennes en vogue au
Brésil : de l’homme perfectible aux
visions darwinistes et essentialistes.
Vers une idéologie de la fixité
biologique.
Jusqu’au 19ème siècle, en Europe, les différences entre les êtres humains sont abordées
sous le prisme d’une forme de déterminisme social et culturel. Et l’inscription des êtres
vivants dans l’Humanité dépend de l’existence de leur âme. L’appartenance à
l’humanité repose donc sur la croyance religieuse, « c’est l’intégration dans l’univers du
Salut, le recours à une référence située en dehors et au-dessus de l’humanité qui fait
loi »101. C’est pourquoi Colette Guillaumin reprend l’exemple bien connu de Bartolomé
de Las Casas qui, découvrant que les Indiens ont une âme, qu’ils font donc partie de
l’humanité, décide d’avoir recours à des esclaves noirs pour l’instant dépourvus
d’humanité selon les connaissances de Las Casas. En d’autres termes, l’humanité n’est
pas une question de degré, elle est nulle ou totale. Les différences de mœurs, de mode
de vie, de couleur de peau sont des variables qui ne sont pas essentialisées. L’humanité
est hétérogène mais fondée sur la transcendance divine.
Les philosophes du 18ème siècle insistent ainsi sur les facteurs extérieurs aux hommes
pour expliquer ces différences. Nulle question d’un déterminisme biologique mais
plutôt d’un déterminisme lié au consensus social et à la psychologie individuelle pour
101 GUILLAUMIN, Colette, L’Idéologie raciste, Paris, Folio essais, Gallimard, 2002 (Mouton &Co, 1972),
p.26.
93
Rousseau102, au milieu géophysique pour Montesquieu103, aux structures sociales pour
Sade104. Quant à Jean Itard, il systématise la croyance dix-huitiémiste en la perfectibilité
humaine à travers son étude sur Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron105. Ces différents
auteurs mettent l’accent sur l’importance des stimuli extérieurs dans la constitution de
l’humanité. À travers la recherche de la nature humaine, le consensus auquel
aboutissent les philosophes et savants du 18ème est qu’il ne saurait y avoir de
déterminisme biologique. L’homme est perfectible, c’est-à-dire que son comportement
social n’est pas inné, d’où la recherche de son état sauvage106, primitif. Chez Rousseau,
cette perfectibilité est liée au libre-arbitre et donc à l’absence de déterminisme naturel.
L’homme, contrairement à l’animal, a la capacité de se perfectionner, d’apprendre, de
développer certains comportements librement choisis, et il n’est jamais abouti. Pour le
18ème, la société joue un rôle essentiel dans le développement humain puisqu’elle tire
l’homme de son état de nature et contribue à son évolution, à son perfectionnement.
Pour le meilleur ou pour le pire en fonction des auteurs.
En Europe comme au Brésil, l’émergence de la science et la laïcisation de la notion
d’humanité ont conduit à repenser, au cours du 19ème siècle, la façon d’envisager la
société et les conditions d’appartenance à l’humanité. Au Brésil, l’idée est de mettre un
terme à la relativité incarnée par le romantisme pour lui opposer l’universalité incarnée
par la science et la connaissance. Cette époque est celle pendant laquelle des
intellectuels vont se nourrir de la pensée « scientifique » européenne pour comprendre
ce qui est désormais perçu comme un « retard civilisationnel ». Cependant cela ne sera
pas sans choisir et adapter les théories européennes. Ces théories, quelles sont-elles ?
102 Voir La Nouvelle Héloïse, Amsterdam, 1761, ou la moins connue Lettre à Chrisophile ou Discours sur
les richesses, Paris, Reinwald, F. Bouet, 1853. 103 L’Esprit des lois, Genève, 1748. Voir aussi l’article de GOUROU, Pierre, « Le déterminisme physique
dans L’Esprit des lois », L’Homme, vol. 3, n°3, 1963, pp.5-11. 104 Voir par exemple La Nouvelle Justine, suivi de Histoire de Juliette, sa sœur, 1799. 105 Jean Itard lui consacre deux mémoires en 1801 et 1806, regroupés par exemple dans l’édition
suivante : ITARD, Jean, Victor de l’Aveyron, Paris, Allia, 2009, 151p. 106 La recherche de l’état primitif de l’homme avant sa corruption par la société et le développement du
mythe du « bon sauvage » ont été développés par de nombreux auteurs, parmi lesquels on peut également
citer Diderot (Supplément au voyage de Bougainville, 1772, publié en 1796), et avant le 18ème siècle
Montaigne (Essais, Livre I, chap. 31, « Des Cannibales », 1580 et Livre III, chap. 6, « Des Coches »,
1588) et Jean de Léry (Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, 1578).
94
L’Europe du 19ème siècle change de focale pour appréhender les différences entre les
hommes, le système traditionnel de causalité est bouleversé. En effet, la différence est
désormais inscrite au sein même de la nature de l’humanité.
« Pour le XVIIIe, l’origine des différences culturelles et politiques, arrachée
à la théologie, était soit géographique, soit psychologique, soit pur
mécanisme social, en tout cas étrangère à la biologie. L’apparition de la
causalité biologique marque la pensée sociale et psychologique du XIXe
siècle. Les sociétés sont différentes avait remarqué le XVIIIe, parce qu’elles
sont déterminées biologiquement répondra le XIXe. »107
En effet, les recherches scientifiques menées alors tendent à expliquer les différences
entre les êtres humains par leur versant biologique, la notion de race fait son apparition
et permettrait alors d’expliquer la transmission de certains caractères. Ceux-ci
deviendraient alors héréditaires.
La fin du 19ème siècle voit la société se naturaliser, se biologiser et « cette biologie
triomphante ne pouvait pas ne pas déteindre sur la société »108. Les trois grands noms de
ces avancées biologiques sont, selon Pichot, Claude Bernard et sa physiologie moderne,
Louis Pasteur et la microbiologie aux applications médicales, hygiénistes, industrielles
et agricoles, et Charles Darwin et la théorie de l’évolution. De ces trois avancées
scientifiques, celle qui a le plus d’impact idéologique – bien que toutes contribuent à la
vision biologisante de la société – est définitivement le darwinisme. En effet, cette
théorie qui a progressivement été adoptée par la communauté scientifique affirme le
principe de la sélection naturelle des espèces et de leur évolution pour s’adapter au
milieu. Ce principe a été énoncé par Darwin en 1859 dans son livre L’origine des
espèces. L’élaboration de cette théorie, encore balbutiante et peu claire, aboutit et
devient plus précise et scientifiquement convaincante grâce aux développements
ultérieurs de la génétique. Ainsi, selon Pichot,
« Pendant un demi-siècle (de 1859, date de publication de L’origine des
espèces, jusqu’à 1909-1915), les conceptions en matière d’évolution furent
107 GUILLAUMIN, Colette, op.cit., p.39. 108 PICHOT, André, La Société pure de Darwin à Hitler, Paris, Flammarion, 2000, p.32.
95
d’une confusion extrême, et ne pouvaient donc guère servir d’exemples à
imiter dans les sciences humaines et sociales. Régnait alors un
embrouillamini de théories diverses (Galton, Haeckel, Weismann, De Vries,
etc.), qui se recoupaient ou s’opposaient, mais qui toutes se réclamaient de
Darwin et toutes s’accordaient à peu près avec lui sur la question de la
sélection naturelle. C’était bien leur seul point d’accord, et ce point devint
central dans la constellation assez floue de doctrines biologiques regroupées
sous le nom de darwinisme (encore que, même là, l’accord ne fût pas
toujours parfait – avec De Vries par exemple). C’est d’ailleurs ce seul point
de la théorie qui fut exporté dans les autres disciplines (psychologie,
sociologie, etc.). »109
Ainsi Darwin n’est pas le seul à élaborer des thèses cherchant à démontrer le caractère
héréditaire de certains traits. Les savants Lamarck et Wallace ont ainsi participé aux
mêmes types d’étude que Darwin. On peut aussi citer l’abbé Mendel qui, en 1866, à
travers une étude sur les petits pois, confirme le principe de transmission et de
mutations des gènes.
Du côté des études sociologiques, les auteurs s’attachent également à expliquer le
fonctionnement des sociétés. Une théorie de l’évolutionnisme social est synchronique
avec celle de l’évolutionnisme biologique. Certains auteurs tendent à expliquer que
celui-ci est le résultat du développement de celui-là. En fait, ce sont deux processus
concomitants puisque c’est Herbert Spencer, un des leaders de la théorie de
l’évolutionnisme social, qui a popularisé les concepts d’évolution et de survie du plus
apte entre 1860 et 1890. L’évolutionnisme social postule l’unité de l’humanité et
l’évolution de chaque société d’un mode primitif à la civilisation, civilisation qui est
incarnée par l’Occident. Une autre théorie, celle du darwinisme social, se développe sur
les bases du darwinisme biologique qui s’est étendu, à la faveur de l’esprit de l’époque,
aux sciences humaines et sociales en construction. La lutte, la concurrence et la
sélection, concepts clés de la théorie darwiniste sont transposés à la société humaine et
permettent de justifier les inégalités et les conflits. Comme le note Vacher de Lapouge,
109 Ibid., p. 71.
96
« Dès la publication de L’Origine des espèces, les esprits clairvoyants
comprirent que les idées sur l’histoire et l’évolution des sociétés, que les
bases mêmes de la morale et de la politique ne pouvaient plus être celles
qu’elles avaient été jusque-là. Clémence Royer fut, je crois, la première à
dire dans la préface de sa traduction [1862] de l’Origine que la découverte
de Darwin aurait plus d’importance encore au point de vue social qu’à celui
de la biologie. […]
Darwin, en formulant le principe de la lutte pour l’existence et de la
sélection, n’a pas seulement révolutionné la biologie et la philosophie
naturelle : il a transformé la science politique. La possession de ce principe a
permis de saisir les lois de la vie et de la mort des nations, qui avaient
échappé à la spéculation des philosophes. »110
La collusion entre la découverte de la génétique, du darwinisme et du déterminisme
biologique avec la réflexion sur la société bourgeoise en construction produit une
pensée associant le déclin des sociétés au non-respect de la sélection naturelle. Ce que
Royer et d’autres dénoncent à travers le darwinisme social, c’est que cette sélection
naturelle n’étant plus respectée, la société est amenée à la dégénérescence. Cette
réflexion est partagée par Gumplowicz, Bagehot, Ratzenhofer, Haeckel et Vacher de
Lapouge. À l’opposé de cette idée de dégénérescence, l’eugénisme, dont Francis Galton
a été l’un des théoriciens, s’est développé à la même période et a connu un succès
malheureux au 20ème siècle.
Parallèlement, Gobineau développe une théorie de la hiérarchie des races. Selon
l’aryanisme, l’espèce humaine est composée de trois groupes ou races archétypales :
blanche, jaune et noire, les deux secondes étant inférieures à la première. Sa pensée,
souvent contradictoire, est exprimée dans son Essai sur l’inégalité des races humaines
(1853-1855). Le racisme de Gobineau tient essentiellement à sa lecture raciale de
l’histoire et à la façon dont il s’inscrit dans le cadre du mythe de la supériorité aryenne.
Gobineau établit donc une hiérarchie entre les races, chacune dotée de spécificités et de
dons particuliers hérités de la biologie. Cette hiérarchie se mesure en termes de
110 VACHER DE LAPOUGE, Georges, Les Sélections sociales (cours libre de science politique professé à
l’université de Montpellier, 1888-1889), Fontemoing, Paris, 1896, pp. V-VI et 1-2. Cité par PICHOT,
André, op. cit., p.70.
97
civilisation. Gobineau est un essentialiste pour lequel la race détermine les caractères
propres à chacun. Cependant toutes les races font également partie de l’humanité. Pour
lui, « il y a une différence fondamentale entre l’homme et l’animal, et il n’y a pas de
hiérarchie dans le degré d’humanité. C’est ce qui lui permet de concilier son racisme et
son catholicisme »111. En effet, en fervent catholique, Gobineau est monogéniste –
toutes les races sont issues de la Création – mais explique leur différenciation par leur
dispersion. Cette différenciation, une fois acquise, est cependant devenue irréversible.
Le métissage dans ce contexte est une dégénérescence pour la société humaine
puisqu’elle diminue la race supérieure et le métis se trouve comme déclassé,
n’appartenant plus à aucune des deux races112. Les idées de Gobineau ont été reprises et
développées par Houston Chamberlain, lequel devient un des principaux théoriciens de
la pensée raciste au 20ème siècle et défenseur de la supériorité germanique.
Au tournant des 18ème et 19ème siècles, la croyance en les progrès de l’esprit humain et
en le développement de l’apport de la science a eu des répercussions dans la façon de
penser la société. Entre l’objectif d’Auguste Comte113 qui pensait remplacer le pourquoi
(théologique) par le comment (scientifique), la religion par le positivisme scientifique,
et fondait la sociologie (1839) et Gobineau, ce n’est pas un écart de 10 ou 15 ans qui
apparaît, mais bien la fracture entre des conceptions du 18ème siècle héritées de Saint-
Simon pour l’un et les perceptions biologisantes de la société du 19ème siècle. Avec cette
révolution de pensée, il n’y a plus de mobilité possible, l’identité individuelle n’existe
plus réellement, l’identité est celle de la biologie, elle est marquée par la fixité, elle se
trouve essentialisée : « la rigidité des appartenances de groupe, fatalité biologique, est
maintenant inamovible, intouchable »114.
En quoi ces théories ont pu influencer la pensée brésilienne et son approche de la
société ?
111 PICHOT, op.cit., p.309 112 Notons que la pensée de Gobineau est très influencée par le système de castes indien. 113 Cours de philosophie positive, 1830-1842. 114 GUILLAUMIN, Colette, op. cit., p.41.
98
B. Théorie du blanchiment et démocratie
raciale
Le Brésil est généralement reconnu dans le monde et il existe d’ailleurs une croyance
forte au sein même du Brésil pour affirmer que le pays, ayant été formé à partir des trois
matrices indiennes, européennes et africaines (comme le reste de l’Amérique latine), ait
réussi à surpasser les différences raciales originelles et constituerait ainsi une certaine
exception. D’après Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, ceci peut s’expliquer par
l’attitude de l’Etat pour intégrer dans la nation les populations d’origine indigène et les
descendants d’esclaves en deux étapes : « D’abord, (la solution brésilienne) a été de nier
l’existence de différences biologiques (capacités innées), de différences politiques
(droits), de différences culturelles (ethnicité) et de différences sociales (ségrégation ou
préjugés) entre ces personnes et les descendants d’Européens, avec ou sans mélange
racial. Deuxièmement, c’est parce que la solution brésilienne a incorporé toutes ces
différences d’origine dans une seule syncrétique et hybride matrice, à la fois en termes
biologiques, culturels, sociaux et politiques. C’est ce que nous appelons
conventionnellement démocratie raciale. »115 Ce que décrit ici Guimarães correspond à
la période précédant la « Modernité » brésilienne, dont le début est traditionnellement
associé à la Révolution de 1930, période durant laquelle a été pensée et élaborée la
construction identitaire nationale brésilienne.
a. La modernisation passe un blanchiment de la
population
Durant la Première République (1889-1929), l’Etat a tenté de moderniser le pays :
d’abord en adoptant de nouvelles institutions, ensuite en cherchant à européaniser le
115 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo, « The Race Issue in Brazilian Politics (The Last Fifteen
Years) », Fifteen Years of Democracy in Brazil, University of London, Institute of Latin American
Studies, Londres, 15 et 16 février 2001.
99
pays, d’un point de vue culturel et démographique, via une favorisation de
l’immigration européenne, en d’autres termes blanche. En effet,
« L’abolitionnisme et la politique d’incitation à l’immigration européenne
(…) introduisent une valorisation croissante de l’immigrant, impliquant la
proposition d’européanisation, c’est-à-dire de blanchiment, de la population.
Àcôté de l’idéalisation de l’indien en opposition avec le portugais et le noir,
se développe l’idéalisation de l’européen là aussi en opposition avec le
noir. »116
C’est dans ce contexte de fin du travail servile et de « révolution bourgeoise en
marche »117 que l’immigrant européen est valorisé, selon Ianni toujours, car il s’agit
d’une part de redéfinir socialement et culturellement le travail manuel et d’autre part de
le valoriser en le libérant du « stigmate de l’esclavage »118. Mais ce recours à la main
d’œuvre européenne n’est pas sans causes idéologiques119. Il ne s’agit pas seulement de
main d’œuvre, il est question de « créer une nouvelle et différente nation »120. Les
années 1870 marquent ainsi à la fois l’assurance de la fin définitive de l’esclavage avec
la Lei do Ventre Livre121 de 1871 et aussi l’entrée au Brésil des théories comme
l’évolutionnisme social, le positivisme, le naturalisme, le darwinisme social. La fin de
l’esclavagisme pose la question de la main d’œuvre manquante. Le Brésil a fait preuve
d’une grande réceptivité pour les théories scientifiques européennes du 19ème siècle. On
connaît notamment la venue de Gobineau et sa familiarité avec Dom Pedro II, de même
que l’influence du positiviste Auguste Comte dont est issue la formule emblématique du
116 IANNI, Octavio, Raças e classes sociais no Brasil, Rio de Janeiro, Brasileira, 1972, pp. 345-346. 117 Ibid, p.346. 118 Id. 119 Voir par exemple: OLIVEIRA, Lucia Lippi, O Brasil dos imigrantes, Rio de Janeiro, Jorge Zahar,
2001 ; RAMOS, Jair de Souza, « Dos males que vêm com o sangue : as representações raciais e a categoria
do immigrante indesejável nas concepções sobre imigração de década de 20 », In MAIO, Marcos Chor ;
SANTOS, Ricardo Ventura (org.), Raça, ciência e sociedade, Rio de Janeiro, Fiocruz, CCBB, 1995, pp.
59-82 ; SEYFERTH, Giralda, « Os immigrantes e a campanha de nacionalização do Estado Novo », In :
PANDOLFI, Dulce (org.), Repensando o Estado Novo, Rio de Janeiro, FGV, 1999, pp.199-228. 120 SANTOS, Sales Augusto dos, « Historical Roots of the "Whitening" of Brazil », Latin American
Perspectives, Issue 122, vol. 29, n°1, janvier 2002, p.72. 121 Ou Loi du Ventre Libre.
100
Brésil Ordem e Progresso. Ces théories européennes nécessitent cependant d’être
remaniées pour faire leur entrée au Brésil. Mais elles offrent à la fois une explication et
une solution aux problèmes brésiliens : le Brésil a un problème de main d’œuvre, il
souffre également d’un retard dans la marche vers le progrès qui peut s’expliquer par la
composition de sa population, mais tout ceci est résolvable.
En effet, les élites brésiliennes doivent composer avec la réalité d’un métissage déjà très
présent. Ainsi, dans un article comparatif entre le Brésil et le Mexique, Thomas
Skidmore insiste sur la nécessité pour les intellectuels de prendre en compte, dans la
constitution du mythe national, cette miscégénation, ce « mélange racial massif qui
avait déjà eu lieu, particulièrement à l’époque coloniale »122. Les élites vont retenir du
darwinisme social le principe de « la différence entre les races et de leur hiérarchie
naturelle, sans que soient problématisées les implications négatives de la
miscégénation »123. De l’évolutionnisme social, elles vont souligner « la notion selon
laquelle les races humaines ne restent pas figées, mais en constante évolution et
"perfectionnement"124, élimant l’idée d’une humanité unique »125. Grâce à ces théories
revisitées et adaptées, le retard du Brésil trouve une explication dans l’importance de la
population noire et une solution dans l’importation d’une population européenne. La
miscégénation continue avec des populations blanches sera la solution. Du métissage,
loin d’être perçu comme une dégénération126, est escompté un blanchiment physique,
culturel et intellectuel de la population brésilienne, les aryens, conformément aux
théories raciales en vigueur en Europe, représentant le sommet de l’échelle raciale. Le
blanchiment escompté de la population est posé comme une condition à la
modernisation du pays. « Le noyau de ce racialisme était l’idée que le sang blanc
purifiait, diluait et exterminait le noir, ouvrant ainsi la possibilité pour les métis de
122 SKIDMORE, Thomas E., « Onde estava a "Malinche" brasileira ? Mitos de origem nacional no Brasil e
no Mexico », Cultura Vozes, n°3, mai-juin 1997, p.113. 123 SCHWARCZ, Lilia Moritz, O espetáculo das raças, São Paulo, Companhia das Letras, 2007 (1993),
p.18. 124 Entre guillemets dans le texte. 125 SCHWARCZ, Lilia Moritz, O espetáculo das raças, São Paulo, Companhia das Letras, 2007 (1993),
p.18. 126 Et ici, le Brésil marque une nette différence avec le darwinisme social.
101
s’élever vers la civilisation »127. L’importation de ces théories scientifiques a naturalisé
des différences sociales tout en permettant de maintenir une hiérarchie sociale existante.
C’est pourquoi
« il est extrêmement important de garder présent à l’esprit que cette phase de
nationalisme présent(e) une forte composante européocentrique, malgré
l’autonomie et l’originalité qu’elle revendique. L’incorporation de
l’idéologie civilisatrice et de théories climatiques et raciales a conduit à un
rapport européocentrique avec le milieu naturel local et les cultures
indigènes, africaines et métisses du pays »128.
L’encouragement de l’immigration européenne peut ainsi se comprendre, depuis le
milieu du 19ème siècle, comme une réponse à la fin de l’esclavagisme, comme une
requalification du travail manuel et, grâce à la popularisation de théories scientifiques
européennes, comme une volonté de faire entrer le Brésil dans le progrès.
b. Le développement du paradigme de la démocratie
raciale
Un basculement s’opère cependant dans les années 1920-1930 face à la possibilité de
voir se créer une fracture au sein de la société brésilienne dans laquelle cohabitent
plusieurs cultures et qui peine à se rassembler autour d’une identité nationale129. Nous
avons vu en effet que l’immigration européenne est très diverse, composée d’individus
127 « O núcleo desse racialismo era a idéia de que o sangue branco purificava, diluía e exterminava o
negro, abrindo assim a possibilidade para que os mestiços se elevassem ao estágio civilizado »,
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo, « Racismo e anti-racismo no Brasil », Novos Estudos da CEBRAP,
São Paulo, n°43, 1995, p.37. 128 BITTENCOURT, Ezio da Rocha, « Aspects du processus d’européanisation du Brésil et aperçu de la
culture européenne dans les théâtres du Rio Grande do Sul (XIXème siècle-1940) », Revue Europa,
Genève, vol.1, n°26, 2004, p.103. 129 Voir par exemple: OLIVEIRA, Lucia Lippi, A questão nacional na Primeira República, São Paulo,
Brasiliense, CNPq, 1990.
102
venant du Portugal, d’Espagne, d’Italie, de France, de Russie… et portant avec eux leur
propre culture nationale et/ou régionale. Une solution apparaît alors, celle de lier la
nation métisse et de la brésilianité. Cette phase a été rendue visible à travers trois
facteurs. Pour les citer dans un ordre à la fois chronologique et thématique, il s’agit de
la production littéraire et artistique notamment pendant la Semaine d’Art Moderne de
1922, des solutions économiques envisagées au cours de la Révolution de 1930, et de
travaux en sciences sociales comme ceux de Gilberto Freyre130, Sérgio Buarque de
Holanda131 et Caio Prado Júnior132.
Du point de vue économique, la croissance et les débuts de l’industrialisation d’une
part, et la baisse de l’immigration européenne dans les années 1930 d’autre part,
ouvrent potentiellement la voie à l’insertion de la population noire et métisse par le
salariat. En effet, jusque là, l’abolition de l’esclavage avait surtout ouvert la voie à
l’immigration européenne, préférée aux populations noires et métisses libérées de leur
statut servile. Du point de vue artistique et littéraire, le modernisme brésilien naît en
1922 lors de la Semaine d’Art moderne de São Paulo133 et ce que l’on nomme
l’anthropophagie est son courant le plus puissant. Les artistes qui se réclament de ce
courant entendent assimiler de façon rituelle et symbolique la culture occidentale134.
130 Il s’agit des ouvrages Casa Grande e Senzala (1933) et Sobrados e macumbos (1936). 131 Voir son ouvrage Raizes do Brasil (1936). 132 Nous renvoyons à son écrit majeur Formação do Brasil contemporâneo (1942). 133 La ville tient une place privilégiée au 20ème siècle, c’est en ville que se développent les nouveaux
courants de pensée, mais les situations des deux villes les plus importantes, Rio de Janeiro et São Paulo
sont bien distinctes. Rio de Janeiro est la ville de toutes les influences étrangères et c’est une ville
« blanche » comparée à la cité pauliste qui reçoit tous les nouveaux libres que l’industrie du café ne
souhaite pas embaucher et auxquels elle préfère l’immigration européenne. A São Paulo se développe une
identité originale, une identité nouvelle, à contre-courant de l’influence européenne et que les artistes vont
nommer anthropophagie. Ce courant de pensée est une tentative de différenciation identitaire par rapport
au seul apport européen.
134 Cette revendication de l’originalité brésilienne dans le cadre des arts est tout à fait compréhensible :
les critères esthétiques qui y sont alors reconnus sont les critères européens. Ainsi, le modèle artistique a
directement été importé d’Europe, en témoigne la venue de la mission artistique française à Rio en 1816,
mission qui a participé à la création des Beaux-Arts brésiliens. On affirme en outre que ce mouvement
n’aurait pu naître ailleurs qu’en ville qui est le lieu de la modernité, où tout est mouvant et où l’influence
étrangère est partout perceptible. Sur l’émergence de cette théorie à São Paulo plutôt qu’à Rio, Bartolomé
103
C’est pourquoi le manifeste anthropophage d’Oswaldo Andrade de 1928 fait référence
aux pratiques anthropophages des Indiens. Expliquons-nous : en 1554, des Indiens ont
« consommé » un archevêque portugais. En datant son manifeste de « l’an 374 de la
déglutition de l’archevêque portugais Sardinha » et en le situant à Piratininga, nom tupi
de São Paulo, Andrade revendique les héritages du peuple brésilien. Etre brésilien, la
brésilianité, c’est un retour sur ce qui est constitutif de la nation, un retour sur les
racines du Brésil, un métissage et non une simple copie de ce qui se fait en Europe.
L’idéal européen s’éloigne pour prendre en considération les spécificités brésiliennes.
Enfin, l’idé(ologi)e de la démocratie raciale adaptée de l’œuvre de Gilberto Freire (Casa
Grande e Senzala) consistait à affirmer que le caractère de la nation brésilienne était le
métissage de sa population. Selon l’auteur, les hiérarchies sociales existantes ne sont de
fait pas des hiérarchies raciales mais de classe. Cependant, on peut remarquer que, bien
que le blanchiment ne soit plus aussi valorisé, le métissage ou miscégénation restent le
fondement de la conception nationale. Ainsi, « l’image de Freire de la fusion
harmonieuse des trois races, image qu’il n’a pas créée135 (…), est devenu le paradigme
prédominant par lequel les brésiliens expliquent la création de leur société et de leur
identité nationale ».
Bennassar donne la raison suivante : São Paulo est une « métropole bien plus cosmopolite et réceptive
aux avant-gardes européennes » (BENNASSAR, Bartolomé, 2000, p.301). Il serait donc question d’une
naissance de cette identité par opposition. L’affirmation d’une identité par opposition à une autre est un
processus qui a été bien décrit concernant la naissance des nationalismes européens au 19ème siècle ou
encore sur l’affirmation nationale qui a provoqué les décolonisations du 20ème siècle – nous n’associons
pas ici le cas des décolonisations d’Amérique latine pour lesquelles le nationalisme n’est pas le moteur
premier des Indépendances. Sur la question européenne, on peut se reporter notamment à l’ouvrage de
CARON, Jean-Claude et VERNUS, Michel, L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes. 1815-
1914, Paris, Armand Colin, 1996. Sur la décolonisation, on peut citer le livre de H. GRIMAL, La
décolonisation de 1919 à nos jours, Bruxelles, Complexes, 1985. 135 Thomas Skidmore nous rappelle que le romantisme brésilien du 19ème siècle a beaucoup insisté sur le
métissage sexuel. Nous pouvons par exemple citer les ouvrages du cearense José de Alencar O Guarani
(1857) et Iracema (1865) abordant les amours de deux couples. Dans le premier, Alencar pose l’amour
des hommes indigènes pour les femmes blanches, dans le second des femmes indigènes pour les hommes
blancs. Quant à Paulo Prado, notamment dans son Retrato do Brasil publié en 1928, il explique le
métissage par l’omniprésence de la sensualité et du désir sexuel au Brésil.
104
Comme nous l’avons indiqué dès l’introduction, l’émergence du terme même de
« démocratie raciale » est un long processus qui ne s’est affirmé qu’au cours des années
1940 d’après une évolution et une interprétation de la pensée de Gilberto Freyre. Elle
est le fruit d’une interrogation d’une vingtaine d’années sur la spécificité de la
brasilianité. Cette idéologie qui devient l’étendard du modèle d’intégration à la
brésilienne repose sur le métissage déjà engagé des populations. Cependant, la
démocratie raciale ne met pas un terme à l’idée de blanchiment. Elle signifie plutôt la
capacité de la brésilianité à incorporer et intégrer les métis et les noirs. Elle constitue
une matrice idéologique très puissante qui, au lieu de remettre en question les
différences sociales inter-raciales136, permet de les occulter et de les maintenir hors du
jeu politique137. « Il n’existe pas et ne peut exister de racisme au Brésil puisque nous
sommes un pays de métis formé par l’harmonieux mélange des trois races indienne,
noire et blanche », dit la démocratie raciale. La démocratie raciale nie toutefois le
caractère inné des différences raciales, mais elle prolonge l’idéologie du blanchiment,
ce qui a des répercussions dans les flux migratoires. Dans ce cadre en effet, des
questions se posent pour certains candidats à l’immigration : Sont-ils un atout dans cette
perspective de blanchiment de la population ? Sont-ils assimilables dans le cadre la
démocratie raciale ? Vont-ils se fondre dans le creuset de la brésilianité ? Constituent-ils
un facteur de développement et de progrès ou s’y opposent-ils ?
Ces questions ont été soulevées dans le cas de la population juive : ni blanche, ni noire
mais sémite, souhaitant en majorité immigrer à partir des années 1920-1930, comment
envisager leur intégration dans la société brésilienne ? Force est de constater cependant
que durant les années 1920-1930, les juifs européens ont migré vers le Brésil.
***
La Première République a constitué une période de transition entre les idéologies, les
manières de penser et de se penser héritées de la période coloniale et celles que nous
136 Nous utilisons par commodité ce terme inter-racial dans la mesure où il renvoie au mode de pensée de
l’époque. 137 Cf. HASENBALG, Carlos, Race relations in modern Brazil, Albuquerque, The Latin American Institute,
University of New Mexico, 1984.
105
connaissons actuellement au Brésil. Quête inaugurée avec le déplacement de la Cour
portugaise à Rio de Janeiro, le Brésil se cherche pendant la Première République une
identité nationale. « Le Brésil n’a pas de peuple »138 disait dans les années 1880 Léon
Couty, un français installé à Rio de Janeiro, il n’est pour autant pas vide pourrions-nous
ajouter. Sa population est composite et métissée. Le pays attire de nombreux migrants
européens et conclut même des accords migratoires avec le Japon. La suppression de
l’esclavage, les développements agricoles désirés, les débuts de l’industrialisation et la
volonté de progrès conduisent les élites brésiliennes, alors essentiellement terriennes, à
imaginer la formation d’un creuset national. Le Brésil, très réceptif aux modes et aux
idéologies européennes, n’en demeure pas moins un pays original dans sa façon de
traiter cette question. La démocratie raciale et la miscégénation avec les Européens
doivent permettre de résoudre le double problème du pays : son « retard » de
développement et une forme de manque de cohésion nationale. Ce métissage, déjà en
cours depuis la période coloniale, est donc particulièrement souhaité. Cependant, il
n’évacue pas certains aspects idéologiques car il a pour fonction d’aboutir à un
blanchiment de la population. C’est pourquoi, si la démocratie raciale a des ambitions
plus englobantes, moins européocentrées que le seul blanchiment de la population via
l’immigration européenne, l’image de la brasilianité qu’elle propose ne remet pas en
cause et même passe sous silence les préjugés raciaux de la société et une forme de
hiérarchie raciale. La démocratie raciale, telle qu’elle va être appliquée par la génération
de 1930 qui arrive au pouvoir, devra se poser la question de l’assimilation possible ou
non des migrants dans le creuset de la brasilianité. Dans ce cadre, les juifs constituent-
ils des immigrants indésirables ? C’est la question que nous allons aborder dans ce
deuxième chapitre.
138 Référence célèbre que l’on peut notamment retrouver chez COCCO, Giuseppe ; NEGRI, Antonio, « Les
modulations chromatiques du biopouvoir au Brésil », Multitudes, 2005/4, n°23, pp. 53-61.