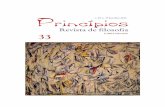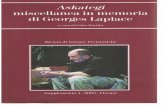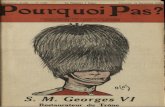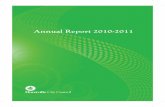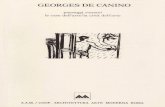Georges Cuvier et le premier paradigme de la paléontologie
Transcript of Georges Cuvier et le premier paradigme de la paléontologie
ISSN 0253-6730
1 Postdoctorant en Philosophie de l’Université Féderale de Santa Catarina (Brésil), Rua Protenor Vidal, 40, CEP.88040-320, Florianópolis, SC, Brésil. E-mail : [email protected]
I. IntroductIon
Dès la préhistoire humaine, divers objets fossilisés ont attiré la curiosité humaine en raison de leur forme et de leur composition lithologique. Les fossiles ressemblent souvent à des organismes vivants, ou à leurs parties, mais leur état pétrifié leur donne un aspect différent, qui était valorisé par l’Homme préhistorique. Au-delà de cet aspect, la rareté des objets fossiles a rendu ces phé-nomènes naturels encore plus valorisés par l’Homme, qui les expliquait en les associant à des mythes et des légendes (Oakley, 1965, p. 9-10 et 117).Ces explications étaient encore utilisées dans l’Antiquité, lorsque des penseurs tels que Pythagore de Samos (570-500 av. J. -C.) ou Hérodote d’Halicarnasse (480-420 av. J. -C.) ont commencé à défendre l’idée que les fossiles étaient les dépouilles d’organismes qui, dans un lointain passé, avaient vécu dans les endroits où ils étaient trou-vés (Mayor, 2000, p. 210-211, 264). Toutefois, d’autres penseurs, tels que Pline l’Ancien (23-79 av. J.-C.), ont soutenu l’idée que les fossiles ont été générés au sein de la Terre par des forces ayant le pouvoir de transformation (Pline, 1857, p. 397-404).
Cette discussion a traversé l’époque médiévale et a continué jusqu’à l’époque moderne, lorsque les travaux de l’anatomiste Danois Nicolaus Steno (1638-1686/87) et du naturaliste italien Fabio Colonna (1567-1650) ont associé des organismes marins fossilisés, trouvés dans des endroits éloignés de la côte, à d’anciennes trans-gressions et régressions marines. Avec le progrès des études, l’origine organique des fossiles a été acceptée par la communauté des chercheurs travaillant sur ces phé-nomènes naturels (Zittel, 1901, p. 19 ; Edwards, 1967, p. 25 ; Rudwick, 1976, p. 43-44). L’acceptation de cette nature organique a été rapidement utilisée par les pen-seurs modernes et contemporains, en particulier les théo-logiens naturels diluvianistes, comme un témoignage de l’existence de traces du déluge biblique. La configura-tion de la distribution universelle des fossiles et les loca-lités éloignées de la mer où étaient trouvés les fossiles d’organismes marins, étaient utilisées par les diluvia-nistes comme preuve de l’importance cette inondation (Woodward, 1723, p. 76-129).Le domaine des sciences géologiques, qui traite des ques-tions de la stratigraphie, avait été mis en place princi-palement grâce au travail de Steno sur l’existence d’une
Revue de Paléobiologie, Genève (décembre 2013) 32 (2) : 297-302
Georges cuvier et le premier paradigme de la paléontologie
Felipe FaRia1
résuméLes travaux et les efforts de Georges Cuvier ont inauguré un nouveau niveau paradigmatique dans l’étude des fossiles, les introduisant, pour la première fois, dans un système de classification qui comprenait tous les êtres vivants. Les méthodes développées par lui ont permis la reconstruction des organismes fossilisés et, par conséquent, la compréhension de leurs formes d’organisation corporelle, ce qui était l’objectif cognitif du programme de recherches de Cuvier pour l’Histoire Naturelle. Mais avec ce développement scientifique, quelques difficultés ont commencé à apparaître, comme l’explication, au travers du « Catastrophisme », d’une grande quantité d’événements d’extinction, enregistrés dans les couches géologiques. Cette situation a conduit à l’introduction des idées évolutionnistes dans les travaux paléontologiques.
Mots-clésEtude des fossiles, paradigme, système de classification, programme de recherches, extinction.
AbstractGeorges Cuvier and the first paradigm of paleontology.- The works and efforts of Georges Cuvier inaugurated a new paradigmatic stage in the study of fossils, introducing them, for the first time, into a classification system covering all living beings. The methods developed by him, allowed the reconstruction of fossil organisms and consequently an understanding of their corporal organization, the cognitive objective of Cuvier’s research program for Natural History. But with this scientific development, some difficulties began to arise, like the explanation, by « catastrophism » of the great number of extinction events registered in the geological strata. Then this situation led to the introduction of evolutionary ideas in paleontological research.
KeywordsStudy of fossils, paradigm, classification system, research program, extinction.
298 F. FaRia
séquence dans les couches géologiques interprétée chro-nologiquement (Steno, 1939 [1671], p. 37-44). Ainsi, pour beaucoup de naturalistes, les fossiles trouvés dans les différentes strates pouvaient être compris comme résultant de différents événements, et non d’un seul, comme le défendaient les diluvianistes.Ainsi, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, en dépit de l’accep-tation de l’origine organique des fossiles, ces derniers continuent d’être expliqués selon différents points de vue et sont décrits et classés de façon très rudimentaire (Rudwick, 2005, p. 153). C’est une telle situation que le philosophe des sciences, Thomas Kuhn (1922-1996) a décrite comme étant la période pré-paradigmatique d’un domaine scientifique. Durant cette période, plusieurs écoles de pensées se disputent l’hégémonie dans un domaine d’études précis – dans notre cas l’étude des fos-siles – sans qu’aucune d’entre elles ait obtenu le consen-sus de la communauté scientifique concernée (Kuhn, 2003, p. 224 ; 2006, p. 185).
II. Le Projet de cuvIer
Tout au long de sa carrière scientifique, le naturaliste français Georges Cuvier (1769-1832) a essayé de com-prendre la Nature à travers des études démontrant les limites de l’organisation corporelle avec laquelle la Nature produit pourtant une grande variété de formes (Cuvier, 1835, p. 59). Il comprit qu’il n’était pas suffisant pour cela d’étudier seulement les organismes vivants. Les organismes disparus, qui souvent présentaient des orga-nisations corporelles différentes, apportaient également de nouvelles données permettant à Cuvier de mieux com-prendre quelles étaient les limites de cette organisation (Caponi, 2008, p. 130). Mais, seules des comparaisons permettaient à Cuvier d’analyser ces limites en raison de l’impossibilité de transgression, dont l’intervention dans les processus fonctionnels aurait interrompu l’har-monie des parties d’un organisme. Et ce fut cette même méthode comparative qui lui permit la reconstitution d’êtres disparus, connus seulement par quelques frag-ments d’ossements fossilisés. Les organismes éteints étant ainsi reconstruits, Cuvier peut développer un sys-tème de classification unique pouvant inclure tous les organismes ayant existé au cours de l’histoire de la vie sur le globe. C’était le projet du développement d’une histoire naturelle globale.
III. Le PArAdIGMe de cuvIer
En 1796, au début de sa carrière, Cuvier présente un « mémoire sur les espèces d’éléphans vivantes et fos-siles » (Cuvier, 1796). Dans ce travail, il propose quelques points de son programme pour la paléontologie. Bien que le but de ce travail soit l’étude des fossiles de mammouths et mastodontes, Cuvier ne se limite pas à
leur simple description, mais les compare à des os d’élé-phants vivants, asiatiques et africains, avec l’intention d’établir leur position taxonomique. Grâce aux méthodes et aux lois de l’anatomie comparée qu’il avait formulées, Cuvier conclut que les éléphants d’aujourd’hui, les mam-mouths et les mastodontes sont des espèces différentes. Avec une telle conclusion, il prouve ainsi l’occurrence du phénomène naturel d’extinction pendant l’histoire de la vie. Mais ce qui peut-être illustre plus clairement son programme scientifique, c’est la défense de « l’existence d’une science qui ne paroît pas d’abord avoir avec l’ana-tomie, des rapports aussi intimes ; celle qui s’occupe de la structure de la terre, qui recueille les monumens de l’histoire physique du globe, et cherche à tracer d’une main hardie le tableau des révolutions qu’elle a éprou-vée ; la géologie, en un mot, ne peut établir d’une manière sure plusieurs des faits qui lui servent de base, que par le secours de l’anatomie » (Cuvier, 1796, p. 441-442).Dans le cadre de la diffusion de ses idées, de ses méthodes et de son programme de recherches pour l’étude des fossiles, Cuvier affirme, dans le Discours sur les révo-lutions de la surface du Globe, que jusqu’alors, les fos-siles étaient mal étudiés et considérés comme des objets de curiosité. Il note également qu’ils n’étaient pas liés aux couches géologiques dans lesquelles ils avaient été trouvés et que surtout, ils n’avaient pas été traités comme des « monuments » qui pouvaient être restaurés et déchif-frés (Cuvier, 1812, p. 1-3). Cette approche historique de l’étude des fossiles, contenue dans son programme de recherches, a également été défendue par Cuvier dans l’introduction de son Discours, lorsqu’il déclare : « [comme] antiquaire d’une espèce nouvelle, il m’a fallu apprendre à déchiffrer et à restaurer ces monuments, à reconnaître et à rapprocher dans leur ordre primitif les fragments épars et mutilés dont ils se composent ; à reconstruire les êtres antiques auxquels ces fragments appartenoient ; à les comparer enfin à ceux qui vivent aujourd’hui à la surface du globe : art presque inconnu, et qui supposoit une science à peine effleurée aupara-vant, celle des lois qui président aux coexistences des formes des diverses parties dans les êtres organisés » (Cuvier, 1812, p. 1).Cuvier applique comme méthode de connaissance phy-siologique les principes de l’anatomie comparée, seule façon d’analyser le phénomène de la vie et les lois qui régissent les êtres vivants (Guillo, 2003, p. 38 ; Caponi, 2004, p. 181). Il entreprend alors la recherche de ces lois et de ces principes, rendant possible son programme. Pour cela, Cuvier avance un principe connu sous le nom des « conditions d’existence » :« Comme rien ne peut exister s’il ne réunit les conditions qui rendent son existence possible, les différentes parties de chaque être doivent être coordonnées de manière à rendre possible l’être total, non seulement en lui-même, mais dans ses rapports avec ceux qui l’entourent » (Cuvier, 1817, p. 6). Cette compréhension des formes d’organisation corpo-
Georges Cuvier et le premier paradigme de la paléontologie 299
relle l’amène à formuler son premier principe de l’ana-tomie comparée, appelé la « corrélation des parties » ou « corrélation des formes ».Exposé dans ses Leçons d’anatomie comparée, écrites en 1805, ce principe établit que « tout être organisé forme un ensemble, un système unique et fermé, dans lequel toutes ses parties se rapportent et convergent vers la même action définitive au travers d’une réaction réci-proque » (Cuvier, 1805, p. 47). Ce caractère de récipro-cité implique qu’un changement dans l’une des parties du corps provoque nécessairement la modification d’autres parties de ce même corps :« Mais ces combinaisons, qui paroissent possibles, lorsqu’on les considère d’une manière abstraite, n’existent pas toutes dans la nature, parce que, dans l’état de vie, les organes ne sont pas simplement rapprochés, mais qu’ils agissent les uns sur les autres, et concourent tous ensemble à un but commun. D’après cela les modi-fications de l’un d’eux exercent une influence sur celles de tous les autres. Celles de ces modifications qui ne peuvent point exister ensemble, s’excluent réciproque-ment, tandis que d’autres s’appellent, pour ainsi dire, et cela non seulement dans les organes qui sont entre eux dans un rapport immédiat, mais encore dans ceux qui paroissent au premier coup d’oeil les plus éloignés et les plus indépendans » (Cuvier, 1805, p. 47).Ce principe doit être en conformité avec le deuxième principe, appelé la « subordination des caractères » : « Les parties d’un être devant toutes avoir une conve-nance mutuelle, il est tels traits de conformation qui en excluent d’autres ; il en est qui, au contraire, en néces-sitent ; quand on connait donc tels traits dans un être on peut calculer ceux qui coexistent avec ceux-la, ou ceux qui leur sont incompatibles ; les parties, les propriétés ou les traits de conformation qui ont le plus grand nombre de ces rapports d’incompatibilité ou de coexistence avec d’autres, ou en d’autres termes, qui exercent sur l’en-semble de l’être, l’influence la plus marquée, sont ce que l’on appelle les caractères importans, les caractères dominateurs ; les autres sont les caractères subordon-nés, et il y en a ainsi différens degrés » (Cuvier, 1817, p. 10-11).Sur la base de ces principes, Cuvier développe de nom-breuses études dans lesquelles il fait d’importantes reconstructions paléontologiques, lui permettant d’iden-tifier de nouvelles espèces fossiles, significatives pour la compréhension, d’une part des limites des formes d’organisation corporelle, et d’autre part, de l’histoire de la vie sur le globe (Buffetaut, 2001, p. 35). Grâce à ses méthodes, Cuvier corrige des déterminations taxono-miques, par exemple celle du ptérodactyle, qui avait été identifié par Cosimo Collini (1726-1806) comme étant un reptile marin (Cuvier, 1809, p. 424-437).Il rectifie également la classification taxonomique du Mosasaure, que Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1742-1819), titulaire de la chaire de géologie au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, avait identifié comme
étant un crocodilien (Saint-Fond, 1799, p. 59-75). Cuvier montre que l’animal avait une organisation corporelle différente de celle des crocodiles, et qu’il devait être classé plutôt avec les reptiles marins, son organisation corporelle ayant été assimilée à celle des lézards (sau-riens) (Cuvier, 1808, p. 145-176).La confiance en ses méthodes était telle que Cuvier a fait des démonstrations publiques de leur efficacité, précisant le résultat par avance. Leur confirmation lui valut une reconnaissance supplémentaire de la communauté scien-tifique. Un de ses plus célèbres résultats est la correc-tion de la détermination taxonomique de l’Homo diluvii testis, célèbre fossile identifié par Johan J. Scheuchzer (1672-1733) comme étant un homme témoin du déluge biblique. A l’aide d’un simple dessin, Cuvier démontre que le fossile était le squelette d’une salamandre, avant même qu’il fasse « creuser dans la pierre ». « À mesure que le ciseau enlevait un éclat de pierre », les caractères permettant une correcte détermination ont été révélés, confirmant ainsi la prédiction de Cuvier (Cuvier, 1836, p. 371-372).L’identification taxonomique de la sarigue (opossum) de Montmartre reste sûrement le plus connu de ses exploits paléontologiques. Ce fossile, à première vue, ne possé-dait pas les principaux caractères taxonomiques permet-tant son identification. Cuvier applique néanmoins ses méthodes et ses principes dans l’analyse des dents fos-siles et prédit que ce spécimen est un marsupial (groupe pourtant actuellement restreint au Nouveau Monde et à l’Océanie). Lorsque la gangue qui recouvrait ce fossile a été retirée, les caractères morphologiques d’identifica-tion ont été révélés, confirmant ainsi sa prédiction.Ces épisodes, ainsi que les travaux de reconstitution paléontologique, ont rendu possible l’identification taxo-nomique des êtres fossiles et ont valu à sa méthode un excellent accueil par la communauté scientifique, qui à son tour l’a utilisée pour produire de nouvelles données. De façon circulaire, ces nouveaux résultats renforçaient plus encore l’efficacité des méthodes de Cuvier.En 1800, il lance un appel à la collaboration scientifique internationale pour enrichir cette étude. Cuvier propose aux naturalistes du monde entier de lui envoyer du maté-riel d’étude. Il s’engage à payer les frais d’envoi, à four-nir les résultats des études et à assurer la reconnaissance de la découverte. Dans ses propres mots, contenus dans son travail, Extrait d’ouvrage sur les espèces de qua-drupèdes, 1801, cet échange réciproque de données « est peut-être le commerce le plus noble et le plus intéressant que puissent faire les hommes » (Cuvier, 1801a, p. 266 ; 1801b, p. 80-81).Participer au programme de recherches de Cuvier et s’en-gager dans son grand projet de développer une science de la compréhension des formes possibles de l’organisation corporelle était tellement motivant que les naturalistes ont commencé rapidement à lui envoyer leurs contribu-tions. Des descriptions détaillées et des dessins étaient la principale source d’échange. Présentes durant la majeure
300 F. FaRia
partie de la carrière de Cuvier, les guerres entre la France et plusieurs pays européens ont peu altéré les échanges de données entre les participants à ce réseau européen de coopération. L’état de guerre a certes empêché le dépla-cement physique des personnes, mais les systèmes de communication ayant peu souffert de cet état, les natura-listes étrangers pouvaient correspondre, permettant ainsi un rythme de travail scientifique presque normal.Comme il était impossible aux naturalistes de tous pays de se retrouver autour des fossiles découverts, souvent uniques, il était nécessaire d’envoyer des descriptions et des dessins les plus précis possible. Grâce à ces envois de documents, Cuvier mit en place une sorte de « musée vir-tuel » de fossiles, avec lequel il pouvait avoir des pièces de comparaison pour continuer à élargir sa connaissance de l’organisation des corps vivants.La forme et la fréquence avec lesquelles les membres de la communauté scientifique citent la méthode et les tra-vaux de Cuvier indiquent le succès de son programme de recherches. Les naturalistes européens le citent partout comme référence (Faria, 2012, p. 104-109).Se forme ainsi une communauté de savants spécialistes des fossiles qui partagent leurs réflexions et produisent leurs recherches dans un cadre méthodologique cuvierien. Ces recherches produisent des résultats qui engendrent encore plus d’adhésions de la part d’autres scientifiques, confirmant ainsi le principe même du paradigme. Plus il y a de fossiles déterminés taxonomiquement, plus le sys-tème de classification taxonomique proposé par Cuvier se vérifie.
Iv. LA crIse et LA trAnsItIon
En étudiant les fossiles de Montmartre dans le Bassin parisien, Cuvier constate, grâce à l’observation des strates géologiques de différentes lithologies, que dans le passé cet endroit avait été soumis à diverses « révolutions » ou catastrophes. Il observe au sein de ces couches plu-sieurs espèces fossiles considérées comme « disparues » et éteintes. Pour Cuvier, toute la région de Montmartre, dans le passé, avait été soumise à différentes « révolu-tions », qui ont eu pour résultat les différentes composi-tions lithologiques et biologiques des strates géologiques qu’il étudiait. Ces « révolutions » auraient été des inonda-tions, submergeant la faune locale et apportant les sédi-ments qui formeront les strates (Cuvier & Brongniart, 1808, p. 179).Grâce à cette étude, Cuvier arrive bientôt à la conclusion que certains groupes fossiles n’apparaissent que dans certaines strates. Autour de 1803, Cuvier commence une étude stratigra-phique, en collaboration avec le minéralogiste Alexandre Brongniart (1770-1847), en utilisant le principe de la « corrélation par les fossiles », qui stipule que certaines strates géologiques peuvent être reconnues par leur contenu fossile (Cuvier & Brongniart, 1808, p. 170).
L’application de ce principe a permis de mettre en évi-dence la correspondance entre des couches lointaines et non continues, ayant des lithologies différentes, mais qui contiennent les mêmes fossiles. Avec cette correspon-dance, il était dorénavant possible d’élaborer des cartes stratigraphiques, même pour des régions où les couches ne sont pas continues.Ce travail, en collaboration avec Brongniart, a révélé que certains groupes de fossiles apparaissent dans une couche, persistent pendant une période de temps (repré-sentée par l’épaisseur de la strate), puis sont remplacés par d’autres groupes. Cette perception a conduit à la découverte du phénomène de la « succession biotique » ou « biostratigraphique », qui établit un ordre chronolo-gique des groupes fossiles et une meilleure compréhen-sion de leur histoire.Cuvier explique le processus qui conduit à cette suc-cession des faunes par sa théorie des révolutions, ou « Catastrophisme » comme on l’appellera plus tard. Selon cette théorie, certains endroits auraient été soumis à plusieurs phénomènes géologiques catastrophiques, principalement des inondations, qui auraient détruit des faunes entières. Ces événements alternaient avec des périodes de temps de relatif calme géologique. Ensuite, les espèces des localités non atteintes par les « révolu-tions » migraient vers les lieux atteints, en formant ainsi la nouvelle faune de ces régions (Cuvier, 1812, p. 81).La théorie des révolutions fournit une bonne base théo-rique pour les travaux des paléontologues de son temps. Cependant, au fil des ans, une difficulté apparaît. Un nombre croissant de faunes disparues étant identifiées, il devenait nécessaire de définir un nombre de plus en plus important de « révolutions ». En outre, il devenait difficile de défendre l’idée d’un stock biologique originel, aussi vaste et diversifié soit-il, qui aurait subi de nombreux événements destructeurs, tout en présentant la multitude d’espèces que nous observons encore aujourd’hui.D’autres difficultés apparurent lorsque certains éléments de faunes fossiles supposées disparues lors de différentes révolutions ont commencé à être trouvés dans les mêmes strates géologiques. Selon la théorie des révolutions, il devait toujours y avoir une séparation stratigraphique entre les faunes victimes des différentes révolutions et les nouvelles faunes résultant du phénomène de migra-tion initié seulement après que les conditions environ-nementales soient redevenues appropriées. Jusqu’à ce moment, la couche géologique qui se forme n’est pas censée contenir de fossiles. Avec l’occupation du site par la faune migrante, une nouvelle couche commence à se former avec la présence des fossiles de cette faune. D’après cette interprétation, les faunes ayant occupé à différents moments les lieux touchés par les révolutions doivent être séparées stratigraphiquement.Certains naturalistes ont commencé à trouver sur le ter-rain des contradictions à ce principe, principalement sur des fossiles provenant de cavernes. Plusieurs fois, des fossiles de faunes détruites par différentes révolutions ont
Georges Cuvier et le premier paradigme de la paléontologie 301
été découverts dans une même strate géologique. Comme la théorie des révolutions ne pouvait pas expliquer cela, les travaux de Cuvier commencèrent à subir des critiques de la part de la communauté scientifique, notamment sur l’application de la méthode (Cuvier, 1812, p. 83-84 ; 1830, p. 138-140). Par la suite, ces difficultés ont conduit à des critiques du pouvoir heuristique de la théorie des révolutions. Thomas Kuhn a décrit une telle situation comme « crise du paradigme » à partir du moment où il y a incapacité à expliquer un phénomène ou une découverte. Face à cette situation, commencent à émerger d’autres candidats au rôle de paradigme, avec de nouvelles théories, méthodes, etc., qui prétendent expliquer le phénomène. Commence alors une controverse qui ne s’arrête que lorsque l’un des candidats reçoit l’acceptation de la communauté scienti-fique, qui élabore dès lors ses travaux à partir de ce nou-veau paradigme (Kuhn, 2003, p. 22-25).Mais, dans le cadre de la paléontologie, ce processus a ses propres particularités. Même après l’abandon de la théorie des révolutions par la communauté scientifique, cette dernière a continué à utiliser les méthodes de l’ana-tomie comparée de Cuvier. Ces méthodes ont, en effet, continué à produire des résultats qui étaient utilisés par le système de classification basé sur les formes d’orga-nisation corporelle, mais pouvaient également être utili-sés pour la construction des généalogies évolutives, qui étaient le reflet du nouveau paradigme en paléontologie, après l’acceptation des travaux de Charles Darwin (1809-1882).Alors que ce nouveau paradigme – l’évolution – est déjà installé, les déterminations taxonomiques ont continué à être effectuées sous la direction des méthodes de Cuvier, l’anatomie et la physiologie des organismes faisant par-tie des principaux critères utilisés par la taxonomie. De même, pour la constatation d’une unité de type entre les taxons, les caractéristiques anatomiques et physio-logiques étaient parmi les plus importantes. Ainsi, les travaux utilisant la méthode comparative de Cuvier pro-duisirent des données qui pouvaient être utilisées indif-féremment par les partisans de l’ancien et du nouveau paradigme. Avec cette forme d’utilisation, l’occurrence d’une crise, comme celle prévue par Kuhn, a été rendue presque imperceptible dans le cas de la paléontologie. Le paradigme évolutionniste a provoqué des change-ments au sein de la paléontologie qui ont eu des consé-quences dans le cadre programmatique, mais non dans la méthodologie. Les méthodes de l’anatomie comparée de Cuvier ont continué à être utilisées pour les reconstitu-tions paléontologiques, si importantes pour l’élaboration des lignées évolutives. Même remplacé, d’une certaine façon le programme de recherches de Cuvier continue d’être indispensable à la compréhension des formes de l’organisation corporelle, permettant ainsi d’atteindre les objectifs cognitifs de plusieurs domaines de l’histoire naturelle, dont la paléontologie.
V. REMERCIEMENTS
L’auteur remercie la Coordination d’Amélioration des Cadres Supérieurs - Brésil (CAPES) pour l’aide finan-cière qui a rendu possible la communication de cet article pendant le Quatrième Symposium Georges Cuvier à Montbéliard (France, 8-12 octobre 2012).L’auteur remercie de même le Conseil national du déve-loppement scientifique et technologique - Brésil (CNPq), pour l’aide financière dans le cadre de la publication du livre « Georges Cuvier : de l’étude des fossiles à la paléontologie » (Fig. 1) qui a servi de base à cet article. L’Association Paléontologique Française a en outre contribué financièrement à la participation de l’auteur au Symposium Cuvier.
Fig. 1 : Couverture de l’ouvrage écrit en 2012 par Felipe Faria : « Georges Cuvier : do estudo dos fósseis à paleontologia » editora & 34, São Paulo, 269 p.
302 F. FaRia
VI. REFERENCES BIBLIoGRAPHIqUES
Buffetaut, E. (2001) - Cuvier : le découvreur de mondes dispa-rus. Collection « Les Génies de la Science ». Pour la Science, Paris.
Caponi, G. (2004) - Georges Cuvier : un nombre olvidado en la história da la fisiologia. Asclepio Revista de historia de la medicina y de la ciencia 54 (1) : 169-207.
Caponi, G. (2008) - Georges Cuvier : um fisiólogo de museo. Un. Nacional Autônoma de México (LIMUSA), México, DF.
Cuvier, G. (1796) - Mémoire sur les espèces d’Eléphans tant vivantes que fossiles, lu à la séance publique de l’Institut national le 15 germinal, an IV, par G. Cuvier. Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des lettres et des arts, 3 : 440-445.
Cuvier, G. (1801a) - Extrait d’un ouvrage sur les espèces de quadrupèdes dont on a trouvé les ossemens dans l’intérieur de la terre, adressé aux savans et aux amateurs des sciences, par G. Cuvier, membre de l’Institut, professeur au Collège de France et à l’Ecole Centrale du Panthéon, etc. Journal de physique, de chimie, d’histoire naturelle et des arts, 52 : 253-267.
Cuvier, G. (1801b) - Extrait d’un ouvrage sur les espèces de quadrupèdes dont on a trouvé les ossemens dans l’intérieur de la terre, adressé aux savans et aux amateurs des sciences, par G. Cuvier, membre de l’Institut, professeur au Collège de France et à l’Ecole Centrale du Panthéon, etc., imprimé par ordre de la classe des sciences mathématiques et phy-siques de l’Institut national, du 26 brumaire an 9. Magasin encyclopédique ou Journal des sciences des lettres et des arts, 1 : 60-82.
Cuvier, G. (1805) - Leçons d’anatomie comparée. Baudouin, Paris.
Cuvier, G. (1808) - Sur le grand animal fossile des carrières de Maestricht. Annales du Muséum d’Histoire Naturelle, 12 : 145-176.
Cuvier, G. (1809) - Sur quelques quadrupèdes ovipares fossiles conservés dans les schistes calcaires. Annales du Muséum d’Histoire Naturelle, 13 : 401-437.
Cuvier, G. (1812) - Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes où l’on rétablit les caractères de plusieurs espèces d’animaux que les révolutions du Globe paroissent avoir détruite. Tome I, Deterville, Paris.
Cuvier, G. (1817) - Le règne animal distribué d’après son orga-nisation, pour servir de base à l’histoire naturelle des ani-maux et d’introduction à l’anatomie comparée. Tome I, Deterville, Paris.
Cuvier, G. (1830) - Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changements qu’elles ont produits dans le règne animal. Edmond D’Ocagne, Paris.
Cuvier, G. (1835) - Leçons d’anatomie comparée, de Georges Cuvier, recueillies et publiées par M. Duméril. Tome I, Paris, Crochard.
Cuvier, G. (1836) - Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes où l’on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du Globe ont détruit les espèces. Tome X, quatrième édition, Deterville, Paris.
Cuvier, G. & A. Brongniart (1808) - Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris. Annales du Muséum d’Histoire Naturelle, 11 : 170-188.
Edwards, W. (1967) - The early history of palaeontology. Bri-tish Museum (Natural History), Londres.
Faria, F. (2012) - Georges Cuvier : do estudo dos fósseis à paleontologia. Scientiae Studia & 34, São Paulo.
Guillo, D. (2003) - Les figures de l’organisation. Presses Uni-versitaires de France, Paris.
Kuhn, T. S. (2003) - A estrutura das revoluções científicas. Pers-pectiva, São Paulo.
Kuhn, T. S. (2006) - O caminho desde A estrutura. Trad. César Mortari. 1ed. Unesp, São Paulo.
Oakley, K. (1965) - Folklore of Fossils. Antiquity (39) : 9-16, 117-125.
Mayor, A. (2000) - The first fossil hunters. Princeton University Press, Princeton.
Pline l’Ancien (1857) - The Natural History of Pliny (translated with copious notes and illustrations by the late John Bos-tock M. D., F. R. S. and H. T. Riley, Esq., B. A., late scholar of Clare Hall, Cambridge), vol. 6. Henry G. Bohn, Londres.
Rudwick, M. (1976) - The meaning of fossils : episodes in the history of palaeontology. Chicago University Press, Chicago.
Rudwick, M. (2005) - Bursting the limits of time : the recons-truction of geohistory in the age of revolution. Chicago University Press, Chicago.
Saint-Fond, F. B. (1799) - Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de Maestricht. J. Jansen, Paris.
Steno, N. (1939) - of solids naturally contained within solids » (From The Prodromus of Nicolaus Steno’s dissertation concerning a solid body enclosed by process of nature wit-hin a solid [1671]). In : Mather, K. F. & S. Mason (eds.), Source book in geology, Nova York, 33-44.
Woodward, J. (1723) - A essay towards a natural history of the earth, and terrestrial bodies, especially minerals : as also of the sea, rivers and springs. With an account of the uni-versal Deluge : and of the effects that it had upon the earth. Bettesworth & Taylor, Londres.
Zittel, K. A. R. (1901) - History of Geology and Palaeontology : to the end of the 19th century. Walter Scott, Londres.
Accepté mars 2013