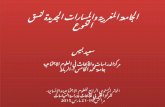La dialogicité de la culture : élargissement du paradigme interculturel et transposition...
Transcript of La dialogicité de la culture : élargissement du paradigme interculturel et transposition...
PHILIPPE BLANCHET ET DANIEL COSTE (DIR.)
Phi
lippe
Bla
nche
tet
Dan
ielC
oste
(Dir
.)R
EG
AR
DS
CR
ITIQ
UE
SSU
RL
AN
OT
ION
D’«
INT
ER
CU
LTU
RA
LIT
É»
REGARDS CRITIQUESSUR LA NOTION
D’« INTERCULTURALITÉ »
Pour une didactique de la pluralitélinguistique et culturelle
REGARDS CRITIQUES SUR LA NOTIOND’« INTERCULTURALITÉ »
Pour une didactique de la pluralité linguistique et culturelle
La notion d’interculturalité a connu depuis les années 1980 un suc-cès remarquable, au point d’être devenue incontournable en didactiquedes langues et dans de nombreuses autres disciplines qui se préoccu-pent de relations dites « interculturelles », notamment d’éducation etd’insertion sociale. Elle s’est diffusée largement chez les praticiens etdivers acteurs sociaux. Cette expansion du terme dans divers champsa provoqué des réductions de ses significations et de ses usages,notamment un repli vers une enseignement culturel centré sur des sté-réotypes nationaux ou encore vers une acception « angélique » qui enlimite la portée à des « relations humaines harmonieuses malgré lesdifférences culturelles et linguistiques ». Il fait, dès lors, l’objet d’uncertain nombre de critiques justifiées. L’objectif de ce volume est dereplacer le concept au centre de la compréhension des dynamiques etdes tensions sociales, parce que les altérités en sont constitutives. Ils’agit, dès lors, de lui restituer une portée fondamentale et des fonc-tions transversales d’intervention de terrain, notamment en sociolin-guistique et pour une didactique des compétences plurilingues et inter-culturelles
ISBN : 978-2-296-12600-818,50 !9 782296 126008
LA DIALOGICITE DE LA CULTURE ELARGISSEMENT DU PARADIGME
INTERCULTUREL ET TRANSPOSITION PEDAGOGIQUES
Damien Le Gal, EA 3207 PREFics, Université Européenne de Bretagne – Rennes 2
Cet article présentera une réflexion sur la dialogicité du concept de culture prise comme base d'un paradigme interculturel. Ce cadre théorique soutiendra une réflexion sur l’interculturalité et les modalités de développement des compétences interculturelles.
La dialogicité de la culture
Comme le souligne Martine Abdallah-Pretceille, « si aucune description, même la plus affinée possible, ne saurait rendre compte de la complexité et de la pluralité du concept de « culture », c'est que « sa réalité » est plus subjective qu'objective, donc variable et instable. » (1986 : 34).
Définition de culture Différentes définitions (Ladmiral & Lipiansky, 1989 : 8,
Bakic-Miric, 2008, Camilleri1) abordent la culture dans la seule perspective d’un produit collectif, « ensemble de systèmes de
1 Camilleri Carmel, Cohen-Emerique Margalit, Abdallah-Pretceille
Martine, 1989, Chocs de cultures: concepts et enjeux pratiques de l'interculturel, L'Harmattan, Paris.
60significations propres à un groupe » (Clanet, 1993 : 15), « programmation mentale collective propre à un groupe d'individus […]. Dans ce sens la culture est un système de valeurs collectivement partagées »1, « a deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an organization » (un niveau plus profond de conceptions fondamentales et de croyances partagées par les membres d’une organisation, Edgar Schein). Ces approches et nombre d'autres occultent le versant individuel du concept qui doit être souligné. Cet article se distinguera ainsi d'Aline Gohard-Radenkovic qui affirme que toute culture est partagée (1999 : 122).
Les définitions opératoires pour le paradigme dialogique dans lequel s'inscriront ces propos sont la définition essentialiste, ontologique de Pierre Bourdieu de la culture comme « capacité à faire des différences », de « système global d'interprétation du monde et de structuration des comportements » de Denys Cuche (2001 : 97) et celle anthropologique d'Edward Thomas Hall et de Mildred Reed Hall : « système développé par l'être humain pour créer, émettre, conserver et traiter l'information, système qui le différencie des autres êtres vivants » (dans Collès 2007). En effet ces définitions embrassent autant l'aspect collectif qu'individuel de la culture.
Visant à la construction de compétences interculturelles, notre perspective adopte également une approche interactionniste de la culture telle qu'on la trouve chez Edward Sapir qui fut un des premiers à avoir considéré la culture comme un système de communication interindividuelle (Cuche,
1 Geert Hofstede, 1991, Cultures and Organizations: Software of the
Mind, McGraw-Hill, New York.
61 2001 : 49) quand il précisait : « le véritable lieu de la culture, ce sont les interactions individuelles »1 .
Une conception dialogique de la culture
La culture étant l'ensemble des construits symboliques et discursifs d'un groupe, national ou régional, social, elle est « culture collective » (Gohard-Radenkovic, 1999 : 186-187), « culture partagée »2. Pour Geert Hofstede, « Culture is always a collective phenomenon, because it is at least partly shared with people who live or lived within the same social environment »3 (« la culture est toujours un phénomène collectif parce qu'elle est au moins en partie partagée par des gens qui vivent ou ont vécu dans le même environnement social »).
Dialogiquement, une autre part de la culture est propre à chaque individu, personnelle, et n'est pas partagée. Il me semble fondamental pour l'approche interculturelle de distinguer avec Aline Gohard-Radenkovic culture des individus et culture de l'individu. Tout être humain, de par ses qualités propres, expériences, itinéraires se construit un système de significations qui lui est personnel, apparenté à son identité, sa personnalité, c'est sa « culture individuelle » (Gohard-Radenkovic 1999 : 187). Les propos d'Edward Sapir qui critique vivement des
1 Sapir Edward, 1993, The Psychology of Culture: A Course of
Lectures, reconstruit et édité par J. T. Irvine. Mouton de Gruyter, Berlin.
2 Galisson Robert, 1989, « La culture partagée : une monnaie d'échange interculturelle », Recherches et Applications, août-septembre, pages 113-117.
3 Idem note page précédente.
62approches ne distinguant pas un niveau collectif et individuel d'analyse1 pourraient être repris ici.
Si l'on considère une culture nationale, à y regarder de près on y distinguera des sous-entités culturelles propres aux différents groupes régionaux qui la composent. De même, l'observation attentive montre qu'au delà d'un tronc commun toute culture se subdivise jusqu'à atteindre un seuil dans les particularismes individuels. L'hétérogénéité culturelle est présente dans les groupes nationaux comme dans tout groupe ; les cultures individuelles sont elles aussi composées de subcultures variées (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996 : 14).
Un paradigme interculturel plus complexe
Par l'emphase portée sur cette dialogicité de la culture, un certain paradigme interculturel est en construction.
Claude Clanet définit « « l'interculturel » comme un mode particulier d'interactions et d'interrelations qui se produisent lorsque des cultures différentes entrent en contact » (Clanet, 1993 : 22). Cette approche -comme un certain nombre d'approches interculturelles- peut dériver vers un certain réductionnisme si elle considère, à l'instar d'une certaine linguistique abordant la rencontre entre deux locuteurs de langues-cultures différentes comme une interaction entre deux systèmes linguistiques, l'échange entre deux individus comme la rencontre de deux systèmes culturels, nationaux le plus souvent. Ces approches occultent l'élément individu, personne, sujet qui y tient pourtant une place fondamentale. En effet si les cultures se rencontrent c'est au travers de leurs représentants ; or
1 Irvine T. Judith, 1993, « Editor's Introduction » dans The
Psychology of Culture : A Course of Lectures, reconstruit et édité par J. T. Irvine, Mouton de Gruyter, Berlin.
63 ceux-ci transcendent les différentes cultures auxquelles ils appartiennent dans une « constellation » identitaire propre à chaque être humain. Transférées sur le plan pédagogique, ces approches de l'interaction interculturelle doivent amener l'apprenant à envisager la rencontre interculturelle sur le seul plan culturel, délaissant l'individu et ses caractéristiques personnelles, considérant celui-ci seulement comme un représentant de son groupe. Au contraire, le paradigme interculturel proposé ici intègre pleinement le sujet, la personne et la dimension individuelle dans l'approche des interactions.
Considérer la personne Il est très important, à considérer une rencontre
interculturelle, d'intégrer cette dimension individuelle. Une dérive réductionniste serait de considérer la rencontre entre Jean et Mohammed seulement comme la rencontre d'un Français et d'un Marocain. La mise en œuvre de la compétence interculturelle dans l’interaction implique pour le locuteur de prendre en compte toute la spécificité, l’unicité de son interlocuteur. Celui-ci, si il possède des traits issus de sa culture nationale ou régionale, les fusionne dans une association qui lui est propre. Aussi le locuteur ayant développé ses compétences plurilingues et pluriculturelles ne doit pas s’arrêter à une perception « de surface » mais demeurer en questionnement, ouvert à la singularité qu’il rencontre.
D’autre part l'approche, l'entrée culturelle, si elle est pertinente car les facteurs d'ordre culturels sont extrêmement prégnants sur la situation, ne doit pas être la seule « entrée » dans l'approche des phénomènes, à l'instar d'un enfermement disciplinaire. Cette interaction franco-marocaine par exemple, implique, plus que le croisement de deux ensembles de schèmes symboliques, au-delà de la rencontre de deux représentants des groupes nationaux français et marocain, deux êtres humains,
64acteurs sociaux dans toute leur complexité. Cette complexité doit engager, en complément de l'approche interculturelle sur ces phénomènes, un syncrétisme d'approches, ou plutôt une approche qui joint les différents regards des Sciences Humaines et Sociales (S.H.S.), inspirée de la transdisciplinarité morinienne (Morin, 1986, 1991, 1997). L'observateur s'attache alors à aborder les phénomènes en-dehors d'un ancrage disciplinaire mais dans une ouverture scientifique où les outils théoriques pertinents des S.H.S. sont mis à profit.
Considérer que la rencontre interculturelle implique des personnes requiert un regard sur ces protagonistes en tant qu'acteurs sociaux, « homo oeconomicus, politicus, historicus » (Morin, 1986, 1991), un questionnement sur la psychologie, la personnalité, les passions... de la personne rencontrée, tout ce qui la construit en tant qu'individu, irréductiblement différent. L’approche interculturelle doit faire adopter aux apprenants une attitude d'ouverture à l'autre, à la personne rencontrée :
« On ne peut donc connaître autrui sans communiquer avec lui, sans échanger, sans lui permettre de se dire, de s'exprimer en tant que sujet. L'objectif est donc d'apprendre la rencontre et non pas d'apprendre la culture de l'Autre ; apprendre à reconnaître en autrui, un sujet singulier et un sujet universel. » (Abdallah-Pretceille, 1999 : 59).
Une certaine éducation interculturelle
Le cadre paradigmatique ébauché, considérant l’irréductible particularité de chaque individu, sert les objectifs d’une éducation interculturelle et se présente comme plus opératoire dans la perspective de développement de compétences plurilingues et pluriculturelles. Cette compétence est définie (je préférerais l’envisager au pluriel, dans sa multiplicité) comme la :
65 « compétence à communiquer langagièrement et à interagir
culturellement possédée par un acteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et a, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d’une compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l’acteur social concerné » (Coste, Moore et Zarate, 1997).
En effet l'éducation interculturelle s'inscrivant dans le paradigme interculturel développé oriente le locuteur loin des représentations et des comportements schématiques et englobants tels que la réduction de la culture d’autrui à une culture nationale. L’approche interculturelle dialogique construit mieux une ouverture à la différence, à l'inconnu, une attitude de découverte, de curiosité à l'égard de l'Autre.
Dans notre cadre théorique, la personne, le sujet est intégré à l'équation interculturelle comme une composante tout aussi importante que l'identité nationale, régionale, sociale. L’idiosyncrasie, les différences, l'altérité particulière de l'interlocuteur sont ici mises en avant. Considérer le spécifique avant l'identique, l’ipse avant l’idem1 c'est faire un pas vers l'inconnu, la découverte et s'engager dans une attitude d'ouverture et d'écoute qui permet de prendre en compte les différences pour mieux communiquer.
On trouve cette prise en compte de l'individualité chez Martine Abdallah-Pretceille :
« La place accordée par l'interculturel au sujet, singulier et acteur, dans ses interprétations, ses perceptions redonne à la subjectivité (et non au subjectivisme) une place de choix. […]
1 Ricœur Paul, 1990, Soi-même comme un autre, Editions du Seuil, Paris.
66L'interculturel est fondé sur une philosophie du sujet, […] L'approche interculturelle s'intéresse à la production de la culture par le sujet lui-même » (1999 : 54).
La représentation de la culture On sait que les représentations jouent un rôle fondamental
dans l'approche de l'étranger (Véronique, 2001 : 34, 35, Zarate, 1995 : 30). Le travail de réflexion mené sur la dialogicité de la culture et le paradigme construit engagent certaines orientations sur le plan représentationnel.
Il est ici proposé de développer chez les apprenants une représentation dialogique de la culture et corrélativement de l'autre, de l'étranger. L’éducation interculturelle doit transmettre une représentation de la culture comme une entité dialogique, construite d'une part par l'individu, de l'autre par ses groupes d'appartenance. Cette représentation considère non seulement la nationalité mais prend également en compte la personne ; l'apprenant considère autant les communautés d’appartenance de son interlocuteur que son individualité.
Gestion des représentations D'autre part le développement des compétences
interculturelles implique la mise à distance des représentations circulantes (non scientifiques) sur les groupes nationaux. L’éducation interculturelle doit travailler sur les représentations, les préjugés et non contre ceux-ci car ils sont inévitables, l’humain se construit toujours une « représentation mentale » de tout ce qu’il rencontre (Blanchet, 2007 : 44).
L'apprenant doit, dans la rencontre interculturelle, mettre entre parenthèses le construit discursif qu'il a pu se constituer,
67 souvent de l’ordre du stéréotype ou du réductionnisme, représentations circulantes véhiculées par les médias et l’environnement social ; sur les Allemands en tant que personnes rigoureuses et disciplinées par exemple. Le locuteur, pour demeurer ouvert à cet Allemand qu'il va rencontrer, possiblement laxiste et désordonné, doit adopter une distanciation critique sur ces représentations et apprendre à les relativiser, à les « gérer », mesurant dans quelle mesure elles sont fondées, utiles, évaluant leur fond de vérité ou d’inexactitude, la part de mythe...
Transpositions pédagogiques Sur le plan pédagogique, il semble pertinent de faire
appréhender aux apprenants les nombreuses sous-cultures de leurs propres cultures d'appartenance. Cela pourrait être réalisé par un travail d'auto-observation qui mettrait en évidence les multiples variétés présentes au sein de leurs cultures nationales et régionales mais également l'hétérogénéité individuelle qui constitue tout humain en tant qu’être unique. Les apprenants pourraient observer par exemple les différentes manières de nommer un même objet selon les régions, de se saluer, différentes techniques, procédés relatifs à la réalisation d'un objet, d'un rite (exemple : ce que l'on mange à Noël). Les apprenants analyseraient des documents qui leur permettraient de constater les différences régionales, locales, sociales (entre différents quartiers) de pratiques et en discuteraient ensemble. Ces activités visent à permettre aux apprenants de voir combien ce qui est assemblé sous une même étiquette occulte bien souvent de grandes différences et qu'il convient de garder à l’esprit que tout groupe est un ensemble d'individualités fort différentes.
À charge ensuite au formateur de transférer ce constat de l'hétérogénéité « chez nous » puis « chez soi » dans l'approche
68de l'étranger, montrant comment les cultures étrangères elles aussi sont composites, tout comme la culture de leurs membres.
La dialogicité de la culture sera mieux encore approchée de manière pratique, pragmatique car l'expérimentation est la clé de voûte de la dynamique de la compétence interculturelle et l'expérience la meilleure manière d'apprendre comme l’a montré Célestin Freinet (1994).
Par le biais d'Internet, il est possible de mettre en place un échange avec une classe d'un autre pays. Les apprenants s'exerceraient à échanger en face à face virtuel avec leurs « correspondants », accompagnés par l'enseignant qui donne des conseils sur la manière de mener ces interactions interculturelles. A posteriori, les apprenants échangent sur leurs impressions, leurs difficultés de communication, éclairés par l'enseignant.
Un classique échange linguistique en présentiel est également une excellente occasion d’identifier et de développer les savoir-faire communicationnels.
Compétence de communication La dialogicité de la culture amène certaines répercussions
sur la compétence de communication, sur le plan de la compréhension particulièrement.
On peut en effet découper l'ensemble des compétences de communication (que l’on pourrait également nommer plurilingues, pluriculturelles...) en deux ensembles : celles qui concernent la compréhension, comme une phase préalable à l’interaction, et celles qui régissent la production, celle-ci étant la conséquence de la première, qui rétroactivement va générer du matériau à comprendre dans une interrelation en spirale.
69 L'approche dialogique ici développée soutient le
développement d'une compétence de compréhension qui amène l'apprenant à adopter une attitude de questionnement sur son interlocuteur, (Qui est-il ? Quelle est son histoire ? Ses modes de communication ?), favorisant ainsi le travail d'empathie.
Conclusion
Amenée de manière progressive chez l’apprenant par la découverte de l’hétérogénéité culturelle de son groupe d’appartenance puis de lui-même, il devient ensuite aisé de transposer la dialogicité chez autrui. Ce travail s’intègre à une éducation interculturelle et gagne à être accompagné d’une réflexion sur les représentations.
Parce que la conception dialogique de la culture influe sur la manière dont l’altérité sera appréhendée et vécue dans l'interaction, ce cadre entraîne diverses conséquences sur le développement des compétences plurilingues et pluriculturelles. Mieux qu’une approche où la culture d’autrui risque d’être réduite à sa culture nationale, l’éducation interculturelle prépare -par la mise en avant de la dialogicité de la culture- une rencontre avec autrui dans toute sa multiplicité et sa complexité et engage l’apprenant sur la voie d’un échange réussi.
70
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ABDALLAH-PRETCEILLE M., 1996, Vers une pédagogie interculturelle, 3ème édition, Anthropos, Paris (Exploration interculturelle et sciences sociales).
ABDALLAH-PRETCEILLE M., PORCHER L., 1996, Éducation et communication interculturelle, PUF, Paris.
ABDALLAH-PRETCEILLE M., 1999, L’éducation interculturelle, PUF, Paris.
BAKIC-MIRIC Natasa, 2008, « Re-imaging Understanding of Intercultural Communication », dans Journal of Intercultural Communication Issue 17, June 2008.
BEACCO J.-C., 2000, Les dimensions culturelles des enseignements de langue : des mots aux discours, Hachette Français Langue Étrangère, Paris.
BEACCO J.-C., 2007, L’approche par compétences dans l’enseignement des langues, Didier, Paris.
BLANCHET Philippe, 2007, « Quels « linguistes » parlent de quoi à qui, quand, comment et pourquoi ? Pour un débat épistémologique sur l’étude des phénomènes linguistiques », dans Carnets de l’Atelier de Sociolinguistique. Un siècle après le Cours de Saussure, la Linguistique en question, BLANCHET Philippe, CALVET Louis-Jean, ROBILLARD Didier de, 2007, L’Harmattan, Paris.
BYRAM M., FLEMING M. (Eds), 1998, Language Learning in Intercultural Perspective : Approaches through drama and ethnography, Cambridge University Press, Cambridge.