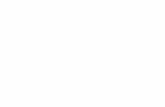Ulff Chapitre 1
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ulff Chapitre 1
CHAPITRE I
Le développement de monopoleset les pratiques commerciales monopolistiques
La position hégémonique de l’industrie cinématographiqueaméricaine a été déterminée de manière significative par lesdifférences structurelles entre les marchés français etaméricain, qui firent très tôt leur apparition dans ledéveloppement de l’industrie cinématographique. Alors quel’histoire du cinéma traite d’art, l’histoire de l’industriecinématographique est celle de monopoles. L’intégration et lemonopole font indissociablement partie de l’histoire del’industrie cinématographique. Georges Sadoul, l’historien ducinéma français, explique l’hégémonie américaine comme lerésultat d’une diffusion des films beaucoup plus développée auxÉtats-Unis, qui possédaient de puissantes associations deproducteurs, de distributeurs et de diffuseurs. L’échec destentatives européennes de monopole fut le résultat de différencesstructurelles essentielles entre les marchés européen etaméricain1. Cette section cherche à examiner comment cesdifférences structurelles sont apparues.
Comme la plupart des autres secteurs commerciaux,l’industrie cinématographique comporte une structure tripartite,qui se subdivise en production, distribution et diffusion. Lesproducteurs sont fortement incités à créer une intégrationverticale des trois aspects en absorbant les entreprises dedistribution et en établissant des chaînes de cinémas afind’éliminer la concurrence. La production cinématographiqueaméricaine doit être envisagée comme une production industrielledans une société capitaliste moderne hautement développée, danslaquelle des compagnies monopolistiques verticalement intégréescontrôlent la production. À l’opposé, la production européenneest le fait d’une petite industrie dotée d’une faible intégrationverticale.
La législation a souvent interdit les monopoles provenant del’intégration verticale et horizontale par des lois antitrust,telles que la loi Sherman contre les monopoles, mais ces lois ont1 Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma, II : Les Pionniers du cinéma, Paris, 1947, p. 512.
11
rarement été appliquées à l’encontre de l’industriecinématographique américaine.
Le cinéma comme commerce : principes et histoire
Les lois commerciales qui s’appliquent au commerce d’unemanière générale s’appliquent aussi à l’industriecinématographique. Les films sont eux-mêmes des exemples typiquesde biens produits en série, qui s’accommodent très bien desprincipes propres au commerce moderne. La distribution des films– depuis le producteur jusqu’au consommateur – ne diffère pas enprincipe de la distribution d’autres produits. La production decaméras, de pellicule vierge et d’autres équipements techniqueséchappe à cette définition de l’industrie cinématographique.
L’intégration verticale de l’industrie cinématographique aété renforcée par les qualités monopolistiques inhérentes auproduit cinématographique. Même si les films sont des produitscommerciaux comme n’importe quel autre, ils se distinguentd’autres genres de produits du fait de leurs qualités artistiqueset monopolistiques intrinsèques. Le produit cinématographique estparticulier du fait que ce qui est vendu est un «produit»artistique et immatériel. Les spectateurs achètent une«expérience», non un produit. Sous cet aspect, le cinéma n’estpas différent des autres domaines artistiques. On paie des droitsd’entrée pour les concerts, pour les pièces de théâtre et lesexpositions, et les livres ont une valeur monétaire autantqu’artistique. Le produit cinématographique se distingue de cesdomaines artistiques par le fait qu’il est un bien produit ensérie qui, par le biais de la projection, peut être indéfinimentreproduit. En conséquence, l’industrie cinématographique se prêtedavantage à l’établissement de cartels et de trusts que d’autresindustries.
Toutefois, l’aspect commercial s’impose beaucoup plus dansl’industrie cinématographique que dans les autres formes d’art,principalement parce que la production cinématographique estextrêmement coûteuse et exige des investisseurs disposés àprendre de grands risques pour produire un film. Un directeur defilm ne peut réaliser son film que s’il peut trouver unproducteur disposé à investir de l’argent dans le projet. Enconséquence, le producteur est en mesure de contrôler ce à quoiressemblera le produit final. Un éditeur ou un directeur de
12
théâtre ne possède pas le même pouvoir sur la production d’unauteur que celui qu’a un producteur sur le produit d’un directeurde film.
Une autre particularité du film est que les coûts initiauxde production sont extrêmement élevés, alors qu’il est très peucoûteux de faire des copies. En conséquence, un producteur quicontrôle un grand marché détient un fort avantage concurrentiel.Parce que les coûts initiaux peuvent être répartis entre un grandnombre de clients, les prix peuvent donc être diminués, étouffantainsi la concurrence. Alors que les producteurs de films peuventproduire un nombre illimité de films, les cinémas ne peuvent enprésenter qu’un très petit nombre. Il en résulte que lesproducteurs de films sont fortement incités à mettre sur pied uneintégration verticale en prenant le contrôle des cinémas et deleur programmation.
Le contrôle de la distribution des films et des cinémasn’est pas la seule façon pour un producteur de contrôler la miseen marché des films de la compagnie. Les compagniescinématographiques américaines ayant plusieurs films en locationpeuvent réduire les risques économiques de la production de filmsen contraignant les diffuseurs indépendants à louer plusieursfilms simultanément par le recours à des contrats de location defilms sous forme de location par blocs (block-booking) et delocation sans projection préalable (blind selling) comme méthoderégulière de distribution. Les films n’étaient pas loués à lapièce, mais par blocs, puisque les contrats portaient sur lesbesoins en films d’un diffuseur pour une période de six mois à unan. La location sans projection préalable (blind selling) signifiaitque le diffuseur était aussi obligé de réserver des films sansles avoir vus, souvent parce qu’ils n’avaient pas encore étéréalisés. Pour honorer la location par blocs, il était nécessairequ’un producteur soit en mesure de faire face à la demande totalede films sur une longue période.
La compagnie américaine Famous Players-Laski (Paramount)systématisa la location par blocs en produisant quelques«superproductions» (blockbusters) – des films attrayants au coût deproduction élevé, les «films A») – , que les diffuseurs nepouvaient louer que simultanément à un grand nombre de filmsmoins attrayants, à faible coût de production, les films B. Lebut des films B était de remplir le temps de projection des
13
cinémas de sorte que les concurrents ne seraient pas en mesure demontrer leurs films. Le Motion Picture Herald expliquait en 1939 que«les grands films étaient utilisés pour les vendre les films B.Sans les films A pour gonfler leurs ventes, il y aurait peu oupas de profit dans les films mis à l’affiche (program pictures)2».
La location par blocs était une pratique commercialemonopolistique qui déformait la concurrence, et elle devintillégale dans les années 1950 avec le verdict concernant laParamount, qui déclarait que la location par blocs était unelimitation du commerce qui contrevenait à la loi Sherman contreles trusts. Avec la croissance des exportations américaines, lalocation par blocs fut transférée en Europe et devint un principelargement utilisé dans la location des films en France. Lerecours à la location par blocs signifiait qu’il devenaitdifficile de projeter les films locaux dans les cinémas quiprojetaient aussi des films américains. À partir des années 1920,la loi anglaise sur les films et les lois danoises sur le cinémadéfendirent aux diffuseurs de signer des contrats de location parblocs. La France n’interdit la location sans projection préalablequ’à partir de 1934.
Plus pertinente est la façon dont les «indépendants»industrialisèrent la production cinématographique à Hollywoodpour riposter au trust cinématographique couronné de succès deThomas Edison, la Motion Pictures Patent Company (MPPC). Pourcombattre le trust, la compagnie indépendante Paramount étenditles pratiques monopolistiques de la location par blocs et de lalocation sans projection préalable. Ces tactiques, en même tempsque les démarches judiciaires, paralysèrent effectivement la MPPCen 1913, et le trust lui-même fut déclaré illégal en 1917.Lorsque la location par blocs fut par la suite utilisée enFrance, elle empêcha l’industrie cinématographique française depouvoir présenter plusieurs de ses films sur le marché local, enparticulier dans les cinémas de province.
Il existe aussi d’autres obstacles à la libre circulationdes films. Des brevets protégeaient l’aspect «équipement»(hardware) des films, puisque les brevets portaient à la fois surles films et l’équipement. Les inventeurs de la technique du filmen France comme aux États-Unis avaient un avantage. Par exemple,2 Motion Picture Herald, 18 novembre 1939; cité par Peter Bächlin, Der Film als Ware, Bâle, 1978, p. 108.
14
le trust cinématographique d’Edison, la MPPC, avait été établipour exploiter au mieux les brevets en contrôlant la projectionde 1908 à 1914. Avec l’entrée en scène du film sonore, lesindustries allemande et américaine recoururent aussi aux ententesprévues par les brevets en 1929-1930. Toutefois, même lesdisputes sur les brevets n’eurent aucun effet direct sur lacapacité des compagnies cinématographiques d’Hollywood de dominerle marché français du cinéma.
Il existe aussi des restrictions à l’utilisation des filmsliées à l’aspect conceptuel (software) des films, qui fait l’objetde droits d’auteur. Le producteur, le directeur, les acteurs etle scénariste détiennent les droits d’auteurs d’un film. LesÉtats-Unis refusèrent de signer les accords sur les droitsd’auteur dans les années 1920; les producteurs américains purentainsi plagier les films d’autres compagnies sans crainte d’êtrepoursuivis. Ceci affecta particulièrement le producteur françaisGeorges Méliès puisque ce fut l’un des facteurs qui menèrent à safaillite, mais les problèmes de copyright n’expliquent pas à euxseuls l’émergence de la position dominante des films américains.
Un autre élément essentiel d’information sur l’arrière-plandoit faire appel à une brève histoire de la riposte dugouvernement américain à la menace posée par les pratiquesmonopolistiques des grandes entreprises. La loi Sherman de 1890contre les trusts, complétée en 1914 par la loi Clayton contreles trusts, représenta la plus importante intervention dugouvernement en vue de contrôler un tel comportement, mais lesinterventions contre les trusts déclinèrent dans les années 1920,alors que l’hégémonie du film américain était en voie de seconsolider. Par ailleurs, avec la loi Webb-Pomerene de 1918, lesÉtats-Unis encouragèrent la formation de trusts dans le but depromouvoir les exportations. L’industrie cinématographiqueaméricaine fut par la suite la principale bénéficiaire de cetteloi, en partie grâce au soutien diplomatique reçu du Départementd’État et l’Ambassade américaine en France. Le soutien duDépartement du Commerce fut moins important et prit la forme dela communication d’informations. (Pour une explication pluscomplète des politiques américaines sur les grandes entreprises,le lecteur pourra se reporter à l’Appendice A).
Les comportements propres aux cartels furent principalementle fait des services des principales compagnies établies à New
15
York. Ces compagnies se concertaient officiellement dans le cadredu MPPDA. Le MPPDA joua le rôle d’un instrument de mise en œuvredu cartel sous les apparences de l’«autorégulation desentreprises» aux États-Unis et il s’occupa aussi des relationsdes grandes compagnies cinématographiques avec l’étranger. Lecomportement de cartel des grandes compagnies s’affirma mêmedavantage dans les ventes à l’étranger, qui, dans les années1930, comptaient pour environ 35% de l’ensemble des revenus del’industrie. Le département des affaires étrangères du MPPDAavait le double rôle d’essayer de garder ouverts les canaux dedistribution des films américains à l’étranger et d’informerHollywood sur les exigences particulières des censeurs étrangers.Ceci comportait l’énorme responsabilité de traiter avec d’autresgouvernements pour des questions se rapportant aux quotas, tarifset restrictions commerciaux; en conséquence, le département desaffaires étrangères collaborait nécessairement avec leDépartement d’État; il avait un bureau à Washington même. Àl’occasion, des membres de l’organisation se rendaient aussi àl’étranger pour appuyer les efforts de la diplomatie officielle;pour cette raison, le MPPDA avait son propre bureau à Paris, dontle chef fut, à partir du printemps 1928, l’ancien diplomate àl’ambassade de Paris, Harold L. Smith3.
L’émergence de monopoles, 1895-1914
Les entreprises cinématographiques françaises dominaient lemarché mondial dans le domaine des longs métrages avant laPremière Guerre mondiale et il n’y avait aucun indice que lesfilms américains allaient acquérir une position dominante aprèsla guerre. Les compagnies cinématographiques françaises,anglaises et danoises, telles que Pathé Frères, Gaumont, Éclair,Hepworth et Nordisk Films Compagni, dominaient le petit marchémondial du cinéma; la guerre inversa ce scénario en faveurd’Hollywood.
Les entrepreneurs français furent les premiers à associerles diverses inventions nécessaires pour réaliser les premiersfilms. Afin d’exploiter ce nouveau médium, il était nécessaire demettre au point l’équipement technique, la qualité de lapellicule et l’esthétique des films. Les pionniers du cinéma
3 «The Hays Office», Fortune, vol. 18, décembre 1938. Réimp. dans Tino Balio, éd., The American Film Industry, Madison (WI), 1976, p. 311-312.
16
français, tel les frères Auguste et Louis Lumière et GeorgesMéliès, furent les premiers à développer ces aspects.
La première projection de films sur un écran blanc pour unpublic payant fut réalisé par les frères Lumière le 18 décembre1895, date qui est considérée comme la naissance de lacinématographie. Ils furent les premiers à mettre au point unsystème pratique de projecteur, le «cinématographe». C’était à lafois une caméra et un projecteur. Ils se lancèrent dans laproduction de projecteurs, de caméras et de pellicule; laproduction cinématographique elle-même n’était qu’un prolongementde leurs activités techniques. Leurs films avaient un caractèredocumentaire, illustrant la vie quotidienne de la classe moyennefrançaise. La première projection cinématographique présentaitdes travailleurs quittant l’usine des frères Lumière, un trainentrant en gare et le repas de bébé4.
La production de la compagnie Star Film de Georges Mélièsentre 1896 et 1905 demeura aussi artisanale. Sa compagnie acquitune position internationale dominante en mettant au point unstyle cinématographique dramatique et en recourant à des films àeffets spéciaux, même s’il utilisait une caméra fixe. Sa mise enscène faisait appel à des décors et à une reconstitutionhistoriques, tout en recourant à des styles comme le drame, lacomédie et l’opéra5. Les films devinrent plus intéressants àmesure qu’ils incorporèrent une action dramatique. Le voyage à la lune(1902) de Méliès et The Great Train Robbery (1903) de S. Portercomptent parmi les premiers films qui démontraient clairement quele cinéma avait des capacités dramatiques.
Toutefois, ce furent des hommes d’affaires tels que CharlesPathé et Léon Gaumont qui industrialisèrent la productioncinématographique et instaurèrent des pratiques commerciales quifaisaient appel à la monopolisation. L’industrialisation de laproduction cinématographique débuta après 1896, alors que LéonGaumont et Charles Pathé établirent les compagnies de cinémaPathé Frères et Gaumont Films. La production cinématographique,artisanale avant 1903, devint industrielle avec l’expansion des4 Les premiers programmes de Lumière comptaient les films La sortie des usines[l’usine Lumière], Le déjeuner de Bébé, La sortie du port, La démolition d’un mur, L’arrivée du train en gare, La partie d’écarté.5 David A. Cook, A History of Narrative Film, New York, 1981, p. 46-47; Georges Sadoul, French Film, Londres, 1953, p. 4.
17
activités de Pathé et, de 1907 jusqu’à la Première Guerremondiale, la compagnie fut la plus importante productrice aumonde.
L’établissement de cinémas permanents après 1902-1903 étaitissu de l’apparition d’une division tripartite de l’industriecinématographique : production, distribution et diffusion. Avecl’amélioration du produit cinématographique au début du XXe
siècle, il devint possible d’exploiter des salles de cinémapermanentes. Au début, les cinémas n’avaient survécu que peu detemps parce que les films ne pouvaient retenir l’attention dupublic : les programmes ne duraient qu’entre vingt minutes et unedemi-heure. Les films étaient plutôt projetés par des cinémasitinérants dans les marchés ou dans des salles de réunion. Lesmêmes films étaient projetés à plusieurs reprises, mais le lieuchangeait.
L’amélioration du produit cinématographique rendit possiblel’exploitation permanente de salles de cinéma, qui supplantèrentprogressivement les cinémas mobiles qui avaient dominé ladiffusion dans les premières années. Le passage de cinémasambulants aux salles de cinéma fixes se produisit dans lesprincipales villes industrielles d’Europe en 1904-1905, et auxÉtats-Unis vers 1902-19036. Alors que le lieu devenait stable, lesfilms devaient être régulièrement changés. Au début, lesprésentateurs achetaient directement du producteur des copies desfilms, mais les propriétaires de cinémas commencèrent alors às’échanger les films, avec la conséquence que la distribution desfilms devint progressivement une forme indépendante de commerce.L’instauration de la location de films eut pour résultat uneexplosion de tous les secteurs de l’industrie cinématographique.
Entre 1909 et 1914, les rapports commerciaux connurent deschangements radicaux lorsque Pathé Frères tenta de monopoliser lecommerce cinématographique. Des conflits de pouvoir en vue decontrôler le commerce cinématographique international apparurentaux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, la rivalitéconduisit à la création du trust Edison, la MPPC, en janvier1909. L’objectif du trust était de monopoliser le marchéaméricain, de même que d’écarter les concurrents européens.Lorsque les «indépendants», menés par William Fox, entreprirentune poursuite antitrust contre la MPPC en 1913 pour violation de6 Peter Bächlin, Der Film als Ware, Bâle, 1947, p. 18.
18
la loi Sherman contre les trusts, le trust devint progressivementinopérant, même avant d’être déclaré illégal en 1917.
Les producteurs de films européens tentèrent de créer untrust semblable à la MPPC lors d’une conférence que Sadoul aappelée le «congrès des dupes». La conférence était une réuniondes directeurs des principales compagnies cinématographiqueseuropéennes, qui se tint à Paris en février 1909. Mais lespuissants diffuseurs européens réussirent à empêcherl’instauration d’une production monopolistique. Cette tentativemanquée de monopolisation conduisit à une confrontation entrePathé Frères et tous les autres producteurs cinématographiques,qui fit perdre à Pathé sa position internationale dominante.
Pathé Frères
Georges Sadoul7 a appelé la période de 1903 à 1909 l’âged’or de Pathé, et Charles Pathé, «le Napoléon du cinéma». Lecontrôle qu’il exerça sur la vaste compagnie industrielle donna àPathé un pouvoir dictatorial sur les marchés français etinternationaux durant la période d’avant la Première Guerremondiale.
Charles Pathé était au départ un détaillant d’équipement quise mit à produire des projecteurs et des films. La compagniePathé Frères fut fondée le 30 septembre 1896 dans le but devendre des phonographes, des projecteurs de films et des films.La compagnie Pathé fut incorporée le 11 décembre 1897 sous le nom«Compagnie Générale de Phonographes, Cinématographes et Appareilsde Précision». À la base de l’établissement de l’association setrouvaient les investisseurs Claude Grivolas et Jean Neyret, cedernier ayant des relations avec le Crédit Lyonnais8. Ce furentles bonnes relations avec les banques françaises qui donnèrent saforce et sa position dominante à Pathé Frères.
Les efforts de Pathé pour monopoliser l’industriecinématographique dans sa totalité eurent une influence néfastesur le développement des rapports commerciaux internationaux. Audébut, au cours de la période de 1901 à 1907, Charles Pathédéveloppa sa production cinématographique sous la forme de ce7 Georges Sadoul, French Film, Londres, 1953, p.7.8 Jean-Jacques Meusy, Cinquante ans d’industrie cinématographique, Aubenas d’Ardèche, 1996, p. 14, 121ss.
19
qu’on appelle un trust horizontal, en construisant des studios,des entreprises de reproduction de films et des usines pour laproduction d’équipement et le montage, et en finançant dessuccursales à l’étranger. Pathé ouvrit des bureaux pour ladistribution de ses films partout dans le monde. En 1904, Pathéouvrit des bureaux à Londres, New York, Moscou, Bruxelles, Berlinet Saint-Pétersbourg; en 1906, à Amsterdam, Barcelone et Milan;en 1907, à Rostov-sur-le-Don, Kiev, Budapest, Varsovie, Calcuttaet Singapour; et en 1909, à Copenhague. En 1914, Pathé possédaitquarante et une succursales à travers le monde9.
En 1907, Pathé commença à monopoliser l’industriecinématographique en lançant la location de films à des cinémaspossédant un permis. Jusqu’en 1907, l’industrie cinématographiqueressemblait à n’importe quelle industrie, vendant le produitcinématographique aux détaillants à un certain prix par mètre depellicule. Les acheteurs passaient les films à leurs collèguesaprès avoir fini de les utiliser. Mais lorsque la distributiondes films se développa au cours de la période 1905-1907, avec descompagnies fournissant les films de plusieurs producteurscinématographiques, Pathé entreprit de monopoliser la locationdes films et la diffusion de ses propres films. La nouvellepolitique fut annoncée dans un article du démarcheur de Pathé,Edmond Benoît-Levy, dans Ciné-Gazette de 1905, publié sous le nom deFrancis Mair : «Qu’est-ce qu’un film? Est-ce un articlecommercial ordinaire, que l’acheteur peut utiliser comme ill’entend?… Non, un film possède des droits d’artiste et d’auteur.Pour les présenter, il est nécessaire de payer un droit. Leprésent débat porte sur l’établissement de ce droit, qui conduiraà la suppression des distributeurs de films, parce que, àl’avenir, on ne verra que des producteurs qui louent leurspropres films10.»
9 Sadoul, Histoire générale du cinéma, II, p. 248; cité par Kristin Thompson, Exporting Entertainment : America in the World Film Market, 1907-1934, Londres, 1985, p. 5.10 «Qu’est-ce qu’un film? Est-ce une marchandise ordinaire dont l’acheteur peut faire l’emploi qui lui convient?… Non, un film est une propriété littéraire et artistique. Pour le représenter, il faut payer un droit. C’est sur l’établissement de ce droit que le débat portera un jour, et ce sera la suppression des loueurs, car on ne verra plus que des fabricants louant eux-mêmes.» Cité par G.-Michel Coissac, Histoire du Cinématographe, Paris, 1925, p. 348; aussi cité par Paul Leglise, Histoire de la politique du cinéma français, p. 35.
20
Pour mettre en œuvre les idées proposées par Benoît-Levy, letrust Pathé se développa verticalement en créant la distributionde films et des compagnies de cinémas dans le but de diffuser lespropres films de la compagnie. En juillet 1907, Pathé annonçaqu’il cessait de vendre des films. L’objectif de Pathé étaitd’éliminer le commerce et la distribution cinématographiquesindépendants en faisant louer ses propres films directement parles cinémas. Pour les remplacer, Charles Pathé mit sur pied uneorganisation compliquée de compagnies de distribution, comportantune compagnie mère, la «Compagnie Générale», et cinq succursalesrégionales, qui obtenaient un monopole pour présenter les filmsPathé pendant une période de vingt ans11. Pathé interdit alors laprojection des films Pathé produits avant le 15 août 1907 partoute compagnie autre que les cinémas autorisés.
Les historiens n’ont pas décrit l’amertume que durentéprouver les propriétaires français de cinémas devant lestentatives de Pathé de les exclure du commerce, tentatives qui nedevaient pas être oubliées de sitôt. Au cours de l’été 1907, dansle but d’attirer le marché et d’annihiler les revenus de sesconcurrents, Pathé envoya vingt-quatre cinémas mobiles en tournéeen France afin de projeter des films une semaine ou deux avant ledébut de la mise en marché. Pathé ne réussit probablement pas àmonopoliser l’exploitation des cinémas en France autant qu’ill’aurait voulu, en grande partie parce que le Crédit Lyonnais etJean Neyret semblent n’avoir pas été disposés à investir l’énormecapital qui aurait été nécessaire. Pour financer la production dephonographes et de films, il avait suffi d’emprunter deux outrois millions de francs, mais la construction de cinémas partouten France aurait exigé un investissement de plusieurs millionssupplémentaires12.
L’instauration du nouveau système de location de Pathésignala le commencement d’une nouvelle période de l’histoire ducinéma dans les années 1908 et 1909, qui fut caractérisée par uneconcurrence brutale et des tentatives de monopolisation. AuxÉtats-Unis, la transition se fit en même temps quel’établissement de la MPPC en janvier 1909, au sein duquel leconsortium d’Edison et Pathé Frères eurent une influence11 Pathé répartit la France entre les cinq associés; voir Sadoul, Histoire générale du cinéma, II, p. 250-252.12 Ibidem, p. 251.
21
décisive. La MPPC eut une importance directe sur l’évolution dela situation en Europe.
La croyance populaire veut que si une compagnie a produit unbon film, elle aura la même possibilité de présenter le film quen’importe quelle compagnie. Toutefois, de telles conditionsdémocratiques n’ont existé que dans l’enfance de l’industriecinématographique. Elles prirent fin en 1909, lorsque les trustset les monopoles commencèrent à dominer le commerce du cinéma.
La Motion Picture Patent Company, 1909-1914
Aux États-Unis, les années 1908-1914 furent aussi unepériode d’activité fébrile et de rudes combats pour le contrôlede l’univers cinématographique. Deux événements affectèrent lecours de l’histoire : d’abord, la mise sur pied du trust MPPC,qui domina toutes les activités cinématographiques pendant quatreans, et ensuite, le lancement du long métrage qui s’imposabientôt et révolutionna le commerce cinématographique.
La croissance de la demande de films produisit uneconcurrence âpre et élargie. Les fabricants, importateurs etdistributeurs atteignirent le nombre de cinquante à cent environ,et les cinémas à cinq sous se chiffrèrent par milliers. Laproduction de films était grande ouverte aux producteurs quidétenaient un titre légal aux brevets de l’une des troiscompagnies : Edison, Biograph et Vitagraph. Avec lamultiplication des poursuites, la situation devint critique.
Afin d’apporter une stabilité accrue et d’empêcher unenouvelle concurrence déstabilisante, les neuf fabricantsprincipaux et les plus grands distributeurs de films étrangers seregroupèrent et, le 1er janvier 1909, annoncèrent la formation dela MPPC. La compagnie comprenaient sept fabricants américains –Edison, Biograph, Vitagrap, Essanay, Selig, Lubin et Kalem – etles deux compagnies françaises Méliès et Pathé – , ainsi que ledistributeur George Kleine. Tous fusionnèrent leurs brevets etchacun reçut un permis de produire des films. Lewis Jacobs13 amontré que les partenaires convinrent alors qu’on n’accorderaitpas d’autre permis. La production cinématographique devait selimiter à ces neuf compagnies d’origine, et Edison, reconnu commele détenteur des principaux brevets, devait recevoir des13 Lewis Jacobs, The Rise of the American Film, New York, 1939, p. 82.
22
redevances pour l’usage des caméras et des pellicules. Pourrenforcer son objectif de contrôle et de monopolisation de laproduction cinématographique, la MPPC passa un contrat avecEastman Kodak Company pour n’approvisionner en pellicule viergeque les membres en règle.
Pour contrôler la diffusion et la production, la MPPCinstaura un système de redevances pour les brevets. Lesprésentateurs devaient payer deux dollars par semaine pourl’utilisation de projecteurs et la location de films aux membresen règle du trust. Environ dix mille diffuseurs signèrent descontrats avec la MPPC, mais, comme on devait s’y attendre, letrust rencontra une âpre opposition de la part des fabricants etdes distributeurs qui ne faisaient partie du trust. Jacobsexplique que, pendant que les indépendants se mettaient à fairede la contrebande de films et de projecteurs, un systèmecommercial clandestin se développa entre les indépendants et lesdiffuseurs. Plusieurs compagnies s’opposèrent ouvertement autrust; les plus importantes d’entre elles furent la Carl Laemme’sMotion Picture Distributing and Sales Company et la William Fox’sNew York Film Rental Company14.
En 1910, la MPPC établit un système commercial pour lesfilms, la General Film Company, et, pour assurer son monopole,absorba tous les contrats d’échange en règle. Le 1er janvier 1912,cinquante-sept des cinquante-huit principaux contrats avaient étérachetés. La seule compagnie qui ne s’inclina pas fut la WilliamFox’s Greater New York Fils Rental Company, dont le pouvoirvenait des nombreux cinémas qu’elle possédait à New York. Foxprit la tête de la résistance au trust et intenta une poursuitecontre la MPPC comme étant une conspiration illégale en vue delimiter les échanges commerciaux en violation de la loi Shermancontre les trusts. La poursuite mena à la dissolution de la MPPCen 1917. Même si le trust n’exerçait plus ses activités en 1914,Le Département de la Justice continua de surveiller lamonopolisation sans intervenir vraiment15.
Dans leur combat pour survivre, les concurrents indépendantsse concentrèrent sur la nécessité d’améliorer la qualité de leursfilms. Ils découvrirent aussi Hollywood et y établirent leurcentre de production, qui était situé dans un endroit où les14 Ibid., p. 83.15 Ibid., p. 84, et U.S. Department of Justice, RG.60, National Archives.
23
conditions météorologiques étaient favorables et où ils pouvaientéchapper aux agressions du trust. Ils mirent au point le systèmedes vedettes (star system) comme méthode pour accroître les profitset ils développèrent considérablement la publicité de leursfilms. Ils attirèrent plusieurs des principaux producteurs enoffrant des salaires plus élevés. En 1913, Hollywood avait sibien évolué qu’il devint sa propre municipalité16.
Le changement survenu dans les relations commercialesinternationales en 1909 changea définitivement le commercecinématographique. Les conflits internationaux de pouvoir pour lecontrôle de l’industrie cinématographique, qui apparurentsimultanément en Europe et aux États-Unis, menèrent à lamonopolisation. Après avoir défait la MPPC, les indépendantscréèrent à leur tout leur propre monopole. Après 1909, les trustset les cartels dominèrent l’industrie cinématographique.
La monopolisation dans le cinéma européen, 1909-1914
Les tentatives de Pathé pour monopoliser la distributioncinématographique européenne représentaient aussi une menace pourla distribution de films par d’autres producteurs, quis’organisèrent pour se défendre contre Pathé. La premièreconférence des producteurs cinématographiques se tint à Paris, le9 mars 1908, à l’initiative conjointe franco-britannique. LéonGaumont venait de créer une section du cinéma à l’intérieur de la«Chambre Syndicale Française du Phonographe». Il en résulta quela plupart des producteurs de films français et des représentantsdes compagnies étrangères s’y joignirent, à l’exception deCharles Pathé. Cette organisation s’occupa de la réunionsubséquente17.
Il existait chez les producteurs de films un certain intérêtcommun pour la location des films. Le désavantage de la nouvellepratique de location de Pathé Frères était qu’elle visait àéliminer la distribution indépendante de films de façon àmonopoliser la distribution des propres films de la compagnie,s’assurant ainsi le contrôle des cinémas. Mais la location defilms était généralement avantageuse pour tous les producteurs defilms, qui, jusque là, avaient vendu les copies de leurs et ainsiperdu le contrôle de leur exploitation. Le but de la conférence,16 Ibid., p. 88.17 Sadoul, Histoire générale du cinéma, II, p. 509-510.
24
que Sadoul a appelée «le congrès des dupes»18, était d’abord dedécider comment les films pouvaient être mieux exploités, afin decréer en bout de course un trust cinématographique européen.
Le Congrès des Dupes
En 1908, les compagnies cinématographiques européennesfirent leurs plus grands profits aux États-Unis, et ce fut doncpour elles un grand choc de découvrir qu’Edison avait établi untrust cinématographique en février 1908. Le trust avait acceptéplusieurs producteurs cinématographiques américains, mais, parmiles compagnies européennes, seuls Pathé Frères et la Star Film deGeorges Méliès avaient été invités à faire partie du trust. Tousles autres producteurs cinématographiques étaient écartés dumarché américain. En mars 1908, Gaumont, Urban Trading et Cinèsdemandèrent, en passant par Méliès, à faire partie du trustd’Edison, mais leur demande fut rejetée parce que Pathés’objectait à leur participation19.
La proposition de l’organisation des producteurscinématographiques britanniques de tenir une conférence pourdiscuter de la situation du cinéma fut universellement acceptéepar les producteurs français et les autres producteurs de filmsétrangers, à l’exception de Pathé. Charles Pathé, le«monopolisateur» du cinéma européen, s’opposa de manièrevéhémente au congrès qui était proposé; pour lui, la crise étaitbienvenue parce qu’elle allait éliminer des concurrents. LorsqueMéliès transmit à Pathé l’invitation du congrès de la part deVitagraph-Nordisk, celui-ci répliqua de manière arrogante qu’ilétait lié par des accords et que la situation ne pouvait serésoudre que par des faillites inévitables. Les organisateurs ducongrès abandonnèrent l’idée de voir Pathé se joindre à laconférence.
L’organisation des producteurs de films français, la«Chambre Syndicale Française du Phonographe», organisa lecongrès, qui s’ouvrit le 9 mars 1908. Le président et fondateurde l’association était Léon Gaumont, et Marcel Vandal, del’Éclair, en était le vice-président. On discuta des avantagespour les producteurs de films d’établir leur propre distribution18 Ibid., p.509ss.19 Ibid., p. 509ss. Cet exposé contient la description la plus détaillée des congrès sur le cinéma des années 1908-1909.
25
des films, ce qui était une attaque contre Pathé, mais non contrele trust Edison. La compagnie Nordisk Film et Stuart Blackton deVitagraph suggérèrent de tenir un autre congrès international àParis pour explorer la manière de combattre le trust. Un comitéd’initiative élut Méliès comme organisateur, même si sa compagnieStar Film connaissait de grandes difficultés économiques et nesurvivait que grâce à sa succursale de New York20.
Les producteurs européens voyaient dans le nouveau congrèsprojeté un moyen d’éviter la crise avec l’aide de George Eastman.Le congrès fut donc reporté au 10 décembre 1908, jour où Eastmanétait censé arriver à Paris. Mais Eastman reporta son départd’Amérique jusqu’après la formation de la MPPC, forçant ainsi unnouveau report du congrès.
Entre-temps, Pathé estima qu’il tirerait personnellementprofit de la monopolisation du marché américain. Il passa l’été1908 à New York pour essayer d’établir ses propres succursales delocation de films, semblables à celles qu’il avait établies enFrance. Mais Edison n’entendait pas lui permettre d’empiéter surses propres arrangements avec les distributeurs en permettantainsi à son concurrent étranger de se renforcer. Charles Pathéquitta les États-Unis en septembre 1908 sans avoir établi sessuccursales.
Georges Sadoul a montré que lorsque Eastman vint à Paris enjanvier 1909, il se rendit directement discuter l’établissementde la MPPC avec Pathé à Vincennes avant l’ouverture du congrès.Les dirigeants de la compagnie – Pathé, Iwatts et Prévost –soutinrent que la principale raison pour établir une méthodedifférente d’autorisation était d’être en mesure d’éliminer lesconcurrents européens. Eastman aboutit à la conclusion qu’ils neréussiraient pas. Pour Eastman, la conférence des producteurseuropéens était d’importance secondaire si elle n’obtenait pas unarrangement avec les principaux producteurs de films européens,parce que l’association européenne des producteurs de films étaitplus puissante que l’américaine. Pour les empêcher de s’unir, ilétait nécessaire d’ouvrir le marché américain à certaines descompagnies les plus importantes – Gaumont, Urban, Cinés etNordisk Films Compagni. Pathé accepta l’entente qui créait laMPPC, conclue deux semaines plus tôt. Eastman fit aussi accepter20 Article dans Argus Phono-Ciné, mars 1908, cité par Sadoul, Histoire générale du cinéma, II, p. 509-510.
26
à Pathé l’établissement d’une association européenne desproducteurs cinématographiques21.
Ainsi, malgré son opposition antérieure, Pathé était présentlorsque le congrès s’ouvrit le 2 février 1908, présidé parGeorges Méliès et en présence d’Eastman et de trente desprincipaux producteurs de films (les directeurs de Cinés, Urban,Gaumont, William Paul, Hepworth, Nordisk, Messter et Duske).Charles Pathé fut l’architecte du fait que la conférence réussitinitialement à créer un trust semblable à celui d’Edison.
Le congrès décida que les diffuseurs seraient obligés deretourner les films après quatre mois, sans exception. Les filmsne devaient pas être vendus, mais loués à 1,75 francs par mètrepour quatre mois, dont 50 centimes seraient remboursés. Un tarifminimum de location des films était imposé aux cinémas. Lesproducteurs se mirent aussi d’accord pour exiger qu’Eastman-Kodakmonopolise la fourniture de pellicule vierge au trust, comme ils’était mis d’accord pour le faire avec la MPPC. En retour, letrust s’obligeait à n’acheter de la pellicule que de Eastman22.
Après la conférence, les producteurs de films prirentconscience que le trust démolissait les distributeurs et lesdiffuseurs cinématographiques et qu’il ne profiterait qu’auxproducteurs de films qui étaient aussi des distributeurs – end’autres termes, Pathé Frères. Si les distributeurs cessaientd’exister, le diffuseur devrait se tourner vers le producteur-distributeur, et s’ils étaient incapables de payer 1,25 francs lemètre pour les films, ils devraient se retirer des affaires.
Afin de s’opposer au trust, les diffuseurs et lesdistributeurs s’organisèrent. Lorsque les distributeurs, lorsd’une réunion tenue le 15 mars, recommandèrent le boycottage desfilms du trust, celui-ci commença à s’effriter. Des désaccordsétaient déjà apparus le 5 mars, lorsque Méliès négocia sanssuccès l’accord sur la location des films, parce que lesnouvelles compagnies Éclair et Lux ne voulaient pas offenserleurs clients. Lors d’une réunion tenue le 15 mars, Charles Pathéretira soudainement son accord pour détruire les films aprèsquatre mois et rejeta aussi le système de prix fixe. Peu après,George Eastman démissionna. Les problèmes subséquents liés à la21 Sadoul, Histoire générale du cinéma, II, p. 513-514.22 Ibid., p. 517ss.
27
fourniture de pellicule vierge conduisirent au démantèlementfinal du trust. Il ne pouvait exister sans Pathé et Eastman.Éclair reprit la vente libre des films et abandonna la location,et les compagnies anglaises Williamson et Walturdaw firent demême23.
En s’appuyant sur ses conceptions marxistes, Georges Sadoula expliqué l’échec du trust et des conditions qu’il cherchait àimposer, par comparaison avec la MPPC, comme le résultat dedifférences structurelles essentielles entre les marchésaméricain et européen. Pour l’essentiel, il relève que laprésentation de films était beaucoup plus développée aux États-Unis, qui possédaient aussi de puissantes associations dedistributeurs, alors que, en Europe, le petit commerce étaitresté important et que la distribution des films n’était pasencore développée. Le congrès avait échoué, remarquait-il, enraison d’un écart trop prononcé entre les intérêts24.
Sadoul ne s’est pas demandé si la stagnation plus prononcéedes structures internationales dans la diffusion des films enEurope ne résultait pas de l’application de systèmes de permisdépassés pour les cinémas, qui rendaient risqués lesinvestissements dans le cinéma. Avec l’augmentation des taxesd’amusement au cours des années 1910 et 1920, l’investissementdans la diffusion devint certainement moins profitable.
La description du «congrès des dupes» est suivie d’unelacune dans l’histoire du cinéma de Georges Sadoul25. Une revue decinéma danoise26 rapporte qu’en raison de la résistance de la partdes distributeurs et des diffuseurs, une autre conférence tenue àParis en avril rétablit le marché libre des films. Tous lesproducteurs acceptèrent la nouvelle convention à l’exception dePathé, qui n’entendait pas abandonner la location directe defilms aux cinémas. En conséquence, Pathé s’engagea dans unnouveau conflit avec les autres producteurs de films, et s’amorça
23 Ibid., p. 524-526.24 Ibid., p. 512.25 Les congrès subséquents en avril ne sont pas mentionnés par Sadoul, etil n’a pas décrit les conflits entre Pathé et les industries cinématographiques européennes à l’étranger au cours des années 1909-1914, qui paralysèrent l’hégémonie cinématographique française.26 «Blade af Krigen mod Pathé Frères», Nordisk Biograf-Tidende, 1.årg., nr. 3, Copenhague, novembre 1909, p. 41, 43.
28
un combat contre Pathé, qui aboutit à un boycottage total de lacompagnie sur tout le Continent. La décision initiale selonlaquelle les films devaient être retournés fut rejetée par lesproducteurs, mais les prix furent déterminés par conventionjusqu’au 1er avril 1910. Tous les participants, à l’exception deCharles Pathé et de quelques compagnies anglaises, signèrent leprotocole. La revue danoise affirmait que Charles Pathé avait ditque «les distributeurs faisaient trop de profits; ils doiventêtre abattus – les cinémas devraient alors danser “au son de laflûte du producteur”». Elle prétendait aussi que l’intention dePathé n’était pas seulement d’éliminer la distribution des films,mais aussi de créer un cartel vertical pour contrôler laproduction, la distribution et la diffusion cinématographiques –une menace sérieuse à l’existence des autre compagniescinématographiques.
La convention était une déclaration de guerre entre lesdistributeurs de films européens et la compagnie Pathé, qui futécartée du marché continental. Partout en Europe, ils formèrentdes coalitions avec les diffuseurs pour mettre un terme à lastratégie de monopolisation de Pathé. Un congrès réuni à Berlinle 29 avril 1909 décida de créer une organisation unifiée, quitint son assemblée de fondation le 13 mai. Cette assemblée adoptaune résolution pour exclure Pathé frères d’Allemagne27. Partoutfurent créés des syndicats de distributeurs et de diffuseurs. EnAutriche, une compagnie unifiée de location fut créée, qui exclutdu marché la location des films de Pathé. Pathé fut finalementobligé de reprendre la livraison aux distributeurs de films etdut abandonner la location directe aux diffuseurs.
Pathé semble avoir réussi temporairement à distribuer sespropres films en France, en Grande-Bretagne, au Danemark et enSuède, mais la documentation est pour le moment trop limitée pourdéterminer à quel point il réussit à monopoliser la distributionde ses propres films. En 1913, la guerre contre Pathé reprit enGrande-Bretagne et en Suède. En janvier 1914, la compagnie Pathés’était affaiblie au point que les distributeurs danois, encréant un trust, purent forcer la compagnie à mettre un terme àlocation de films à Copenhague28. Les distributeurs suédois27 Ibid., p. 43-44. La reprise de films par Pathé est mentionnée par Sadoul, Histoire générale du cinéma, II, p. 526.28 Jens Ulff-Møller, «Da Filmen til Danmark…», Sekvens 1989, Copenhague, 1990, p. 45-46.
29
imitèrent les Danois en créant aussi un trust, mais le conflitcontinua en 1915 et, en 1917, Pathé ne louait des films qu’à unpetit nombre de cinémas, qui, en conséquence, se virent interdirela location de films d’autres distributeurs29. Les résultats desconflits dans d’autres pays européens sont inconnus, mais ilsemble probable que Pathé Frères aura été forcé de laisser tomberla location de films.
Le trust européen du cinéma en ruines, un seul trust ducinéma fit son apparition : le trust américain. Le trustaméricain réussit à monopoliser le marché américain du cinéma àun point dont seul Pathé avait rêvé.
29 «Filmkrig i Sverrig», Filmen, 3. Årg., nr. 13, Copenhague, 15 avril 1915, p. 110. Et, extrait de The Film Trust, Report to the Secretary of Statefrom the American Consulate General, Stockholm, 7 septembre 1917 : «La formation d’un trust du cinéma en Suède a causé beaucoup d’insatisfaction. Le trust, suivant l’exemple du Danemark, a boycotté les films de Pathé Frères… À Sollefteå, un cinéma avait un contrat avec Pathé Frères pour projeter un certain nombre de leurs films, et une forte amende devait être payée si le contrat était rompu. Toutefois, le trust n’entendait pas que d’autres films soient fournis au cinéma aussi longtemps que celui-ci projetait des films Pathé, et ainsi il dut choisir entre le paiement d’une forte amende pour rupture de contrat ou la fermeture.»
30