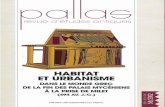Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism)...
-
Upload
univ-nantes -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism)...
Urbanisme Insoupçonné
Paul FRANÇOIS
Projeter la ville égyptienne au Nouvel EmpireUrba
nism
e In
soup
çonn
éPr
ojet
er la
vill
e ég
yptie
nne
au N
ouve
l Em
pire
Paul
FRA
NÇO
IS
Urbanisme InsoupçonnéProjeter la ville égyptienne au Nouvel Empire
Civilisation des pyramides et des temples de pierres, l’Égypte Ancienne a laissé peu de traces de ses agglomérations au point que certains ont douté de l’existence de villes, et a fortiori d’urbanisme, pendant cette période. Cette étude tente d’apporter la preuve de réelles connaissances urbanistiques en mettant en œuvre un projet urbain issu des leçons des vestiges de villes du Nouvel Empire. Il met en lumière un urbanisme insoupçonné alternant planification stricte et libertés d’organisation qui permit l’essor d’une des civilisations les plus brillantes du bassin méditerranéen.
Mots clés : Ville, Urbanisme, Égypte, Antiquité, Analyse Urbaine
Civilization of stone pyramids and temples, Ancient Egypt left so few traces of its urban areas that some may doubt the existence of cities and urbanism du-ring this time. This study tries to demonstrate the existence of real urbanistic knowledges by creating a urban design from the lessons learned from the remains of New Kingdom settlements. It highlights an unsuspected urbanism between strict town planning and organic development which allowed the economic and cultural expansion of one of the most outstanding civilization of the Mediter-ranean Basin.
Keywords : City, Urbanism, Egypt, Antiquity, Urban Analysis
Unsuspected UrbanismDesigning egyptian cities during New Kingdom
Mémoire de Master d’Architecture,sous la direction de Benjamin Chavardés,
soutenu en septembre 2014.
Mémoire de Master d’Architecture,réalisé à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon,sous la direction de Benjamin Chavardés.© Benjamin Chavardés & Paul François, Lyon, 2014
Urbanisme Insoupçonné
Paul FRANÇOIS
Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire
La réalisation de ce mémoire a été un travail scientifique dans lequel je crois m’être beaucoup investi, en tant qu’apprenti chercheur mais surtout en tant que passionné. C’est pourquoi je voulais profiter de cet espace pour exprimer mes remerciements et également pour évoquer quelques choix qui ont fortement influencé la forme et le fond de ce tra-vail.
Mes premiers remerciements vont naturellement à Benjamin Chavardés qui m’a apporté son soutien et est resté toujours convaincu de l’intérêt de mon travail. Je lui dois d’avoir pu lier ce que je pensais devoir rester une simple passion, que l’on pratique en marge d’autres activités, à mon futur métier d’architecte-ingénieur. Les nombreux conseils méthodo-logiques qu’il m’a prodigué, ainsi qu’une certaine rigueur de travail m’ont été d’un grand secours. Ses remarques, nombreuses, sur d’innombrables aspects tant cosmétiques que pratiques de ce travail ont permis d’en amé-liorer substantiellement la qualité. Je tiens ensuite à montrer ma recon-naissance envers Corinne Castel, chercheure du laboratoire Archéorient, qui m’a fait l’honneur d’être son stagiaire et m’a ainsi permis de m’im-
merger dans la méthodologie archéologique afin de mieux positionner mon travail dans ce contexte. Corinne m’a également laissé exprimer mon avis d’architecte sur ses travaux à paraître, me permettant de comprendre l’intérêt de cette profession en archéologie. D’autres acteurs ont de même joué un rôle important, consciemment ou non, pour mener à bien les recherches présentées ici. Franck Monnier, auteur d’excellents ouvrages sur l’architecture en Égypte Ancienne, a partagé avec moi plusieurs conseils utiles, tandis que des internautes, qui se reconnaîtront, m’ont apporté des sources indispensables qui étaient parfois hors de ma portée.
L’intérêt pour la ville en Égypte Ancienne m’est venu naturelle-ment lors de mes études au sein de l’École Nationale Supérieure d’Ar-chitecture de Lyon, trouvant que les exemples de conception urbaine en dehors de la Grèce ou de la Rome antiques étaient trop rares, et cherchant à comprendre les raisons de cette absence. Passionné depuis longtemps par l’Égypte Ancienne, et notamment l’architecture de ses temples, il m’a paru logique de chercher du côté de cette civilisation les traces de villes anciennes dans le cadre d’un Rapport d’Étude de Licence intitulé La Ville Égyptienne au Nouvel Empire et soutenu à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon en 2013 sous la direction de Benjamin Chavar-dés. Souhaitant poursuivre ce travail, je voulais néanmoins y intégrer la question de la reconstitution tridimensionnelle que j’avais déjà eu l’oc-casion d’expérimenter avec plus ou moins de succès sur un site Internet consacré aux Temples dans l’Égypte Ancienne. Il en a résulté une métho-dologie particulière où le projet urbain est utilisé comme outil heuristique en y intégrant une conception tridimensionnelle grâce à des outils comme 3D Studio Max.
Ainsi, le lecteur remarquera sans doute la quantité de documents graphiques présentés dans ce mémoire, ainsi que leur caractère inédit. L’image est en effet pour moi un vecteur essentiel de compréhension et l’évolution des technologies nous permet aujourd’hui de créer des images plus réalistes et plus didactiques. Ainsi ai-je opté pour des perspectives coniques dans la plupart des représentations, plutôt que les traditionnelles axonométries qui ont tendance à exclure le lecteur de l’image qu’il re-
garde. J’ai également cherché à donner aux perspectives de la ville projetée une couleur et une atmosphère particulière afin d’y inclure le lecteur. Ces choix limitent fortement l’utilisation de documents graphiques is-sus d’autres ouvrages ou publications, néanmoins on pourra trouver en annexe le détail des techniques et sources utilisées pour concevoir chaque illustration. De même, la toponymie des sites anciens pouvant mener par-fois à confusions, du fait de la redondance de certaines racines communes (on ne compte plus les sites dont le nom commence par «Tell», ou par «Deir»), le lecteur perdu pourra toujours se référer à la carte de l’Égypte Ancienne en annexe.
9
L’histoire de l’égyptologie moderne commence en 1798 lorsque, sous l’impulsion de Napoléon Bonaparte, l’Institut d’Égypte s’emploie à effectuer pour la première fois un travail monumental d’étude des faits naturels, historiques ou économiques du pays1. Il s’agit alors d’un des premiers inventaires scientifiques d’Égypte qui est pourtant biaisé par un intérêt certain pour l’œuvre d’art ou le monument architec-tural. Les monuments, souvent partiellement ensablés, apparaissent tels des icônes du romantisme tandis que l’impossibilité de lire les inscriptions qui les recouvrent ne permet pas d’en comprendre leur signification. À Karnak, surpris par l’importance des ruines de pierres, les savants voient dans cet ensemble une ville entière alors qu’il ne s’agissait que du temple d’un seul dieu.
Tout au long du XIXème siècle, l’Égypte dont l’instabilité n’a fait que croître depuis le départ de Napoléon, est devenue la terre des aventuriers plus que des scientifiques. Les expéditions qui s’y en-
1 Vercoutter Jean, 1992, p. 2
Introduction
10 11
URBANISME INSOUPÇONNÉ INTRODUCTION
chaînent ont pour objectif premier de remplir les cabinets de curiosi-tés et musées européens. Champollion n’hésite pas à arracher un pan entier de pilier de la tombe de Séthi Ier pour les collections françaises. Aidés par les populations locales, qui fouillent sauvagement certaines tombes, les aventuriers européens reviennent avec de nombreux ob-jets d’origine inconnue, la démarche de fouilles scientifiques est alors balbutiante. Autant dire que les vestiges des villes anciennes, faites de briques crues sont alors de bien peu d’intérêts. C’est seulement avec l’arrivée d’Auguste Mariette à la tête du Service des Antiquités Égyp-tiennes que la donne change. Il s’emploie à faire cesser les plupart des fouilles sauvages2.
Dès le XXème siècle, aidée par la maîtrise grandissante des hiéro-glyphes, la recherche scientifique sur le thème de l’Égypte Ancienne est marquée par la publication des collections des musées, la création de sociétés d’égyptologie nationales, et la mise en place de nouvelles méthodes de fouilles. C’est à cette période que l’on doit la découverte ou re-découverte des sites urbains majeurs que sont Deir el-Medineh et Tell el-Amarna. Les recherches sur ces sites se concentrent sur les informations inédites qu’ils apportent concernant la vie quotidienne des anciens égyptiens, leur administration ou leurs coutumes. La re-cherche égyptologique liée à l’urbanisme ancien est alors quasi inexis-tante. Bernard Bruyère, qui fouille Deir el-Medineh, se garde bien de généraliser les quelques conclusions qu’il a pu déduire sur l’organisa-tion d’un village égyptien3 et Barry John Kemp ne publie ses analyses de l’organisation de Tell el-Amarna qu’à la fin du XXème siècle4.
Après un peu plus de deux siècles d’histoire, l’égyptologie a ac-quis une autonomie disciplinaire, au croisement de l’archéologie, de la philologie, de la sociologie et de l’architecture… mais pas de l’urba-nisme. De fait, les études sur ce sujet restent peu nombreuses.
2 Vercoutter Jean, 1992, p. 113 Bruyère Bernard, 19394 Kemp Barry John, 1992
De l’urbanisme en Égypte Ancienne ?
En 1960, dans un congrès sur l’urbanisation du Moyen Orient tenu à Chicago, John A. Wilson fait une intervention remarquée sur le thème de «Egypt through the New Kingdom, A Civilization without cities ?». Cette conférence questionne directement l’existence de villes telles qu’on les conçoit aujourd’hui5 dans l’Égypte Ancienne, et, bien qu’elle fut faite il y a plus de cinquante ans, elle reste pertinente et s’interroge sur le rôle politique des ces zones urbanisées. Même Tell el-Amarna, pourtant capitale de l’empire égyptien, est parfois décrite comme un «agrégeât de villages»6.
Pourtant, les preuves archéologiques mettent clairement en évi-dence une certaine maîtrise des égyptiens de la question urbaine. D’une part, la fonction de la ville est déterminante dans son organi-sation spatiale. Il y a clairement une différenciation en plan entre les cités ouvrières dédiées à la mise en œuvre d’un chantier comme Deir el-Medineh ou Kahoun, les forteresses sensées protéger les biens et intérêts de l’Égypte comme Bouhen, ou mêmes les capitales dédiées au contrôle global du territoire et à une mise en scène du pouvoir royal comme Tell el-Amarna ou Thèbes. D’autre part, le savoir urba-nistique égyptien a évolué dans le temps. Les cités primitives, comme Hiérakonpolis présentent un plan spontané qui s’efface au Moyen Empire au profit du plan en damier (hippodaméen avant l’heure) de Kahoun. Au Nouvel Empire, les deux exemples persistent même si le système devient moins rigide et ne semble organiser que les noyaux durs de la ville, laissant le reste se développer de façon organique.
Malgré ces quelques éléments, la question de l’urbanisme en Égypte Ancienne reste très lacunaire. C’est dans ce contexte qu’une vision différente - celle de l’architecte - peut permettre d’avancer en se servant d’outils inhabituels pour l’archéologue, comme l’analyse
5 Wilson John A., 1960, dont la traduction française du titre est : L’Égypte au Nouvel Empire, une Civilisation Sans Villes ?
6 Laboury Dimitri, 2010, p. 260
12 13
URBANISME INSOUPÇONNÉ INTRODUCTION
urbaine. Les architectes sont sensés «retisser la toile des relations entre conception et pratique des édifices et de l’environnement»7.
État de la question
On l’a vu, pendant longtemps les archéologues en Égypte se sont principalement concentrés sur les monuments plutôt que sur l’étude de la ville. Bien que lié à l’attrait artistique pour l’Égypte Ancienne, cet état de fait est également une conséquence de l’état de conserva-tion des vestiges urbains datant d’une période allant de 3000 avant J.-C. à l’époque romaine. En effet, les villes égyptiennes étaient bâties de briques crues, matériau peu onéreux mais qui nécessite un entre-tien important et n’est pas compatible avec les crues annuelles du Nil dont l’ampleur atteignait parfois les villes. Une partie non négligeable des villes a donc été purement et simplement détruite, tandis que bon nombre de localités actuelles de la vallée sont en fait simple-ment construites sur les ruines anciennes. Ainsi, Louxor est-elle bâ-tie entièrement sur l’ancienne Thèbes sans pour autant tenir compte des tracés de la cité antique. Des découvertes récentes, couplées à de nouvelles technologies, permettent cependant d’avoir accès à des ensembles urbains importants, c’est le cas par exemple des données satellites, des prospections magnétiques ou des images d’avions qui permettent de redécouvrir des sites et d’en faire des études poussées sans même, dans certains cas, recourir aux fouilles, grâce à des SIG (Systèmes d’Informations Géographiques)8.
7 Pierre von Meiss dans Zignani Pierre, 2008, p. 58 Ces techniques ont déjà fait leurs preuves sur de nombreux sites dans
et hors d’Égypte, notamment sur le site de Tell Al-Rawda, en Syrie, dont un plan d’urbanisme a pu être découvert sur l’ensemble de la ville grâce aux prospections magnétiques. Les SIG, quant-à eux, permettent grâce au rassemblement de très nombreuses données, issues à la fois des observations géographiques et du travail des archéologues, de fournir rapidement un modèle numérique spatial permettant le test de nombreuses hypothèses.
Les sites urbains préservés en Égypte existent : Tell el-Amarna, capitale habitée une dizaine d’années puis abandonnée, Tanis, dont le dégagement est en cours, Kahoun, Deir el-Medineh, de nombreuses forteresses… À ces sites s’ajoutent de nombreuses traces d’urbanisa-tion que l’on peut déceler autour des monuments anciens. C’est le cas à Karnak où le temple est petit à petit venu empiéter sur les espaces urbains en les recouvrant9. Une des premières sources d’informations concernant le fait urbain en Égypte Ancienne est donc l’observation de ces sites in situ, ou la lecture des nombreux rapports de fouilles. Néanmoins, la difficulté de ces rapports est qu’ils sont dépendants de la façon dont sont effectuées les fouilles et bien souvent font seu-lement état de l’ensemble des découvertes sur une parcelle donnée (quelle que soit leur époque, leur typologie, leur origine), délaissant l’analyse globale d’un site. En d’autres termes, ils font une sorte de photographie d’une portion de site, basée sur l’approche stratigra-phique, photographie qu’il convient de décomposer pour trouver les cohérences au sein d’ensembles plus larges.
La maîtrise de la lecture des hiéroglyphes a permis également à tout un nouvel ensemble d’études sur l’urbanisme égyptien d’émerger ces dernières années. Il s’agit par exemple d’étudier un type littéraire en vogue au Nouvel Empire, «l’Éloge de la Ville»10. Ces textes, tou-jours organisés de la même façon content le «mal du pays» d’un parti-culier temporairement éloigné de sa ville d’origine. Les différentes va-riations au sein du même thème ont permis de mettre en avant que la ville égyptienne cristallise la différenciation des classes sociales, et est également perçue comme le centre culturel de l’Égypte, voire même l’origine du monde. Enfin, la ville est toujours assimilée de manière très forte à son temple et à sa divinité tutélaire. De manière similaire, d’autres études se sont interrogées sur des ensembles économiques apparaissant dans les textes du Moyen Empire sous le nom de Hw.t, et
9 Lauffray Jean, 1975, p. 2910 Ragazzoli Chloé, 2008
14 15
URBANISME INSOUPÇONNÉ INTRODUCTION
l’étude des textes permet de tirer des conclusions sur le rôle d’organi-sation de mise en valeur du territoire que ces entités possédaient, mais également leur potentiel à devenir des villes à part entière11.
Les textes égyptiens fournissent donc une deuxième source d’in-formation envers laquelle il convient de se montrer très vigilant. D’une part, la population sachant lire et écrire devait être extrême-ment faible et il s’agit donc de visions issues de l’élite du peuple, fortement formatée par l’idéologie, d’autre part il s’agit de textes à visée poétique, et qui sont donc plus enclins à raconter une réalité déformée et idéalisée.
La littérature de synthèse sur le sujet à destination des architectes ou des urbanistes est peu étoffée. Les livres de Geneviève Sée, archi-tecte de formation, Naissance de l’urbanisme dans la vallée du Nil12 et Grandes villes de l’Égypte antique13, bien que s’intéressant explici-tement à la question de l’urbanisation de la vallée du Nil tendent à s’intéresser plus globalement à la question de la vie quotidienne des anciens égyptiens qu’à la question de la ville en elle-même.
Ainsi, la majorité de la littérature traitant du sujet est-elle de na-ture archéologique et les ouvrages dits de vulgarisation sur ce thème sont rares ou inexistants. Il s’agit principalement d’actes de confé-rences ou de colloques où l’état de la question de la ville en Égypte Ancienne est débattu parallèlement à la question de l’urbanisation du Moyen Orient de façon générale. Les ouvrages traitant de la morpho-logie urbaine sont plus rares et en général axés sur l’architecture de l’habitat égyptien et les plans de maisons ou de palais y sont retirés de leurs contextes immédiat. Il est clair que la littérature archéologique tend généralement à s’intéresser soit à la gestion du territoire dans son ensemble (c’est le cas des ouvrages traitant de l’Histoire de l’Égypte par exemple), soit à la question de la vie quotidienne via l’architec-
11 Moreno Garcia Juan Carlos, 199912 Sée Geneviève, 197313 Sée Geneviève, 1974
ture des habitats antiques. Il y a ainsi clairement une échelle urbaine inexplorée entre ces deux thèmes, celle des relations conceptuelles ou fonctionnelles au sein de la ville. De même, la question de l’évolu-tion temporelle des établissements urbains est rarement traitée, et si l’on peut parfois dégager des grandes périodes il s’agit avant tout de reconstitutions hypothétiques, mais la dynamique d’évolution n’est jamais abordée.
Problématique et méthodologie
L’ensemble de ces sources permet de mettre en avant plusieurs postulats concernant le fait urbain en Égypte Ancienne. Première-ment, l’analyse globale de l’histoire de la civilisation égyptienne permet de certifier l’existence de villes. Par ville, il faut entendre un établissement humain faisant office de pôle théologique, dont les habitants ont développé à la fois une sensation d’appartenance et adopté un mode de vie différent de celui de la population paysanne14. Ces villes constituaient le lieu de vie d’une partie de la population égyptienne. Le second postulat est que les égyptiens partageaient une culture commune du nord au sud du pays, ce qui permet de généra-liser à l’ensemble du pays les schémas développés sur un site15. Ain-si peut-on minimiser les variations de cultures au sein du territoire,
14 Cette définition découle d’une part de l’entrée «Ville» du Dictionnaire de l’Urbanisme (Choay Françoise, Merlin Pierre, 1988) mais également de l’étude sur des Éloges de la Ville (Ragazzoli Chloé, 2008). Elle a l’avantage de ne pas chercher à définir la ville par une densité difficile à estimer ou par une population supérieure à celle du simple village. Plutôt que de chercher à définir la ville égyptienne comme une entité politique, à la manière des cités grecques, on s’attarde plus sur l’impor-tance cultuelle.
15 Discutée dans Kemp Barry John, 1992 (2006), pp. 19-33, l’existence d’une nation égyptienne, partageant des traits culturels communs et une identité de groupe semble acquise aux yeux de cet auteur, il est donc possible d’en faire un postulat simplificateur pour cette étude.
16 17
URBANISME INSOUPÇONNÉ INTRODUCTION
inévitables, dues à l’éloignement de certains sites de la capitale de l’empire, ou au brassage des cultures aux frontières. Enfin, on peut supposer que la façon d’organiser la ville était une expression de la culture égyptienne, c’est à dire que malgré les particularismes locaux dus au site en lui-même, la construction observée découle d’un savoir faire égyptien, qu’il soit issu d’une pratique empirique ou d’une vraie théorie.
L’étude du sujet recouvre donc deux aspects, le premier concer-nant les caractères communs à l’ensemble des villes en Égypte au Nouvel Empire, et le second s’intéressant aux caractéristiques de l’urbanisme égyptien, dans son sens de processus - planifié ou non - d’aménagement de l’espace. Dans le détail, cela implique de s’inter-roger sur l’existence de schémas d’organisation récurrents, de formes urbaines redondantes ou de plans types d’une ville à l’autre, mais également de comprendre l’évolution de la ville dans le temps et dans l’espace, c’est à dire du processus d’urbanisation. Pour reprendre un mot cher aux architectes, il s’agit de s’intéresser à la façon de «proje-ter» la ville en Égypte au Nouvel Empire.
Le projet est le cœur du travail de l’architecte et de l’urbaniste et est une véritable démarche scientifique qui consiste à penser un objet (que ce soit un bâtiment, un quartier urbain ou une ville toute entière) en terme de processus non linéaire. Ce processus consiste en différentes étapes parmi lesquelles comprendre son environne-ment, formaliser le rapport entre un édifice et cet environnement, mettre au point ou comprendre un programme, l’appliquer, définir un vocabulaire architectural, etc. Dans le cas de la ville en Égypte Ancienne, effectuer un projet urbain «à la manière» peut donc per-mettre reconstituer un processus de création utilisé il y a plus de trois mille ans et d’en étudier les différentes étapes en détail. Cette volonté forte de se replacer mentalement dans le contexte de l’époque oblige à comprendre les questions que se posèrent les concepteurs des villes d’Égypte Ancienne. La méthodologie employée consiste donc à éla-
borer un projet urbain sous la forme d’un modèle synthétique de ville dans le contexte géographique, historique, social et culturel de l’Égypte Ancienne.
Afin d’assurer une forte contextualisation de ce projet urbain (et ainsi de s’assurer qu’il s’agit bien de la constitution d’une ville à la manière des Anciens Égyptiens et non à la manière d’un architecte contemporain), l’ensemble sera accompagné d’analyse de sources textuelles liées soit au contexte défini ci-dessus, soit à la ville en elle-même (rapports de fouilles, articles ou publications scientifiques). Une analyse typo-morphologique d’ensembles urbains d’époque, identifiés comme pertinents au regard du problème posé, viendra compléter et renforcer chaque étape du projet qui sera ainsi précisée, et dessinée.
Sur la base de cette méthodologie, le développement du mémoire suivra la trame de développement d’un projet urbain telle que définie par David Mangin et Philippe Panerai16. L’objectif n’est pas d’appli-quer la théorie de ces auteurs à l’urbanisme en Égypte Ancienne, mais de s’assurer que, via une démarche cohérente et accessible, l’ensemble des thèmes d’un projet urbain soit traité. Ainsi, précédé d’un rappel culturel et historique sur l’héritage de la ville au Nouvel Empire, le projet se déroulera-t-il selon les étapes suivantes :
I. Fonder une villeCette première partie vient définir l’ensemble des contraintes
du projet urbain global, elle s’intéresse à l’environnement du projet, à son contexte politique, historique et culturel. Il s’agit également de mettre en évidence les acteurs d’un projet urbain en Égypte An-cienne. Cette phase est essentielle car le choix des objectifs (qu’ils soient défensifs, constructifs, politiques, etc.) influence a priori la ty-pologie urbaine, de même que le choix d’un site.
16 Mangin David, Panerai Philippe, 1999
18 19
URBANISME INSOUPÇONNÉ INTRODUCTION
II. Espaces privés : l’échelle parcellaireCette échelle fait intervenir la très grande variation dimension-
nelle des parcelles17 observées dans les ensembles urbains égyptiens et les constructions qui s’y implantent. On s’intéresse dans cette partie à la façon dont les égyptiens occupaient l’espace, c’est à dire, sans rentrer dans le détail de l’organisation interne d’un logement - qui sort de l’objet de cette étude - comment la dimension des parcelles influence l’organisation globale du bâti qui s’y trouve.
III. Espaces publics : rues et placesDans cette partie, l’objectif est de produire un panorama des
types d’espaces publics18. Si la place semble peu usitée dans les tissus urbains de l’Égypte Ancienne, la voie de circulation revêt des formes différentes : voies processionnelles, avenues, rues, venelles. De même, les dispositifs qui occupaient une partie de ces espaces (drains, bas-sins, mangeoires, etc.) méritent d’être relevés.
IV. Le tissu urbain : l’îlotSuite logique des thèmes précédents, cette partie cherche à mettre
en évidence les variations parcellaires au sein d’un îlot en Égypte Ancienne, mais également les différentes hiérarchies de voiries qui peuvent l’entourer.
V. Objets repèresLe commerce tel qu’on le connaît (fait de magasins ayant pi-
gnons sur rue) devait avoir une place mineure dans le tissu urbain
17 Lié au cadastre, le parcellaire est aujourd’hui fortement attaché à des considérations juridiques ou d’imposition. Les mots «parcelles» et «parcellaires» resteront cependant dans tout cet ouvrage simplement utilisation dans leur accep-tation de «découpage du sol».
18 Le terme «d’espace public» recouvre des réalités multiples, et il doit être compris ici, comme l’ensemble des espaces publics destinés à la circulation de tous. On se référera à l’article «Espace Public» de Choay Françoise, Merlin Pierre, 1988 pour un inventaire des différents sens de cette expression.
dans cette civilisation de troc. En revanche, des activités liées au «ser-vice public», telles que les greniers, les administrations, les casernes militaires et mêmes certaines industries (bière, pain, tissus notam-ment) devaient prendre place au cœur de la ville et se démarquer par une forme bâtie différente. Il s’agit donc de comprendre la position de ces équipements et leur influence sur le tissu urbain en tant qu’ob-jets repères. Parmi toutes ces activités, le temple avait une importance toute particulière qu’il convient d’étudier également.
VI. Tracés à l’échelle de la villeCette échelle traite de la ville dans son ensemble, et comment
les tracés de voirie ou de parcellaires sont positionnés dans un site donné, en réponse à cet environnement. Ils sont en effet dépendant de la déclivité du terrain, de l’existence éventuelle de cours d’eau, de la recherche d’une orientation idéale par rapport au vent ou au soleil, etc. Cette étape étudie également la variation des tracés au contact d’objets majeurs du tissu urbain comme les temples, reposoirs de barques, palais ou bâtiments administratifs.
Une fois le plan global d’une ville ainsi établi, il est intéressant de chercher à comprendre comment celui-ci peut se comporter à l’épreuve du temps. Il s’agit d’abord de comprendre comment le chantier de ville s’organise, quelles sont les priorités des constructeurs égyptiens, mais également d’imaginer une évolution de certains de ses composants parmi lesquels le temple, qui a tendance à s’agrandir avec le temps vient peu à peu empiéter sur le bâti qui l’entoure. L’ambi-tion de ce travail est d’apporter de nouvelles pistes pour l’analyse des vestiges urbains en Égypte Ancienne et constitue ainsi une approche différente d’étude de l’urbanisme égyptien antique.
21
Les hommes vivent aujourd’hui dans un monde profondé-ment urbain qui implique que pour chacun d’entre eux ou presque, l’idée de la ville renvoie à tout un imaginaire qui correspond peu ou prou aux mégapoles qui ont émergé au XXème siècle. Celles-ci sont faites de béton, de verre, d’acier, d’asphalte, elles doivent répondre à des plans d’urbanisme, à des réglementations incendie, de mobilité et elles sont faites par des ingénieurs, des urbanistes ou des architectes. Les égyptiens du Nouvel Empire, de tous ces termes, ne connaissaient que l’architecte. De fait, l’écart civilisationnel, temporel et culturel qui sépare l’homme moderne des égyptiens prend des proportions d’au-tant plus imposantes. Il est donc nécessaire de s’intéresser d’abord à la notion de «ville» pour les anciens égyptiens, avant d’éclaircir leur contexte géographique, culturel et surtout, historique.
«Ville» en Égypte Ancienne
22 23
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
Qu’est-ce qu’une ville ?
Lorsqu’on s’intéresse à la morphologie de la ville dans l’Égypte Ancienne, il paraît évident qu’un travail de définition et de contex-tualisation sont à entreprendre afin de percevoir toute la complexité de la notion de ville dans le quotidien d’une population vivant il y a trois à quatre millénaires en Égypte. Deux moyens existent pour s’intéresser à la question de l’existence d’un concept de ville en Égypte Ancienne. Le premier consiste à comprendre la définition actuelle du mot «ville» et d’essayer de la placer sur les agglomérations antiques. La seconde consiste à s’intéresser à la vision des égyptiens de leur propre lieu de vie.
La notion de ville, au XXIème siècleSitôt que l’on se penche sur la définition moderne d’une ville,
on se heurte à des problématiques parfois insurmontables pour tenter d’appliquer cette définition à l’Égypte Ancienne. En effet, le Dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement donne la définition suivante : «Trois conditions sont indispensables pour qu’un établis-sement humain constitue une ville : l’agglomération de construc-tions [...] ; certains traits sociaux de la population [...], la diversité aujourd’hui [...] et les activités de relations [...] ; une certaine dimen-sion.»19 Bien sûr, l’agglomération de constructions est une propriété facilement transposable à la vallée du Nil, les sites fouillés montrant clairement une continuité du tissu bâti.
Pour qu’une agglomération soit une ville, sa population devrait présenter certains traits comme la diversité sociale, mais également la diversité des activités exercées par sa population. Rappelons qu’une grande majorité de la population égyptienne vit alors de l’agriculture, les populations des villes étant de facto une certaine élite amenée à gouverner, ou la population servant cette élite. Cependant, certaines
19 Choay Françoise, Merlin Pierre, 2010, p. 822
agglomérations étaient construites dans un but bien précis, limitant fortement la diversité de la population. Kahoun, par exemple, était un ensemble abritant une population parfois décrite comme entière-ment dédiée à la construction de la pyramide ou au culte de Sésos-tris II. Sa population estimée entre 3000 et 5000 habitants20 en fait une agglomération majeure de l’Égypte Ancienne, mais le manque de diversité ferait de Kahoun une grosse agglomération, pas une ville.
La taille de la population, qui caractérise la dimension d’une ville plus que son étalement géographique, est un point essentiel dans le monde d’aujourd’hui pour caractériser le passage du simple village à une ville. En France, l’INSEE fixe la limite inférieure de population d’une ville à 2000 habitants, en gardant un rapport similaire entre la population totale du pays et la taille minimale d’une ville, une ville en Égypte Ancienne devrait avoir une population d’au moins 95 ha-bitants21. Plus que ce chiffre dérisoire, le vrai problème consiste avant tout à évaluer la population abritée par des ensembles bâtis. D’une part, il est particulièrement malaisé d’estimer le nombre d’habitants d’une habitation dont on ne conserve souvent que le plan du rez-de-chaussée, parfois incomplet. D’autre part, afin de palier à cette difficulté, il est d’usage d’utiliser la densité du Caire au XIXème siècle (de 625 habitants par hectare) dont l’organisation serait similaire aux quartiers antiques22. Cette comparaison de l’organisation et de la den-sité ne semble pas pouvoir résister à l’analyse approfondie des tissus urbains qui ont des différences notables.
Si l’on exclu l’agglomération de constructions, la notion contem-poraine de «ville» n’est donc pas transposable telle quelle aux établis-sements humains antiques en Égypte Ancienne, il convient donc de s’interroger sur l’avis des égyptiens eux-même sur ce sujet.
20 Vandersleyen Claude, 2007, p. 8421 La population totale de l’Égypte durant la période antique aurait varié
selon Kemp Barry John, 1992 (2006), p. 56 entre un million d’habitants au début de la période dynastique, à près de cinq millions à la fin de la période romaine.
22 Soulié Daniel, 2002, p.69
24 25
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
La notion de ville, au XVème siècle avant notre èreDans la langue égyptienne classique, appelée Moyen-Égyptien,
et parlée de 2200 avant notre ère à 400 après Jésus Christ23, on trouve trois termes se rattachant directement à la notion d’agglomération, chacun avec son sens particulier : njw.t, wH.yt et dmj24. Ils se tra-duisent respectivement par «ville», «village» et «quartier», mettant ainsi en avant une différenciation dans la langue égyptienne entre des ensembles urbains de taille différente. Le vocabulaire égyptien sépare également des ensembles urbains ayant des rôles différents, comme le xtm, la place forte, ou Xnw, la Résidence25, c’est à dire la localité qui abrite en son sein le pouvoir royal, servant de capitale politique au pays. Cependant, les égyptiens eux-même paraissent avoir eu des dif-ficultés à placer une agglomération dans un type précis de sorte que la capitale, Thèbes, se retrouve classée parmi les villages dans certains documents du Nouvel Empire26.
Quoiqu’il en soit, le système d’écriture hiéroglyphique fixe la no-tion d’agglomération avec un déterminatif27 figurant deux routes se croisant à angle droit (Cf. Fig. 1). Il est défini comme représentant un plan de ville et détermine les mots en rapport avec l’agglomé-ration, le pays ou la région28. Plus que la diversité des mots utili-sés dans la langue égyptienne, ce hiéroglyphe marque dans l’écriture l’idée même de la ville et de l’urbanisme : deux routes, deux espaces publics, qui se croisent. Il semble donc que pour l’égyptien, la ville soit avant tout un lieu de rencontre, où des personnes issues de che-mins différents peuvent partager un même espace et l’on en revient à la définition de Françoise Choay pour qui la ville naît des besoins
23 Grandet Pierre, Mathieu Bernard, 1993 (2003), p. 924 Bonnamy Yvonne, Sadek Ashraf, 201025 Bonnamy Yvonne, Sadek Ashraf, 201026 Soulié Daniel, 2002, p.6827 Les déterminatifs sont des signes qui ne servent qu’à «préciser visuel-
lement le sens des mots auxquels ils sont joints» [Grandet Pierre, Mathieu Ber-nard, 1993 (2003), p. 13], ils ne possèdent pas dans cet usage de valeur phonétique.
28 Grandet Pierre, Mathieu Bernard, 1993 (2003), p. 36
Fig. 1 : Ce signe sert à préciser le sens des mots liés à la ville. (Source : logiciel JSesh)
26 27
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
d’interactions des gens29. La ville n’est pas seulement un lieu destiné à habiter, mais également à circuler. Ainsi, le déplacement des biens et des personnes est-il directement suggéré par la présence des deux rues. Ce signe apparaît également dans l’écriture du mot citadin, ac-compagné du signe figurant un homme assis. La variété des usages de ce signe montre qu’il se rapporte à la fois aux notions d’espace délimité (pays, ou nomes30), et aux notions de lieu de vie sur terre ou dans l’au-delà (citadins, nécropole).
Dans les éloges de la ville, des poèmes écrits au Nouvel Empire, les égyptiens lettrés mettent en évidence ce qui pour eux fait la ville : un certain statut social31 et un rattachement à une divinité qui en fait idéologiquement le centre de l’Égypte et du monde32. La ville semble alors être pour l’égyptien du Nouvel Empire le lieu où l’on est «chez soi» en tant que membre d’une catégorie sociale supérieure. Elle se-rait un établissement humain doté d’un rayonnement théologique au moins à l’échelle du nome si ce n’est à l’échelle de l’Égypte entière et dont les habitants ont développé à la fois une sensation d’apparte-nance et un mode de vie différent de celui de la population paysanne.
29 Choay Françoise, Merlin Pierre, 2010, p. 82230 Les nomes sont des subdivisions administratives du territoires égyptien,
instituées dès les premiers temps de l’histoire égyptienne.31 Ragazzoli Chloé, 2008, p. 16632 Ragazzoli Chloé, 2008, p. 170
L’Égypte, un contexte unique
La ville en Égypte Ancienne tire sa morphologie de contextes géographique, culturel et historique bien définis qui, tous trois, ont sans aucun doute participé à élaborer un type urbain particulier.
Le Nil, au coeur de la civilisation égyptienneD’une longueur d’environ 5600 kilomètres, le Nil traverse
l’Égypte du nord au sud. Il est indissociable de la civilisation égyp-tienne dans la mesure où il lui apporte à la fois de quoi prospérer et est à l’origine de toutes ses particularités. D’une part, si le territoire de l’Égypte est principalement désertique et montagneux, le Nil et sa vallée verte sont les seuls portions cultivables du territoire... et donc le lieu quasi unique de l’implantation humaine du pays. La vallée du fleuve est limitée à l’est par le désert arabique, montagneux, qui s’étend jusqu’à la mer rouge, et à l’ouest par la chaîne libyque33. La crue du fleuve était accompagnée d’un phénomène unique, le dépôt d’un limon très fertile sur les terres longeant son cours, permettant une agriculture très productive. Il a rapidement été nécessaire pour les égyptiens de s’installer sur des levées de terres, ou d’organiser des digues autour des établissements humains, afin de s’affranchir de l’inondation et ainsi éviter que les villes et villages soient détruits par le Nil lors de sa crue.
Le cours du fleuve lui-même est à l’origine de la subdivision du territoire en deux parties administratives. La Basse Égypte correspond à l’ensemble du delta nilotique, la région est principalement humide et marécageuse et contraste fortement avec la Haute Égypte. Celle-ci est principalement désertique et sa seule zone de fertilité est, on vient de le voir, la vallée du Nil. Enfin, le Nil délimite du nord au sud le territoire d’une façon plus conceptuelle : la rive ouest, le désert, est généralement associé au royaume des morts car c’est là que le soleil
33 Goyon J-Claude et al., 2004, p. 59
28 29
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
se couche. Avec un raisonnement similaire, la rive est est associée au monde des vivants car le soleil s’y lève. Cette idée, bien que se vérifiant dans des villes comme Thèbes, ne résiste pas à l’approche systématique puisque de nombreuses villes ont été construites sur la rive ouest du fleuve. C’est le cas notamment d’Edfou, dès l’Ancien Empire, de Deir el-Ballas au Nouvel Empire ou de nombreuses for-teresses.
Contexte géopolitique La situation géographique de l’Égypte place le pays de facto au
carrefour entre plusieurs cultures et flux de biens et de personnes. Si cette implantation a sans doute permis à la civilisation de profiter des apports de ses voisines, elle a toujours été un risque d’invasion. Au sud, l’Égypte est bordée par la Nubie, un territoire tantôt direc-tement rattaché au royaume (c’est le cas au Nouvel Empire où il est administré par le vice-roi de Koush), tantôt complètement indépen-dant (à la fin du Moyen Empire notamment, où le royaume prend possession de certaines forteresses égyptiennes34), dont les richesses en or intéressent particulièrement l’Égypte. À l’ouest, les libyens et nomades bédouins sont connus pour leurs raids sur les établissement égyptiens dans le désert35 (certains oasis sont en effet des postes égyp-tiens avancés).
À l’est, la situation est plus complexe et les pouvoirs locaux sont relativement peu stables mais l’Égypte cherche sans cesse à défendre ses intérêts commerciaux dans cette région (c’est en tous cas l’image renvoyée par la correspondance entre le roi d’Égypte et les différents intermédiaires dans cette région36). C’est du Moyen Orient que viendront pourtant les Hyksôs qui «envahiront» l’Égypte pendant la deuxième période intermédiaire, ou les Hittites, contre qui se battra Ramsès II. Au nord, la mer Méditerranée est assez peu propice aux
34 Vandersleyen Claude, 1995, p. 20235 Manley Bill, 1996 (1998), p. 4336 Vandersleyen Claude, 1995, pp. 376-379
contacts de civilisations avec l’Égypte et il ne semble pas que le pays ait eu directement des contacts via la Méditerranée même avec l’ar-rivée des Peuples de la Mer aux portes du pays, qui sont vraisembla-blement passés de la Méditerranée en Égypte via le Moyen Orient37.
Technique et culture de l’Égypte AncienneLa géographie de l’Égypte a rendu disponible au peuple égyp-
tien un ensemble de matériaux dont la civilisation a su exploiter les qualités et les limites au mieux. Les formations géologiques le long du Nil renferment une certaine diversité de pierres parmi lesquelles quartzite, granites, calcaire, grès, etc. Leur utilisation en architecture est quasi-systématiquement réservée aux monuments qui devaient d’une part résister aux assauts du temps, et d’autre part être les seuls à bénéficier des ressources et de la main d’œuvre nécessaire pour en-treprendre l’acheminement de pierres parfois venues de carrières re-lativement lointaines38. La pierre est donc globalement absente de la construction des villes, mais certains éléments, comme les seuils et encadrements de portes ou les bases de colonnes, devaient nécessiter la résistance de ce matériau.
La brique, en revanche, est le matériau de prédilection de la construction urbaine en Égypte Ancienne. Sa composition, dans des proportions fortement variables (limon déposé par le Nil à la fin de la crue, du sable, de la paille hachée et des tessons concassés39) en faisait un matériau peu onéreux, tandis que n’étant pas cuite, elle ne nécessitait que peu de main d’œuvre. Les dimensions de la brique qui oscillent fortement d’un site à l’autre, et même au sein d’un même site (à Deir el-Medineh40 par exemple la taille des briques varie entre 28×13×9 cm et 42×19×15 cm), permettaient son transport à dos d’homme sans nécessiter d’engins de levage. La construction en
37 Manley Bill, 1996 (1998), p. 9738 Goyon J-Claude et al., 2004, pp. 141-17439 Goyon J-Claude et al., 2004, p. 10540 Bruyère Bernard, 1939, p. 24
30 31
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
brique elle-même possède des caractéristiques communes en Égypte Ancienne qui sont de faibles fondations, des murs d’une épaisseur avoisinant les cinquante centimètres et un appareillage en carreau ou en boutisse en assurant le croisement des joints pour assurer l’intégri-té structurelle de la construction. Enfin, le mur était recouvert d’un enduit de terre, peint ou non suivant la qualité de la construction41. Évidemment, la brique crue a comme inconvénient de nécessiter un certain entretien pour que sa solidité soit assurée. En fait, la recons-truction de certaines parties des habitations était l’occasion de faire correspondre la construction avec de nouveaux besoins. La destruc-tion des ensembles urbains et la reconstruction, sur place, amenait à une élévation globale du niveau de la ville qui, au fil des millénaires, a fini par la faire s’élever comme une véritable colline au dessus des plaines environnantes appelée tell42.
Le climat aride de l’Égypte ne permet pas à des essences de grands arbres de pousser sur le territoire. De toutes les espèces qui poussent sur les bords du fleuve, seul le palmier a réellement trouvé sa place dans la construction. Son tronc résistant permettait son utilisation comme poutre soutenant le plafond, ou comme colonne43. Les pièces de bois plus imposantes étaient importées du Liban ou de Nubie44 mais étaient en général réservées au mobilier ou à la construction de navires, réservant ainsi majoritairement le domaine de la construc-tion à la pierre et aux briques.
À ces particularités de disponibilités de matériaux s’ajoute celles d’une civilisation parmi les plus prospères du bassin méditerranéen. Il convient de rappeler que la civilisation égyptienne, et particuliè-rement les grandes secteurs d’activité, revêt un caractère étatique de sorte que l’ensemble des grands travaux, des activités commerciales ou militaires est géré par un corps de fonctionnaires qui dépendent
41 Goyon J-Claude et al., 2004, pp. 110-11142 Goyon J-Claude et al., 2004, p. 11043 Vercoutter Jean, 1992, p. 4544 Vercoutter Jean, 1992, p. 44
d’un pouvoir central45. L’influence de cette organisation sur la ville égyptienne est notable, dans la mesure où cela implique une culture des grands travaux, menant à la construction de ville ou de quartiers ex-nihilo. Il y a donc une culture de la ville nouvelle en Égypte An-cienne.
La population de l’Égypte Ancienne reste globalement paysanne, et donc peu ou pas concernée par les villes, l’importance du secteur agricole est capitale pour la survie et la prospérité de l’État égyptien46. De fait, la population rurale a plutôt tendance à s’organiser en petits villages permettant un accès facile aux champs qu’elle exploite, ou plus simplement en petits domaines composés d’une habitation en-tourée de ses champs. Néanmoins, la taille réduite de ces domaines, d’environ 2500 à 8000 mètres carrés47 permet d’imaginer un tissu de petits domaines semblables sur certains points à celui de nos ban-lieues résidentielles composées de maisons et de jardins. Les autres secteurs d’activités, comme les activités artisanales ou intellectuelles, pouvaient prendre place au cœur de la ville.
La culture égyptienne ne peut pas être dissociée de ses croyances en une vie après la mort, certes, mais surtout en une multitude de divinités. L’importance de ces divinités, et ainsi des clergés qui leur vouaient un culte mène à la création d’entités économiques et poli-tiques dont le pouvoir est parfois susceptible d’éclipser celui du roi. Les établissements humains dans la vallée du Nil sont quasi-systéma-tiquement liés à un lieu de culte qui semble fournir certains services «publics» comme la justice48 ou l’approvisionnement en denrées.
45 Gros de Beler Aude, 2006, p. 12546 Gros de Beler Aude, 2006, pp. 126-12747 Gros de Beler Aude, 2006, p. 13048 Cabrol Agnès, 2001, p. 735
32 33
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
Trois mille ans d’évolution de la ville
Les premiers établissements humains attestés dans la Vallée du Nil remontent à plus de 120 000 ans avant Jésus-Christ49. Autant dire que l’occupation de ce territoire par l’homme est une histoire an-cienne. Certains traits de la civilisation pharaonique se lisent déjà vers environ 5000 ans avant Jésus Christ. De cette période jusqu’au début de l’unification du territoire égyptien par le roi Narmer (vers 3000 av. J-C), les exemples d’urbanisme sont quasi inexistants. Pourtant, c’est à cette période que se seraient fondés les premiers centres pro-to-urbains comme Abydos, Coptos, Nekheb, Edfou et Éléphantine50. Parmi les rares vestiges de villes qui ont été conservés, l’enceinte cir-culaire de la ville de Nekheb, d’un diamètre d’environ 400 mètres, donne une idée de l’importance des cités fortifiées de l’époque51 (Cf. Fig. 2).
Le roi Narmer est crédité par les égyptiens eux-même de la fon-dation d’un royaume uni de Haute et Basse Égypte et de la création de la ville de Memphis, qui restera longtemps la capitale politique du pays. Pour ce faire, il aurait élevé une digue à l’entrée du Delta du Nil (plus connue sous le nom de Mur Blanc), asséché les terres laissées par le fleuve et posé les fondations du temple de Ptah52, dieu de la créa-tion, qui deviendra un des principaux lieux de culte du pays. Il s’agit là sans doute du premier exemple d’édification d’une nouvelle ville par ordre royal. Les raisons de cette décision sont multiples mais on peut penser que pour asseoir son pouvoir sur l’ensemble du territoire nouvellement uni, le roi a souhaité créer une ville qui soit à la fois la charnière entre les deux Égypte, et signifier par ce geste le début d’une nouvelle ère.
49 Vercoutter Jean, 1992, p. 10750 Vercoutter Jean, 1992, p. 17451 Monnier Franck, 2010, p. 17552 Vercoutter Jean, 1992, p. 208
Nil
N 0 100 200 300 400 m1/10000
Fig. 2 : Les enceintes de la ville de Nekheb. En orange, l’enceinte circulaire telle que dégagée et son tracé hypothétique. (Source : d’après Depuydt Frans, 1989)
34 35
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
Narmer a fait rentrer l’Égypte dans la période appelée dynastique : le pouvoir royal est suffisamment fort et organisé pour contrôler l’en-semble du pays. L’architecture citadine est connue partiellement par quelques sites fouillés, parmi ceux-ci, le site de Hiérakonpolis offre un bon exemple de l’organisation de la ville dans son enceinte. Elle marque un changement important dans la conception de l’architec-ture égyptienne, celui du passage d’ensembles proto-urbains de basse densité à celle d’une véritable ville de brique avec une densité bien plus forte53. Les caractéristiques de cette ville sont la présence d’un mur d’enceinte de forme géométrique rectangulaire, et celle d’une porte, qui présente une organisation typique, dite en façade de pa-lais. La construction de ce mur d’enceinte pour les villes de l’Ancien Empire, dont la forme n’est jamais identique, révèle qu’il s’agit là d’une initiative locale car certaines enceintes sont arrondies, tandis que d’autres sont composées de murailles rectilignes. Les directions du bâti ont tendance à suivre celles des murs d’enceinte de la ville.
S’étendant d’environ 2650 av. J-C à environ 2200 av. J-C, l’An-cien Empire est l’époque de la construction des pyramides, qui sont peu ou prou les seuls vestiges architecturaux que cette époque a laissé. Néanmoins, certaines d’entre elles étaient accompagnées de «villes des pyramides», petits ensembles de constructions adjacentes au monument qui accueillaient le personnel dédié à perpétuer le culte du défunt. Le village qui accompagnait la tombe de la reine Khe-netkaous, sur le plateau de Gizeh, permet par exemple de juger de l’organisation régulière des logements (Cf. Fig. 3). La fin de l’Ancien Empire est marquée par une diminution de la puissance du pouvoir royal, ce qui permet à de nombreux pouvoirs locaux de se mettre en place et le renforcement induit du rôle des villes de province mène à une poussée démographique de celles-ci54.
53 Kemp Barry John, 1992 (2006), p. 8154 Kemp Barry John, 1992 (2006), p. 194
Fig. 3 : Organisation des logements (en haut) et parcellaire associé (en bas) aux loge-ments du complexe funéraire de Khenetkaous. (Source : d’après Kemp Barry John, 1992 (2006))
N 0 10 20 30 40 m1/1000
36 37
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
Fig. 4 : Trois systèmes parcellaires issus de sites du Moyen Empire. Sur chacun de ces plans sont représentés trois îlots «typiques». Les dimensions des parcelles oranges sont les suivantes : 4.1 - env. 63 m2 ; 4.2 - env. 25 m2 ; 4.3 - env. 850 m2. (Source : Paul François)
N0 20 40 60 80 m1/2000
N0 20 40 60 80 m1/2000
N0 20 40 60 80 m1/2000
Fig. 4.1 : Kahoun
Fig. 4.2 : Tell El-Dab’a
Fig. 4.3 : Wah-Sut
La montée sur le trône de Mountouhotep vers 2150 av. J-C en-tame le Moyen Empire. Cette époque est marquée par un certain raf-finement dans l’ensemble des productions artistiques, architecturales ou culturelles55. Si les souverains continuent d’édifier des pyramides, elles ne sont plus faites de pierres, mais de briques, une économie de moyens qui n’empêche pas le développement d’une technique artis-tique poussée de la taille de la pierre.
En ce qui concerne la ville, les exemples préservés sont plus nom-breux qu’à l’Ancien Empire et trois villes nouvelles construites sur un territoire vierge montrent une organisation rationnelle en damier : la ville de Kahoun, de Tell el-Dab’a et celle de Wah-sut à Abydos (Cf. Fig. 4). La première ville est de loin la plus intéressante, de même que les villes des pyramides, elle a été conçue dans le but de permettre la continuation du culte du roi défunt. Une portion relativement importante de son plan est connue, environ 50%, ce qui permet le calcul de la population, estimée à environ 3000 habitants56. Les deux autres villes, Wah-Sut et Tell El-Dab’a montrent une organisation semblable, ces trois villes ayant un plan en damier, des parcelles de di-mensions carrées, et un découpage des îlots homogène. Néanmoins, on trouve une grande disparité dans les dimensions de ces éléments qui prouvent que même si dans une même période, et sur des lieux différents du territoire, on trouve des villes nouvelles ayant des points commun, il n’y a pas de règles dimensionnelles fixes.
Le Moyen Empire se termine vers 1750 av. J-C dans des condi-tions similaires à celles de l’Ancien Empire. La faiblesse de l’état per-met cependant à des peuplades venus du nord-ouest de s’installer en Égypte durablement, les Hyksôs.
Le Nouvel Empire doit sa fondation à l’éviction par les princes thébains des souverains Hyksôs vers 1550 av. J-C, et donc au retour d’une domination du pays par des rois égyptiens. Cette invasion
55 Grimal Nicolas, 1988 (2005), p. 22856 Kemp Barry John, 1992 (2006), p. 217
38 39
URBANISME INSOUPÇONNÉ «VILLE» EN ÉGYPTE ANCIENNE
est sans doute un facteur déclencheur de l’extraordinaire expansion du territoire Égyptien, tant au sud, en Nubie, qu’à l’est et au nord. En fait, la taille du territoire ainsi acquis au Nouvel Empire fait du royaume un territoire extrêmement riche et particulièrement stable qui joue un rôle majeur dans la géopolitique du Moyen Orient57. Cette richesse se caractérise d’un point de vue de l’urbanisme par le développement d’un type urbain particulier, appelé «Ville Royale» qui semble marqué par l’imbrication au sein d’un système construit cohérent de bâtis liés au culte divin, mais également à l’expression du pouvoir royal via le palais. Malgré l’apparente stabilité de l’empire pendant cette période, la succession des dynasties (une première dy-nastie, ou famille, issue de Thèbes, puis une dynastie issue du nord, d’origine militaire) est marquée par une rupture majeure, le règne du roi Akhenaton. Ce règne a livré un des exemples les plus complets d’organisation urbaine au Nouvel Empire, grâce au développement dans une période très courte puis à l’abandon de la ville d’Akheta-ton. Les particularités du règne de ce roi, d’un point de vue théolo-gique notamment, nécessitent néanmoins d’éviter de prendre cette ville comme la norme sans démonstration de l’existence, ailleurs, de principes urbains similaires. Vers la fin du Nouvel Empire, le point focal du royaume se déplace vers le nord est de l’empire, impliquant la construction de nouvelles capitales : Pi-Ramsès, d’abord, puis Tanis au début de la Troisième Période Intermédiaire. L’ensemble du Nou-vel Empire est la période de référence pour les différents exemples d’urbanisme qui suivront, sauf mention contraire.
À partir de la Troisième Période Intermédiaire, l’Égypte traverse une longue période pendant laquelle le pouvoir est souvent divisé, et même aux mains de dynasties étrangères. Les brassages culturels se font ainsi plus importants ce qui a pour conséquence de transformer également les habitudes constructives. Poussée à l’extrême, le contrôle du territoire égyptien par les Lagides suite à la conquête du territoire
57 Grimal Nicolas, 1988 (2005), p. 286
par Alexandre Le Grand transforme définitivement l’urbanisme : Alexandrie d’Égypte est ainsi une nouvelle ville conçue sur des bases complètement issues de l’urbanisme hellénique.
41
Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Toutes les villes d’aujourd’hui sont issues d’un ensemble de circons-tances qui, à un moment donné de l’histoire ont concouru à ce qu’une famille décide de s’installer à un endroit précis, à ce qu’un général décide d’établir un campement ou qu’un roi souhaite construire une nouvelle capitale. L’objectif de ce chapitre est de remonter à l’instant zéro de la ville. C’est bien sûr une démarche vaine dans la plupart des cas car le temps qui passe fini par effacer les traces de ces pionniers mais il est parfois possible de comprendre leurs intentions premières. La cité que l’on peut observer grâce à des fouilles n’est peut-être ap-parue comme agglomération que des dizaines d’années, des siècles ou des millénaires après ces pionniers et toute trace de ceux-ci aura ir-rémédiablement disparu. Il y a néanmoins une catégorie de villes où l’on peut remonter de façon relativement claire à une genèse : la ville nouvelle. Décidée et conçue comme une ville dès le départ, la ville nouvelle a le mérite de figer dans l’espace les préceptes de l’urbanisme d’une époque donnée.
Fonder une ville
58 59
URBANISME INSOUPÇONNÉ FONDER UNE VILLE
Fig. 6 : Schéma axonométrique d’une portion de la Vallée du Nil montrant les posi-tions typiques d’implantation des villes le long du fleuve. (Source : Paul François)
1 - Frange désertique en surplomb de la vallée2 - Terres non recouvertes par la crue3 - Terres arables recouvertes par la crue4 - Cours du Nil5 - Ville construite sur une colline épargnée par la crue6 - Ville construite en bordure des terres arables
1 2 3 4
6
On l’a en effet déjà vu, les villes sont en effet indifféremment placées à l’est ou à l’ouest du cours du fleuve.
Matières premièresEn terme de volume, la brique crue est sans aucun doute le ma-
tériau prédominant de la construction égyptienne. Il est utilisé dans la majorité des constructions, et seuls certains éléments comme les bases de colonnes ou certains linteaux sont en pierres. L’avantage de la brique de terre crue est qu’elle peut être fabriquée sur site. Sa composition, fortement variable d’un bâtiment à l’autre, est la preuve d’une recette empirique basée sur les matières premières locales94. Les différents composants des briques de terre crue sont l’argile, le limon et le sable, ce dernier représentant près de la moitié de la masse de la brique. Ces matières sont toutes aisément récupérables sur les bords du Nil et ne présentent donc aucune contrainte particulière d’ache-minement sur le lieu du chantier.
La pierre, bien qu’en faible proportion dans le volume global construit d’une ville, n’en est pas moins présente. Les temples en sont presque exclusivement constitués de même que, comme on l’a vu, certaines parties de bâtiments privés. À l’inverse des briques de terre crue, la pierre est extraite de carrières bien précises qui fournissent chacune une qualité et un type de roche donnés. On pourrait penser que les villes se soient implantées à proximité de carrières afin de li-miter les distances à parcourir avec des chargements de pierres. Néan-moins, la superposition de la carte des principales villes anciennes en Égypte et la carte des carrières de pierres exploitées ne montre pas de corrélation probante (Cf. Fig. 7). Si la plupart des villes de Haute Égypte sont entourées de carrières, ce n’est pas le cas des villes de Basse Égypte.
En fait, il semble que les carrières de pierres aient surtout été ex-ploitées par des expéditions sous contrôle militaire qui se chargeaient
94 Nicholson Paul T., Shaw Ian, 2000, p. 81
5
60 61
URBANISME INSOUPÇONNÉ FONDER UNE VILLE
d’extraire la quantité nécessaire pour un chantier en cours95, et éven-tuellement quelques blocs de grande taille destinés à des sculptures ou des obélisques. Ainsi était-il peu important que le choix d’un site de ville se porte sur un lieu peu éloigné de carrières exploitables dans la mesure où des expéditions se chargeraient de répondre à ces be-soins. Notons cependant que le site de Tell el-Amarna semblait offrir une qualité de pierres suffisantes pour les besoins de la ville de sorte que de nombreuses carrières de taille diverse se sont ouvertes dans les collines avoisinantes96. Il n’est pas exclu que certains affleurements rocheux du désert aient ainsi pu convenir comme source de blocs de construction dans de nombreuses villes et quelques ouvriers se rendaient probablement dans les collines pour y collecter les pierres nécessaires à l’avancement du chantier, sans pour autant y créer de véritables carrières.
La question de l’approvisionnement en matériaux ne semble donc pas avoir une importance majeure dans le choix d’un site de construction. La relative facilité avec laquelle les matériaux pouvaient être extraits a rendu sa question secondaire au profit des questions plus importantes que sont la proximité avec des sources d’eau ainsi que l’existence de terres agricoles.
Pour qu’une nouvelle ville voit le jour en Égypte Ancienne, il était nécessaire qu’un certain nombre de conditions soient réunies. Si des villes spontanées sont en effet apparues au cours de l’évolution historique du pays, la ville nouvelle est un fait rare qui dépend d’une volonté administrative afin de répondre à des objectifs précis, et qui ne s’installe pas n’importe où. Les énergies nécessaires à l’établisse-ment d’une nouvelle agglomération ne pouvaient se justifier que par des arguments de poids aux yeux des anciens égyptiens, qu’ils soient d’ordre économique, technique, militaire… mais également idéolo-
95 Goyon Jean-Claude et al., 2004, p. 14296 Kemp Barry John, 2012 (2013), pp. 60-61
M e rR o u g e
Napata
Abou SimbelAniba
Éléphantine
El-Kharga
Dakhla
Farafra
Bahariya
Memphis
Tanis
Serabit el-Khadim
Timnah
Gaza
Meggido
QadeshByblos
OugaritEnkomi
Thinis
CoptosThèbes
EdfouHiérakonpolis
Abydos
Nékheb
Kahoun
Gizeh
Tell el-Amarna
M e r M é d i t e r r a n é e
Cnossos
Alexandrie
Héliopolis
Saïs
Hermopolis
Pi-Ramsès
Bouhen
Kerma
Amara
Deir el-BallasDenderah
Deir el-Medineh
SesebiSoleb
N
Fig. 7 : Carte de l’Égypte montrant la position des principales villes ainsi que les carrières de pierre de construction exploitées par les anciens égyptiens (en orange). (Source : d’après Nicholson Paul T., Shaw Ian, 2000)
62 63
URBANISME INSOUPÇONNÉ FONDER UNE VILLE
gique et religieux. Toute une organisation devait ensuite s’activer pour permettre l’accomplissement du dessein royal, malheureusement la plupart des acteurs de ces projets d’importance sont cachés derrières des titres protocolaires et pompeux qui laissent tout le bénéfice des actions au seul roi. Pourtant, entre les vizirs, trésoriers et architectes devait se partager la paternité du développement urbain et peut-être même du choix d’un site adapté aux objectifs fixés par le programme. Ce site, nécessairement en lien avec les eaux du Nil, devait également répondre à des critères stratégiques mais surtout spatiaux, permettant à une nouvelle ville de se développer dans des conditions optimales.
Projection
Un projet de ville à l’époque ramesside97 aurait ainsi porté de façon préférentielle sur un emplacement dans l’est du Delta du Nil, permettant un déploiement rapides des forces égyptiennes en Asie et d’effectuer de nombreuses commerciales avec ces pays. C’est en effet le programme de deux grandes capitales de l’époque ramessi-de et du début de la Troisième Période Intermédiaire : Pi-Ramsès et Tanis. L’idéologie et l’ego royal poussent le roi à faire de cette ville une preuve de sa dévotion envers les principaux dieux dynastiques mais également une preuve de son pouvoir et un événement histo-rique majeur. Il convient dont que le roi puisse séjourner dans cette nouvelle agglomération afin d’une part de pouvoir surveiller l’avan-cement des travaux et de mener ses armées au combat. Le secteur du delta est fait d’une multitude de petites collines qui dépassent des zones inondables, mais en bordure sud du delta, quelques plaines
97 La période ramesside, du nom de la majorité des souverains qui y ont régné, correspond à la fin du Nouvel Empire. Elle commence sous le règne de Ram-sès Ier vers 1300 avant Jésus-Christ, et se termine sous le règne de Ramsès XI. Les souverains les plus connus de cette période sont Séthy Ier, Ramsès II, Merenptah et Ramsès III.
Fig. 8 : Plan montrant le relief proposé pour le site de projet, avec ses courbes de niveau en orange, sa plaine inondable en gris clair et le bras du Nil en gris foncé. (Source : Paul François)
0 1 2 3 4 km1/100000N
64 65
URBANISME INSOUPÇONNÉ FONDER UNE VILLE
Fig. 9 : (Double page suivante) Un site typique, vierge, sur lequel pourrait se déve-lopper une nouvelle ville commanditée à la fin du Nouvel Empire. Le Nil, en crue, recouvre la plaine inondable et prend des proportions importantes. Le site, limité au sud par des falaises s’étend sur une terre majoritairement aride. (Source : Paul François)
bordées par l’extrémité nord des reliefs montagneux du désert ara-bique apparaissent et forment un emplacement idéal pour une nou-velle ville. En effet, proches des terres cultivables et à l’abri des crues du Nil, le site offre un cirque rocheux protecteur, tandis qu’il peut fournir des matières premières utiles pour les constructions les moins prestigieuses. La faille rocheuse dans la falaise à l’extrémité ouest du site offre également un lieu privilégié pour l’installation d’une nou-velle nécropole. Le paysage de la ville est profondément marqué par la présence des hautes falaises du plateau désertique, car celles-ci sont perceptibles depuis l’ensemble de la plaine et le resteront dans les rues malgré l’implantation de constructions basses. Cette limite, qui marque également l’entrée dans un paysage associé à la mort et au mal en Égypte Ancienne, pousse la ville à s’en éloigner le plus pos-sible, de sorte que son urbanisation restera cantonnée aux abords de la plaine inondable, source de vie et de richesses.
69
Il est nécessaire pour comprendre l’organisation de la ville dans son ensemble de changer complètement l’échelle de cette analyse et de se concentrer sur la plus petite unité que traitée dans cette étude, la parcelle. L’ensemble des parcelles d’une ville, qui constitue ce que l’on nomme parcellaire désigne un découpage du sol de forme très variée délimitant des secteurs qui correspondent habituellement à un propriétaire donné : une maison et son jardin entouré de murs consti-tuent une parcelle qui appartient à un propriétaire. L’intérêt de l’étude parcellaire est qu’elle tend à éviter l’étude architecturale de l’habitat égyptien qui est un sujet à propos duquel la littérature est déjà rela-tivement fournie. L’habitat a, de plus, une organisation spatiale qui découle nécessairement de la forme du parcellaire et, bien que cette relation ne soit pas bijective, l’étude parcellaire offre une précision suf-fisante pour comprendre l’organisation d’un plan de ville. Plus qu’un outil d’analyse contemporain, c’est également une notion déjà pré-sente en Égypte Ancienne, et qui, intrinsèquement ou dans sa relation avec le bâti, devait être utilisée par les architectes de l’époque.
L’espace privé : le parcellaire
93
En opposition à l’espace privé vient l’espace public : ce terme très usité dans le langage moderne de l’architecte ou de l’urbaniste n’en est pas moins une invention récente qui recouvre des réalités multi-ples. Outre une question juridique qui le défini comme appartenant au «domaine public», qui correspondrait plutôt en Égypte Ancienne aux propriétés du roi, l’espace public se définit également comme un ensemble d’espaces ouverts et extérieurs qui permettent la circulation des personnes et des biens. L’espace public est ce que les égyptiens pouvaient expérimenter d’une ville sans y résider : un ensemble de lieux qui, à moins d’une réglementation tacite dont il n’existe pas de traces, sont ouverts à tous. Si la fonction première de la voirie est évi-demment de permettre les déplacements au sein de la ville, certains es-paces publics peuvent également servir de support au commerce. Bien sûr, la conception de l’espace public, à supposer qu’elle fut envisagée ainsi, devait être extrêmement éloignée des pratiques urbanistiques actuelles, qui en font un enjeu urbain majeur, elle n’en est pas pour autant dénuée de spécificités.
L’espace public : rues et places
94 95
URBANISME INSOUPÇONNÉ L'ESPACE PUBLIC : RUES ET PLACES
Commerce et transports
En raison du fort potentiel de rencontres qu’il offre, l’espace pu-blic est le lieu privilégié d’implantation des activités commerciales. La place est ainsi historiquement, du moins en occident où elle dérive du forum gréco-romain, un lieu où l’on échange, où le commerce se fait. Malgré cela, la question du commerce en Égypte Ancienne pose parfois problème car elle semble secondaire face à un fonctionnement officiel fortement étatisé123. Pourtant, les égyptiens s’échangeaient des biens entre personnes privées et pratiquaient le commerce124.
En effet, il semble que les paysans participaient à un marché. Le mot «marché» est pris ici au sens du processus qui fait se rencontrer des vendeurs et des acheteurs. Vendeurs professionnels, officiels en-voyés par l’État pour écouler ses stocks ou propriétaires terriens ven-daient ainsi leurs produits. À chaque bien était attribuée une valeur dans une unité, la plus célèbre étant le «dében» (dbn en égyptien), ce qui permettait d’assurer l’échange de biens de même valeur. La situa-tion commerciale s’apparente ainsi à un troc, où les biens échangés le sont en passant par une unité intermédiaire, jamais matérialisée par une monnaie125.
Pour concevoir la ville, la question majeure concerne l’existence d’un marché en tant que lieu. La présence de marchés locaux im-plique l’existence d’un espace dévolu à cette activité d’achat et de vente126. S’il n’est pas possible, dans l’état actuel de nos connaissances, de connaître la fréquence de ces marchés, on peut imaginer que ceux-ci avaient lieu dans différents lieux, de manière tournante ou non. Certains textes et bas reliefs font état d’endroits où l’on pou-vait s’échanger des biens, et donc de marchés au sens d’espace : si-tués près du fleuve, ces zones d’échanges profitaient sans doute de
123 Gros de Beler Aude, 2006, p. 125124 Zingarelli Andrea Paula, 2010, pp. 14-16125 Zingarelli Andrea Paula, 2010, p. 17126 Zingarelli Andrea Paula, 2010, p. 33
cet important moyen de transport pour faire communiquer des lieux de production parfois lointains à la ville, lieu de consommation par excellence. C’est en tous cas la description qu’en font certains reliefs à Deir el-Medineh ou Dra Abou el-Naga127.
Si le commerce pouvait également avoir lieu dans la rue128, celle-ci est avant tout liée aux problématiques de transport et de déplace-ment. En Égypte Ancienne la rue est principalement traversée par des gens se déplaçant à pied, ce mode de transport étant de loin le plus répandu : pieds nu, ou en sandales pour les plus riches129. En-fin, la haute bourgeoisie pouvait éventuellement s’offrir le luxe de se déplacer en chaise à porteurs. La plupart des charges lourdes étaient quant à elles déplacées à dos d’ânes, qui est resté pendant plusieurs millénaires le moyen de transport privilégié pour les biens130. La ville s’arpente donc à pieds, ce qui limite fortement les aménagements de voirie à effectuer et impose un rapport donné entre la dimension de la ville et la perception humaine. Le temps mis pour la traverser ou pour la rejoindre depuis la campagne environnante sont des données uniquement dépendantes de la vitesse de marche d’un homme.
Venelles, rues, avenues et voies processionnelles
Parmi tous les espaces publics, on distingue deux grandes ca-tégories. La première concerne tous les espaces dont la fonction est d’abord de permettre la circulation des hommes et des biens dans les différentes parties de la ville, et ainsi de desservir l’ensemble des habitats. La seconde catégorie concerne les espaces dont la fonction, en plus de permettre une desserte, est de servir de lieu à part entière : capacité de rassemblement, existence de services ou de commerces,
127 Zingarelli Andrea Paula, 2010, p. 33128 Zingarelli Andrea Paula, 2010, p. 41129 Partridge Robert, 1996, p. 83130 Partridge Robert, 1996, p. 95
96 97
URBANISME INSOUPÇONNÉ L'ESPACE PUBLIC : RUES ET PLACES
expression d’un pouvoir sont des qualités qui font de ces espaces plus que de simples moyens de circulations. Les venelles, rues, avenues et voies processionnelles entrent toutes dans la première catégorie : elles forment la majeure partie de l’espace public en Égypte Ancienne et correspondent à des usages bien précis.
Typologies et morphologies de voirieDe tous les types de voirie, la venelle est l’espace public de base
car elle résulte simplement de l’écartement entre deux bâtis adjacents qui permet ainsi un passage. Elle se démarque des autres espaces de circulation par son rôle de desserte locale uniquement : elle n’a comme objectif que de permettre l’accès des parcelles qui lui sont immédiatement adjacentes. Cette organisation a pour conséquence de multiplier les culs-de-sac, la venelle ne débouche en effet par for-cément à chacune de ses extrémités. La largeur de la venelle, dont la limite inférieure est celle de la largeur d’un homme et la limite supé-rieure - arbitraire131 - est d’environ deux mètres cinquante, devait per-mettre le passage d’un homme éventuellement accompagné d’un âne.
Cette faible largeur devait permettre à la venelle d’être couverte en employant des moyens simples et peu coûteux (Cf. Fig. 20), ce que révèlent des fouilles archéologiques aussi bien dans le village des arti-sans de Deir el-Medineh132 que celui de Tell el-Amarna133. De simples pièces de bois où des troncs de palmiers devaient ainsi faire office de poutres au dessus de la rue, tandis qu’une couverture légère devait apporter une ombre rafraîchissante à la rue. Cette couverture, on s’en doute, devait permettre de maintenir une atmosphère relativement fraiche dans ces espaces où la réverbérations des murs proches les uns des autres couplée au soleil d’Égypte pouvaient mener à des tempéra-tures étouffantes. Bien entendu, la hauteur des bâtiments entourant
131 Bien qu’elle désigne d’abord une voie étroite, on distinguera la venelle de la rue étroite surtout par sa fonction.
132 Bruyère Bernard, 1939, p. 32133 Peet T. E., Woolley Leonard C., 1923, p. 68
Fig. 20 : Section de venelle d’un mètre soixante de largeur, couverte par une couverture légère. (Source : Paul François)
Fig. 21 : Section de venelle de deux mètres de largeur. (Source : Paul François)
Fig. 22 : Section de venelle de deux mètres vingt de largeur, bordée de bâtis ayant un étage. (Source : Paul François)
98 99
URBANISME INSOUPÇONNÉ L'ESPACE PUBLIC : RUES ET PLACES
ces venelles, lorsqu’elle dépassait le simple rez-de-chaussée, pouvait éventuellement permettre de se passer de couverture, l’ombre proje-tée des bâtiments étant suffisamment protectrice (Cf. Fig. 22).
La voirie du village de Deir el-Medineh offre un bon exemple d’un système de venelles. Toutes les voies ont une largeur qui oscille entre 1,6m et 2,2m et elles se terminent toutes en impasse. La venelle «principale», reliée à l’entrée du village, se ramifie en plusieurs venelles secondaires, toutes gardent une largeur plus ou moins constante, sans que l’on puisse dire que les venelles les plus éloignées de l’entrée - et donc empruntées par un nombre plus restreint de personnes - soient plus étroites. Le village, dont les maisons ne s’élevaient jamais plus haut que le rez-de-chaussée possédait donc des venelles bordées de murs peu élevés et protégées par une couverture légère.
Plus large en principe que la venelle, et donc avec une largeur de passage de plus de 2,5m, la rue permet des déplacements plus impor-tants (Cf. Fig. 25). Cette dimension permettait en effet aisément à plusieurs convois composés d’ânes et de leur maître de se croiser sans difficultés ce qui amène à la principale distinction entre la rue et la venelle : la rue permet non seulement la desserte des parcelles qui la longent, mais également le passage en étant débouchante à chacune de ses extrémités (et donc sans impasses). À Tell el-Amarna134, les es-paces pouvant être identifiés comme des rues ont une largeur d’une dizaine de mètres environ ce qui représente des espaces relativement importants, d’autant plus qu’ils étaient majoritairement empruntés par des piétons et non des véhicules qui auraient pu rapidement congestionner ces voiries. Il est néanmoins permis de penser que la
134 Sur les secteurs de la grille dénommés P47 et Q47 notamment, d’après les relevés présents dans Borchardt Ludwig, Ricke Herbert, 1980, Streifenplan III. Concernant le système de grilles et de subdivisions des espaces de fouilles à Tell el-Amarna, consulter Kemp Barry John, Garfy Salvatore, 1993 et Kemp Barry John, 2012 (2013), p. 11
0 10 20 30 40 m1/1000
Fig. 23 : Les venelles de Deir el-Medineh forment un espace public - en orange - étroit et irrégulier. (Source : d’après Bruyère Bernard, 1939)
N
100 101
URBANISME INSOUPÇONNÉ L'ESPACE PUBLIC : RUES ET PLACES
0 20 40 60 80 m1/2000
Fig. 24 : L’espace public des sections P47 et Q47 de Tell el-Amarna. On y distingue clairement une venelle en 1 (largeur 1,4m), deux rues en 2 et 3 (largeur entre 7 et 10m) ainsi qu’une avenue en 4 (largeur de 22 à 32m). (Source : d’après Borchardt Ludwig, Ricke Herbert, 1980)
N
1
2
3
4
largeur exceptionnelle de ces voies est une particularité de cette ville car on retrouve rarement des passages aussi larges dans d’autres sites.
La différence entre la rue et l’avenue, même aujourd’hui135, est avant tout basée sur une question de perception toute relative. L’ave-nue est une artère majeure de la circulation et sert de support à un système de voirie secondaire comprenant les rues et venelles précé-demment citées (Cf. Fig. 24). Cette importance se traduit principa-lement par une largeur accrue, allant jusqu’à une trentaine de mètres (toujours à Tell el-Amarna, secteurs P47 et Q47). L’intérêt de telles largeurs n’apparaît que si l’on considère des défilés militaires ou re-ligieux qui pouvaient traverser la ville. De tels défilés militaires sont attestés à Tell el-Amarna et il n’est pas exclu qu’ils aient également été pratiqués dans d’autres villes, afin de faire démonstration de la puissance militaire royale. La largeur imposante de ces voiries semble exclure qu’elles soient uniquement le fruit d’un développement orga-nique de la ville. On comprend mal en effet pourquoi des espaces de plus de trente mètres auraient été laissés libres alors que les flux qui les traversaient étaient sans doute très limités ou en tous cas loin de nécessiter de telles proportions. Il est ainsi hautement probable que les tracés et la largeur de ces voies aient été décidées a priori.
La voie processionnelle136 pourrait se définir comme une avenue dédiée au passage des processions liées aux cultes divins. Ce type de voirie, dont l’aspect public est sujet à cautions, est pourtant mar-qué par un aménagement plus strict (Cf. Fig. 26). Particulièrement évident dans la ville de Thèbes, ce réseau reliait entre elles les diffé-
135 Choay Françoise, Merlin Pierre, 1988 (2010), p. 95136 Bien qu’elle soit souvent appelée «Dromos», on préfèrera le terme de
«voie procesionnelle» qui évitera la confusion avec les Dromos de l’architecture grecque et proche-orientale qui sont des accès aux tombes (Aurenche Olivier, 1977 (2004), p.75). Le terme «Avenue bordée de béliers» est également usité dans les publications anglo-saxonnes (Wilkinson Richard H., 2000) mais il entretien la confusion avec la «simple» avenue.
117
La ville est constituée d’espaces privés ou publics. C’est néan-moins par la façon dont ils s’imbriquent et se répondent, ainsi que grâce à leurs particularités, qu’ils fabriquent un tissu urbain spécifique. Plutôt que d’étudier ce tissu à l’échelle entière d’une ville, il convient de passer par un point de vue intermédiaire, celui de la rangée ou de l’îlot. En plus d’apporter des facilités d’analyse, cette échelle corres-pond également à la façon dont l’homme perçoit la ville : plus petit qu’un quartier, l’îlot constitue le voisinage immédiat et, bien que la mitoyenneté n’implique pas forcément des échanges entre occupants, il peut être le garant d’une certaine cohérence sociale. Rangées et îlots sont lisibles et conçus différemment selon qu’ils résultent d’un pro-cessus de conception réfléchis d’un lotissement de façon sommaire, en traçant simplement le contour des rues, ou bien d’une conception plus complète, pouvant aller jusqu’à la planification des intérieurs de logements. Cette dernière méthode interroge directement les capacités de planification des anciens égyptiens.
Tissus urbains : rangées et îlots
141
Constituée uniquement d’un tissu urbain de logements, une ag-glomération ne pourrait prétendre au statut de ville, car celle-ci est également un lieu où s’expriment des pouvoirs, des croyances, et où se créent et s’échangent des biens : elle est bien plus qu’un simple dispositif destiné à habiter. C’est pourquoi il est nécessaire d’aborder des types de bâti qui ne sont pas du logement mais destinés à la pro-duction, au stockage ou à la distribution de nourriture, à assurer l’ad-ministration et le maintien de l’ordre, à permettre une vie luxueuse à la famille royale ou à entretenir le culte des divinités. De tels bâtiments constituent des objets-repères, qui pouvaient servir à s’orienter dans la ville, ou revêtaient une véritable importance au sein de celle-ci. Si on ne peut sans doute pas parler de «monument» pour la plupart de ces édifices, ce terme peut éventuellement s’appliquer au temple et à son complexe, dans la mesure où ils formaient une entité urbaine majeure au cœur de toutes les attentions. Afin d’expliquer ce rôle, il convient de s’intéresser avant tout à la place du culte en Égypte Ancienne.
Objets repères
166 167
URBANISME INSOUPÇONNÉ OBJETS REPÈRES
les zones les plus sacrées du temple239. Il est intéressant de constater qu’une séquence identique de passage des espaces publics extérieurs aux espaces privés intérieurs est reprise pour l’organisation des pa-lais… architecture elle-même reprise dans l’habitat commun.
S’il est possible que la cour du temple soit ouverte en certaines occasions et accessible au commun des mortels240, les portes du py-lône devaient rester la plupart du temps closes, d’autant que leurs dimensions imposantes devaient rendre leur maniement particuliè-rement difficile. Le pylône et ses aménagements reste alors, on l’a vu, la seule chose qui soit visible par la plupart des égyptiens. Si la décoration de l’ensemble des parois des môles était sensée éloigner les puissances néfastes, les représentations du roi massacrant ses ennemis ne sont pas anodines : elles devaient profondément impressionner la population et rappeler que le souverain était également un chef des armées à craindre. Il en va de même pour les statues du roi placées souvent symétriquement par rapport à la porte et qui, hors d’échelle, devaient également impressionner. Le temple devient alors un ou-til de propagande politique au service du pouvoir royal. Bien qu’ils soient indissociables du temple dans l’imaginaire commun, les obé-lisques étaient loin d’être systématiques241 et la plupart des parvis se contentaient de statues monumentales.
Le domaine divinMalgré ses dimensions importantes, le temple de pierres n’oc-
cupe parfois qu’une portion assez faible de la surface protégée par
239 Wilkinson Richard H., 2000, pp. 24-25240 Wilkinson Richard H., 2000, p. 62241 L’obélisque, sensé représenter un rayon de soleil pétrifié, est un symbole
de culte fortement lié aux divinités solaires (comme Rê ou Amon-Rê) et on ne le retrouve pas dans les temples dédiés à des divinités chtoniennes (comme Ptah ou Osiris). Le très imposant temple de Ptah à Memphis, dont les dimensions devaient égaler Karnak, était donc dénué d’obélisques. De même, les temples de millions d’années ne sont pas dotés de ces constructions, s’agissant d’établissements dédiés, entre autre, à faire perdurer le culte d’un souverain décédé.
Fig. 49 : Parvis d’un temple tel qu’il devait se présenter aux égyptiens. (Source : Paul François)
0 10 20 30 40 m1/1000
168 169
URBANISME INSOUPÇONNÉ OBJETS REPÈRES
une enceinte de briques crues et marquant la limite du domaine divin (Cf. Fig. 48). Cette enceinte, dont l’épaisseur pouvait aller jusqu’à une dizaine de mètres était parfois conçue à la manière de forteresses, avec des bastions242 et s’ouvrait avec plusieurs portes secondaires sur l’espace environnant, permettant une circulation des personnes (et notamment des prêtres) et des biens sans avoir à utiliser la porte prin-cipale en principe réservée à la divinité et au roi. Les constructions à l’intérieur de ce mur d’enceinte sont des structures qui ont déjà été évoquées et parmi lesquelles les entrepôts sont une portion impor-tante. Le temple, via ses possessions en terres agricoles et grâce aux nombreuses donations royales243 était en effet une puissance écono-mique majeure qui devait abriter d’importantes richesses.
Afin de permettre de loger les prêtres qui officiaient à l’intérieur du temple, des habitats étaient installés à l’intérieur de l’enceinte. Ces constructions révélées à Karnak aux abords de l’enceinte du Nouvel Empire montrent des maisons de dimensions importantes, autour de 80 mètres carrés, et peu ou prou semblables dans leur aména-gement244, sans pour autant afficher la cohérence et la planification de certains quartiers ouvriers. Des ateliers de production, ainsi que des boulangeries et boucheries étaient également présents à l’inté-rieur de l’espace sacré, afin de subvenir aux importants besoins en offrandes245. Notons ici qu’à Tell el-Amarna, ces fonctions habituelle-ment construites à l’intérieur de l’enceinte de briques y ont été relé-guées à l’extérieur : l’espace sacré y est laissé entièrement vide et seul le temple de pierres, d’une architecture particulière y est présent.
242 Monnier Franck, 2010, pp. 66-70243 On pense notamment aux très importants dons faits au domaine d’Amon
par Ramsès III, puisqu’il augmenta les possessions de terres du clergé de près de 2400 km2, tout en y affectant e 86486 ouvriers. Pour plus de détails, consulter à ce sujet Grandet Pierre, 1993, pp. 228-229.
244 Lauffray Jean et al., 1975, pp. 26-30245 Wilkinson Richard H., 2000, p. 75
Fig. 50 : Représentation perspective d’une chapelle construite en dehors de l’espace sacré du temple. (Source : Vincent Euverte, Paul François et Raymond Monfort)
177
Les composants de la ville, un site précis, le parcellaire et ses lo-gements, les différents espaces publics, la façon dont ces deux der-niers créent du tissu urbain, ainsi que l’ensemble des bâtiments ve-nant ponctuer ce tissu ont été évoqués. La ville n’est cependant pas une répétition infinie d’un même module dans laquelle ne pourrait être repérée aucun point focal, aucune voie principale… au fond au-cune preuve d’humanité. En réalité la sensibilité de l’humain a de tout temps imposé des tracés, des motifs dans la ville : là en contournant un obstacle, ici en s’alignant vers les points d’intérêts majeurs de la ville. Même si certains tracés sont antérieurs à la décision même de construire une ville - chemins très anciens, par exemple - ceux qui sont l’objet d’un nouveau plan d’urbanisme peuvent résulter soit de contraintes géographiques, soit de contraintes inhérentes à la ville elle-même qui crée son propre jeu d’objets-repères et de polarités. Dans ce jeu de points focaux, savoir qui détient le pouvoir est un atout majeur pour en comprendre les règles.
Tracés à l’échelle de la ville
180 181
URBANISME INSOUPÇONNÉ TRACÉS À L'ÉCHELLE DE LA VILLE
pente très importante, là un méandre du fleuve, etc. Ces difficultés ne sont pas suffisamment importantes pour empêcher l’installation ou le développement d’une ville mais peuvent pourtant altérer la ma-nière dont les tracés urbains peuvent être conçus. Aujourd’hui, les contraintes géographiques globales, comme l’orientation par rapport à des points cardinaux, sont importantes dans le processus de concep-tion architecturale car elles conditionnent l’apport solaire de chacune des pièces, et, par extension les qualités thermiques du bâti. Si ces contraintes pouvaient intervenir à l’époque, elles étaient supplantées par l’importance du référentiel local que fournissait le Nil, et égale-ment par le relief lui-même.
Contraintes spatiales globalesDans un pays où les températures estivales peuvent devenir très
importantes, avec plus d’une quarantaine de degrés en été à Thèbes par exemple, la gestion du confort thermique aurait pu passer par une orientation par rapport à la course solaire. Une rue orientée est-ouest aurait ainsi tout son côté sud à l’ombre toute la journée, ou un bâtiment avec des ouvertures au nord aurait pu capter le vent frais en été. Cependant, l’observation de plans de villes montre qu’il n’en est rien : d’un point de vue de l’îlot et des plans de logement, l’organisa-tion suivant des points cardinaux n’a aucune influence (Cf. Fig. 53). Certains dispositifs, comme le malqaf destiné à capter le vent pour ra-fraîchir une pièce257, pouvaient s’adapter à la plupart des dispositions du bâti sur lequel ils pouvaient s’installer, limitant probablement le recours à une architecture orientée à des fins thermiques.
En revanche, certains temples étaient orientés selon des contraintes célestes globales indépendantes de la position locale. Un des exemples les plus connus au Nouvel Empire est le cas du Grand Temple d’Abou Simbel - construit en dehors d’un contexte urbain - dont les statues du naos, creusé à près de quarante mètres dans la
257 Monnier Franck, 2013, p. 85
N N
N N
Fig. 53 : Directions principales de l’organisation urbain dans quatre ensembles planifiés. On voit clairement que les points cardinaux ne sont pas déterminants dans la mise en place d’un plan d’urbanisme. (Source : Paul François)
Fig. 53.1 : Village des artisans de Tell el-Amarna.
Fig. 53.2 : Village des artisans de Deir el-Medineh.
Fig. 53.3 : Walled Village de Malkata.
Fig. 53.4 : Forteresse de Sesebi.
182 183
URBANISME INSOUPÇONNÉ TRACÉS À L'ÉCHELLE DE LA VILLE
montagne, sont éclairées par le soleil deux fois par an258. Cet éclairage n’était pas le fruit du hasard et résulte d’une orientation solaire parti-culière, tandis que d’autres orientations stellaires (sur Į ou ȕ du Cen-taure notamment) ont été suggérées pour d’autres temples259. L’orien-tation des lieux de culte n’est pas anodine, car ceux-ci constituent des objets repères importants du tissu urbain sur lesquels viennent se connecter de nombreux axes de circulation.
Le Nil comme référentiel localLe rôle du Nil chez les anciens égyptiens a déjà été évoqué à plu-
sieurs reprises, il est la source de l’agriculture, un moyen de transport idéal… dès lors il occupe également une place de choix dans l’orga-nisation urbaine. Il permet dans de nombreuses villes d’orienter le temple, le fleuve coulant globalement du sud vers le nord et le temple s’orientant symboliquement de l’est vers l’ouest260, l’enceinte sacrée était perpendiculaire au cours du fleuve. Or, dans le détail le Nil coule assez rarement du nord au sud, mais les temples conservent une orientation perpendiculaire à son cours. Celui-ci définit un «Nord Liturgique», sorte de référentiel local pour la construction et le déve-loppement d’un temple261.
Au delà du positionnement d’un temple, le fleuve influe directe-ment sur l’orientation des voies dans la ville. Cette influence est vi-sible sur le plan d’ensemble de la ville de Tell el-Amarna (Cf. Fig. 54). On y voit que les voies principales de la ville, grossièrement orientées nord-sud et définissant les macro-îlots, suivent une courbure similaire à celle du fleuve. Par endroits le parallélisme n’est pas parfait mais
258 Peters-Destéract Madeleine, 2003, p. 228259 Shaltout Mosalam, Belmonte Juan Antonio, 2005, p. 9260 L’orientation sur l’axe est-ouest suit la course solaire, le naos étant à l’est,
lieu de naissance du soleil et de l’horizon (le point de contact entre le soleil et la terre, entre le monde divin et le monde des hommes) et la porte principale à l’ouest. Théoriquement, chaque matin, le lever du soleil aperçu entre les deux môles du py-lône formait le hiéroglyphe signifiant l’horizon.
261 Shaltout Mosalam, Belmonte Juan Antonio, 2005, p. 9
0 0,5 1 1,5 2 km1/50000N
Fig. 54 : Tracé des voies principales de Tell el-Amarna montrant le parallélisme entre celles-ci et le cours du Nil. (Source : Paul François)
184 185
URBANISME INSOUPÇONNÉ TRACÉS À L'ÉCHELLE DE LA VILLE
les inflexions nécessaires pour suivre le cours du Nil sont particuliè-rement visibles au nord et au sud de la ville. Cette organisation est une réponse naturelle à la propension de la ville à se rapprocher des points d’eau. Plutôt que de se développer dans la plaine et donc loin de l’approvisionnement en eau, la ville se développe le long des terres inondables et donc du Nil. Ce développement est permis par une trame urbaine souple plutôt que strictement orthogonale, qui permet de limiter les pertes d’espaces lorsqu’elle rencontre des obstacles aux formes irrégulières et forme un moyen efficace d’optimisation de l’es-pace, convoité, près des bords du fleuve.
Des directions principales semblables sont observables à Deir el-Ballas, où les restes urbains de la plaine semblent majoritairement suivre la direction du fleuve, c’est à dire que leurs murs s’oriente du nord au sud, ou perpendiculairement, d’est en ouest (Cf. Fig. 55). Néanmoins, dans les villes du delta où plusieurs branches du Nil pou-vaient entourer une même ville, il est vraisemblable que les bâtiments se soient alignés en fonction du cours d’eau le plus proche. Les sché-mas d’organisation de la ville de Pi-Ramsès262 (Cf. Fig. 62) permettent de juger de cette influence dans une ville traversée par de nombreuses branches secondaires du Nil ou par des canaux car les temples n’y suivent pas de direction privilégiées.
L’influence du reliefLe relief joue un rôle non négligeable dans l’établissement des
axes et le positionnement des objets-repères. Il peut former les li-mites d’un site car un relief trop escarpé crée une barrière infranchis-sable qui contraint l’extension urbaine, tandis qu’un cirque rocheux peut faire office de protection naturelle pour l’ensemble d’une ville, comme c’est le cas sur le site de Tell el-Amarna. De plus, le relief peut fournir des points dominant le reste du site, qui sont le lieu privilégié pour l’installation d’objets-repères ou de lieux de pouvoir. À Deir
262 Bietak Manfred, 1975, planche 44
0 50 100 150 200 m1/5000N
Fig. 55 : Courbes de niveau et principaux vestiges du site de Deir el-Ballas, montrant une orientation majoritairement parallèle au Nil - qui coule ici dans l’axe sud-nord - sauf pour le palais sud qui occupe une position surplombant le site. (Source : d’après Lacovara Peter, 1990)
201
La conception d’une ville est un processus qui s’inscrit dans la durée. Non seulement la fondation et la construction d’une ville nou-velle prennent du temps, mais celle-ci n’en devient pas pour autant figée une fois ces travaux accomplis. L’évolution du tissu urbain se fait principalement selon deux tendances, la première consistant à le densifier pour permettre à une population plus importante d’habiter le cœur de ville, et la seconde consistant à étendre son emprise sur les territoires alentours. Les bâtiments qui constituent l’agglomération ne sont pas éternels, d’autant plus qu’ils sont faits de briques crues demandant beaucoup d’entretien, et leur réfection participe à la mé-tamorphose jour après jour de la ville sur elle-même. Ce palimpseste peut faire oublier les préoccupations urbanistiques qui ont prévalu à la conception de la ville nouvelle, un urbanisme insoupçonné dont seules quelques traces ténues ont pu subsister jusqu’au XXIème siècle. S’il est bien loin de la science urbaine de la civilisation occidentale d’aujourd’hui, il n’en est pas moins un héritage historique majeur.
Conclusion : La ville à l’épreuve du temps
202 203
URBANISME INSOUPÇONNÉ CONCLUSION - LA VILLE À L'ÉPREUVE DU TEMPS
Densifier, étendre et modifier
Le temps nécessaire à la construction d’une nouvelle ville en Égypte Ancienne est difficile à estimer, tout au plus peut-on détermi-ner des tendances grâce à des exemples comme le site de Tell el-Amar-na où l’ensemble urbain est construit, perdure assez longtemps pour subir des modifications dans son plan original puis est abandonné, le tout en seize ou dix-sept ans seulement278. C’est un délais relative-ment court au regard de l’importance du site qui s’explique par le rôle de centre politique et culturel du pays qu’il a joué sous l’influence de son commanditaire, Akhenaton. En quelques années seulement, voir moins pour les agglomérations les moins importantes, une ville nou-velle pouvait voir le jour, si ce n’est en étant complètement achevée, au moins en étant fonctionnelle. À partir de là, l’évolution de la ville se fait principalement selon trois directions que sont la densification, l’extension et la modification du tissu urbain.
À plusieurs reprises, il a été noté que les vestiges de Tell el-Amar-na correspondent à une version très peu dense de la ville. Cela fait dire à de nombreux auteurs que ce site, en plus d’être issu d’une période de chamboulement profond des cultes traditionnels, n’est pas un exemple significatif pour étudier le fait urbain en Égypte An-cienne279. En fait, cette particularité vient principalement du fait que cette ville n’a pas encore été modifiée par le processus de densification urbaine, ou seulement très peu. Grâce aux techniques de construc-tion de la brique en Égypte Ancienne, et notamment des tendances des constructeurs à appuyer les nouveaux bâtiments sur les anciens, il est ainsi possible de retracer dans les grandes lignes l’historique de la densification d’un quartier280. L’observation des vestiges de la partie
278 Kemp Barry John, 2012 (2013), p. 301279 Fairman Herbert Walter, 1949 : «Town Planning in Ancien Egypt» in
Town Planning Review, numéro 20, pp. 31-50280 Effectuée dans Kemp Barry J., Stevens Anna, 2010, cette analyse de
l’historique du développement horizontal de l’occupation d’un quartier est éga-
centrale des grilles P47 et P48 de Tell el-Amarna permet ainsi de se faire une idée des phases principales d’occupation du quartier (Cf. Fig. 61). Les domaines les plus importants se sont installés dans une pre-mière phase, suivie par des domaines de taille moindre et des maisons isolées (Phase II). À cette phase la morphologie du quartier est déjà visible, avec les rues principales délimitées. La Phase III est une pre-mière étape de densification qui voit des habitats bien plus modestes s’accoler aux domaines, probablement en raison d’une relation hiérar-chique existant entre les deux types d’habitants. On peut également remarquer la densification à l’intérieur des domaines, correspondant à des inclusions d’habitat d’un type relativement aisé, dans l’espace délimité par leur enceinte. Pour la parcelle nord-est du secteur étudié, le domaine du sculpteur Thoutmose, cela passe par la construction d’un mur séparant les deux demeures, et par le percement du mur de nord de l’enceinte permettant de desservir la nouvelle maison. La Phase IV, elle, voit les espaces laissés libres par la phase précédente se remplir par des constructions s’appuyant, de proche en proche, sur les murs des bâtiments déjà existants. Cette observation permet de mettre en évidence deux phénomènes de densification : un premier consistant à mettre en place un nouveau parcellaire par l’attribution des espaces laissés libres, et le second consistant à redécouper le par-cellaire déjà existant. La faible durée d’occupation des secteurs P47 et P48 ne permet pas d’observer dans le temps les conséquences du redécoupage des parcelles faisant progressivement perdre leurs es-paces extérieurs aux domaines et imposant des domaines urbains à étages. Une information très importante est également lisible dans les schémas d’évolution du quartier, c’est la conservation de la position des axes de circulation. Aucune construction ne s’est étendue à l’est,
lement basée sur la composition des briques de construction. Afin d’être menée sur d’autres quartiers de Tell el-Amarna, une étude similaire nécessiterait donc des données issues de nouvelles fouilles. Dans le cadre de cette étude restreinte, on se contentera donc d’une étude morphologique permettant déjà de dégager les grandes phases de densification d’un quartier.
204 205
URBANISME INSOUPÇONNÉ CONCLUSION - LA VILLE À L'ÉPREUVE DU TEMPS
0 20 40 60 80 m1/2000N 0 20 40 60 80 m
1/2000N
Fig. 61 : Différentes phases de densification d’un quartier à Tell el-Amarna. (Source : Paul François)
Fig. 61.1 : Phase I
Fig. 61.2 : Phase II
Fig. 61.3 : Phase III
Fig. 61.4 : Phase IV
206 207
URBANISME INSOUPÇONNÉ CONCLUSION - LA VILLE À L'ÉPREUVE DU TEMPS
sur ce qui est une artère majeure de circulation. La largeur de celle-ci, avoisinant, trente-deux mètres, aurait parfaitement pu supporter l’implantation de plusieurs logements de taille réduite tout en restant utilisable. Cela suppose l’existence d’un véritable respect de la voirie et donc l’application de règles tacites, ou dont le caractère officiel reste inconnu281, concernant le développement urbain.
Au cours du temps en plus de se densifier, la ville s’étend en de-hors de ses limites originales, à la faveur également des changements du paysage environnant. Le tracé du cours du Nil, comme celui de tous les fleuves, est changeant. Cette évolution de la position du fleuve peut dégager de nouvelles terres pour le développement d’une ville. C’est semble-t-il le cas pour la ville de Thèbes et son temple de Karnak dont les développements vers le nord et vers l’ouest on pu s’effectuer suite au dépôt des alluvions du fleuve sur sa rive est282. L’évolution du cours du Nil est relativement rapide puisqu’en l’espace d’un siècle seulement, des modifications substantielles des îles sur le fleuve peuvent être perçues283, et le paysage de la ville a dû profon-dément varier lors des trois millénaires de son histoire antique. Dans un laps de temps plus réduit que l’évolution de la ville de Thèbes, les sites de Tell el-Dab’a et Qantir qui formaient à la fin du Nouvel Empire la ville de Pi-Ramsès permettent de juger des proportions des extensions urbaines (Cf. Fig. 62). La ville d’Avaris (sur le site de Tell el-Dab’a), capitale des Hyksôs pendant la Deuxième Période Inter-médiaire se développait autour du temple de Seth et du port. Suite à la décision de Ramsès II, au Nouvel Empire, de la construction de la ville de Pi-Ramsès sur le site tout proche de Qantir, l’agglomération s’étend alors vers le nord et vers l’est dans des proportions très impor-tantes qui viennent plus que doubler la surface originale de la capitale Hyksôs. La ville suit néanmoins le cours de la branche pélusiaque
281 Il n’existe pas, à notre connaissance, de textes apportant la preuves de restrictions officielles de l’occupation de l’espace public ou de la voirie.
282 Charloux Guillaume, Mensan Romain, 2011, p. 50283 Charloux Guillaume, Mensan Romain, 2011, pp. 48-49
0 0,5 1 1,5 2 km1/50000N
Fig. 62 : Développement urbain d’Avaris (le site actuel de Tell el-Dab’a), en noir, puis de Pi-Ramsès (site actuel de Qantir), en orange, le long de la branche pélusiaque du Nil. (Source : d’après Bietak Manfred, 1975)
208 209
URBANISME INSOUPÇONNÉ CONCLUSION - LA VILLE À L'ÉPREUVE DU TEMPS
du Nil, évitant ainsi un développement «en tache d’huile» autour du centre urbain plus ancien. En revanche, à Tell el-Amarna et sur une période plus courte, le développement de la ville s’effectue plutôt du fleuve vers les terres intérieures, en bandes successives correspondant à la largeur d’un macro-îlot284.
Évoquée à plusieurs reprises, l’existence de tells285 est la consé-quence directe d’un autre processus d’évolution de la ville, celui de la modification continuelle de sa couche bâtie. Les bâtiments aban-donnés et tombant en ruines, ou les ensembles ne correspondant plus à l’usage souhaité, étaient arasés et les constructions suivantes effectuées sur les débris de cet arasement (principalement de la terre donc, puisque les constructions étaient faite de briques crues), de sorte que le niveau de la ville s’élevait petit-à-petit. Lors des fouilles archéologiques, l’approche stratigraphique implique de remonter le temps en fouillant de plus en plus profond pour revenir aux couches les plus anciennes, recouvertes par des bâtis plus récents, à leur tour détruits, etc. Ce type d’étude permet de comprendre quel genre de modifications s’effectuaient progressivement dans un tissu urbain. Certaines structures s’agrandissaient et c’est le cas notamment des temples qui avaient tendance à être agrandis plutôt que reconstruits au cours du temps, et dont l’emprise sur la ville pouvait être de plus en plus importante286. À Karnak, l’évolution du complexe a ainsi né-
284 Laboury Dimitri, 2010, p. 258285 Défini comme une «colline artificielle provoquée par les ruines d’un éta-
blissement» (Aurenche Olivier, 1977 (2004), p. 164), le tell est une structure très répandue dans l’ensemble du Moyen Orient et qui explique les très nombreux noms de site archéologiques commençant par «Tell» : Tell el-Amarna ou Tell el-Dab’a par exemple.
286 Il semble néanmoins que suivant les époques, l’inverse se produise. Pen-dant la troisième période intermédiaire, sous le règne de Psousennès Ier l’enceinte de Karnak est reconstruite afin d’éviter que l’espace ne soit envahi par la ville envi-ronnante (Grimal Nicolas, 1988 (2005), p. 408). Cela correspond néanmoins à une période relativement troublée ou le clergé d’Amon avait un pouvoir moins important qu’au Nouvel Empire.
cessité de s’étendre sur des portions de ville à l’est, dont les vestiges sont conservés sous l’enceinte du Nouvel Empire287. Les destructions importantes nécessitées par ce type de développement permettent également de mettre en place une nouvelle organisation urbaine, li-sible dans un changement d’orientation du bâti dans le quartier288. L’évolution du quartier au sud du temple de la forteresse d’Amara (Cf. Fig. 63) montre que la structure urbaine évolue fortement au cours du temps d’occupation du site, c’est à dire pendant la période ramesside289. Les relevés, effectués par la mission de fouilles d’Amara Ouest290, mettent en effet en évidence la conservation à l’ouest du quartier d’une rue grossièrement orientée nord-sud, tandis qu’une rue moins importante voit son tracé dévié par de nouvelles constructions. Progressivement, les parcelles sud s’agrandissent en empiétant sur le grand ensemble nord, qui est réduit, à la phase III, à un ensemble de ruines partiellement occupées au sud-est, et à une construction plus réduite au nord-ouest. À l’échelle d’une ville, l’ensemble du tissu urbain devait donc être extrêmement mouvant tout en conservant les grandes lignes de tracés urbanistiques prédéfinis pour peu qu’ils soient utilisés et conservent un rôle structurant, sans quoi l’espace privé pouvait empiéter sur la voirie au gré des besoins.
Les processus de mutation de la ville sont nombreux, et ceux rapidement évoqués ici peuvent être définis comme «naturels». Le développement de proche en proche et l’extension de l’emprise de la ville suivent l’évolution globale de la population et des besoins de celle-ci. Des interventions extérieures, comme les abandons massifs,
287 Lauffray Jean et al., 1975, p. 29288 Les bâtiments du Moyen Empire ont en effet une différence d’orientation
de quelques degrés avec l’enceinte du Nouvel Empire sur laquelle s’alignent les nou-velles constructions de l’époque. Voir à ce sujet Kemp Barry John, 1992 (2006), pp. 228-229.
289 Monnier Franck, 2010, p. 160290 Spencer Patricia , 1997
210 211
URBANISME INSOUPÇONNÉ CONCLUSION - LA VILLE À L'ÉPREUVE DU TEMPS
les invasions ou mêmes les incendies peuvent également transformer de manière durable une ville. Tell el-Amarna fut ainsi abandonnée, presque du jour au lendemain, au début du règne de Toutankhamon, ne laissant derrière elle qu’un village bien loin du faste de l’ancienne capitale291. Dans tous les cas, la ville est en perpétuel mouvement et ne cesse de se modifier. Pourtant, certains traits persistent ou se mo-difient moins fortement que les autres comme le tracé d’une avenue ou d’une rue majeure, ou même l’emplacement d’un lieu de culte. La persistance de ces éléments à travers le temps tend à mettre en valeur le respect de règles urbanistiques, et donc une véritable conscience du fait urbain en Égypte Ancienne durant le Nouvel Empire.
Urbanisme insoupçonné
L’ensemble de ce travail avait pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques de l’urbanisme égyptien au Nouvel Empire, le mot «urbanisme» étant alors pris dans son sens de processus d’amé-nagement réfléchis, ou non, de l’espace. Suivant cette acceptation, différentes échelles et composantes du tissu urbains furent étudiées et il est maintenant possible de se faire une idée plus précise de ce à quoi pouvaient ressembler les villes du Nouvel Empire. Bâtie de préférence sur les bords du Nil sans se soucier outre mesure de la pré-sence de ressources matérielles permettant l’édification de bâtiments, la ville se développe par extension progressive et par accumulation de son composant de base, la parcelle habitable. Celle-ci, couvrant une gamme dimensionnelle et formelle variée, permet de lire sans grande difficulté le niveau social de ses occupants tout en étant le théâtre d’une architecture privée très réfléchie et empreinte de codes d’ori-gines diverses. Afin d’accéder à ces habitats et se déplacer dans la ville, les égyptiens avaient recours à toute une gamme d’espaces publics
291 Kemp Barry J., 2012 (2013), p. 3010 10 20 30 40 m1/1000N
Fig. 63 : Différentes phases de l’occupation de la zone au sud du temple d’Amara. (Source : d’après Spencer Patricia , 1997)
Fig. 63.1 : Phase I
Fig. 63.2 : Phase II
Fig. 63.3 : Phase III
212 213
URBANISME INSOUPÇONNÉ CONCLUSION - LA VILLE À L'ÉPREUVE DU TEMPS
allant de la simple venelle à la voie processionnelle, chacun corres-pondant à des aménagements particuliers. La façon dont ces espaces privés et publics s’enchevêtrent est à la base de la formation du tissu urbain et les solutions pour formaliser et planifier ce tissu sont extrê-mement nombreuses. Les égyptiens semblent avoir eu recours à de nombreuses solutions de planification qui vont du lotissement le plus planifié à l’ensemble urbain se développant sans véritable règle. Issus de la culture égyptienne exaltant le pouvoir royal et le rôle des dieux, palais, temples et autres objets-repères fixent par leur position et les tracés qu’ils impliquent la cohérence de l’ensemble. Ils apportent aux agglomérations ce qui fait d’elles des villes : l’expression d’un pouvoir politique ou divin et l’expression d’une culture urbaine. Ainsi peut-on généraliser les concepts majeurs du processus d’aménagement spa-tial, l’urbanisme, de la ville égyptienne au Nouvel Empire.
Cependant, le mot «urbanisme» peut recouvrir bien d’autres as-pects. Ce terme, que l’on doit à Ildefonso Cerdá, peut également dé-signer une discipline autonome ayant pour vocation l’aménagement scientifique de l’espace urbain292. Il faut comprendre par là l’existence d’une pensée de la ville avant qu’elle ne soit construite, et donc une réflexion sur la façon de vivre dans une agglomération. La tentation est grande de voir dans les différents exemples de formes urbaines ce type de réflexion chez les égyptiens du Nouvel Empire. Il faut néan-moins se rappeler qu’il n’existe aucun document prouvant l’existence d’une réflexion théorique sur le fait urbain à cette époque, et que les seules conjectures qui puissent être faites le sont de l’observation de tissus urbains. Si l’on se réfère à la ville de Tell el-Amarna, ses compo-santes principales ont bien été énoncées avant que la construction soit entamée, mais cela n’est attesté que grâce à l’existence des stèles fron-tières tout à fait inhabituelles. De telles descriptions du programme de villes nouvelles, qui ont forcément existé sans quoi il n’y aurait aucun moyen de s’assurer que la construction d’une nouvelle agglo-
292 Choay Françoise, Merlin Pierre, 1988 (2010), p. 797
mération réponde aux besoins dictés par les commanditaires, étaient probablement habituellement transmises oralement puis recopiées sur ostraca ou papyrus et sont donc définitivement perdues.
La manière dont sont organisées certaines agglomérations de la vallée du Nil antérieurement et pendant le Nouvel Empire semble impliquer une réflexion a priori sur la dimension, la morphologie et la nature de l’espace à concevoir. La ville de Kahun au Moyen Empire se développe ainsi dans une enceinte à la forme très proche du carré, tandis qu’elle est découpée intérieurement en multiples parcelles de taille différente permettant d’y loger des classes sociales variées en mi-nimisant la perte de place. Ceci exalte une véritable conception géo-métrique de l’espace. Une organisation similaire est reprise au Nouvel Empire, dans des proportions bien plus réduites toutefois, pour le vil-lage des artisans chargés de creuser les tombes de Tell el-Amarna. De même, l’organisation de l’ensemble palatial et urbain de Malkata, où différents types parcellaires sont alignés et séparés, plaide fortement en faveur d’une conception antérieure au processus de construction. Néanmoins, planification et urbanisme ne sont pas synonymes et la différence qui les sépare s’illustre dans l’écart qu’il y a entre pouvoir loger une certaine quantité de personnes, et concevoir les qualités d’un espace urbain.
Il y a dans la diversité des espaces publics égyptiens du Nouvel Empire, de la venelle à l’esplanade, autre chose qu’un espace résiduel nécessaire à l’accès des logements. On peut penser à la couverture des venelles qui vient résoudre les questions d’utilisation de la voirie en plein soleil et sous une chaleur étouffante, mais également aux larges avenues de Tell el-Amarna, ou à son esplanade, dont les dimensions presque excessives et respectées malgré l’évolution du tissu urbain, sont probablement là pour produire un effet architectural. Il existe une certaine réticence dans le milieu archéologique à généraliser les leçons du site de Tell el-Amarna293. Pourtant, il n’est pas envisageable
293 On citera ici à nouveau Fairman Herbert Walter, 1949 : «Town Plan-
214 215
URBANISME INSOUPÇONNÉ CONCLUSION - LA VILLE À L'ÉPREUVE DU TEMPS
de considérer Akhenaton comme ayant inventé un type d’urbanisme ex-nihilo, d’autant qu’il est prouvé grâce à l’étude de sites comme Deir el-Ballas que le modèle urbain de Ville Royale existait déjà avant son règne294. La recherche de cet effet architectural, c’est à dire la pro-duction chez l’usager d’une émotion, semble être un véritable indice de l’existence d’un urbanisme. L’architecture des temples de la même époque jouait également sur ce type de perceptions, en introduisant des structures hors d’échelle afin d’instaurer chez la plupart des égyp-tiens un sentiment de soumission et d’exaltation du pouvoir divin. Les représentations du souverain atteignant plus d’une dizaine de mètres de hauteur ne pouvaient laisser insensibles leurs admirateurs, tandis que le roi était mis en scène dans les palais royaux295. Une telle recherche de sensations aurait très bien pu être appliquée dans la conception d’espaces urbains, créant ainsi un urbanisme égyptien.
Un urbanisme insoupçonné, car en l’absence de preuves directes on ne peut se baser que sur l’étude des plans des vestiges parvenus jusqu’au XXIème siècle, en essayant de remonter aux opérations men-tales ayant précédé les développements urbains. De fait, on se refuse parfois à parler de véritable urbanisme en Égypte Ancienne, voyant dans les ensembles réguliers une simple conséquence de l’utilisation de la brique. Or, la forme rectangulaire de la brique n’implique pas de construire à angles droits : les murs courbes étaient pratiqués dans la construction, ne serait-ce que pour les silos à grains, et de nombreux ensembles présentent des angles variés. Il est également possible de ne voir dans la forme du développement urbain qu’une conséquence naturelle de l’extension de la ville, et pourtant, même dans ce cas des règles urbanistiques semblent s’appliquer, en conservant certaines
ning in Ancien Egypt» in Town Planning Review, numéro 20, pp. 31-50, mais cette remarque est également issue de nombreuses discussions avec des égyptologues.
294 Lacovara Peter, 1997, passim295 L’architecture des palais royaux joue en effet, comme on l’a vu, sur le
concept de fenêtre d’apparition et de cheminements différents pour le roi et pour ses sujets qui n’empruntaient pas de portes axiales, par exemple.
Fig. 64 : (Double-page suivante, et en couverture) Vue d’oiseau de l’ensemble de la ville projetée dans cet ouvrage sur son site. (Source : Paul François)
voiries ou des alignements particuliers. Il y aurait donc dans l’urba-nisme «à l’égyptienne», de même qu’il y a un urbanisme «hippoda-mien» ou «haussmannien», une dichotomie entre une organisation pré-établie de certains critères de voirie, et une certaine liberté pour le développement de l’habitat dans des limites fixées par avance.
L’hypothèse de l’existence d’un urbanisme comme processus de réflexion de l’espace est néanmoins issue d’un travail de généralisation sur le fait urbain en Égypte Ancienne au Nouvel Empire. L’urba-nisme est cependant une science globale qui ne peut se contenter de l’étude de plans. D’une part la ville se vit en trois dimensions ce qui la rend peu perceptible dans les vestiges de l’époque et nécessite de recourir à des reconstitutions que l’on a seulement esquissé dans cet ouvrage et dont le potentiel heuristique est immense. De plus, l’urbanisme peut également se nourrir, par exemple, de recherches philologiques permettant d’entrevoir le point de vue des égyptiens sur leur propre lieu de vie, d’études thermiques pour comprendre la manière dont les égyptiens pouvaient vivre sous des températures parfois étouffantes ou d’études hydrologiques explicitant le rapport de la ville à l’eau… autant de travaux qui sont actuellement entrepris dans le milieu archéologique, et qui une fois rassemblés, pourraient amener à confirmer l’existence d’un urbanisme en Égypte Ancienne.
220 221
URBANISME INSOUPÇONNÉ ANNEXES
Table technique des illustrations
Le lecteur pourra trouver dans cette partie l’ensemble des sources graphiques ou textuelles ayant permis de concevoir chacune des illus-trations de ce mémoire. La plupart d’entre elles sont inédites dans la mesure où elles ne sont pas issues d’une copie ou d’un travail d’inspi-ration directe depuis une illustration déjà existante. Sont indiqués en fin de chaque description les logiciels utilisés pour la conception des documents conformément la nomenclature suivante :
3DS : 3D Studio Max, avec le moteur de rendu V-Ray1
AI : Adobe IllustratorPS : Adobe Photoshop
Fig. 1 : Signe O49, désignant la villeSigne issu de la bibliothèque de signes du logiciel JSesh (http://
jsesh.qenherkhopeshef.org).
Fig. 2 : Plan des enceintes de la ville de NekhebPlan réalisé d’après les relevés topographiques de DEPUYDT Frans,
1989, le tracé de l’enceinte circulaire en pointillés reste hypothétique et n’a été dessiné qu’en prenant compte la géométrie de la section restante. (AI)
1 La configuration matérielle utilisée pour la réalisation de ces images, à savoir un iMac (Intel Core i7 3,4 GHz) ainsi qu’un Mac Pro (2x Intel Xeon 2,8GHz), doit beaucoup à Stanislas Doin qui a gracieusement prêté son poste de travail. Afin de gagner du temps, le modèle 3D utilisé pour la réalisation des images est uniquement composé des informations de volume sans aucune texture. N’est calculée par V-Ray que l’occlusion, et l’ensemble du travail de colorisation et de texture a été réalisé sur Photoshop.
Fig. 3 : Organisation de logements et parcellaireLe plan est extrait de KEMP Barry John, 1992 (2006), p. 206 et
redessiné, le parcellaire est un document original, issu de l’observa-tion des limites du bâti et des séparations des logements. (AI)
Fig. 4 : Trois systèmes parcellaires du Moyen EmpireCes trois plans de parcellaires sont des documents originaux, réa-
lisés à partir des plans présents dans KEMP Barry John, 1992 (2006), p. 212 (Fig. 4.1), p. 226 (Fig. 4.2) et p. 224 (Fig. 4.3). (AI)
Fig. 5 : Plan de la ville fortifiées de SolebCe plan est issu des publications du temple de Soleb, et notam-
ment des cartes de l’ouvrage SCHIFF GIORGINI Michela, 2003. L’en-semble est ici représenté dans son état final : le détail des aménage-ments à l’intérieur des enceintes n’est à ce jour pas connu. (AI)
Fig. 6 : Portion de vallée du NilCe schéma est un document original, dont les informations re-
coupent celles présentes dans la coupe de QUIRKE Stephen, 2005, p.45. (AI)
Fig. 7 : Carte d’Égypte montrant les carrièresLe fond de carte est redessiné à partir des cartes présentes dans
MANLEY Bill, 1996 (1998) tandis que les données concernant les car-rières sont, elles, extraites de NICHOLSON Paul T., SHAW Ian, 2000. (AI)
Fig. 8 : Plan d’invention d’un siteCe plan montre les lignes de niveau d’un site d’invention per-
mettant d’y installer un projet urbain fictif. La géographie du site est inspirée par l’analyse de cartes géographiques du territoire égyptien
222 223
URBANISME INSOUPÇONNÉ ANNEXES
et de l’observation de nombreux sites d’implantation. (VectorWorks, AI)
Fig. 9 : Vue d’un site typique d’implantationLe paysage composé ici est entièrement inventé : le cours de la
branche du Nil ainsi que le relief sont issus de l’analyse des cartes du territoire égyptien, et ont été sélectionnés dans le but de rendre au mieux un site «typique». L’ambiance globale est rendue d’après des photos des bords du Nil, issues d’un voyage personnel. Les textures utilisées sont réalisées à partir de photos. (3DS, PS)
Fig. 10 : Écorché d’une maison de Tell el-AmarnaCet écorché a été conçu en effectuant une synthèse de la plupart
des maisons de nobles de Tell el-Amarna, dont les plans sont dis-ponibles dans BORCHARDT Ludwig, RICKE Herbert, 1980, les éléva-tions sont elles, comme toujours, sujettes à caution mais inspirées par les travaux multiples sur l’habitat égyptien. (3DS, PS)
Fig. 11 : Écorché d’une maison de Deir el-MedinehLa source majeure de ce travail est le relevé des fouilles de Deir
el-Medineh par Bruyère (BRUYÈRE Bernard, 1939), qui présente des élévations des maisons de Deir el-Medineh. Le plan de la maison est également une synthèse et une simplification des plans d’édifices relevés. (3DS, PS)
Fig. 12 : Vue perspective d’un domaineLe plan de ce domaine est inspiré par les multiples plans de do-
maines présents dans BORCHARDT Ludwig, RICKE Herbert, 1980, de même que l’élévation est inspirée par la vue d’oiseau de KEMP Barry John, 1992 (2006), p. 328. Il a néanmoins été choisi de représenter
les linteaux aux portes d’entrée, ainsi qu’un sanctuaire couvert, afin de se détacher des contraintes atonistes de Tell el-Amarna. (3DS, PS)
Fig. 13 : Parcellaire d’un domainePlan parcellaire dessiné à partir du plan du domaine Q46.1 à Tell
el-Amarna (BORCHARDT Ludwig, RICKE Herbert, 1980), choisi pour sa relative simplicité, le caractères complet de son plan et sa dimen-sion moyenne. (AI)
Fig. 14 : Perspective d’une maison isolée typeCette représentation est librement inspirée par de nombreuses
perspectives et axonométries de maisons égyptiennes, et correspond aux plans de maisons isolées. (3DS, PS)
Fig. 15 : Parcellaire d’une maison isoléePlan parcellaire dessiné à partir du plan de la maison Q47.13 à
Tell el-Amarna (BORCHARDT Ludwig, RICKE Herbert, 1980). (AI)
Fig. 16 : Perspective d’une maison de groupe bâti homogèneL’élévation et le plan de cette maison sont issus des travaux pré-
sents dans KEMP Barry John et al., 1986, qui montrent une pers-pective axonométrique d’une maison du village des artisans de Tell el-Amarna. (3DS, PS)
Fig. 17 : Parcellaire d’un maison de groupe bâti ho-mogènePlan parcellaire dessiné à partir du relevé de fouilles de Tell
el-Amarna publié dans PEET T. E., WOOLLEY Leonard C., 1923. (AI)
224 225
URBANISME INSOUPÇONNÉ ANNEXES
Fig. 18 : Identification du parcellaire de Deir el-BallasPlan parcellaire dessiné à partir du relevé des fouilles de Deir
el-Ballas (LACOVARA Peter, 1990). Les limites des parcelles, approxi-matives, sont sujettes à caution. (AI)
Fig. 19 : Vue d’une maison isolée dans son contextePerspective d’invention, les critères de conception du site en ar-
rière plans sont évoqués dans la description de la figure 7. La maison respecte les standards de l’habitat tel qu’il peut être observé à Tell el-Amarna et dans d’autres sites, en choisissant de se limiter à une re-constitution à un seul étage. En arrière plan, un domaine et ses deux entrées, l’une, principale, permettant d’accéder à la maison, et l’autre permettant d’accéder aux dépendances. (3DS, PS)
Fig. 20 : Section de venelle largeur 1,60mSection en perspective, les hauteurs sont déduites des travaux
de BRUYÈRE Bernard, 1939 tandis que la couverture est imaginée en matériaux légers de type feuilles de palmiers. Ces matériaux ne sont généralement pas conservés et sont donc purement hypothétiques. (3DS, PS)
Fig. 21 : Section de venelle largeur 2mSection en perspective, les hauteurs sont déduites de travaux de
BRUYÈRE Bernard, 1939. (3DS, PS)
Fig. 22 : Section de venelle largeur 2,2mSection en perspective, les hauteurs sont ici obtenues en ajou-
tant un étage d’environ deux mètres soixante au rez-de-chaussée. Les
rebords des murs permettent néanmoins d’imaginer un toit terrasse accessible. (3DS, PS)
Fig. 23 : Réseau de venelles de Deir el-MedinehPlan des espaces publics de Deir el-Medineh obtenu à partir du
plan du site de BRUYÈRE Bernard, 1939 en ne faisant figurer que l’espace de la venelle. (AI)
Fig. 24 : Réseau de voirie à Tell el-AmarnaPlan des espaces publics des secteurs P47 et Q47 de Tell el-Amar-
na obtenu à partir des plans de BORCHARDT Ludwig, RICKE Herbert, 1980. Les limites de l’espace public au nord-est sont parfois difficile à cerner étant donné la faible densité du bâti dans cette zone. (AI)
Fig. 25 : Section de rue de largeur 12mSection en perspective, le choix de bâti irrégulier le long de la
rue permet de montrer le manque de régularité des limites bâties de l’espace public, sans pour autant empiéter sur la largeur importante de la rue. (3DS, PS)
Fig. 26 : Section de voie processionnelleSection en perspective, dont les hauteurs sont obtenues à par-
tir des spécifications dans l’ouvrage CABROL Agnès, 2001. Le détail des sphinx, spécifique ou presque à chaque site, n’est pas représenté. (3DS, PS)
Fig. 27 : Plan du système de drainage d’AmaraPlan montrant la position et l’étendue du système de drainage
de la porte ouest d’Amara. Obtenu à partir du plan des fouilles de SPENCER Patricia , 1997. (AI)
226 227
URBANISME INSOUPÇONNÉ ANNEXES
Fig. 28 : Représentation du «Pont de Tell el-Amarna»Perspective montrant le pont de l’Avenue Royale à Tell el-Amar-
na. Étant donné l’état des vestiges (il ne reste que la base des murs de l’ensemble), l’élévation relève d’un travail hypothétique. La référence principale est le plan, relevé dans PENDLEBURRY John D. S., 1951 et la vue perspective issue du même ouvrage. Malheureusement, celle-ci donne des proportions aux éléments qui ne tiennent pas compte des relevés du plan. Une autre référence est la maquette de Boston (KEMP Barry John, 2012 (2013)), qui représente une construction bien plus sobre. On a fait ici le choix de conserver l’aménagement d’une fe-nêtre d’apparition, tout en conservant l’idée du linteau brisé, chère à l’architecture atoniste. Le plan ne révèle pas l’existence de jambages de pierre, aussi seuls les linteaux sont dans ce matériau. La hauteur de l’édifice est obtenue en trouvant une proportion convenable pour la porte, proche des canons égyptiens. Il en ressort une construction bien plus imposante que celle représentée dans PENDLEBURRY John D. S., 1951 mais a priori plus en accord avec les relevés archéolo-giques. (3DS, PS)
Fig. 29 : Plan de la place du village des Artisans de Tell el-AmarnaPlan obtenu à partir des relevés de PEET T. E., WOOLLEY Leonard
C., 1923, en ne faisant figurer que l’espace public au sud du site. (AI)
Fig. 30 : Plan d’une place dans le secteur Grille 12 à Tell el-AmarnaPlan obtenu à partir de l’analyse des espaces publics du secteur
de la grille 12 publiés dans KEMP Barry John, STEVENS Anna, 2010. (AI)
Fig. 31 : Vue d’une ruelle et d’une rue dans leur contextePerspective d’invention, la largeur, la couverture et l’aménage-
ment de la venelle sont conformes aux observation faites dans tout le chapitre, de même que l’aménagement et les bâtiments longeant la rue. La présence du réservoir d’eau, bien que non attestée sur tous les sites permet de donner une idée de l’emplacement et de la forme de ce type d’aménagement. (3DS, PS)
Fig. 32 : Plan du parcellaire de Medinet HabouCette portion nord-est du plan parcellaire du temple de Medinet
Habou est issue de l’analyse des plans publiés dans HÖLSCHER Uvo, 1951 qui montre clairement la répétition d’un même type d’habitat le long de deux voies. (AI)
Fig. 33 : Section perpective des logements de Medi-net HabouCette section perpective est obtenue à partir des plans, coupes et
relevés publiés dans HÖLSCHER Uvo, 1951. Un certain degré d’inter-prétation a néanmoins été nécessaire, notamment pour gérer l’éclai-rage et l’aération de l’étage supérieur des habitats. (3DS, PS)
Fig. 34 : Parcellaire du «Walled Village» de MalkataLe parcellaire présenté est issu de l’analyse des plans du village
publiés dans IIDA Kishuro et al., 1993. (AI)
Fig. 35 : Quatre îlots et parcellaire de SesebiLe plan original de la ville de Sesebi, relevé par Fairman a été re-
pris dans deux ouvrages (LACOVARA Peter, 1997 et MONNIER Franck, 2010) qui ont servi à l’analyse de ce parcellaire. Le contour des por-tions sud, très endomagées, est une restitution hypothétique. (AI)
228 229
URBANISME INSOUPÇONNÉ ANNEXES
Fig. 36 : Trois macro-îlots à Tell el-AmarnaLes contours de ces trois îlots sont obtenus grâces aux relevés
effectués dans KEMP Barry John, GARFY Salvatore, 1993, et notam-ment des secteurs est de la Main City North. Le choix des domaines représentés, les plus importants, est basé sur une limite de taille ar-bitraire. (AI)
Fig. 37 : Vue rapprochée sur un îlot de Tell el-AmarnaLe parcellaire de cet îlot, correspondant aux secteurs P47 et P48,
est issu des plans publiés dans KEMP Barry John, GARFY Salvatore, 1993. Les entrées de logements ne sont visibles à cette échelle que pour les domaines. (AI)
Fig. 38 : Plan montrant le positionnement des macro-îlots sur le site d’inventionCe plan reprend le site de la figure 8 et y place les macro-îlots
suivant les préceptes étudiés dans le chapitre correspondant. (Vec-torWorks, AI)
Fig. 39 : Vue d’oiseau de quartiers résidentielsL’ensemble du site est réalisé en tenant compte des typologies
d’habitat observées, ainsi que de l’organisation urbaine en macro-îlots. L’image se compose de six îlots standards qui sont recomposés selons diverses combinaisons afin de créer l’illusion de la diversité urbaine. (3DS, PS)
Fig. 40 : Alignement de boulangeries à Tell el-AmarnaCette représentation de l’ensemble des bâtiments des boulange-
ries de Tell el-Amarna est issue des plans de KEMP Barry John, GARFY Salvatore, 1993 du secteur Q40. Seules les limites d’emprise au sol sont représentées, les murs de cloture des espaces extérieurs ne sont pas pris en compte. (AI)
Fig. 41 : Plan des greniers d’EdfouLe plan de l’emprise des greniers est issu du rapport de fouilles
du site d’Edfou paru dans MOELLER Nadine, 2010. Les détails de l’intérieur des silos n’ont pas été représentés. (AI)
Fig. 42 : représentation perspective de greniersLa représentation perspective est issue d’une part des observa-
tions sur la forme des silos publiées dans NICHOLSON Paul T., SHAW Ian, 2000 et des représentations publiées dans MONNIER Franck, 2013 ainsi que dans de nombreuses représentations des domaines de Tell el-Amarna. (3DS, PS)
Fig. 43 : Représentation perspective d’un ensemble typique d’entrepôtsCette vue perspective ne représente pas d’entrepôts en particu-
lier, mais s’appuie sur les dimensions des entrepôts de Medinet Ha-bou, ainsi que sur l’architecture typique de ce genre d’ensemble, étu-diée dans GOYON Jean-Claude et al., 2004. (3DS, PS)
Fig. 44 : Plan des entrepôts de Medinet HabouPlan issu des relevés parus dans HÖLSCHER Uvo, 1951. (AI)
Fig. 45 : Organisation parcellaire des bureaux admi-nistratif de Tell el-AmarnaCe parcellaire est issu des plans publiés dans KEMP Barry John,
2012 (2013). Les parcelles des parties nord et est ne sont pas lisibles et seuls les contours des îlots le sont. (AI)
Fig. 46 : Positionnement du palais de KarnakCe plan est issu des recherches sur le positionnement d’un palais
de la XVIIIème dynastie en avant du temple de Karnak, parues dans GITTON Michel, 1974. Cependant, les dimensions du palais ont été
230 231
URBANISME INSOUPÇONNÉ ANNEXES
augmentées afin de se conformer aux standards de l’époque, notam-ment au regard des palais de Malkata. (AI)
Fig. 47 : Plan du palais de MalkataLe plan est issu des fouilles archéologiques du site publiées dans
IIDA Kishuro et al., 1993, tandis que seuls sont représentés en détails les espaces effectivement traversés pour atteindre les appartements du roi. (AI)
Fig. 48 : Plan du temple de Medinet HabouPlan issu des relevés parus dans HÖLSCHER Uvo, 1951. (AI)
Fig. 49 : Parvis d’un templeReprésentation effectuée en utilisant les dimensions des diffé-
rents éléments tels qu’ils devaient se présenter à Medinet Habou, en utilisant les sources HÖLSCHER Uvo, 1951 et WILKINSON Richard H., 2000. (VectorWorks, PS)
Fig. 50 : Perspective d’une chapelle construite en dehors de l’espace du templeLe modèle de cette chapelle est celui de la Chapelle Blanche de
Sésostris Ier, publiée par Henri Chevrier, qui est restée longtemps un modèle d’architecture pour les anciens égyptiens. Le modèle, réali-sé par Paul François pour le Site Internet du Projet Rosette (http://projetrosette.info/page.php?Id=799&TextId=66) a ici simplement fait l’objet d’un nouveau rendu et de nouvelles textures. Il est issu d’une collaboration avec Vincent Euverte et Raymond Monfort, lors de l’année 2008, pour la publication sur Internet de l’intégralité des textes de ce monument. (3DS, PS)
Fig. 51 : Position des principaux objets-repères sur le site d’inventionLa position de l’ensemble des objets-repères suit les grandes lignes
des éléments définis dans LACOVARA Peter, 1997. (VectorWorks, AI)
Fig. 52 : Vue de deux objets-repèresVue depuis l’esplanade du temple et du palais administatif. Il a
été choisi de représenter la façade du palais royal avec un pylône simi-laire (bien qu’en briques et plus réduit) à celui du temple. Ce choix s’explique par la similarité de fonctionnement entre ces deux entités et par certains vestiges architecturaux, notamment à Tell el-Amar-na, qui semblent indiquer que les pylônes (à un ou deux môles) for-maient également l’entrée monumentale des palais. (3DS, PS)
Fig. 53 : Directions principales d’ensembles urbainsCes schémas ont été réalisés à partir de l’analyse des plans de
plusieurs établissements urbains, publiés dans PEET T. E., WOOLLEY Leonard C., 1923 pour Tell el-Amarna, BRUYÈRE Bernard, 1939 pour Deir el-Medineh, IIDA Kishuro et al., 1993 pour Malkata et LACOVARA Peter, 1997 pour Sesebi. (AI)
Fig. 54 : Tracé des voies principales de Tell el-AmarnaCe tracé est effectué à partir des plans de la ville publiés dans
KEMP Barry John, GARFY Salvatore, 1993. Le choix a été fait de ne pas représenter de continuité bâtie à la place des ouadi, en supposant que ceux-ci étaient déjà présents durant l’époque antique. (AI)
Fig. 55 : Courbes de niveau et vestiges de Deir el-Bal-lasCette carte est issue du travail de LACOVARA Peter, 1990. Lorsque
possible, les ensembles bâtis complets ont été dessinés clairement, mais de nombreuses zones restent non fouillées. (AI)
232 233
URBANISME INSOUPÇONNÉ ANNEXES
Fig. 56 : Plan des voies processionnellesPlan réalisé d’après les plans publiés dans KEMP Barry John,
1992 (2006) pour le tracé global des voies. Le plan de Karnak est quant à lui issu de CHEVRIER Henri, 1936 où seules sont représentées les structures du Nouvel Empire. L’enceinte de Karnak dessinée est celle de l’époque tardive, car il n’existe pas à ce jour de plan complet de l’enceinte du Nouvel Empire. (AI)
Fig. 57 : Organisation des palais et temples de Tell el-AmarnaLe fond de carte correspond aux travaux de KEMP Barry John,
GARFY Salvatore, 1993, tandis que l’analyse du fonctionnement et du tracé de la voie principale sont issus entre autres de KEMP Barry John, 1992 (2006) et de LABOURY Dimitri, 2010. (AI)
Fig. 58 : Organisation des palais de Deir el-BallasLe fond de carte correspond aux relevés publiés dans LACOVARA
Peter, 1990 tandis que l’analyse du tracé et de la répartion des prin-cipaux bâtiments est issue de LACOVARA Peter, 1992.
Fig. 59 : Plan des axes directeurs du site d’inventionLes axes directeurs sont mis en place en fonction notamment
de la position des objets-repères, mais également du cours du Nil, conformément aux observations du chapitre correspondant. (Vec-torWorks, AI)
Fig. 60 : Vue de l’avenue principale du siteLe temple au premier plan suit les conceptions architecturales
fréquentes durant le Nouvel Empire (consulter à ce sujet WILKINSON Richard H., 2000) tandis que l’organisation des quartiers urbains a déjà été développée. Le temples ouest, avec son pylône orienté à l’ouest est une particularité qui reprend certains traits architecturaux
du temple de Louxor, ou du temple de Karnak avec ses deux orienta-tions principales. (3DS, PS)
Fig. 61 : Phases de densification d’un quartier à Tell el-AmarnaL’analyse du développement historique des bâtiments de ce sec-
teur (P47) de Tell el-Amarna est issu des relevés au 150ème des dif-férentes maisons parus dans BORCHARDT Ludwig, RICKE Herbert, 1980. Les différentes phases sont issues d’une observation morpho-logique des parcelles et habitats (certains formes ne s’expliquent en effet que par leur postériorité par rapport à des bâtiments plus an-ciens) ainsi que certains détails structurels (certaines constructions s’appuient sur d’autres). (AI)
Fig. 62 : Développement urbain d’Avaris et de Pi-RamsèsCarte réalisée à partir du travail publié dans BIETAK Manfred,
1975. (AI)
Fig. 63 : Phases d’occupations du site d’AmaraCes plans sont directement issus des relevés stratigraphiques de
l’étude archéologique parue dans SPENCER Patricia , 1997.
Fig. 64 : Vue globale de la ville projetéeCette vue reprend l’ensemble des propriétés et détails déjà évo-
qués dans les précédentes perspectives. (3DS, PS)
259
Table des Matières
Introduction 9De l’urbanisme en Égypte Ancienne ? 11État de la question 12Problématique et méthodologie 15
«Ville» en Égypte Ancienne 21Qu’est-ce qu’une ville ? 22L’Égypte, un contexte unique 27Trois mille ans d’évolution de la ville 32
Fonder une ville 41Villes Nouvelles en Égypte Ancienne 42Construire une ville nouvelle 43Les acteurs d’un projet de ville 52Choisir un site 56Projection 62
260 261
URBANISME INSOUPÇONNÉ TABLE DES MATIÈRES
L’espace privé : le parcellaire 69Le parcellaire, une notion égyptienne 70Logements et densités 71Le domaine, un type urbain privilégié 76La maison, principe fondamental de l’urbanisation 82Projection 89
L’espace public : rues et places 93Commerce et transports 94Venelles, rues, avenues et voies processionnelles 95Places et esplanades 108Projection 113
Tissus urbains : rangées et îlots 117Plans en Égypte Ancienne 118Rangées ou îlots réfléchis 120Îlots peu planifiés ou organiques 128Projection 134
Objets repères 141Croyances des anciens égyptiens 142Production, distribution et stockage 144Administration et armée 152Palais royaux 157Temples et espaces sacrés 163Projection 172
Tracés à l’échelle de la ville 177Pouvoir et polarités urbaines 178Tracés et contraintes géographiques 179Tracés et objets repères 187Projection 195
Conclusion : La ville à l’épreuve du temps 201Densifier, étendre et modifier 202Urbanisme insoupçonné 211
Annexes 219Table technique des illustrations 220Frise historique 234Carte de l’Égypte 242Carte de la région Thébaine 243
Bibliographie 245Urbanisme 245Égypte Ancienne 246Ville en Égypte Ancienne 252
Table des Matières 259
École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon3 rue Maurice-Audin, BP 17069512 Vaulx-en-Velincourriel : [email protected] internet : www.lyon.archi.fr
![Page 1: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013109/631ca7d5665120b3330bf65c/html5/thumbnails/65.jpg)