Génie électrique et électronique Systèmes d'apprentissage et ...
Tristan et Iseut (Béroul, XIIe s.) ‐ Commentaire et analyse d’un extrait en ancien français
Transcript of Tristan et Iseut (Béroul, XIIe s.) ‐ Commentaire et analyse d’un extrait en ancien français
Tristan et Iseut (Béroul, XIIe s.)
-‐ Commentaire et analyse d’un extrait en
ancien français
Diachronie van het Frans
Sally Witdouck, Michiel Van Kampen & Tristan-‐David Depré
Prof. dr. M. Van Peteghem – Dr. M. Van Acker année universitaire: 2013-2014
1
Table des matières
1. Introduction
1.1. L’origine du texte
1.2. Troubadours
1.3. Caractéristiques du texte
2. Choix du fragment
3. Ancien français
3.1. Graphie
3.2. Lexique
3.3. Morphologie
3.4. Syntaxe et ordre des mots
4. Synthèse et conclusions
Bibliographie
2
1. Introduction
1.1. L’origine du texte
Dans ce travail, nous allons traiter du manuscrit de Tristan et Iseut de Béroul, écrit en
ancien français, une version que l’on situe aux XIIème et XIIIème siècles. Comme beaucoup
d’autres récits de ce genre, l’histoire de Tristan et Iseut est issue de la tradition orale. Avant
que Béroul - l’auteur de notre version – l’ait écrit, on chantait l’histoire en poème, ce qui
entraînait des adaptations aux différents contextes, ainsi que différentes versions du même
récit. L’histoire trouve son origine dans les légendes celtiques, et se déroule autour de la Mer
d’Irlande, au Pays de Galles, en Ecosse et en Bretagne (Eggenberger 2009).
L’histoire de Tristan et Iseut voyage partout dans le monde médiéval et connaît un
grand succès grâce au commerce. Les marchands l’emportent en dehors de la région des
anciens celtes. Ainsi l’histoire reçoit d’autres motifs et de nouvelles idées. Ces différentes
versions sont à l’origine de la réalisation de beaucoup de manuscrits au XIIème siècle, mais
malheureusement, on ne dispose pas des versions intégrales. Il surgit quelques auteurs
proéminents avec leurs propres manuscrits, comme Béroul ou Thomas d’Angleterre.
Le texte sur lequel nous nous sommes basés, est celui de Béroul. Contrairement à
l’autre grand auteur de cette même histoire, Thomas d’Angleterre, on sait peu de la vie de
Béroul. Grâce aux caractéristiques de son langage, on peut déduire qu’il s’agit d’un Normand,
mais on ne peut pas confirmer si Béroul est l’auteur ou la source de l’auteur (Braet 1999) : Il
se désigne deux fois dans son récit comme auteur, aux vers 1268 et 1790 où il se représente
comme « Bérox ». Braet (1999) pose qu’il s’agit de quelqu’un qui connaît l’Angleterre et qui
a visité les lieux comme Tintagel en Cornouailles. Sa connaissance de la géographie
particulière de la région semble souligner ceci. Quant au manuscrit incomplet, on distingue
deux parties différentes : il se compose d’une partie écrite en 1170 et d’une autre partie écrite
plus tardivement. Une remarque intéressante est l’usage des mots qui proviennent de
l’anglais : dans la fameuse scène avec le philtre, Béroul utilise le mot lovendrinc ou
lovendrant, ce qui fait supposer qu’il se dirige à un public familier avec la langue anglaise,
renforçant l’idée qu’il est un Normand demeurant en Angleterre (Lavielle 2000).
3
1.2. Troubadours
Les troubadours dans le Sud et les trouvères dans le Nord de la France étaient des
artistes qui créent des textes, mais ne les interprétaient pas forcément eux-mêmes. Les thèmes
courants étaient la vie des chevaliers, l’amour courtois ou des pièces comiques ou satiriques.
Les troubadours étaient invités à plusieurs cours, où des mécènes comme Aliénor d’Aquitaine
les accueillent (Darcos 1992).
En France méridionale, les troubadours créaient à partir de la tradition orale une
littérature avec un amour plus concret, plus charnel, alors qu’au Nord, les trouvères décrivent
en langue d’oïl un amour plus idéalisé. Les deux récits les plus importants de Tristan et Iseut,
ceux de Béroul et Thomas d’Angleterre, sont tous les deux écrits en langue d’oïl, le dialecte
anglo-normand (Darcos 1992).
Le roman révèle plusieurs traits courtois comme le développement psychologique des
personnages et la présence du fin’amor, qui engendre la réflexion sur l’amour. Néanmoins, en
analysant le roman de Béroul, on découvre plusieurs infractions contre les codes de l’amour
courtois comme le phénomène que tout paraît être permis dans l’amour et l’incapacité des
amants de maîtriser leur désir.
Béroul n’est pas intéressé par l’introspection des personnages et leurs états d’âme,
contrairement à Thomas d’Angleterre. Voilà pourquoi l’on remarque souvent que le récit de
Béroul se rapproche plutôt du genre épique (Braet 1999).
1.3. Caractéristiques du texte
La versification octosyllabique du poème est à rime plate, la première partie est
classée en quatrains et la seconde partie en ancien couplet brisé (Braet 1999).
Selon Braet (1999), le comportement des deux amants peut aussi se diviser en deux
parties : d’abord on retrouve le comportement inspiré par la magie du désir du philtre, après
on constate la fidélité amoureuse qui inspire l’élimination des traitres et la réintégration
sociale.
Selon le même auteur, une autre caractéristique remarquable est l’oralité du récit qui
influence la syntaxe, caractérisée par une rhétorique très forte et pleine d’exclamation.
4
2. Choix du fragment
L’histoire de Tristan et Iseut est une histoire intemporelle, qui a changé la littérature
occidentale, en fixant l’image de l’amour tragique.
Nous avons choisi le fragment dans lequel les amoureux sont découverts par la ruse du
nain Frocin. C’est un moment clef dans le récit parce que ceci oblige le roi Marc d’affronter
les chuchotements : le couple couche ensemble et les barons menacent de quitter la cour si le
roi Marc ne dénonce pas Tristan et Iseut. Le nain Frocin propose un piège à Marc pour révéler
ce secret et le roi accepte. Frocin répand de la farine entre le lit de Tristan et celui d’Iseut,
pour qu’on puisse voir les traces de Tristan quand il irait chez elle. Tristan comprend la ruse
du nain et saute de façon qu’il ne laisse pas de traces dans la farine. Malgré son idée
ingénieuse, les deux amants seront tout de même découverts, parce qu’une récente blessure de
chasse de Tristan se rouvre à cause de la saute. Le sang se répand dans le lit et toute la cour
les prend en flagrant délit.
5
Molt fu li nain de grant voidie, 673 : Le nain, qui était plein d’astuce,
Molt par fist rede felonie : ourdit la machination la plus terrible :
Cil en entra chiés un pestor, Il se rendit chez un boulanger
Quatre derees prist de flor, 676 Et lui prit pour quatre deniers de fleur de farine
Puis la lia a son gueron. Qu’il serra sous sa ceinture.
Qui pensast mais tel traïson ? Qui aurait jamais imaginé une telle ruse ?
La nuit, qant ot li rois mengié, Le soir, après le repas du roi,
Par la sale furent couchié. 680 On se coucha dans la salle ;
Tristran alla le roi couchier. Tristran alla coucher le roi.
« Beaus niés », fait-il, « je vos requier, « Cher neveu, » fait celui-ci, « je vous prie
Ma volenté faites, gel vuel : de faire ce que je désire, c’est un ordre :
Au roi Artus, jusqu’a Carduel, 684 Il faudra vous rendre à cheval
Vos covendra a chevauchier ; auprès du roi Arthur, à Carlisle ;
Cel brief li faites desploier. Faites-lui ouvrir cette lettre.
Niés, de ma part le salüez, Mon neveu, saluez-le de ma part et
o lui c’un jor ne sejorner. » 688 ne restez qu’un jour avec lui. »
Du mesage ot Tristran parler, En entendant parler du message,
Au roi respont de lui porter : Tristran assure le roi qu’il ira le porter :
« Rois, ge irai bien par matin. » « Roi, je partirai de bon matin,
— « O vos, ainz que la nuit ait fin. » 692 - oui, avant la fin de la nuit. »
Tristran fu mis en grant esfroi ; Voilà Tristran en grand émoi ;
Entre son lit et cel au roi Entre son lit et celui du roi
Avoit bien le lonc d’une lance. Il y avait bien la longueur d’une lance.
Trop out Tristran fole atenance : 696 Il vint à Tristran une idée par trop insensée :
En son cuer dist qu’il parleroit Il se promit en son cœur
A la roïne, s’il pooit, Qu’il verrait, s’il le pouvait, la reine,
Qant ses oncles ert endormiz. Quand son oncle serait endormi.
6
Deus, quel pechié ! trop ert hardiz ! 700 Dieu, quel malheur ! Il était par trop téméraire !
Li nains la nuit en la chanbre ert, Cette nuit-là, le nain était dans la chambre.
Oiez comment cele nuit sert . Ecoutez comment il agit au cours de la nuit.
Entre deus liez la flor respant, Il répand la farine entre les deux lits,
Que li pas allent paraisant 704 de manière qu’apparaissent les traces de pas.
Se l’un a l’autre la nuit vient : Si l’un d’eux rejoint l’autre pendant la nuit :
La flor la forme des pas tient. La fleur de farine garde l’empreinte des pas
Tristran vit le nain besuchier Tristran vit le nain s’affairer
Et la farine esparpellier ; 708 Pour répandre la farine ;
Porpensa soi que ce devoit, Il se demanda ce que cela pouvait signifier,
Qar si servir pas ne soloit. Car il (le nain) n’avait pas l’habitude d’agir ainsi.
Pus dist : « Bien tost, a ceste place Puis il se dit : « Il pourrait bien répandre ici
Espandroit flor por nostre trace 712 de la farine pour repérer nos traces
Veer, se l’un à l’autre iroit. Et voir si l’un rejoindrait l’autre.
Qui iroit or, que fous feroit ; Bien fou qui irait maintenant ;
Bien verra mais se or i vois. » Il verra bien si j’y vais ! »
Le jor devant, Tristran, el bois 716 La veille, dans la forêt, Tristran
En la janbe nafrez estoit Avait été blessé à la jambe
D’un grant sengler ; molt se doloit. Par un gros sanglier ; il souffrait beaucoup.
La plaie molt avoit saignié ; La plaie avait abondamment saigné ;
Deslïez ert, par son pechié. 720 Pour son malheur, elle n’était plus bandée.
Tristran ne dormoit pas, ce quit. Tristran ne dormait pas, j’imagine ;
Et li rois live a mie nuit. Le roi s’est levé à minuit
Fors de la chanbre en est issuz. Et est sorti de la chambre ;
7
O lui ala li nains boçuz. 724 Le nain bossu est parti avec lui.
Dedenz la chanbre n’out clartez, Dans la chambre, aucune lumière ;
Cirge ne lanpë alumez. Il n’y avait d’allumé ni chandelle, ni lampe.
Tristran se fu sus piez levez. Tristran s’est mis debout.
Deus! por qoi fist ? Or escoutez ! 728 Dieu ! Pourquoi fit-il cela ? Ecoutez donc !
Les piez a joinz, esme, si saut, Il joignit les pieds, évalua la distance, sauta
El lit le roi chaï de haut. Et retomba dans le lit du roi.
8
3. Ancien français
3.1. Graphie
L’ancien français se caractérise par différents phénomènes ; il est important de
signaler ces caractéristiques typiques, mais en même temps on relèvera des aspects introduits
plus tardivement par des éditeurs modernes pour rendre le manuscrit plus lisible.
Dans l’orthographe, l’on peut distinguer plusieurs consonnes qui se confondent à
l’écrit. Les lettres u et i suffisaient en latin pour les voyelles et semi-voyelles, ce qui n’était
plus le cas en ancien français. Néanmoins, l’on continuait à utiliser ces deux lettres, ce qui
causait beaucoup de confusion. L’auteur a cherché d’autres solutions pour résoudre le
problème en utilisant d’autres lettres, ainsi l’on rencontre aussi bien ge (v.691) que je (v.682).
La plupart des confusions ont été enlevées par les éditeurs modernes, mais il y a toujours
quelques différences comme i (v.715) au lieu de y (Bonnard & Régier 1989).
L’emploi du tréma est un phénomène qui est propre à l’ancien français en scripta
anglo-normand (Bonnard & Régier 1989) : les manuscrits se caractérisent bel et bien de
quelques trémas pour signaler un hiatus et ainsi désambigüiser plusieurs interprétations. Dans
le récit investigué, l’on retrouve plusieurs trémas ajoutés par des éditeurs modernes puisque
l’usage du tréma était rare en ancien français. Ainsi nous pouvons distinguer traïson (v.678),
salüez (v.686), roïne (v.698), desliëz (v.720), lanpë (v.726) et chaï (v.730).
L’usage de la cédille n’est pas propre à la langue d’oïl mais de toute façon, nous en
retrouvons une. Ceci révèle l’intervention d’un éditeur moderne, qui a rectifié l’omission d’un
e intercalaire « pour marquer le timbre doux de la lettre c devant un a ou un o » (Bonnard &
Régier 1989 : 11). Généralement, les scribes mettaient un e intercalaire dans ce cas : boceuz.
L’apparition de la cédille dans le mot boçuz (v.724) est donc postérieure à la rédaction.
L’emploi de la majuscule dans le fragment est très moderne ; les scribes l’utilisaient
pour indiquer les titres de la noblesse (Bonnard & Régier 1989). Dans le fragment, nous
relevons l’usage moderne des majuscules, avec des noms propres comme Tristran (v.689),
Carduel (v.683) ou Artus (v.683). Nous remarquons le même phénomène avec la
ponctuation : dans les manuscrits de l’ancien français, il n’y avait que le point. Tous les signes
comme les deux points, les virgules, les points d’exclamation, les points d’interrogation et les
guillemets sont ajoutés par les éditeurs modernes pour rendre le texte plus lisible (Bonnard &
Régier 1989).
9
Les abréviations latines typiques comme Diex pour Dieus ou des abréviations hybrides
françaises ne s’utilisent pas dans le fragment (Bonnard & Régier 1989). Les éditeurs ont aussi
ajouté l’apostrophe : dans les textes en ancien français, les scribes sautaient les voyelles des
petits mots grammaticaux qui précédaient des mots commençant par une voyelle (Bonnard &
Régier 1989). Les combinaisons s’il (v.698), l’un (v.705) et l’autre (ibidem) étaient
respectivement écrites comme sil, lun et lautre.
Nous constatons que quelques traits régionaux de l’accent anglo-normand comme un o
fermé tonique libre, qui ne construit pas la diphtongue [ou] mais qui s’est simplifié en o en
dialecte anglo-normand comme flor. Nous remarquons aussi la tradition gallo-romane du yod
par g devant i comme en mengié (Biedermann-Pasques 1990 : 36).
3.2. Lexique
Dans cette partie, nous allons observer le lexique du fragment de Tristan et Iseut. En
général, nous retrouvons beaucoup de mots qui survivent jusqu’à nos jours. Naturellement ils
subissent des changements phonétiques, graphiques et sémantiques, mais en grande partie
nous reconnaissons le mot actuel. Nous commençons par les mots les plus ‘latins’, pour finir
par ceux plus proches du français moderne.
Si nous entamons la recherche par les mots latins, un cas saute directement à l’œil :
dans le vers 700 nous avons deus, qui est la forme latine pour dieux ou divinité.
En outre, nous n’avons plus trouvé de mots en forme latine, mais nous découvrons
assez de formes hybrides qui montrent leur origine latine et qui sont en voie de s’adapter aux
règles françaises. Dans ce cas-ci il y a trois options : ou bien ils disparaissent en français
moderne, soit ils apparaissent en français moderne, ou ils s'attestent sous une forme modifiée.
Beaucoup de mots proviennent du latin, mais il existe aussi des termes avec une autre origine.
Si nous examinons les formes hybrides dans le fragment, les suivantes disparaitront en
français moderne :
(1) Molt fu li nain de grant voidie (v.673)
(2) « O vos, ainz que la nuit ait fin. » (v.692)
(3) Tristran vit le nain besuchier (v.707)
(4) Porpensa soi que ce devoit (v.709)
10
L’exemple (1) voidie, qui signifie ruse, tromperie ou machination vient de la forme
latine vitium selon le Dictionnaire du moyen français (DMF). Selon le même ouvrage, il
s’agit d’un mot déjà vieilli en moyen français. Dans l’exemple (2), nous voyons une
dérivation du mot latin ante (DMF), qui a probablement disparu par compétition avec le
synonyme avant (ab ante en latin). De même pour besuchier (3), dont la signification est
épargner, avoir pitié ou ménager selon Godefroy. Actuellement, besuchier ne forme plus
partie du vocabulaire français. L’exemple (4) porpensa nous montre que la signification du
préfixe por est superflue. Jadis, l’affixe ajoutait une signification, c’est-à-dire que le mot
signifiait penser mûrement à quelque chose. De suite, por a probablement disparu par
épuisement de sens de l’affixe.
Ensuite nous voyons quelques mots en voie de disparition ; ils ne s'utilisent que dans
des énoncés archaïques ou pour expliquer un texte ancien. Ici, il s’agit d’objets disparus qui
entraînent une disparition lexicale :
(5) Quatre derees prist de flor (v.676)
(6) Puis la lia a son gueron (v.677)
(7) Qar si servir pas ne soloit. (v.710)
D’après Godefroy, derees (5) s'est attribué plusieurs sens, mais signifie en premier lieu
la valeur d'un denier, quantité de marchandise, un douzième du sou (Glossaire du Roman de
Tristan). Le latin denarius (pièce de monnaie) veut actuellement dire ancienne monnaie, ce
qui indique déjà sa disparition graduelle. L'objet gueron (6) (originaire du verbe latin gero qui
signifie porter, tenir avec soi) est un pan coupé en pointe à droite et à gauche de la robe ou
de la tunique ou espace qui s'étend de la ceinture jusqu'aux genoux d'une personne assise
(Godefroy). Ainsi le terme actuel giron a la signification de pan de vêtement taillé en pointe
(Petit Robert), mais s'utilise plutôt dans un sens figuré comme sein. Si nous regardons le
verbe soloit (7), un hispaniste reconnaît directement soler (avoir l'habitude), mais un
francophone ne le reconnaît guère. En effet, le mot s'utilise seulement en imparfait dès le
16ème siècle et finit par disparaître complètement (Trésor de la langue française informatisée
(TLFi)).
Nous continuons à examiner les formes hybrides qui modifient de forme ou de
fonction au cours de leur itinéraire linguistique. Dans les exemples (8) et (9), il s'agit d'un
changement formel et dans les autres exemples (10), (11) et (12) nous avons affaire à un
changement de catégorie grammaticale:
11
(8) Les piez a joinz, esme, si saut (v.729)
(9) Et li rois live a mie nuit. (v.721)
(10) Cel brief li faites desploier (v.685)
(11) D’un grant sengler ; molt se doloit. (v.718)
(12) Fors de la chanbre en est issuz. (v.723)
Le mot latin aestimare s'est transformé en esmer (8) en ancien français, mais par la
disparition plus tardive du s, il surgit une confusion au plan phonétique avec aimer. Ainsi
esmer (8) est remplacé par estimer, une forme plus proche du latin, pour éviter l’homonymie
(TLFi). L’adjectif mie (9) et le substantif nuit se joignent pour donner minuit en français
moderne, mais l’adjectif a perdu l’accord avec le substantif dans ce processus. Dans le cas
suivant, brief (10) est une invention substantivée de l’adjectif latin brevis. En ancien français
deux catégories coexistent : d'un côté l'adjectif bref (signifiant court) et de l'autre côté, le
substantif pour un écrit bref (Godefroy). En français moderne, l'adjectif reste tel quel, mais le
substantif s'utilise seulement dans un cas particulier : un récit du pape (Petit Robert).
L'adjectif sengler (11) subit déjà très tôt des changements catégoriels, c'est-à-dire que
l'adjectif sengler (du latin singularis, qui signifie ce qui vit solitaire) se combinait souvent
avec le substantif porc pour désigner un sanglier. Ainsi, en ancien français l’on utilise
seulement l'adjectif devenu substantif masculin pour désigner l'animal qui vit solitaire. Le
dernier exemple (12) est l'adverbe fors, originaire du latin foris (dehors). Dans ce fragment-ci,
nous retrouvons une étape intermédiaire de son changement : l'adverbe est suivi de la
préposition de et l'ensemble signifie hors de la chambre. En français moderne fors est devenu
une préposition avec le sens figuré de sauf.
Naturellement il existe des mots qui changent peu de forme et ne permutent pas de
catégorie grammaticale, mais au cours du temps ils éprouvent quand même des changements
sémantiques :
(13) Molt par fist rede felonie (v.674)
(14) Tristran fu mis en grant esfroi (v.693)
(15) En la janbe nafrez estoit (v.717)
(16) Cirge ne lanpë alumez. (v.726)
12
Mot Signification Godefroy Signification Petit Robert Felonie Fureur, colère, emportement, ardeur,
violence, cruauté Félonie: Déloyauté du vassal envers son suzerain
esfroi Bruit, vacarme, tumulte Effroi: grande frayeur nafrez Blesser, affliger quelqu'un Navrer: contrarier vivement lanpë Appareil d'éclairage, torche, éclair,
foudre Lampe: source de lumière; tube électrique
(Tableau 1 : signification Godefroy et Petit Robert)
Ces évolutions sont souvent dues au sens figuré, comme dans le cas de navrer. Parfois nous
voyons des cas particuliers, comme dans félonie et effroi. Ces significations se sont rendues
plus spécifiques par l’attribution d'un autre sens : l'effroi est devenu l'émotion de quelque
chose qui donne la frayeur, c'est-à-dire le bruit, le vacarme, le tumulte. La félonie est une
cruauté ou une violence d'un vassal ou un félon, signifiant une déloyauté du vassal. Un autre
cas particulier est la lanpë dont le sens évolue à cause d'une réalité toujours en mutation.
Nous terminons ce chapitre par les formes les plus proches du français moderne, parce
celles-ci ne changent plus de sens et éprouvent des changements phonétiques et graphiques
minimaux. Ainsi, il suffit de les mentionner, car ils sont faciles à reconnaître dans leur
contexte littéraire :
(17) flor (v.676), traïson (v.678), couchié (v.680), jor (v.688), sejorner (v.688),
cuer (v.697), hardiz (v.700), pechié (v.700), chanbre (v.701), respant (v.703),
esparpellier (v.708), farine (v.708), janbe (v.717), plaie (v.717), deslïez (v.720),
live (v.722), boçuz (v.724), escoutez (v.728), chaï (v.730)
3.3. Morphologie
Pour des raisons de place, nous nous limiterons dans cette partie aux affixes, les
articles définis et indéfinis, les mots possessifs et déterminants, la déclinaison des noms et des
adjectifs, les pronoms personnels et les verbes. Nous regarderons de plus près si la
morphologie de notre fragment correspond aux normes établies dans la Petite Grammaire de
l’ancien français (Bonnard & Régnier 1989) et nous signalerons les irrégularités.
13
Tout d’abord, dans la construction des mots, il existe des affixes pour créer des
néologismes. Ici, les affixes du fragment sont d’origine latine. Les préfixes sont ex-
(esparpellier, v.708), por- (porpensa, v.709) et dé- (deslïez, v.720). Parmi les suffixes, nous
avons retrouvé -on (traïson, v.678) et -ie (felonie, v.674), qui sont tous les deux un héritage du
latin (Bonnard & Régnier 1989 : 24).
Généralement nous constatons une docilité envers les normes de la morphologie de
l’ancien français. Dans le tableau ci-dessous, nous regroupons quelques exemples de l’article
défini (Bonnard & Régnier 1989 : 16), qui affirment les règles suivantes :
Article défini Masculin singulier Masculin pluriel
Cas sujet Li - Molt fu li nain de grant voidie (673) - La nuit, qant ot li rois mengié (679)
Li - Que li pas allent paraisant (704)
Cas régime Lo, le - Tristran alla le roi couchier (681) - Avoit bien le lonc d’une lance (695)
Les - Les piez a joinz, esme, si saut (729)
(Tableau 2 : l’article défini masculin)
Article défini féminin singulier Féminin pluriel
Cas sujet La - La nuit, qant ot li rois mengié (679)
Les /
Cas régime La - A la roïne, s’il pooit (698)
Les /
(Tableau 3 : l’article défini féminin)
Nous remarquons quelques cas spéciaux : entre autres el (18), qui est l’union de la
préposition en et l’article le. En outre, nous retrouvons une irrégularité (19), dans laquelle
Béroul utilise l’article défini du cas régime pour un cas sujet. En effet, cela peut engendrer
une évolution postérieure :
(18) El bois (v.716) ; el lit (v.730)
(19) Le jor devant (v.716)
Nous passons à l’article indéfini (Bonnard & Régnier 1989 : 17) qui est peu attesté
dans le fragment. En outre, dans les exemples, il n’y a pas d’irrégularité :
14
Article indéfini
masculin singulier- pluriel Féminin singulier -pluriel
Cas sujet Uns Un /
Une Unes /
Cas régime Un Uns - Cil en entra chiés un pestor (675) - o lui c’un jor ne sejorner (688)
Une Unes - Avoit bien le lonc d’une lance (695)
(Tableau 4 : l’article indéfini)
Ensuite, nous localisons les mots possessifs (Bonnard & Régnier 1989 : 52), dont nous
constatons seulement les formes faibles et les mots démonstratifs (Bonnard & Régnier 1989 :
55-59), qui ont plusieurs formes attestées dans le fragment. Quant aux mots possessifs, nous
avons seulement des exemples de formes faibles de la première et troisième personne du
singulier et de la première personne du pluriel. Ces formes fournissent un excellent exemple
de leurs fonctions :
(20) Ma volonté (v.683) ; ma part (v.687) : cas régime féminin singulier
(21) Son lit (v.693) ; son cuer (v.697) : cas régime masculin singulier
(22) ses oncles (v.699) : cas sujet masculin singulier
De toute façon, il y a deux formes douteuses : dans le syntagme sus piez (v.727) nous
voyons une forme agrammaticale. Néanmoins, nous pensons qu’il y a une analogie avec la
forme latine suos. En outre, l’article possessif nostre et le nom féminin trace (v.712)
indiquent qu’il s’agit d’un féminin singulier, sinon la forme au pluriel serait noz. Pourtant, la
traduction nous fournit le pluriel nos traces, cela indique soit une erreur en ancien français,
soit une interprétation libre du traducteur.
Les mots démonstratifs se divisent en deux groupes, à savoir les formes de proximité
cist et les formes d’éloignement de cil. Chaque groupe a sa propre conjugaison. Dans notre
fragment, nous observons deux catégories : premièrement les exemples de la catégorie de
proximité :
(23) ceste place (v.711) : cas sujet féminin singulier
Deuxièmement, il y a trois exemples de la catégorie d’éloignement, dont nous nous
rendons compte qu’une ellipse du substantif est tout à fait possible, contrairement au français
moderne :
15
(24) cel brief (v.686) : cas régime masculin singulier
(25) cel [lit] de roi (v.694) : cas régime masculin singulier
(26) cele nuit (v.702) : cas sujet féminin singulier
Le mot démonstratif comme pronom, ainsi que le pronom neutre, sont tous les deux
appropriés, comme dans les exemples cil (v.675) et ce (v.709).
Nous continuons avec les pronoms personnels (Bonnard & Régnier 1989 : 41) qui sont
très fréquents dans le fragment, sans être obligatoires. Voici les formes que nous y
retrouvons :
Personnes Cas sujet Cas régime Forme faible Forme forte 1e sing. Je (v.682), ge (v.691) 3e sing. Masculin Féminin
Il (v.697), il (v.698), il (v.682)
Le (v.687) La (v.677)
Li (v.685)
Lui (v.688), lui (v.690)
2e plur. Vos (v.682), vos (v.685) 3e personne réfléchi
Soi (v.709)
(Tableau 5 : pronoms personnels)
Nous remarquons aussi une forme de liaison gel (v.683) entre je et le. Nous
rencontrons également des attestations des pronoms adverbiaux en (v.723) et i (v.715)
(Bonnard & Régnier 1989 : 50).
Ensuite, nous passons à la déclinaison des mots (Bonnard & Régnier 1989 : 20-24) et
des adjectifs (Bonnard & Régnier 1989 : 28-29). Dans la plupart des cas, les formes sont
conformes aux règles grammaticales de l’ancien français. Sauf la forme li nain (v.673), qui est
un cas sujet masculin singulier, requiert un s au substantif nain, comme dans le vers 701. Cet
abondon de la flexion casuelle n’est pas arbitraire : il s’annonce une évolution vers une perte
du cas sujet. Nous prêtons attention aux formes piez (v.729) avec z, qui se composent de
l’union entre le d de pied au singulier et le s du cas régime au pluriel :
Masculin Féminin Singulier Cas sujet Li rois (v.679), li nains
(v.701) La nuit (v.679) La flor (v.703), la sale (v.680), la roïne (v.698) Cas régime Le lonc (v.695), le nain
(v.707) Pluriel Cas sujet / / Cas régime Les piez (v.729) / (Tableau 6 : la déclinaison des substantifs)
16
Les formes de l’adjectif sont partagées en deux groupes selon leur étymologie latine.
La première catégorie représente les adjectifs biformes, pendant que la deuxième les formes
uniformes.
Masculin Féminin Cas sujet Singulier Beaus (v.682), boçuz
(v.727) /
Pluriel / / Cas régime
Singulier / Fole (v.696)
Pluriel / (Tableau 7 : la déclinaison des adjectifs biformes)
Masculin Féminin Cas sujet Singulier / / Pluriel / / Cas régime
Singulier Grant (v.717) Grant (v.673), grant (v.693)
Pluriel / / (Tableau 8 : la déclinaison des adjectifs uniformes)
Finalement, nous abordons les verbes (Bonnard & Régnier 1989 : 83-182). Dès la
disparition du latin classique, les temps du verbe ont commencé à se confondre et nous
arrivons à des temps déviants du latin par le biais des grammaticalisations. Il se crée aussi un
système de temps composés parallèle au système des temps simples. En parcourant les temps
dans le fragment, nous percevons un éventail de formes verbales :
Temps simples
Exemple du fragment
L’infinitif Exemple du fragment
L’infinitif
L’indicatif présent
- requier (v.682) - vuel (v.683) - ot (v.689) - respont (v.690) - dist (v.697) (v.711)
requerir voloir oïr respondre dire
- sert (v.702) - vient (v.705) - tient (v.706) - vois (v.715) - live (v.722)
servir venir tenir vëoir lever
L’imparfait - avoit (v.695) - pooit (v.698) - ert (v.699) (v.700) - devoit (v.709)
avoir pöoir estre devoir
- soloit (v.710) - doloit (v.718) - dormoit (v.721)
soloir doloir dormir
Passé simple
- fu (v.673) - fist (v.674) (v.728) - prist (v.676) - lia (v.677) - pensast (v.678)
estre faire prendre liier penser
- alla (v.681) - vit (v.707) - ala (v.724) - chaï (v.730)
aler vëoir aler chëoir
17
Indicatif futur
- covendra (v.685) -irai (v.691)
covenir aler
-verra (v.715) vëoir
conditionnel - parleroit (v.697) - espandroit (v.712)
parler espandre
- iroit (v.713) (v.714) -feroit (v.714)
aler faire
Subjonctif présent
- ait (v.692) avoir - allent (v.704) aler
Impératif - fait (v.682) - faites (v.683) (v.686)
faire faire
- oiez (v.702) - escoutez (v.728)
oïr écouter
(Tableau 9 : les temps simples)
Temps composés
Exemple du fragment
L’infinitif Exemple du fragment
L’infinitif
Indicatif passé composé
- est issuz (v.723)
estre - eissir - a joinz (v.729) avoir - joindre
Indicatif Plus-Que-Parfait
- ert endormiz (v.699) - estoit nafrez (v.717)
estre – endormir estre - navrer
- avoit saignié (v.719) - deslïez ert (v.720)
avoir – saignier estre – deslier
Passé antérieur - ot mengié (v.679) - furent couchié (v.680) - fu mis (v.693)
avoir – mangier estre – couchier estre - metre
- out alumez (v.726) - fu levez (v.727)
avoir – alumer estre - lever
(Tableau 10 : les temps composés)
Déjà en gallo-roman, le futur était grammaticalisé à cause de l’union de l’infinitif et du
verbe avoir. Ainsi, nous avons dans ce fragment ces formes nouvelles au lieu des formes
latines, dont la majorité des autres verbes proviennent. Nous remarquons aussi dans l’indicatif
plus-que-parfait les deux formes (ert - estoit) pour estre, mais seulement la forme estoit
continuera à exister en français moderne, pendant que ert, l’imparfait latin erat, disparaît.
Nous ajoutons que les participes passés dans les temps composés s’accordent comme des
adjectifs, aussi bien avec avoir qu’avec estre.
Pour terminer, nous mentionnons trois périphrases verbales utilisées fréquemment en
ancien français. Il s’agit du verbe aller et une forme en -ant : allent paraisant (v.704), qui
expriment l’aspect continuatif et itératif du verbe. Ensuite, nous rencontrons le verbe soloir,
suivi de l’infinitif soloit servir, qui signifie un prolongement ou répétition de l’action.
Finalement le verbe faire, accompagné d’un infinitif (faites desploier, v.685), remplace le
verbe jubere, ainsi que la valeur factitive de l’action de l’infinitif dès l’ancien français.
18
3.4. Syntaxe et ordre des mots
En ce qui concerne l’ordre des mots en ancien français, l’on aperçoit vite une vaste
liberté en comparant au français moderne. Au fil de l’évolution linguistique, nous avons vu
des changements de l’ordre des mots dès le latin (langue SOV) jusqu’au français moderne
(SVO) (Marchello-Nizia 1995).
Vu sa longue tradition germanique, les séquences les plus attestées en ancien français
sont celles qui ont le verbe comme deuxième constituant de la phrase, tout comme en
néerlandais et en allemand. Cette position secondaire du verbe (aussi noté V2) est donc très
caractéristique pour les langues germaniques, comme nous l’indiquent les exemples (27-31) :
(27) Molt fu li nain de grant voidie (v.673)
(28) Qui pensast mais tel traïson ? (v.678)
(29) Tristran fu mis en grant esfroi (v.693)
(30) Trop out Tristran fole atenance (v.696)
(31) Deus, quel pechié ! trop ert hardiz ! (v.700)
Néanmoins, nous rencontrons beaucoup de cas où cette structure ne semble pas encore être
respectée : dans les nombreuses phrases SOV, l’on semble avoir recours à des astuces
prosodiques, n’est-ce qu’il s’agit en vérité d’un calque du latin :
(32) Li nains la nuit en la chanbre ert, (v.701)
Oiez comment cele nuit sert. (v.702)
(33) Se l’un a l’autre la nuit vient : (v.705)
La flor la forme des pas tient. (v.706)
Notons de toute façon que les séquences avec S, V et O n’étaient nullement
pertinentes en ancien français. C’est-à-dire que l’on parlait plutôt d’un ordre TVX : à savoir le
‘thème’ (l’information connue) suivi du verbe et ensuite l’information nouvelle (Marchello-
Nizia 1995).
Comme nous le voyons dans les exemples (34) et (35) : quel que soit le sujet ou le
complément, le ‘thème’ ou ‘ce dont on parle’ se trouve en première position, le verbe en
position intermédiaire et le ‘rhème’ (les compléments, le prédicat, etc.) à la fin.
19
(34) Du mesage ot Tristran parler (v.689)
(35) En la janbe nafrez estoit (v.717)
Dans (34), le sujet est Tristran, bien que le complément du mesage soit en première position.
De même pour (35), où En la janbe paraît jouer un rôle plus important que le sujet il, qui est
d’ailleurs impliqué dans estoit. En effet, l’auteur d’autrefois accentue de cette façon que c’est
bien le message qu’apprend Tristan et que c’est sa jambe qui est blessée.
Selon Greenberg (1963), l’ordre VO est bien plus fréquent que l’ordre OV et le sujet
tend à précéder l’objet. De suite, celui-ci pose que dans les langues VO -qui utilisent des
prépositions- les adjectifs, génitifs et relatives tendent à se postposer au N, tandis que l’on voit
l’inverse dans les langues OV.
(36) (VO) Qui pensast mais tel traïson ? (v.678)
(37) (VO) Entre son lit et cel au roi (v.694)
Avoit bien le lonc d’une lance (v.695)
(38) (VO) El lit le roi chaï de haut (v.730)
L’ancien français, qui admet autant OV que VO, se comporte parfois différemment :
dans (36), l’adjectif tel se trouve encore devant traïson. En ce qui concerne le génitif : nous
voyons trois fois la postposition du génitif dans (37) et (38), ce qui nous semble être une
tendance innovatrice. Notons aussi que l’on avait déjà une préférence marquée pour SVO dès
le XIIème siècle, comme l’est toujours le cas en français moderne (Fuchs & Le Goffic 2007).
La séquence OV par contre, sera effacée en moyen français, comme l’a étudié Buridant
(1987).
Dans cette version de Tristan et Iseut, nous pouvons remarquer l’omission du sujet,
comme dans (39), qui est d’ailleurs très fréquente en ancien français, étant une langue pro-
drop (Adams 1987).
(39) Les piez a joinz, esme, si saut (v.729)
Notons aussi que l’on n’est pas toujours en l’absence d’un pronom sujet (40), car le
trait ‘pro-drop’ était alors en voie de disparition, ainsi que le signale entre autres Offredi
(2006).
20
(40) « Beaus niés », fait-il, « je vos requier, (v.682)
Comme nous le signalent Bonnard & Régnier (1989 : 37), « l’ancien français suppléait
la marque morphologique de superlatif (à peu près disparue en latin) par des adverbes de
quantité ». Dans Tristan et Iseut, nous retrouvons molt dans (41) et (42):
(41) Molt fu li nain de grant voidie (v.673)
(42) D’un grant sengler ; molt se doloit (v.718)
Pour exprimer le haut degré, l’ancien français s’appuyait sur trop (Bonnard & Régnier
1989 : 37) :
(43) Deus, quel pechié ! trop ert hardiz ! (v.700)
(44) Trop out Tristran fole atenance (v.696)
Une particularité que nous aimerions signaler en (43) est que l’adverbe trop figure ici
en position éloignée de son adjectif hardiz, et encore davantage dans (44). Ceci nous mène à
l’hyperbate (45), qui sépare ici l’infinitif de son auxiliaire :
(45) Tristran alla le roi couchier (v.681)
Notons que l’hyperbate est une figure de style latine, désormais définie comme « celle qui
renverse l’ordre naturel du discours » (Ricken 1978 : 17).
Selon Bonnard & Régnier (1989 : 57), cist et cil pouvaient figurer en tant qu’adjectif
ou pronom, mais les auteurs notent une préférence ‘précoce’ d’employer cest et cel comme
adjectif et cestui et celui comme pronom. Dans notre corpus, nous avons trouvé cil pronom
(46) et cel adjectif (47). Nous aimerions affirmer la thèse de Bonnard & Régnier, mais nous
signalons que dans le XIIème siècle, cet emploi n’était pas encore fixe.
(46) Cil en entra chiés un pestor (v.675)
(47) Cel brief li faites desploier (v.686)
Nous avons aussi trouvé des cas d’ellipse (48), qui nous semblent fonctionner comme
élément prosodique :
(48) Molt fu li nain de grant voidie (v.673)
Molt [ø] par fist rede felonie (v.674)
21
(49) El lit le roi chaï de haut (v.730)
(50) La flor la forme des pas tient (v.706)
Dans (48), il s’agit de la suppression du verbe. Pour (49) c’est la préposition qui est omise : le
génitif du roi est simplement désigné par le cas régime, ce qui fait contraste avec (50), où la
préposition est bien présente.
En partant de l’ellipse nous abordons notre dernier sujet de syntaxe : le sujet nul. Selon
l’ouvrage de Hirschbühler (1990), les textes en vers de l’ancien français ont plus souvent
recours au sujet nul (aussi appelé V1) : dans la phrase (51), nous voyons que le vers 680 est
sans sujet, et l’on traduit par « on se coucha dans la salle ».
(51) La nuit, qant ot li rois mengié, (v.679)
Par la sale [ø] furent couchié. (v.680)
22
4. Synthèse et conclusions
En guise de synthèse, nous remarquons d’abord que la graphie a été modifiée par les
éditeurs modernes. Leur but -rendre le texte plus lisible- explique l’usage des cédilles, la
ponctuation et l’apparition des trémas à plusieurs reprises. D’autres indications
d’interventions sont le manque des abréviations latines, typiques pour l’ancien français, et
l’usage contemporain des majuscules.
Comme mentionné dans la partie sur le lexique, nous observons clairement les trois
étapes que les mots parcourent vers le français moderne. Nous retrouvons peu d’attestations
du latin et la majorité des mots du fragment sont proches du français moderne, ce qui rend le
fragment plus facile à lire et comprendre.
Dans la morphologie, nous pouvons conclure que nous voyons des évolutions vers le
français moderne. Néanmoins nous reconnaissons l’origine latine dans un grand nombre des
formes. Quant au texte de Tristan et Iseut, nous retrouvons peu d’irrégularités, sauf quelques
cas particuliers que nous avons représentés.
Sur le plan de la syntaxe et l’ordre des mots, nous avons montré qu’il y a une liberté
de style remarquable, mais que la composition avec V2 est préférable. En ce qui concerne la
position de O et S, l’on tend à mettre le thème en avant. Parfois nous avons encore affaire à
pro-drop, ainsi que l’omission volontaire d’autres constituants.
Tout le susdit nous mène à conclure que l’évolution langagière est bien remarquable
dans Tristan et Iseut ; nous avons discerné les éléments clairement latins des innovateurs, et
posons pour finir que le langage dans l’extrait traité représente à bon droit l’ancien français,
malgré les quelques traces qu’a laissées son aïeul, le latin.
23
Bibliographie
Adams, M. (1987). From Old French to the theory of pro-drop. Natural Language &
Linguistic Theory, 5 :1, pp. 1-32.
Béroul, Tristan et Iseut, Ed. & Trad. Herman Braet et Guy Raynaud de Lage (1999). Paris-
Louvain : Peeters.
Biedermann-Pasques, L. (2001). « Approche du système graphique de la Séquence de Sainte
Eulalie (deuxième moitié du IXe siècle). » Presencia y renovación de la lingüística
francesa, pp. 25-40
Bonnard, H. & Régnier, C. (1989). Petite grammaire de l'ancien français. Magnard.
Buridant, C. (1987). L'ancien français à la lumière de la typologie des langues: les résidus de
l'ordre OV en ancien français et leur effacement en moyen français. Romania, 108 :
429, pp. 20-65.
Darcos, X. (1992). Histoire de la littérature française. Paris : Hachette livre.
Eggenberg, J. (2009). La littérature du Moyen Age [en ligne]. Lausanne, août 2009. URL :
<http://librable.fr/p/59459.>
Fuchs, C. & Le Goffic, P. (2007). Le français moderne, entre V2 et SVO ? Discours,
diachronie, stylistique du français, pp.17-35.
Godefroy, F. (1880-1902). Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous des
dialectes du IXe au XVe siècle, Paris : Vieweg.
<http://micmap.org/dicfro/chercher/dictionnaire-godefroy/>
Greenberg, J. H. (1963). Some universals of grammar with particular reference to the order of
meaningful elements. Universals of language, ed. by Joseph H. Greenberg, pp. 73-113.
Hirschbühler, P. (1990). La légitimation de la construction V1 à sujet nul en subordonnée
dans la prose et le vers en ancien français. Revue québécoise de linguistique, 19, pp.
33-55.
Lagarde, André & Laurent Michelard, (1985). « Introduction : I Histoire et civilisation. Les
origines de notre langue. » Collection littéraire Lagarde et Michard : Moyen Age.
Paris : Bordas, pp. 3-4.
24
Lavielle, E. (2000). Béroul : Tristan et Iseut. Paris : Editorial Bréal.
Marchello-Nizia, C. (1995). L'évolution du français (ordre des mots, démonstratifs, accent
tonique). Linguistique, Paris.
Offredi, F. (2006). L'ancien français du XIIIe siècle est-il une langue pro-drop? étude du
corpus 1.
Ricken, U. (1978). Grammaire et philosophie au siècle des lumières: controverses sur l'ordre
naturel et la clarté de français (Vol. 5). Presses Univ. Septentrion.
Robert, P., Rey-Debove, J., & Rey, A. (2009). Le nouveau petit Robert. Dictionnaires Le
Robert, Paris.
Dictionnaire du moyen français (DMF)
<http://www.atilf.fr/dmf>
Le Trésor de la langue française informatisée (TLFi)
<http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;>
Olivetti, Dictionnaire latin
<http://www.grand-dictionnaire-latin.com/>































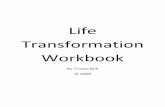


![Urbanisme Insoupçonné - Projeter la ville égyptienne au Nouvel Empire (Unsuspected Urbanism) [Extrait/Excerpt]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ca7d5665120b3330bf65c/urbanisme-insoupconne-projeter-la-ville-egyptienne-au-nouvel-empire-unsuspected.jpg)





![[tapuscrit original] Femme et langue. Sexe et langage (1982)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336af56e8daaa60da100428/tapuscrit-original-femme-et-langue-sexe-et-langage-1982.jpg)





