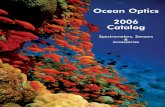Physique et intelligibilité. Meyerson, la raison et l'irrationnel
Transcript of Physique et intelligibilité. Meyerson, la raison et l'irrationnel
Version française de « Physics and the Intelligibility of Nature »
TEOREMA, XXX/1 : 75-97 (1912)
PHYSIQUE ET INTELLIGIBILITÉ
MEYERSON, LA RAISON ET L’IRRATIONNEL
M. ESPINOZA
L’esprit humain est absurde par ce qu’il cherche;
il est grand par ce qu’il trouve.
Paul Valéry
INTRODUCTION
Dans quelle mesure l’intelligibilité naturelle est-elle accessible à la physique ?
Dans la première partie de cet essai je dévoile, en essayant de les expliquer, les
fondations épistémologiques et métaphysiques du scepticisme meyersonian en
physique. D’après le dualisme de Meyerson, la compréhension des phénomènes
naturels signifie une lutte entre, d’une part, une raison qui s’efforce de tout identifier à
l’espace et au temps, et, d’autre part, une nature diverse et changeante. Je suis conscient
qu’il n’est pas courant de classer Meyerson parmi les penseurs sceptiques, néanmoins
ce qui peut être considéré comme scepticisme chez lui est cette importante réflexion
selon laquelle, primo, beaucoup de faits ou des phénomènes naturels résistent à
l’identification réductrice, secundo, quand la raison explique, elle le fait en réduisant
complètement la diversité et le changement qu’il s’agissait d’expliquer. Ainsi,
paradoxalement, quand la physique réussit, elle montre que rien n’arrive. La raison de
cette curieuse conclusion est que pour Meyerson l’identité et l’unité existent seulement
en tant que conditions rationnelles a priori : il n’ y a ni identité ni unité réelles dans la
diversité naturelle. Les racines de l’épistémologie meyersonienne incluent ses
conceptions de la physique, de la raison, de la nature et de la causalité-identité.
Physique et intelligibilité
2
Chez Meyerson, l’inclination épistémologique réaliste de la physique n’est pas
basée sur une métaphysique réaliste. C’est pourquoi dans la deuxième partie de cet
essai l’analyse de la philosophie meyersonienne de l’intellect est suivie de la suggestion
qu’au moins quelques-unes de ses propriétés sceptiques peuvent être écartées si on
remplace ses fondements métaphysiques dualistes par une base métaphysique qui est à
la fois naturaliste et réaliste. Cette réflexion sur l’essence de l’explication en physique
selon Meyerson s’inscrit en effet dans notre lutte contre le dualisme ontologique de la
nature et de l’esprit dont la disparition est indispensable au plein épanouissement du
naturalisme émergentiste repensé.
§ 1. — EXPLICATION, CAUSALITÉ ET IDENTITÉ
Le scepticisme meyersonien est, comme nous le verrons, le résultat philosophique
d’une enquête scientifique dont le début n’est pas sceptique. Le cheminement de
l’explication est ainsi paradoxal. Néanmoins à notre époque positiviste pendant laquelle
la théorie de l’explication a été assez abandonnée car on pense que la science, et la
physique en particulier, n’explique pas, le développement d’une théorie claire et
distincte de l’explication n’est pas l’un des mérites mineurs de la philosophie de
Meyerson. Il pense, contrairement à l’avis de tous les épistémologues non réalistes, que
l’objectif de la science est l’explication.1
[…] Le but unique de tout ce travail [réalisé par les éminents participants au Conseil de physique réuni à Bruxelles en octobre et novembre 1911] consistait dans la recherche d’une véritable théorie physique, d’une supposition relative au mode de production (si odieuse à Auguste Comte et si inadmissible, en effet, d’après sa conception de la science). On veut une hypothèse susceptible d’expliquer toute une série de phénomènes constatés d’une manière indubitable par des savants autorisés et qui contredisent nettement toutes les théories qu’on avait formulées jusqu’à ce jour.2
Expliquer veut dire, au sens meyersonien, identifier. Mais la vérité est que
Meyerson, en tant que philosophe français typique de son époque, n’a pas donné une
définition exacte des concepts centraux de sa pensée. On trouve, à la place de telles
définitions, de longues séries d’exemples, développés et instructifs, visant à montrer
que le concept principal, «identité», «identification» et «identifier», recouvre des
notions telles qu’«invariance», «conservation», «permanence», «équivalence»,
«égalité» et «nécessité». Ce sont des idées qui, selon leur contexte physique ou
1 «La science recherche l’explication» s’intitule le Ch. 2 du livre de Meyerson De l’explication dans les sciences (Payot, Paris, 1927) où la plupart des exemples développés en vue de la justification de cet objectif sont extraits de la physique. 2 É. Meyerson, De l’explication dans les sciences, op. cit., pp. 62-63.
Physique et intelligibilité
3
métaphysique, ne signifient pas la même chose (pensez, entre autres, à la transformation
de l’énergie potentielle en physique, ou bien, en biologie, considérer la façon dont un
être parfaitement achevé résulte d’un programme identique). Moritz Schlick interprète
l’identité ainsi:
Une explication peut être accomplie seulement quand un certain nombre de lois sont réunies dans une loi unique, et quand l’une d’entre elles est reconnue comme un cas spécial de l’une des autres lois réunies. Dans ce cas, une même formule peut décrire un certain nombre, ou, en fait, un nombre arbitraire de processus. Voilà l’essence de l’interprétation que Meyerson fait du rôle de l’identité dans l’interprétation de la nature.3
L’affirmation selon laquelle l’explication en physique est la recherche d’identité
revient à dire que cette science classe comme inintelligibles et irrationnelles les
propriétés des phénomènes qui, d’une façon ou d’une autre, ne sont pas
convenablement décrites par la famille d’idées mentionnées. Par exemple, la physique
est une lutte contre le temps irréversible, ce qui est manifeste dans la formation de ses
lois et de ses principes (masse, inertie, quantité de mouvement, conservation de
l’énergie, etc.). La notion meyersonienne d’explication signifie aussi que, si quelque
chose est accidentel ou contingent, alors il est, à cause de cela, au-delà de la portée de la
physique. L’explication est un raisonnement causal, ce qui veut dire, en fin de compte,
réduire tous les phénomènes au temps et à l’espace. Les théories tirent leur force
explicative
à peu près uniquement des considérations de temps et d’espace, en première ligne du maintien de l’identité dans le temps. Il faut […] que quelque chose persiste, la question de savoir ce qui persiste étant relativement de peu d’importance. Notre esprit, conscient (inconsciemment conscient, si l’on veut bien nous permettre cet apparent paradoxe) conscient de l’explication causale, est, pour ainsi dire, d’avance résigné à cet égard, consentant à accepter à peu près n’importe quoi, même quelque chose d’inexpliqué et de radicalement inexplicable, pourvu que la tendance à la persistance dans le temps se trouve satisfaite.4
L’identité est pour Meyerson non seulement une catégorie a priori, elle est aussi
plausible. « Plausible » est l’une de ses notions favorites pour qualifier la famille de
concepts assimilés à l’identité, ce par quoi il veut dire que ces concepts sont, jusqu’à un
certain point au moins, raisonnables ou probables, ce qui est partiellement vérifié par le
fait que de temps en temps nous nous rendons compte que la nature tend à les réaliser
— sans y arriver complètement. Le cadre de l’identité est a priori, le contenu, a
posteriori. Les lois et les causes révèlent des uniformités naturelles, et, réciproquement,
si on préfère prendre les choses par l’autre bout : la science est — d’après sa définition
3 Moritz Schlick, Philosophy of Nature, Philosophical Library, New York, 1949, p. 19. 4 É. Meyerson, Identité et réalité, Vrin, Paris, 1951, pp. 111-112.
Physique et intelligibilité
4
la moins exigeante — une recherche de lois qui serait impossible sans la présupposition
de l’existence de l’homogénéité de l’espace et du temps.
La philosophie meyersonienne de la physique est ainsi encapsulée dans ces trois
notions lesquelles, dans sa pensée, sont des synonymes : explication, causalité et
identité dans l’espace et dans le temps :
Pour les termes cause et causalité […], nous n’ignorons point qu’on peut les définir d’une manière fort différente de la nôtre, et nous nous rendons compte à quel point est choquante tout d’abord la tentative de réduire ces concepts à l’affirmation précise de l’identité dans le temps (et, par extension, dans l’espace). Mais c’est que ces notions nous apparaissent comme les seules dont la science fasse réellement usage.5
En ce qui concerne la théorie générale de la relativité, rappelons, par exemple, de quelle
façon, si décidée, quelques physiciens ont voulu montrer que les phénomènes
gravitationnels ne sont que des accidents dans la géométrie de l’espacetemps.6
L’épistémologue est arrivé à la conclusion que l’intellect recherche la causalité-identité
par une sorte d’analyse ou interprétation de la façon dont cette faculté travaille, car,
sensible à la contribution non négligeable de l’inconscient à la pensée, Meyerson a, en
effet, évité de prendre pour argent comptant le témoignage du scientifique lui-même
concernant ce qu’il fait, attendu que, « pas plus que n’importe quel autre homme il ne
s’aperçoit pensant, et il peut donc se tromper du tout au tout à ce sujet. »7
On trouve la spéculation d’après laquelle la matière doit être comprise comme une
variation de la courbure de l’espace — idée inspirée par la notion de riemannienne de
la courbure constante de l’espace — dans le texte de William K. Clifford « On the
space-theory of matter » (1870), texte antérieur à celui de Meyerson. Du point de vue
de la théorie générale de la relativité, la matière, au moins jusqu’à un certain point,
semble se réduire à l’espace physique, ce qui fait penser à la doctrine cartésienne qui,
primo, identifie la matière à l’étendue, secundo, tend à confondre l’espace physique et
la géométrie. Mais dans ce contexte cette confusion ne doit pas être considérée de façon
péjorative, et ce, pour deux raisons : premièrement, si — comme le stipula la physique
cartésienne — la matière est extension pure ou espace, alors le monde externe,
intelligible en soi, devient également intelligible pour nous étant donné qu’il existe une
science bien développée de l’espace, à savoir, la géométrie ; deuxièmement,
l’ambiguïté de l’espace — réalité externe, concept mathématique — sert de pont entre
la nature étendue et l’entendement humain.
Mais le panmathématisme est une chimère. Pour Meyerson de telles
identifications, sont, en effet, illégitimes : matière et gravitation ne sont pas qu’espace
5 É. Meyerson, Ibid., Préface de la deuxième édition, p. ix. 6 É. Meyerson, La déduction relativiste, Payot, Paris, 1925, pp. 92-93. 7 É. Meyerson, Essais, Vrin, Paris, 1936, p. 110.
Physique et intelligibilité
5
géométrique. Si la théorie relativiste explique la matière et la gravitation via ces
identifications-là, alors cette théorie, d’une façon typique de toute théorie physique qui
réussit, élimine ce que l’on essaie d’expliquer. Et cette élimination est plus claire ici, en
physique relativiste, que nulle part ailleurs en physique, précisément parce que la
tendance à l’identification n’est nulle part aussi proche d’être parfaitement accomplie :
[…] Si l’électricité n’existait point, c’est-à-dire s’il n’y avait, dans la nature, que des phénomènes mécaniques, ou si, plutôt, l’électricité pouvait être ramenée à la mécanique, tous ces phénomènes essentiels, sans exception aucune, eussent pu être prévus par un géomètre de génie, tous seraient déductibles. Ils le deviennent si, à la théorie originale de M. Einstein, nous joignons son extension par M. Weyl. Dès lors, nous pouvons donc, comme le formule M. Eddington, « voir la raison pour laquelle l’Univers doit nécessairement revêtir la forme que nous lui avions trouvée.8
L’identification ou réduction des phénomènes aux propriétés de l’espace produit
des lois et, en conséquence, un déterminisme légal car les lois stipulent l’identité ou
l’invariance des relations entre les phénomènes par translation dans l’espace.
Maintenant si à l’identité spatiale de la relation entre phénomènes on peut ajouter
l’identité dans le temps des phénomènes eux-mêmes, alors il y a causalité et
déterminisme causal : « En effet, s’il y a toujours égalité complète entre les causes et les
effets, si rien ne naît ni ne périt, c’est que non seulement les lois, mais encore les choses
persistent à travers le temps. »9 Il y a déterminisme dans le sens où de la connaissance
des causes il est possible de progresser vers la connaissance de leurs effets et vice versa,
et il y a déterminisme causal dans le sens que Meyerson prit des scolastiques et de
Leibniz : « Causa æquat effectum », « l’effet intégral peut reproduire la cause entière ou
son semblable. »
Ainsi conçue, la causalité est un principe conservateur : il y a autant de matière ou
d’énergie dans les causes que dans leurs effets. Elle apparaît comme un renouvellement
d’un principe énoncé par Anaxagore et que l’on trouve ensuite comme un leitmotiv
dans le poème philosophique le plus impressionnant de tous les temps, le lucide et
mélancolique De rerum natura de Lucrèce : « Rien ne vient de rien […] ni ne va vers le
néant. » Et Platon, dans le Timée, avait écrit que « toute naissance sans une cause est
impossible. » Dans les temps modernes, ce principe a participé à guider l’œuvre, entre
autres, de Lavoisier et de Schopenhauer.
Il existe une confusion dans l’esprit de beaucoup de physiciens depuis l’origine de
la science moderne, approfondie par la description des phénomènes faite par la
physique quantique, à savoir, la croyance selon laquelle le déterminisme, la légalité et
la causalité sont pratiquement la même chose. Il faut donc les distinguer. Le
déterminisme scientifique moderne est, d’un mot, la faculté humaine de calculer le 8 É. Meyerson, La Déduction relativiste, op. cit., pp. 130-131. 9 É. Meyerson, Identité et réalité, op. cit., p. 31.
Physique et intelligibilité
6
développement des phénomènes avec un degré élevé de précision. La légalité est la
propriété d’une série de phénomènes d’être ordonnée par une ou plusieurs lois, et la loi
fonctionnelle décrit la façon dont les phénomènes varient ensemble. La causalité est un
principe ontologique qui décrit une propriété de la relation entre des choses réelles. Ce
principe est adaptable à plusieurs définitions alternatives et cohérentes, et l’une d’entre
elles est la causalité-identité meyersonienne que nous avons déjà rencontrée. D’après
une autre conception, le principe de causalité signifie que des causes identiques ou
semblables produisent des effets identiques ou semblables par translation dans l’espace
et dans le temps. Encore une autre idée est la caractérisation négative : ablata causa,
tollitur effectus.
§ 2. — LA PHYSIQUE, UNE DÉMARCHE IMPOSSIBLE
Je suis d’avis que Meyerson a raison d’indiquer que le grand principe ex nihilo
nihil est essentiel non seulement à la raison en physique et en science, mais encore, plus
généralement, à la raison du sens commun. De là Meyerson tire la conclusion que la
spontanéité, le hasard, la contingence, tout ce qui implique créativité, est irrationnel. Ce
n’est pas tout car il considère comme irrationnel également tout ce qui n’est pas
déductible du seul a priori rationnel, l’identification. La conséquence est que la liste des
irrationnels s’allonge et inclut, entre autres, la sensation, les constantes universelles et
l’irréversibilité du temps :
L’identité est le cadre éternel de notre esprit. Nous ne pouvons donc que la retrouver dans tout ce qu’il crée, et nous avons constaté, en effet, que la science en est pénétrée.10 […] Si elle [la raison] fait halte quelque part […] c’est uniquement contrainte et forcée, forcée par ce qu’elle connaît comme n’émanant pas d’elle. Et cette halte même, elle ne l’accepte jamais qu’en tant que provisoire.11
La raison est un pouvoir d’identification, i.e. causalité, ce qui signifie, nous l’avons vu,
identité des choses dans l’espace et dans le temps ; elle est pouvoir de déduction depuis
l’identité. Tout le reste est irrationnel.
Comme un écho lointain de la lutte héraclitéenne des opposés, Meyerson voit un
conflit entre l’unité et l’identité rationnelles d’un côté, la multiplicité et la diversité
réelles de l’autre. Son attitude est comme celle des anciens pour qui le semblable est
connu par le semblable, ainsi la raison peut connaître seulement l’objet qui s’adapte à
elle. Ceci est visible dans une physique conçue comme un réseau d’équations et de
relations d’équivalence, attendu que pour cette science la nature est compréhensible
10 É. Meyerson, Identité et réalité, op. cit., p. 322. 11 É. Meyerson, Essais, op. cit., p. 63.
Physique et intelligibilité
7
dans la mesure où, ce qui est maintenant, a été et sera. Quand quelqu’un établit une
relation d’équivalence ou trouve une équation, quand deux membres d’une proposition
sont considérés égaux, cela ne signifie pas qu’il y a identité parfaite entre tous les
aspects des choses représentées. Les équivalences et équations signifient seulement
l’existence d’identités quantitatives. La physique, on le sait, ne retient que les qualités
premières — le reste n’a pas de signification physique.
Depuis l’aube de la philosophie naturelle en Occident, savants et philosophes
essayent de distinguer les propriétés réelles et objectives de la nature de celles qui
dépendent essentiellement de l’activité de notre organisme et intellect :
Il y a deux espèces de connaissances, la connaissance réelle et l’obscure ; à la connaissance obscure appartiennent les objets de la vision, de l’ouïe, de l’odorat, de la saveur ou du toucher ; la connaissance réelle diffère de cette classe-là de connaissance […] Convention que la couleur, convention que le doux, convention que l’amer ; en réalité : les atomes et le vide (Démocrite).
L’histoire de la chasse aux qualités premières est longue, les éminents savants-
philosophes modernes (Descartes, Galilée, Locke, entre autres) y ont participé, eux
aussi, et l’espoir de les saisir n’a jamais abandonné les physiciens : la recherche
d’invariants et de symétries continue. Personne ne doute, dans ce domaine, que
l’universalité et l’objectivité progressent à mesure que l’on arrive à exprimer les
qualités en termes quantitatifs. D’où l’importance de la mesure et de l’invention
d’échelles, ainsi que l’importance du principal critère de signification de la physique :
un terme a une signification physique si et seulement si il est susceptible d’être exprimé
quantitativement. Il est à remarquer l’ingéniosité dont font preuve les physiciens pour
exprimer ainsi les phénomènes. Considérez, par exemple, la relation entre la chaleur et
le concept de température, la construction d’échelles. L’avantage des nombres et de la
quantité est que les nombres, combinés à d’autres nombres, génèrent d’autres nombres.
Dans la mesure où les nombres peuvent représenter des aspects des choses, ce
prolongement analytique permet la prévision précise, et, par conséquent,
l’indispensable contrôle précis des hypothèses sans lequel il est impossible de
progresser de la spéculation à la croissance de la connaissance.
Meyerson savait parfaitement à quel point il est paradoxal d’essayer d’expliquer
le changement par la causalité-identité car, en effet, la réussite d’une telle explication
signifie, d’après cette dernière, la réduction de la diversité et du changement à l’unité et
à l’identité. En somme, expliquer revient à montrer que le changement et la diversité ne
sont qu’apparences, épiphénomènes — étrange aboutissement de cette explication
causale quand on sait que pour les Anciens, tel Aristote, la causalité a été conçue pour
rendre compte du devenir, de la diversité, du changement, de la génération et de la
corruption, et non pour les éliminer. De toute façon et d’après la physique et la chimie,
Physique et intelligibilité
8
ce qui reste identique dans le changement, une fois que la causalité-identité a fait son
travail, est quelque chose d’abstrait et de théorique, i.e. les atomes ou l’énergie.
Rappelons que le concept d’énergie, tout comme le principe de sa conservation, ont été
forgés d’une façon toute explicite, sous pression intellectuelle, pour sauver l’apparence
de la continuité des objets et des phénomènes descriptibles quantitativement, une fois
que l’on eût découvert que d’autres valeurs plus anciennes et moins abstraites comme la
matière, le poids et la masse, variaient, elles aussi, à travers les changements.
Néanmoins même les grandes lois de conservation de la physique, souvent mentionnées
par Meyerson comme des exemples de la manière dont la raison satisfait sa quête
d’identité, ne semblent pas, elles non plus, à l’abri du changement. De plus, bien
entendu, nous n’avons aucune façon de vérifier que la somme totale d’énergie du
monde est un invariant — mais, en général, quelle est la valeur des hypothèses sur
l’Univers considéré comme un tout attendu que toute vérification et contrôle ne peuvent
êtres que locaux ? Ces observations donnent un aperçu de la robustesse de la foi de la
raison en son a priori meyersonien, la recherche d’identité à travers le changement. Il
nous semble, intuitivement, que quand quelque chose change, quelque chose reste
pareil ; autrement nous ne dirions pas que quelque chose change. Maintenant, si dans
quelques changements il y avait réellement des vides ou des intervalles, le principe ex
nihilo nihil ferait défaut, ce qui est invraisemblable. De plus, au 19ème siècle, la
croyance s’était imposée selon laquelle ce qui n’est peut être annihilé ne peut être créé,
et, conversement, que tout ce qui commence a une fin. Maintenant, étant donné que
l’énergie est conçue comme quelque chose qui ne peut être anéanti, il s’ensuit, d’après
cette croyance, qu’elle n’a pas eu du commencement, ce qui signifie qu’elle est
éternelle.
Étant donné que la raison recherche l’identification, toute proposition causale, à
condition qu’elle postule l’identification des phénomènes dans l’espace et dans le
temps, semble plausible d’emblée. L’intellect est préparé à l’accepter, et pour l’écarter
il faut rien moins qu’un rejet net de la part de l’expérience.12 Il arrive parfois que la
raison réussisse à identifier, comme on le voit grâce à toute la connaissance accumulée
à travers les siècles. Parfois la raison n’arrive pas à ses fins, ce qui n’a rien d’étonnant
quand on se rend compte qu’il y a de vastes régions de la nature orientées par une
temporalité irréversible et constituées de phénomènes indomptés comme la sensation et
les constantes universelles, des réalités non déductibles a priori de l’identité. Il est donc
clair que la relation entre une raison qui essaie d’apprivoiser le réel et le réel qui résiste
n’est pas une affaire de tout ou rien. Penser que rien n’est explicable (au sens
meyersonien) est un scepticisme infondé — pourquoi nous rendre plus ignorants de ce
12 É. Meyerson, Identité et réalité, op. cit., p. 162.
Physique et intelligibilité
9
que nous sommes ? —, penser que tout est ainsi explicable est un optimisme excessif :
la nature nous surprend tous les jours.
Meyerson, comme tout épistémologue typique, évite la métaphysique, et, prenant
les précautions qui s’imposent à lui, pense que la causalité existe au moins dans les
endroits où elle a été effectivement découverte, tout en reconnaissant qu’il y a beaucoup
de phénomènes réticents à l’identification. D’autre part, je pense que l’épistémologie
est une discipline mineure consciemment ou inconsciemment basée sur la
métaphysique, raison pour laquelle pour résoudre ou dissoudre les dilemmes ou
paradoxes épistémologiques il n’est pas rare qu’il faille rien moins que rendre explicite
leur métaphysique sous-jacente pour la modifier en la rendant ainsi compatible avec
l’évidence, et ceci est précisément mon intention. Un paradoxe, tel que celui consistant
à dire qu’expliquer quelque chose signifie l’éliminer, n’est qu’apparence. Il n’existe que
symboliquement, i.e. dans notre représentation de la nature. Il est donc temps
d’abandonner les scrupules de Meyerson et de retourner à la métaphysique.
§ 3. — UNE NATURE
Meyerson mentionne « l’illusion causale »13 : si la physique réussissait dans tout
ce qu’elle entreprend d’expliquer, on aurait montré que tout est fait d’une même étoffe
et que, contrairement aux apparences, rien n’arrive puisque la cause et l’effet sont
interchangeables. Ceci est pourtant illusoire étant donné que la sensation, le premier
contact avec le réel externe au sujet, montre la diversité et l’irréversibilité des
phénomènes. C’est pourquoi de temps en temps nous sommes obligés de choisir entre
la physique et le sens commun, et il me semble, pour ma part, qu’il est sage de rejeter
les fictions de la physique mathématique au moins dans certains cas, par exemple,
quand elle tend à éliminer l’irréversibilité du temps ou à tout réduire à l’unité et à
l’identité parfaites. Concernant d’autres points de désaccord entre le sens commun et la
physique, le bon sens nous forcera probablement à rester du côté de cette dernière.
D’après le réalisme scientifique, dans les affaires ontologiques la science a le
dernier mot ; c’est elle qui dresse la liste des choses existantes, tandis que pour le sens
commun et la philosophie il n’y a pas de raison de penser qu’en toute circonstance, la
science en général et la physique en particulier, soient la meilleure connaissance de la
nature. Après tout, à mesure que la physique progresse, ses hautes abstractions se
développent en s’éloignant de plus en plus de la réalité concrète de telle façon que seul
leur examen attentif peut déterminer si, dans une situation donnée, la physique est ou
n’est pas sur la bonne voie. Il est donc à remarquer qu’aussi bien le sens commun que la
13 Ibid., pp. 315, 319.
Physique et intelligibilité
10
philosophie sont une aide précieuse pour mener à bien la critique des abstractions de la
science. La conclusion qui s’impose est, ainsi, qu’il n’y a pas de raison valable pour
supposer, systématiquement et dans tous les cas, que seule la physique a le dernier mot
sur l’essence du réel. Étant donné la physique, la philosophie et le sens commun,
l’histoire des idées montre qu’il est raisonnable de considérer n’importe quel couple de
ces trois activités non seulement comme des approches mutuellement complémentaires,
mais également comme des points de vue critiques du troisième. Et, selon les cas
étudiés, avant de distribuer des priorités entre eux, il est indispensable de clarifier les
concepts d’intelligibilité, d’explication et de compréhension : que veulent-ils dire ?
qu’attendons d’eux ? quels sont leurs objectifs ? Une telle analyse montrerait, sans
aucun doute, que les affirmations du réalisme scientifique — souvent un autre nom
pour le matérialisme ou le physicalisme — sont loin d’être évidentes.
Pour essayer de dissoudre les paradoxes apparents de la physique je propose
quelques arguments représentatifs d’un certain nombre d’aspects de la métaphysique
réaliste tout en les contrastant aux idées de Meyerson. Mais avant de développer ces
raisonnements, il est juste de rappeler qu’il a basé son épistémologie sur une grande
quantité d’analyses détaillées de l’histoire des sciences naturelles, précieuse source
d’information pour tout historien et philosophe des sciences. Meyerson est convaincant,
son éloquence laisse peu de place au doute : la physique, en effet, travaille et progresse
comme il le décrit, son herméneutique est correcte. Cela signifie que toute indication
visant les façons de dissoudre les paradoxes de la physique doit atteindre la profondeur
des racines de ces paradoxes.
L’une des mes thèses est que la racine principale des paradoxes éclairés par
Meyerson est le dualisme métaphysique d’origine cartésienne : le monde est divisé en
deux, la matière et l’esprit. Il y a l’observateur et l’observé, la matière et sa
représentation. On présuppose ensuite que ces deux parties du monde ont des propriétés
bien différentes, la principale étant que, d’un point de vue meyersonien, à la recherche
rationnelle d’identité menée par le physicien, ne correspond pas toujours une identité
naturelle : il arrive que ce que l’on trouve soit, en effet, une diversité irréductible. Les
dualistes, héritiers de Descartes, renouvellent les paradoxes issus de la relation entre
l’homme et la nature. Dans un domaine bien plus vaste que celui des sciences de la
nature car coextensif à toute l’expérience humaine, Jean-Paul Sartre, par exemple,
termine en pensant que l’homme est une passion inutile parce que la conscience, un
néant, fait tout son possible, tout au long de sa vie, pour devenir quelque chose, ce qui
est impossible. De façon analogue, on peut dire que, pour Meyerson, l’intellect est une
passion inutile dans la mesure où il essaie de tout expliquer en le réduisant à l’identité.
Considérez maintenant, comme excursus complémentaire et critique de la
recherche d’identité, que cette perspective explicative n’est pas la seule car en effet le
développement scientifique est dû également à la reconnaissance d’opposés et à
Physique et intelligibilité
11
l’exploitation de la tension existant entre eux : en mathématiques, le fini et l’infini, la
discontinuité et la continuité, opposition paradigmatique qui a été immédiatement
héritée par la physique mathématique. Ensuite, en physique, on observe l’opposition
entre l’espacetemps et la matière-énergie. Les sciences biologiques ont été marquées
par l’opposition entre le mécanisme et le vitalisme, par la dualité entre les forces
physicochimiques et les causes finales. Et considérez comment, de nos jours, les
sciences psychologiques progressent grâce à l’opposition entre le cerveau et l’esprit. Il
est à remarquer que dans toutes les disciplines on constate aussi une opposition entre la
catégorie de substance et la catégorie de relation. L’attention portée à la tension entre
les pôles opposés de cette série paradigmatique est clairement une façon de concevoir le
progrès de la science différemment de la recherche d’identité : quand, à l’intérieur
d’une scienc, durant une période donnée, les scientifiques tendent à favoriser l’un des
membres de la dualité, d’autres scientifiques se chargent de montrer que le pôle choisi
n’explique pas tout et des efforts sont faits en vue de développer les potentialités du
pôle opposé.
Voici un caveat important : considérant que souvent la physique explique, en
effet, comme Meyerson l’a montré, mes critiques concernant cette façon d’expliquer
s’adresse, en premier lieu, aux fondements de cette science, et seulement en deuxième
lieu à Meyerson lui-même. Essentiellement mon reproche consiste à dire que l’auteur
d’Identité et réalité n’a pas creusé avec une profondeur suffisante les fondements de la
physique, ce qui lui aurait permis de voir et d’écarter les bases métaphysiques du
paradoxe selon lequel la physique, à travers la causalité-identité, élimine l’objet de
l’explication, i.e. la diversité et les changements naturels.
Le cartésianisme postule l’existence d’un esprit face à la nature et celle d’une
nature matérielle qui se dresse devant lui. Pour Descartes la nature est intelligible parce
qu’elle est étendue et donc l’objet d’une science mathématique, la géométrie. La
géométrie est l’arrière-plan de la mécanique rationnelle laquelle est, à son tour, le
modèle général de la physique. Le temps disparaît : le temps physico mathématique,
d’après ce modèle, est réversible comme le sont les propriétés de l’espace, c’est-à-dire
qu’il n’est pas le temps réel. Ainsi les phénomènes, tels ceux concernant les trajectoires
des corps célestes, expliqués d’une façon satisfaisante par la mécanique rationnelle,
pourraient — sans conséquence — être projetés dans le sens opposé.
À en croire Meyerson, qui, tout en conservant le dualisme cartésien ne pense pas
que la nature soit exclusivement étendue, toute activité, tout changement irréductible à
l’identité dans l’espace et dans le temps est inintelligible, et la liste est longue : la
sensation, la vie, les qualités secondes, l’irréversibilité du temps, le principe de Carnot,
tout phénomène irréversible d’ordre psychique, biologique ou physique, les constantes
universelles (des données brutes), la volonté libre, l’action par contact, l’action à
distance, la force, tout ce qui n’est pas spatial, l’hétérogénéité de la cause et de l’effet
Physique et intelligibilité
12
visible dans les causes efficientes, etc. Dans ce contexte ma thèse est donc que pour
lutter contre le scepticisme meyersonien, manifeste par cette longue liste d’irrationnels,
il faut réviser le dualisme métaphysique d’origine cartésienne entre l’esprit et la nature
en vue de restaurer la continuité entre la nature et l’homme. L’homme, faut-il le
rappeler encore aujourd’hui, est une entité naturelle émergente parmi d’autres ; dans sa
formation, y compris dans celle de ses facultés et de ses comportements dits supérieurs,
la nature emploie essentiellement les mêmes mécanismes à l’œuvre ailleurs.
Je rappelle ces évidences pour suggérer que seul le naturalisme d’après lequel il y
a une continuité entre les parties non humaines et humaines du monde est une base
convenable pour une science libérée du genre de paradoxe et de mystère si
éloquemment décrit par Meyerson. Tant que le dualisme cartésien est préservé seules
quelques activités ont une chance d’être expliquées, à savoir, celles qui se laissent
réduire à l’unique condition a priori de la connaissance : l’identité. On dira que
l’appareil a priori peut s’élargir (pensez, par exemple, à Kant ou à Husserl) ce qui aurait
pour conséquence de rendre bien d’autres phénomènes deviennent explicables. Mais il
est à remarquer que dans tous les cas l’explication, en tant que satisfaction des
conditions a priori au sens idéaliste kantien du terme — sens qui est aussi celui de
Meyerson — apparaît comme une coïncidence miraculeuse : il n’existe aucune raison
susceptible de nous faire comprendre pourquoi un élément a priori, qui pourrait émerger
d’un nombre infini de possibilités, devrait s’adapter aux objets de notre expérience, et
réciproquement. Prenons donc les choses autrement.
D’après le naturalisme intégral émergent, l’intellect ou la raison (considérons ici
ces deux noms comme faisant référence à une même entité) est une entité émergente
parmi d’autres entités, et elle est émergente, nous le savons maintenant, car, considérée
comme un tout, elle présente des propriétés, des comportements et des lois qui sont
absentes dans ces composants. Évidemment, la compréhension symbolique est absente
des neurones pris isolément. Mais rien ne sort de rien et, dans l’exemple présent, la
compréhension symbolique présuppose au moins des bases ou des éléments biologiques
et sociaux, le cerveau et la communication respectivement. Ainsi dans l’émergence il y
a, en un sens, discontinuité — l’apparition de nouvelles propriétés, comportements et
lois — et, dans un sens différent, il y a continuité de l’espace, du temps et de la
causalité, car les éléments de l’entité nouvelle étaient déjà là, la nouveauté étant le
résultat de nouvelles relations et de nouvelles combinaisons entre les anciens
composants. Le semblable est connu par le semblable : c’est alors la continuité dans
l’existence de ces anciens composants dans l’entendement humain, le fait que
l’entendement humain partage avec d’autres secteurs naturels quelques éléments et
structures, qui, du point de vue métaphysique, enlève à l’explication son aspect
mystérieux. Par exemple, les lois de la mécanique sont inscrites dans notre corps, et
c’est la raison pour laquelle les explications mécaniques nous semblent si naturelles.
Physique et intelligibilité
13
C’est aussi pour cette raison que les physiciens ont développé la mécanique avant les
autres disciplines de leur science.
§ 4. — CRITÈRES DE RÉALITÉ
La physique, pour l’antipositiviste Meyerson, est la tentative d’explication du réel
et son critère de réalité est la résistance à l’identité et à la déduction à partir de
l’identité, résistance à ce que la raison est capable de développer par ses propres
moyens. J’ai attiré l’attention sur le fait que les exemples de résistance à la raison
donnés par Meyerson forment une liste impressionnante et longue d’éléments
irrationnels. Mais y a-t-il de bonnes raisons de croire que seules les choses rebelles à la
raison sont réelles ? Après tout, en prenant les choses par l’autre bout, on ne peut pas
dire que les phénomènes ou objets expliqués deviennent irréels une fois que l’on
découvre leur conformité à la raison. Considérez, par exemple, les phénomènes
expliqués par la mécanique rationnelle : ils sont tout à fait réels avant et après leur
explication. D’autre part, en effet, la résistance à notre pouvoir de déduction a priori est
une règle efficace pour déterminer le réel en tant que chose indépendante de notre
esprit, mais pourquoi penser qu’il s’agit de l’unique règle pour cette détermination, et
ce qui vient d’être affirmé, que certaines choses expliquées ne cessent pas pour autant
d’être réelles, montre bien que le critère meyersonien de réalité ne peut être le seul.
Voici donc deux critères plus justes:
Primo, l’invariabilité : quelque chose est réel s’il est indépendant de nos états
subjectifs, s’il ne change pas quoi qu’on fasse. La Lune est là où elle est et à une
distance donnée de la Terre quels que soient les moyens employés pour établir ce fait :
que ce soient les premières stratégies ingénieuses des astronomes Grecs tel
qu’Aristarque de Samos qui a observé des éclipses lunaires, la méthode des parallaxes,
l’emploi du radar, la durée d’un voyage vers la Lune à telle ou telle vitesse ou encore
l’emploi que l’on fait aujourd’hui du laser réfléchi par le grand réflecteur placé sur la
surface lunaire par les astronautes d’Apollo.
Secundo, l’efficacité causale ou sensibilité : être c’est agir et avoir la capacité
d’être l’objet d’une action. Quelque chose est réel s’il est l’agent ou le patient d’une
action causale. Ainsi une chose réelle peut se dresser contre nous de plusieurs façons et
non seulement quand il arrive qu’elle soit irréductible à la déduction a priori. Par
« efficacité causale » je n’entends pas seulement l’action de la cause efficace ou
motrice telle qu’elle a été conçue par les penseurs modernes car, comme Aristote l’a fait
en son temps, j’étends l’efficacité au mode d’action de n’importe laquelle des quatre
classes de causes de la tradition — les causes matérielles et formelles, efficientes et
Physique et intelligibilité
14
finales. Ces quatre causes agissent chacune selon sa nature, et chacune d’entre elles est
sensible aux contraintes imposées par les autres, en conséquence elles sont réelles.
Que Meyerson eût accepté ces deux critères semble évident, bien que pour des
raisons différentes de celles annotées ici. Par exemple, il a rejeté les causes finales et ne
semble pas s’être aperçu que la causalité-identité est interprétable comme une
expression de la cause formelle. De plus selon lui toute action, par contact ou à
distance, est irrationnelle donc réelle. Par contre dans le contexte aristotélicien l’action
a un sens quand elle guidée par les causes formelles et finales, et si elles font défaut on
obtient alors des accidents et des monstres.
L’idée que je viens d’exposer, utile pour affaiblir le scepticisme meyersonien et la
conception de la physique comme une activité paradoxale, est qu’il existe des critères
de réalité tout à fait fiables permettant d’établir la réalité de quelque chose, que celle-ci
soit explicable ou non. Continuons l’examen des présuppositions meyesoniennes.
§ 5. — VERS LA SOLUTION MÉTAPHYSIQUE RÉALISTE
DES PARADOXES DÉCRITS PAR MEYERSON
D’après la philosophie meyersonienne, à tout moment le point de départ de la
physique est réaliste parce que l’objectif est l’explication de la diversité et du
changement réels tels qu’ils sont donnés à la perception. La physique présuppose le
concept de chose externe à nos facultés.14 De cette incontestable tendance
épistémologique Meyerson conclut que le positivisme est erroné. Auguste Comte et
Ernst Mach, parmi bien d’autres philosophes ou scientifiques, n’ont pas compris la
psychologie des physiciens : ceux-ci ne sont jamais tout à fait satisfaits face à une
collection de lois. Ils ne pensent pas que leur science se réduise à un patchwork de lois :
ils voient leur discipline comme une contribution à la véritable image de la nature. Nous
pouvons ajouter aujourd’hui que les illustres physiciens du 20ème siècle, en incluant
ceux qui ont développé la physique quantique (discipline éloignée de l’idéal de
présenter une image cohérente du réel), se sont considérés comme des philosophes
naturels en envisageant la physique comme une philosophie naturelle. Pour exprimer la
même idée négativement, disons qu’aujourd’hui la plupart des physiciens ne semblent
pas s’accommoder de bon gré de l’idée positiviste selon laquelle la physique ne peut
être autre chose qu’une recette qui marche, une calculatrice. Meyerson, on le sait, avait
pris l’habitude de commencer ses discussions en exposant les insuffisances et les
aspects négatifs du positivisme, et, en particulier, en montrant ce qui est erroné dans la
doctrine d’A. Comte. Attendu que toutes les versions du positivisme ont en commun le
14 En effet, le titre du premier chapitre du livre de Meyerson De l’explication dans les sciences est « La Science exige le concept de chose ».
Physique et intelligibilité
15
rejet de la métaphysique, il est à regretter que Meyerson, précisément parce qu’il n’a
pas accordé à la métaphysique l’importance qui s’impose, ne soit pas allé suffisamment
loin dans son rejet du positivisme.
La façon dont la physique commence sa recherche est la première partie du
paradoxe consistant à transformer le réalisme de ce commencement en un final idéaliste.
En effet les théories physiques, depuis Descartes et Galilée et jusqu’à nos jours,
recherchent la mathématisation, i.e. l’explication mathématique des phénomènes
naturels, soit par l’application des mathématiques de l’extérieur aux concepts
préexistants de la physique, soit, ce qui signifie un rapport plus intime entre ces deux
sciences, par la constitution mathématique des concepts de la physique : ce sont des
concepts indescriptibles sans les mathématiques tels que l’accélération, l’entropie, la
courbure de l’espacetemps, etc. Reprenons le premier pôle du paradoxe : il s’agit de
l’observation qu’il y a des choses matérielles en devenir et externes à nos facultés.
Considérez, par exemple, le mouvement de la matière qui résulte de la gravitation, la
diminution de l’énergie utilisable, etc. Néanmoins la physique, à mesure qu’elle se
développe en devenant de plus en plus théorique, tend à se débarrasser de la matière en
mouvement en stipulant, par exemple d’après certaines versions de la physique
relativiste, que ce qui compte dans les propriétés du mouvement est la structure
géométrique de l’espacetemps (je ne parle pas ici des phénomènes de la
thermodynamique relatifs à l’énergie). Et Meyerson aurait certainement vu une preuve
supplémentaire de son épistémologie s’il avait eu la possibilité de savoir que, d’après
Gödel, les mathématiques de la théorie générale de la relativité n’excluent pas en
principe la possibilité que l’Univers soit réversible, une possibilité mathématique qui
selon Einstein devait être écartée pour des raisons physiques. En physique relativiste on
tend à réduire la matière à la structure mathématique, on n’y exclut pas la possibilité que
le devenir soit représenté par une courbe fermée et que le temps soit réversible : voilà
donc un exemple du deuxième pôle du paradoxe, le résultat idéaliste de l’intransigeante
condition nécessaire de la causalité-identité. La physique se développe vers un
panmathématisme que Meyerson, nous l’avons déjà fait remarquer, considère comme
une ambition extravagante : l’Univers n’est pas seulement une structure
algébricogéométrique. Il y a la matière et ses mystères qui nous surprennent à chaque
tournant du monde, et la grande variété de choses ne se laisse pas réduire au concept
abstrait d’espace, comme certains spécialistes de la physique relativiste l’ont pensé.
Cette attitude de Meyerson nous rappelle la façon dont les penseurs romantiques, suivis
plus tard par quelques phénoménologues et existentialistes, ont jugé la physique
mathématique : ils sont d’avis que la science crée un monde fantastique peuplé par des
entités et des lois mathématiques ou théoriques, par des Idées platoniciennes. Ce monde
n’a rien à voir avec la nature telle qu’elle est donnée aux hommes en chair et en os.
Physique et intelligibilité
16
Meyerson en est conscient: c’est pourquoi, selon lui, la physique est créatrice
d’ontologie.
La tendance omnivore à tout expliquer par la réduction aux propriétés de la raison
n’est pas absente de la philosophie où on a essayé de mener à bien ce projet avec les
outils du langage ordinaire. Ce programme n’a pas donné une vraie science. Considérez,
par exemple, les tentatives de Schelling ou de Hegel. Dans plusieurs livres Meyerson
compare, en particulier, la Naturphilosophie hégélienne à des constructions scientifiques
telles que celles de Descartes ou d’Einstein.15 Ils sont unis dans l’espoir excessif et
déraisonnable de déduire la nature complète à partir d’un nombre réduit d’idées en tirant
le meilleur parti de la générativité de nos systèmes de symboles. Hegel choisit le
langage usuel, de portée qualitative, avec lequel il a voulu rendre compte de tous les
phénomènes, y compris ceux de la sensation, de l’esprit et de la culture. Le programme
d’Einstein, basé sur les possibilités des mathématiques et se concentrant sur les qualités
premières, fut moins ambitieux mais plus fécond.
D’après l’épistémologie meyersonienne l’un des paradoxes principaux de la
physique, j’ai déjà eu l’occasion de le dire, est qu’elle a un commencement réaliste et un
aboutissement idéaliste. La façon de résoudre cette contradiction semble donc évident :
considérez le processus de connaissance dans sa totalité d’un point de vue
exclusivement réaliste ou exclusivement idéaliste. Cette dernière option contredit
plusieurs convictions du philosophe français : il existe un monde indépendant de nos
esprits qui est pourtant connaissable au moins jusqu’à un certain point — souvenons-
nous de son critère de réalité. Puis il y a sa remarque selon laquelle la science
présuppose le concept de chose. L’objet de la physique est l’explication des
phénomènes externes donnés à la perception. Mais, d’autre part, la thèse principale de
Meyerson possède un caractère idéaliste bien distinct attendu que, pour lui, l’essentiel
pour que la connaissance existe est une contribution de la raison et non pas une
contribution de la nature externe : rien ne peut être connu s’il n’est moulé ou certifié par
la raison. La diversité et le changement naturels sont compréhensibles seulement dans la
mesure où ils s’enfoncent dans la raison. Il s’ensuit que la philosophie de Meyerson
n’est ni exclusivement réalité ni exclusivement idéaliste. C’est une troisième voie située
à peu près à égale distance de ces deux doctrines. Il me semble que la solution du
paradoxe ne devrait pas être bien difficile pour les idéalistes à qui il suffirait, peut-être,
de réfléchir en suivant leur pente naturelle consistant à étendre le domaine des
15 Voir, par exemple, La Déduction relativiste, Ch. X «L’explication globale» où Meyerson compare la physique relativiste en tant que système de déduction globale à la philosophie de la nature hégélienne ; De l’explication dans les sciences, Livre III, Ch. XI «La tentative de Hegel», Ch. XII «Les objections de Schelling», Ch. XIII «Hegel et Comte» et Ch. XIV «Hegel, Descartes et Kant».
Physique et intelligibilité
17
conditions et des pouvoirs a priori : c’est, par exemple, ce que Kant et Husserl ont fait
pour résoudre leurs problèmes.
De la présupposition raisonnable qu’un paradoxe ou une contradiction n’a
d’existence que dans notre intellect, jamais dans le réel, je conclus que le paradoxe que
Meyerson dit avoir découvert est une conséquence d’un manque d’audace
métaphysique. Par exemple, une fois qu’il avait appris de l’histoire des sciences que la
raison impose aux choses une seule condition a priori, il ne s’est pas senti autorisé à en
ajouter d’autres ou à revoir les fondements métaphysiques du paradoxe. Il est
indéniable que la prudence dans la formation de nos croyances est une propriété
vertueuse, mais elle n’est pas la seule vertu que nous attendons d’un penseur. En ce qui
me concerne, je considère la philosophie de la nature comme la recherche d’un système
d’idées compréhensif, vrai et cohérent où chaque entité et chaque expérience puissent
trouver leur place. Évidemment, pour élaborer une philosophie de la nature ainsi conçue
il est nécessaire de trouver des idées profondes et de longue portée. Meyerson aurait
certainement classé un tel programme parmi les tentatives qu’il dénonce comme étant
trop ambitieuses pour être raisonnables. Telle est son opinion, et c’est donc la raison
pour laquelle il a développé une philosophie de l’intellect au lieu d’une métaphysique
ou d’une philosophie de la nature. Or nous nous trouvons maintenant, par nécessité, sur
un terrain métaphysique car c’est la seule façon d’éviter les procédures paradoxales de
la physique.
§ 6. — L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
J’ai déjà eu l’occasion d’exposer au moins ces deux propriétés de la métaphysique
réaliste : un critère de réalité et une brève description du naturalisme émergentiste. Une
troisième idée majeure est que l’identité et l’unité existent non seulement dans
l’intellect mais ontologiquement et, avant cela, ils existent dans la diversité d’entités et
des phénomènes. Ainsi, comme nous l’avons vu dans l’essai sur la forme, dans la
longue tradition aristotélicienne on considère que les choses naturelles sont non
seulement matière, elles sont aussi forme et possèdent une essence. Les formes sont des
archétypes ou des paradigmes inscrits dans les choses naturelles. Elles ne peuplent pas
un monde à part. Que les formes ne fussent pas des aspects naturels des choses était, on
s’en souvient, l’idée de Platon. Maintenant il est à remarquer que pour ces deux
penseurs ainsi que pour la plupart des philosophes de leur temps (les sceptiques
faisaient exception) c’est parce que les choses ont une forme (Aristote) ou parce
qu’elles participent d’une forme (Platon) qu’elles sont connaissables. Sans forme, point
de connaissance. La forme est l’identité d’essence dans la diversité des choses, l’unité
dans la multiplicité. Il s’ensuit que les formes sont les bases métaphysiques de
Physique et intelligibilité
18
l’analogie, laquelle est indispensable aux raisonnements inductifs et, par conséquent, à
la croissance de la connaissance.
En physique, les mathématiques permettent de se rendre compte que des
phénomènes, visiblement différents, partagent une même structure. Le fait que la même
équation s’applique à différents ensembles de phénomènes prouve qu’ils cachent une
même structure, et ce dévoilement est l’une des valeurs majeures des mathématiques
pour les sciences. En effet, les phénomènes qui composent le domaine d’application
d’une loi entretiennent entre eux des relations analogiques. Les lois empiriques sont des
manières de révéler l’unité et l’identité des phénomènes, ce qui leur est essentiel, et à un
niveau supérieur d’abstraction, les entités et les lois théoriques résument et synthétisent
les lois empiriques. Dans cette même recherche d’identité réelle il faudrait situer l’ordre
manifeste parmi les entités vivantes : espèce, genre, famille et ainsi successivement. À
chaque strate de cette hiérarchie on trouve quelques analogies caractéristiques utiles à la
définition d’une telle strate. Ces archétypes sont les solutions données par la nature aux
problèmes rencontrés par ces êtres pour vivre. La classification, rendue possible par
l’analogie, est l’une des premières étapes de la recherche. Ainsi la reconnaissance que
l’identité et l’unité résultent d’un processus d’abstraction est une importante propriété
de la métaphysique réaliste absente chez Meyerson, absence responsable de la lutte
meyersonienne entre la recherche a priori de l’identité et de la diversité d’un côté, et
une nature externe à l’esprit rebelle à cette exigence, de l’autre. Le réalisme épistémologique impliqué par la métaphysique réaliste n’est ni naïf ni
exhaustif. Compte tenu de nos propriétés et limitations en tant que nous sommes (faut-il
le rappeler) des entités naturelles parmi d’autres entités naturelles, tout n’est pas
observable et compréhensible pour nous. Notre point de vue est forcément partiel. Ce
que nous observons et comprenons ne sont que quelques aspects réels des choses. Nous
ne pouvons pas savoir ce qu’une objectivité parfaite en profondeur et en étendue peut
bien être, que ce soit concernant le monde externe à l’esprit ou l’esprit lui-même. Ainsi,
quand nous posons notre regard sur l’infiniment petit ou l’infiniment grand, notre
perception ou intuition devient défaillante et disparaît rapidement — la connaissance
devient croyance symbolique. Dans les théories physiques les plus développées cette
croyance est basée sur la capacité présumée des mathématiques à représenter le monde.
Maintenant, pour le réalisme, l’important c’est la reconnaissance du fait que l’essentiel
de la connaissance et de la compréhension est une contribution du réel : l’ordre, la
structure, la causalité, la stabilité, l’unité, l’analogie — d’un mot, la raison — existent
d’abord dans la nature extérieure à l’entendement et seulement d’une manière
secondaire et dérivée à l’intérieur de l’esprit dans notre entendement. En embrassant ce
réalisme nous avons, une fois de plus, abandonné Meyerson.
La nature est intelligible et une partie de cette intelligibilité nous est accessible.
Pour ceux d’entre nous qui essayons d’élaborer une métaphysique et une épistémologie
Physique et intelligibilité
19
réalistes cohérentes et intégrales il n’y a — en vue d’éviter toute possibilité de
contradiction interne — qu’une seule option : poser comme axiome l’idée selon
laquelle l’intelligibilité est une propriété réelle et intrinsèque de la nature. La nature ne
se voile pas, ne se cache pas. Si la connaissance et la compréhension sont partielles et
obtenues avec beaucoup de difficultés, c’est parce que nos appareils symboliques, le
langage ordinaire, les mathématiques, nous ont rendus trop ambitieux : cela fait
longtemps que l’apprivoisement de l’indispensable à notre vie biologique ne suffit plus.
Maintenant le processus d’abstraction, amplement reconnu dans le présent essai,
signifie que l’entendement participe activement à l’actualisation de l’intelligibilité dans
notre esprit ; mais, bien que quelques aspects de l’intelligibilité assimilée soient
manufacturés, ce fait n’implique pas que l’ordre, la causalité, la stabilité, l’unité,
l’analogie, bref, la raison, soient des inventions humaines. Les animaux supérieurs,
ceux qui ont une représentation de l’environnement, ne pourraient vivre si leur idée du
monde était essentiellement inadéquate. Une telle métaphysique réaliste concerne, en
premier lieu, une série de phénomènes et de besoins élémentaires et vitaux. Ainsi mon
problème en ce moment n’est pas de savoir si le réalisme, en tant qu’interprétation des
entités sophistiquées et des lois théoriques de la physique récente, est correct ou non. Il
ne faut pas identifier la métaphysique réaliste avec le réalisme scientifique. Ce dernier
est une métaphysique qui s’arrête à mi-chemin et qui ne dit pas son nom ; il est, en
effet, une espèce de réductionnisme : le matérialisme scientifique.16
§ 7. — LA CAUSALITÉ-IDENTITÉ ET LES QUATRE CAUSES
La notion meyersonienne de la causalité-identité est l’opposé exact de la
conception de Hume. Dans la conception du philosophe britannique, l’asymétrie
temporelle est essentielle : la cause précède l’effet. Par contre chez Aristote, on s’en
souvient, l’idée du rapport causal comme une succession constante et asymétrique est
absente ; pour lui la cause et l’effet sont simultanés. Ensuite, selon Meyerson,
rappelons-le, l’attitude du physicien est encore bien plus radicale : son explication
causale, quand elle réussit, élimine le temps.17 Hume :
16 Cette appréciation est développée dans mon essai « Le réalisme scientifique: une métaphysique tronquée », Archives de Philosophie, 57: 325–340 (1994). 51 Émile Meyerson, Identité et réalité, op. cit., Ch. VI « L’élimination du temps ». 52 David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, éd. Washington Square Press, Inc., New York, 1963, Essay IV, Part I, p. 39.
Physique et intelligibilité
20
D’un mot, par conséquent, chaque effet est un événement distinct de sa cause. Il ne pourrait donc pas être découvert dans la cause ; et la première invention ou conception de lui, a priori, doit être entièrement arbitraire.18
D’après Hume, nous n’avons la perception d’aucune information qui passe
nécessairement de la cause à l’effet et ainsi, à partir de la connaissance de la cause, on
ne peut obtenir aucune connaissable sur le futur. Maintenant — et ceci est plus grave —
si entre la cause et l’effet il y a seulement une connexion arbitraire, alors toute
connaissance inférentielle de la nature basée sur le rapport causal est impossible : le
scepticisme suit. Mais l’affirmation de Hume est tout simplement incroyable et
contredit notre expérience la plus évidente — l’accueil favorable de cette idée de Hume
dans les secteurs les plus divers a de quoi surprendre (nombreux sont les scientifiques
qui, dans leurs préfaces, aiment se réclamer de Hume et du positivisme, préférence
oubliée au moment de faire de la recherche).
Si les affirmations huméennes sur la causalité étaient vraies, alors n’importe quoi
pourrait suivre ou émerger de n’importe quoi, avec des conséquences désastreuses
ontologiques et épistémologique faciles à imaginer. Les entités et les processus naturels
n’auraient aucune stabilité ce qui rendrait notre langage impossible attendu que, pour
garder quelque chose en mémoire et pour communiquer, il faut que nos esprits, les sens
et les références des mots soient stables. L’arbitraire est non seulement source de
scepticisme mais également de solipsisme : nous vivrions enfermés dans un solipsisme
du temps présent. Mais contrairement aux conséquences des idées de Hume, parmi les
vérités les plus évidentes on trouve l’existence de la communication, ce qui présuppose
la stabilité du monde extérieur à notre esprit et la stabilité de celui-ci. Nous l’avons dit à
mainte reprise : dans la nature stable il y a répétition, uniformité, ordre, analogie. Ainsi
le point de vue de Hume sur le rapport causal est contredit par le sens commun et par la
science telle qu’elle est faite. On sait que quelques interprètes des phénomènes de la
physique quantique tendent à conclure que cette discipline réfute la connexion
nécessaire entre la cause et l’effet, alors que tout ce que l’on prouve est que, pour la
physique quantique, le fond de la nature est flou.19 Il est intéressant de se rendre compte
que ces deux conceptions de la causalité, celle de Meyerson et celle de Hume,
conduisent au scepticisme, bien que pour des raisons fort différentes. Il faut donc
chercher de la lumière ailleurs.
La recherche d’une idée du rapport causal plus adéquate aux faits mène à la
doctrine aristotélicienne non réductionniste des quatre causes ou principes explicatifs :
la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale (je les ai
19 Cf. e.g. M. Espinoza, Théorie du déterminisme causal, Essai IV « Déterminisme causal et physique quantique », L’Harmattan, Paris, 2006.
Physique et intelligibilité
21
mentionnées plus haut dans l’essai « La forme, une cause oubliée », § 2).20 Cela étant
dit, il est légitime de penser que Meyerson — j’interprète car il ne l’a pas affirmé —voit
une valeur explicative seulement dans les causes structurelles ou formelles. Ni pour
Aristote ni pour Meyerson — une fois leurs conceptions dûment adaptées pour les
rendre comparables — les causes agissantes et les causes matérielles en devenir ne
constituent les éléments principaux de l’intelligibilité. Pour Aristote elles conditionnent,
chacune à sa façon, les processus ; mais le sens de l’activité matérielle et de l’action des
causes efficaces vient du modèle qui est en train d’être réalisé, i.e. de la cause formelle,
et du pourquoi du processus, i.e. de la cause finale.
Ensuite nous ne pouvons qu’être d’accord avec Meyerson quand il affirme que
personne ne sait vraiment ce qu’est la matière ou l’énergie (source inépuisable
d’information et de surprises, avons-nous dit). La matière-énergie n’est pas le genre de
chose qui se donne à nos sens : c’est un substrat hypothétique des phénomènes, postulé
pour concevoir que malgré le devenir et tous les changements observables, il reste
quelque chose d’inobservable, d’identique et d’invariant sous-jacent aux phénomènes
— considérez les lois de conservation et, en particulier, celle de la conservation de
l’énergie.
Ainsi selon Meyerson, les forces agissantes ou efficientes, introduites
généralement pour expliquer le mouvement et le changement, ne peuvent être
explicatives à moins d’être réduites à l’identité. Cela peut se faire si l’on considère que
tout est fait d’atomes (ou de particules subatomiques) identiques, et que tout
changement n’est autre chose qu’une série de déplacements, de changement de lieu des
atomes dans un espace homogène. Dans la vision mécaniste et atomiste du monde, cette
supposition est ce que l’on peut trouver de plus proche de la conception selon laquelle
même quand quelque chose varie, rien ne change. Pensez, par exemple, à l’inertie dans
la mécanique rationnelle newtonienne. Dans le compte rendu meyersonien de la
physique, il n’existe pas de phénomène plus simple et aisé à comprendre que le
déplacment, raison pour laquelle nous serions autorisés à dire qu’il est le premier
principe de l’intelligibilité mécaniste et atomiste. Maintenant s’il est le premier principe
de l’intelligibilité tout court, c’est une affaire différente. En ce qui me concerne, le
premier principe tout court est le déterminisme des quatre causes.
La notion meyersonienne de la causalité-identité n’est ni une sorte de cause
agissante ni une sorte de cause finale. La première, selon son sens moderne huméen,
présuppose l’asymétrie temporelle (ce qui n’est requis, nous l’avons dit, ni par Aristote
ni par Meyerson) et les causes finales sont rejetées par Meyerson : il pense, de façon
erronée, qu’elles présupposent que l’avenir, qui n’existe pas encore, a un pouvoir sur le
présent, et, en les anthropomorphisant toutes, il croit qu’elles impliquent le libre arbitre
20 Vide, e.g., Aristotle, Physique, II, (3).
Physique et intelligibilité
22
et la conscience de la part des éléments qui se laissent organiser par un objectif.21 Mais,
évidemment, rien de tout cela n’est nécessaire : aucun système complexe — pensez à
un organe — doué d’un principe directeur et ordonné par une série de contrôles
hiérarchiques, n’est libre ni conscient. Et les éléments qui contrôlent existent
simultanément avec les éléments contrôlés.22 La causalité-identité pourrait être une
sorte de cause matérielle dans le sens où la matière première aristotélicienne est
préservée à travers tous les changements, ou bien dans le sens où les physiciens du
19ème siècle ont élaboré le principe de la conservation de l’énergie pour garder une
substance d’une même grandeur une fois que l’on avait découvert que le poids et la
masse de la matière qui se donne à la perception, varient.
Mais je dirais bien plus volontiers que la causalité-identité est, d’une façon assez
nette, une espèce de cause formelle. Ce n’est pas que les autres sortes de causes ne
soient pas considérées par Meyerson, mais il se trouve que pour lui seules les causes
conservatrices donc structurelles ont une valeur explicative. On se rappelle que pour
Aristote le terme « cause formelle » est ambigu : il désigne soit la figure d’un objet
(pensez, par exemple, à la forme de la frontière d’un objet matériel façonnée par le
changement de phase de la matière), soit l’essence ou définition. Le sens pertinent dans
le contexte meyersonien est la forme en tant qu’essence : tout ce qui existe s’efforce de
réaliser son essence qui agit comme modèle. Maintenant si on donne à cette notion une
interprétation structurelle, il devient alors légitime d’affirmer qu’en physique
mathématique il y a des causes formelles. Bien que tout dans la nature ne soit pas
d’ordre mathématique, les phénomènes physiques sont structurés ou modelés par des
archétypes, des invariants, des symétries, des régularités, des lois et des équations.
Précisons davantage : la causalité-identité est une espèce de cause formelle à
condition d’accepter un couple de changements sémantiques. Le premier signifie la
réduction de la forme à ce qui est susceptible d’expression mathématique. En physique,
la cause formelle est ainsi une structure ou grandeur invariante. Dans ce contexte, les
formalismes mathématiques, les équations, sont l’ordre, l’essence, le logos des
phénomènes. Mais il est à remarquer que cette interprétation n’est pas, au bout du
compte, si éloignée de ce qu’Aristote avait à l’esprit étant donné qu’il a utilisé, comme
exemple important de cause formelle, l’existence de proportions mathématiques.23 La
deuxième adaptation de la signification du terme « forme » amène à considérer tout
phénomène non pas en tant que quelque chose d’individuel mais en tant qu’élément
d’un ensemble de phénomènes ordonné par des lois : la forme est la loi, la fonction
21 É. Meyerson, De l’explication dans les sciences, op.cit., p. 319. 22 Vide, e.g., Paul Janet, Les Causes finales, Librairie Germer Baillière et Cie., Paris, 1986, Livre Premier, Chs. 1 et 2. 23 En un autre sens, [la cause] c’est la forme et le modèle, c’est-à-dire la définition de la quiddité et ses genres : ainsi le rapport de deux à un pour l’octave, et, généralement, le nombre et les parties de la définition» (Aristotle, Physique, II, 3, 194 b 26-29).
Physique et intelligibilité
23
mathématique, les relations mathématiques entre phénomènes. Pour Aristote, la cause
formelle est, d’une façon exemplaire, l’idée, le modèle qui guide le développement des
êtres vivants pour qu’ils arrivent à être les adultes qu’ils doivent devenir. Il a pensé en
termes biologiques et ainsi, pour le suivre, on doit adopter son attitude de biologiste.
Par contre, pour les scientifiques et les épistémologues modernes le paradigme est la
physique et souvent, plus abstraitement encore, le mécanisme atomiste, et cette
différence d’archétype est l’une des raisons majeures pour lesquelles la réactualisation
des catégories aristotéliciennes n’est pas tâche aisée.
Maintenant si dans le seul sens où quelque chose a une signification pour la
physique, c’est-à-dire quantitatif, la cause est identique à l’effet, alors, en effet, il n’y a
pas de changement ; mais, encore une fois, le rapport causal a été introduit précisément
pour expliquer les différentes sortes de changements. Cette étrange situation est la
conséquence d’une métaphysique tronquée d’après laquelle seules les qualités
premières sont réelles, physiques et significatives. Nul doute : sur ce sujet, la
métaphysique aristotélicienne est plus juste que l’image de la physique donnée par
Meyerson. Premièrement, il est remarquable qu’Aristote ait affirmé que dans tout genre
de changement, en incluant le changement substantiel, la matière première, substrat de
toute forme, soit préservée, alors qu’il n’avait pas de moyen de la mesurer et donc de
contrôler empiriquement son idée. La prémisse de son raisonnement était un principe
métaphysique : la matière est éternelle. Il a conçu clairement la doctrine de la
conservation de la matière et en ce sens il a pensé (cela a été dit) comme les défenseurs
de la loi de la conservation de l’énergie au 19ème siècle. Ainsi, d’après la métaphysique
aristotélicienne, si quelques propriétés d’un objet ou d’un phénomène changent, on peut
montrer que d’autres ne sont pas modifiées et il y a, en conséquence, continuité de
quelque chose et discontinuité d’autre chose à l’intérieur de ce qui est,
fondamentalement, le même objet ou le même phénomène. D’autre part, lors d’un
changement substantiel, ce qui change, c’est la forme, et ce qui reste, c’est la matière
première.24
Forme et finalité sont deux aspects d’un même fait. Une chose n’aurait pas la
fonction qu’elle a si sa forme était différente, et vice-versa. Pour Aristote, on le sait, la
nature est téléologique. Tout être naturel tend vers un but. Il n’est pas difficile de
trouver des critères de finalité : elle existe quand il y a tendance vers un objectif ; quand
il y a des proportions bien respectées pour obtenir quelque chose ; il y a finalité quand
une série de causes et d’éléments de différentes sortes collaborent ensemble pour
produire le but recherché. Ainsi le dauphin nouveau-né, à moins d’ un accident, de
l’action d’éléments étrangers à son développement normal, tend à devenir dauphin
adulte. L’un des exemples favoris des penseurs téléologistes est l’assemblage du
24 Aristote, De Generatione et Corruptione, I, 2, 317a 17-27.
Physique et intelligibilité
24
système visuel, pensez, par exemple, à la façon dont l’œil s’est adapté à la lumière. Je
ne sais pas quelle place occupe la finalité dans la science de S. Vavilov, toujours est-il
que L’Œil et le Soleil est un bel exemple de finalité conçue comme besoin d’adaptation
à la lumière pour vivre : « On ne peut comprendre l’œil sans connaître le Soleil. Au
contraire, les propriétés du Soleil nous permettent théoriquement de brosser un tableau
des propriétés de l’œil telles qu’elles doivent être, sans les connaître, à l’avance. »25 Les
êtres vivants ne peuvent être conçus sans l’action de la finalité. On a du mal à croire —
le contraire n’étant peut-être qu’une apparence — que les recherches des biologistes ne
soient pas guidées, consciemment ou inconsciemment, par l’idée que chaque composant
d’un être vivant a une raison d’être, un sens, une fonction dans la vie de l’organisme.
Il apparaît donc clairement que les causes formelles et finales sont des pouvoirs
directeurs ou organisateurs. Il est à remarquer qu’effectivement et de plusieurs façons la
nature biologique extra mentale, inconsciente, agit, d’une certaine façon, comme les
êtres conscients. La reconnaissance de la forme et de la finalité dans la nature revient à
reconnaître l’ordre, la raison, l’organisation et, par conséquent, l’intelligibilité dans la
nature : l’intelligibilité (j’ai eu l’occasion de le dire) n’est pas un cadeau que la raison
humaine offre au monde.
Pour la plupart des scientifiques et de philosophes aujourd’hui la finalité est un
vestige d’autrefois, et Meyerson n’est pas une exception. En pensant que le rejet de la
cause finale est essentiel au développement de la science, il affirme que les causes
finales ne sont, dans le meilleur cas, que des explications provisoires : elles peuvent être
utiles là où la causalité-identité n’a pas encore pénétré. Mais là où cette dernière
commence à être efficace, la téléologie recule, et elle n’a pas d’autre destin que la
disparition là où la causalité-identité s’établit. D’après Meyerson, la finalité présuppose
quelque chose qui répugne à la raison, à savoir, qu’un événement futur puisse avoir une
influence sur quelque chose qui existe maintenant. Ceci est si choquant pour la raison,
que d’autres ont préféré une autre idée, tout aussi choquante : le pouvoir agent ou
efficace est considéré être identique à la cause finale, la conséquence étant que le passé
est identique à l’avenir et que l’Univers, comme l’Être parménidéen, existe en bloc.
Rien n’arrive, la sensation contraire n’est qu’illusion. De plus, attendu que pour
Meyerson la finalité doit impliquer la conscience, la première est impossible en dehors
de tout être conscient. Et au moment de penser la notion de pouvoir directeur, il ajoute
qu’il présuppose la liberté consciente de la part des éléments qui se laissent harmoniser.
Ainsi les constructeurs d’une maison choisissent consciemment et librement de suivre
les instructions de l’architecte, mais tout être dépourvu de conscience et de liberté se
borne à suivre des lois inflexibles. Mais si la liberté et la contingence qui, selon,
Meyerson, sont présupposées par la finalité, existent, alors elles sont irrationnelles —
25 S. Vavilov, L’Œil et le Soleil, Éditions en langues étrangères, Moscou, 1955, p. 142.
Physique et intelligibilité
25
elles échappent à l’explication causale, au déterminisme parfait de la causalité-
identité.26
Cette appréciation de Meyerson est correcte si et seulement si on accepte les
présuppositions meyersoniennes, sa façon de la concevoir la cause finale, partagée par
la tradition moderne. Mais j’ai montré ici et ailleurs qu’il est possible et légitime de
développer une interprétation naturaliste de la téléologie et du pouvoir de la forme selon
laquelle la forme et la finalité n’ont pas besoin des propriétés rejetées par les critiques.27
J’ai exposé des critères permettant d’affirmer la téléologie ailleurs que dans le
comportement conscient animal et humain. Considérez, de plus, les caractères suivants
qui ne tombent pas sous les critiques meyersoniennes : il n’y a pas un but pour chaque
chose — il n’y a pas de pantéléologie. Nous l’avons vu, l’action de la cause finale ne
présuppose ni conscience ni liberté (c’est ce que l’on constate, par exemple, dans le
travail des organes ou parmi les insectes qui travaillent inconsciemment vers un but
collectif) ; la téléologie est immanente à beaucoup de systèmes naturels — la question
de la possible existence d’une finalité pour l’Univers considéré comme un tout n’a pas
de sens ; la téléologie naturellement conçue n’est pas anthropocentrique — les choses
n’existent pas pour notre bien-être.28
L’objet de cette brève discussion sur la causalité, on l’aura compris, est de
suggérer que le processus de pensée en physique serait probablement moins paradoxal
si, au lieu de chercher exclusivement la causalité-identité, les physiciens étaient plus
réceptifs à une notion plus riche et plus sophistiquée telle que la doctrine
aristotélicienne des quatre causes
CONCLUSION : DE LA PHILOSOPHIE DE L’INTELLECT
À LA PHILOSOPHIE DE LA NATURE
Du compte rendu meyersonien de la physique nous avons hérité quelques
paradoxes. La raison explique en éliminant ce qu’elle voulait comprendre. Nous sentons
et nous pensons qu’il y a, ou qu’il doit y avoir, une transition plutôt lisse et fluide de la
perception sensorielle à la raison : alors pourquoi la raison se montre-t-elle si
tyrannique et impitoyable ? Ces énigmes sont-elles le prix à payer pour la physique
mathématique ? Le terme « physique mathématique » est-il un oxymore — comment
des entités non temporelles et dépourvues de mouvement peuvent-elles décrire et
26 Vide É. Meyerson, Identité et réalité, op. cit., pp. 359-364, et De l’explication dans les sciences, op.cit., Livre II, Ch. VII « Les phénomènes biologiques ». 27 Voir par exemple mon essai « La finalité, le temps et les principes de la physique » in Vol. Coll. La Finalité en question, L’Harmattan, Paris, 2000, et dans mon livre Le Naturalisme intégral repensé (2014) « La forme, une cause oubliée ». 28 Le lecteur peut trouver de très nombreux exemples de cette téléologie naturellement conçue, par exemple, in Paul Janet, Les causes finales, Librairie Germer Baillière et Cie., Paris, 1876.
Physique et intelligibilité
26
expliquer ce qui bouge et qui a, par conséquent, un aspect temporel ? Comment la
forme mathématique peut-elle rendre compte de la matière-énergie ? Ces problèmes
sont majeurs et c’est pourquoi j’ai affirmé que seule une révision des bases
métaphysiques de la physique permet de préparer les voies d’un avenir plus harmonieux
entre la nature non-humaine et la nature humaine. La révision principale, telle que je
l’ai indiquée, consiste, primo, à abandonner l’arrière-plan métaphysique de la pensée de
Meyerson, et, dans la mesure où cette pensée est une description correcte de la
physique, cela revient à abandonner la base métaphysique de la physique moderne.
Cette base est le dualisme cartésien de la matière et de l’esprit. J’ai essayé ensuite de
montrer l’intérêt qu’il y a à remplacer le cartésianisme par un naturalisme intégral
émergentiste dont la métaphysique tient compte non seulement des discontinuités entre
la pensée et le monde, mais, également, de leurs continuités.
* * *