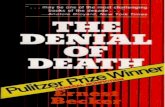raison d'etat - the relations between morality - Martin Wight ...
2013. Ernest Renan, taupier et torpilleur de la raison
-
Upload
college-de-france -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2013. Ernest Renan, taupier et torpilleur de la raison
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 179 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
Ernest Renan, taupier et torpilleur de la raison
par CLAUDINE TIERCELIN
Raison, raison, n’es-tu pas le dieu que je cherche ?Ernest RENAN, Prière sur l’Acropole.
Ma religion, c’est toujours le progrès de la raison, c’est-à-dire dela science.
Ernest RENAN, L’Avenir de la science.
Que la science rigoureuse ne réponde pas à toutes les questions quelui pose notre légitime curiosité, cela est sûr. Mais qu’y faire ? Mieuxvaut savoir peu de choses, mais les savoir effectivement, que de s’ima-giner savoir beaucoup de choses et se repaître de chimères.
Ernest RENAN, Discours et conférences.
La science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire. Elle est inhumaine.Anatole FRANCE.
Le moyen d’avoir raison dans l’avenir est, à certaines heures, desavoir se résigner à être démodé.
Ernest RENAN, Qu’est-ce qu’une nation ?
Renan offre, on le sait, un portrait contrasté : on le présente souventsous les traits d’un génie jésuitique, d’un épicurien libidineux, d’un volup-tueux à l’optimisme déconcertant, « le plus livresque de nos contemporains »,dira perfidement Brunetière en dénonçant le style ondoyant, fuyant duséducteur qui abuse de l’équivoque et des « décevantes finesses », déployant« une manière d’écrire qui est proprement une manière de penser », se mon-trant généralement de l’avis de celui qui parle, effet peut-être de l’ironie,mais plus sûrement d’une impuissance à rien « affirmer1 ». Mais ce sceptique,
1. F. Brunetière, Cinq lettres sur Ernest Renan, Paris, Perrin, Libraire académique Didier,1904 (voir en particulier la Première lettre, p. 12-23 et la Deuxième, p. 25-43).
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 180 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
180 E R N E S T R E N A N
dilettante, tantôt adoré puis détesté par un Barrès ou un Rolland, cet « illu-sionniste admirable » (Fonsegrive), ce « chef des défroqués » sera finalementadoubé par la IIIe République du petit père Combes, puis par Clemenceau.Pour ses amis, au premier rang desquels Marcellin Berthelot ou AnatoleFrance, Ernest Renan, c’est bien autre chose : le modèle de la sincérité, dela droiture, de l’honnêteté, un homme qui « se faisait une obligation dedire tout ce qu’il croyait être la vérité », « croyant fermement en 1891,comme en 1848, que l’avenir appartenait à la science et à la raison ».
Renan était vertueux de la façon la plus rare : il l’était avec grâce. Il avaitdes vertus fortes et des vertus charmantes. Il était bienveillant et serviable.Il mettait tout son soin à ne désobliger personne. Il s’efforçait de se fairepardonner sa supériorité à force de simplicité, de déférence pour autrui,et en se donnant, autant que possible, les dehors d’un homme ordinaire.[…] Il disait, dans une de ses préfaces de la Vie de Jésus : « J’écris pourproposer mes idées à ceux qui cherchent la vérité. Quant aux personnesqui ont besoin, dans l’intérêt de leurs croyances, que je sois un ignorant,un esprit faux ou un homme de mauvaise foi, je n’ai pas la prétentionde modifier leur avis. Si cette opinion est nécessaire au repos de quelquespersonnes pieuses, je me ferais un véritable scrupule de les désabuser. »Il s’attendait du reste à ce que sa mort fût contée dans des légendes pieusesavec une grande abondance de détails horribles, comme l’Église a faitpour les derniers moments d’Arius et de Voltaire. « Mon Dieu ! Que jeserai noir », s’écriait-il avec un effroi plein de bonhomie.
Et France d’ajouter :
Il ne se trompait pas2.
Lorsqu’on se penche sur ce que les philosophes de son temps ontpu dire, la situation, si elle est moins violente, reste souvent négative : dansle meilleur des cas, Renan est traité avec condescendance. Un « penseur àpart », dit de lui Théodule Ribot dans un article paru dans Mind et censéprésenter la philosophie française. Suprême injure, tout philosophe un peusérieux le sait. « Nous ne pouvons pas associer à une école spéciale, poursuitRibot, trois penseurs qui ne doivent cependant pas être passés sous silencedans un exposé, même modeste, de la philosophie française – Vacherot,Renan et Cournot. » Rien de décisif, donc, chez Renan, comparé à unTaine, un Renouvier ou un Ravaisson. Alfred Fouillée, quant à lui, s’expri-
2. A. France, Discours prononcé lors de l’inauguration de la statue de Renan à Tréguier,Paris, Calmann-Lévy, 1903, p. 31-33.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 181 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 181
mera en ces termes : « Le Lamennais de la seconde moitié du siècle estRenan, qui se borne à combiner les souvenirs poétiques de sa religieuseenfance avec un hégélianisme inconséquent, et qui finit par réduire Dieuà la catégorie de l’idéal3. » Au fond, pour tous, Renan est un amuseur degénie, un penseur, mais ce n’est pas un philosophe. Peut-on leur donnertort ? Renan vaut-il mieux que cette condescendance ?
Oui, et une manière de le montrer est peut-être de tenter de cernersa conception, son culte, devrait-on dire, de la raison. Assurément, celacommence mal. Car dans un même élan, comme s’il égrenait un chapeletplus qu’il ne pensait au sens de ce qu’il énonce, Renan dote la raison demille et un attributs : la raison, soutient-il, c’est la science, c’est-à-dire laphilosophie, c’est-à-dire la conscience, c’est-à-dire l’humanité, c’est-à-direDieu. C’est par de telles enflures que la pensée s’égare ; et Renan le saitbien, qui insiste tant par ailleurs sur le culte du détail, de la recherchepatiente et minutieuse, sur le travail à venir qui prendra bientôt le nomde philologie. Se pourrait-il qu’il n’appliquât pas aux concepts eux-mêmesla rigueur qu’il préconise et que tout philosophe, en tout cas, serait endroit d’attendre ? « Le sens d’un concept, écrivait C. S. Peirce dès 1878,de l’autre côté de l’Atlantique, c’est l’ensemble de ses effets pratiques conce-vables. ». Ce qui n’empêchait pas ce « philosophe de laboratoire », de créerà Harvard, « moitié par ironie », « moitié par défi », un Metaphysical Clubréunissant savants, juristes, philosophes et linguistes, et se donnant pourobjectif de clarifier nos idées pour nous prémunir, au premier chef, desillusions et pseudo-questions de la métaphysique.
Il me semble que Renan, si sensible aux duperies et à la nécessité,pour les « torpiller », de miser sur l’observation et l’expérimentation, sidésireux aussi de philosophie « positive », aurait approuvé une telleméthode. Tâchons donc de mettre quelque chose sous les concepts qu’ilutilise, au premier chef, celui de raison. Et pour ce faire, commençonspar ce qu’il affectionne, donc, par un peu d’histoire.
Où en est, à l’époque, la raison ?
Elle va plutôt bien, comme le rappelle Ribot : elle sort tout justede sa gangue hégélienne passée à la moulinette de l’orthodoxie répanduepar l’éclectisme cousinien, psychologie superficielle, extension littéraire
3. A. Fouillée, Le Mouvement idéaliste en France et la réaction contre la science positive,Paris, Félix Alcan, 1896, introduction, p. XV.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 182 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
182 E R N E S T R E N A N
d’un sens commun affadi, spiritualisme purement réflexif faisant fi dela science, « christianisme sans miracles4 ». Hegel lui-même est un peumoins prisé, à l’exception peut-être de Vacherot. Sans doute la raisonest-elle encore malmenée, sous l’influence du « spiritualisme mystique »qui règne en maître à l’École normale (sur laquelle tirent à boulets rougestant Renan que Ribot) avec Ravaisson et Lachelier ; mais elle a aussipris son envol, se faisant moins chauvine et plus « expérimentale », ens’ouvrant (comme Taine) à l’associationnisme anglais (avec Stuart Mill),ou à la psychologie de Wundt ou de Fechner. Ce n’est pas un hasardsi Ribot fait ici une place à Renan, qu’il classe parmi les « expérimen-talistes » ouverts5. Georges Fonsegrive confortera cette interprétation. Sil’on suit son « histoire » (largement surinterprétée par le catholique qu’ilest), deux grands faits caractériseraient, durant les années 1880, l’intel-ligence française : la foi en la science, tout d’abord, qui se traduit par ladomination intellectuelle exercée par Taine et par Renan, et, dans unemoindre mesure, par Comte, et que l’on ne va pas tarder à juger « scien-tiste » ou « positiviste », avant de proclamer carrément dans les années1895 la « banqueroute de la science6 ». Le deuxième trait majeur, c’estle réalisme, le naturalisme littéraire et l’espèce de suprématie reconnueaux romans d’Émile Zola, qui « groupait autour de lui à Médan lesMaupassant, les Huysmans, les Rod, la jeunesse littéraire7 ». Aussi le portraitque tire Fonsegrive du rationalisme que défendent, selon lui, tant Renanque Taine, mais aussi, jusqu’à un certain point, Comte, revient-il, ni plusni moins, à manifester jusqu’où peut aller la tyrannie de la raison.
Assurément, si l’on entend par raison et par rationalisme cequ’entendaient Descartes ou (à d’importantes nuances près, on s’endoute !) les Lumières, aucun de ces auteurs ne songerait à y déroger.C’est bien sur la base d’une exigence cartésienne de clarté et de distinctionrationnelles, condition de notre maîtrise et possession de la Nature, queles philosophes du XVIIIe siècle se donneront pour mission de faire laguerre aux ténèbres et appelleront leur siècle « le siècle des lumières »,leurs confrères allemands célébrant, quant à eux, les beautés del’Aufklärung, conditions de la connaissance et du progrès. Kantisme et
4. Dante, cité à propos de Renan par F. Brunetière, Cinq lettres sur Ernest Renan, op.cit., p. 33. T. Ribot, « Philosophie et psychologie en France » [« Philosophy in France »,Mind, 1877], Revue d’histoire des sciences humaines, 2000, 1 (n° 2), p. 107-123.5. T. Ribot, « Philosophie et psychologie en France » [« Philosophy in France », Mind,1877], Revue d’histoire des sciences humaines, 2000/1(n° 2), p. 107-123.6. H. W. Paul, « The debate about the Bankruptcy of science in 1895 », French His-
torical Studies, 1968, vol. 5, n° 3, p. 299-327.7. G. Fonsegrive, De Taine à Péguy. L’évolution des idées dans la France contemporaine,Paris/Barcelone, Bloud et Gay Éditeurs, 1917, p. 17.10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 183 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 183
comtisme feront d’ailleurs au départ, eux aussi, assez bon ménage. Deuxhommes en France – Taine et Renan – incarnent dès 1870 cet étatd’esprit que, « dès 1848, Renan avait exprimé dans un manuscrit rédigéà cette époque, et qu’il ne publia qu’en 1890 sous le titre de L’Avenirde la science. C’est ce qui faisait écrire à Marcellin Berthelot, dans lapréface de son Histoire de l’alchimie, ces mots si souvent cités : “Le mondeest aujourd’hui sans mystère”, ce qui ne voulait évidemment pas direque le grand chimiste regardait la science humaine comme achevée, maisqu’il était sûr qu’elle pourrait s’achever, en suivant les mêmes méthodesqui en avaient institué les débuts et assuré les progrès8 ». Comme le noteFonsegrive, « de cette prodigieuse fermentation scientifique, une ivressevenait à l’homme. Il s’apparaissait à lui-même comme l’investigateur etle maître du monde : maître de la mort, maître de la vie9 ». Mais onsait aussi le refrain que l’on commence à entonner et dont un Fonsegrivese fait déjà l’écho : c’est là que tout le mal commence. « Il semblait désor-mais qu’il n’y eût rien ni dans l’homme ni hors de l’homme qui pûtéchapper à la connaissance scientifique10 », identifiée à la raison.
Les malentendus autour de la « raison » et du « rationalisme »
N’en déplaise pourtant à Fonsegrive, il y a bien des façons d’êtrerationaliste, d’entendre le concept de « raison », d’évaluer son rôle dansl’économie de la pensée et, en la circonstance, dans la manière dont ils’est développé dans la philosophie française11, et dont la complexité sefait jour chez Renan12.
Ce à quoi échappe en tout cas le philosophe de Tréguier, c’est àcette caricature du rationalisme souvent faite en France mais aussi enEurope, dans cet âge de l’« éclipse » ou du « déclin de la raison » qu’auraété une bonne partie du XXe siècle à partir des années 1920. Une cari-cature qui s’appuie souvent plus sur le concept hégélien que sur le concept
8. Ibid., p. 19.9. Ibid.10. Ibid.11. Sur les différents malentendus qui ont entouré ce terme, voir P. Engel, « Entretienavec Lionel Fouré et Claude Obadia », Le Philosophoire, 2007, n° 20, La Raison, p. 27-46.12. J. Bouveresse, « Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? », Essais, t. IV, Pourquoi
pas des philosophes ?, Marseille, Agone, 2004, p. 23-24. J’ai analysé cela plus en détaildans « Bouveresse dans le rationalisme français », Agone, 2012, n° 48, La philosophiemalgré eux, p. 14-20.10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 184 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
184 E R N E S T R E N A N
moins triomphant de l’Aufklärung, et qui s’interprète comme un savoirabsolu et dogmatique, une raison qui sait et qui peut tout. De valeurliée aux idéaux de liberté, de révolution, d’une démocratie chèrementgagnée par l’accès public au savoir (souvent scientifique), mais désormaisdénoncée comme le mythe positiviste « de la supériorité de la méthoderationnelle et celui du progrès de l’humanité par la connaissance en géné-ral et par la science en particulier13 », la raison s’est ainsi trouvée assimiléeà la froideur (terme qu’on retrouve du reste aussi chez Renan), à la répres-sion des puissances du sentiment, de la création, de la vie, de l’existenceet, pour finir, par les raccourcis que l’on sait, au conservatisme, au tota-litarisme, au bolchevisme, ou au goulag. Telle serait la tyrannie exercéepar le Logos et l’illusion contenue dans l’universalisme censément désin-téressé du « savoir » et de la raison, uniquement destinée en fait à masquerdes intérêts et des désirs de pouvoir. À partir de l’équation raison = savoir= science = scientisme ou positivisme, et non plus raison = savoir= vérité = objectivité = liberté = progrès démocratique, le savant ou phi-losophe des Lumières a été sommé de se taire, de rester dans son cabinetou dans son labo. Le savoir théorique, n’ayant plus de légitimité intrin-sèque, se trouve happé par le savoir pratique, par la politique et bientôtpresque uniquement par la « Morale », la scène publique puis foncière-ment médiatique étant désormais occupée par l’intellectuel littéraire, le« philosophe écrivain », le journaliste, à présent le « bloggeur » ou, mieuxencore, le « twitteur », dont l’objectif premier n’est plus de « justifier »son opinion par des « raisons » mais de séduire, en affichant une curiositétous azimuts, d’éviter surtout de donner une impression de « sérieux »qui pourrait sentir son universitaire informé ou cultivé.
S’il faut entendre par « rationalisme » cette caricature d’une penséeaffranchie de toute espèce d’émotion, d’une rationalité pure, d’une abso-lue différence entre le rationnel et l’irrationnel ou entre la science etl’idéologie, il s’agit là, de toute évidence, de notions bien trop fortes,qui ne sont pratiquement plus, depuis longtemps déjà, défendues parpersonne, qui ne le furent même pas par des rationalistes classiquescomme Descartes ou Leibniz, et qui ne le sont pas davantage par Renan.À l’opposé du fonctionnaire ou du prêtre de la raison, aucun d’eux n’estpas assez obtus pour oublier que la raison n’est ni un don du ciel niun idéal inaccessible, ou encore pour oublier, que lorsque la raison semet en pratique, elle se heurte bien aux paradoxes de l’irrationnel. Leproblème n’est donc pas, comme le voit fort bien Renan, de jouer la
13. J. Bouveresse, Essais, t. II, L’Époque, la morale, la satire, Marseille, Agone, 2001,p. XI.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 185 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 185
raison contre les émotions, les instincts ou les sentiments, mais d’assurerleur coexistence.
Sans doute cela explique-t-il ce qui est moins chez Renan une« contradiction » qu’une oscillation constante entre un premier modèlede la raison (plus kantien) et un second (plus « cartésien »), mais qui estaussi une incarnation classique de la tradition rationaliste dans la philo-sophie française, telle qu’on la retrouve dans les différentes philosophiesde la conscience et du sujet, et dont le tour est foncièrement idéalisteet souvent aussi spiritualiste : le monde n’existe qu’en tant qu’il est l’objetet le produit d’une activité de l’esprit (intuition ou jugement) ou du lan-gage, qui n’est pas le monde14.
Si on conjoint ces courants rationalistes, on peut dire que s’y atta-chent traditionnellement plusieurs thèmes : l’examen critique des idéesd’abord, rendu possible par l’existence de lois de la pensée qu’il convientde respecter, et qui doivent leur force normative (voire leur valeuréthique) à leur capacité à protéger de toutes les formes d’enthousiasme,religieux ou non, et leur stabilité à leur indépendance relativement àl’expérience et donc, sans doute, à certains éléments de la connaissancequi sont ou a priori ou encore non révisables. On trouve ensuite, maispas toujours, une certaine forme aussi de réalisme dans le domaine cognitif,qui suppose – antidote à un idéalisme exacerbé – la reconnaissance d’uneobjectivité et d’une indépendance minimale du monde par rapport àl’esprit. Mais également, la conscience de certaines limites de la connais-sance : l’idée qu’il peut exister des vérités qui ne seront jamais connuesou qui, à tout le moins, échappent à la justification rationnelle (mêmeidéale), avec le risque permanent de scepticisme auquel on est alorsconfronté. S’attachent aussi à l’idéal rationaliste, une prédilection pourla clarté, la précision, la sobriété, le « grand style » classique, l’absencede verbiage, de grandiloquence, l’aversion pour la rhétorique, l’approxi-mation et le flou littéraire. On ne s’étonnera pas de retrouver chez Renan,ces thèmes classiques, chers aussi bien à Malebranche (dont il se sentproche) qu’à des moralistes français comme La Bruyère, Vauvenarguesou Chamfort. Il est moins sûr, en revanche, qu’on trouve chez lui uneaversion complète pour ce « vice épistémique » que peut devenir la« curiosité » (que prônait aussi Montaigne…), cette « tendance naturellede l’esprit » liée à l’« inquiétude de notre volonté ». Renan a souvent étéaccusé par ses adversaires de « dilettantisme », voire de « papillonnageintellectuel », et, plus souvent encore, de donner dans le sceptique
14. P. Engel, « Entretien avec Lionel Fouré et Claude Obadia », art. cit., p. 36. Voiraussi C. Tiercelin, « Bouveresse dans le rationalisme français », art. cit., p. 18.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 186 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
186 E R N E S T R E N A N
mondain, ou dans le « bel esprit », jamais toutefois au point de se voirreprocher un manque de sensibilité au vrai ou un aveuglement aux valeursde l’esprit. Car le « bel esprit », ou le « savantasse », c’est celui qui aaccès à la vérité mais qui la méprise, et qui exerce délibérément sonintelligence sur ce qui n’est pas sérieux, ou encore, tel le Figaro deBeaumarchais ou le bloggeur contemporain, qui « dégoise » ou excelledans ce que Musil et Kraus qualifient de « bavardage » (Geschwätz) oudans l’art de ce que Harry Frankfurt appelle aujourd’hui des « conneries »ou des « foutaises » (bullshit)15.
Renan est par ailleurs un très grand écrivain ; et, jusqu’à un certainpoint, si on doit le ranger parmi les « philosophes » ainsi que parmi les« éducateurs », il épouserait plus peut-être la conception du « philosopheécrivain » que celle du « philosophe professeur », telle que la défendraen 1927 Thibaudet dans sa République des professeurs, conception nonseulement professionnelle mais académique et universitaire du métier dephilosophe. En tout cas, à l’enseignant, il préférera le profil (non pas,certes, du « philosophe populaire »), mais du « chercheur-enseignant »,comme le lui permettront, au passage, ses cours du Collège de France.Ce qui va aussi de pair avec sa conviction qu’il est impossible d’« édu-quer » sans tenir compte de ce que dit, au premier chef, la science.
C’est bien ce qui fait enrager Fonsegrive : « Renan, comme Taine,comme Auguste Comte, remet l’homme dans la nature. Entre l’animalet l’homme, il n’y a qu’une différence de degré. L’homme est plus hautsur l’échelle, mais il est sur la même échelle. “Il y a plus de différenceentre un Papou et Newton qu’entre un singe et un Papou16.” » Et l’onvoit déjà poindre l’un des arguments qu’affectionneront les critiques durationalisme naturaliste : la raison scientifique qui, avec morgue, assurela supériorité de l’homme sur les autres espèces. On a tôt fait de lancercontre Renan cette accusation d’être « raciste » et d’être un rallié tardifet insincère à la démocratie ; à quoi Renan répondra qu’« il y a de grandesdifférences entre les hommes. Il y a des races inférieures et des racessupérieures, et, parmi celles-ci mêmes, il y a des individus supérieurs.Normalement, c’est à eux que devrait être confiée la conduite de tousles autres, et le grand vice des démocraties, c’est qu’elles confient le gou-vernement non pas aux meilleurs mais aux moins bons17 ». Mais on saitl’explication qu’il en donne : « Ces hommes, cependant, ne sont pas supé-rieurs aux autres parce qu’ils sont d’autre race, mais simplement parce
15. H. Frankfurt, L’Art de dire des conneries [On Bullshit, 2000], Paris, 10/18, 2006.16. G. Fonsegrive, De Taine à Péguy, op. cit., p. 29.17. Ibid.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 187 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 187
qu’ils connaissent mieux et les autres et eux-mêmes. Ils sont plus savants,usent mieux de leur raison. Quelle est donc l’unique cause de la supé-riorité des uns, de l’infériorité des autres ? C’est l’usage de la raison, c’estla science. Les degrés du savoir marquent les degrés de l’être. “Toute ladignité de l’homme, disait Pascal, ne consiste que dans la pensée.” Etpour bien penser, il faut suivre les méthodes rigoureuses que pratiquentles savants. Renan applique ces méthodes à la philologie, à l’exégèse, àl’histoire18. »
Renan ou la raison positiviste et scientiste ?
Est-ce à dire, alors, que l’on puisse faire de la raison renanienneune raison positiviste, voire une raison carrément scientiste ? « Natura-lisme, rationalisme, scientisme, tels sont, estime Fonsegrive, les trois motspesants et barbares qui résument toute la pensée de Renan. […] Ellepeut se résumer en quelques articles : tout ce qui existe est justiciablede la raison ; de même qu’il n’y a rien au-delà de la nature, il n’y arien non plus qui puisse échapper aux prises de la raison. La nature estl’objet de la raison et la raison est le moyen de la connaissance de lanature. La science est le produit de la raison appliquée à la nature19. »Très tôt, à Tréguier, Renan est attiré par les « sciences positives20 » : parles mathématiques, puis par la physique et l’histoire naturelle que luifait découvrir à Issy un professeur. Analyses, recherches expérimentales,inductions fondées sur des faits vont bientôt être étendues à la théologie,laquelle se mue en une « mythologie qui tombe devant la critique ». Entrela théologie orthodoxe, qui admet la foi au surnaturel et la science, ilfaut choisir. Et, comme y insiste Annie Petit, « Renan choisit lascience21 ». L’examen minutieux de la Vie de Jésus, des Origines du chris-tianisme, le conduit à mieux comprendre d’où partent les courants depensée, comment s’y mêlent enthousiasmes, outrances, mensonges etdélires qui conduiront au dogme chrétien. Il faut montrer comment toutela fondation du christianisme est une immense illusion, et ce, sans quitterle sol de l’expérience observable par tous, en usant tous les outils de laraison, afin d’indiquer que cette fondation n’a rien de spécifiquement
18. Ibid., p. 29-30.19. Ibid., p. 31.
20. A. Petit, « Le prétendu positivisme d’Ernest Renan », Revue d’histoire des scienceshumaines, 2003, 8, p. 73-101.21. Ibid., p. 76.10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 188 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
188 E R N E S T R E N A N
religieux. En 1848-1849, dans L’Avenir de la science, Renan livre la guerreau surnaturel et sonne le glas du « supernaturalisme ». Aux données etrésultats positifs, à la recherche méthodique de la « science positive », iloppose les contraintes de la soumission aux autorités ou aux douteusesabstractions de la métaphysique. Il faut montrer que « rien d’étranger àla nature ne peut changer le cours de la nature. Pour qu’un miracle pûtêtre admis, il faudrait que le thaumaturge pût à volonté le renouvelersous le contrôle des académies, c’est-à-dire, pour parler franc, qu’il cessâtd’être un miracle. Car le miracle est précisément ce qui ne se répète paset ne peut, par définition, entrer dans une formule22 ». Ici, Renan suitTaine et le positivisme : la métaphysique n’est pas une science et nepeut être traitée comme telle. À ces « pauvres petites sciences conjectu-rales » aux résultats incertains que sont la philologie ou l’histoire, Renanpréfère les certitudes du naturaliste ou du physicien : notre science nepeut s’étendre au-delà de l’observation des faits et des conclusions quela raison bien conduite permet d’en tirer23. Mais « les milliards de sièclessont à notre disposition », écrit-il à Berthelot avec un optimisme queraillera Ravaisson ; on peut donc rêver à la possibilité pour les « petitessciences conjecturales » de parvenir à la connaissance des choses24.
Mais ce culte de la raison ne révèle pas vraiment du scientisme, nimême, en toute rigueur du positivisme. S’il est vrai, comme l’observeAnnie Petit, que « Renan traite de nombreuses questions cruciales pourtous les positivistes : conception de l’histoire de l’esprit humain ; concep-tion des rapports entre les sciences, de leur classification, de l’articulationde leur unité et de leurs variétés ; et conceptions de l’organisation dutravail scientifique en lui-même et des incidences de l’avenir de la sciencesur l’avenir social, c’est-à-dire de la politique des sciences25 », très tôtaussi, « lorsque Renan parle de “positivisme”, c’est pour lui réserver desjugements peu amènes. Hors du séminaire, il s’inquiète d’être “infectépar le positivisme” ; dans ses lettres à Henriette le “positif” s’opposepresque toujours à la hauteur de la pensée et il parle même du “positi-visme dégoûtant” des maîtres de pension avec lesquels il est obligé denégocier ses nouvelles conditions de vie Pour le jeune homme, il estclair que “positif” est synonyme de “grossier”, qu’il l’assimile volontiers
22. G. Fonsegrive, De Taine à Péguy, op. cit., p. 30.23. Voir par exemple ce qu’il écrit dans « Les sciences de la nature et les scienceshistoriques », lettre à Marcellin Berthelot, août 1863, in E. Renan, Dialogues et fragmentsphilosophiques, Paris, Calmann-Lévy, 1876, p. 454-455.
24. Voir les pages sur la morphologie et la zoologie dans Dialogues et fragments phi-losophiques, op. cit., p. 463-464.25. A. Petit, « Le prétendu positivisme d’Ernest Renan », art. cit., p. 75.10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 189 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 189
aux “doctrines abjectes du matérialisme” soutenues par les “polissons”.En 1848-1849, dans L’Avenir de la science, Renan, qui continue d’opposerla “vie supérieure, la vie idéale” à “la vie inférieure, la vie des intérêtset des plaisirs” continue aussi à donner à “positif” des connotations péjo-ratives en le liant à l’utilitaire et à la platitude : il dénonce avec Pascal“le cercle vicieux nécessaire de la vie positive”, les calculs d’intérêt, lesmesquineries des “esprits positifs”, et des “gens positifs” qui n’ont plusle sens du sacrifice, de l’idéal religieux ; il déplore aussi que la sciencepositive dans son état actuel bien incomplet “semble ne révéler que peti-tesse et fini”. Ces interprétations plutôt défavorables sont celles des accep-tions au sens courant. Lorsque Renan connaît Auguste Comte et sa “phi-losophie positive”, qu’il cite et discute, ce “positif”-là n’est pourtant guèremieux jugé. Renan y reconnaît certes un “rationalisme”, mais ne le trouvepoint à son goût, et il l’expédie rapidement avec quelques autres aussisévèrement dépréciés : “Notre rationalisme n’est donc pas cette morgueanalytique, sèche, négative, incapable de comprendre les choses du cœuret de l’imagination qu’inaugura le XVIIIe, ce n’est pas l’emploi exclusifde ce que l’on a appelé ‘l’acide du raisonnement’ ; ce n’est pas la phi-losophie positive de M. Auguste Comte26.” »
Sur la plupart des points, en vérité, Renan s’oppose à Comte : pourle premier, l’histoire de l’esprit humain a pour première étape obligée,celle des religions ; il reste fasciné par les problèmes d’origine et de fin.La science est bien du côté des « sciences idéales » qui ont une viséephilosophique (au point de passer même aux yeux de Berthelot pour un« métaphysicien ») : le seul objet digne de la science, c’est de résoudrel’énigme des choses, c’est de dire à l’homme le mot de l’univers et desa propre destinée. Il qualifie sa conception de « critique » ; il a le goûtdu minutieux des « laborieux travailleurs », et l’horreur des « -ismes »,des systèmes, des sectes et des Églises. Comte, pour sa part, juge inutilesla recherche des causes et des origines, voit dans l’esprit critique, unesprit « négatif », aime les généralités et ne dédaigne pas l’idée d’une« Église positiviste ». Aussi Renan voit-il dès 1849 en Littré l’antithèsede Comte : il admire son « élévation », son sens de la « critique historique »,son « esprit de finesse ». On dira que Renan, avec les positivistes, rêved’« organiser scientifiquement l’humanité ». Mais ce qui anime Comte, c’est« le souci de réorganiser la société et son avenir ; pour Renan, c’est plutôtl’avenir de la science qui motive les réformes de société. Ce qui est finpour l’un est moyen pour l’autre. De plus, l’organisation scientifique del’humanité est présentée par Renan comme une étape vers une plus
26. Ibid., p. 76-77.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 190 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
190 E R N E S T R E N A N
audacieuse prétention : “Je vais plus loin encore. L’œuvre universelle detout ce qui vit étant de faire Dieu parfait, […] il est indubitable que laraison, après avoir organisé l’humanité organisera Dieu27.” »
En résumé, « pour les conceptions de la science même, de ses moda-lités et de ces buts, Comte et Renan n’ont guère en commun que desrefus. Ils ne s’accordent en fait ni sur la science primitive, ni sur la sciencepositive, ni sur son avenir. Pour Renan, Comte est plutôt un de cesmétaphysiciens abstraits et systématiques qu’il dédaigne28. […] ChezRenan, l’originalité est toujours respectée et même recherchée ; et, paral-lèlement à l’obligation pour la société de laisser la science entièrementlibre de ses travaux, il y a une sorte de devoir d’indifférence du savantvis-à-vis des pressions de l’opinion publique. […] Le positivisme, quivise par la science une religion de l’Humanité, n’est pas une religion dela science ; la philosophie renanienne de la science, qui lui délègue uneirréductible transcendance par rapport à toute autre activité humaine,est bien une “religion de la science” et qui lui fait réassumer l’exigencetraditionnelle du religieux : l’aspiration à l’infini29 ». D’où la conclusiond’Annie Petit : « Il faut tenir compte des différences entre les positivismesde Comte et de Littré, et de l’évolution des positions de Renan. Bienque le positivisme reste une référence majeure pour comprendre la penséede Renan, le traiter comme positiviste s’avère inadéquat30. »
Y aurait-il plus de justification à le qualifier de « scientiste » ? Engénéral, le scientisme se repère à six signes essentiels31.
1. Il utilise les mots « science », « scientifique », « scientifiquement »comme des termes génériques de louange épistémique.2. Il adopte les manières, les pièges de la terminologie technique, etc., dessciences, sans tenir aucun compte de leur utilité réelle.3. Il se préoccupe de démarcation, i.e. de tracer une ligne stricte entre lascience authentique, la vraie chose (the real thing), et les imposteurs« pseudo-scientifiques ».4. Le scientiste se préoccupe d’identifier la « méthode scientifique », censéeexpliquer les succès des sciences. Certes, Renan s’y emploie ; mais il prendsoin aussi de distinguer les plans, selon que l’on a affaire à la physique ouà la philologie ou l’histoire.
27. Ibid., p. 90.28. Ibid., p. 91.29. Ibid., p. 99-100.
30. Ibid., p. 73.31. C. Tiercelin, Le Ciment des choses, Paris, Ithaque, 2011, p. 113 sq, et, plus géné-ralement, le chapitre 2.10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 191 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 191
5. Le scientiste cherche dans les sciences des réponses à des questions quine sont pas de leur ressort.6. Enfin, il tend à nier ou dénigrer la légitimité ou la valeur d’autressortes de recherche en dehors de la recherche scientifique, ou la valeurd’activités humaines autres que la recherche, telles que la poésie ou l’art.
Renan tombe-t-il sous le coup de telles caractérisations ? Difficile-ment : s’il vante la science, c’est beaucoup moins comme dogme, corpusou doctrine que comme recherche soumise à des idéaux. Il ne se privepas, du reste, de critiquer les savants qu’ils jugent un peu courts sur laphilosophie qu’ils prétendent, en sortant de leur champ, impunémentdéfendre (voir les reproches à peine voilés qu’il adresse à Pasteur dansson discours de réception à l’Académie française) ; il reconnaît la valeurscientifique de l’histoire et des sciences morales (sur laquelle insisteratant Hilary Putnam) sans pourtant les souder (comme le fera Taine).Renan, sans conteste, s’intéresse à la question de la « classification » dessciences ; mais il finit (ce qui effraie du reste Littré) par placer l’histoireen position de tête, et il souligne aussi les difficultés à tracer une lignede démarcation entre sciences « dures » et sciences « humaines ». Il estmoins naturaliste que Taine ; moins psychologue aussi que Ribot. Il restefoncièrement un historien qui, pour cela même, reste sensible aux récitssur l’origine ; même s’il est à deux doigts de faire de l’histoire une science,comme en témoigne son obsession du détail méticuleux, de la philologie,sa préférence, contre le banal, pour la sophistication. En même temps,Renan aime l’essai, le conte : les contes celtes plus que les mathématiques,ce qui ne l’empêche pas de s’opposer à l’esprit littéraire, réservant à lalittérature la charge d’avoir à « organiser scientifiquement l’humanité ».Renan est bien fils des Lumières : de plus en plus, et contrairement auxidées reçues, il estime que ce dont notre époque a le plus besoin ce n’estpas d’un supplément d’âme, mais d’une meilleure organisation de l’esprit.
Renan ou la raison idéale
Chaque proposition scientifique doit donc être précise et positive.Mais l’esprit doit en permanence animer le savant, un idéal l’attirer etle soulever. Cette quête incessante du savoir, cet élan vers la vérité futurenous obligent à monter sans cesse et toujours plus haut. Savoir pour
prévoir, afin de pouvoir, certes ; mais, contrairement à Comte, Renanpense que le savoir vise d’abord… le savoir. Fonsegrive a bien vu qu’il10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 192 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
192 E R N E S T R E N A N
y avait là, chez Renan, une réminiscence des doctrines catholiques aumoins autant que des rationalismes des Lumières : le bonheur ne consistepas dans la satisfaction de désirs grossiers, il réside dans la joie intellec-tuelle. Il y a bien là une certaine idée de la supériorité de la contemplationsur l’action : ce que l’humanité appelle Dieu ne peut être que l’espritprenant conscience de la nature ; quand la science sera achevée, Dieusera. Il y a donc du divin dans tout travail scientifique, du divin danstoute pensée.
Fonsegrive voit ici, chez Renan, la marque du voluptueux et dudilettante : dans la science, Renan aurait moins aimé la vérité en elle-même que la joie de la conquérir et moins la science que la jouissance.On trouverait des traces de ce fond voluptueux de son âme jusque dansL’Avenir de la science, puis dans L’Abbesse de Jouarre et dans les fâcheuxDiscours à la jeunesse rédigés à la fin de sa vie. Le jugement demande àêtre nuancé. Il faut entendre au moins en quatre sens ce que Renan metsous ce concept d’idéal associé à la raison.
Tout d’abord Renan est aussi kantien que cartésien32. Lorsqu’ilabandonne Comte, c’est de plus en plus pour se rapprocher de Kant.Renan connaissait la philosophie de Hegel ; mais il avait aussi, enAllemagne, étudié Herder. Il était imprégné des écrits de David Strausset de toute l’école de Tübingen. S’il refuse à la métaphysique le titrede science, ce n’est pas du tout pour supprimer la philosophie, bienau contraire ; ne serait-ce que parce qu’il juge impossible de n’en pasavoir quelqu’une : « Chaque tête pensante a été, à sa guise, le miroirde l’univers ; chaque être vivant a eu son rêve qui l’a charmé, élevé,consolé ; grandiose ou mesquin, plat ou sublime, ce rêve a été saphilosophie. » Dès que nous réfléchissons, nous sommes donc néces-sairement philosophes. De plus, cette nécessité est bienfaisante : « Laphilosophie est l’assaisonnement sans lequel tous les mets sont insi-pides, mais qui, à lui seul, ne constitue pas un aliment. » Renan estkantien au moins à deux titres : au sens des limitations qu’il reconnaîtà la connaissance ; au sens de la primauté qu’il donne à la raisonmorale.
En second lieu, la raison « idéale » a aussi des connotations hégé-liennes. Mais c’est un hégélianisme décapité et Renan le montrera danssa critique de Vacherot33, à qui il reprochera, contrairement à Renouvier(dont on peut comprendre qu’il apprécie le « néocriticisme » kantien),de l’être trop resté.
32. E. Renan, Dialogues et fragments philosophiques, op. cit., p. 162, 168, 172, et 178.33. Sur ce débat, voir dans le présent volume l’article de J. Bouveresse, p. NN-NN.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 193 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 193
Troisièmement, c’est aussi un idéalisme qui revêt plutôt parmoments des accents carrément bouddhiques (qu’on retrouve à la mêmeépoque, du reste, de l’autre côté de l’Atlantique, chez un métaphysiciencomme Peirce). On sait la réponse un peu effarée que fera à RenanM. Berthelot dans « La science idéale et la science positive », et la manièredont, tout en donnant les mêmes impératifs aux sciences positivistes dela nature et aux sciences de la morale (à savoir la méthode des faits etde l’observation), il distinguera entre, d’une part, les sciences positives,et d’autre part, les sciences idéales qui, certes, n’ont pas la même clarténi la même certitude, mais dont l’histoire de l’esprit humain (là où ilfaut, en bonne méthode chercher) montre qu’elles sont nécessaires, car« la science des relations directement observables ne répond pas et n’ajamais complètement répondu à un besoin34 ». Simplement, ajouteraBerthelot, si l’on veut y voir une science qui parlerait de la réalité, alorsqu’elle ne procède que déductivement et par le raisonnement, alors ilne s’agirait là que d’une chimère (par où l’on voit qu’il reste plus posi-tiviste que Renan).
Pour mesurer le sens de la raison « idéale », il faut aussi se souvenirque Renan, à qui le patriotisme antinationaliste et lucide préserve toujoursquelque indulgence pour les bons côtés de l’esprit français, reste aussitrès influencé par l’Allemagne, comme en témoigne la détresse que pro-voque en lui l’évolution de celle-ci dans la fameuse Lettre à un ami d’Alle-magne. Et cette Allemagne, c’est au moins autant celle qui s’exprimedans le génie de Goethe, mais aussi de Herder, de Humboldt, lesquelsinspirent toute la conception que développe Renan sur le langage dansL’Origine du langage. C’est évidemment aussi ce que l’on retrouve dansla dimension politique de la raison qu’on le voit développer dans lesessais politiques, au premier rang desquels La Réforme morale et intellec-tuelle, mais aussi dans l’essai dont il ne cessera de dire qu’il l’affectionneparticulièrement : le Discours à la nation, où on voit clairement le démo-crate peu convaincu prôner en définitive toutes les valeurs défendues parles Aufklärer.
Enfin, à d’autres égards, et non des moindres, la raison idéale deRenan, c’est aussi celle d’un idéalisme platonicien classique, celui d’unhomme qui a d’abord été épris de latin et de mathématiques. On raconteque, lors d’une séance où se trouvaient réunis Renan, Berthelot et AlfredFouillée, c’est finalement sur ce sens d’« idéal » que Fouillée confiera seretrouver avec ses deux collègues. Et c’est bien ce sens-là qui transpiredans la correspondance avec Berthelot.
34. E. Renan, Dialogues et fragments philosophiques, op. cit., p. 244-249.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 194 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
194 E R N E S T R E N A N
Seraient-ce les mathématiques, serait-ce surtout le calcul infinitésimal, quinous tiendraient ici le secret ? Sans contredit, les mathématiques, par leursdivers ordres d’infini, nous fournissent la seule image qui jette quelquejour sur cette situation étrange de l’esprit humain, placé entre la nécessitéde supposer un commencement à l’univers et l’impossibilité de l’admettre ;mais ce n’est là qu’une image, les mathématiques ne sortant pas du signe,de la formule, ou, en d’autres termes, n’impliquant aucune réalité. Lesmathématiques, en effet, seraient vraies quand même rien n’existerait. Ellessont dans l’absolu, dans l’idéal. Or tout l’ordre des phénomènes où nousnous sommes tenus jusqu’ici est dans le réel. Entre l’existence premièrede l’atome et les mathématiques, il y a un abîme. Les mathématiques nesont que le développement du principe d’identité, une tautologie d’unsecours précieux quand on l’applique à quelque chose de réel, mais inca-pable de révéler une existence ni un fait. Elles ne fournissent pas de loisde la nature ; mais, en donnant d’admirables formules pour exprimer lestransformations de la quantité, elles servent merveilleusement à faire sortirdes lois de la nature tout ce que celles-ci contiennent. Elles n’apprennentrien sur le développement de l’être, mais elles montrent dans quelles caté-gories il était décidé de toute éternité que l’être existerait, en supposantqu’il dût exister. J’en dis autant de la métaphysique. J’ai nié autrefoisl’existence de la métaphysique comme science à part et progressive ; jene la nie pas comme ensemble de notions immuables à la façon de lalogique. Ces sciences n’apprennent rien, mais elles font bien analyser ceque l’on savait. En tout cas, elles sont totalement hors des faits. […]Mathématiques pures, logique, métaphysique, autant de sciences de l’éter-nel, de l’immuable, nullement historiques, nullement expérimentales,n’ayant aucun rapport avec l’existence et les faits. Par elles, nous plongeonsdans un monde qui n’a ni commencement, ni fin, ni raison d’exister.Ne nions pas qu’il n’y ait des sciences de l’éternel, mais mettons-les biennettement hors de toute réalité35.
Renan est géomètre et non pas logicien. Il est aussi historien avantque d’être psychologue (ou s’il l’est, c’est au sens de Kant, pas au sensde Ribot). Et sa conception de la raison idéale est, foncièrement, celleque l’on retrouve dans la Prière sur l’Acropole.
35. Ibid., p. 474. Voir aussi p. 484.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 195 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 195
Faiblesses et forces de Renan
J’ai voulu m’attacher au sens que pourrait revêtir le concept de« raison » chez Renan : critique. Il est vrai aussi que Renan (ce qui estmoins vrai de Taine ou de Renouvier) est plus un penseur qu’un phi-losophe ; ses définitions (entre conscience et raison, entre science et rai-son), comme on l’a vu, restent souvent floues. Sans doute est-ce parceque, fondamentalement, ce qu’il met sous ce terme de « raison », c’estessentiellement l’âme, ou encore l’esprit. Fouillée lui reprochera aussi dene pas être assez attentif à l’expérience (point sur lequel, en revanche,insistent à la même époque des pragmatistes comme C. S. Peirce ouWilliam James).
Plus étonnants, en revanche, apparaissent ses propos sur le MoyenÂge, sur l’islam, sur la scolastique en général, quand on sait non seule-ment le fin lettré et philologue qu’il est, et, plus encore, qu’à la mêmeépoque, exactement, le logicien et chimiste C. S. Peirce avait prisconscience des mines d’or que recelaient les écrits logiques des scolastiques(Paul de Venise, Ockham, Duns Scot) en matière de théorie des consé-quences ou de suppositio. Sans doute parce que Renan était d’abord ungrammaticus plutôt qu’un dialecticus, sensible aux « arts du langage »,comme en témoigne son analyse herdérienne du langage, là où Taineest plus attentif, en psychologue, aux signes. Une fois encore, Renanreste poète, philologue, historien et mathématicien plus que logicien etpsychologue.
On lui a reproché aussi une certaine condescendance à l’égard dupeuple et son sentimentalisme conservateur, pire son « génie jésuitique ».Sans doute peut-on s’étonner davantage aujourd’hui de certaines appré-ciations qu’il peut faire sur les femmes (voir ses liens avec Henriette, etles liens de celle-ci avec la femme de Renan, homme vénéré des deux),sur ses analyses des liens entre l’amour et la sexualité ou vivre avec deuxfemmes ; mais il n’est pas le seul à l’époque, même si l’on peut jugerque fait partie aussi de l’histoire celle des sensibilités, qui exige une atten-tion particulière à leur évolution. Au demeurant, on voit aussi Renanironiser sur la réaction de la directrice d’école qui favorise les garçonset manifeste des préjugés sexistes (dans Les Prix de vertu). Renan joue-t-il, comme on l’a dit, sur « tous les tableaux » ? Est-il ce sceptique dilet-tante et voluptueux ? Ressort plutôt de ses écrits l’image d’un stoïcien
(à tout le moins cicéronien ou marc aurélien) et, chez lui, l’optimismese vit le plus souvent comme un devoir (l’obligation de résister au10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 196 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
196 E R N E S T R E N A N
pessimisme schopenhauerien, d’une manière qui n’est pas sans évoquerles réactions de William James dans La Volonté de croire).
Renan a sans conteste le sens de la nuance, mais aussi, bien souvent,une véritable passion des contraires. Mais peut-on en conclure qu’il neserait qu’un tissu de contradictions ?
Tout d’abord, il n’est peut-être pas inutile d’appliquer ici à Renance que, dans sa préface au Traité sur le vide, Pascal disait des Anciens :
Ils doivent être admirés dans les conséquences qu’ils ont bien tirées dupeu de principes qu’ils avaient, et ils doivent être excusés dans celles oùils ont plutôt manqué du bonheur de l’expérience que de la force duraisonnement. […] C’est ainsi que, sur le sujet du vide, ils avaient droitde dire que la nature n’en souffrait point, parce que toutes leurs expé-riences leur avaient toujours fait remarquer qu’elle l’abhorrait et ne lepouvait souffrir. Mais si les nouvelles expériences leur avaient été connues,peut-être auraient-ils trouvé sujet d’affirmer ce qu’ils ont eu sujet de nierpar là que le vide n’avait point encore paru. De même, quand les Anciensont assuré que la nature ne souffrait point de vide, ils ont entendu qu’ellen’en souffrait point dans toutes les expériences qu’ils avaient vues, et ilsn’auraient pu sans témérité y comprendre celles qui n’étaient pas en leurconnaissance. Que si elles y eussent été, sans doute ils auraient tiré lesmêmes conséquences que nous et les auraient par leur aveu autorisées àcette antiquité dont on veut faire aujourd’hui l’unique principe dessciences. C’est ainsi que, sans les contredire, nous pouvons assurer lecontraire de ce qu’ils disaient et, quelque force enfin qu’ait cette antiquité,la vérité doit toujours avoir l’avantage, quoique nouvellement découverte,puisqu’elle est toujours plus ancienne que toutes les opinions qu’on ena eues, et que ce serait ignorer sa nature de s’imaginer qu’elle ait commencéd’être au temps qu’elle a commencé d’être connue.
La deuxième force de Renan est aussi d’avoir mesuré, non seulement« la difficulté de croire », comme l’a noté Anatole France, mais aussi ladifficulté de ne pas croire, la force des illusions, la prégnance de l’irra-tionalisme, et la difficulté d’y porter remède. Sa défense de l’esprit « cri-tique » (qui n’est pas si éloignée du néocriticisme de Renouvier) entémoigne. Mais, simultanément, sa conscience aiguë que cette « critique »est impuissance si elle ne s’appuie pas aussi sur ce que William Jamesappelait un « sentiment » de rationalité. La personnalité tourmentée deRenan va aussi de pair avec cette idée de l’exigence de rationalité commeétant une exigence morale :
L’attitude la plus logique du penseur devant la religion est de faire commesi elle était vraie. Il faut agir comme si Dieu et l’âme existaient. La religion
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 197 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 197
rentre ainsi dans le cas de ces nombreuses hypothèses telles que l’éther,les fluides électriques, lumineux, caloriques, nerveux, l’atome lui-même,que nous savons bien n’être que des symboles, des moyens commodespour expliquer les phénomènes, et que nous maintenons tout de même.Dieu créant le monde en vertu de profonds calculs est une formule biengrossière ; mais les choses se comportent à peu près comme si cela avaiteu lieu. L’âme n’existe pas comme substance à part ; mais les choses sepassent à peu près comme si elle existait. Rien n’a jamais été révélé àaucune famille humaine par des voix surnaturelles, et pourtant la révélationest une métaphore dont l’histoire religieuse a de la peine à se passer. Leparadis éternel promis à l’homme n’a pas de réalité, et pourtant il fautagir comme s’il en avait ; il faut que ceux qui n’y croient pas surpassenten bonté, en abnégation, ceux qui y croient36.
Conclusion. Renan rationaliste ou mystique ?
Dans Le Mouvement idéaliste et la réaction contre la science positive(1896), Alfred Fouillée écrit ceci :
Après avoir traversé une période où, selon le mot d’Auguste Comte, l’intel-ligence était en insurrection contre le cœur, nous entrons dans une autreoù le cœur est en insurrection contre l’intelligence. Ce que nous aimonset voulons n’est pas ce que, sur l’autorité de la science, nous jugions êtrela réalité. Nous concevons mieux, nous désirons mieux, alors même quenous ne pourrions encore formuler avec précision l’objet de notre penséeet de notre désir. Le résultat apparent d’un tel état des esprits, c’estl’anarchie intellectuelle et morale. Pourtant, cette apparence n’est-ellepoint superficielle et trompeuse ? Si l’on regarde au fond des choses, nedécouvre-t-on pas, comme résultante de tant de mouvements qui semblentdésordonnés, une direction précise et, en somme, un progrès ? Quelle estcette direction ? Est-ce en faveur du mysticisme qu’a lieu la réaction contreles abus de la science positive ? Ne prépare-t-elle point une réconciliationde la science mieux interprétée avec la morale mieux comprise, et n’est-ce pas par l’intermédiaire de la philosophie que cette réconciliation doitse produire ? Notre intention est de montrer ici les origines, et le termeprobable du mouvement idéaliste. Nous espérons, pour notre part, revenirun jour sur les hautes questions philosophiques intimement liées à lamorale et à la science sociale ; nous n’avons voulu, dans ce livre, quedéblayer le terrain, déterminer les résultats qui nous semblent désormais
36. Ibid., p. 197.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 198 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
198 E R N E S T R E N A N
acquis, enfin montrer l’orientation des esprits vers ces buts élevés qu’onne fait encore qu’entrevoir, vers ces sommets lumineux qui semblent émer-ger d’une mer de nuages37.
Et Fouillée ajoute :
Rarement en France on assista à pareil labeur des philosophes. Les pro-ductions dans l’ordre de la psychologie, de la philosophie générale, del’esthétique, de la sociologie, se succèdent sans interruption. Les thèsesde philosophie sont plus nombreuses que jamais, et il en est peu qui nesoient des œuvres remarquables. Aux travaux historiques qui charmèrentune moitié du siècle, on préfère aujourd’hui les recherches théoriques :on sent qu’il faut tourner les yeux vers l’avenir plutôt que vers le passé.Jamais l’enseignement philosophique n’excita chez la jeunesse plus d’inté-rêt, et, s’il a pu donner lieu à quelques protestations, c’est précisémentparce que, conscient de sa vitalité, et entraîné par un certain enthousiasme,il n’a pas toujours su se tenir au niveau moyen des esprits. En outre, lebesoin de croyances générales a produit une recrudescence, parfois exa-gérée, des spéculations métaphysiques. On est tombé dans le subtil etdans l’abscons ; comme la littérature, la philosophie a eu ses symbolisteset ses décadents ; mais si, sous les exagérations et les déviations, on chercheà pénétrer le sens du mouvement actuel, on peut dire que, dans le domainede la philosophie comme dans tous les autres, il est idéaliste. Quelquechose s’en va, quelque chose vient, et toute cette agitation, qui inquièteles esprits superficiels, n’aura point été vaine. Le scepticisme et le dilettan-tisme n’existent plus que chez quelques littérateurs ou critiques, qui sontdemeurés fidèles à certaines tendances de Renan. Pour ceux-là seuls, c’est« un abus vraiment inique de l’intelligence que de l’employer à rechercherla vérité », ou encore à « juger selon la justice les hommes et leurs œuvres ».L’intelligence, selon eux, s’emploie proprement « à ces jeux, plus compli-qués que la marelle ou les échecs, qu’on appelle métaphysique, éthique,esthétique » ; où elle sert le mieux, c’est à « saisir çà et là quelque soupçonou clarté des choses et à en jouir » (cf. Anatole France, Le Jardin d’Épicure).Cette attitude n’est pas celle de la majorité des esprits, qui comprennentde plus en plus le sérieux de la vie, de la science, de l’art même, et laréalité de l’idéal. Par idéalisme, d’ailleurs, nous n’entendons pas la théoriequi veut tout réduire à des idées, tout au moins à de la pensée telle que nousla trouvons en nous, ou à quelque pensée analogue. Nous ne désignons parce mot ni la négation des objets extérieurs, ni la représentation purementintellectualiste du monde ; nous entendons la représentation de toutes chosessur le type psychique, sur le modèle des faits de conscience, conçus comme
37. A. Fouillée, « Le mouvement idéaliste », Le Mouvement idéaliste en France et la réac-tion contre la science positive, op. cit., chap. VI.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 199 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 199
seule révélation directe de la réalité. Quant au spiritualisme proprementdit, ce mot, devenu ambigu, désigne plutôt aujourd’hui la doctrine quiattribue à l’esprit une existence plus ou moins séparée, plus ou moinssubstantielle, indépendante des relations du dehors, de l’espace et même,selon quelques-uns, du temps. Ainsi représenté, le spirituel ne semble plusaujourd’hui (comme le matériel) qu’un extrait du fait total, dont on aéliminé par abstraction les rapports mécaniques, pour en faire une sortede « substance » ou d’« acte pur » capable de subsister par soi, avec lescaractères d’« unité », d’« indivisibilité », de « pérennité ». Une telleconception (vraie ou fausse) est une thèse métaphysique ; ce n’est pas lefait psychique de l’expérience, en sa réalité immédiate et concrète. Quelleque soit donc la valeur de cette conception, elle ne peut venir qu’ulté-rieurement : le point de départ doit être le fait d’expérience interne. Delà, chez les philosophes contemporains, cet « idéalisme » dont le vrai nomserait plutôt le « psychisme ». En ce sens, le mouvement de la penséeidéaliste est visible pour tous ceux qui parcourent les revues spécialementconsacrées aux questions philosophiques, morales et sociales38.
Sans doute Fouillée est-il injuste à l’égard de Renan ; mais son ana-lyse de la situation historique montre à quel point il est impossibled’apprécier la position de Renan et la nature de son rationalisme sansmesurer ce qui se joue à l’époque, entre les différents courants qui vontconduire à une forme « idéaliste » du rationalisme ou à une forme déci-dément « spiritualiste » de celui-ci. La véritable question qui se pose alors,pour évaluer la position de Renan, c’est de savoir de quel côté au justeil pencherait plutôt.
Dans « Le procès du rationalisme », paru dans la tribune libre deLa Pensée, Julien Benda – qui s’oppose à un article paru dans Le Mondesous le titre « La querelle du rationalisme39 » et qui reproche à son auteur,Jean Lacroix d’omettre l’essentiel du procès – rappelle que le « rationa-liste » (terme sous lequel il range Einstein, Louis de Broglie, Russell,mais aussi Brunschvicg, Meyerson, Parodi, Beaulavon, Louis Weber) a« fort bien accepté de porter son esprit sur des territoires nouveaux etparticulièrement ardus à défricher [et qu’]il l’a fait, sans cesser d’employerles méthodes rationnelles. Il a compris qu’il lui fallait considérablementaffiner ces méthodes dans leur application, mais les a conservées dansleur nature. » Or, poursuit Benda, « ce que les adversaires du rationalismelui reprochent […], c’est précisément son attachement à ces méthodes,quelle que soit l’application qu’il en fasse et le terrain sur lequel il le
38. Je souligne.39. Le Monde, 18 janvier 1946.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 200 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
200 E R N E S T R E N A N
porte », là où ils veulent, eux, « une communion avec les choses elles-mêmes à l’exclusion de toute attitude intellectuelle. Disons le mot : aunom d’une position mystique ». Mais on voit alors « l’inégalité du com-bat. Le rationaliste dit à son adversaire : “nous prenons le rationnel etnous vous laissons le mystérieux”. Le mystique répond : “Je prends lemystérieux et aussi le rationnel.” Chose d’ailleurs naturelle, chez quirefuse toute distinction entre l’être et le connaître le rationaliste doitcomprendre le mystique ; ce que ce dernier n’est pas tenu de lui rendre ».Or, cette confusion, Renan ne l’a jamais voulue, ce pourquoi il a suiviles méthodes rationnelles, et elles seules, et en premier lieu dans sontravail sur les Évangiles.
« Vous connaissez ce mot de l’Évangile : “Seigneur, à qui irions-nous ? Nous n’avons pas d’autre espérance.” C’est ce que je dirais de laraison : “À qui irions-nous ? Nous n’avons rien d’autre.” Je constated’ailleurs que nombre de philosophes contemporains, après avoir consi-déré la raison comme intrinsèquement répressive ou s’être laissé fascinerpar les solutions violentes ou raciales en sont arrivés à peu près à lamême conclusion. Mais nous devons aussi nous méfier de l’étrange rôlequ’on voudrait aujourd’hui faire jouer au philosophe : on attend de luiqu’il fasse la morale à une société qui est dans l’ensemble totalementimmorale. Plus la réalité vraie est celle de la compétition économique,du marché et du profit, plus on semble avoir besoin de gens qui rappellentque les grandes idées et les idéaux restent essentiels, même s’ils sontcontredits de façon patente et presque insupportable par cette réalité.C’est pourquoi il ne peut y avoir de rationalisme sans une bonne dosed’ironie. Neurath disait déjà que “l’humour est une précondition de lamorale.” J’ai envie d’ajouter sur le même ton, que “l’ironie est une pré-condition du rationalisme40” ».
Ce rationalisme ironique, il me semble que Renan, qui appréciaitles métiers de taupier et de torpilleur, l’a toujours en fait pratiqué, leplus souvent entre deux virgules dans un long développement. En quoiil est le fils de Voltaire, de Swift, le frère des Kraus, des Musil et desLichtenberg, un authentique représentant des Lumières et de l’Aufklärung,même s’il y a aussi chez lui beaucoup des Romantiker. Certes, Tréguiern’est qu’à quelques encablures de Combourg. Et il y a toujours du Renéchez Ernest. Lamartine lui-même n’était-il pas rangé parmi les rationa-listes ? « “Raison, raison, n’es-tu pas le dieu que je cherche41 ?” Le vraiDieu, c’est Athénée, la sagesse, la science immortelle et souveraine. En
40. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, Paris, Hachette, 1998, p. 9-10.41. E. Renan, Prière sur l’Acropole.
10_203199SNN_RENAN_FM9.fm Page 201 Mardi, 11. juin 2013 4:06 16
C l a u d i n e T i e r c e l i n 201
elle seule résident la puissance et la vertu. “On est plus ou moins homme,plus ou moins fils de Dieu. On a de Dieu et de vérité ce dont on estcapable et ce qu’on mérite. Je ne vois pas de raisons pour qu’un Papousoit immortel42.”43 » Pour cela, et ne serait-ce que pour cela, parce qu’ilresta foncièrement fidèle à Athénée, certes autant que le lui permît safoi, il ne serait pas, selon moi déplacé, de considérer que Renan a toutesa place dans notre Acropole républicaine. Si mon athéisme celte ne meprédispose pas à en faire la prière, je me risque pour ma part, depuisce Collège de France qu’il a tant aimé, à en formuler le vœu.
42. E. Renan, « De la métaphysique et de son avenir », Revue des Deux Mondes, 1860,p. 378.43. G. Fonsegrive, De Taine à Péguy, op. cit., p. 31.