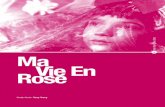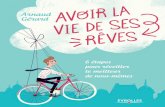Donner aux squelettes un supplément d’âme : vie et mort des chiens d’Autricum
-
Upload
campus-paris-saclay -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Donner aux squelettes un supplément d’âme : vie et mort des chiens d’Autricum
83
Les sources archéologiques, iconographiques ou écrites, témoignent de l’ancienneté (Pion-nier-Capitan 2011) et du permanent renouvelle-ment des morphotypes de chiens (Baxter 2010).Beaucoup s’accordent aussi à reconnaître, pour le territoire et la culture qui nous occupent, une « explosion » de la diversité des formes canines associé à des changements de statuts, qui trou-veraient leur origine à la fin du second Âge du Fer (Méniel 1987 et Horard-Herbin 1996).L’origine de cette petite révolution, à la fois zootechnique et cognitive (diminution ou arrêt de la cynophagie, de la récupération de la peau, apparition de petits chiens de compagnie), est tout récemment discutée par M.-P. Horard-Her-bin (2014). Elle s’envisage aujourd’hui comme un phénomène plus nuancé, tel que le suggèrent des découvertes récentes portant sur la place de cette espèce dans les pratiques artisanales (Le-petz, Rivière et Frère 2013) et les rituels gallo-romaines (Bayle et Frénée 2013).Les méthodes d’analyse archéozoologiques permettent de caractériser ces populations an-ciennes et de les rapprocher de nos races ac-tuelles. La confrontation avec les descriptions issues des textes antiques ou des sources icono-graphiques autorise à reconnaître, ici et là, des types de chiens dont les fonctions peuvent être supposées.L’application au domaine de l’archéologie de ce type de sources, riches d’enseignements sur les rôles et considérations que la société antique accorde à cette espèce (Bodson, 1980, Goguey, 1995, Leseleuc 1983), reste toutefois sujette à caution pour bien des raisons.Il est apparu intéressant de s’attarder sur l’his-toire individuelle des chiens découverts dans les niveaux antiques de Chartres et de ses en-virons afin d’enrichir l’approche traditionnelle au moyen d’une discipline encore nouvelle en archéozoologie qu’est l’analyse paléopa-thologique3. Celle-ci est envisagée ici en tant qu’examen des conditions de vie des espèces animales et de leurs implications socio-cultu-relles (Binois 2012).
Les contextes de découverteLes fouilles préventives menées ces dix dernières années à Chartres et dans ses alentours ont livré quantité de restes animaux (environ 60 000) attri-bués aux périodes antiques. Si une grande majo-rité de ces vestiges correspond à des déchets ali-mentaires ou artisanaux issus de l’exploitation des espèces consommées, d’autres sont liés à la pratique de l’équarrissage des cadavres d’équidés et de chiens (Lepetz et al. 2013). Mais, alors que les premiers sont, de manière systématique, reje-tés dans les secteurs périurbains en phase d’aban-
Donner aux squelettes un supplément d’âme : vie et mort des chiens d’Autricum
Gwenaëlle Boutin1 et Julie Rivière2
Fig. 1 - Localisation des principaux lieux de découverte de squelettes de chiens à Autricum (DAO Ville de Chartres).
1 - Étudiante à Paris I, Master I Archéologie et Environnement.
2 - Archéozoologue - Service Archéolo-gie de la Ville de Chartres - UMR 7209.
3 - Les informations biologiques et paléopathologiques acquises sur ce petit échantillon de squelettes de chiens Carnutes sont issues d’un travail de mémoire de Master I réalisé par G. Boutin (Paris I), sous la co-tutelle de Christophe Petit (professeur) et Anne-Lise Binois (doctorante).
84
don (carrières en friches, comblement supérieur du fossé « à talus massif », décharges commu-nautaires, etc.), les restes de chiens s’immiscent davantage dans les dépotoirs d’habitats, à l’état d’ossements épars ou de squelettes en connexion anatomique. Ce corpus de données représente plus de 1200 restes osseux4, dont huit squelettes en place. Cet échantillon est majoritairement com-posé d’adultes (87, 5 %) de sexe mâle (75 %).La diversité des contextes est grande : habitat do-mestique urbain, espace de décharge périurbaine, habitat périurbain à vocation artisanale, agglomé-ration secondaire ou habitat rural.Au sein de ces différents espaces, la proportion relative des restes de cette espèce s’apprécie aussi de manière assez variable (de 2 à 20 %). Seul le contexte de décharge du site de Beaulieu (opé-ration 6) se démarque, avec des effectifs qui dé-passent 20 % du NRdet.5, pour des niveaux datés des années 200 à 250 après J.-C.D’un point de vue chronologique, l’augmentation sensible de cette espèce dans les niveaux tardifs du Haut-Empire est en grande partie fondée sur les données du site de Beaulieu. Ce site ne peut sans doute pas rendre compte à lui seul d’une si-tuation d’ordre général.
Les conditions de rejets présentent un panel réduit de situations, qui oppose les restes isolés ou épars6
aux cadavres sub-complets ou entiers7. La dispo-sition de ces restes n’est pas toujours connue ou suffisamment documentée, eu égard aux condi-tions de découvertes et à la forte mécanisation des fouilles. Certains de ces squelettes ont néan-moins pu faire l’objet d’analyses taphonomiques qui confirment l’intégrité initiale des cadavres au moment de leur enfouissement, indiquent un mode de recouvrement rapide, pas toujours homo-gène (espace colmaté ou espace colmaté différé) et révèlent le peu de soin apporté à leur rejet.
C’est le cas notamment du chien découvert dans le creux d’un fossé sur le site rural antique du Petit Archevilliers (C267.2, fig. 2) qui semble avoir été rejeté ventre contre terre et qui présentait une tor-sion importante au niveau des cervicales.
C’est aussi le sort du petit chien découvert dans le comblement d’abandon d’un puits sur le site urbain du Cinéma (C219.1, Chartres, fig. 3). Il a été jeté sur le dos, la tête renversée en arrière. Celle-ci a basculé par la suite dans l’espace vide laissé entre les blocs de pierres et de terres cuites architecturales.
Fig. 2 - Squelette de chien en connexion anatomique découvert dans le comblement d’un fossé sur le site du Petit Archevilliers (C267.2, Chartres, cliché J. Rivière).
Fig. 3 - Squelette d’un chien découvert dans les niveaux d’abandons du site du « Cinéma »,
Chartres (IIe s. ap. J.-C.).
85
C’est peut-être aussi ce qui s’est produit pour les restes « remaniés »8 du squelette d’un autre individu, rejeté dans une mare à l’aplomb d’une voie et accompagné de la semelle en cuir d’une chaussure, sur le site de décharge périurbaine de Beaulieu (C263.op. 6, Chartres, fig. 4).À ces modalités de rejets, visiblement peu soi-gnés, s’ajoute une nature de comblement très riche en détritus divers (céramique, fragments de verre, de fer rejets alimentaires animaux et blocs).C’est sans doute le caractère commun à l’en-semble des contextes, qui place les chiens au même niveau que les déchets ordinaires et ex-clut l’inhumation au registre des découvertes.(fig.5)D’autres indices, assez rares et non systéma-tiques, apportent aussi un certain éclairage sur le traitement post-mortem des cadavres de chiens. Ces indices, correspondent à de dis-crètes incisions lisibles à la surface des os, qui témoignent de la récupération de la peau (sites de Reverdy) ou de la désarticulation des membres (site du Clos-Vert). Ces deux sites sont caractérisés, en outre, par la présence de déchets artisanaux de l’os ou du fer. Si dans un cas, les traces de dépouillage, localisées au niveau du museau, ne concernent pas la récu-pération de matières comestibles, il faut bien avouer que les quelques traces de désarticu-lation des membres observées sur le site du Clos-Vert, invitent davantage au débat.
Caractérisations biologiques et biométriques
L’état de conservation des restes squelettiques est dépendant d’une combinaison de divers facteurs, souvent cumulatifs, liés à l’interven-tion de l’homme (avant enfouissement ou lors de la découverte) ou à l’action de phénomènes naturels (pendant l’enfouissement). Ces biais de conservation peuvent considérablement limiter l’acquisition de données biologiques et biométriques. À ces biais s’ajoutent les cas relativement fréquents, notamment lors d’opérations archéologiques préventives, de prélèvements partiels des squelettes. La carac-térisation de la population étudiée et la recon-naissance des différents morphotypes s’en trouvent parfois limitées.
Fig. 4 - Restes remaniés d’un squelette de chien accompagné d’une semelle de chaussure en cuir (Beaulieu, op. 6, Chartres).
Fig. 5 - Rejets successifs de deux cadavres de chiens dans une vaste fosse dépotoir sur l’habitat urbain rue Casanova (C229.3, IIe siècle après J.-C., cliché M. Pousset).
86
Les sites d’habitat urbain
Le site urbain du « Cinéma » (C219.1) a livré les restes d’un mâle (Ruscillo 2006) âgé de 2 à 3 ans au moment de son décès (stade Ec, Horard-Herbin 2000). Cet animal présentait des os longs très graciles, un crâne de petite dimension et un museau assez fin. Il mesurait 29,5 cm au garrot. Sa morphologie céphalique est de type brachy-céphale, laquelle confère aux individus un aspect juvénile (Lignereux et al. 1991). La gracilité os-seuse des os longs le rapproche d’une morpho-logie ellipsométrique ou naine (Galy 2005). En considérant les seuls indices de taille, de graci-lité des membres et de morphologie crânienne, ce chien peut être rapproché d’espèces actuelles telles que les Bichons ou Loulous de Pomé-ranie (appelé aussi Spitz nain ou Petit Spitz) mais également des terriers, comme le West-Hi-ghland White Terrier ou encore d’autres terriers modernes tels les races de Norfolk et Jack Rus-sel (Baxter 2010). Ces terriers sont par ailleurs connus pour avoir été utilisés comme chasseurs de nuisibles chez les Romains. Cependant, et malgré la présence d’un stop marqué qui carac-térise de manière commune les crânes ces deux types de chiens, les mesures et la morphologie de notre individu le rapprochent davantage des Bichons (Baxter 2010, fig. 6).L’habitat urbain de la rue Casanova (C229.3) a livré les restes de trois cadavres, dont deux reje-tés dans la même fosse dépotoir (US 1284). Le premier individu (dernier rejeté) présente une stature qui se situe entre 43 et 44 cm au garrot. Ce chien mâle était âgé de 4 à 6 ans (Horard-Herbin 2000). Son crâne est de type dolicho-céphale (Lignereux et al. 1991). L’ensemble des données nous indique que nous sommes face à un individu de taille moyenne, avec une mor-phologie crânienne proportionnelle à sa taille. Ceci nous permet de le classer dans la catégo-rie des médiolignes et selon des caractères plus spécifiques, dans la catégorie des lupoïdes (Galy 2005). Ces caractéristiques morphologiques, ainsi que la longueur et l’indice de robustesse des tibias, orientent le diagnostic vers un chien de type Cocker ou Épagneul breton (Lignereux et al. 2011, fig. 7).Le deuxième squelette correspondait à celui d’un jeune mâle, âgé entre 8 et 10 mois (New-ton 1985). L’estimation de sa stature ne peut être précisée en raison de l’immaturité de ses osse-ments. Toutefois, sa morphologie céphalique et post-céphalique le rapproche des petits chiens de compagnie, tels que nos Bichons actuels (fig. 6).
Une dernière concentration d’ossements, assez mal conservés, a révélé la présence d’un troisième individu dont la taille au garrot a pu être estimée à 27, 7 cm. Les restes de cet animal appartenaient à une jeune femelle (Ruscillo 2006) âgée de moins de 2 ans (18 et 24 mois), comme l’indique le degré de suture de sa crête iliaque (Barone, 1976). Les caractéristiques morphologiques de ses ossements sont très proches de l’individu précédent (fig. 6), ce que confirme l’analyse biométrique de son tibia (Belhaoues 2011). De plus, l’absence de la troi-sième molaire, le chevauchement de la quatrième prémolaire et de la première molaire, et la chute ante-mortem des premières et deuxièmes prémo-laires, sont autant d’indices qui nous invitent à re-connaître ici un « chien nain/jouet » tel que défini par I. Baxter (2010).Le site de l’avenue Béthouart (C314) a livré un squelette très partiel, car prélevé dans une tran-chée de diagnostic. Les quelques ossements dis-ponibles permettent d’estimer une taille comprise entre 44 et 45 cm au garrot. Ce jeune mâle, dont l’âge au décès est compris entre 1 et 1,5 ans, pré-sente en effet, sur certains os longs, des sutures épiphysaires encore visibles (Wilson et al. 1982) qui sont compatibles avec la très légère usure de la surface occlusale de sa carnassière inférieure (stade Bb, Horard-Herbin 2000). La conformation des tibias s’accorde avec les races de type Cocker ou Épagneul breton (Lignereux et al. 2011, fig. 8).
Les décharges ou habitats péri-urbains
Sur le site de Beaulieu (op. 6), les ossements sont très majoritairement des restes isolés et très fragmentés. Seule l’US 6702 a livré un squelette quasi-complet appartenant à un adulte de sexe in-connu, âgé de 4 à 6 ans (stade Gb, Horard-Herbin 2000). La fragmentation de ce squelette étant très importante, sa taille n’a pu être estimée. Toutefois, après remontage, nous pouvons remarquer qu’il possède des os gracile et de longueur moyenne. La longueur et la robustesse de la mandibule per-mettent de le rapprocher, avec prudence, des races actuelles que sont l’Épagneul breton ou le Whip-pet, une race de lévrier (Belhaoues 2011, fig. 9).Le site de Reverdy (C260) a majoritairement livré des parties squelettiques isolées et très fragmen-tées. Le degré d’épiphysation de l’ensemble des os longs, la fermeture des sutures crâniennes asso-ciées à la présence de dents définitives, indiquent la présence exclusive d’adultes.
4 - Sites : Reverdy, Saint-Brice et Réservoirs C260 (fouille V. Acheré, 2007-2008), Beaulieu, opération 6,
C263.6 (fouille L. Coulon, 2007-2008), Cinéma C219.1 (fouille D. Joly, 2005-2006), Clos-Vert C268
(fouille C. Ben Kaddour, 2008), rue Casanova C229.3 (fouille P. Gibut,
2013), Petit Archevilliers C267.2 (fouille T. Lecroère, 2013) et avenue Béthouart C314.1 (fouille P. Gibut, 2012) pour Chartres. Les Vergers à Mignières (fouille P. Gibut, 2011).
5 - Nombre de Restes Déterminés.
6 - C’est le cas pour la totalité des restes issus des sites de Reverdy
(C260, rue de Reverdy, de Saint-Brice et des Réservoirs, Chartres) et (C245, 17, rue de Reverdy, Chartres), sur le site de Beaulieu, opération 6, sur le
site du Clos-Vert (C268, Chartres). Mais aussi pour la grande majorité
des restes issus des sites des Vergers à Mignières, du Cinéma (C219.1) et de
la rue Casanova (C229.3) à Chartres.
7 - Sites de l’avenue Béthouart, du Petit Archevilliers (C267.2), du
Cinéma (C219.1) et de la rue Casanova (C229.3).
8 - L’absence d’analyse taphonomique ne nous permet pas de connaître
l’état de conservation du corps de ce chien avant son enfouissement, ni
de décrire d’éventuels remaniements post-dépositionnels qui seraient à
l’origine de l’état dispersé de ces osse-ments lors de sa découverte.
87
Fig. 6 - Crânes et mandibules des chiens issus des sites C219.1 et C229.3 (Chartres) et proposition de comparaison avec les races actuelles des Bichons ou Loulous de Poméranie (clichés : G. Boutin).
Fig. 7 - Crâne et mandibule de l’individu 1 du site C229.3 (Chartres) et proposition de comparaison avec la race actuelle des Cockers ouÉpagneuls bretons (cliché G. Boutin).
88
Fig. 8 - Crâne et mandibule du chien découvert sur le site C314 (Chartres) et
proposition de compa-raison avec les races
actuelles des Cockers ou Épagneuls bretons
(cliché G. Boutin).
Fig. 9 - Mandibule du chien découvert sur le site C263.6 (Chartres) et proposition de com-paraison avec les races actuelles des Épagneuls bretons ou des Lévriers (cliché G. Boutin).
89
Sur le site du Clos-Vert (C268), la totalité des restes ont été prélevés de manière isolée. L’étude distingue deux chiens adultes et un juvénile âgé de moins de 7 mois (Newton 1985). Ni le sexe, ni la taille des individus ne sont accessibles.
Le monde rural
La dépouille découverte dans le creux d’un fossé parcellaire sur l’occupation rurale du « Petit Ar-chevilliers » (C267.2) appartient à un mâle adulte, âgé de 4 à 6 ans (stade Ga, Horard-Herbin 2000), qui mesurait 54 cm au garrot, ce qui le place dans la catégorie des grands chiens. Cet individu pré-sente des membres antérieurs plus robustes que les membres postérieurs, ce qui peut indiquer un type de chien taillé pour la course ou l’attaque. La relation entre l’indice de robustesse de la mandi-bule et sa longueur maximale (Belhaoues 2011) semble confirmer une morphologie de type mé-dioligne (Lignereux et al. 1991). La présence de côtes bien voûtées, de membres antérieurs puis-sants et de pattes arrière plus graciles et dotées d’une musculature saillante permet de reconnaître un chien de type molossoïde, tel que les Boxers (fig. 10).
L’agglomération secondaire
Le site des Vergers (Mignières) a livré de nom-breuses parties squelettiques isolées. Au sein d’une même unité stratigraphique (US 3415), les restes osseux prélevés en lot ont pu être rapportés au même individu (était-il en connexion anato-mique ?). Ce dernier est un mâle adulte (Ruscillo 2006) âgé d’environ 2 ans (stade Db, Horard-Her-bin 2000 ; Hillson 2005) qui présente une taille au garrot relativement grande, car estimée à 62 cm. La majeure partie de ses ossements sont frag-mentés, notamment son crâne. Néanmoins, les mesures prises sur les mandibules et les tibias le rapprochent des races de Bergers, tel le Berger allemand (Belhaoues 2011, fig. 11).
Les sites du Cinéma et de Casanova (individus 2 et 3) ont livré des types Bichon ou Loulou de Poméranie que nous plaçons dans le groupe des chiens de compagnie et d’agrément. Mar-tial parle de ces chiens d’agrément dans les Epigrammes (XIV, 198 in Leseleuc 1983) : « les chiens préférés étaient de mignonnes bêtes que l’on tirait de la Gaule ». La présence des bichons est aussi attestée par Strabon (Géo-
graphie, VI, 2) et Pline (Histoire naturelle, III, 30) sous le nom de « chiens de compagnie de Malte » tandis que les Loulou de Poméranie sont décrits par ces mêmes auteurs antiques comme « des chiens dameret de petite taille, au front assez large, museau pointu, oreilles droites, poil long et fourni, queue touffue et retournée sur elle-même » (Leseleuc 1983).Des chiens de taille moyenne sont aussi dé-couverts sur les sites de Casanova (individu 1) et de l’avenue Bétouart. Ces derniers sont rapprochés des types Cocker ou Épagneul breton. Les Cockers appartiennent au groupe des chiens leveurs de gibiers, rapporteurs et des chiens d’eau, les Épagneuls bretons, au groupe des chiens d’arrêt. Ceci nous permet de supposer que les individus retrouvés sur ces sites pouvaient être utilisés pour la chasse. Ces types de chiens sont décrits dans la littérature antique et notamment chez Oppien (Cynégé-tique, I, 468) : « Parmi les chiens qui chassent à la piste, il est une espèce petite à la véri-té, mais robuste ; les Bretons les nomment agasses » (Leseleuc 1983).Les restes d’un chien provenant de la décharge périurbaine du site de Beaulieu (opération 6) peuvent-être rapprochés du groupe des Lé-vriers, une race connue pendant l’Antiquité pour la chasse.Enfin, sur les sites du Petit Archevilliers et sur le site des Vergers à Mignières, ont été découverts des types Boxer et Berger alle-mand. Le premier appartient au groupe des chiens de type Pinscher, Schnauzer, molos-soïdes et chiens de bouvier suisses. Les boxers descendent des chiens de combat de type mo-lossoïde de l’Antiquité et semblent avoir été employés pour la guerre. Selon Strabon, les Bretons « produisaient des chiens excellents pour la chasse mais aussi des dogues qui ser-vaient à la guerre » (Strabon, Géo. IV, 5 in : Leseleuc 1983). Cela se confirme avec Gratius (Cynégétique, 174, 181 in : Leseleuc 1983). Ils ont aussi souvent été utilisés comme chien de travail ou de chasse, en particulier pour la chasse au gros gibier tel le daim, le sanglier ou encore l’ours. Le deuxième individu appartient au premier groupe des chiens de berger et de bouvier. Le berger allemand est un descendant des chiens de berger dévolu par excellence à la tâche de garde des troupeaux.La population des chiens de Chartres et de sa proche campagne est donc assez diversifiée. Trois groupes principaux se détachent: les chiens de compagnie, les chiens de chasse et les chiens
90
de garde (des troupeaux ou pour l’attaque). Bien que l’échantillon reste limité, il apparaît que les formes petites à moyennes (animaux de compa-gnie ou de chasse) se rencontrent exclusivement en milieu urbain. Dans le domaine rural, bien que le site des Vergers, à Mignières, corresponde à une agglomération secondaire, les individus pré-sentent une stature plus importante et leurs hypo-thétiques affectations recouvrent les domaines de la chasse au gros gibier, de la garde, voire de la guerre.
L’approche paléopathologique
Les lésions traumatiques, infectieuses ou inflammatoires
Au sein de ce petit corpus quatre individus pré-sentent des lésions d’origine traumatique, infec-tieuse ou inflammatoire.L’individu du site du Cinéma présente des patho-logies dégénératives (arthrose du genou et début d’arthrose au niveau des thoraciques par la pré-sence d’un « bec de perroquet » en formation). De manière générale, les causes de l’arthrose sont assez mal connues. Elles n’entrent pas en contra-diction avec le jeune âge de l’individu. Au niveau du tibia, elle peut faire suite à l’inflammation de l’articulation et peut avoir une origine trauma-tique ou infectieuse.Sur le site du Clos-Vert, un des individus (US 1128) présente un cal vicieux formant une pseu-do-articulation en partie distale. Cette lésion a entraîné un défaut d’alignement avec le tibia, qui a dû affecter sa mobilité. En outre, il est possible d’avancer l’idée que l’animal ne devait plus poser la patte à terre, car dans le cas contraire la sur-face articulaire du plateau tibial aurait présenté un important remodelage (arasement des épines intercondylaires).Sur le site de la rue Casanova, l’individu 1 pré-sente une lésion visible sur la phalange I anté-rieure. Cette lésion peut être liée à un diagnostic d’enthésopathie ayant affecté le métacarpe II. Elle devait entrainer une douleur prononcée et des problèmes de mobilité. En effet, l’enthéso-pathie est une pathologie des enthèses désignant les insertions osseuses des tendons, des capsules articulaires ou des ligaments. Elle peut être liée à
un traumatisme ou à une maladie inflammatoire comme l’arthrose.Enfin, un autre cas d’enthésopathie est observé sur le métacarpe IV gauche du chien provenant de l’occupation rurale du Petit Archevilliers. Cette enthésopathie couplée à une asymétrie de taille des métacarpes a pu gêner l’animal dans ses dé-placements.Ces diagnostics d’enthésopathie sont à prendre avec précaution, l’étude des radiographies reste préliminaire.
Les lésions traumatiques
En comparaison avec ces lésions dont les causes sont incertaines, d’autres traumatismes observés sur les individus 1 et 2 du site de la rue Casano-va peuvent être diagnostiqués comme d’origine traumatique certaine. Ces lésions sont localisées au niveau des côtes. En effet, l’individu 1 (mâle-adulte) présente trois fractures résorbées sur les côtes 8, 9 et 10 droites. Le second individu (mâle-immature) présente également deux fractures avec des cals osseux légers sur la première côte droite et la huitième gauche. Ces fractures costales semblent avoir été résorbées longtemps avant la mort des individus. Elles peuvent cicatriser entre 8 et 16 semaines (Cruess et al. 1985).Pour l’individu 1, ces fractures résultent de deux évènements distincts, sans pour autant que la chronologie des faits puisse être avancée. En effet, l’emplacement des fractures est différent d’une côte à l’autre. La fracture de la huitième côte est localisée en partie mésio-distale alors que les fractures des côtes 9 et 10 sont alignées et se situent en partie proximale. Elles ne présentent aucun défaut d’alignement et n’avaient donc pas d’incidence dans la vie de l’animal.Ce type de fracture peut être d’origine acciden-telle, lié à l’homme ou à un conflit inter- ou in-tra-populationnelle. Toutefois, les fractures liées à la maltraitance, appelées aussi « traumatismes contondants », touchent préférentiellement les côtes et les vertèbres (Merck 2007 in Binois 2012). En outre, elles se distinguent des fractures accidentelles par le fait qu’elles présentent diffé-rents stades de cicatrisation (Munro et Thrusfield 2001 ; Tong 2013). À ces critères s’ajoute la for-mation d’un cal, qui n’apparaît pas dans les cas de lésions accidentelles (Tong, 2013). L’hypothèse de la maltraitance pourrait alors être envisagée pour expliquer l’origine des fractures observées sur ces deux individus.
91
Fig. 10 - Mandibules d’un chien provenant du site M019 (Mignières) et proposition de rapprochement avec les actuels Boxers (cliché G. Boutin).
Fig. 11 - Mandibules du chiens découvert sur le site C267.2 (Chartres) et proposition de rapprochement avec la race actuelle des Bergers allemands (cliché G. Boutin).
92
Discussion et perspectives
La population des chiens antiques provenant de Chartres et de ses environs représente pour l’heure un corpus restreint, qui recense néanmoins une assez large diversité de morphotypes dont on ne saurait dire s’ils sont le fruit de besoins ou de désirs particuliers.Ces résultats s’accordent avec les sources litté-raires ou iconographiques antiques, qui tendent à valoriser les chiens de garde, de chasse et de compagnie. Il s’agit des trois principaux types de chiens rencontrés dans notre corpus.Une lecture hâtive des données pourrait convenir qu’une opposition se dessine entre la population urbaine et rurale, caractérisée, pour l’une, par la présence de petits chiens de compagnie et, pour l’autre, par la présence de chiens de garde. Cette opposition devra être confirmée par l’apport de données plus nombreuses.L’analyse paléopathologique permet de décrire une population présentant un état de santé glo-balement bon, comprenant des individus présen-tant des lésions mineures qui n’ont pas entraîné la mort, malgré le décès prématuré de quelques
individus. Elle précise qu’aucun soin visible ne semble avoir été apporté aux quelques individus souffrant d’affections ayant contrarié leur mobili-té, malgré l’existence d’une médecine vétérinaire (Bodson 1984), dont il serait intéressant d’analy-ser l’étendue et les compétences à cette espèce9.L’analyse paléopathologique évoque, en outre, l’existence d’actes de maltraitance observés sur deux individus, dont un adulte de taille moyenne et un immature de petite taille, découverts sur le site de la rue Casanova.L’ensemble s’accorde pour restituer une image as-sez ordinaire d’une population canine comprenant son lot d’estropiés et d’une population humaine où sévissent de mauvais maîtres.La mise en évidence de traumatismes liés à de mauvais traitements infligés par l’homme, obser-vés notamment sur un jeune chien de morphologie proche de nos actuels bichons, invite toutefois à réexaminer le statut favorisé de ces chiens dits de « compagnie ». Ce statut n’a d’ailleurs guère d’in-cidence au-delà de leur mort, puisque ces derniers rejoignent le sort commun et peu enviable réservé aux cadavres de leurs semblables, rejetés sans complaisance au milieu des détritus ordinaires.
Références bibliographiques
Barone R., 1999 - Anatomie comparée des mammifères domestiques, Vigot Frères, Paris, 4em éd. 761 p.
Baxter I.-L., 2010 - Small Roman Dogs. In BoneCommons,Item#901,http://alexandriaarchive.org/bone-commons/items/show/901 (accessed May 12, 2014).
Bayle G. et Frenée E., 2013 - Un ensemble d’inhumations associant un chien et un mouton dans l’envi-ronnement d’un sanctuaire gallo-romain à Pannes « Plateville », (Loiret). IN : Auxiette G et Méniel P. (eds) - Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à l’interprétation. p.77-85.
Belhaoues F., 2011 – Variabilité des chiens antiques. L’apport inédit du puits PT103 à Ambrussum (Hé-rault), Publication des « Cinquièmes Rencontres archéozoologiques de Lattes », 17 juin 2011.
Binois A., 2012 – Une vie de chien…Traumatismes multiples et maltraitance potentielles sur un chien médiéval, un cas paléopathologique. Bull. Soc. Hist. Méd. Sci. Vét., 12, p. 37-50.
Bodson L., 1980 - Place et fonction du chien dans le monde Antique. Ethnozootechnie, n°25, p.13 – 21.Bodson L., 1984 – La médecine vétérinaire populaire. Ethnozootechnie n° 34, p. 3-12.
Cruess R.-L., Dumont J., Newton C.-D. et Rhinelander D.-M., 1985 - Chapter 3. Healing of bone. In: Newton, Nunamaker (eds.), Textbook of Small Animal Orthopaedics, Philadelphia.
9 - Voir sur ce sujet la publication à venir du IVe Colloque international
de médecine vétérinaire antique « La trousse du vétérinaire dans l’Anti-quité et au Moyen-âge : instruments, médicaments, pratiques ». Boehm I. et Gitton-Ripoll V., Lyon, juin 2014.
93
Galy G., 2005 – Analyse ostéopathique de la variété des morphologies canines. Mémoire pour l’obten-tion du diplôme d’ostéopathe animalier, European School of Animal Osteopathy (E.S.A.O.), 2005, 53 p.
Garseiden A., Valenzuela Lamas S. et Belhaoues F., 2011 – Variabilité des morphotypes canins archéo-logiques et implications sur le statut du chien dans l’Antiquité. In : Brugal J.-P., Gardeisen A. et Zucker A., Prédateurs dans tous leurs états : 2volution, Biodiversité, Interaction, Mythes, Symboles. Actes des XXXIe Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Editions APDCA Antibes, CEPAM-UNSA, p. 225-237.
Goguey D., 1995 – Les romains et les animaux : regards sur les grands fauves, liens affectifs entre l’homme et l’animal. Caesarodonum. Actes du colloque de Nantes, 1991 : Homme et animal dans l’Anti-quité Romaine, p.51-66.
Habermehl K.-H., 1975 – Die Altersbestimmung bei Haus- und Labortieren, 2. Aufl. 216 S., Berlin et Hamburg.
Harcourt R., 1974 – The Dog in Prehistoric and Early History Britain, Journal of Archaeological Science, 1, p. 151-175.
Hillson S., 2005 – Teeth, Cambridge university press (2e ed.), Cambridge, 373 p.
Horard-Herbin M.-P., 1996 – L’élevage et les productions animales dans l’économie de la fin du second Age du Fer à Levroux (Indre). Thèse de Doctorat, Université de Paris I, 350 p.
Horard-Herbin M.-P., 2000 – «Dog management and use in the late Iron Age: The evidence from the Gal-lic site of Levroux (France)». In: Crockford S. (Ed.) – Dogs Through Time: An Archaeological Perspec-tive. Proceedings of the First ICAZ Symposium on the History of the Domestic Dog BAR, International Series, 889, p. 115–121.
Horard-Herbin M.-P., 2014 (sous presse).
Lepetz S., Rivière J. et Frère S., 2013 - Des accumulations de cadavres d’équidés aux portes des villes romaines : pratiques hygiénistes, récupération de matières premières et équarrissage. In : Auxiette G et Méniel P. (eds) - Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à l’interprétation, p. 221-248.Leseleuc de A., 1983 – La représentation du chien à l’époque gallo-romaine, Thèse de 3e cycle en Ar-chéologie (Paris I-Sorbonne), 2 vol. de catalogue : 511 pages ; 1 vol. de commentaires : 156 pages ; 1 vol. d’iconographie : 170 p.
Lignereux Y. et al., 1991 – Typologie céphalique canine, Revue de Médecine Vétérinaire 142, 6, p. 469-480.
Méniel P., 1987 – Chasse et élevage chez les Gaulois, Editions Errance, 154 p.
Munro, Thrusfield, 2001 – Battered pets: non-accidental physical injuries found in dogs and cats, Journal of Small Animal Practice, 42, p. 279-290.
Newton, 1985 – Canine Epiphyseal Plate Closure in Days. In : Newton C., Nunamaker D. (Eds.) – Textbook of Small Animal Orthopaedics. J.B.Lippincott Company, Philadelphia, Appendix C, table C1. http://cal.vet.upenn.edu/projects/saortho/appendix_c/ct1.jpg
94
Ovide, 2001 - Les Métamorphoses, Le Livre de poche, 604 pages.
Pionnier-Capitan M., Bemilli C., Bodu P., Célérier G., Férrier J.-G, Fosse Ph., Garcia M. et Vigne J.-D., 2011 – New evidence for Upper Paleolithic domestic dogs in South-Western Europe. Journal of Archaeo-logical Science 238 (2011), p. 2123-2140.
Ruscillo D., 2006 – The Table Test: a Simple Method for Sexing Canid Humeri. In: Albarella U., Dobney K. and Rowley-Conwy P. – Recent Advances in Ageing and Sexing Animal Bones (Proceedings of the 9th Conference of the International Council of Archaeozoology, Durham, August 2002), Oxbow Books, 2006, p. 62-67.
Tong, 2013 – Fracture characteristics to distinguish between accidental injury and non-accidental injury in dogs, The Veterinary Journal. http://dx.doi.org/10.1016/j.tvjl.2013.08.019
Von Den Driesch, 1976 – A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin 1, Peabody Museum of Archeology and Ethnology, Harvard University, Massachusetts, 1976, 148 p.
Wilson, 1982 – Ageing and Sexing animal bones from archaeological sites. BAR, British Series 109, Oxford, 1982, 268 p.