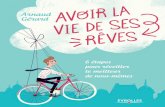"Etre orphelin au XVIIIe siècle : vie familiale et pérégrinations d’après quelques récits de...
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Etre orphelin au XVIIIe siècle : vie familiale et pérégrinations d’après quelques récits de...
1
Etre orphelin au XVIIIe siècle :
vie familiale et pérégrinations à partir de quelques récits de vie.
Isabelle Robin
UMR 8596/université Paris-Sorbonne
La présence d’un récit d’enfance est un élément constitutif important de
l’autobiographie selon Philippe Lejeune1. L’enfance, longtemps invisible ou à peine
évoquée chez de nombreux mémorialistes anciens, s’impose de plus en plus dans
les mémoires à la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle2 ; de la simple
mention d’une naissance et d’une place dans la lignée agrémentée, au mieux, d’un
développement à propos de la famille et de remarques sur l’éducation, on passe à
un récit plus circonstancié annonciateur d’un destin et surtout fondateur de la
personne, comme l’a inauguré Jean Jacques Rousseau dans ses Confessions3. Ces
détails sur l’enfance constituent désormais un début de récit de vie habituel. Ils ont
leur rôle dans la naissance d’une personnalité et expliquent en partie les voies
suivies à l’âge adulte. S’il grandit et grossit ce récit n’atteint toutefois pas souvent
l’introspection et ne restitue pas le point de vue de l’enfant. On parle de l’enfance,
de l’enfant, mais sans lui laisser vraiment la parole.
Loin des sources statistiques, les écrits privés nous font rencontrer des
orphelins. Ce sont des témoignages isolés, si peu nombreux que leurs particularités
sautent aux yeux bien souvent. Chaque témoignage vaut d’abord pour lui-même,
chacun rapporte un fragment de vie composé avec ses valeurs, sa propre
1 Philippe Lejeune, L’autobiographie en France, 1971, p. 38.
2 Emmanuèle Lesne, La poétique des Mémoires (1650-1685), Paris, Honoré Champion, 1996, p. 395 et
suivantes, consacre quelques pages éclairantes au récit d’enfance, et insiste sur les lieux communs et les récits
interchangeables qui sont produits dans les Mémoires de la seconde moitié du XVIIe siècle. 3 Jean-François Perrin, « Le récit d’enfance du 17
e siècle à Rousseau », XVIIIe siècle, n°30, 1998, p. 211-220.
2
reconstitution, son fantasme. On ne peut les comparer sans scrupules, ni même
généraliser, malgré la tentation qui est grande, mais, juxtaposés, ils dessinent les
contours de ce que peuvent vivre, ou attendre les hommes de ce temps4. Pour cela,
et parce qu’ils nous font accéder à l’intérieur des familles, ils sont irremplaçables.
Pour rapprocher autant que faire se peut leurs expériences, on a choisi des auteurs
hors de la noblesse. Les adultes, auteurs de ces récits cités ci-dessous, sont nés dans
des familles paysannes, ouvrières, ou bourgeoises pour quelques uns, et sont
devenus orphelins de père ou de mère durant leur enfance. La tradition de l’écriture
privée est plutôt aristocratique, encore au XVIIIe siècle. Cependant, certains
individus, aux parcours un peu exceptionnels, qui les éloignent géographiquement
et socialement de leur milieu d’origine à l’âge adulte, s’y risquent. Leur appréciation
sur l'importance de l'épisode varie considérablement. On ne peut manquer de noter
l’absence d’attention d’un certain Bocquillon. Tout occupé à justifier ses opinions
politiques, cet ingénieur des Ponts et Chaussées, ne juge pas opportun de raconter
quoi que ce soit sur le moment où il est devenu orphelin et sur les conséquences
engendrées par cet événement5. L’orientation professionnelle ou politique de
certains récits de vie élimine d’emblée tout ce qui se rapporte à la famille ou à la
formation du caractère. Pour autant, les orphelins ne connaissent pas dans leur vie
familiale le sort de tous. Comment rendent-ils compte de leur état ? Quelle
importance lui accordent-t-ils dans leur autobiographie ? Dans leur vie?
1. L’enfant et la mort
Les récits d’enfance rejoignent les enseignements de la démographie
historique en nous montrant des enfants devenus orphelins. Dans la confrontation
4 Le petit corpus rassemblé ici ne prétend pas arriver au point de saturation défini par les sociologues comme le
moment où le nombre des récits de vits est tel que le chercheur ne peut plus rien attendre que la répétition de ce
qu’il sait déjà en poursuivant sa quête. Daniel Bertaux, « L’approche biographique : sa validité méthodologique,
ses potentialités », Cahiers internationaux de sociologie, 1980, vol. LXIX, p.205-206. 5Augustin Pierre Fidel Armand Bocquillon, Ma profession de foi avec des réflexions des plus intéressantes,
Besançon, 1842, 22 p.
3
entre les sources, les écrits privés rendant compte chacun d’un exemple ne peuvent
qu’apporter ponctuellement des faits à titre de complément des sources sérielles des
registres paroissiaux. Les enfants orphelins sont nombreux dans la société pré-
industrielle. Toutefois ils ont rarement perdu leurs deux parents, ce n’est le cas que
de 10% des enfants parmi eux. Quant au risque de devenir orphelin, il tend à
augmenter avec l’âge. En Normandie du XVIIIe siècle, à cinq ans, il est de 100
pour 1000, à dix ans, de 186, et à quinze ans de 2746. Mais dans les âges les plus
jeunes, le risque de voir disparaître sa mère plutôt que son père est sensiblement
supérieur en raison de la surmortalité féminine à l’âge adulte.
L’irruption de la mort ne laisse pas toujours de traces particulières dans le
récit. Jacques Lablée, fils d’un marchand de vin de Beaugency, rapporte l’accident
qui causa la mort de sa mère. « Elle fit un faux pas, tomba, se blessa, se mit au lit et
mourut »7. Pour ce fils, aîné de trois garçons, mais âgé d’environ cinq ans à l’époque
des faits, aucune image ne subsiste de cet épisode tragique, ni de ses suites. Dans
cette famille durement touchée par la mort, comme beaucoup d’autres, le témoin
était peut être trop jeune pour en garder un souvenir bien vivant et éprouver le
besoin d’en dire plus. Etienne-François Girard, pour sa part, dresse laconiquement
le constat suivant : « Mes parents eurent huit enfants. Je suis le dernier. Ma mère
avait 48 ans lorsqu’elle me mit au monde. Elle mourut peu de temps après. Mon
père, inconsolable, la suivit bientôt. Nous n’étions plus alors que cinq enfants,
quatre garçons et une fille.» La sécheresse apparente de ces lignes tranche avec le
chagrin paternel et avec sa propre douleur ressentie et transcrite dans ses mémoires
à la mort de sa sœur aînée quelques années plus tard8. Nombre d’enfants orphelins,
qui n’ont pas connu leur mère trop tôt disparue, vivent dans des familles où l’on ne
semble pas non plus entretenir la mémoire de la défunte, à la différence de ce qui se
passe chez certains.
6 Ces probabilités ont été calculées à partir de la base de données Vernon et les villages alentours au XVIIIe
siècle du centre R. Mousnier développée par J.P. Bardet. L’échantillon retenu comprend 26 025 enfants issus
des premières unions entre 1700 et 1829. 7 Jacques Lablée (né vers 1750), Mémoires d’un homme de lettres, ouvrage anecdotique faisant suite aux
mémoires sur la Révolution française, 2e édition, paris, 1825, p. 1.
8 Les cahiers du colonel Etienne-François Girard, (né en 1766), publiés par P. Desachy, Paris, Plon, 1951, p. 2.
4
Jean Nicolas Barba, aussi orphelin de mère, mais à douze ans, écrit : « A
trente ans, quand on parlait d’elle, je la pleurais encore »9. La perte plus tardive
semble irréparable et a laissé un souvenir plus prégnant. Chez François Sugier,
originaire d’une famille de charpentier auvergnate, la scène d’adieux fait partie de
son récit. Cinq enfants entourent le lit de la mourante. Elle leur fait ses adieux, les
embrasse tout à tour. François analyse parfaitement ce vrai-faux souvenir : « j’étais
encore bien jeune quand le ciel me la prit, et pourtant, soit que le souvenir de sa
mort se soit gravé ce jour-là dans ma mémoire, soit qu’il s’y soit imprimé par les
récits qu’on m’en a faits, il me semble encore assister à cette scène de désolation »10.
Il reste peu de traces de la confrontation de ces enfants avec la mort. Nombre
d’entre eux ont pourtant certainement approché leur parent agonisant, à l’instar du
petit François Sugier. Non seulement cela pose la question du souvenir, des plus
anciens souvenirs, mais cela indique peut-être ce que ces auteurs ont voulu taire ou
oublier. Avec un père ou une mère disparu(e), la cellule familiale déstabilisée
cherche un nouvel équilibre en renforçant le rôle des aînés ou bien en remplaçant le
défunt.
2. En famille
Le rôle des aînés
Quand Marmontel père meurt, juste après les thèses de son aîné, le jeune
homme fait alors une déclaration aux siens : « Ma mère, mes frères, mes soeurs,
nous éprouvons, leur dis-je, la plus grande des afflictions, ne nous y laissons point
abattre. Mes enfants, vous perdez un père ; vous en retrouvez un, je vous en
servirai ; je le suis, je veux l’être ; j’en embrasse tous les devoirs ; et vous n’êtes plus
orphelins. » Cette décision l’oblige à trouver au plus vite un état pour subvenir aux
besoins de sa nombreuse famille. Les formules « mes enfants » ou « nos enfants »
9 Jean Nicolas Barba (né en 1769), Souvenirs, Paris, 1845, p. 2.
10 François Sugier, L’enfant de la cabane, graves et plaisants récits de son pèlerinage dans la vie, Paris, 1867,
p.31-34.
5
reviennent ensuite régulièrement sous sa plume.11 Le fils aîné s’attribue donc de
façon volontaire de nouvelles et lourdes responsabilités ; il a vocation à remplacer
le père aux côtés de sa mère. Dans la famille Girard, le fils aîné, âgé de 29 ans, est
également devenu le protecteur et le responsable de ses frères et sœurs, dont le plus
jeune -l’auteur- n’avait que 4 ans alors. Lors d’un conseil de famille élargi, présidé
par un cousin, qui avait été auparavant nommé tuteur des mineurs, la parenté a
décidé que toute la fratrie devait vivre en communauté dans la maison paternelle de
Chateaudun. Ils ont ainsi vécu tous ensemble de 1770 à 1777, partageant tant bien
que mal le travail et les soins domestiques entre eux. Toutefois, la charge était
particulièrement lourde pour le grand « qui devint triste et pensif »12.
En dehors des aînés, pas toujours assez âgés pour assumer leurs petits frères
et sœurs, les orphelins trouvent des substituts parentaux dans leur entourage. Le
jeune Jacques Lablée est ainsi accueilli très chaleureusement par la famille de la
gouvernante de la maison de son père. Il a vécu heureux avec eux, un peu à l’écart
de la bourgeoisie de la ville, à laquelle il appartenait par ses racines. Il voyait assez
peu son père, un homme déjà âgé –il avait plus de 60 ans au moment de son
mariage- mais doux et grave, qui craignait que les cris des enfants ne perturbent son
intérieur. Malgré tout, ceux-ci le regardaient avec vénération, mais à distance13.
François Sugier a trouvé, pendant toute son enfance, affection et secours auprès de
sa tante maternelle, Marguerite, venue s’installer chez son beau-frère après le décès
de la mère de famille14. S’il tait tout de ses relations avec son père, toujours vivant, il
encense la bienveillance et le dévouement de sa tante devenue sa « mère en
second ». Le modèle de la tante substitut maternel fait partie de ces figures
fréquemment rencontrées dans les récits. Souvent elles acquièrent un statut de
sainte femme se sacrifiant pour leurs neveux et nièces orphelins, qui de leur côté
11
Jean -François Marmontel (né en 1723), Mémoires adaptées à l’usage de la jeunesse, Paris, 1850, p. 50-57. 12
Les cahiers du colonel Etienne-François Girard, op.cit., p. 2-3. 13
Jacques Lablée, op. cit., p. 1-4. 14
François Sugier, op. cit.
6
viennent combler un vide affectif pour ces femmes restées célibataires ou devenues
veuves15.
Dans la famille recomposée
Le remariage du veuf ou de la veuve intervient dans un grand nombre de cas.
Les contes et bon nombre de fictions romanesques ou théâtrales du temps
véhiculent une image particulièrement noire de la famille recomposée en présentant
des marâtres et des parâtres, c’est-à-dire des parents dénaturés. Le vécu des
orphelins est plus nuancé, faisant entrer la variété et la complexité de la vie16. Les
relations de Jacques-Louis Ménetra avec sa belle-mère dénoncent la simplification
de cette tradition. Dans un premier temps de l’histoire de ma vie, il explique qu’il sait
bien qu’il n’était pas le bienvenu, qu’elle cherchait à l’écarter, mais lui, de son côté,
était au fond ravi de vivre avec sa bonne grand-mère, véritable mère de
substitution, qu’il appelle volontiers « ma mère »17. On apprend par ailleurs, que sa
belle-mère lui ouvrait la porte la nuit quand son père, en colère, le jetait dehors, et
qu’elle a été bonne avec lui dans son enfance. Son décès est pour lui l’occasion
d’une courte oraison funèbre où il reconnaît sincèrement ses mérites18. Plus
enthousiaste, Jacques Nicolas Bouilly commence ses Récapitulations par un hommage
appuyé à son beau-père dès les premières lignes : « Privé de mon père, avant d’avoir
reçu le jour, j’en avais retrouvé la tendresse et les soins dans le second mari de ma
mère. »19 Cet homme, fort justement prénommé Vincent-de-Paul, s’est montré bon
et attentif. Il a fait son éducation, il est devenu son guide et son bienfaiteur, c’est
pourquoi il voit en lui son père adoptif20.
15
Ce développement reprend les conclusions de Marion Trévisi dans sa thèse Oncles et tantes en France au
XVIIIe siècle: au cœur de la parenté, quelle présence, quels rôles ?, Paris IV, 2003, chapitre 9. 16
Pour un autre point de vue dans la famille voir Sylvie Perrier, « La marâtre dans la France d’Ancien Régime :
intégration ou marginalité ? », communication au colloque de la Société de démographie historique en janvier
2005, à paraître. 17
Jacques-Louis Ménetra compagnon vitrier au XVIIIe siècle (né en 1738), Journal de ma vie, édité par Daniel
Roche, Paris, Albin Michel, 1998 (première édition 1982), p. 30. 18
Idem, p. 37-38. 19
Jacques Nicolas Bouilly, Mes récapitulations, tome 1, Paris, 1836-1837, p. 1. 20
Idem, p. 35.
7
D'autres rendent compte des difficultés de leur vie dans une famille
recomposée à laquelle ils ont tenté d’échapper. Orphelin de mère à neuf ans,
Joachim Joseph Delmarche a voulu vivre avec son père et sa nouvelle femme : « Je
pensais retrouver la mère que j'avais perdu, mais quel fut mon étonnement d'y
trouver une mégère et une marâtre !... (c’est le nom que je puis donner à celle qui
tenait la place de ma mère...) Elle débuta par une grimace qui, tout jeune que j'étais,
me fit reculer dix pas en arrière. Je m’aperçus alors que je m'étais trompé, qu’il était
temps de revenir de mon erreur en retournant dans la maison de mes bons aïeuls
que je venais de quitter. »21 Echaudé par cette rencontre, le jeune Delmarche ne
témoigne plus ensuite d'aucune nouvelle tentative de retour sous le toit paternel.
Des récits rapportent des situations proches mais poussées à l’extrême où le parâtre
ou la marâtre, mal accepté, finit par rendre la vie des enfants du premier lit
impossible. Trois histoires proches de celles des contes en attestent. Valentin
Jamerey en dit très peu sur ces années avec son beau-père22. Mais il apparaît que les
enfants entretiennent, et surtout Valentin, les pires relations avec l’homme choisi
par leur mère après huit ans de veuvage. Le père de Jean Roch Coignet a été marié
trois fois ; Jean Roch est issu de la deuxième union23. En 1784, à huit ans, il eut le
« malheur de perdre cette mère chérie ». Son père, en troisièmes noces, épousa sa
servante qui lui donna sept nouveaux enfants. Cette belle-mère se révéla
immédiatement être une marâtre pour ses quatre beaux-enfants qui sont affamés et
battus continuellement ; une plainte auprès de leur père aggrava encore leur
situation. Françoise Perrot, enfin, apporte un autre regard sur des circonstances
assez proches24. Son père n’était pas riche, mais bon ouvrier. Grâce à la dot de sa
première épouse, Jeanne Loiselot, il avait quelques terres et des bêtes. Alors que
l'auteur avait trois ans, sa mère mourut de saisissement quand on lui annonça 21
Joachim Joseph Delmarche (né en 1786), Les soirées du grenadier français de la Grande Armée, Rocroy,
1849, p. 9. 22
Valentin Jamerey-Duval (né en 1695), Mémoires. Enfance et éducation d'un paysan au XVIIIe siècle, présenté
par Jean-Marie Goulemot, Paris, 1981. 23
Capitaine Jean-Roch Coignet (né en 1776), Les cahiers du Capitaines Coignet, (1789-1815), Paris, 1883,
XXXIX-494 p. ; p. 1. Son père a eu en tout treize enfants : deux, puis quatre puis sept. 24
Melle Françoise Perrot, dite Pauline (née avant 1789), Histoire de l'enfance de la petite paysanne et de la
barraque de son père racontée par elle-même ou Reconnaissance à Dieu qui a servi de père à l'orpheline
abandonnée, 2 tomes, Besançon, 1863.
8
l’assassinat du seigneur local. Françoise explique au cours de son récit les raisons du
remariage de son père : « resté veuf avec quatre petits enfants, dont le plus jeune
n'avait que quelques semaines, mon père se décida à contracter un second mariage.
De plus un train de labourage pesait sur ses épaules ; il ne pouvait donc guère se
dispenser de se remarier. »25 La situation est des plus banales pour cet homme,
mais, il choisit une personne sans fortune, prétendument couverte de mérites. Elle
était de plus étrangère au village ce qu'on ne manqua pas de lui reprocher. Pour les
enfants, ce n’était là qu'un moindre mal. Non seulement elle n’avait ni ordre ni
propreté, mais encore elle les maltraitait. Françoise raconte qu'un jour, cherchant à
calmer et réchauffer le petit dernier, elle fut battue injuriée et enfermée dans une
salle basse. Elle affirme dans ses mémoires que le bébé mourut de mauvais
traitements. La fillette, étant l’aînée, devint une petite « cendrillon » durement mise
à l’épreuve des tâches domestiques :
« Je courais au devant des volontés de ma belle-mère, sans me laisser
commander l'ouvrage que j'avais à faire. Je remplissais les seaux d'eau, je
récurais le bassin, les marmites, je lavais les drapeaux des enfants, je balayais.
Lorsque je demandais, en tremblant, à ma belle-mère si telle chose était bien
faite, je me trouvais trop heureuse quand elle ne me répondait pas des injures
ou qu'elle ne me rouait pas de coup de sabot. Je n'osais pas me placer près
du feu quand il faisait froid : le berceau, la belle mère et ses enfants étaient
autour, mon frère aîné et moi derrière eux, debout, prêts à leur donner ce
dont ils avaient besoin. Lorsqu'elle avait à nous donner du pain ou toute
autre chose, elle ne le donnait pas honnêtement de la main, mais elle le jetait
comme à un chien, et si, faute d'adresse ou de promptitude, je ne prenais pas
au vol ce qui m'étais destiné et le laissais tomber par terre, une insulte
m'arrivait avec ce commandement : Ramasse, toi. »26
Accumulant les récits des coups et des injures, elle oppose sans cesse sa
belle-mère à sa « vraie et bonne mère ». Le récit larmoyant et misérabiliste fait par
25
Idem, tome I, p. 8 et p. 55 26
Idem, tome I, p. 201-202.
9
Françoise Perrot ne doit pas cacher les réalités d’une situation insupportable. Les
remariages trop rapides ou mal avisés conduisent parfois à de telles situations dans
lesquelles les nouvelles épousées sont belles, mais peu attentives au bien-être des
membres de la famille. En lisant ces mémoires, on remarque aussi que le remariage
a annihilé toute la volonté ou la capacité de résistance des pères et mères de ces
orphelins. Valentin Jamerey écrit que sa mère n’avait trouvé qu’un « maître
impérieux » et non un mari. Les reproches faits aux nouveaux conjoints ne
changent rien à la situation. Françoise et Jean Roch essaient d’ailleurs en partie de
dédouaner leur père. Françoise le dit de façon flagrante quand elle raconte combien
son père les aimait : « Mon pauvre père pleurait amèrement en me relevant et en
voyant les meurtrissures dont j'étais couverte ; il se frappait la poitrine. Que je suis
donc malheureux! Allez, lui dit-il, allez-vous-en chez votre mère, dans votre village ;
laissez-moi avec mes enfants, et que je ne vous revoie plus ! » 27, lançait-il à sa
nouvelle épouse. Malgré ses menaces, il ne renvoya jamais celle-ci. D’autres
malheurs l’accablaient et il finit par être emprisonné pour dettes. Jean Roch
Coignet, qui laisse pointer son admiration pour son père dans son premier portrait
de lui, montre aussi un homme incapable de protéger ses enfants face à sa jeune
femme. Un sentiment d'isolement et peut-être d'abandon a pu saisir les orphelins ;
sans autre aide dans leur entourage, le reste de la parenté ne manifestant aucune
solidarité, le départ est devenu la seule issue.
3. En fuite
Les fugueurs
Le vagabondage des adolescents est un trait de moeurs. La tentation de la
fuite chez les plus jeunes est grande et les occasions nombreuses. La pauvreté, les
mauvaises fréquentations, la mort des parents ou leur départ, l'enfermement à
l'hôpital, enfin la mise en apprentissage loin de la famille provoquent des départs.
27
Idem, tome I, p. 69.
10
Les archives hospitalières livrent sans aucune difficulté des exemples nombreux de
ces jeunes gens en rupture de ban, parmi lesquels on retrouve au premier rang les
abandonnés et les orphelins. Ainsi parmi les enfants placés en métier par l'hôpital
de la Charité de Lyon, les évasions solitaires ou groupées sont fréquentes. Elles
peuvent représenter jusqu’à un quart dans le cas d’un petit groupe d’enfants
abandonnés28. Les orphelins légitimes secourus par l’assistance se conduisent de la
même façon et fuient s'ils le peuvent leur maître ou l'hôpital. En ce cas, ils
deviennent des vagabonds qui finissent à l'armée et pour beaucoup demeurent des
errants professionnels sur les routes et dans les rues. Ils sont insaisissables car
toujours en mouvement, en voyage, instables par définition. Ils échappent ainsi à
tous les contrôles familiaux et sociaux qui fournissent des repères si utiles à
l'historien. De plus, il est difficile de les saisir en tant qu'orphelins au sein de la
masse des vagabonds, mendiants et autres miséreux, où ils sont néanmoins très
nombreux29. Les trois récits de Valentin, Françoise et Jean-Roch nous montrent des
orphelins en cavale et abandonnés à eux-mêmes qui font un difficile apprentissage
de l’autonomie et de l’errance.
Valentin Jamerey prend la fuite seul et sans envisager de retour en arrière
possible. Ainsi, il refuse de dire son nom à un meunier charitable, et décide de
changer de nom pour se faire appeler Duval. Il souhaite au départ se rendre à Paris,
mais pendant son errance qui dure plusieurs années, il voyage en Bourgogne, en
région parisienne et enfin en Lorraine. Il fait un séjour à l’hôpital, mais se place
aussi comme berger ou domestique chez divers maîtres. C’est alors qu’il apprend à
lire puis à écrire. Sa rencontre avec le duc de Lorraine, en 1717, vient bouleverser
son existence. Il quitte alors la vie bucolique pour rejoindre la cour de Lorraine et
voyager en Europe. Dans la famille Coignet, on sait qu’aucun des quatre enfants du
second lit n’est resté à la maison. Jean et son frère aîné ont quitté le domicile
28
Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon. 1534-1789, Paris, Les
Belles Lettres, 1971, p. 123-128. 29
La littérature consacrée aux mendiants et gueux leur donne même une grande importance dans les bandes de
miséreux voire une fonction essentielle pour la mendicité, Bronislav Geremek, Les fils de Caïn, l’image des
pauvres dans la littérature européenne du XVe au XVIIIe siècle, Paris, 1980 , p. 214.
11
paternel en cachette et les deux plus jeunes ont été abandonnés en forêt par leur
marâtre30. Les deux fuyards ne se sont pas trop éloignés de leur point de départ et,
selon Jean, se sont arrêtés après seulement une heure de marche. On ne sait ce qu’a
fait son aîné alors, mais Jean a été engagé pour garder les moutons dans un village
des environs. Il y est resté une année, puis est devenu transporteur de bois pendant
trois ans à Menou. Il a alors franchi une frontière régionale passant de la
Bourgogne au Morvan. De retour dans son village, où personne ne le reconnaît
plus, il passe pour étranger puisqu'il est « morvandiau ». Se sentant du goût pour la
vie militaire, il est enchanté de partir, en l'an VII, à l'armée où il fait carrière. La
jeune Françoise et Richard, son frère cadet, se sont sauvés deux fois, la première
fois pendant une absence de leur père. La deuxième fois, alors qu’ils avaient été
retrouvés par leur cruelle belle-mère, ils se sont enfuis de nouveau sur le chemin du
retour à la maison. Livrés à eux-mêmes, ils ont rencontrés de bonnes âmes. Un
voisin, puis des bergers, un meunier, et même un de leurs oncles compatissant les
ont secourus successivement. Décidés à ne pas demander l'aumône, les enfants ont
cherché une place en allant de maison en maison pour trouver une place31. Leur
fuite n’avait rien de définitif pour eux car, au bout d’un certain temps, ils ont décidé
de repartir vers leur village de Guyonvelle pour s'assurer de la libération de leur
père. Celui-ci est toujours emprisonné, ils connaissent de nouveau des errements.
Le garçon est recueilli, pour la deuxième fois, par un curé. Quant à la fillette, elle
décide de rejoindre son père et de ne plus le quitter. A Besançon, où il s’est rendu
pour son procès, elle est reçue par charité dans une famille aisée de la ville. Elle
prépare alors sa communion et fréquente la classe d’un couvent. En sortant, elle
apprend à travailler en linge avec une ouvrière.
30
C’est ce que déclare Coignet lui-même. Il l’a appris de voisins bien après les événements. 31
« Jamais je n'ai oublié l'entretien que nous eûmes en passant dans ce bois, où, n'étant ni vus ni entendus de
personne, nous décidâmes comment il faudrait faire. Je ne veux pas, me dit Richard d'un ton résolu, demander
l'aumône, mon papa ni ma mère ne l'ont pas demandée. Ceux qui se portent bien et qui demandent l'aumône ne
sont que des fainéants, et moi je ne veux pas le faire. -Ni moi non plus, lui répondis-je. Je sens, ajouta-t-il en
s'arrêtant, qu'il m'est impossible de m'y résoudre. Nous demanderons de l'ouvrage à tous ceux que nous
verrons... » F. Perrot, op. cit., p. 235.
12
Nos trois orphelins et leurs frères se retrouvent sur les routes, sans but fixé
au départ, sinon qu'ils cherchent à s'éloigner au plus vite de leur domicile. On note
tout de même qu'il leur suffit de quelques heures de marche pour échapper aux
recherches. Aucun d'entre eux ne va très loin dans un premier temps. Ensuite, tous
essaient de trouver un engagement chez des particuliers pour survivre. La présence
de ces enfants, ils ont alors entre neuf (Françoise) et treize ans (Valentin)32, ne
semble pas incongrue aux gens qu'ils rencontrent et qui les prennent à leur service
ou leur proposent une aide circonstancielle. D'une façon générale, la circulation des
hommes et des enfants sur les chemins n'intrigue pas outre mesure, tout un chacun
voyage ainsi, à pied, et sans beaucoup de ressources ou de bagages. On leur pose
d'ailleurs peu de questions et les deux garçons, qui se gardent bien de raconter leur
histoire, réussissent leur évasion grâce à leur discrétion. Au contraire, le récit
circonstancié de leurs malheurs tout au long du chemin vaut à Françoise et son
frère d’être rattrapés par leur belle-mère une première fois.
Retour au pays
L’épisode du retour au village figure dans les trois récits, quoiqu’il n’ait pas
donné lieu à un traitement similaire par les auteurs. Valentin, Françoise et Jean sont
restés absents plusieurs années avant de faire une réapparition dans leur village.
Personne ne les reconnaît au premier abord. Ils ont grandi et souvent on les croit
morts. Si la fille se nomme immédiatement, les deux garçons affectent dans un
premier temps d’être des étrangers pour mieux se découvrir ensuite. Pour Valentin,
ce retour est un simple constat de son indifférence pour ses parents, son village, car
plus rien ne le rattache à ces gens qu’il quitte sans aucun regret33. Pour Jean
Coignet, le travail de deuil est plus ambigu et difficile34. Il pleure d’amertume, mais
ne cherche pas à se faire reconnaître tout de suite ni par son père ni par sa demi-
soeur à l'auberge de qui il déjeune. Il se place même chez cette dernière incognito
32
Coignet perd sa mère à huit ans, on ne sait combien de temps après il a décidé de partir sur les routes. 33
V. Jamerey-Duval, op.cit, p. 290-306. 34
J. Coignet, op. cit., p. 6-22.
13
comme garçon à tout faire. Quand il décide de la quitter pour une place chez deux
marchands de chevaux, il lui révèle son identité et dénonce son ingratitude : « Tu
ne sais donc pas que ton domestique est ton frère. -Par exemple ! -C'est comme
cela. Tu es une mauvaise soeur. Tu nous a laissés partir moi et mon frère, et mon
petit frère et ma petite soeur, mauvaise soeur que tu es. Te rappelles-tu que tu as
coûté trois cents francs à ma mère pour apprendre le métier de lingère chez Mme
Morin ? Tu n'as pas de coeur. Ma mère qui t'aimais comme nous, et nous avoir
laissé partir ! »35. Cette sortie provoque l’émotion générale, Jean, sa demi-soeur et
les témoins de la scène pleurent. Le jeune homme n'épargne pas non plus son père,
accouru au bruit de la scène, qu’il accuse publiquement. Sa vengeance accomplie, il
quitte définitivement l'endroit avec les deux marchands sous les cris et les adieux du
village. A l’inverse, la jeune Françoise à Guyonvelle est pleine de nostalgie et de
regrets dès son arrivée36 ; elle se rend par deux fois près de la fontaine où elle jouait
enfant pour pleurer sur son sort37.
Le souvenir et le récit
Quitter leur famille a infléchi la vie des trois auteurs. Comme Jean et
Valentin, Françoise fait du décès survenu dans sa famille le point de départ de son
récit : « Ce fut là le commencement de tous nos malheurs. Je me rappelle à peine
l'enterrement de ma bonne mère. »38 La suite de leur existence a dépendu, ils en
sont bien conscients de cet épisode tragique et de leur fuite de la maison familiale.
L’enfance, les actions des orphelins font partie intégrante du récit, et deviennent
une clef pour la compréhension de la vie, mais chacun n’y consacre pas la même
attention, ni même autant de pages.
Valentin, Jean et Françoise nous offrent trois récits échelonnés sur le siècle.
Françoise et Jean écrivent dans la première moitié du XIXe siècle, Valentin au
milieu du XVIIIe siècle. Plus le temps avance, plus le récit de l'enfance est empreint
35
Idem., p. 20-21. 36
F. Perrot, op. cit., tome II, p. 102-145. 37
Idem, tome II, p. 104-107 puis p. 116 et suiv. 38
Idem, tome I, p. 5.
14
de sentimentalisme et s'allonge au point que Françoise Perrot, devenue adulte, s'y
attarde même sur deux volumes. Elle multiplie les anecdotes larmoyantes sur le
temps précédant son départ, alors que Jamerey décrit sa situation en peu de lignes :
« J’éprouvay sous ce joug tyrannique toutes les noirceurs que les poëtes ont
attribués aux marâtres les plus dénaturées. Ma qualité d’enfant du premier lit a
manqué cent fois de me coûter la vie. Il est vray que les traitements inhumains
qu’on me faisoient souffrir m’otoient tout sujet de la regretter. C’est un vray miracle
que je n’aye pas succombé sous la violence de cette persécution et que ces effets ne
m’ayent pas rendu contrefait tant de corps que de l’esprit. Si j’avois à depeindrer
l’enfer, je n’aurois qu’à représenter les débats, la haine, le trouble, la confusion et les
imprécations qui regnoient dans cette déplorable famille. Je résolus de m’en
éloigner. »39 Il n’en dévoile pas plus et pourtant, il rend compte de circonstances
identiques à celles qui ont mené Françoise à s’échapper. Peu enclin aux
épanchements et aux récits inutiles pour comprendre son parcours, il ne manifeste
aucun attachement particulier pour sa mère, alors que Françoise ne cesse de clamer
son amour pour son père. Ses mémoires ne cachent pas ses origines, au contraire,
elles veulent montrer le chemin parcouru depuis Arthonnay. Cependant, Jamerey-
Duval en rend compte avec beaucoup de distanciation. Il narre ses aventures et se
tait par exemple à propos de ce qu’il advient à ces frères et sœurs.
A mi-chemin, Coignet narre sa vie familiale et quelques unes de ses aventures
de domestique, fait en passant le portrait de son père, amateur de chasse et de
femmes. Son récit, qui s’étale sur une vingtaine de pages, est attentif à la description
de son enfance d’orphelin. Sa famille existe véritablement, alors que dans les
mémoires de Valentin la parenté de l’orphelin est réduite à l’état de silhouettes
entraperçues, tout occupé qu’est l’auteur à parler de lui. Jean fait également état de
ses émotions, et en particulier lors de sa visite dans son village. Il arrive « le coeur
bien gros », et a plusieurs occasions de s’émouvoir et de pleurer sur son sort ou
celui de ses petits frère et soeur. Il s’efforce même de restituer ses débats d’enfant :
39
V. Jamerey-Duval, op.cit., p. 113.
15
« Je rentrai dans ma grange pour pleurer à mon aise, ne sachant pas ce que je devais
faire, si je rentrerais à la maison accabler mon père de reproches et tomber sur cette
furie de belle-mère qui était la cause de notre malheur. Je délibère dans ma petite
tête de ne pas faire de scandale, je prends ma bêche et vais au jardin travailler »40.
Adulte, il témoigne de son histoire personnelle avec sincérité dans un récit
circonstancié de ses actions en phrases très courtes et descriptives dans lequel sa
voix d’adulte n’interfère pas vraiment.
En revanche, la présence de Françoise Perrot et Valentin Jamerey adultes est
évidente dans leurs récits. Le style même adopté par Valentin atteste clairement de
l’homme érudit qu’il est devenu et contraste volontairement avec l’enfance rustre et
miséreuse qu’il évoque. Quant à Françoise Perrot, cet effort de distanciation lui est
impossible. Au contraire on sent qu’elle continue à vivre cette enfance. Sa nostalgie
la submerge régulièrement dans son récit et en écrivant. Son livre se termine sur
une dernière ( ?) visite à la fontaine de Guyonvelle qui montre son attachement
sentimental à ces lieux de son enfance et combien elle vit tournée vers ce temps.
Les deux hommes ont plus aisément coupé leurs liens avec leurs origines, leur
famille, leur village qui disparaissent de la suite du récit. Leur vie adulte a été bien
plus curieuse et mouvementée que celle de Françoise Perrot, couturière à domicile
dans des familles aisées. Pour elle, le récit de son enfance constitue entièrement ses
mémoires alors que Coignet et Duval évoquent des parcours personnels plus longs.
Leur enfance n’est que le point de départ d’un récit plus riche et plus complexe qui
est celui d’une ascension sociale reconnue et revendiquée.
Conclusion
L’enfance peut parfois dans les écrits personnels apparaître comme un temps
sans événements particuliers et sur lequel les auteurs s’accordent pour avoir peu à
dire. Pour les orphelins, cette période est marquée par la perte d’un des parents ou
40
J.R. Coignet, op. cit., p. 14.
16
des deux, par des changements que l’on suppose importants dans leur vie familiale
et pour leur devenir. Si la confrontation avec la mort a laissé peu de traces chez les
auteurs étudiés, la plupart rend compte de mutations dans la famille. Les rôles sont
en partie redistribués après la disparition du père ou de la mère, les grands frères et
sœurs peuvent gagner de nouvelles responsabilités, le veuf ou la veuve révéler ses
faiblesses. Le décès des parents modifie l’entourage familial de l’enfant qui trouve
dans les femmes de sa famille des substituts maternels, grand-mère, tante ou
domestique, ou bien qui doit établir de nouveaux liens avec une belle-mère, qui
n’est pas toujours une marâtre quoiqu’on en dise dans les contes. Toutefois, les vies
de certains petits orphelins nous rapprochent de ce récit modèle. Les trois
témoignages de Françoise, Valentin et Jean, devenus enfants errants, racontent des
histoires similaires. La fuite d’un foyer rendu détestable par un beau-père ou une
belle-mère les entraîne dans des péripéties dignes d’une narration selon eux. Il est
vrai que d’autres plus malchanceux ou plus misérables n’ont jamais eu le loisir
d’écrire quoi que ce soit. Mais, nos trois orphelins offrent de précieux témoignages
sur un pan de réalité difficilement accessible sans leur récit à la première personne.
Etre orphelin a constitué pour eux un apprentissage particulier de l’autonomie. En
fuite, ils ont du justement survivre, gagner leur vie et tenter de prendre de la
distance avec leurs attaches familiales, ce qui n’est pas si aisé pour la jeune
Françoise Perrot. L’écriture enfin est venue parachever ce travail pour Valentin
Jamerey et Jean Roch Coignet puisqu’elle a permis de rendre compte d’un temps
révolu et d’un parcours bien différent de celui promis au jeune orphelin pauvre
qu’ils avaient été.